Les temps modernes
Thumbnail
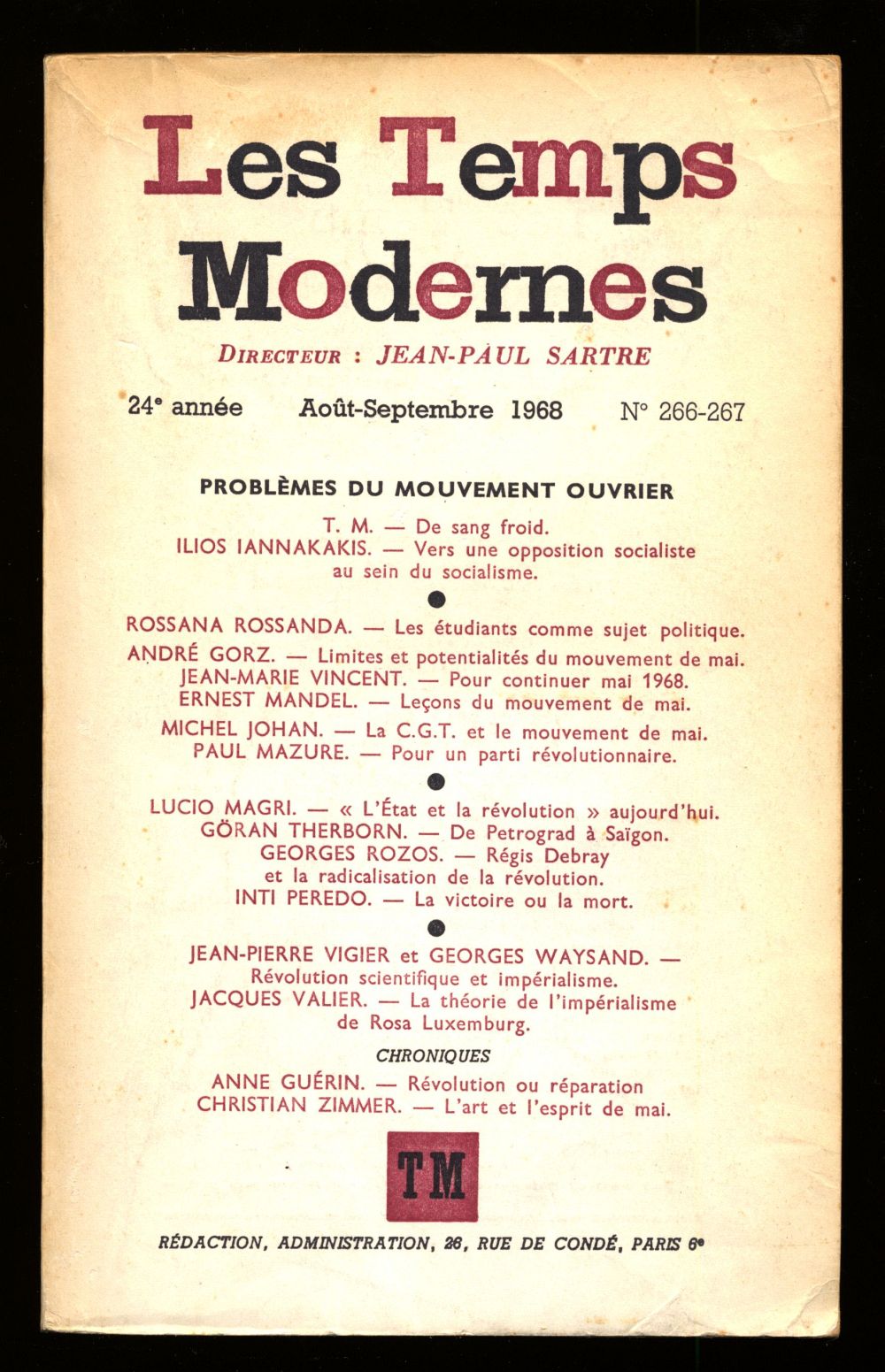

Les Temps
Modernes
Modernes
DIRECTEUR : JEAN-PAUL SARTRE
24e année Août-Septembre 1968 N° 266-267
24e année Août-Septembre 1968 N° 266-267
PROBLÈMES DU MOUVEMENT OUVRIER
T. M. — De sang froid.
ILIOS IANNAKAKIS. — Vers une opposition socialiste
au sein du socialisme.
au sein du socialisme.
ROSSANA ROSSANDA. — Les étudiants comme sujet politique.
ANDRE GORZ. — Limites et potentialités du mouvement de mai.
JEAN-MARIE VINCENT. — Pour continuer mai 1968.
ERNEST MANDEL. — Leçons du mouvement de mai.
JEAN-MARIE VINCENT. — Pour continuer mai 1968.
ERNEST MANDEL. — Leçons du mouvement de mai.
MICHEL JOHAN. — La C.G.T. et le mouvement de mai.
PAUL MAZURE. — Pour un parti révolutionnaire.
PAUL MAZURE. — Pour un parti révolutionnaire.
•
LUCIO MAGRI. — « L'État et la révolution » aujourd'hui.
GÔRAN THERBORN. — De Petrograd à Saïgon.
GEORGES ROZOS. — Régis Debray
et la radicalisation de la révolution.
INTI PEREDO. — La victoire ou la mort.
•
JEAN-PIERRE VICIER et GEORGES WAYSAND. —
JEAN-PIERRE VICIER et GEORGES WAYSAND. —
Révolution scientifique et impérialisme.
JACQUES VALIER. — La théorie de l'impérialisme
de Rosa Luxemburg.
CHRONIQUES
ANNE GUÉRIN. — Révolution ou réparation
CHRISTIAN ZIMMER. — L'art et l'esprit de mai.
CHRISTIAN ZIMMER. — L'art et l'esprit de mai.
RÉDACTION, ADMINISTRATION, 26, RUE DE CONDÉ, PARIS B»
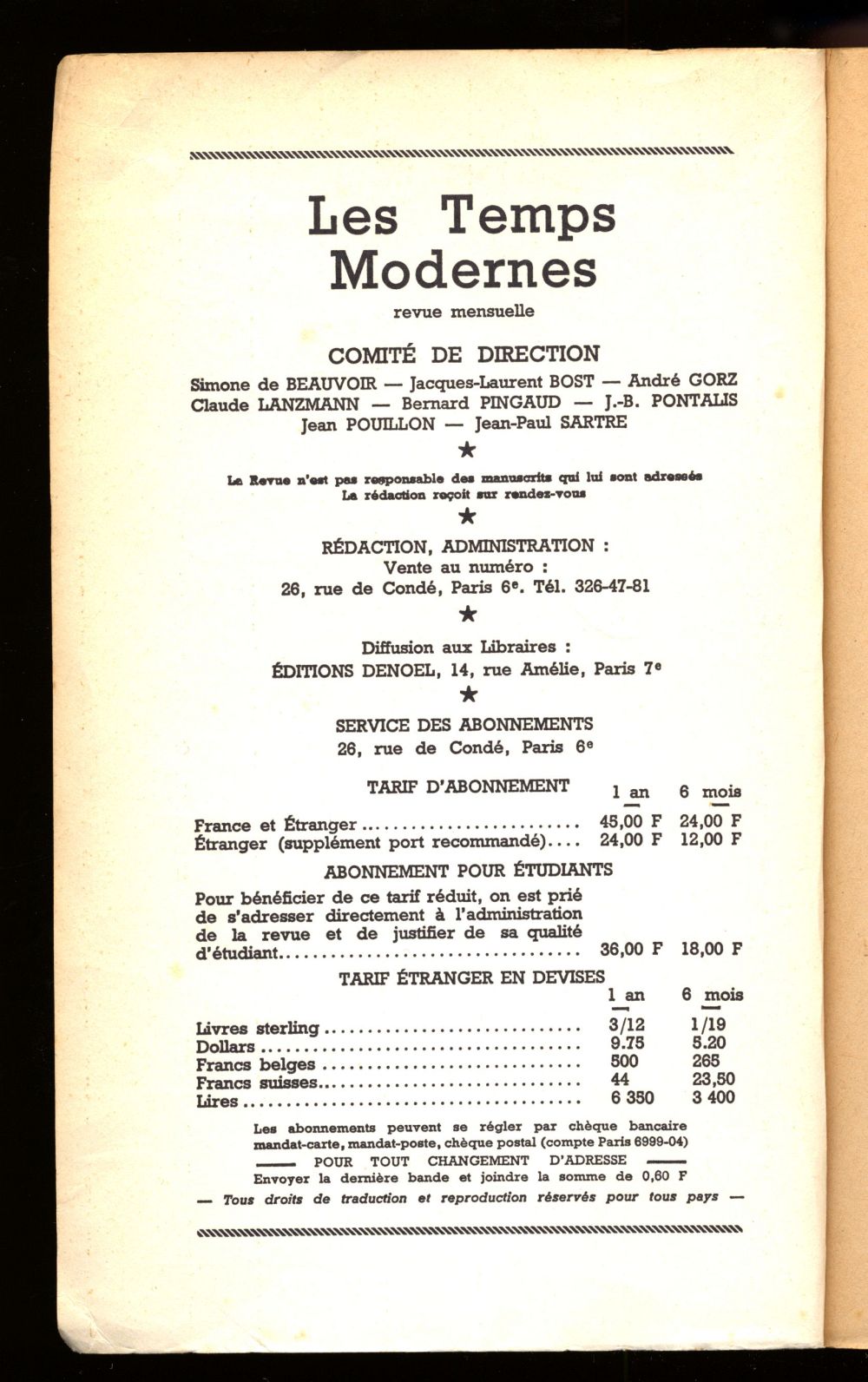

Les Temps
Modernes
Modernes
revue mensuelle
COMITÉ DE DIRECTION
Simone de BEAUVOIR — Jacques-Laurent BOST — André GORZ
Claude LANZMANN — Bernard PINGAUD — J.-B. PONTALIS
Jean POUILLON — Jean-Paul SARTRE
*
Le S«TOS n'a«t pai responsable de* manuioriu qui lui «ont adressé*
La rédaction reçoit «or wdaz-Totu
La rédaction reçoit «or wdaz-Totu
*
RÉDACTION, ADMINISTRATION :
Vente au numéro :
26, rue de Condé, Paris 6«. Tél. 326-47-81
26, rue de Condé, Paris 6«. Tél. 326-47-81
*
Diffusion sax Libraires :
ÉDITIONS DENOEL, 14, rue Amélie, Paris 7e
*
SERVICE DES ABONNEMENTS
26, rue de Condé, Paris 6e
26, rue de Condé, Paris 6e
TARIF D'ABONNEMENT ^
France et Étranger......................... 43,00 F 24,00 F
Étranger (supplément port recommandé).... 24,00 F 12,00 F
ABONNEMENT POUR ÉTUDIANTS
Pour bénéficier de ce tarif réduit, on est prié
de s'adresser directement à l'administration
de la revue et de justifier de sa qualité
d'étudiant.................................. 36,00F 18,00F
de s'adresser directement à l'administration
de la revue et de justifier de sa qualité
d'étudiant.................................. 36,00F 18,00F
TARIF ÉTRANGER EN DEVISES
1 an 6 mois
Livres sterling............................. 3/12 1/19
Dollars.................................... 9.7S S.20
Francs belges............................. 300 265
Francs suisses.............................. 44 23,30
Lires...................................... 6330 3400
Les abonnements peuvent se régler par chèque bancaire
mandat-carte, mandat-poste, chèque postal (compte Paris 3999-04)
mandat-carte, mandat-poste, chèque postal (compte Paris 3999-04)
, POUR TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE -------
Envoyer la dernière bande et joindre la somme de 0,60 F
— Tous droits de traduction et reproduction réservés pour fous pays —
— Tous droits de traduction et reproduction réservés pour fous pays —
XXXX>^X^
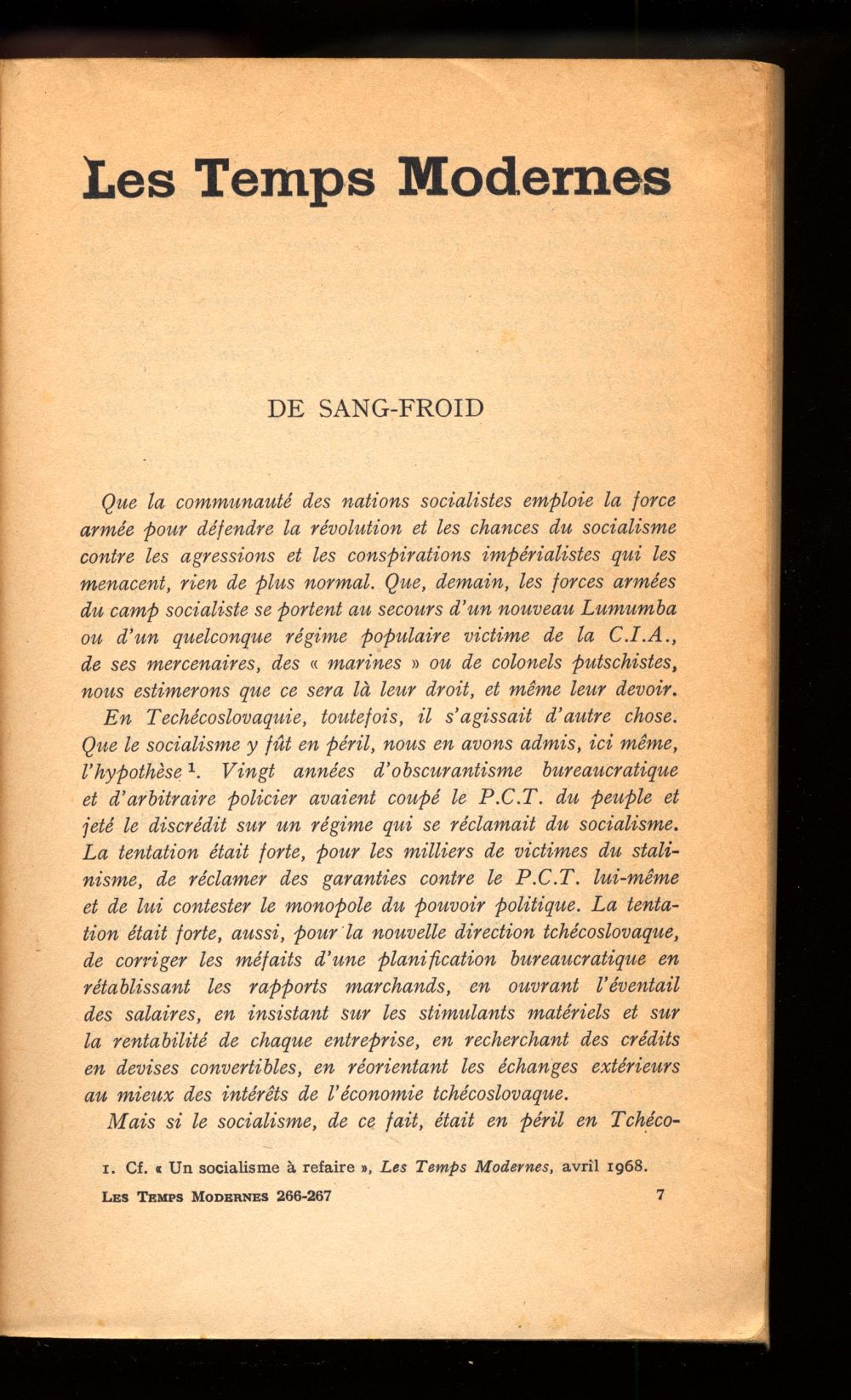

Les Temps Modernes
DE SANG-FROID
Que la communauté des nations socialistes emploie la force
armée pour défendre la révolution et les chances du socialisme
contre les agressions et les conspirations impérialistes qui les
menacent, rien de plus normal. Que, demain, les forces armées
du camp socialiste se portent au secours d'un nouveau Lumumba
ou d'un quelconque régime populaire victime de la C.I.A.,
de ses mercenaires, des « marines » ou de colonels putschistes,
nous estimerons que ce sera là leur droit, et même leur devoir.
armée pour défendre la révolution et les chances du socialisme
contre les agressions et les conspirations impérialistes qui les
menacent, rien de plus normal. Que, demain, les forces armées
du camp socialiste se portent au secours d'un nouveau Lumumba
ou d'un quelconque régime populaire victime de la C.I.A.,
de ses mercenaires, des « marines » ou de colonels putschistes,
nous estimerons que ce sera là leur droit, et même leur devoir.
En Techécoslovaqtiie, toutefois, il s'agissait d'autre chose.
Que le socialisme y fût en péril, nous en avons admis, ici même,
l'hypothèse1. Vingt années d'obscurantisme bureaucratique
et d'arbitraire policier avaient coupé le P.C.T. du peuple et
jeté le discrédit sur un régime qui se réclamait du socialisme.
La tentation était forte, pour les milliers de victimes du stali-
nisme, de réclamer des garanties contre le P.C.T. lui-même
et de lui contester le monopole du pouvoir politique. La tenta-
tion était forte, aussi, pour la nouvelle direction tchécoslovaque,
de corriger les méfaits d'une planification bureaucratique en
rétablissant les rapports marchands, en ouvrant l'éventail
des salaires, en insistant sur les stimulants matériels et sur
la rentabilité de chaque entreprise, en recherchant des crédits
en devises convertibles, en réorientant les échanges extérieurs
au mieux des intérêts de l'économie tchécoslovaque.
Que le socialisme y fût en péril, nous en avons admis, ici même,
l'hypothèse1. Vingt années d'obscurantisme bureaucratique
et d'arbitraire policier avaient coupé le P.C.T. du peuple et
jeté le discrédit sur un régime qui se réclamait du socialisme.
La tentation était forte, pour les milliers de victimes du stali-
nisme, de réclamer des garanties contre le P.C.T. lui-même
et de lui contester le monopole du pouvoir politique. La tenta-
tion était forte, aussi, pour la nouvelle direction tchécoslovaque,
de corriger les méfaits d'une planification bureaucratique en
rétablissant les rapports marchands, en ouvrant l'éventail
des salaires, en insistant sur les stimulants matériels et sur
la rentabilité de chaque entreprise, en recherchant des crédits
en devises convertibles, en réorientant les échanges extérieurs
au mieux des intérêts de l'économie tchécoslovaque.
Mais si le socialisme, de ce fait, était en péril en Tchéco-
i. Cf. « Un socialisme à refaire », Les Temps Modernes, avril 1968.
LES TEMPS MODERNES 266-267 7
LES TEMPS MODERNES 266-267 7
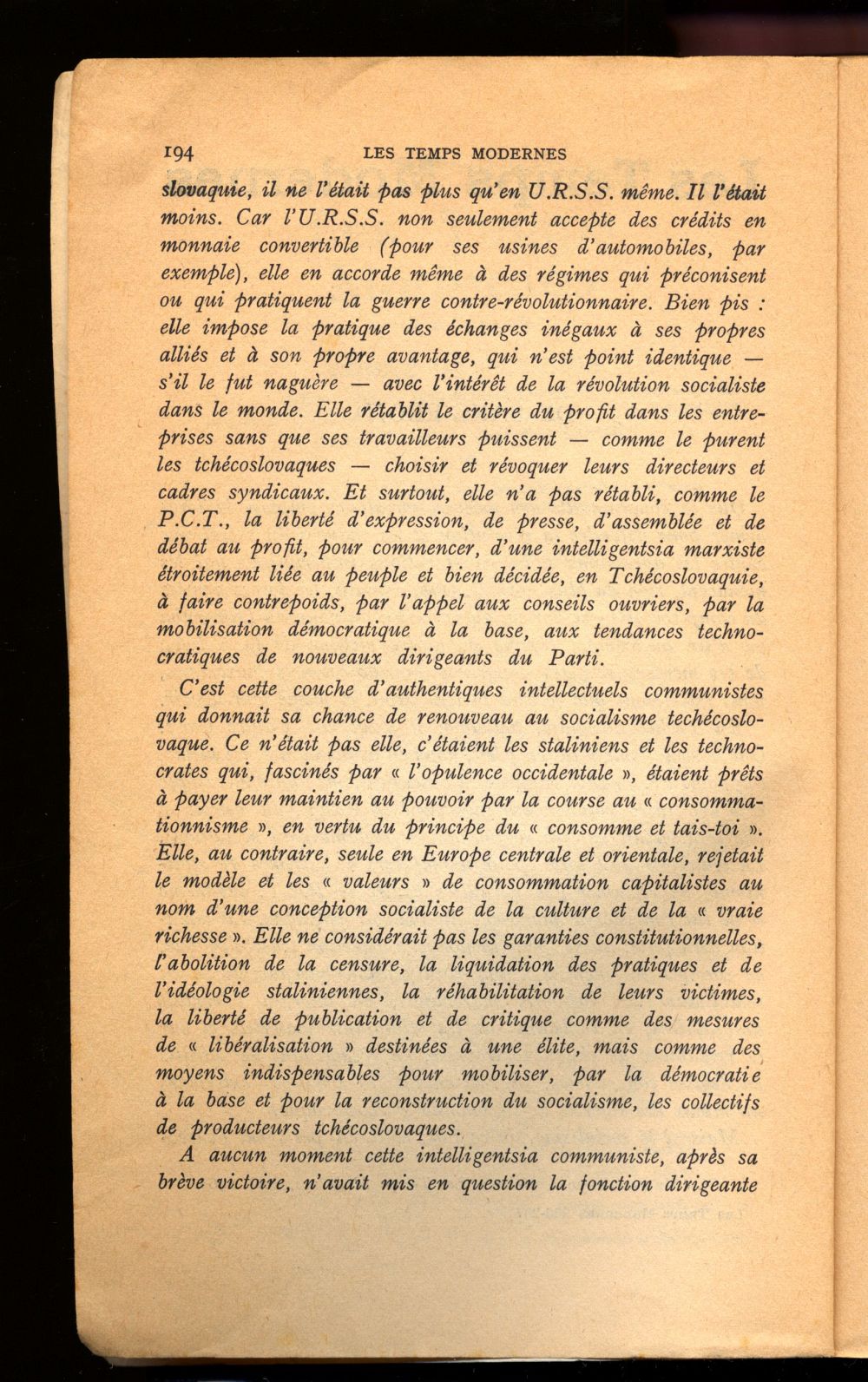

194
LES TEMPS MODERNES
Slovaquie, il ne l'était pas plus qu'en U.R.S.S. même. Il l'était
moins. Car l'U.R.S.S. non seulement accepte des crédits en
monnaie convertible (pour ses usines d'automobiles, par
exemple), elle en accorde même à des régimes qui préconisent
ou qui pratiquent la guerre contre-révolutionnaire. Bien pis :
elle impose la pratique des échanges inégaux à ses propres
alliés et à son propre avantage, qui n'est point identique —
s'il le fut naguère — avec l'intérêt de la révolution socialiste
dans le monde. Elle rétablit le critère du profit dans les entre-
prises sans que ses travailleurs puissent — comme le purent
les tchécoslovaques — choisir et révoquer leurs directeurs et
cadres syndicaux. Et surtout, elle n'a pas rétabli, comme le
P.C.T., la liberté d'expression, de presse, d'assemblée et de
débat au profit, pour commencer, d'une intelligentsia marxiste
étroitement liée au peuple et bien décidée, en Tchécoslovaquie,
à faire contrepoids, par l'appel aux conseils ouvriers, par la
mobilisation démocratique à la base, aux tendances techno-
cratiques de nouveaux dirigeants du Parti.
moins. Car l'U.R.S.S. non seulement accepte des crédits en
monnaie convertible (pour ses usines d'automobiles, par
exemple), elle en accorde même à des régimes qui préconisent
ou qui pratiquent la guerre contre-révolutionnaire. Bien pis :
elle impose la pratique des échanges inégaux à ses propres
alliés et à son propre avantage, qui n'est point identique —
s'il le fut naguère — avec l'intérêt de la révolution socialiste
dans le monde. Elle rétablit le critère du profit dans les entre-
prises sans que ses travailleurs puissent — comme le purent
les tchécoslovaques — choisir et révoquer leurs directeurs et
cadres syndicaux. Et surtout, elle n'a pas rétabli, comme le
P.C.T., la liberté d'expression, de presse, d'assemblée et de
débat au profit, pour commencer, d'une intelligentsia marxiste
étroitement liée au peuple et bien décidée, en Tchécoslovaquie,
à faire contrepoids, par l'appel aux conseils ouvriers, par la
mobilisation démocratique à la base, aux tendances techno-
cratiques de nouveaux dirigeants du Parti.
C'est cette couche d'authentiques intellectuels communistes
qui donnait sa chance de renouveau au socialisme techécoslo-
vaque. Ce n'était pas elle, c'étaient les staliniens et les techno-
crates qui, fascinés par « l'opulence occidentale », étaient prêts
à payer leur maintien au pouvoir par la course au « consomma-
tionnisme », en vertu du principe du « consomme et tais-toi ».
Elle, au contraire, seule en Europe centrale et orientale, rejetait
le modèle et les « valeurs » de consommation capitalistes au
nom d'une conception socialiste de la culture et de la « vraie
richesse ». Elle ne considérait pas les garanties constitutionnelles,
l'abolition de la censure, la liquidation des pratiques et de
l'idéologie staliniennes, la réhabilitation de leurs victimes,
la liberté de publication et de critique comme des mesures
de « libéralisation » destinées à une élite, mais comme des
moyens indispensables pour mobiliser, par la démocratie
à la base et pour la reconstruction du socialisme, les collectifs
de producteurs tchécoslovaques.
qui donnait sa chance de renouveau au socialisme techécoslo-
vaque. Ce n'était pas elle, c'étaient les staliniens et les techno-
crates qui, fascinés par « l'opulence occidentale », étaient prêts
à payer leur maintien au pouvoir par la course au « consomma-
tionnisme », en vertu du principe du « consomme et tais-toi ».
Elle, au contraire, seule en Europe centrale et orientale, rejetait
le modèle et les « valeurs » de consommation capitalistes au
nom d'une conception socialiste de la culture et de la « vraie
richesse ». Elle ne considérait pas les garanties constitutionnelles,
l'abolition de la censure, la liquidation des pratiques et de
l'idéologie staliniennes, la réhabilitation de leurs victimes,
la liberté de publication et de critique comme des mesures
de « libéralisation » destinées à une élite, mais comme des
moyens indispensables pour mobiliser, par la démocratie
à la base et pour la reconstruction du socialisme, les collectifs
de producteurs tchécoslovaques.
A aucun moment cette intelligentsia communiste, après sa
brève victoire, n'avait mis en question la fonction dirigeante
brève victoire, n'avait mis en question la fonction dirigeante
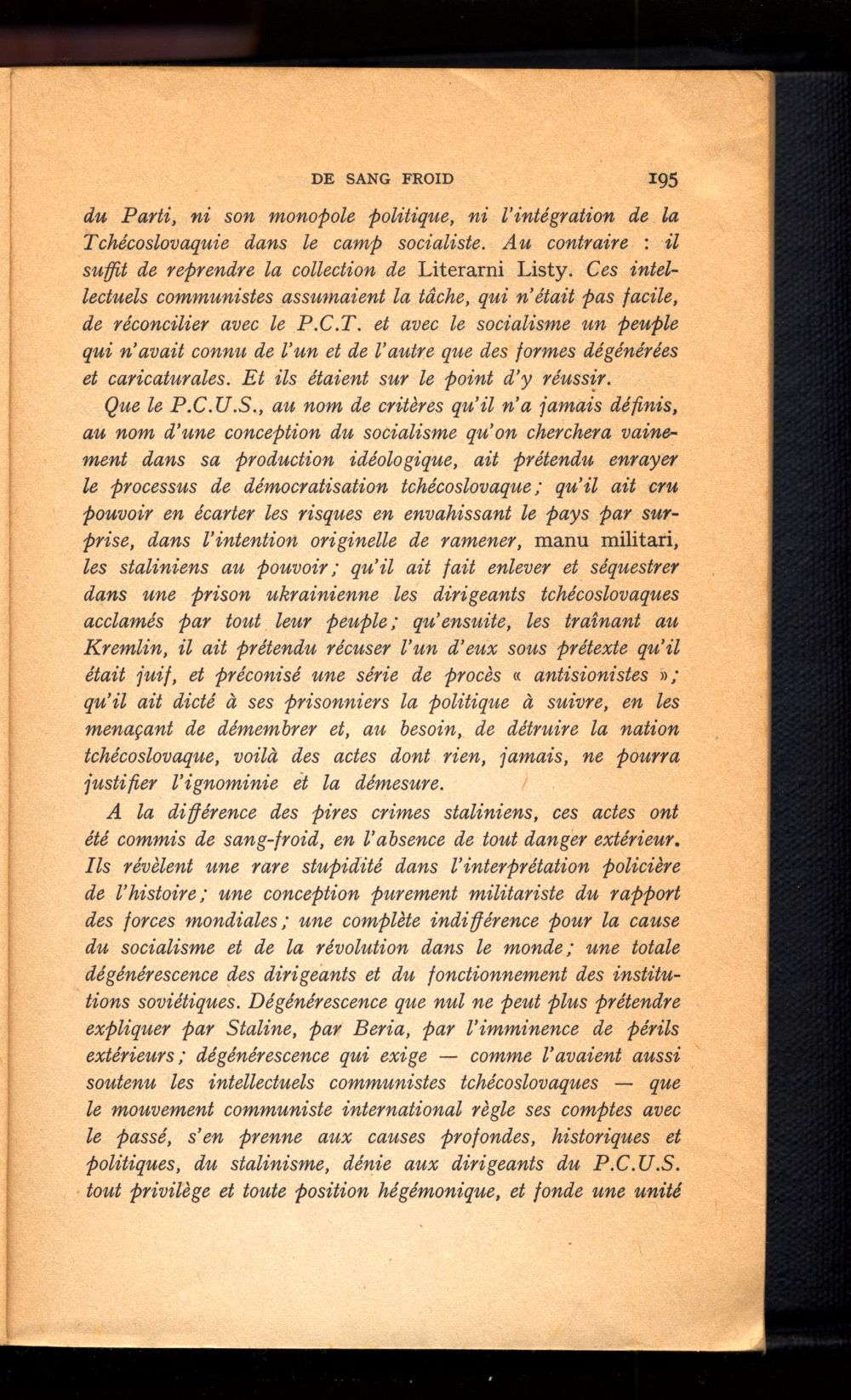

DE SANG FROID 195
du Parti, ni son monopole politique, ni l'intégration de la
Tchécoslovaquie dans le camp socialiste. Au contraire : il
suffit de reprendre la collection de Literarni Listy. Ces intel-
lectuels communistes assumaient la tâche, qui n'était pas facile,
de réconcilier avec le P.C.T. et avec le socialisme un peuple
qui n'avait connu de l'un et de l'autre que des formes dégénérées
et caricaturales. Et ils étaient sur le point d'y réussir.
Tchécoslovaquie dans le camp socialiste. Au contraire : il
suffit de reprendre la collection de Literarni Listy. Ces intel-
lectuels communistes assumaient la tâche, qui n'était pas facile,
de réconcilier avec le P.C.T. et avec le socialisme un peuple
qui n'avait connu de l'un et de l'autre que des formes dégénérées
et caricaturales. Et ils étaient sur le point d'y réussir.
Que le P.C.U.S., au nom de critères qu'il n'a jamais définis,
au nom d'une conception du socialisme qu'on cherchera vaine-
ment dans sa production idéologique, ait prétendu enrayer
le processus de démocratisation tchécoslovaque; qu'il ait cru
pouvoir en écarter les risques en envahissant le pays par sur-
prise, dans l'intention originelle de ramener, manu militari,
les staliniens au pouvoir; qu'il ait fait enlever et séquestrer
dans une prison ukrainienne les dirigeants tchécoslovaques
acclamés par tout leur peuple; qu'ensuite, les traînant au
Kremlin, il ait prétendu récuser l'un d'eux sous prétexte qu'il
était juif, et préconisé une série de procès « antisionistes »;
qu'il ait dicté à ses prisonniers la politique à suivre, en les
menaçant de démembrer et, au besoin, de détruire la nation
tchécoslovaque, voilà des actes dont rien, jamais, ne pourra
justifier l'ignominie et la démesure.
au nom d'une conception du socialisme qu'on cherchera vaine-
ment dans sa production idéologique, ait prétendu enrayer
le processus de démocratisation tchécoslovaque; qu'il ait cru
pouvoir en écarter les risques en envahissant le pays par sur-
prise, dans l'intention originelle de ramener, manu militari,
les staliniens au pouvoir; qu'il ait fait enlever et séquestrer
dans une prison ukrainienne les dirigeants tchécoslovaques
acclamés par tout leur peuple; qu'ensuite, les traînant au
Kremlin, il ait prétendu récuser l'un d'eux sous prétexte qu'il
était juif, et préconisé une série de procès « antisionistes »;
qu'il ait dicté à ses prisonniers la politique à suivre, en les
menaçant de démembrer et, au besoin, de détruire la nation
tchécoslovaque, voilà des actes dont rien, jamais, ne pourra
justifier l'ignominie et la démesure.
A la différence des pires crimes staliniens, ces actes ont
été commis de sang-froid, en l'absence de tout danger extérieur.
Ils révèlent une rare stupidité dans l'interprétation policière
de l'histoire; une conception purement militariste du rapport
des forces mondiales; une complète indifférence pour la cause
du socialisme et de la révolution dans le monde; une totale
dégénérescence des dirigeants et du fonctionnement des institu-
tions soviétiques. Dégénérescence que nul ne peut plus prétendre
expliquer par Staline, par Beria, par l'imminence de périls
extérieurs; dégénérescence qui exige — comme l'avaient aussi
soutenu les intellectuels communistes tchécoslovaques — que
le mouvement communiste international règle ses comptes avec
le passé, s'en prenne aux causes profondes, historiques et
politiques, du stalinisme, dénie aux dirigeants du P.C.U.S.
tout privilège et toute position hégémonique, et fonde une unité
été commis de sang-froid, en l'absence de tout danger extérieur.
Ils révèlent une rare stupidité dans l'interprétation policière
de l'histoire; une conception purement militariste du rapport
des forces mondiales; une complète indifférence pour la cause
du socialisme et de la révolution dans le monde; une totale
dégénérescence des dirigeants et du fonctionnement des institu-
tions soviétiques. Dégénérescence que nul ne peut plus prétendre
expliquer par Staline, par Beria, par l'imminence de périls
extérieurs; dégénérescence qui exige — comme l'avaient aussi
soutenu les intellectuels communistes tchécoslovaques — que
le mouvement communiste international règle ses comptes avec
le passé, s'en prenne aux causes profondes, historiques et
politiques, du stalinisme, dénie aux dirigeants du P.C.U.S.
tout privilège et toute position hégémonique, et fonde une unité
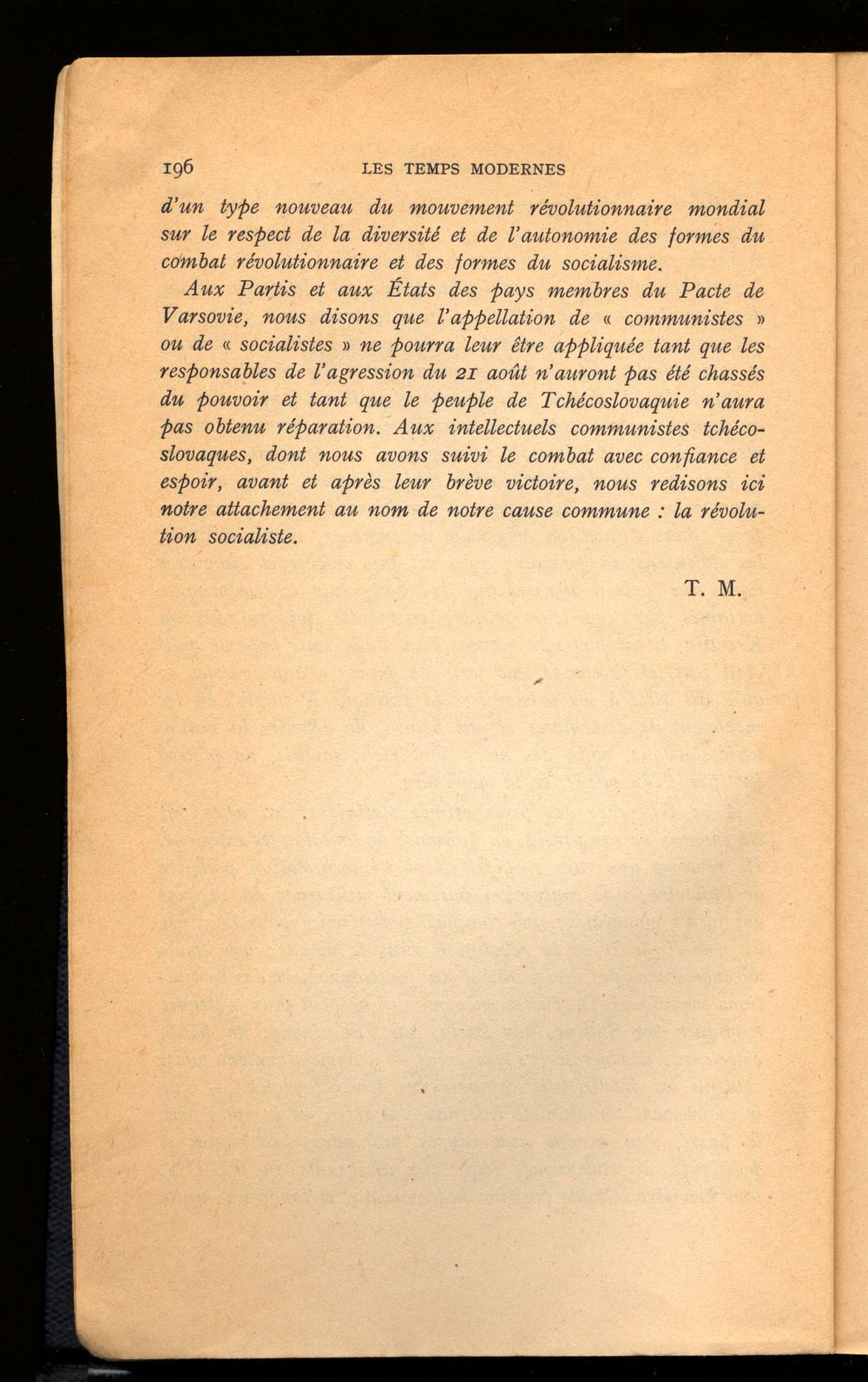

196 LES TEMPS MODERNES
d'un type nouveau du mouvement révolutionnaire mondial
sur le respect de la diversité et de l'autonomie des formes du
combat révolutionnaire et des formes du socialisme.
sur le respect de la diversité et de l'autonomie des formes du
combat révolutionnaire et des formes du socialisme.
Aux Partis et aux États des pays membres du Pacte de
Varsovie, nous disons que l'appellation de « communistes »
ou de « socialistes » ne pourra leur être appliquée tant que les
responsables de l'agression du 21 août n'auront pas été chassés
du pouvoir et tant que le peuple de Tchécoslovaquie n'aura
pas obtenu réparation. Aux intellectuels communistes tchéco-
slovaques, dont nous avons suivi le combat avec confiance et
espoir, avant et après leur brève victoire, nous redisons ici
notre attachement au nom de notre cause commune : la révolu-
tion socialiste.
Varsovie, nous disons que l'appellation de « communistes »
ou de « socialistes » ne pourra leur être appliquée tant que les
responsables de l'agression du 21 août n'auront pas été chassés
du pouvoir et tant que le peuple de Tchécoslovaquie n'aura
pas obtenu réparation. Aux intellectuels communistes tchéco-
slovaques, dont nous avons suivi le combat avec confiance et
espoir, avant et après leur brève victoire, nous redisons ici
notre attachement au nom de notre cause commune : la révolu-
tion socialiste.
T. M.
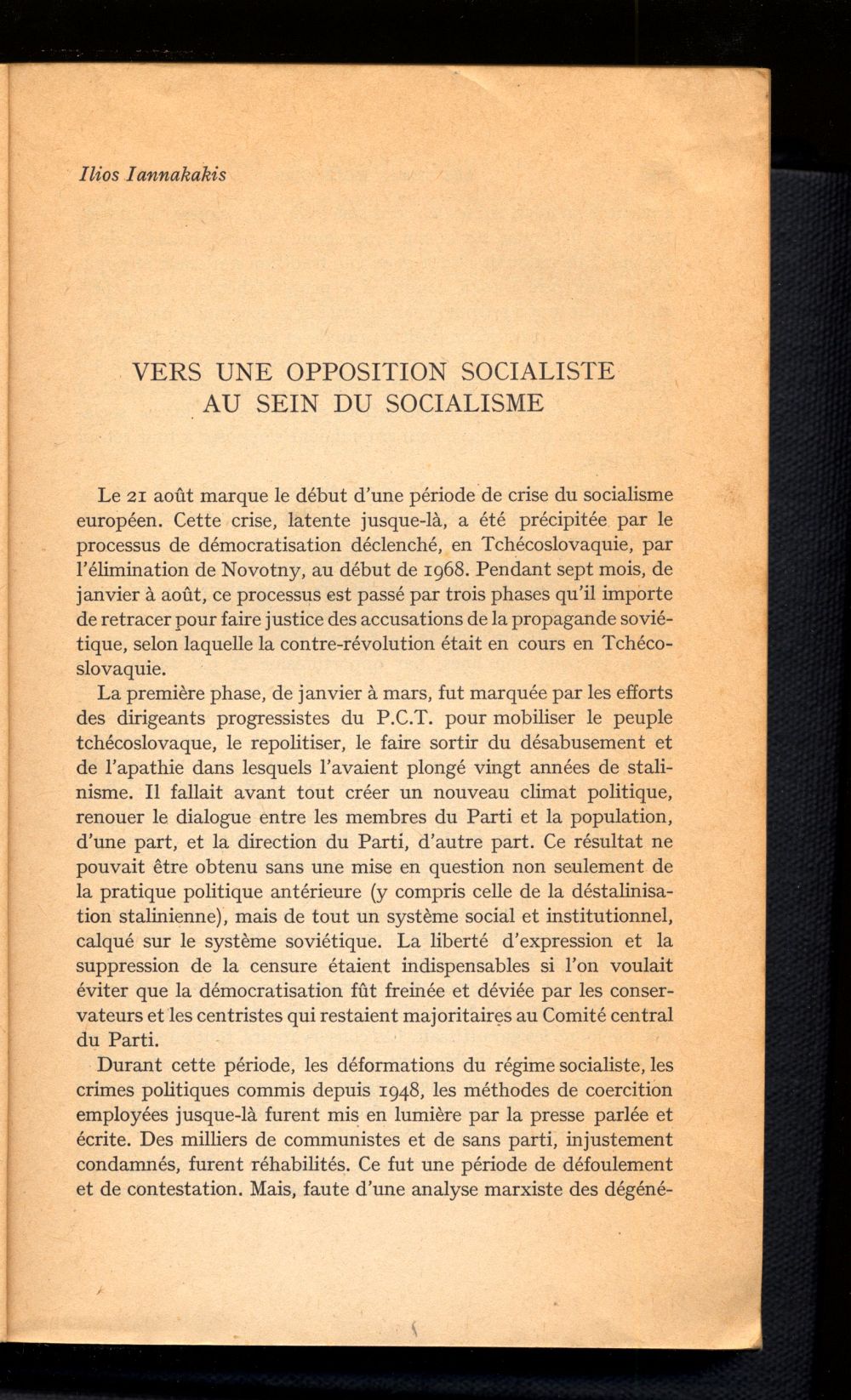

Itios lannakakis
VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE
AU SEIN DU SOCIALISME
AU SEIN DU SOCIALISME
Le 2i août marque le début d'une période de crise du socialisme
européen. Cette crise, latente jusque-là, a été précipitée par le
processus de démocratisation déclenché, en Tchécoslovaquie, par
l'élimination de Novotny, au début de 1968. Pendant sept mois, de
janvier à août, ce processus est passé par trois phases qu'il importe
de retracer pour faire justice des accusations de la propagande sovié-
tique, selon laquelle la contre-révolution était en cours en Tchéco-
slovaquie.
européen. Cette crise, latente jusque-là, a été précipitée par le
processus de démocratisation déclenché, en Tchécoslovaquie, par
l'élimination de Novotny, au début de 1968. Pendant sept mois, de
janvier à août, ce processus est passé par trois phases qu'il importe
de retracer pour faire justice des accusations de la propagande sovié-
tique, selon laquelle la contre-révolution était en cours en Tchéco-
slovaquie.
La première phase, de janvier à mars, fut marquée par les efforts
des dirigeants progressistes du P.C.T. pour mobiliser le peuple
tchécoslovaque, le repolitiser, le faire sortir du désabusement et
de l'apathie dans lesquels l'avaient plongé vingt années de stali-
nisme. Il fallait avant tout créer un nouveau climat politique,
renouer le dialogue entre les membres du Parti et la population,
d'une part, et la direction du Parti, d'autre part. Ce résultat ne
pouvait être obtenu sans une mise en question non seulement de
la pratique politique antérieure (y compris celle de la déstalinisa-
tion stalinienne), mais de tout un système social et institutionnel,
calqué sur le système soviétique. La liberté d'expression et la
suppression de la censure étaient indispensables si l'on voulait
éviter que la démocratisation fût freinée et déviée par les conser-
vateurs et les centristes qui restaient majoritaires au Comité central
du Parti.
des dirigeants progressistes du P.C.T. pour mobiliser le peuple
tchécoslovaque, le repolitiser, le faire sortir du désabusement et
de l'apathie dans lesquels l'avaient plongé vingt années de stali-
nisme. Il fallait avant tout créer un nouveau climat politique,
renouer le dialogue entre les membres du Parti et la population,
d'une part, et la direction du Parti, d'autre part. Ce résultat ne
pouvait être obtenu sans une mise en question non seulement de
la pratique politique antérieure (y compris celle de la déstalinisa-
tion stalinienne), mais de tout un système social et institutionnel,
calqué sur le système soviétique. La liberté d'expression et la
suppression de la censure étaient indispensables si l'on voulait
éviter que la démocratisation fût freinée et déviée par les conser-
vateurs et les centristes qui restaient majoritaires au Comité central
du Parti.
Durant cette période, les déformations du régime socialiste, les
crimes politiques commis depuis 1948, les méthodes de coercition
employées jusque-là furent mis en lumière par la presse parlée et
écrite. Des milliers de communistes et de sans parti, injustement
condamnés, furent réhabilités. Ce fut une période de défoulement
et de contestation. Mais, faute d'une analyse marxiste des dégéné-
crimes politiques commis depuis 1948, les méthodes de coercition
employées jusque-là furent mis en lumière par la presse parlée et
écrite. Des milliers de communistes et de sans parti, injustement
condamnés, furent réhabilités. Ce fut une période de défoulement
et de contestation. Mais, faute d'une analyse marxiste des dégéné-
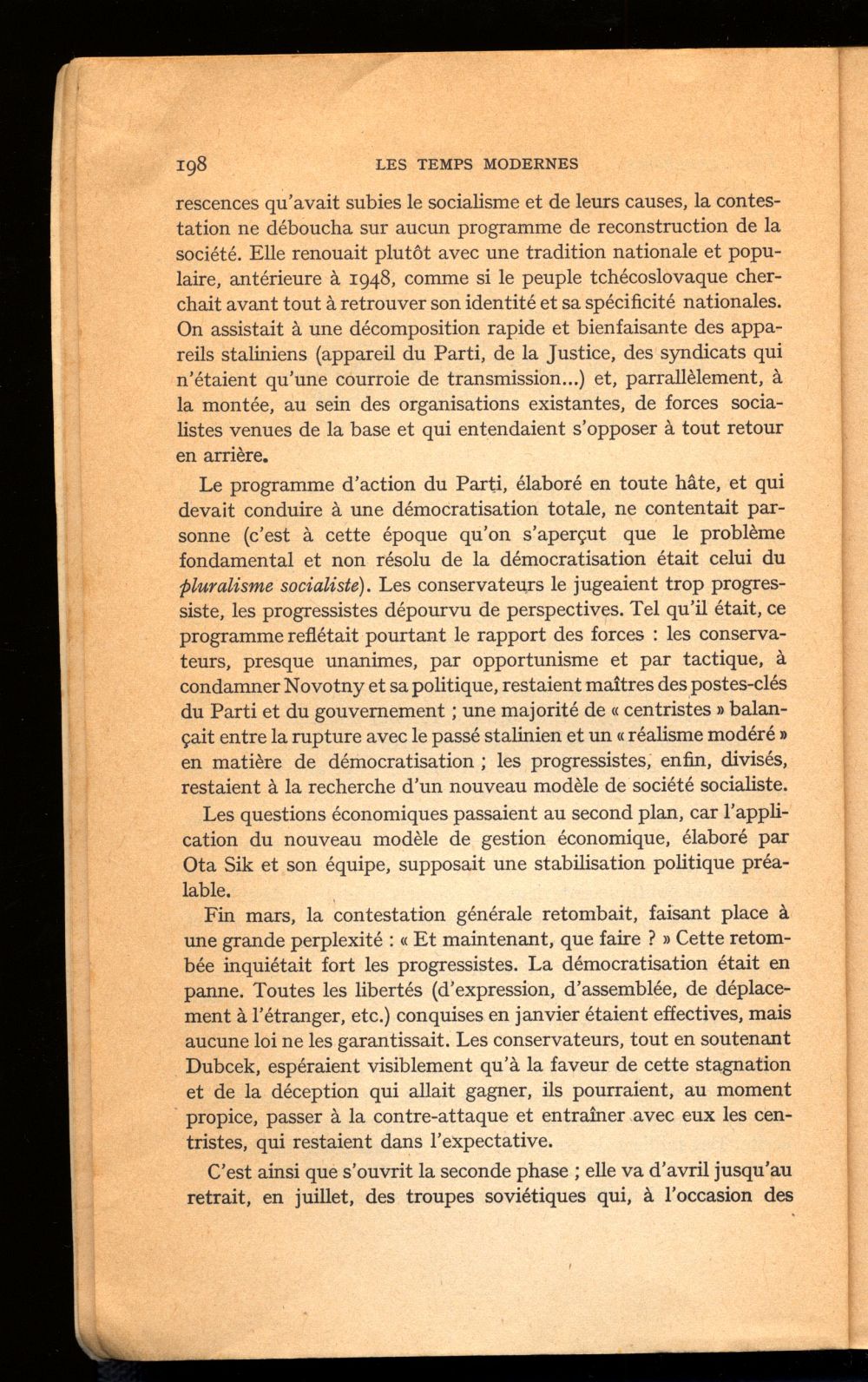

198 LES TEMPS MODERNES
rescences qu'avait subies le socialisme et de leurs causes, la contes-
tation ne déboucha sur aucun programme de reconstruction de la
société. Elle renouait plutôt avec une tradition nationale et popu-
laire, antérieure à 1948, comme si le peuple tchécoslovaque cher-
chait avant tout à retrouver son identité et sa spécificité nationales.
On assistait à une décomposition rapide et bienfaisante des appa-
reils staliniens (appareil du Parti, de la Justice, des syndicats qui
n'étaient qu'une courroie de transmission...) et, parrallèlement, à
la montée, au sein des organisations existantes, de forces socia-
listes venues de la base et qui entendaient s'opposer à tout retour
en arrière.
tation ne déboucha sur aucun programme de reconstruction de la
société. Elle renouait plutôt avec une tradition nationale et popu-
laire, antérieure à 1948, comme si le peuple tchécoslovaque cher-
chait avant tout à retrouver son identité et sa spécificité nationales.
On assistait à une décomposition rapide et bienfaisante des appa-
reils staliniens (appareil du Parti, de la Justice, des syndicats qui
n'étaient qu'une courroie de transmission...) et, parrallèlement, à
la montée, au sein des organisations existantes, de forces socia-
listes venues de la base et qui entendaient s'opposer à tout retour
en arrière.
Le programme d'action du Parti, élaboré en toute hâte, et qui
devait conduire à une démocratisation totale, ne contentait par-
sonné (c'est à cette époque qu'on s'aperçut que le problème
fondamental et non résolu de la démocratisation était celui du
pluralisme socialiste). Les conservateurs le jugeaient trop progres-
siste, les progressistes dépourvu de perspectives. Tel qu'il était, ce
programme reflétait pourtant le rapport des forces : les conserva-
teurs, presque unanimes, par opportunisme et par tactique, à
condamner Novotny et sa politique, restaient maîtres des postes-clés
du Parti et du gouvernement ; une majorité de « centristes » balan-
çait entre la rupture avec le passé stalinien et un « réalisme modéré »
en matière de démocratisation ; les progressistes, enfin, divisés,
restaient à la recherche d'un nouveau modèle de société socialiste.
devait conduire à une démocratisation totale, ne contentait par-
sonné (c'est à cette époque qu'on s'aperçut que le problème
fondamental et non résolu de la démocratisation était celui du
pluralisme socialiste). Les conservateurs le jugeaient trop progres-
siste, les progressistes dépourvu de perspectives. Tel qu'il était, ce
programme reflétait pourtant le rapport des forces : les conserva-
teurs, presque unanimes, par opportunisme et par tactique, à
condamner Novotny et sa politique, restaient maîtres des postes-clés
du Parti et du gouvernement ; une majorité de « centristes » balan-
çait entre la rupture avec le passé stalinien et un « réalisme modéré »
en matière de démocratisation ; les progressistes, enfin, divisés,
restaient à la recherche d'un nouveau modèle de société socialiste.
Les questions économiques passaient au second plan, car l'appli-
cation du nouveau modèle de gestion économique, élaboré par
Ota Sik et son équipe, supposait une stabilisation politique préa-
lable.
cation du nouveau modèle de gestion économique, élaboré par
Ota Sik et son équipe, supposait une stabilisation politique préa-
lable.
Fin mars, la contestation générale retombait, faisant place à
une grande perplexité : « Et maintenant, que faire ? » Cette retom-
bée inquiétait fort les progressistes. La démocratisation était en
panne. Toutes les libertés (d'expression, d'assemblée, de déplace-
ment à l'étranger, etc.) conquises en janvier étaient effectives, mais
aucune loi ne les garantissait. Les conservateurs, tout en soutenant
Dubcek, espéraient visiblement qu'à la faveur de cette stagnation
et de la déception qui allait gagner, ils pourraient, au moment
propice, passer à la contre-attaque et entraîner avec eux les cen-
tristes, qui restaient dans l'expectative.
une grande perplexité : « Et maintenant, que faire ? » Cette retom-
bée inquiétait fort les progressistes. La démocratisation était en
panne. Toutes les libertés (d'expression, d'assemblée, de déplace-
ment à l'étranger, etc.) conquises en janvier étaient effectives, mais
aucune loi ne les garantissait. Les conservateurs, tout en soutenant
Dubcek, espéraient visiblement qu'à la faveur de cette stagnation
et de la déception qui allait gagner, ils pourraient, au moment
propice, passer à la contre-attaque et entraîner avec eux les cen-
tristes, qui restaient dans l'expectative.
C'est ainsi que s'ouvrit la seconde phase ; elle va d'avril jusqu'au
retrait, en juillet, des troupes soviétiques qui, à l'occasion des
retrait, en juillet, des troupes soviétiques qui, à l'occasion des
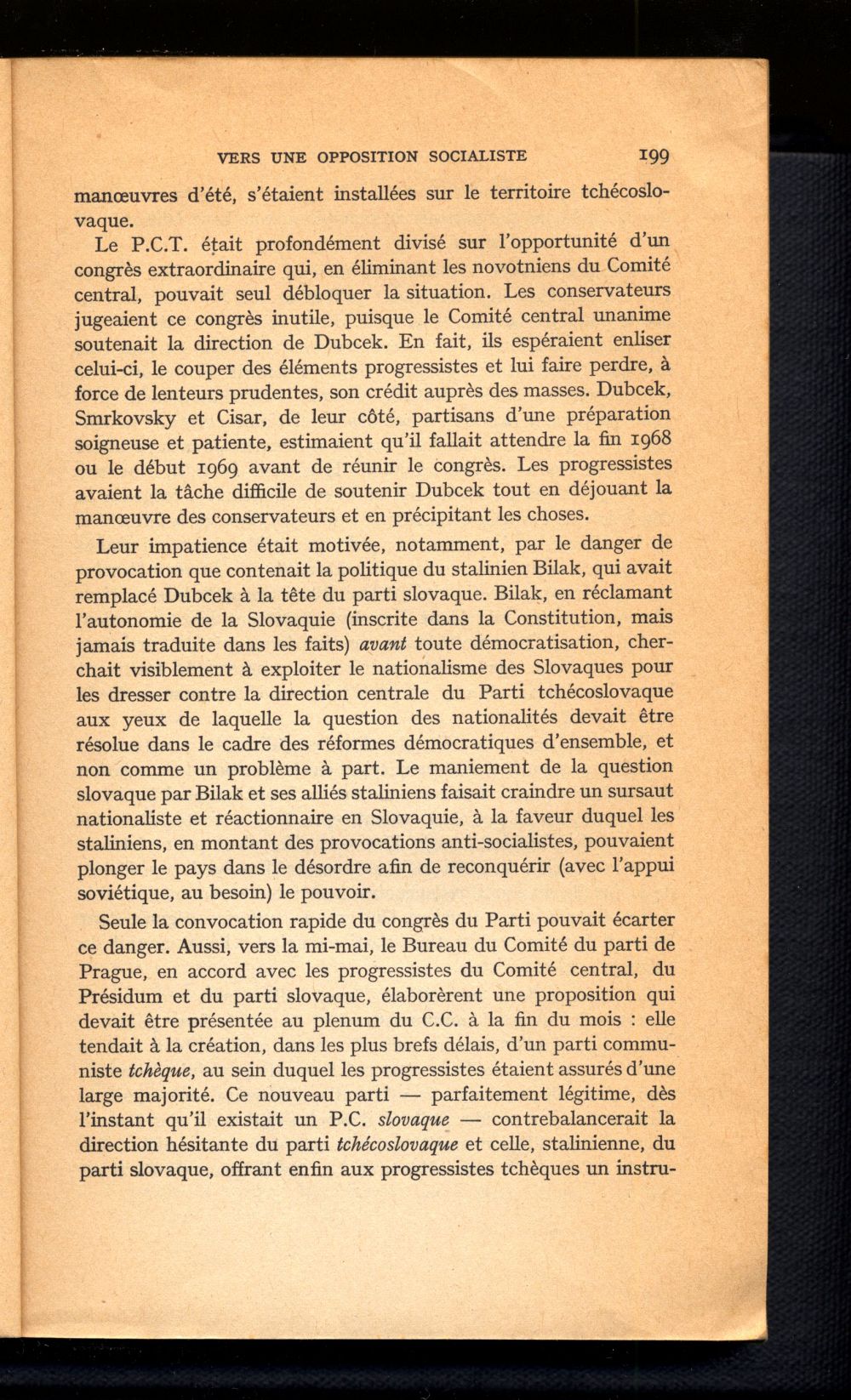

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE
199
manœuvres d'été, s'étaient installées sur le territoire tchécoslo-
vaque.
vaque.
Le P.C.T. était profondément divisé sur l'opportunité d'un
congrès extraordinaire qui, en éliminant les novotniens du Comité
central, pouvait seul débloquer la situation. Les conservateurs
jugeaient ce congrès mutile, puisque le Comité central unanime
soutenait la direction de Dubcek. En fait, ils espéraient enliser
celui-ci, le couper des éléments progressistes et lui faire perdre, à
force de lenteurs prudentes, son crédit auprès des masses. Dubcek,
Smrkovsky et Cisar, de leur côté, partisans d'une préparation
soigneuse et patiente, estimaient qu'il fallait attendre la fin 1968
ou le début 1969 avant de réunir le congrès. Les progressistes
avaient la tâche difficile de soutenir Dubcek tout en déjouant la
manœuvre des conservateurs et en précipitant les choses.
congrès extraordinaire qui, en éliminant les novotniens du Comité
central, pouvait seul débloquer la situation. Les conservateurs
jugeaient ce congrès mutile, puisque le Comité central unanime
soutenait la direction de Dubcek. En fait, ils espéraient enliser
celui-ci, le couper des éléments progressistes et lui faire perdre, à
force de lenteurs prudentes, son crédit auprès des masses. Dubcek,
Smrkovsky et Cisar, de leur côté, partisans d'une préparation
soigneuse et patiente, estimaient qu'il fallait attendre la fin 1968
ou le début 1969 avant de réunir le congrès. Les progressistes
avaient la tâche difficile de soutenir Dubcek tout en déjouant la
manœuvre des conservateurs et en précipitant les choses.
Leur impatience était motivée, notamment, par le danger de
provocation que contenait la politique du stalinien Bilak, qui avait
remplacé Dubcek à la tête du parti slovaque. Bilak, en réclamant
l'autonomie de la Slovaquie (inscrite dans la Constitution, mais
jamais traduite dans les faits) avant toute démocratisation, cher-
chait visiblement à exploiter le nationalisme des Slovaques pour
les dresser contre la direction centrale du Parti tchécoslovaque
aux yeux de laquelle la question des nationalités devait être
résolue dans le cadre des réformes démocratiques d'ensemble, et
non comme un problème à part. Le maniement de la question
slovaque par Bilak et ses alliés staliniens faisait craindre un sursaut
nationaliste et réactionnaire en Slovaquie, à la faveur duquel les
staliniens, en montant des provocations anti-socialistes, pouvaient
plonger le pays dans le désordre afin de reconquérir (avec l'appui
soviétique, au besoin) le pouvoir.
provocation que contenait la politique du stalinien Bilak, qui avait
remplacé Dubcek à la tête du parti slovaque. Bilak, en réclamant
l'autonomie de la Slovaquie (inscrite dans la Constitution, mais
jamais traduite dans les faits) avant toute démocratisation, cher-
chait visiblement à exploiter le nationalisme des Slovaques pour
les dresser contre la direction centrale du Parti tchécoslovaque
aux yeux de laquelle la question des nationalités devait être
résolue dans le cadre des réformes démocratiques d'ensemble, et
non comme un problème à part. Le maniement de la question
slovaque par Bilak et ses alliés staliniens faisait craindre un sursaut
nationaliste et réactionnaire en Slovaquie, à la faveur duquel les
staliniens, en montant des provocations anti-socialistes, pouvaient
plonger le pays dans le désordre afin de reconquérir (avec l'appui
soviétique, au besoin) le pouvoir.
Seule la convocation rapide du congrès du Parti pouvait écarter
ce danger. Aussi, vers la mi-mai, le Bureau du Comité du parti de
Prague, en accord avec les progressistes du Comité central, du
Présidum et du parti slovaque, élaborèrent une proposition qui
devait être présentée au plénum du C.C. à la fin du mois : elle
tendait à la création, dans les plus brefs délais, d'un parti commu-
niste tchèque, au sein duquel les progressistes étaient assurés d'une
large majorité. Ce nouveau parti — parfaitement légitime, dès
l'instant qu'il existait un P.C. slovaque — contrebalancerait la
direction hésitante du parti tchécoslovaque et celle, stalinienne, du
parti slovaque, offrant enfin aux progressistes tchèques un instru-
ce danger. Aussi, vers la mi-mai, le Bureau du Comité du parti de
Prague, en accord avec les progressistes du Comité central, du
Présidum et du parti slovaque, élaborèrent une proposition qui
devait être présentée au plénum du C.C. à la fin du mois : elle
tendait à la création, dans les plus brefs délais, d'un parti commu-
niste tchèque, au sein duquel les progressistes étaient assurés d'une
large majorité. Ce nouveau parti — parfaitement légitime, dès
l'instant qu'il existait un P.C. slovaque — contrebalancerait la
direction hésitante du parti tchécoslovaque et celle, stalinienne, du
parti slovaque, offrant enfin aux progressistes tchèques un instru-
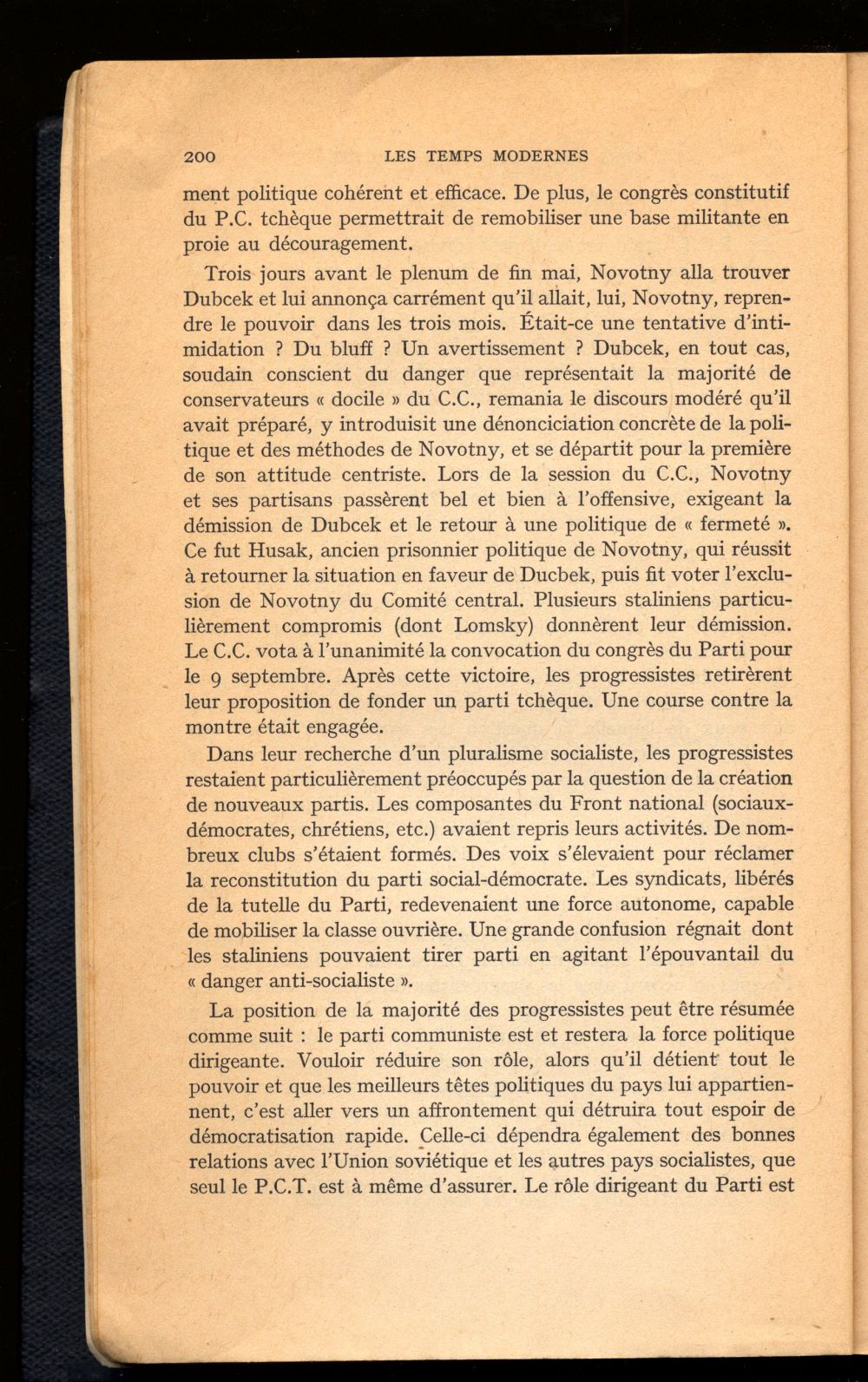

20O
LES TEMPS MODERNES
ment politique cohérent et efficace. De plus, le congrès constitutif
du P.C. tchèque permettrait de remobiliser une base militante en
proie au découragement.
du P.C. tchèque permettrait de remobiliser une base militante en
proie au découragement.
Trois jours avant le plénum de fin mai, Novotny alla trouver
Dubcek et lui annonça carrément qu'il allait, lui, Novotny, repren-
dre le pouvoir dans les trois mois. Était-ce une tentative d'inti-
midation ? Du bluff ? Un avertissement ? Dubcek, en tout cas,
soudain conscient du danger que représentait la majorité de
conservateurs « docile » du C.C., remania le discours modéré qu'il
avait préparé, y introduisit une dénonciciation concrète de la poli-
tique et des méthodes de Novotny, et se départit pour la première
de son attitude centriste. Lors de la session du C.C., Novotny
et ses partisans passèrent bel et bien à l'offensive, exigeant la
démission de Dubcek et le retour à une politique de « fermeté ».
Ce fut Husak, ancien prisonnier politique de Novotny, qui réussit
à retourner la situation en faveur de Ducbek, puis fit voter l'exclu-
sion de Novotny du Comité central. Plusieurs staliniens particu-
lièrement compromis (dont Lomsky) donnèrent leur démission.
Le C.C. vota à l'unanimité la convocation du congrès du Parti pour
le 9 septembre. Après cette victoire, les progressistes retirèrent
leur proposition de fonder un parti tchèque. Une course contre la
montre était engagée.
Dubcek et lui annonça carrément qu'il allait, lui, Novotny, repren-
dre le pouvoir dans les trois mois. Était-ce une tentative d'inti-
midation ? Du bluff ? Un avertissement ? Dubcek, en tout cas,
soudain conscient du danger que représentait la majorité de
conservateurs « docile » du C.C., remania le discours modéré qu'il
avait préparé, y introduisit une dénonciciation concrète de la poli-
tique et des méthodes de Novotny, et se départit pour la première
de son attitude centriste. Lors de la session du C.C., Novotny
et ses partisans passèrent bel et bien à l'offensive, exigeant la
démission de Dubcek et le retour à une politique de « fermeté ».
Ce fut Husak, ancien prisonnier politique de Novotny, qui réussit
à retourner la situation en faveur de Ducbek, puis fit voter l'exclu-
sion de Novotny du Comité central. Plusieurs staliniens particu-
lièrement compromis (dont Lomsky) donnèrent leur démission.
Le C.C. vota à l'unanimité la convocation du congrès du Parti pour
le 9 septembre. Après cette victoire, les progressistes retirèrent
leur proposition de fonder un parti tchèque. Une course contre la
montre était engagée.
Dans leur recherche d'un pluralisme socialiste, les progressistes
restaient particulièrement préoccupés par la question de la création
de nouveaux partis. Les composantes du Front national (sociaux-
démocrates, chrétiens, etc.) avaient repris leurs activités. De nom-
breux clubs s'étaient formés. Des voix s'élevaient pour réclamer
la reconstitution du parti social-démocrate. Les syndicats, libérés
de la tutelle du Parti, redevenaient une force autonome, capable
de mobiliser la classe ouvrière. Une grande confusion régnait dont
les staliniens pouvaient tirer parti en agitant l'épouvantail du
« danger anti-socialiste ».
restaient particulièrement préoccupés par la question de la création
de nouveaux partis. Les composantes du Front national (sociaux-
démocrates, chrétiens, etc.) avaient repris leurs activités. De nom-
breux clubs s'étaient formés. Des voix s'élevaient pour réclamer
la reconstitution du parti social-démocrate. Les syndicats, libérés
de la tutelle du Parti, redevenaient une force autonome, capable
de mobiliser la classe ouvrière. Une grande confusion régnait dont
les staliniens pouvaient tirer parti en agitant l'épouvantail du
« danger anti-socialiste ».
La position de la majorité des progressistes peut être résumée
comme suit : le parti communiste est et restera la force politique
dirigeante. Vouloir réduire son rôle, alors qu'il détient tout le
pouvoir et que les meilleurs têtes politiques du pays lui appartien-
nent, c'est aller vers un affrontement qui détruira tout espoir de
démocratisation rapide. Celle-ci dépendra également des bonnes
relations avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes, que
seul le P.C.T. est à même d'assurer. Le rôle dirigeant du Parti est
comme suit : le parti communiste est et restera la force politique
dirigeante. Vouloir réduire son rôle, alors qu'il détient tout le
pouvoir et que les meilleurs têtes politiques du pays lui appartien-
nent, c'est aller vers un affrontement qui détruira tout espoir de
démocratisation rapide. Celle-ci dépendra également des bonnes
relations avec l'Union soviétique et les autres pays socialistes, que
seul le P.C.T. est à même d'assurer. Le rôle dirigeant du Parti est
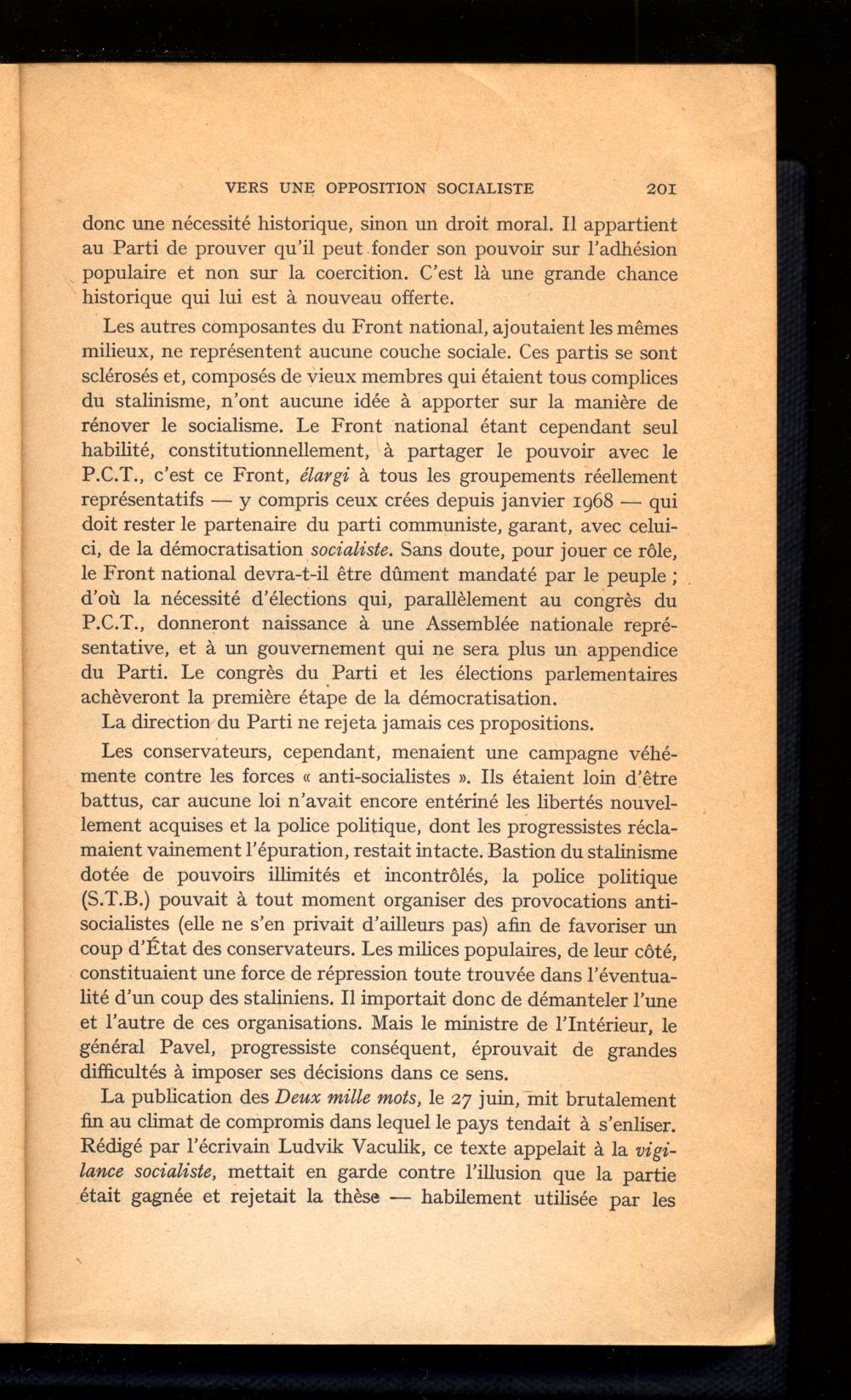

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE
201
donc une nécessité historique, sinon un droit moral. Il appartient
au Parti de prouver qu'il peut fonder son pouvoir sur l'adhésion
populaire et non sur la coercition. C'est là une grande chance
historique qui lui est à nouveau offerte.
au Parti de prouver qu'il peut fonder son pouvoir sur l'adhésion
populaire et non sur la coercition. C'est là une grande chance
historique qui lui est à nouveau offerte.
Les autres composantes du Front national, ajoutaient les mêmes
milieux, ne représentent aucune couche sociale. Ces partis se sont
sclérosés et, composés de vieux membres qui étaient tous complices
du stalinisme, n'ont aucune idée à apporter sur la manière de
rénover le socialisme. Le Front national étant cependant seul
habilité, constitutionnellement, à partager le pouvoir avec le
P.C.T., c'est ce Front, élargi à tous les groupements réellement
représentatifs — y compris ceux crées depuis janvier 1968 — qui
doit rester le partenaire du parti communiste, garant, avec celui-
ci, de la démocratisation socialiste. Sans doute, pour jouer ce rôle,
le Front national devra-t-il être dûment mandaté par le peuple ;
d'où la nécessité d'élections qui, parallèlement au congrès du
P.C.T., donneront naissance à une Assemblée nationale repré-
sentative, et à un gouvernement qui ne sera plus un appendice
du Parti. Le congrès du Parti et les élections parlementaires
achèveront la première étape de la démocratisation.
milieux, ne représentent aucune couche sociale. Ces partis se sont
sclérosés et, composés de vieux membres qui étaient tous complices
du stalinisme, n'ont aucune idée à apporter sur la manière de
rénover le socialisme. Le Front national étant cependant seul
habilité, constitutionnellement, à partager le pouvoir avec le
P.C.T., c'est ce Front, élargi à tous les groupements réellement
représentatifs — y compris ceux crées depuis janvier 1968 — qui
doit rester le partenaire du parti communiste, garant, avec celui-
ci, de la démocratisation socialiste. Sans doute, pour jouer ce rôle,
le Front national devra-t-il être dûment mandaté par le peuple ;
d'où la nécessité d'élections qui, parallèlement au congrès du
P.C.T., donneront naissance à une Assemblée nationale repré-
sentative, et à un gouvernement qui ne sera plus un appendice
du Parti. Le congrès du Parti et les élections parlementaires
achèveront la première étape de la démocratisation.
La direction du Parti ne rejeta jamais ces propositions.
Les conservateurs, cependant, menaient une campagne véhé-
mente contre les forces « anti-socialistes ». Ils étaient loin d'être
battus, car aucune loi n'avait encore entériné les libertés nouvel-
lement acquises et la police politique, dont les progressistes récla-
maient vainement l'épuration, restait intacte. Bastion du stalinisme
dotée de pouvoirs illimités et incontrôlés, la police politique
(S.T.B.) pouvait à tout moment organiser des provocations anti-
socialistes (elle ne s'en privait d'ailleurs pas) afin de favoriser un
coup d'État des conservateurs. Les milices populaires, de leur côté,
constituaient une force de répression toute trouvée dans l'éventua-
lité d'un coup des staliniens. Il importait donc de démanteler l'une
et l'autre de ces organisations. Mais le ministre de l'Intérieur, le
général Pavel, progressiste conséquent, éprouvait de grandes
difficultés à imposer ses décisions dans ce sens.
mente contre les forces « anti-socialistes ». Ils étaient loin d'être
battus, car aucune loi n'avait encore entériné les libertés nouvel-
lement acquises et la police politique, dont les progressistes récla-
maient vainement l'épuration, restait intacte. Bastion du stalinisme
dotée de pouvoirs illimités et incontrôlés, la police politique
(S.T.B.) pouvait à tout moment organiser des provocations anti-
socialistes (elle ne s'en privait d'ailleurs pas) afin de favoriser un
coup d'État des conservateurs. Les milices populaires, de leur côté,
constituaient une force de répression toute trouvée dans l'éventua-
lité d'un coup des staliniens. Il importait donc de démanteler l'une
et l'autre de ces organisations. Mais le ministre de l'Intérieur, le
général Pavel, progressiste conséquent, éprouvait de grandes
difficultés à imposer ses décisions dans ce sens.
La publication des Deux mille mots, le 27 juin, mit brutalement
fin au climat de compromis dans lequel le pays tendait à s'enliser.
Rédigé par l'écrivain Ludvik Vaculik, ce texte appelait à la vigi-
lance socialiste, mettait en garde contre l'illusion que la partie
était gagnée et rejetait la thèse — habilement utilisée par les
fin au climat de compromis dans lequel le pays tendait à s'enliser.
Rédigé par l'écrivain Ludvik Vaculik, ce texte appelait à la vigi-
lance socialiste, mettait en garde contre l'illusion que la partie
était gagnée et rejetait la thèse — habilement utilisée par les
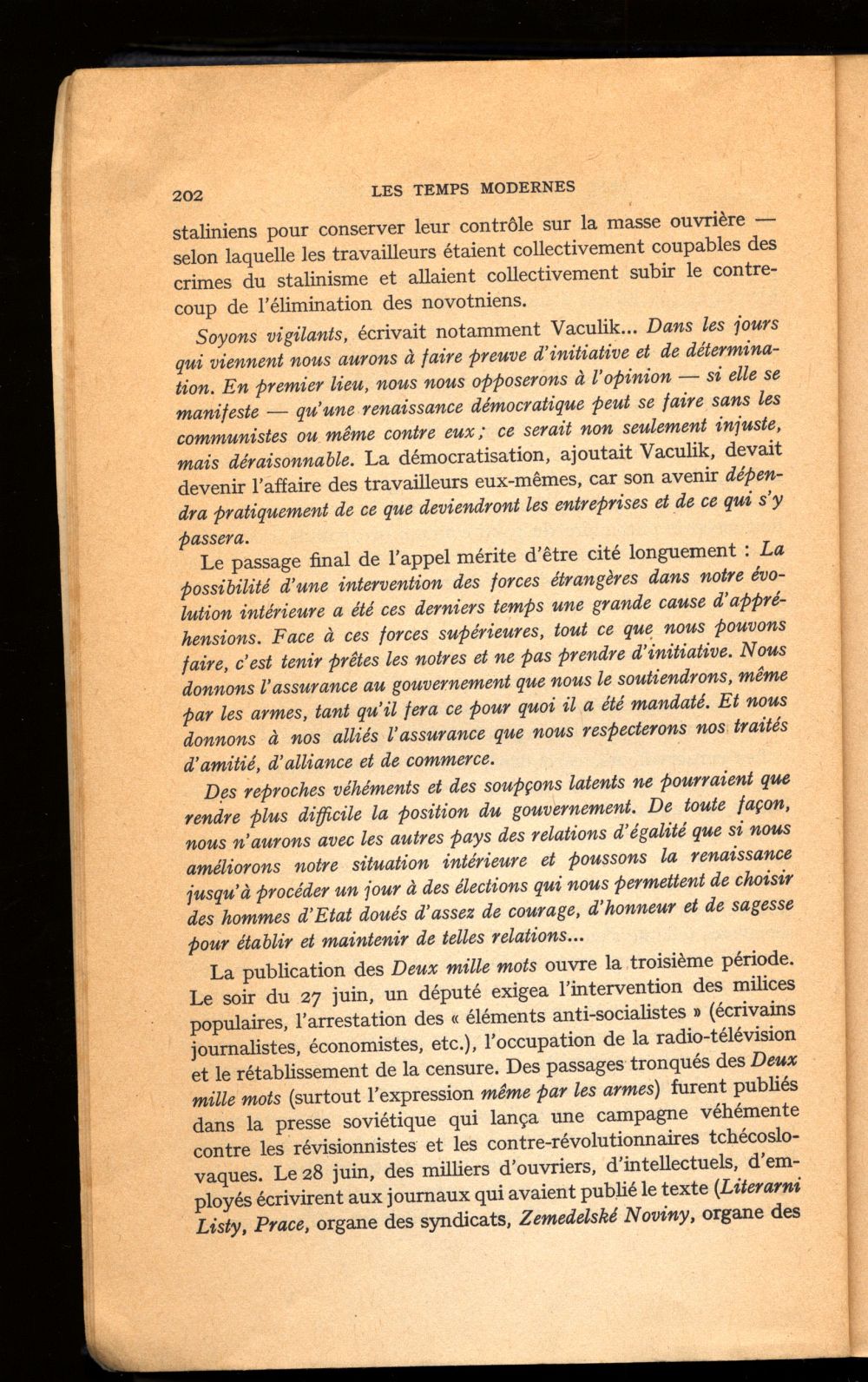

2O2
LES TEMPS MODERNES
staliniens pour conserver leur contrôle sur la masse ouvrière —
selon laquelle les travailleurs étaient collectivement coupables des
crimes du stalinisme et allaient collectivement subir le contre-
coup de l'élimination des novotniens.
selon laquelle les travailleurs étaient collectivement coupables des
crimes du stalinisme et allaient collectivement subir le contre-
coup de l'élimination des novotniens.
Soyons vigilants, écrivait notamment Vaculik... Dans les jours
qui viennent nous aurons à faire preuve d'initiative et de détermina-
tion. En premier lieu, nous nous opposerons à l'opinion — si elle se
manifeste — qu'une renaissance démocratique peut se faire sans les
communistes ou même contre eux; ce serait non seulement injuste,
mais déraisonnable. La démocratisation, ajoutait Vaculik, devait
devenir l'affaire des travailleurs eux-mêmes, car son avenir dépen-
dra pratiquement de ce que deviendront les entreprises et de ce qui s'y
passera.
qui viennent nous aurons à faire preuve d'initiative et de détermina-
tion. En premier lieu, nous nous opposerons à l'opinion — si elle se
manifeste — qu'une renaissance démocratique peut se faire sans les
communistes ou même contre eux; ce serait non seulement injuste,
mais déraisonnable. La démocratisation, ajoutait Vaculik, devait
devenir l'affaire des travailleurs eux-mêmes, car son avenir dépen-
dra pratiquement de ce que deviendront les entreprises et de ce qui s'y
passera.
Le passage final de l'appel mérite d'être cité longuement : La
possibilité d'une intervention des forces étrangères dans notre évo-
lution intérieure a été ces derniers temps une grande cause d'appré-
hensions. Face à ces forces supérieures, tout ce que nous pouvons
faire, c'est tenir prêtes les nôtres et ne pas prendre d'initiative. Nous
donnons l'assurance au gouvernement que nous le soutiendrons, même
par les armes, tant qu'il fera ce pour quoi il a été mandaté. Et nous
donnons à nos alliés l'assurance que nous respecterons nos traités
d'amitié, d'alliance et de commerce.
possibilité d'une intervention des forces étrangères dans notre évo-
lution intérieure a été ces derniers temps une grande cause d'appré-
hensions. Face à ces forces supérieures, tout ce que nous pouvons
faire, c'est tenir prêtes les nôtres et ne pas prendre d'initiative. Nous
donnons l'assurance au gouvernement que nous le soutiendrons, même
par les armes, tant qu'il fera ce pour quoi il a été mandaté. Et nous
donnons à nos alliés l'assurance que nous respecterons nos traités
d'amitié, d'alliance et de commerce.
Des reproches véhéments et des soupçons latents ne pourraient que
rendre plus difficile la position du gouvernement. De toute façon,
nous n'aurons avec les autres pays des relations d'égalité que si nous
améliorons notre situation intérieure et poussons la renaissance
jusqu'à procéder un jour à des élections qui nous permettent de choisir
des hommes d'Etat doués d'assez de courage, d'honneur et de sagesse
pour établir et maintenir de telles relations...
rendre plus difficile la position du gouvernement. De toute façon,
nous n'aurons avec les autres pays des relations d'égalité que si nous
améliorons notre situation intérieure et poussons la renaissance
jusqu'à procéder un jour à des élections qui nous permettent de choisir
des hommes d'Etat doués d'assez de courage, d'honneur et de sagesse
pour établir et maintenir de telles relations...
La publication des Deux mille mots ouvre la troisième période.
Le soir du 27 juin, un député exigea l'intervention des milices
populaires, l'arrestation des « éléments anti-socialistes » (écrivains
journalistes, économistes, etc.), l'occupation de la radio-télévision
et le rétablissement de la censure. Des passages tronqués des Deux
mille mots (surtout l'expression même par les armes) furent publiés
dans la presse soviétique qui lança une campagne véhémente
contre les révisionnistes et les contre-révolutionnaires tchécoslo-
vaques. Le 28 juin, des milliers d'ouvriers, d'intellectuels, d'em-
ployés écrivirent aux journaux qui avaient publié le texte (Literarni
Listy, Prace, organe des syndicats, Zemedelské Noviny, organe des
Le soir du 27 juin, un député exigea l'intervention des milices
populaires, l'arrestation des « éléments anti-socialistes » (écrivains
journalistes, économistes, etc.), l'occupation de la radio-télévision
et le rétablissement de la censure. Des passages tronqués des Deux
mille mots (surtout l'expression même par les armes) furent publiés
dans la presse soviétique qui lança une campagne véhémente
contre les révisionnistes et les contre-révolutionnaires tchécoslo-
vaques. Le 28 juin, des milliers d'ouvriers, d'intellectuels, d'em-
ployés écrivirent aux journaux qui avaient publié le texte (Literarni
Listy, Prace, organe des syndicats, Zemedelské Noviny, organe des
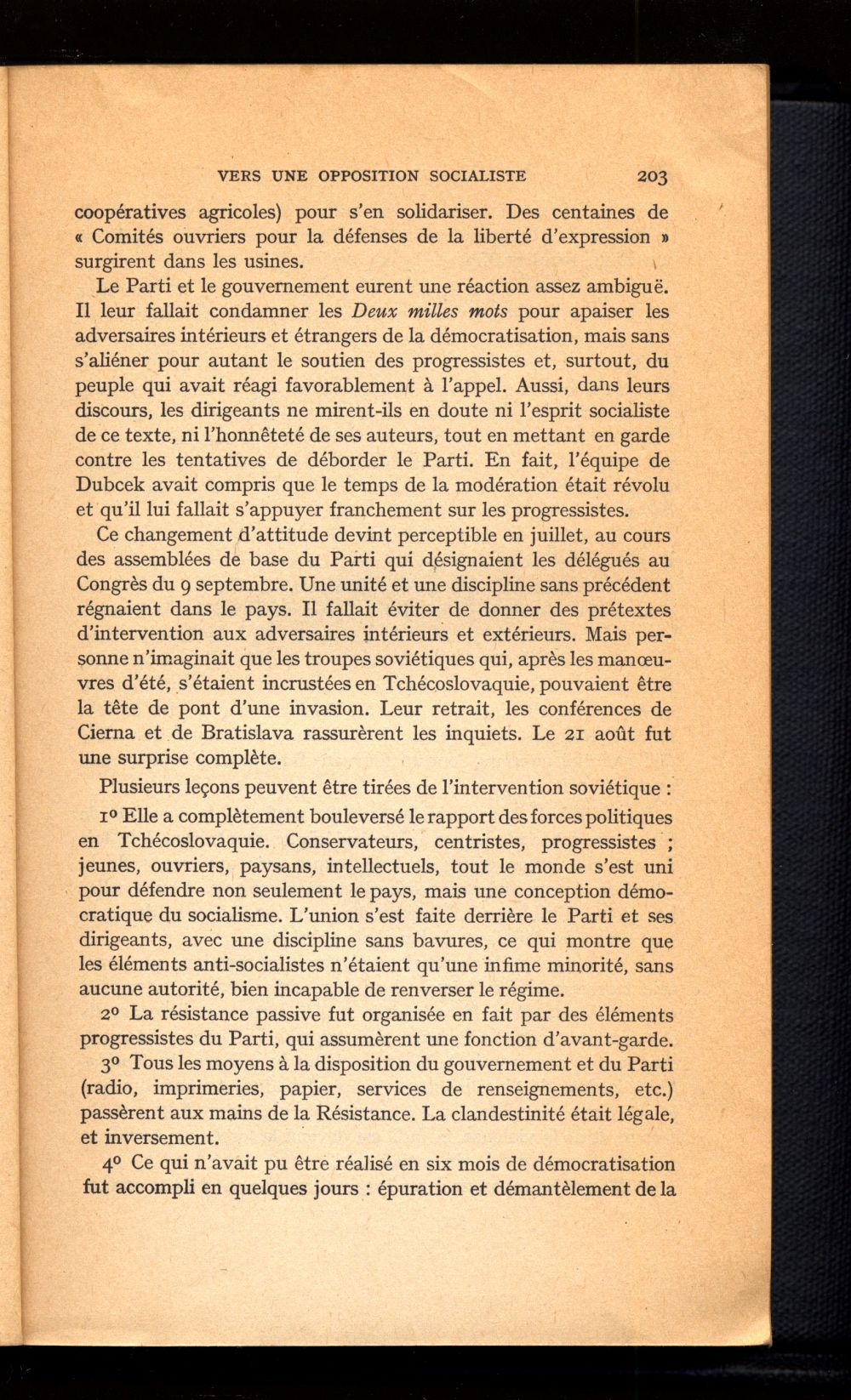

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE
203
coopératives agricoles) pour s'en solidariser. Des centaines de
« Comités ouvriers pour la défenses de la liberté d'expression »
surgirent dans les usines.
« Comités ouvriers pour la défenses de la liberté d'expression »
surgirent dans les usines.
Le Parti et le gouvernement eurent une réaction assez ambiguë.
Il leur fallait condamner les Deux milles mots pour apaiser les
adversaires intérieurs et étrangers de la démocratisation, mais sans
s'aliéner pour autant le soutien des progressistes et, surtout, du
peuple qui avait réagi favorablement à l'appel. Aussi, dans leurs
discours, les dirigeants ne mirent-ils en doute ni l'esprit socialiste
de ce texte, ni l'honnêteté de ses auteurs, tout en mettant en garde
contre les tentatives de déborder le Parti. En fait, l'équipe de
Dubcek avait compris que le temps de la modération était révolu
et qu'il lui fallait s'appuyer franchement sur les progressistes.
Il leur fallait condamner les Deux milles mots pour apaiser les
adversaires intérieurs et étrangers de la démocratisation, mais sans
s'aliéner pour autant le soutien des progressistes et, surtout, du
peuple qui avait réagi favorablement à l'appel. Aussi, dans leurs
discours, les dirigeants ne mirent-ils en doute ni l'esprit socialiste
de ce texte, ni l'honnêteté de ses auteurs, tout en mettant en garde
contre les tentatives de déborder le Parti. En fait, l'équipe de
Dubcek avait compris que le temps de la modération était révolu
et qu'il lui fallait s'appuyer franchement sur les progressistes.
Ce changement d'attitude devint perceptible en juillet, au cours
des assemblées de base du Parti qui désignaient les délégués au
Congrès du 9 septembre. Une unité et une discipline sans précédent
régnaient dans le pays. Il fallait éviter de donner des prétextes
d'intervention aux adversaires intérieurs et extérieurs. Mais per-
sonne n'imaginait que les troupes soviétiques qui, après les manœu-
vres d'été, s'étaient incrustées en Tchécoslovaquie, pouvaient être
la tête de pont d'une invasion. Leur retrait, les conférences de
Cierna et de Bratislava rassurèrent les inquiets. Le 21 août fut
une surprise complète.
des assemblées de base du Parti qui désignaient les délégués au
Congrès du 9 septembre. Une unité et une discipline sans précédent
régnaient dans le pays. Il fallait éviter de donner des prétextes
d'intervention aux adversaires intérieurs et extérieurs. Mais per-
sonne n'imaginait que les troupes soviétiques qui, après les manœu-
vres d'été, s'étaient incrustées en Tchécoslovaquie, pouvaient être
la tête de pont d'une invasion. Leur retrait, les conférences de
Cierna et de Bratislava rassurèrent les inquiets. Le 21 août fut
une surprise complète.
Plusieurs leçons peuvent être tirées de l'intervention soviétique :
i° Elle a complètement bouleversé le rapport des forces politiques
en Tchécoslovaquie. Conservateurs, centristes, progressistes ;
jeunes, ouvriers, paysans, intellectuels, tout le monde s'est uni
pour défendre non seulement le pays, mais une conception démo-
cratique du socialisme. L'union s'est faite derrière le Parti et ses
dirigeants, avec une discipline sans bavures, ce qui montre que
les éléments anti-socialistes n'étaient qu'une infime minorité, sans
aucune autorité, bien incapable de renverser le régime.
en Tchécoslovaquie. Conservateurs, centristes, progressistes ;
jeunes, ouvriers, paysans, intellectuels, tout le monde s'est uni
pour défendre non seulement le pays, mais une conception démo-
cratique du socialisme. L'union s'est faite derrière le Parti et ses
dirigeants, avec une discipline sans bavures, ce qui montre que
les éléments anti-socialistes n'étaient qu'une infime minorité, sans
aucune autorité, bien incapable de renverser le régime.
2° La résistance passive fut organisée en fait par des éléments
progressistes du Parti, qui assumèrent une fonction d'avant-garde.
progressistes du Parti, qui assumèrent une fonction d'avant-garde.
3° Tous les moyens à la disposition du gouvernement et du Parti
(radio, imprimeries, papier, services de renseignements, etc.)
passèrent aux mains de la Résistance. La clandestinité était légale,
et inversement.
(radio, imprimeries, papier, services de renseignements, etc.)
passèrent aux mains de la Résistance. La clandestinité était légale,
et inversement.
4° Ce qui n'avait pu être réalisé en six mois de démocratisation
fut accompli en quelques jours : épuration et démantèlement de la
fut accompli en quelques jours : épuration et démantèlement de la
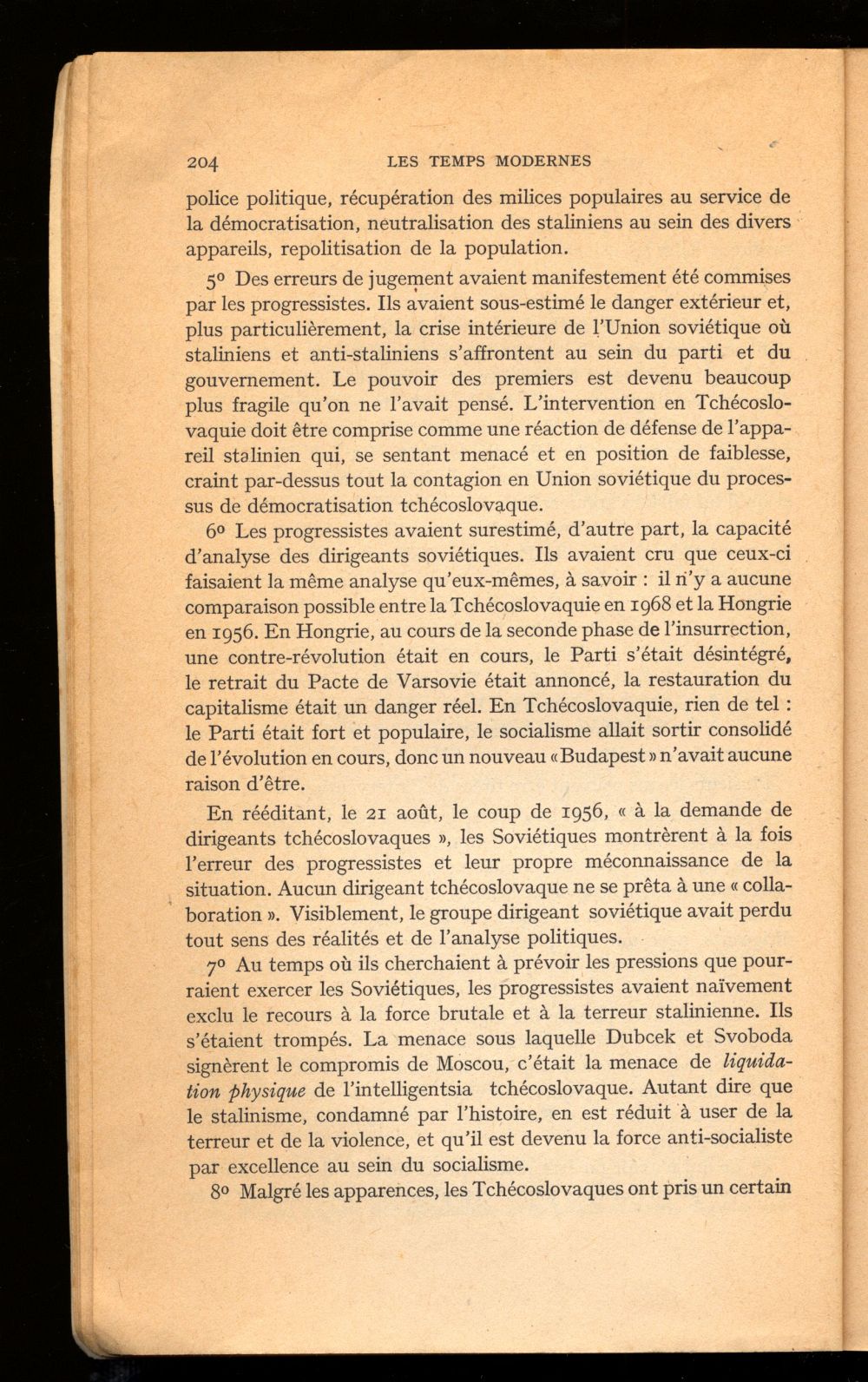

204 LES TEMPS MODERNES
police politique, récupération des milices populaires au service de
la démocratisation, neutralisation des staliniens au sein des divers
appareils, repolitisation de la population.
la démocratisation, neutralisation des staliniens au sein des divers
appareils, repolitisation de la population.
5° Des erreurs de jugement avaient manifestement été commises
par les progressistes. Ils avaient sous-estime le danger extérieur et,
plus particulièrement, la crise intérieure de l'Union soviétique où
staliniens et anti-staliniens s'affrontent au sein du parti et du
gouvernement. Le pouvoir des premiers est devenu beaucoup
plus fragile qu'on ne l'avait pensé. L'intervention en Tchécoslo-
vaquie doit être comprise comme une réaction de défense de l'appa-
reil stalinien qui, se sentant menacé et en position de faiblesse,
craint par-dessus tout la contagion en Union soviétique du proces-
sus de démocratisation tchécoslovaque.
par les progressistes. Ils avaient sous-estime le danger extérieur et,
plus particulièrement, la crise intérieure de l'Union soviétique où
staliniens et anti-staliniens s'affrontent au sein du parti et du
gouvernement. Le pouvoir des premiers est devenu beaucoup
plus fragile qu'on ne l'avait pensé. L'intervention en Tchécoslo-
vaquie doit être comprise comme une réaction de défense de l'appa-
reil stalinien qui, se sentant menacé et en position de faiblesse,
craint par-dessus tout la contagion en Union soviétique du proces-
sus de démocratisation tchécoslovaque.
6° Les progressistes avaient surestimé, d'autre part, la capacité
d'analyse des dirigeants soviétiques. Ils avaient cru que ceux-ci
faisaient la même analyse qu'eux-mêmes, à savoir : il n'y a aucune
comparaison possible entre la Tchécoslovaquie en 1968 et la Hongrie
en 1956. En Hongrie, au cours de la seconde phase de l'insurrection,
une contre-révolution était en cours, le Parti s'était désintégré,
le retrait du Pacte de Varsovie était annoncé, la restauration du
capitalisme était un danger réel. En Tchécoslovaquie, rien de tel :
le Parti était fort et populaire, le socialisme allait sortir consolidé
de l'évolution en cours, donc un nouveau «Budapest » n'avait aucune
raison d'être.
d'analyse des dirigeants soviétiques. Ils avaient cru que ceux-ci
faisaient la même analyse qu'eux-mêmes, à savoir : il n'y a aucune
comparaison possible entre la Tchécoslovaquie en 1968 et la Hongrie
en 1956. En Hongrie, au cours de la seconde phase de l'insurrection,
une contre-révolution était en cours, le Parti s'était désintégré,
le retrait du Pacte de Varsovie était annoncé, la restauration du
capitalisme était un danger réel. En Tchécoslovaquie, rien de tel :
le Parti était fort et populaire, le socialisme allait sortir consolidé
de l'évolution en cours, donc un nouveau «Budapest » n'avait aucune
raison d'être.
En rééditant, le 21 août, le coup de 1956, « à la demande de
dirigeants tchécoslovaques », les Soviétiques montrèrent à la fois
l'erreur des progressistes et leur propre méconnaissance de la
situation. Aucun dirigeant tchécoslovaque ne se prêta à une « colla-
boration ». Visiblement, le groupe dirigeant soviétique avait perdu
tout sens des réalités et de l'analyse politiques.
dirigeants tchécoslovaques », les Soviétiques montrèrent à la fois
l'erreur des progressistes et leur propre méconnaissance de la
situation. Aucun dirigeant tchécoslovaque ne se prêta à une « colla-
boration ». Visiblement, le groupe dirigeant soviétique avait perdu
tout sens des réalités et de l'analyse politiques.
7° Au temps où ils cherchaient à prévoir les pressions que pour-
raient exercer les Soviétiques, les progressistes avaient naïvement
exclu le recours à la force brutale et à la terreur stalinienne. Ils
s'étaient trompés. La menace sous laquelle Dubcek et Svoboda
signèrent le compromis de Moscou, c'était la menace de liquida-
tion physique de l'intelligentsia tchécoslovaque. Autant dire que
le stalinisme, condamné par l'histoire, en est réduit à user de la
terreur et de la violence, et qu'il est devenu la force anti-socialiste
par excellence au sein du socialisme.
raient exercer les Soviétiques, les progressistes avaient naïvement
exclu le recours à la force brutale et à la terreur stalinienne. Ils
s'étaient trompés. La menace sous laquelle Dubcek et Svoboda
signèrent le compromis de Moscou, c'était la menace de liquida-
tion physique de l'intelligentsia tchécoslovaque. Autant dire que
le stalinisme, condamné par l'histoire, en est réduit à user de la
terreur et de la violence, et qu'il est devenu la force anti-socialiste
par excellence au sein du socialisme.
8° Malgré les apparences, les Tchécoslovaques ont pris un certain
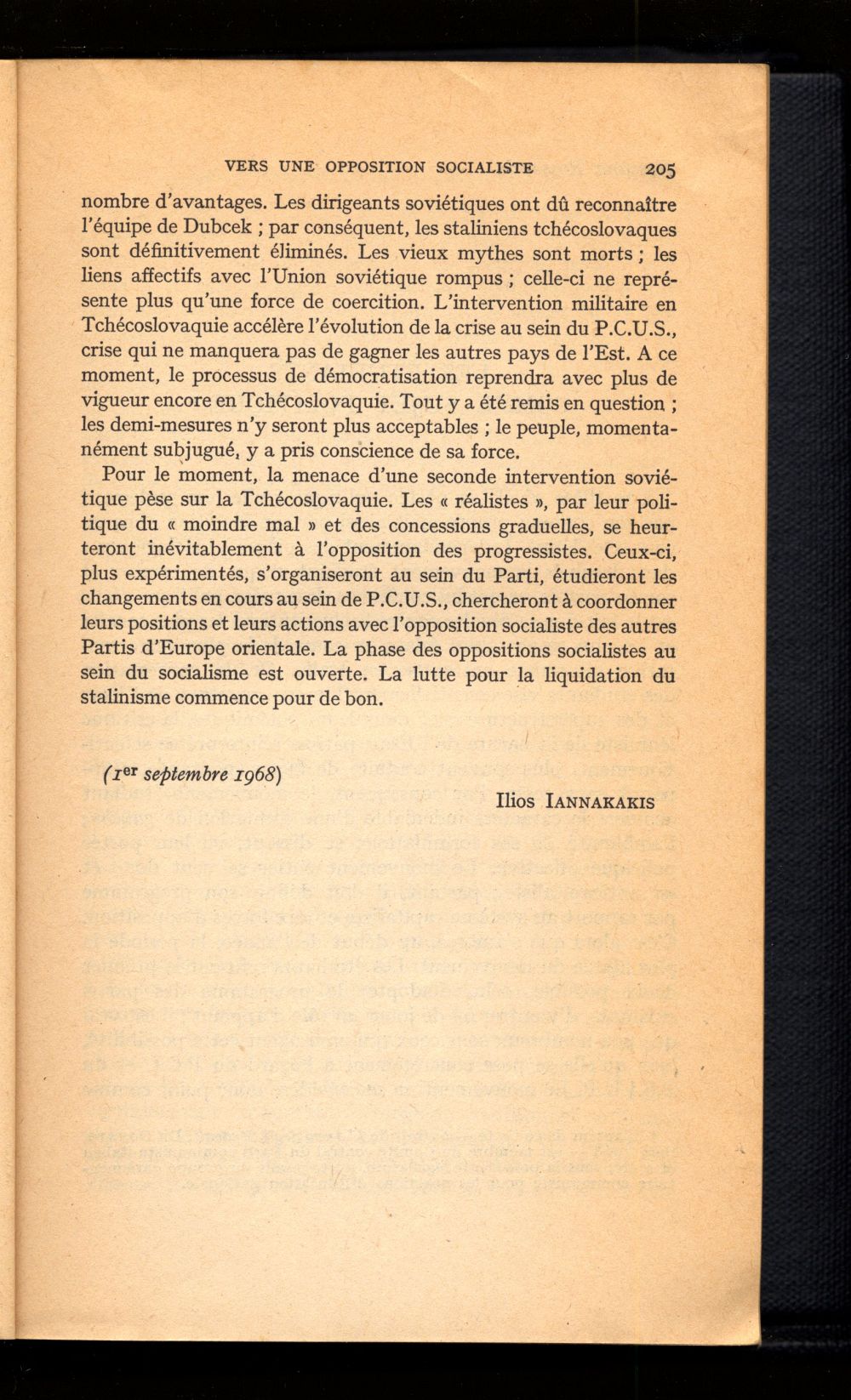

VERS UNE OPPOSITION SOCIALISTE
205
nombre d'avantages. Les dirigeants soviétiques ont dû reconnaître
l'équipe de Dubcek ; par conséquent, les staliniens tchécoslovaques
sont définitivement éliminés. Les vieux mythes sont morts ; les
liens affectifs avec l'Union soviétique rompus ; celle-ci ne repré-
sente plus qu'une force de coercition. L'intervention militaire en
Tchécoslovaquie accélère l'évolution de la crise au sein du P.C.U.S.,
crise qui ne manquera pas de gagner les autres pays de l'Est. A ce
moment, le processus de démocratisation reprendra avec plus de
vigueur encore en Tchécoslovaquie. Tout y a été remis en question ;
les demi-mesures n'y seront plus acceptables ; le peuple, momenta-
nément subjugué, y a pris conscience de sa force.
l'équipe de Dubcek ; par conséquent, les staliniens tchécoslovaques
sont définitivement éliminés. Les vieux mythes sont morts ; les
liens affectifs avec l'Union soviétique rompus ; celle-ci ne repré-
sente plus qu'une force de coercition. L'intervention militaire en
Tchécoslovaquie accélère l'évolution de la crise au sein du P.C.U.S.,
crise qui ne manquera pas de gagner les autres pays de l'Est. A ce
moment, le processus de démocratisation reprendra avec plus de
vigueur encore en Tchécoslovaquie. Tout y a été remis en question ;
les demi-mesures n'y seront plus acceptables ; le peuple, momenta-
nément subjugué, y a pris conscience de sa force.
Pour le moment, la menace d'une seconde intervention sovié-
tique pèse sur la Tchécoslovaquie. Les « réalistes », par leur poli-
tique du « moindre mal » et des concessions graduelles, se heur-
teront inévitablement à l'opposition des progressistes. Ceux-ci,
plus expérimentés, s'organiseront au sein du Parti, étudieront les
changements en cours au sein de P.C.U.S., chercheront à coordonner
leurs positions et leurs actions avec l'opposition socialiste des autres
Partis d'Europe orientale. La phase des oppositions socialistes au
sein du socialisme est ouverte. La lutte pour la liquidation du
stalinisme commence pour de bon.
tique pèse sur la Tchécoslovaquie. Les « réalistes », par leur poli-
tique du « moindre mal » et des concessions graduelles, se heur-
teront inévitablement à l'opposition des progressistes. Ceux-ci,
plus expérimentés, s'organiseront au sein du Parti, étudieront les
changements en cours au sein de P.C.U.S., chercheront à coordonner
leurs positions et leurs actions avec l'opposition socialiste des autres
Partis d'Europe orientale. La phase des oppositions socialistes au
sein du socialisme est ouverte. La lutte pour la liquidation du
stalinisme commence pour de bon.
(iei septembre ig68)
Ilios IANNAKAKIS
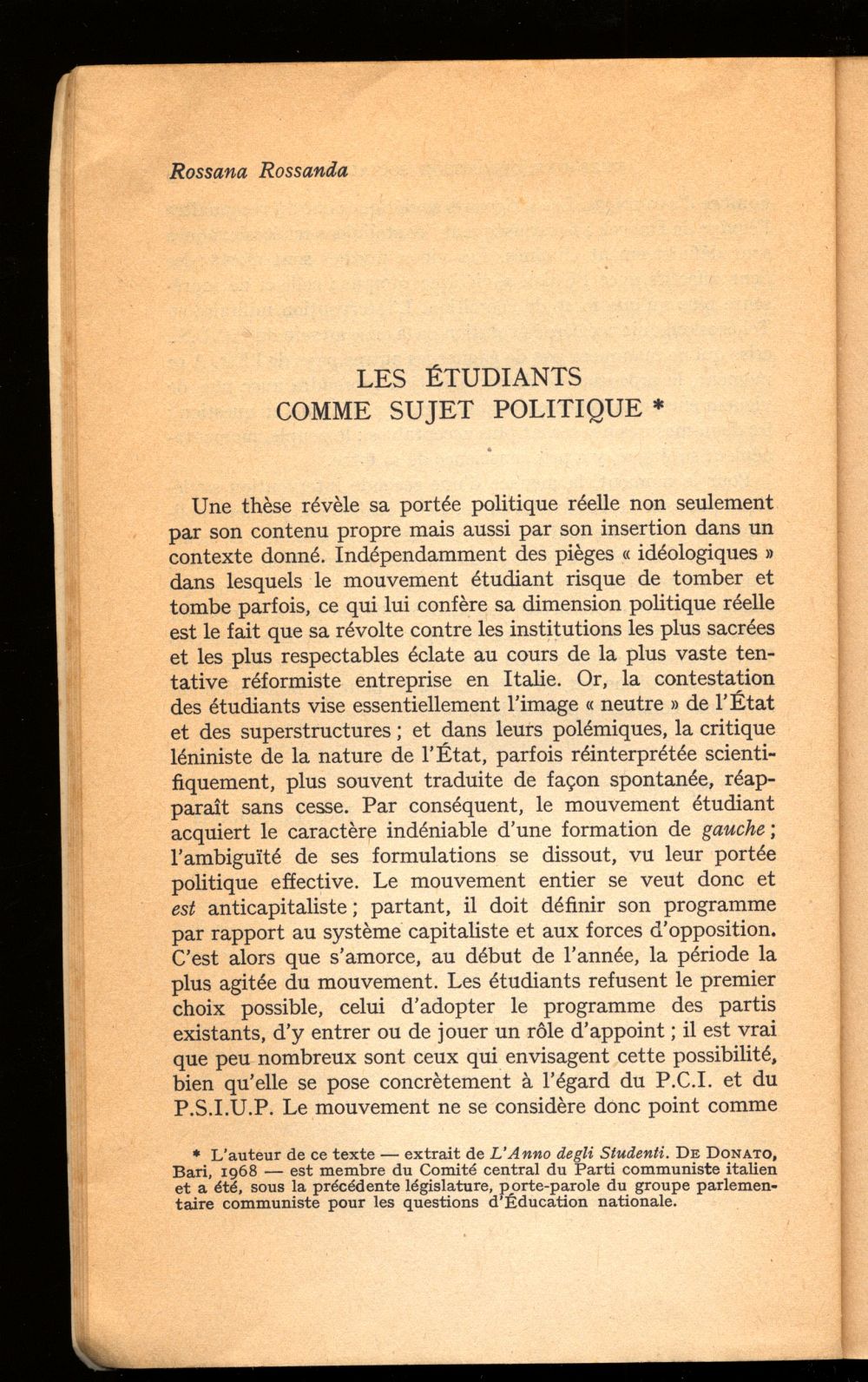

Rossana Rossanda
LES ÉTUDIANTS
COMME SUJET POLITIQUE *
COMME SUJET POLITIQUE *
Une thèse révèle sa portée politique réelle non seulement
par son contenu propre mais aussi par son insertion dans un
contexte donné. Indépendamment des pièges « idéologiques »
dans lesquels le mouvement étudiant risque de tomber et
tombe parfois, ce qui lui confère sa dimension politique réelle
est le fait que sa révolte contre les institutions les plus sacrées
et les plus respectables éclate au cours de la plus vaste ten-
tative réformiste entreprise en Italie. Or, la contestation
des étudiants vise essentiellement l'image « neutre » de l'État
et des superstructures ; et dans leurs polémiques, la critique
léniniste de la nature de l'État, parfois réinterprétée scienti-
fiquement, plus souvent traduite de façon spontanée, réap-
paraît sans cesse. Par conséquent, le mouvement étudiant
acquiert le caractère indéniable d'une formation de gauche ;
l'ambiguïté de ses formulations se dissout, vu leur portée
politique effective. Le mouvement entier se veut donc et
est anticapitaliste ; partant, il doit définir son programme
par rapport au système capitaliste et aux forces d'opposition.
C'est alors que s'amorce, au début de l'année, la période la
plus agitée du mouvement. Les étudiants refusent le premier
choix possible, celui d'adopter le programme des partis
existants, d'y entrer ou de jouer un rôle d'appoint ; il est vrai
que peu nombreux sont ceux qui envisagent cette possibilité,
bien qu'elle se pose concrètement à l'égard du P.C.I. et du
P.S.I.U.P. Le mouvement ne se considère donc point comme
par son contenu propre mais aussi par son insertion dans un
contexte donné. Indépendamment des pièges « idéologiques »
dans lesquels le mouvement étudiant risque de tomber et
tombe parfois, ce qui lui confère sa dimension politique réelle
est le fait que sa révolte contre les institutions les plus sacrées
et les plus respectables éclate au cours de la plus vaste ten-
tative réformiste entreprise en Italie. Or, la contestation
des étudiants vise essentiellement l'image « neutre » de l'État
et des superstructures ; et dans leurs polémiques, la critique
léniniste de la nature de l'État, parfois réinterprétée scienti-
fiquement, plus souvent traduite de façon spontanée, réap-
paraît sans cesse. Par conséquent, le mouvement étudiant
acquiert le caractère indéniable d'une formation de gauche ;
l'ambiguïté de ses formulations se dissout, vu leur portée
politique effective. Le mouvement entier se veut donc et
est anticapitaliste ; partant, il doit définir son programme
par rapport au système capitaliste et aux forces d'opposition.
C'est alors que s'amorce, au début de l'année, la période la
plus agitée du mouvement. Les étudiants refusent le premier
choix possible, celui d'adopter le programme des partis
existants, d'y entrer ou de jouer un rôle d'appoint ; il est vrai
que peu nombreux sont ceux qui envisagent cette possibilité,
bien qu'elle se pose concrètement à l'égard du P.C.I. et du
P.S.I.U.P. Le mouvement ne se considère donc point comme
* L'auteur de ce texte —• extrait de L'Anna degli Studenti. DE DONATO,
Bari, 1968 — est membre du Comité central du Parti communiste italien
et a été, sous la précédente législature, pj3rte-parole du groupe parlemen-
taire communiste pour les questions d'Éducation nationale.
Bari, 1968 — est membre du Comité central du Parti communiste italien
et a été, sous la précédente législature, pj3rte-parole du groupe parlemen-
taire communiste pour les questions d'Éducation nationale.
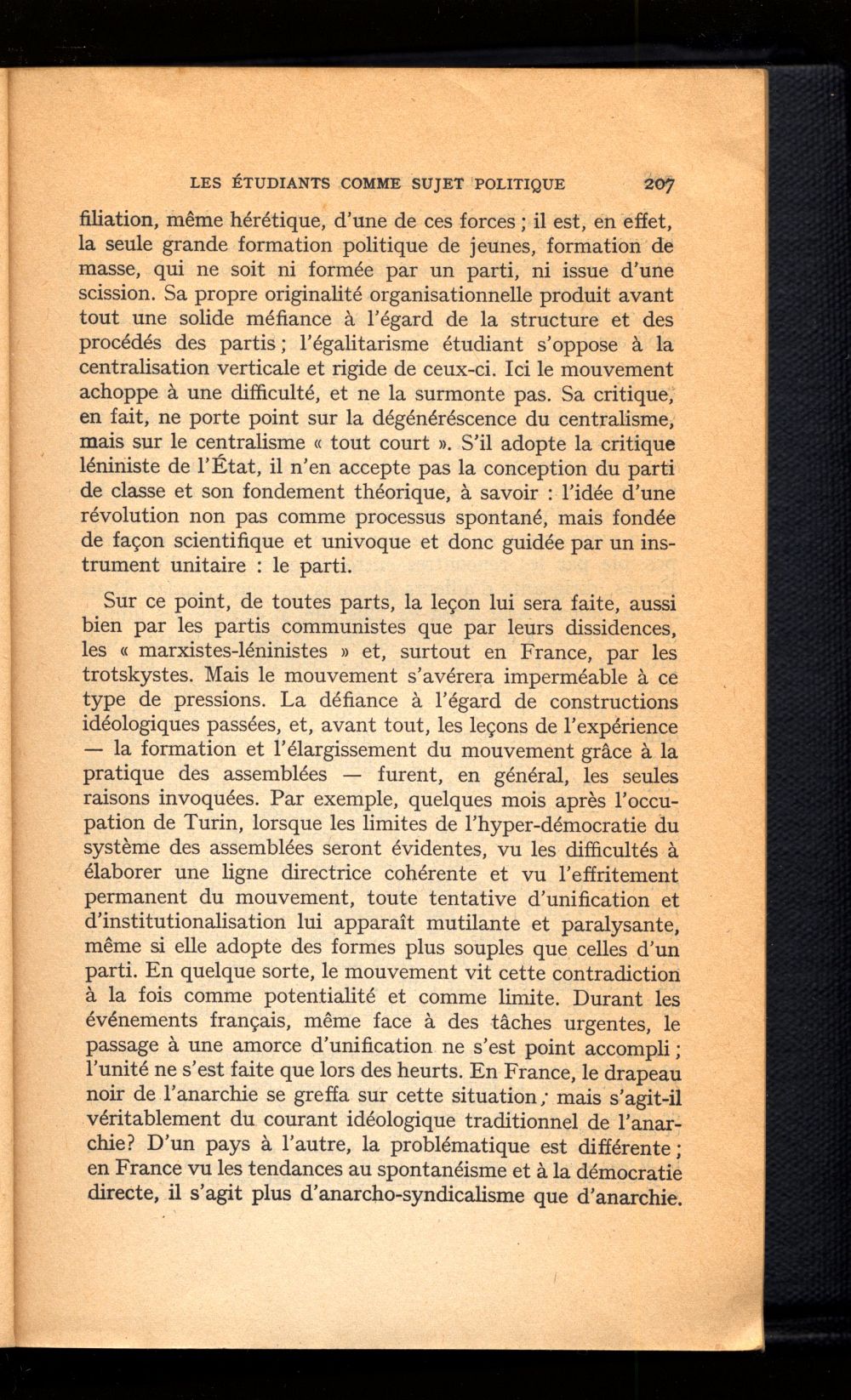

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
2O7
filiation, même hérétique, d'une de ces forces ; il est, en effet,
la seule grande formation politique de jeunes, formation de
masse, qui ne soit ni formée par un parti, ni issue d'une
scission. Sa propre originalité organisationnelle produit avant
tout une solide méfiance à l'égard de la structure et des
procédés des partis ; l'égalitarisme étudiant s'oppose à la
centralisation verticale et rigide de ceux-ci. Ici le mouvement
achoppe à une difficulté, et ne la surmonte pas. Sa critique,
en fait, ne porte point sur la dégénérescence du centralisme,
mais sur le centralisme « tout court ». S'il adopte la critique
léniniste de l'État, il n'en accepte pas la conception du parti
de classe et son fondement théorique, à savoir : l'idée d'une
révolution non pas comme processus spontané, mais fondée
de façon scientifique et univoque et donc guidée par un ins-
trument unitaire : le parti.
la seule grande formation politique de jeunes, formation de
masse, qui ne soit ni formée par un parti, ni issue d'une
scission. Sa propre originalité organisationnelle produit avant
tout une solide méfiance à l'égard de la structure et des
procédés des partis ; l'égalitarisme étudiant s'oppose à la
centralisation verticale et rigide de ceux-ci. Ici le mouvement
achoppe à une difficulté, et ne la surmonte pas. Sa critique,
en fait, ne porte point sur la dégénérescence du centralisme,
mais sur le centralisme « tout court ». S'il adopte la critique
léniniste de l'État, il n'en accepte pas la conception du parti
de classe et son fondement théorique, à savoir : l'idée d'une
révolution non pas comme processus spontané, mais fondée
de façon scientifique et univoque et donc guidée par un ins-
trument unitaire : le parti.
Sur ce point, de toutes parts, la leçon lui sera faite, aussi
bien par les partis communistes que par leurs dissidences,
les « marxistes-léninistes » et, surtout en France, par les
trotskystes. Mais le mouvement s'avérera imperméable à ce
type de pressions. La défiance à l'égard de constructions
idéologiques passées, et, avant tout, les leçons de l'expérience
— la formation et l'élargissement du mouvement grâce à la
pratique des assemblées — furent, en général, les seules
raisons invoquées. Par exemple, quelques mois après l'occu-
pation de Turin, lorsque les limites de l'hyper-démocratie du
système des assemblées seront évidentes, vu les difficultés à
élaborer une ligne directrice cohérente et vu l'effritement
permanent du mouvement, toute tentative d'unification et
d'institutionalisation lui apparaît mutilante et paralysante,
même si elle adopte des formes plus souples que celles d'un
parti. En quelque sorte, le mouvement vit cette contradiction
à la fois comme potentialité et comme limite. Durant les
événements français, même face à des tâches urgentes, le
passage à une amorce d'unification ne s'est point accompli ;
l'unité ne s'est faite que lors des heurts. En France, le drapeau
noir de l'anarchie se greffa sur cette situation; mais s'agit-il
véritablement du courant idéologique traditionnel de l'anar-
chie? D'un pays à l'autre, la problématique est différente ;
en France vu les tendances au spontanéisme et à la démocratie
directe, il s'agit plus d'anarcho-syndicalisme que d'anarchie.
bien par les partis communistes que par leurs dissidences,
les « marxistes-léninistes » et, surtout en France, par les
trotskystes. Mais le mouvement s'avérera imperméable à ce
type de pressions. La défiance à l'égard de constructions
idéologiques passées, et, avant tout, les leçons de l'expérience
— la formation et l'élargissement du mouvement grâce à la
pratique des assemblées — furent, en général, les seules
raisons invoquées. Par exemple, quelques mois après l'occu-
pation de Turin, lorsque les limites de l'hyper-démocratie du
système des assemblées seront évidentes, vu les difficultés à
élaborer une ligne directrice cohérente et vu l'effritement
permanent du mouvement, toute tentative d'unification et
d'institutionalisation lui apparaît mutilante et paralysante,
même si elle adopte des formes plus souples que celles d'un
parti. En quelque sorte, le mouvement vit cette contradiction
à la fois comme potentialité et comme limite. Durant les
événements français, même face à des tâches urgentes, le
passage à une amorce d'unification ne s'est point accompli ;
l'unité ne s'est faite que lors des heurts. En France, le drapeau
noir de l'anarchie se greffa sur cette situation; mais s'agit-il
véritablement du courant idéologique traditionnel de l'anar-
chie? D'un pays à l'autre, la problématique est différente ;
en France vu les tendances au spontanéisme et à la démocratie
directe, il s'agit plus d'anarcho-syndicalisme que d'anarchie.
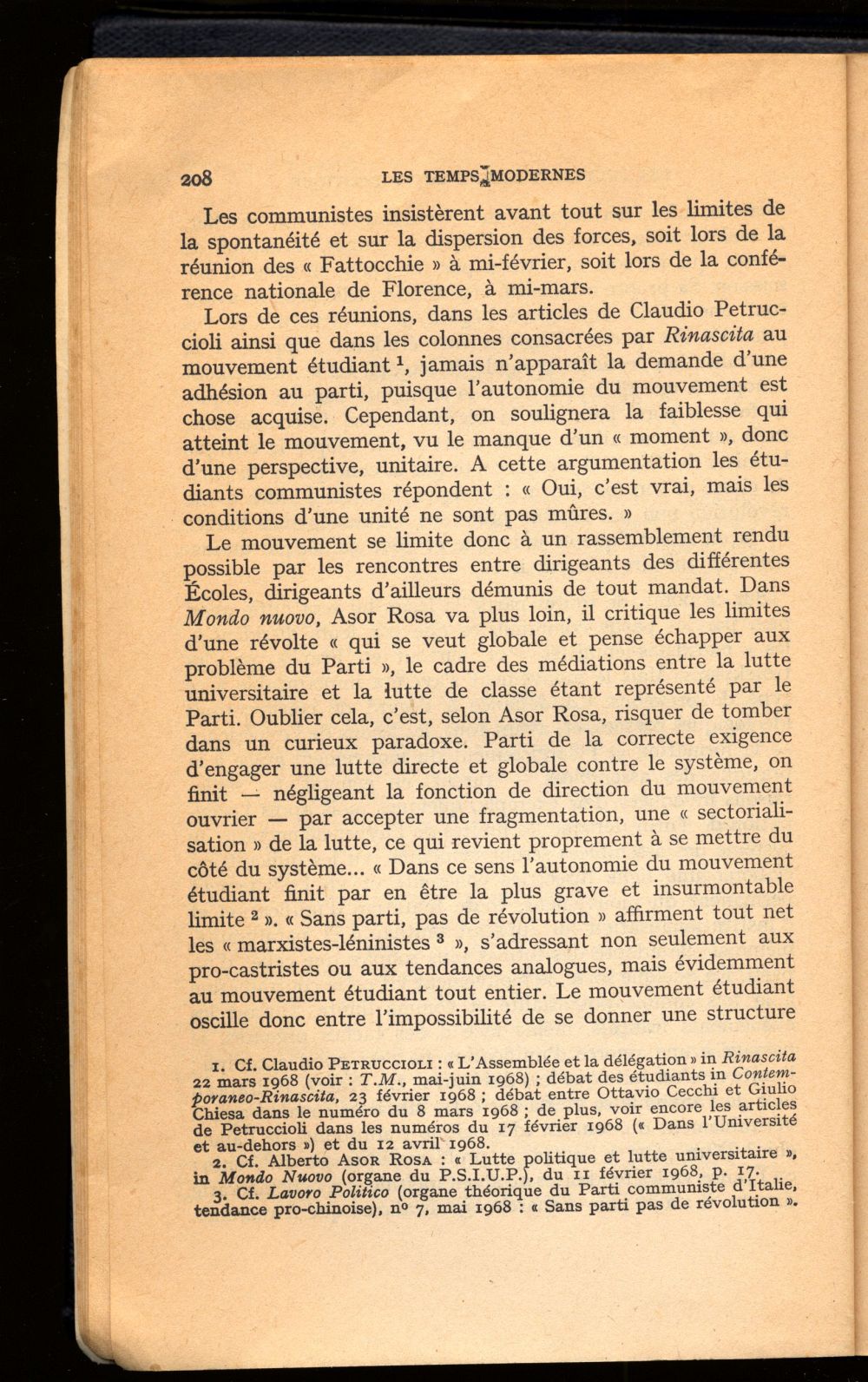

ao8
Les communistes insistèrent avant tout sur les limites de
la spontanéité et sur la dispersion des forces, soit lors de la
réunion des « Fattocchie » à mi-février, soit lors de la confé-
rence nationale de Florence, à mi-mars.
la spontanéité et sur la dispersion des forces, soit lors de la
réunion des « Fattocchie » à mi-février, soit lors de la confé-
rence nationale de Florence, à mi-mars.
Lors de ces réunions, dans les articles de Claudio Petruc-
cioli ainsi que dans les colonnes consacrées par Rinascita au
mouvement étudiant1, jamais n'apparaît la demande d'une
adhésion au parti, puisque l'autonomie du mouvement est
chose acquise. Cependant, on soulignera la faiblesse qui
atteint le mouvement, vu le manque d'un « moment », donc
d'une perspective, unitaire. A cette argumentation les étu-
diants communistes répondent : « Oui, c'est vrai, mais les
conditions d'une unité ne sont pas mûres. »
cioli ainsi que dans les colonnes consacrées par Rinascita au
mouvement étudiant1, jamais n'apparaît la demande d'une
adhésion au parti, puisque l'autonomie du mouvement est
chose acquise. Cependant, on soulignera la faiblesse qui
atteint le mouvement, vu le manque d'un « moment », donc
d'une perspective, unitaire. A cette argumentation les étu-
diants communistes répondent : « Oui, c'est vrai, mais les
conditions d'une unité ne sont pas mûres. »
Le mouvement se limite donc à un rassemblement rendu
possible par les rencontres entre dirigeants des différentes
Écoles, dirigeants d'ailleurs démunis de tout mandat. Dans
Mondo nuovo, Asor Rosa va plus loin, il critique les limites
d'une révolte « qui se veut globale et pense échapper aux
problème du Parti », le cadre des médiations entre la lutte
universitaire et la lutte de classe étant représenté par le
Parti. Oublier cela, c'est, selon Asor Rosa, risquer de tomber
dans un curieux paradoxe. Parti de la correcte exigence
d'engager une lutte directe et globale contre le système, on
finit — négligeant la fonction de direction du mouvement
ouvrier — par accepter une fragmentation, une « sectoriali-
sation » de la lutte, ce qui revient proprement à se mettre du
côté du système... « Dans ce sens l'autonomie du mouvement
étudiant finit par en être la plus grave et insurmontable
limite a ». « Sans parti, pas de révolution » affirment tout net
les « marxistes-léninistes 3 », s'adressant non seulement aux
pro-castristes ou aux tendances analogues, mais évidemment
au mouvement étudiant tout entier. Le mouvement étudiant
oscille donc entre l'impossibilité de se donner une structure
possible par les rencontres entre dirigeants des différentes
Écoles, dirigeants d'ailleurs démunis de tout mandat. Dans
Mondo nuovo, Asor Rosa va plus loin, il critique les limites
d'une révolte « qui se veut globale et pense échapper aux
problème du Parti », le cadre des médiations entre la lutte
universitaire et la lutte de classe étant représenté par le
Parti. Oublier cela, c'est, selon Asor Rosa, risquer de tomber
dans un curieux paradoxe. Parti de la correcte exigence
d'engager une lutte directe et globale contre le système, on
finit — négligeant la fonction de direction du mouvement
ouvrier — par accepter une fragmentation, une « sectoriali-
sation » de la lutte, ce qui revient proprement à se mettre du
côté du système... « Dans ce sens l'autonomie du mouvement
étudiant finit par en être la plus grave et insurmontable
limite a ». « Sans parti, pas de révolution » affirment tout net
les « marxistes-léninistes 3 », s'adressant non seulement aux
pro-castristes ou aux tendances analogues, mais évidemment
au mouvement étudiant tout entier. Le mouvement étudiant
oscille donc entre l'impossibilité de se donner une structure
1. Cf. Claudio PETRUCCIOLI : « L'Assemblée et la délégation » in Rinascita
22 mars 1968 (voir : T.M., mai-juin 1968) ; débat des étudiants in Contem-
poraneo-Rinascita, 23 février 1968 ; débat entre Ottavio Cecchi et Giulio
Chiesa dans le numéro du 8 mars 1968 ; de plus, voir encore les articles
de Petruccioli dans les numéros du 17 février 1968 (« Dans l'Université
et au-dehors ») et du 12 avril 1968.
22 mars 1968 (voir : T.M., mai-juin 1968) ; débat des étudiants in Contem-
poraneo-Rinascita, 23 février 1968 ; débat entre Ottavio Cecchi et Giulio
Chiesa dans le numéro du 8 mars 1968 ; de plus, voir encore les articles
de Petruccioli dans les numéros du 17 février 1968 (« Dans l'Université
et au-dehors ») et du 12 avril 1968.
2. Cf. Alberto ASOR ROSA : « Lutte politique et lutte universitaire »,
in Mondo Nuovo (organe du P.S.I.U.P.), du n février 1968, p. 17.
in Mondo Nuovo (organe du P.S.I.U.P.), du n février 1968, p. 17.
3. Cf. Lavoro Politico (organe théorique du Parti communiste d'Italie,
tendance pro-chinoise), n° 7, mai 1968 : « Sans parti pas de révolution ».
tendance pro-chinoise), n° 7, mai 1968 : « Sans parti pas de révolution ».
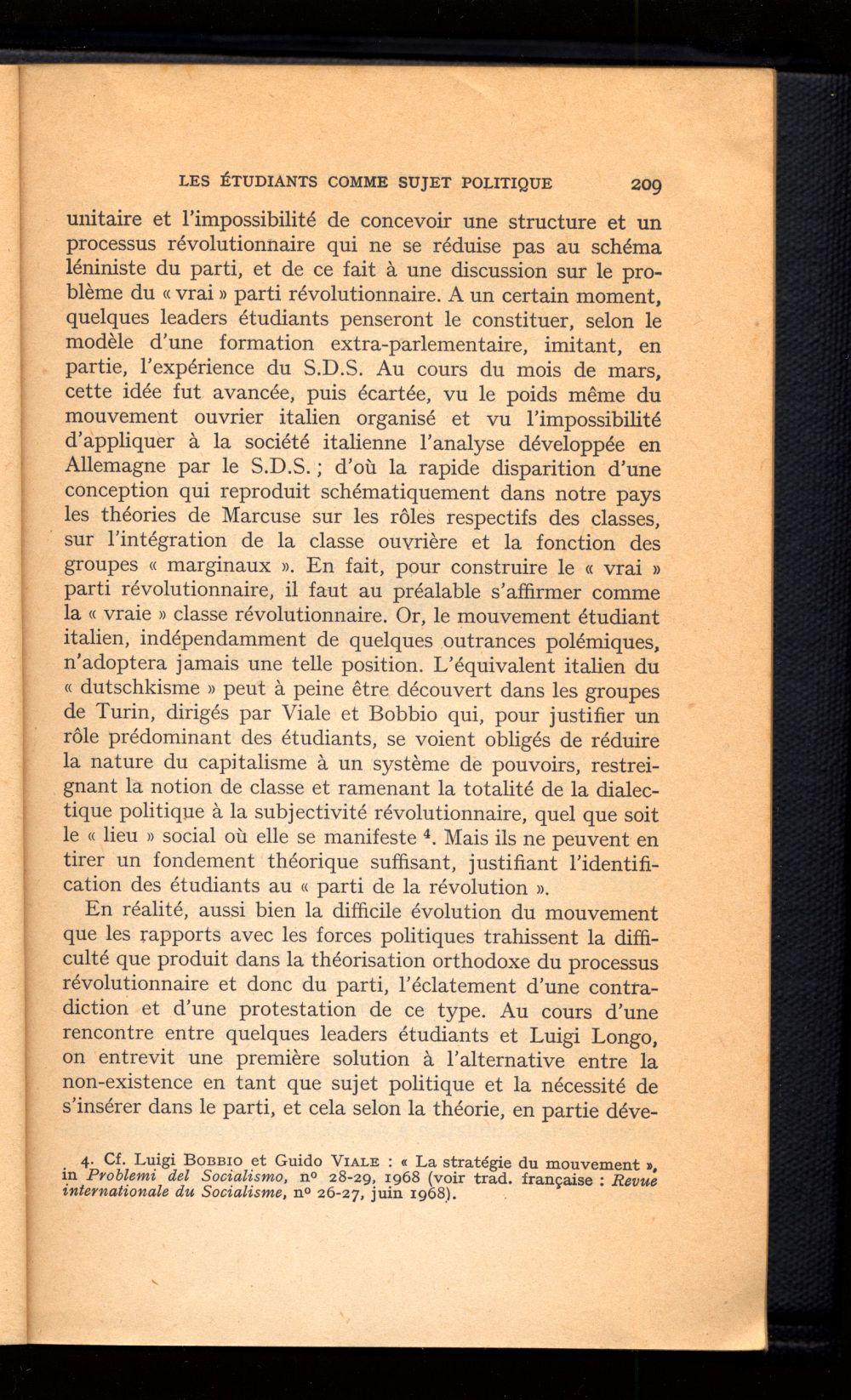

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
20Q
unitaire et l'impossibilité de concevoir une structure et un
processus révolutionnaire qui ne se réduise pas au schéma
léniniste du parti, et de ce fait à une discussion sur le pro-
blème du « vrai » parti révolutionnaire. A un certain moment,
quelques leaders étudiants penseront le constituer, selon le
modèle d'une formation extra-parlementaire, imitant, en
partie, l'expérience du S.D.S. Au cours du mois de mars,
cette idée fut avancée, puis écartée, vu le poids même du
mouvement ouvrier italien organisé et vu l'impossibilité
d'appliquer à la société italienne l'analyse développée en
Allemagne par le S.D.S. ; d'où la rapide disparition d'une
conception qui reproduit schématiquement dans notre pays
les théories de Marcuse sur les rôles respectifs des classes,
sur l'intégration de la classe ouvrière et la fonction des
groupes « marginaux ». En fait, pour construire le « vrai »
parti révolutionnaire, il faut au préalable s'affirmer comme
la « vraie » classe révolutionnaire. Or, le mouvement étudiant
italien, indépendamment de quelques outrances polémiques,
n'adoptera jamais une telle position. L'équivalent italien du
« dutschkisme » peut à peine être découvert dans les groupes
de Turin, dirigés par Viale et Bobbio qui, pour justifier un
rôle prédominant des étudiants, se voient obligés de réduire
la nature du capitalisme à un système de pouvoirs, restrei-
gnant la notion de classe et ramenant la totalité de la dialec-
tique politique à la subjectivité révolutionnaire, quel que soit
le « lieu » social où elle se manifeste 4. Mais ils ne peuvent en
tirer un fondement théorique suffisant, justifiant l'identifi-
cation des étudiants au « parti de la révolution ».
processus révolutionnaire qui ne se réduise pas au schéma
léniniste du parti, et de ce fait à une discussion sur le pro-
blème du « vrai » parti révolutionnaire. A un certain moment,
quelques leaders étudiants penseront le constituer, selon le
modèle d'une formation extra-parlementaire, imitant, en
partie, l'expérience du S.D.S. Au cours du mois de mars,
cette idée fut avancée, puis écartée, vu le poids même du
mouvement ouvrier italien organisé et vu l'impossibilité
d'appliquer à la société italienne l'analyse développée en
Allemagne par le S.D.S. ; d'où la rapide disparition d'une
conception qui reproduit schématiquement dans notre pays
les théories de Marcuse sur les rôles respectifs des classes,
sur l'intégration de la classe ouvrière et la fonction des
groupes « marginaux ». En fait, pour construire le « vrai »
parti révolutionnaire, il faut au préalable s'affirmer comme
la « vraie » classe révolutionnaire. Or, le mouvement étudiant
italien, indépendamment de quelques outrances polémiques,
n'adoptera jamais une telle position. L'équivalent italien du
« dutschkisme » peut à peine être découvert dans les groupes
de Turin, dirigés par Viale et Bobbio qui, pour justifier un
rôle prédominant des étudiants, se voient obligés de réduire
la nature du capitalisme à un système de pouvoirs, restrei-
gnant la notion de classe et ramenant la totalité de la dialec-
tique politique à la subjectivité révolutionnaire, quel que soit
le « lieu » social où elle se manifeste 4. Mais ils ne peuvent en
tirer un fondement théorique suffisant, justifiant l'identifi-
cation des étudiants au « parti de la révolution ».
En réalité, aussi bien la difficile évolution du mouvement
que les rapports avec les forces politiques trahissent la diffi-
culté que produit dans la théorisation orthodoxe du processus
révolutionnaire et donc du parti, l'éclatement d'une contra-
diction et d'une protestation de ce type. Au cours d'une
rencontre entre quelques leaders étudiants et Luigi Longo,
on entrevit une première solution à l'alternative entre la
non-existence en tant que sujet politique et la nécessité de
s'insérer dans le parti, et cela selon la théorie, en partie déve-
que les rapports avec les forces politiques trahissent la diffi-
culté que produit dans la théorisation orthodoxe du processus
révolutionnaire et donc du parti, l'éclatement d'une contra-
diction et d'une protestation de ce type. Au cours d'une
rencontre entre quelques leaders étudiants et Luigi Longo,
on entrevit une première solution à l'alternative entre la
non-existence en tant que sujet politique et la nécessité de
s'insérer dans le parti, et cela selon la théorie, en partie déve-
4. Cf. Luigi BOBBIO et Guido VIALE : « La stratégie du mouvement »,
in Problemi del Socialisme, n° 28-29, 1968 (voir trad. française : Revue
internationale du Socialisme, n° 26-27, juin 1968).
in Problemi del Socialisme, n° 28-29, 1968 (voir trad. française : Revue
internationale du Socialisme, n° 26-27, juin 1968).
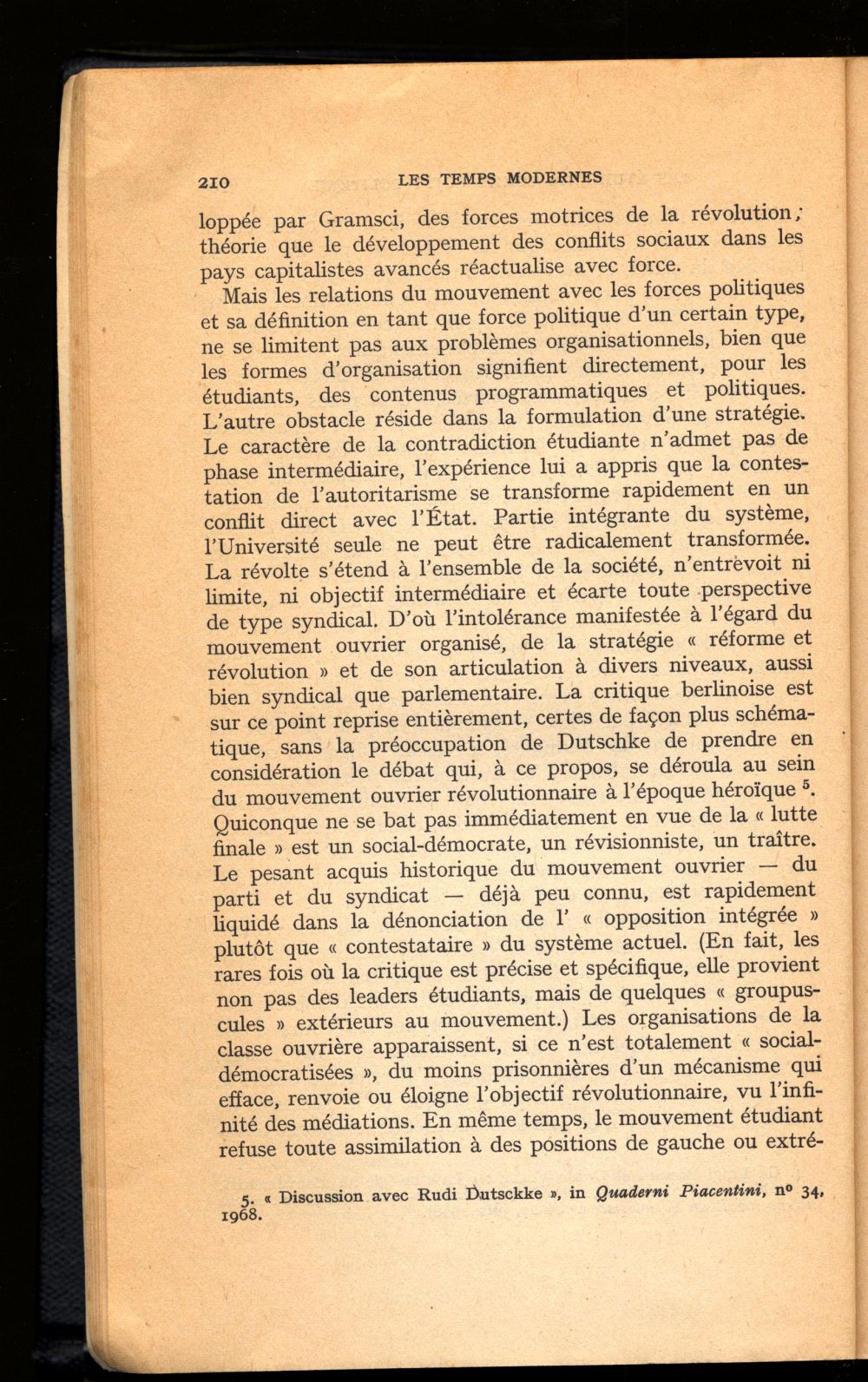

210
LES TEMPS MODERNES
loppée par Gramsci, des forces motrices de la révolution;
théorie que le développement des conflits sociaux dans les
pays capitalistes avancés réactualise avec force.
théorie que le développement des conflits sociaux dans les
pays capitalistes avancés réactualise avec force.
Mais les relations du mouvement avec les forces politiques
et sa définition en tant que force politique d'un certain type,
ne se limitent pas aux problèmes organisationnels, bien que
les formes d'organisation signifient directement, pour les
étudiants, des contenus programmatiques et politiques.
L'autre obstacle réside dans la formulation d'une stratégie.
Le caractère de la contradiction étudiante n'admet pas de
phase intermédiaire, l'expérience lui a appris que la contes-
tation de l'autoritarisme se transforme rapidement en un
conflit direct avec l'État. Partie intégrante du système,
l'Université seule ne peut être radicalement transformée.
La révolte s'étend à l'ensemble de la société, n'entrevoit ni
limite, ni objectif intermédiaire et écarte toute perspective
de type syndical. D'où l'intolérance manifestée à l'égard du
mouvement ouvrier organisé, de la stratégie « réforme et
révolution » et de son articulation à divers niveaux, aussi
bien syndical que parlementaire. La critique berlinoise est
sur ce point reprise entièrement, certes de façon plus schéma-
tique, sans la préoccupation de Dutschke de prendre en
considération le débat qui, à ce propos, se déroula au sein
du mouvement ouvrier révolutionnaire à l'époque héroïque 5.
Quiconque ne se bat pas immédiatement en vue de la « lutte
finale » est un social-démocrate, un révisionniste, un traître.
Le pesant acquis historique du mouvement ouvrier — du
parti et du syndicat — déjà peu connu, est rapidement
liquidé dans la dénonciation de 1' « opposition intégrée »
plutôt que « contestataire » du système actuel. (En fait, les
rares fois où la critique est précise et spécifique, elle provient
non pas des leaders étudiants, mais de quelques « groupus-
cules » extérieurs au mouvement.) Les organisations de la
classe ouvrière apparaissent, si ce n'est totalement « social-
démocratisées », du moins prisonnières d'un mécanisme qui
efface, renvoie ou éloigne l'objectif révolutionnaire, vu l'infi-
nité des médiations. En même temps, le mouvement étudiant
refuse toute assimilation à des positions de gauche ou extré-
et sa définition en tant que force politique d'un certain type,
ne se limitent pas aux problèmes organisationnels, bien que
les formes d'organisation signifient directement, pour les
étudiants, des contenus programmatiques et politiques.
L'autre obstacle réside dans la formulation d'une stratégie.
Le caractère de la contradiction étudiante n'admet pas de
phase intermédiaire, l'expérience lui a appris que la contes-
tation de l'autoritarisme se transforme rapidement en un
conflit direct avec l'État. Partie intégrante du système,
l'Université seule ne peut être radicalement transformée.
La révolte s'étend à l'ensemble de la société, n'entrevoit ni
limite, ni objectif intermédiaire et écarte toute perspective
de type syndical. D'où l'intolérance manifestée à l'égard du
mouvement ouvrier organisé, de la stratégie « réforme et
révolution » et de son articulation à divers niveaux, aussi
bien syndical que parlementaire. La critique berlinoise est
sur ce point reprise entièrement, certes de façon plus schéma-
tique, sans la préoccupation de Dutschke de prendre en
considération le débat qui, à ce propos, se déroula au sein
du mouvement ouvrier révolutionnaire à l'époque héroïque 5.
Quiconque ne se bat pas immédiatement en vue de la « lutte
finale » est un social-démocrate, un révisionniste, un traître.
Le pesant acquis historique du mouvement ouvrier — du
parti et du syndicat — déjà peu connu, est rapidement
liquidé dans la dénonciation de 1' « opposition intégrée »
plutôt que « contestataire » du système actuel. (En fait, les
rares fois où la critique est précise et spécifique, elle provient
non pas des leaders étudiants, mais de quelques « groupus-
cules » extérieurs au mouvement.) Les organisations de la
classe ouvrière apparaissent, si ce n'est totalement « social-
démocratisées », du moins prisonnières d'un mécanisme qui
efface, renvoie ou éloigne l'objectif révolutionnaire, vu l'infi-
nité des médiations. En même temps, le mouvement étudiant
refuse toute assimilation à des positions de gauche ou extré-
5. « Discussion avec Rudi Dutsckke », in Quaderni Piacentini, n° 34,
1968.
1968.
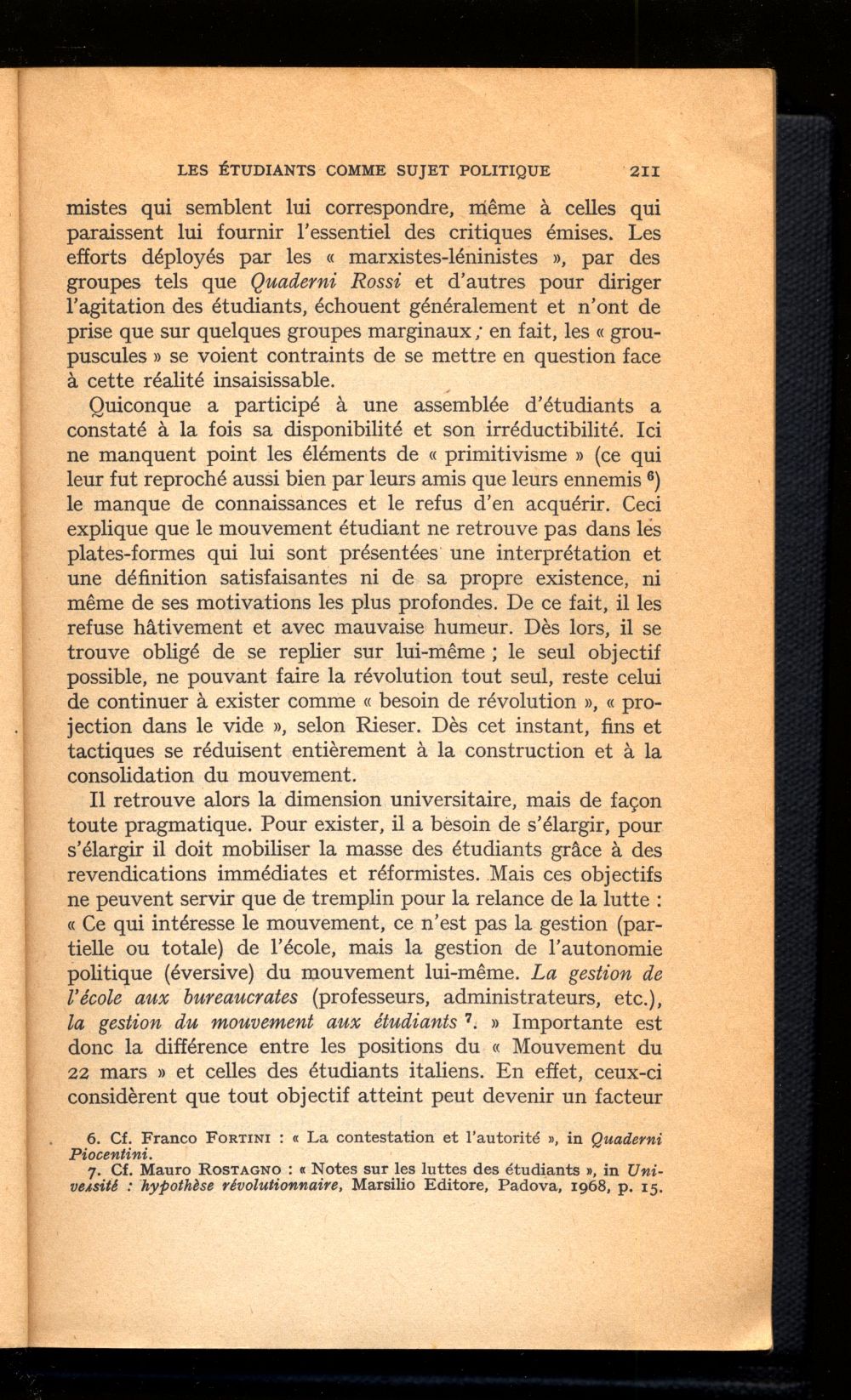

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
211
mistes qui semblent lui correspondre, même à celles qui
paraissent lui fournir l'essentiel des critiques émises. Les
efforts déployés par les « marxistes-léninistes », par des
groupes tels que Quaderni Rossi et d'autres pour diriger
l'agitation des étudiants, échouent généralement et n'ont de
prise que sur quelques groupes marginaux ; en fait, les « grou-
puscules » se voient contraints de se mettre en question face
à cette réalité insaisissable.
paraissent lui fournir l'essentiel des critiques émises. Les
efforts déployés par les « marxistes-léninistes », par des
groupes tels que Quaderni Rossi et d'autres pour diriger
l'agitation des étudiants, échouent généralement et n'ont de
prise que sur quelques groupes marginaux ; en fait, les « grou-
puscules » se voient contraints de se mettre en question face
à cette réalité insaisissable.
Quiconque a participé à une assemblée d'étudiants a
constaté à la fois sa disponibilité et son irréductibilité. Ici
ne manquent point les éléments de « primitivisme » (ce qui
leur fut reproché aussi bien par leurs amis que leurs ennemis 6)
le manque de connaissances et le refus d'en acquérir. Ceci
explique que le mouvement étudiant ne retrouve pas dans lés
plates-formes qui lui sont présentées une interprétation et
une définition satisfaisantes ni de sa propre existence, ni
même de ses motivations les plus profondes. De ce fait, il les
refuse hâtivement et avec mauvaise humeur. Dès lors, il se
trouve obligé de se replier sur lui-même ; le seul objectif
possible, ne pouvant faire la révolution tout seul, reste celui
de continuer à exister comme « besoin de révolution », « pro-
jection dans le vide », selon Rieser. Dès cet instant, fins et
tactiques se réduisent entièrement à la construction et à la
consolidation du mouvement.
constaté à la fois sa disponibilité et son irréductibilité. Ici
ne manquent point les éléments de « primitivisme » (ce qui
leur fut reproché aussi bien par leurs amis que leurs ennemis 6)
le manque de connaissances et le refus d'en acquérir. Ceci
explique que le mouvement étudiant ne retrouve pas dans lés
plates-formes qui lui sont présentées une interprétation et
une définition satisfaisantes ni de sa propre existence, ni
même de ses motivations les plus profondes. De ce fait, il les
refuse hâtivement et avec mauvaise humeur. Dès lors, il se
trouve obligé de se replier sur lui-même ; le seul objectif
possible, ne pouvant faire la révolution tout seul, reste celui
de continuer à exister comme « besoin de révolution », « pro-
jection dans le vide », selon Rieser. Dès cet instant, fins et
tactiques se réduisent entièrement à la construction et à la
consolidation du mouvement.
Il retrouve alors la dimension universitaire, mais de façon
toute pragmatique. Pour exister, il a besoin de s'élargir, pour
s'élargir il doit mobiliser la masse des étudiants grâce à des
revendications immédiates et réformistes. Mais ces objectifs
ne peuvent servir que de tremplin pour la relance de la lutte :
« Ce qui intéresse le mouvement, ce n'est pas la gestion (par-
tielle ou totale) de l'école, mais la gestion de l'autonomie
politique (éversive) du mouvement lui-même. La gestion de
l'école aux bureaucrates (professeurs, administrateurs, etc.),
la gestion du mouvement aux étudiants 7. » Importante est
donc la différence entre les positions du « Mouvement du
22 mars » et celles des étudiants italiens. En effet, ceux-ci
considèrent que tout objectif atteint peut devenir un facteur
toute pragmatique. Pour exister, il a besoin de s'élargir, pour
s'élargir il doit mobiliser la masse des étudiants grâce à des
revendications immédiates et réformistes. Mais ces objectifs
ne peuvent servir que de tremplin pour la relance de la lutte :
« Ce qui intéresse le mouvement, ce n'est pas la gestion (par-
tielle ou totale) de l'école, mais la gestion de l'autonomie
politique (éversive) du mouvement lui-même. La gestion de
l'école aux bureaucrates (professeurs, administrateurs, etc.),
la gestion du mouvement aux étudiants 7. » Importante est
donc la différence entre les positions du « Mouvement du
22 mars » et celles des étudiants italiens. En effet, ceux-ci
considèrent que tout objectif atteint peut devenir un facteur
6. Cf. Franco FORTINI : « La contestation et l'autorité », in Quaderni
Piocentini.
Piocentini.
7. Cf. Mauro ROSTAGNO : « Notes sur les luttes des étudiants », in Uni-
versité : hypothèse révolutionnaire, Marsilio Editore, Padova, 1968, p. 15.
versité : hypothèse révolutionnaire, Marsilio Editore, Padova, 1968, p. 15.
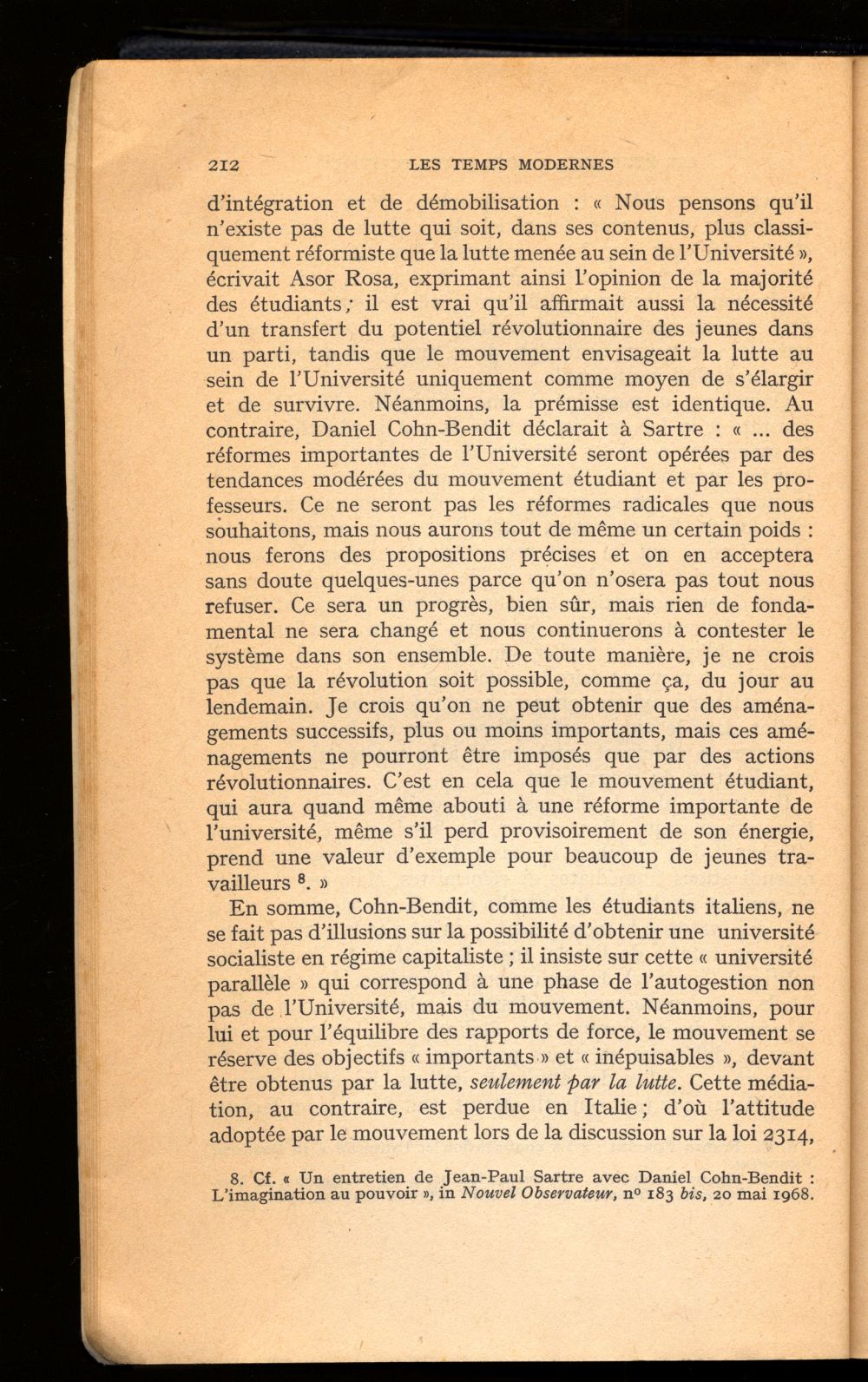

212
LES TEMPS MODERNES
d'intégration et de démobilisation : « Nous pensons qu'il
n'existe pas de lutte qui soit, dans ses contenus, plus classi-
quement réformiste que la lutte menée au sein de l'Université »,
écrivait Asor Rosa, exprimant ainsi l'opinion de la majorité
des étudiants; il est vrai qu'il affirmait aussi la nécessité
d'un transfert du potentiel révolutionnaire des jeunes dans
un parti, tandis que le mouvement envisageait la lutte au
sein de l'Université uniquement comme moyen de s'élargir
et de survivre. Néanmoins, la prémisse est identique. Au
contraire, Daniel Cohn-Bendit déclarait à Sartre : « ... des
réformes importantes de l'Université seront opérées par des
tendances modérées du mouvement étudiant et par les pro-
fesseurs. Ce ne seront pas les réformes radicales que nous
souhaitons, mais nous aurons tout de même un certain poids :
nous ferons des propositions précises et on en acceptera
sans doute quelques-unes parce qu'on n'osera pas tout nous
refuser. Ce sera un progrès, bien sûr, mais rien de fonda-
mental ne sera changé et nous continuerons à contester le
système dans son ensemble. De toute manière, je ne crois
pas que la révolution soit possible, comme ça, du jour au
lendemain. Je crois qu'on ne peut obtenir que des aména-
gements successifs, plus ou moins importants, mais ces amé-
nagements ne pourront être imposés que par des actions
révolutionnaires. C'est en cela que le mouvement étudiant,
qui aura quand même abouti à une réforme importante de
l'université, même s'il perd provisoirement de son énergie,
prend une valeur d'exemple pour beaucoup de jeunes tra-
vailleurs 8. »
n'existe pas de lutte qui soit, dans ses contenus, plus classi-
quement réformiste que la lutte menée au sein de l'Université »,
écrivait Asor Rosa, exprimant ainsi l'opinion de la majorité
des étudiants; il est vrai qu'il affirmait aussi la nécessité
d'un transfert du potentiel révolutionnaire des jeunes dans
un parti, tandis que le mouvement envisageait la lutte au
sein de l'Université uniquement comme moyen de s'élargir
et de survivre. Néanmoins, la prémisse est identique. Au
contraire, Daniel Cohn-Bendit déclarait à Sartre : « ... des
réformes importantes de l'Université seront opérées par des
tendances modérées du mouvement étudiant et par les pro-
fesseurs. Ce ne seront pas les réformes radicales que nous
souhaitons, mais nous aurons tout de même un certain poids :
nous ferons des propositions précises et on en acceptera
sans doute quelques-unes parce qu'on n'osera pas tout nous
refuser. Ce sera un progrès, bien sûr, mais rien de fonda-
mental ne sera changé et nous continuerons à contester le
système dans son ensemble. De toute manière, je ne crois
pas que la révolution soit possible, comme ça, du jour au
lendemain. Je crois qu'on ne peut obtenir que des aména-
gements successifs, plus ou moins importants, mais ces amé-
nagements ne pourront être imposés que par des actions
révolutionnaires. C'est en cela que le mouvement étudiant,
qui aura quand même abouti à une réforme importante de
l'université, même s'il perd provisoirement de son énergie,
prend une valeur d'exemple pour beaucoup de jeunes tra-
vailleurs 8. »
En somme, Cohn-Bendit, comme les étudiants italiens, ne
se fait pas d'illusions sur la possibilité d'obtenir une université
socialiste en régime capitaliste ; il insiste sur cette « université
parallèle » qui correspond à une phase de l'autogestion non
pas de l'Université, mais du mouvement. Néanmoins, pour
lui et pour l'équilibre des rapports de force, le mouvement se
réserve des objectifs « importants » et « inépuisables », devant
être obtenus par la lutte, seulement par la lutte. Cette média-
tion, au contraire, est perdue en Italie ; d'où l'attitude
adoptée par le mouvement lors de la discussion sur la loi 2314,
se fait pas d'illusions sur la possibilité d'obtenir une université
socialiste en régime capitaliste ; il insiste sur cette « université
parallèle » qui correspond à une phase de l'autogestion non
pas de l'Université, mais du mouvement. Néanmoins, pour
lui et pour l'équilibre des rapports de force, le mouvement se
réserve des objectifs « importants » et « inépuisables », devant
être obtenus par la lutte, seulement par la lutte. Cette média-
tion, au contraire, est perdue en Italie ; d'où l'attitude
adoptée par le mouvement lors de la discussion sur la loi 2314,
8. Cf. « Un entretien de Jean-Paul Sartre avec Daniel Cohn-Bendit :
L'imagination au pouvoir », in Nouvel Observateur, n° 183 bis, 20 mai 1968.
L'imagination au pouvoir », in Nouvel Observateur, n° 183 bis, 20 mai 1968.
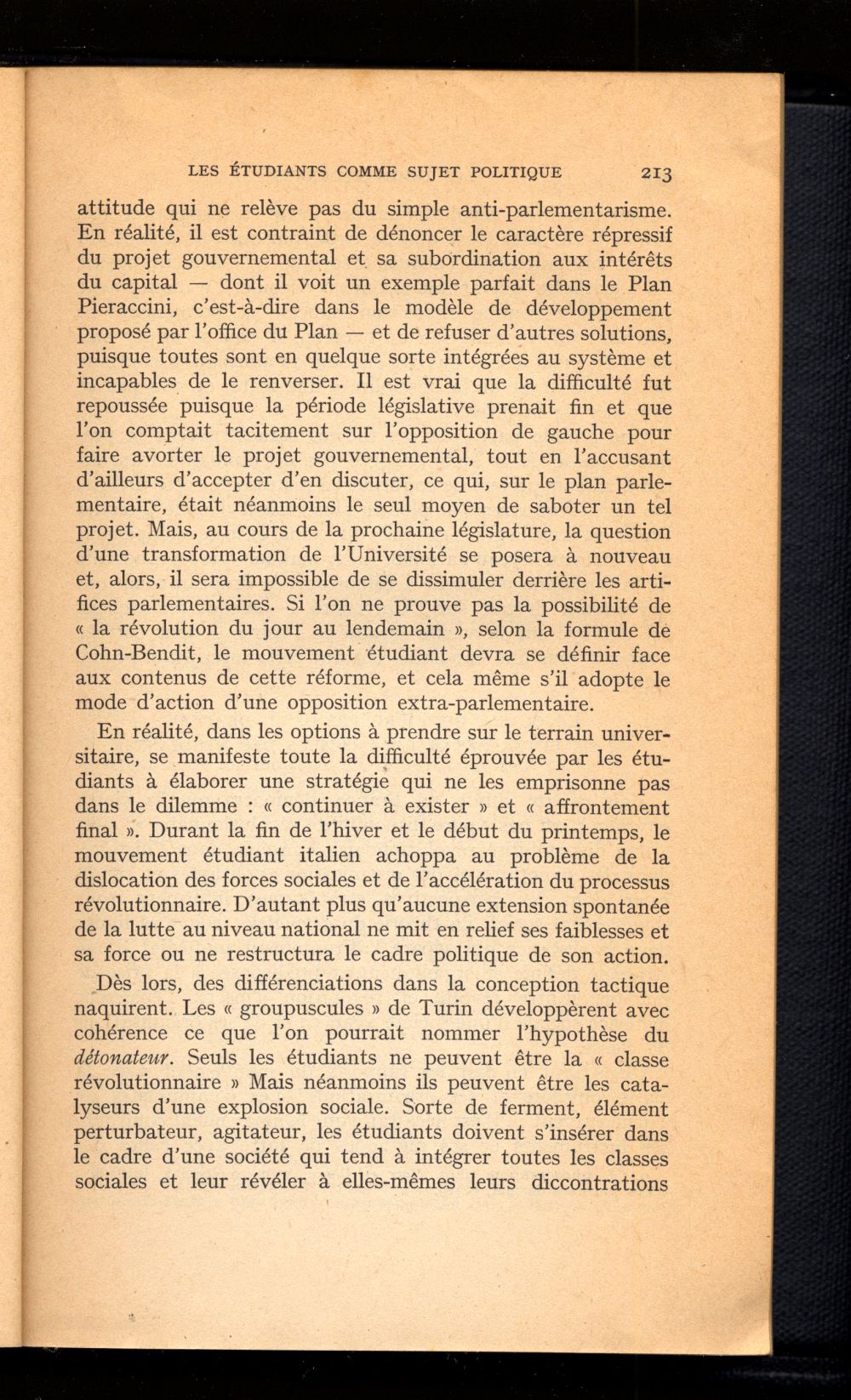

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
213
attitude qui ne relève pas du simple anti-parlementarisme.
En réalité, il est contraint de dénoncer le caractère répressif
du projet gouvernemental et sa subordination aux intérêts
du capital — dont il voit un exemple parfait dans le Plan
Pieraccini, c'est-à-dire dans le modèle de développement
proposé par l'office du Plan — et de refuser d'autres solutions,
puisque toutes sont en quelque sorte intégrées au système et
incapables de le renverser. Il est vrai que la difficulté fut
repoussée puisque la période législative prenait fin et que
l'on comptait tacitement sur l'opposition de gauche pour
faire avorter le projet gouvernemental, tout en l'accusant
d'ailleurs d'accepter d'en discuter, ce qui, sur le plan parle-
mentaire, était néanmoins le seul moyen de saboter un tel
projet. Mais, au cours de la prochaine législature, la question
d'une transformation de l'Université se posera à nouveau
et, alors, il sera impossible de se dissimuler derrière les arti-
fices parlementaires. Si l'on ne prouve pas la possibilité de
« la révolution du jour au lendemain », selon la formule de
Cohn-Bendit, le mouvement étudiant devra se définir face
aux contenus de cette réforme, et cela même s'il adopte le
mode d'action d'une opposition extra-parlementaire.
En réalité, il est contraint de dénoncer le caractère répressif
du projet gouvernemental et sa subordination aux intérêts
du capital — dont il voit un exemple parfait dans le Plan
Pieraccini, c'est-à-dire dans le modèle de développement
proposé par l'office du Plan — et de refuser d'autres solutions,
puisque toutes sont en quelque sorte intégrées au système et
incapables de le renverser. Il est vrai que la difficulté fut
repoussée puisque la période législative prenait fin et que
l'on comptait tacitement sur l'opposition de gauche pour
faire avorter le projet gouvernemental, tout en l'accusant
d'ailleurs d'accepter d'en discuter, ce qui, sur le plan parle-
mentaire, était néanmoins le seul moyen de saboter un tel
projet. Mais, au cours de la prochaine législature, la question
d'une transformation de l'Université se posera à nouveau
et, alors, il sera impossible de se dissimuler derrière les arti-
fices parlementaires. Si l'on ne prouve pas la possibilité de
« la révolution du jour au lendemain », selon la formule de
Cohn-Bendit, le mouvement étudiant devra se définir face
aux contenus de cette réforme, et cela même s'il adopte le
mode d'action d'une opposition extra-parlementaire.
En réalité, dans les options à prendre sur le terrain univer-
sitaire, se manifeste toute la difficulté éprouvée par les étu-
diants à élaborer une stratégie qui ne les emprisonne pas
dans le dilemme : « continuer à exister » et « affrontement
final ». Durant la fin de l'hiver et le début du printemps, le
mouvement étudiant italien achoppa au problème de la
dislocation des forces sociales et de l'accélération du processus
révolutionnaire. D'autant plus qu'aucune extension spontanée
de la lutte au niveau national ne mit en relief ses faiblesses et
sa force ou ne restructura le cadre politique de son action.
sitaire, se manifeste toute la difficulté éprouvée par les étu-
diants à élaborer une stratégie qui ne les emprisonne pas
dans le dilemme : « continuer à exister » et « affrontement
final ». Durant la fin de l'hiver et le début du printemps, le
mouvement étudiant italien achoppa au problème de la
dislocation des forces sociales et de l'accélération du processus
révolutionnaire. D'autant plus qu'aucune extension spontanée
de la lutte au niveau national ne mit en relief ses faiblesses et
sa force ou ne restructura le cadre politique de son action.
Dès lors, des différenciations dans la conception tactique
naquirent. Les « groupuscules » de Turin développèrent avec
cohérence ce que l'on pourrait nommer l'hypothèse du
détonateur. Seuls les étudiants ne peuvent être la « classe
révolutionnaire » Mais néanmoins ils peuvent être les cata-
lyseurs d'une explosion sociale. Sorte de ferment, élément
perturbateur, agitateur, les étudiants doivent s'insérer dans
le cadre d'une société qui tend à intégrer toutes les classes
sociales et leur révéler à elles-mêmes leurs diccontrations
naquirent. Les « groupuscules » de Turin développèrent avec
cohérence ce que l'on pourrait nommer l'hypothèse du
détonateur. Seuls les étudiants ne peuvent être la « classe
révolutionnaire » Mais néanmoins ils peuvent être les cata-
lyseurs d'une explosion sociale. Sorte de ferment, élément
perturbateur, agitateur, les étudiants doivent s'insérer dans
le cadre d'une société qui tend à intégrer toutes les classes
sociales et leur révéler à elles-mêmes leurs diccontrations
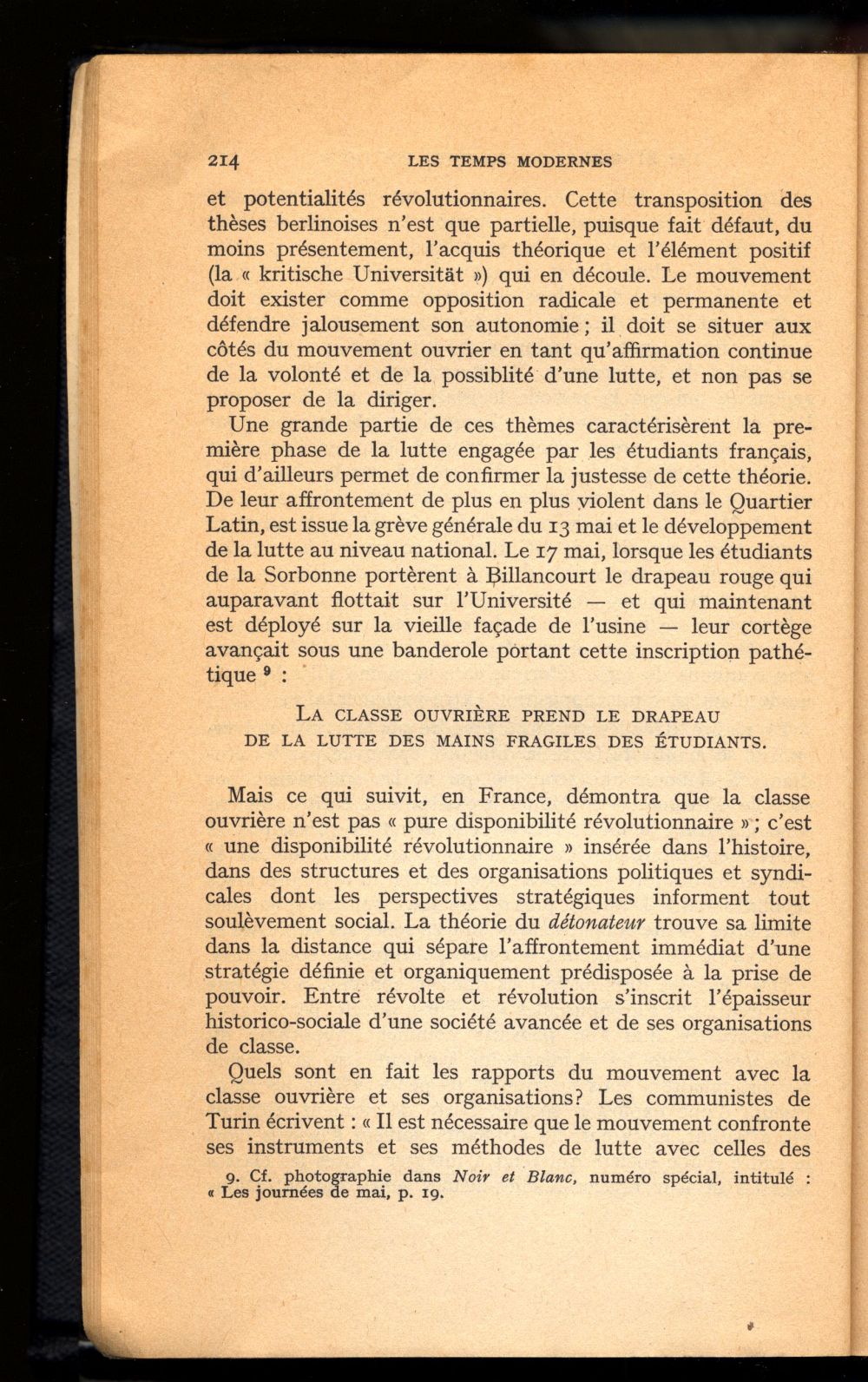

214
LES TEMPS MODERNES
et potentialités révolutionnaires. Cette transposition des
thèses berlinoises n'est que partielle, puisque fait défaut, du
moins présentement, l'acquis théorique et l'élément positif
(la « kritische Universitât ») qui en découle. Le mouvement
doit exister comme opposition radicale et permanente et
défendre jalousement son autonomie ; il doit se situer aux
côtés du mouvement ouvrier en tant qu'affirmation continue
de la volonté et de la possiblité d'une lutte, et non pas se
proposer de la diriger.
thèses berlinoises n'est que partielle, puisque fait défaut, du
moins présentement, l'acquis théorique et l'élément positif
(la « kritische Universitât ») qui en découle. Le mouvement
doit exister comme opposition radicale et permanente et
défendre jalousement son autonomie ; il doit se situer aux
côtés du mouvement ouvrier en tant qu'affirmation continue
de la volonté et de la possiblité d'une lutte, et non pas se
proposer de la diriger.
Une grande partie de ces thèmes caractérisèrent la pre-
mière phase de la lutte engagée par les étudiants français,
qui d'ailleurs permet de confirmer la justesse de cette théorie.
De leur affrontement de plus en plus violent dans le Quartier
Latin, est issue la grève générale du 13 mai et le développement
de la lutte au niveau national. Le 17 mai, lorsque les étudiants
de la Sorbonne portèrent à Billancourt le drapeau rouge qui
auparavant flottait sur l'Université — et qui maintenant
est déployé sur la vieille façade de l'usine — leur cortège
avançait sous une banderole portant cette inscription pathé-
tique 9 :
mière phase de la lutte engagée par les étudiants français,
qui d'ailleurs permet de confirmer la justesse de cette théorie.
De leur affrontement de plus en plus violent dans le Quartier
Latin, est issue la grève générale du 13 mai et le développement
de la lutte au niveau national. Le 17 mai, lorsque les étudiants
de la Sorbonne portèrent à Billancourt le drapeau rouge qui
auparavant flottait sur l'Université — et qui maintenant
est déployé sur la vieille façade de l'usine — leur cortège
avançait sous une banderole portant cette inscription pathé-
tique 9 :
LA CLASSE OUVRIÈRE PREND LE DRAPEAU
DE LA LUTTE DES MAINS FRAGILES DES ÉTUDIANTS.
DE LA LUTTE DES MAINS FRAGILES DES ÉTUDIANTS.
Mais ce qui suivit, en France, démontra que la classe
ouvrière n'est pas « pure disponibilité révolutionnaire » ; c'est
« une disponibilité révolutionnaire » insérée dans l'histoire,
dans des structures et des organisations politiques et syndi-
cales dont les perspectives stratégiques informent tout
soulèvement social. La théorie du détonateur trouve sa limite
dans la distance qui sépare l'affrontement immédiat d'une
stratégie définie et organiquement prédisposée à la prise de
pouvoir. Entre révolte et révolution s'inscrit l'épaisseur
historico-sociale d'une société avancée et de ses organisations
de classe.
ouvrière n'est pas « pure disponibilité révolutionnaire » ; c'est
« une disponibilité révolutionnaire » insérée dans l'histoire,
dans des structures et des organisations politiques et syndi-
cales dont les perspectives stratégiques informent tout
soulèvement social. La théorie du détonateur trouve sa limite
dans la distance qui sépare l'affrontement immédiat d'une
stratégie définie et organiquement prédisposée à la prise de
pouvoir. Entre révolte et révolution s'inscrit l'épaisseur
historico-sociale d'une société avancée et de ses organisations
de classe.
Quels sont en fait les rapports du mouvement avec la
classe ouvrière et ses organisations? Les communistes de
Turin écrivent : « II est nécessaire que le mouvement confronte
ses instruments et ses méthodes de lutte avec celles des
classe ouvrière et ses organisations? Les communistes de
Turin écrivent : « II est nécessaire que le mouvement confronte
ses instruments et ses méthodes de lutte avec celles des
9. Cf. photographie dans Noir et Blanc, numéro spécial, intitulé :
« Les journées de mai, p. 19.
« Les journées de mai, p. 19.
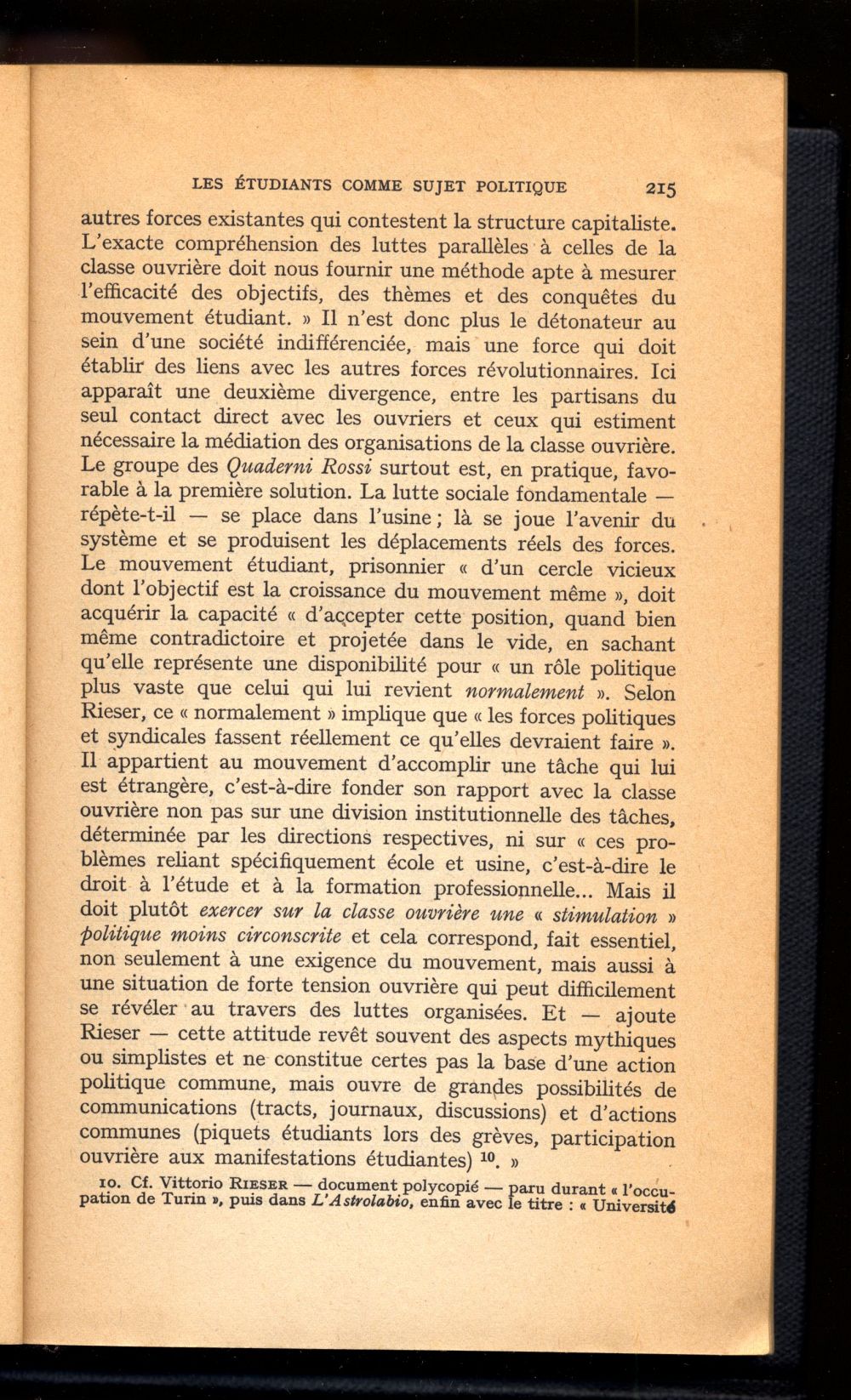

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
215
autres forces existantes qui contestent la structure capitaliste.
L'exacte compréhension des luttes parallèles à celles de la
classe ouvrière doit nous fournir une méthode apte à mesurer
l'efficacité des objectifs, des thèmes et des conquêtes du
mouvement étudiant. » II n'est donc plus le détonateur au
sein d'une société indifférenciée, mais une force qui doit
établir des liens avec les autres forces révolutionnaires. Ici
apparaît une deuxième divergence, entre les partisans du
seul contact direct avec les ouvriers et ceux qui estiment
nécessaire la médiation des organisations de la classe ouvrière.
Le groupe des Quaderni Rossi surtout est, en pratique, favo-
rable à la première solution. La lutte sociale fondamentale —
répète-t-il — se place dans l'usine ; là se joue l'avenir du
système et se produisent les déplacements réels des forces.
Le mouvement étudiant, prisonnier « d'un cercle vicieux
dont l'objectif est la croissance du mouvement même », doit
acquérir la capacité « d'accepter cette position, quand bien
même contradictoire et projetée dans le vide, en sachant
qu'elle représente une disponibilité pour « un rôle politique
plus vaste que celui qui lui revient normalement ». Selon
Rieser, ce « normalement » implique que « les forces politiques
et syndicales fassent réellement ce qu'elles devraient faire ».
Il appartient au mouvement d'accomplir une tâche qui lui
est étrangère, c'est-à-dire fonder son rapport avec la classe
ouvrière non pas sur une division institutionnelle des tâches,
déterminée par les directions respectives, ni sur « ces pro-
blèmes reliant spécifiquement école et usine, c'est-à-dire le
droit à l'étude et à la formation professionnelle... Mais il
doit plutôt exercer sur la classe ouvrière une « stimulation »
politique moins circonscrite et cela correspond, fait essentiel,
non seulement à une exigence du mouvement, mais aussi à
une situation de forte tension ouvrière qui peut difficilement
se révéler au travers des luttes organisées. Et — ajoute
Rieser — cette attitude revêt souvent des aspects mythiques
ou simplistes et ne constitue certes pas la base d'une action
politique commune, mais ouvre de grandes possibilités de
communications (tracts, journaux, discussions) et d'actions
communes (piquets étudiants lors des grèves, participation
ouvrière aux manifestations étudiantes) 10. »
L'exacte compréhension des luttes parallèles à celles de la
classe ouvrière doit nous fournir une méthode apte à mesurer
l'efficacité des objectifs, des thèmes et des conquêtes du
mouvement étudiant. » II n'est donc plus le détonateur au
sein d'une société indifférenciée, mais une force qui doit
établir des liens avec les autres forces révolutionnaires. Ici
apparaît une deuxième divergence, entre les partisans du
seul contact direct avec les ouvriers et ceux qui estiment
nécessaire la médiation des organisations de la classe ouvrière.
Le groupe des Quaderni Rossi surtout est, en pratique, favo-
rable à la première solution. La lutte sociale fondamentale —
répète-t-il — se place dans l'usine ; là se joue l'avenir du
système et se produisent les déplacements réels des forces.
Le mouvement étudiant, prisonnier « d'un cercle vicieux
dont l'objectif est la croissance du mouvement même », doit
acquérir la capacité « d'accepter cette position, quand bien
même contradictoire et projetée dans le vide, en sachant
qu'elle représente une disponibilité pour « un rôle politique
plus vaste que celui qui lui revient normalement ». Selon
Rieser, ce « normalement » implique que « les forces politiques
et syndicales fassent réellement ce qu'elles devraient faire ».
Il appartient au mouvement d'accomplir une tâche qui lui
est étrangère, c'est-à-dire fonder son rapport avec la classe
ouvrière non pas sur une division institutionnelle des tâches,
déterminée par les directions respectives, ni sur « ces pro-
blèmes reliant spécifiquement école et usine, c'est-à-dire le
droit à l'étude et à la formation professionnelle... Mais il
doit plutôt exercer sur la classe ouvrière une « stimulation »
politique moins circonscrite et cela correspond, fait essentiel,
non seulement à une exigence du mouvement, mais aussi à
une situation de forte tension ouvrière qui peut difficilement
se révéler au travers des luttes organisées. Et — ajoute
Rieser — cette attitude revêt souvent des aspects mythiques
ou simplistes et ne constitue certes pas la base d'une action
politique commune, mais ouvre de grandes possibilités de
communications (tracts, journaux, discussions) et d'actions
communes (piquets étudiants lors des grèves, participation
ouvrière aux manifestations étudiantes) 10. »
ip. Cf. Vittprio RIESER — document polycopié — paru durant « l'occu-
pation de Turin », puis dans L'Astrolabio, enfin avec le titre : « Université
pation de Turin », puis dans L'Astrolabio, enfin avec le titre : « Université
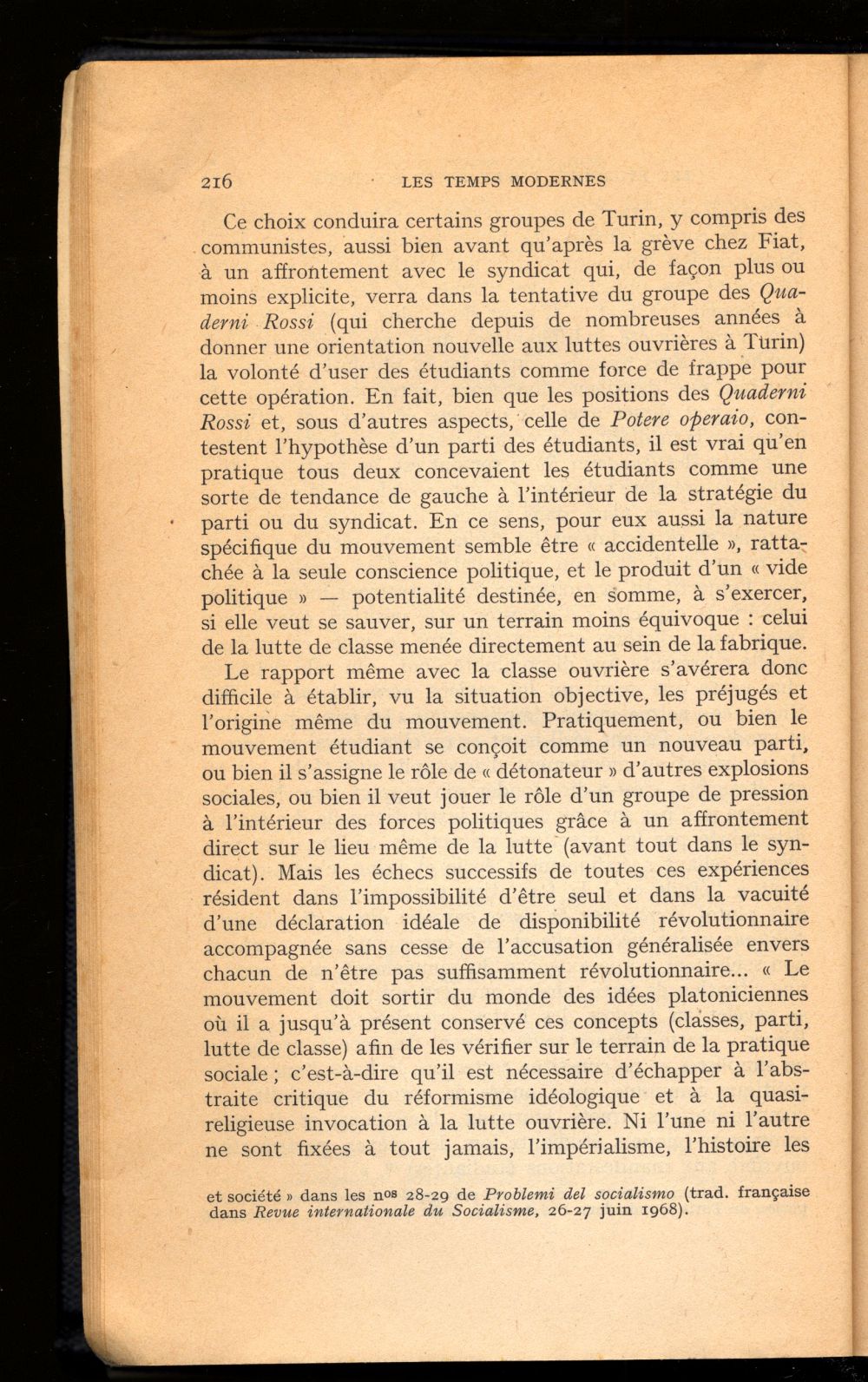

2l6
LES TEMPS MODERNES
Ce choix conduira certains groupes de Turin, y compris des
communistes, aussi bien avant qu'après la grève chez Fiat, ;
à un affrontement avec le syndicat qui, de façon plus ou >
moins explicite, verra dans la tentative du groupe des Qua-
derni Rossi (qui cherche depuis de nombreuses années à
donner une orientation nouvelle aux luttes ouvrières à Turin)
la volonté d'user clés étudiants comme force de frappe pour -,
cette opération. En fait, bien que les positions des Quaderni
Rossi et, sous d'autres aspects, celle de Potere operaio, con-
testent l'hypothèse d'un parti des étudiants, il est vrai qu'en •
pratique tous deux concevaient les étudiants comme une
sorte de tendance de gauche à l'intérieur de la stratégie du
parti ou du syndicat. En ce sens, pour eux aussi la nature ]
spécifique du mouvement semble être « accidentelle », ratta- ;
chée à la seule conscience politique, et le produit d'un « vide
politique » — potentialité destinée, en somme, à s'exercer,
si elle veut se sauver, sur un terrain moins équivoque : celui ;
de la lutte de classe menée directement au sein de la fabrique.
communistes, aussi bien avant qu'après la grève chez Fiat, ;
à un affrontement avec le syndicat qui, de façon plus ou >
moins explicite, verra dans la tentative du groupe des Qua-
derni Rossi (qui cherche depuis de nombreuses années à
donner une orientation nouvelle aux luttes ouvrières à Turin)
la volonté d'user clés étudiants comme force de frappe pour -,
cette opération. En fait, bien que les positions des Quaderni
Rossi et, sous d'autres aspects, celle de Potere operaio, con-
testent l'hypothèse d'un parti des étudiants, il est vrai qu'en •
pratique tous deux concevaient les étudiants comme une
sorte de tendance de gauche à l'intérieur de la stratégie du
parti ou du syndicat. En ce sens, pour eux aussi la nature ]
spécifique du mouvement semble être « accidentelle », ratta- ;
chée à la seule conscience politique, et le produit d'un « vide
politique » — potentialité destinée, en somme, à s'exercer,
si elle veut se sauver, sur un terrain moins équivoque : celui ;
de la lutte de classe menée directement au sein de la fabrique.
Le rapport même avec la classe ouvrière s'avérera donc
difficile à établir, vu la situation objective, les préjugés et
l'origine même du mouvement. Pratiquement, ou bien le ;
mouvement étudiant se conçoit comme un nouveau parti, ;
ou bien il s'assigne le rôle de « détonateur » d'autres explosions
sociales, ou bien il veut jouer le rôle d'un groupe de pression
à l'intérieur des forces politiques grâce à un affrontement
direct sur le lieu même de la lutte (avant tout dans le syn- '
dicat). Mais les échecs successifs de toutes ces expériences :
résident dans l'impossibilité d'être seul et dans la vacuité ;
d'une déclaration idéale de disponibilité révolutionnaire \
accompagnée sans cesse de l'accusation généralisée envers :
chacun de n'être pas suffisamment révolutionnaire... « Le !
mouvement doit sortir du monde des idées platoniciennes ;
où il a jusqu'à présent conservé ces concepts (classes, parti, ;
lutte de classe) afin de les vérifier sur le terrain de la pratique ;
sociale ; c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'échapper à l'abs- •
traite critique du réformisme idéologique et à la quasi- !
religieuse invocation à la lutte ouvrière. Ni l'une ni l'autre ;
ne sont fixées à tout jamais, l'impérialisme, l'histoire les j
difficile à établir, vu la situation objective, les préjugés et
l'origine même du mouvement. Pratiquement, ou bien le ;
mouvement étudiant se conçoit comme un nouveau parti, ;
ou bien il s'assigne le rôle de « détonateur » d'autres explosions
sociales, ou bien il veut jouer le rôle d'un groupe de pression
à l'intérieur des forces politiques grâce à un affrontement
direct sur le lieu même de la lutte (avant tout dans le syn- '
dicat). Mais les échecs successifs de toutes ces expériences :
résident dans l'impossibilité d'être seul et dans la vacuité ;
d'une déclaration idéale de disponibilité révolutionnaire \
accompagnée sans cesse de l'accusation généralisée envers :
chacun de n'être pas suffisamment révolutionnaire... « Le !
mouvement doit sortir du monde des idées platoniciennes ;
où il a jusqu'à présent conservé ces concepts (classes, parti, ;
lutte de classe) afin de les vérifier sur le terrain de la pratique ;
sociale ; c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'échapper à l'abs- •
traite critique du réformisme idéologique et à la quasi- !
religieuse invocation à la lutte ouvrière. Ni l'une ni l'autre ;
ne sont fixées à tout jamais, l'impérialisme, l'histoire les j
!
et société » dans les n°s 28-29 de Problemi del socialismo (trad. française •
dans Revue internationale du Socialisme, 26-27 juin 1968). [
dans Revue internationale du Socialisme, 26-27 juin 1968). [
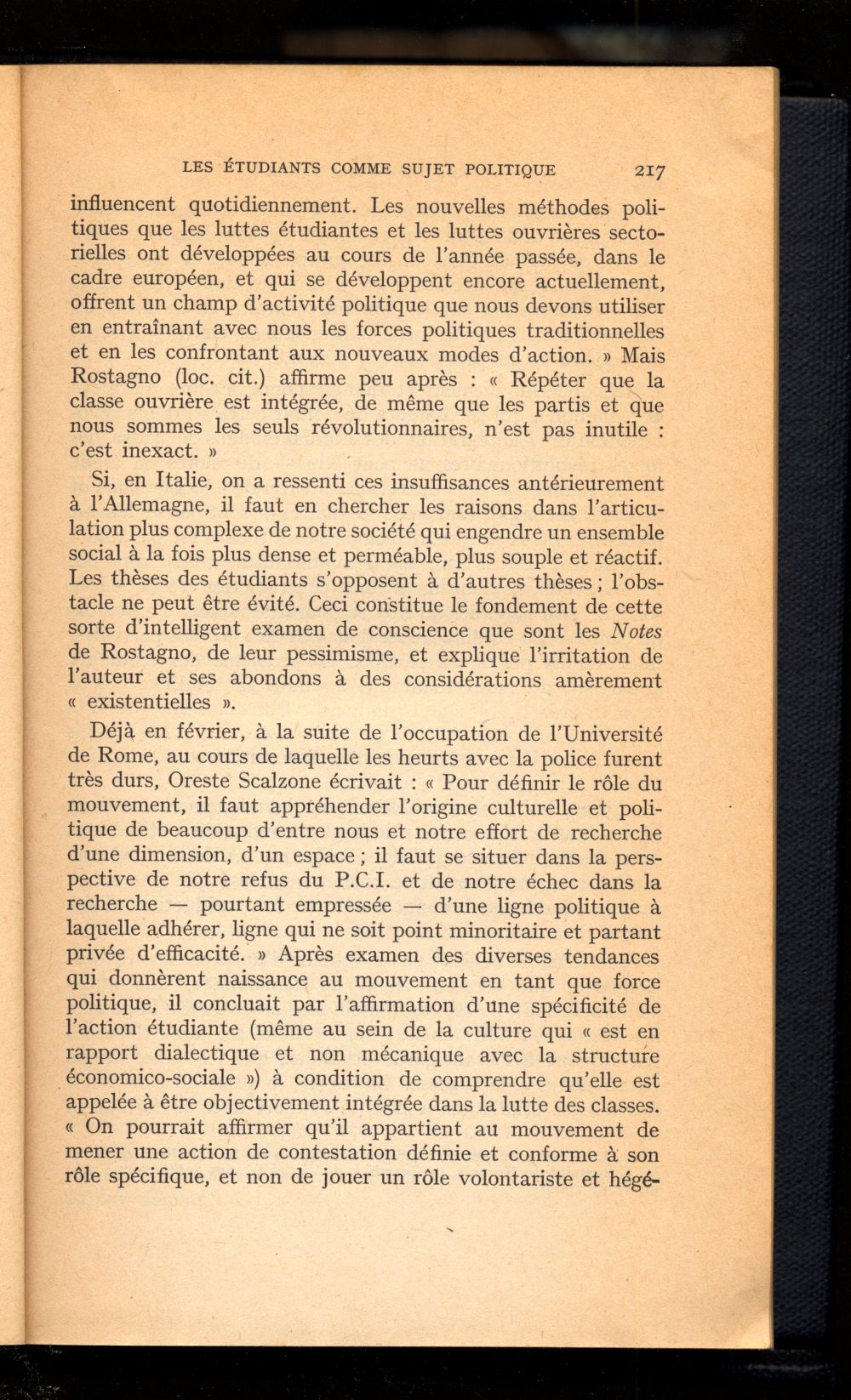

LES ETUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
217
influencent quotidiennement. Les nouvelles méthodes poli-
tiques que les luttes étudiantes et les luttes ouvrières secto-
rielles ont développées au cours de l'année passée, dans le
cadre européen, et qui se développent encore actuellement,
offrent un champ d'activité politique que nous devons utiliser
en entraînant avec nous les forces politiques traditionnelles
et en les confrontant aux nouveaux modes d'action. » Mais
Rostagno (loc. cit.) affirme peu après : « Répéter que la
classe ouvrière est intégrée, de même que les partis et que
nous sommes les seuls révolutionnaires, n'est pas inutile :
c'est inexact. »
tiques que les luttes étudiantes et les luttes ouvrières secto-
rielles ont développées au cours de l'année passée, dans le
cadre européen, et qui se développent encore actuellement,
offrent un champ d'activité politique que nous devons utiliser
en entraînant avec nous les forces politiques traditionnelles
et en les confrontant aux nouveaux modes d'action. » Mais
Rostagno (loc. cit.) affirme peu après : « Répéter que la
classe ouvrière est intégrée, de même que les partis et que
nous sommes les seuls révolutionnaires, n'est pas inutile :
c'est inexact. »
Si, en Italie, on a ressenti ces insuffisances antérieurement
à l'Allemagne, il faut en chercher les raisons dans l'articu-
lation plus complexe de notre société qui engendre un ensemble
social à la fois plus dense et perméable, plus souple et réactif.
Les thèses des étudiants s'opposent à d'autres thèses ; l'obs-
tacle ne peut être évité. Ceci constitue le fondement de cette
sorte d'intelligent examen de conscience que sont les Notes
de Rostagno, de leur pessimisme, et explique l'irritation de
l'auteur et ses abondons à des considérations amèrement
« existentielles ».
à l'Allemagne, il faut en chercher les raisons dans l'articu-
lation plus complexe de notre société qui engendre un ensemble
social à la fois plus dense et perméable, plus souple et réactif.
Les thèses des étudiants s'opposent à d'autres thèses ; l'obs-
tacle ne peut être évité. Ceci constitue le fondement de cette
sorte d'intelligent examen de conscience que sont les Notes
de Rostagno, de leur pessimisme, et explique l'irritation de
l'auteur et ses abondons à des considérations amèrement
« existentielles ».
Déjà en février, à la suite de l'occupation de l'Université
de Rome, au cours de laquelle les heurts avec la police furent
très durs, Oreste Scalzone écrivait : « Pour définir le rôle du
mouvement, il faut appréhender l'origine culturelle et poli-
tique de beaucoup d'entre nous et notre effort de recherche
d'une dimension, d'un espace ; il faut se situer dans la pers-
pective de notre refus du P.C.I. et de notre échec dans la
recherche — pourtant empressée — d'une ligne politique à
laquelle adhérer, ligne qui ne soit point minoritaire et partant
privée d'efficacité. » Après examen des diverses tendances
qui donnèrent naissance au mouvement en tant que force
politique, il concluait par l'affirmation d'une spécificité de
l'action étudiante (même au sein de la culture qui « est en
rapport dialectique et non mécanique avec la structure
économico-sociale ») à condition de comprendre qu'elle est
appelée à être objectivement intégrée dans la lutte des classes.
« On pourrait affirmer qu'il appartient au mouvement de
mener une action de contestation définie et conforme à son
rôle spécifique, et non de jouer un rôle volontariste et hégé-
de Rome, au cours de laquelle les heurts avec la police furent
très durs, Oreste Scalzone écrivait : « Pour définir le rôle du
mouvement, il faut appréhender l'origine culturelle et poli-
tique de beaucoup d'entre nous et notre effort de recherche
d'une dimension, d'un espace ; il faut se situer dans la pers-
pective de notre refus du P.C.I. et de notre échec dans la
recherche — pourtant empressée — d'une ligne politique à
laquelle adhérer, ligne qui ne soit point minoritaire et partant
privée d'efficacité. » Après examen des diverses tendances
qui donnèrent naissance au mouvement en tant que force
politique, il concluait par l'affirmation d'une spécificité de
l'action étudiante (même au sein de la culture qui « est en
rapport dialectique et non mécanique avec la structure
économico-sociale ») à condition de comprendre qu'elle est
appelée à être objectivement intégrée dans la lutte des classes.
« On pourrait affirmer qu'il appartient au mouvement de
mener une action de contestation définie et conforme à son
rôle spécifique, et non de jouer un rôle volontariste et hégé-
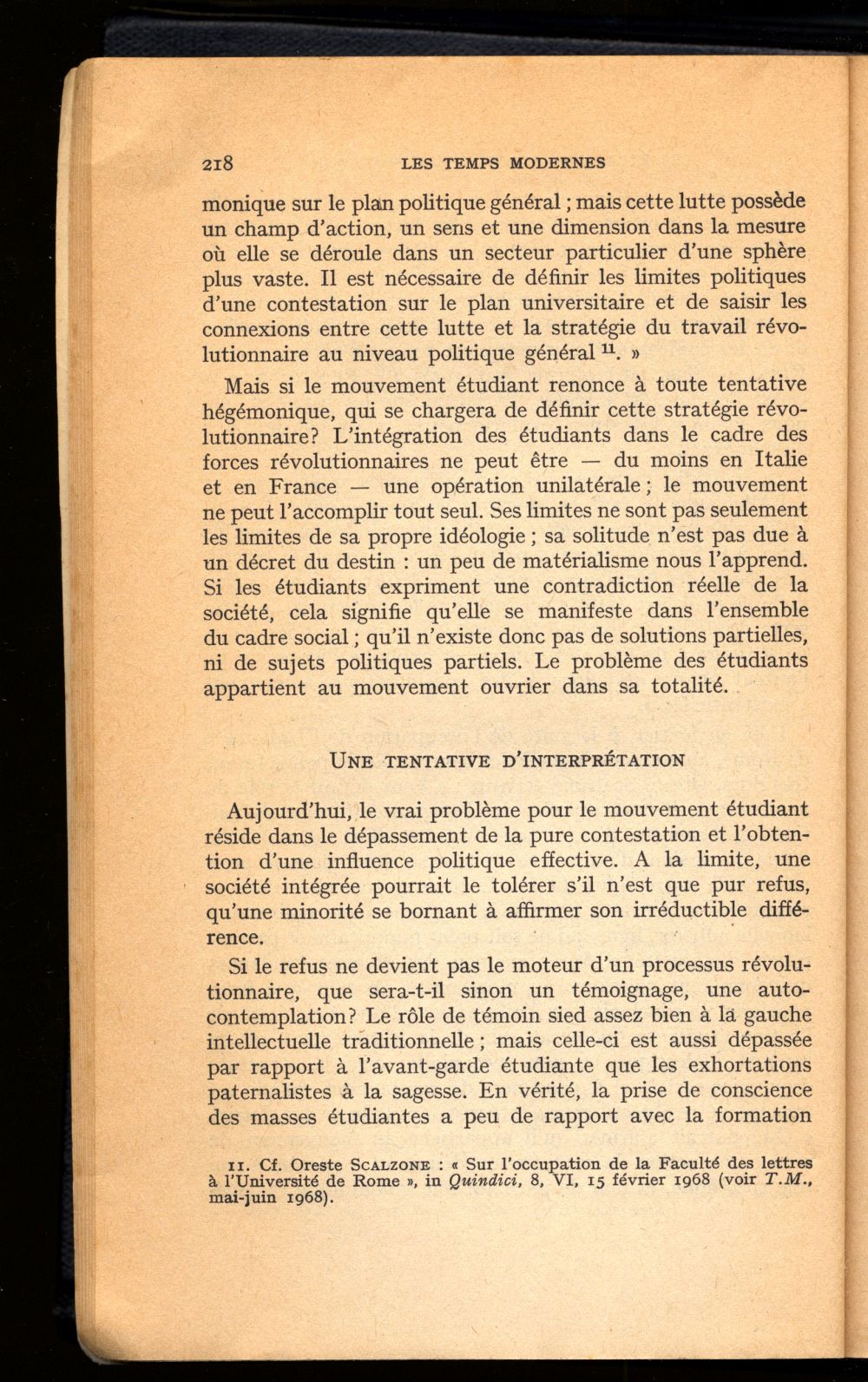

218
LES TEMPS MODERNES
monique sur le plan politique général ; mais cette lutte possède
un champ d'action, un sens et une dimension dans la mesure
où elle se déroule dans un secteur particulier d'une sphère
plus vaste. Il est nécessaire de définir les limites politiques
d'une contestation sur le plan universitaire et de saisir les
connexions entre cette lutte et la stratégie du travail révo-
lutionnaire au niveau politique général u. »
un champ d'action, un sens et une dimension dans la mesure
où elle se déroule dans un secteur particulier d'une sphère
plus vaste. Il est nécessaire de définir les limites politiques
d'une contestation sur le plan universitaire et de saisir les
connexions entre cette lutte et la stratégie du travail révo-
lutionnaire au niveau politique général u. »
Mais si le mouvement étudiant renonce à toute tentative
hégémonique, qui se chargera de définir cette stratégie révo-
lutionnaire? L'intégration des étudiants dans le cadre des
forces révolutionnaires ne peut être — du moins en Italie
et en France — une opération unilatérale ; le mouvement
ne peut l'accomplir tout seul. Ses limites ne sont pas seulement
les limites de sa propre idéologie ; sa solitude n'est pas due à
un décret du destin : un peu de matérialisme nous l'apprend.
Si les étudiants expriment une contradiction réelle de la
société, cela signifie qu'elle se manifeste dans l'ensemble
du cadre social ; qu'il n'existe donc pas de solutions partielles,
ni de sujets politiques partiels. Le problème des étudiants
appartient au mouvement ouvrier dans sa totalité.
hégémonique, qui se chargera de définir cette stratégie révo-
lutionnaire? L'intégration des étudiants dans le cadre des
forces révolutionnaires ne peut être — du moins en Italie
et en France — une opération unilatérale ; le mouvement
ne peut l'accomplir tout seul. Ses limites ne sont pas seulement
les limites de sa propre idéologie ; sa solitude n'est pas due à
un décret du destin : un peu de matérialisme nous l'apprend.
Si les étudiants expriment une contradiction réelle de la
société, cela signifie qu'elle se manifeste dans l'ensemble
du cadre social ; qu'il n'existe donc pas de solutions partielles,
ni de sujets politiques partiels. Le problème des étudiants
appartient au mouvement ouvrier dans sa totalité.
UNE TENTATIVE D'INTERPRÉTATION
Aujourd'hui, le vrai problème pour le mouvement étudiant
réside dans le dépassement de la pure contestation et l'obten-
tion d'une influence politique effective. A la limite, une
société intégrée pourrait le tolérer s'il n'est que pur refus,
qu'une minorité se bornant à affirmer son irréductible diffé-
rence.
réside dans le dépassement de la pure contestation et l'obten-
tion d'une influence politique effective. A la limite, une
société intégrée pourrait le tolérer s'il n'est que pur refus,
qu'une minorité se bornant à affirmer son irréductible diffé-
rence.
Si le refus ne devient pas le moteur d'un processus révolu-
tionnaire, que sera-t-il sinon un témoignage, une auto-
contemplation? Le rôle de témoin sied assez bien à la gauche
intellectuelle traditionnelle ; mais celle-ci est aussi dépassée
par rapport à l'avant-garde étudiante que les exhortations
paternalistes à la sagesse. En vérité, la prise de conscience
des masses étudiantes a peu de rapport avec la formation
tionnaire, que sera-t-il sinon un témoignage, une auto-
contemplation? Le rôle de témoin sied assez bien à la gauche
intellectuelle traditionnelle ; mais celle-ci est aussi dépassée
par rapport à l'avant-garde étudiante que les exhortations
paternalistes à la sagesse. En vérité, la prise de conscience
des masses étudiantes a peu de rapport avec la formation
II. Cf. Oreste SCALZONE : « Sur l'occupation de la Faculté des lettres
à l'Université de Rome », in Quindici, 8, VI, 15 février 1968 (voir T.M.,
mai-juin 1968).
à l'Université de Rome », in Quindici, 8, VI, 15 février 1968 (voir T.M.,
mai-juin 1968).
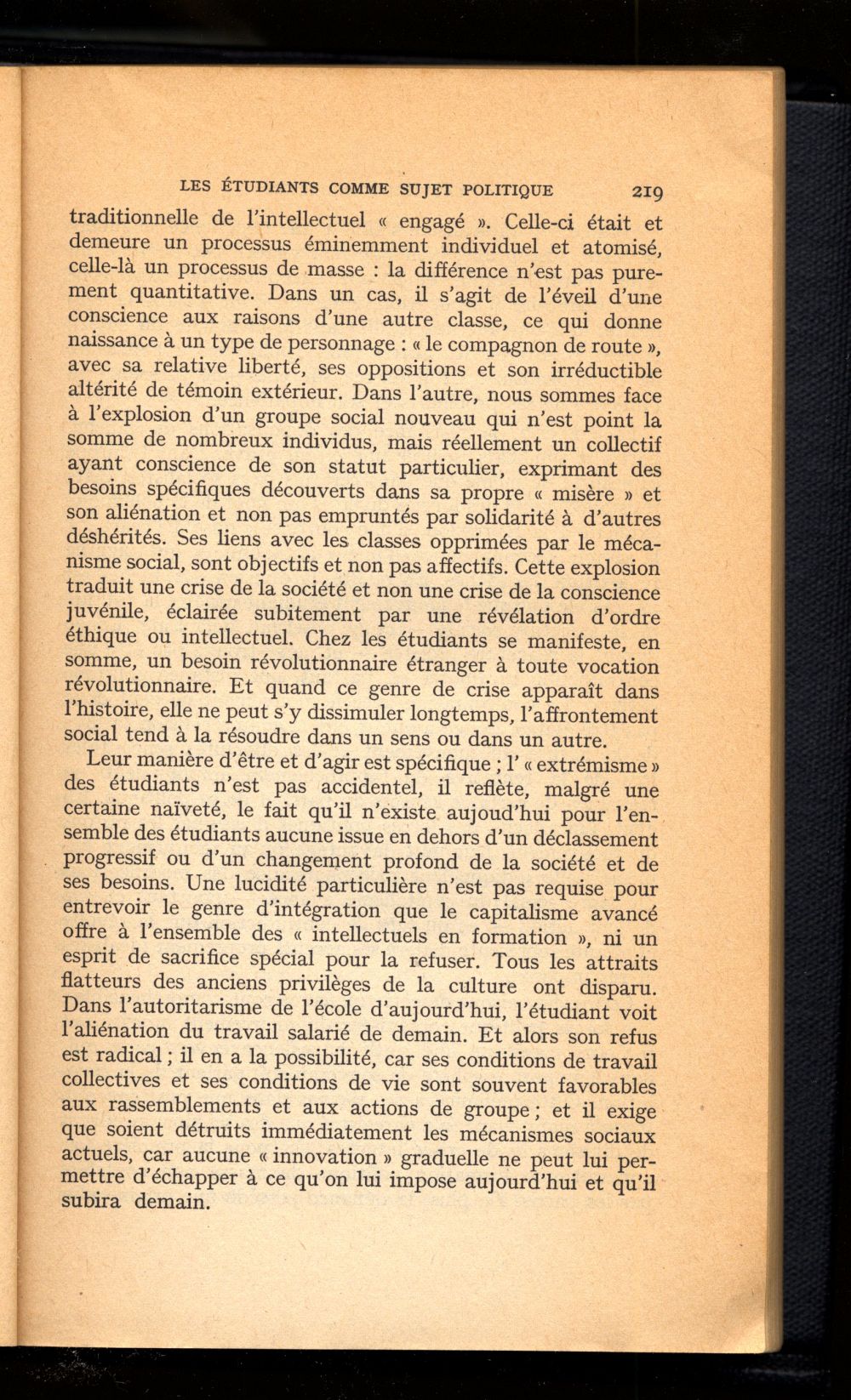

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
219
traditionnelle de l'intellectuel « engagé ». Celle-ci était et
demeure un processus éminemment individuel et atomisé,
celle-là un processus de masse : la différence n'est pas pure-
ment quantitative. Dans un cas, il s'agit de l'éveil d'une
conscience aux raisons d'une autre classe, ce qui donne
naissance à un type de personnage : « le compagnon de route »,
avec sa relative liberté, ses oppositions et son irréductible
altérité de témoin extérieur. Dans l'autre, nous sommes face
à l'explosion d'un groupe social nouveau qui n'est point la
somme de nombreux individus, mais réellement un collectif
ayant conscience de son statut particulier, exprimant des
besoins spécifiques découverts dans sa propre « misère » et
son aliénation et non pas empruntés par solidarité à d'autres
déshérités. Ses liens avec les classes opprimées par le méca-
nisme social, sont objectifs et non pas affectifs. Cette explosion
traduit une crise de la société et non une crise de la conscience
juvénile, éclairée subitement par une révélation d'ordre
éthique ou intellectuel. Chez les étudiants se manifeste, en
somme, un besoin révolutionnaire étranger à toute vocation
révolutionnaire. Et quand ce genre de crise apparaît dans
l'histoire, elle ne peut s'y dissimuler longtemps, l'affrontement
social tend à la résoudre dans un sens ou dans un autre.
demeure un processus éminemment individuel et atomisé,
celle-là un processus de masse : la différence n'est pas pure-
ment quantitative. Dans un cas, il s'agit de l'éveil d'une
conscience aux raisons d'une autre classe, ce qui donne
naissance à un type de personnage : « le compagnon de route »,
avec sa relative liberté, ses oppositions et son irréductible
altérité de témoin extérieur. Dans l'autre, nous sommes face
à l'explosion d'un groupe social nouveau qui n'est point la
somme de nombreux individus, mais réellement un collectif
ayant conscience de son statut particulier, exprimant des
besoins spécifiques découverts dans sa propre « misère » et
son aliénation et non pas empruntés par solidarité à d'autres
déshérités. Ses liens avec les classes opprimées par le méca-
nisme social, sont objectifs et non pas affectifs. Cette explosion
traduit une crise de la société et non une crise de la conscience
juvénile, éclairée subitement par une révélation d'ordre
éthique ou intellectuel. Chez les étudiants se manifeste, en
somme, un besoin révolutionnaire étranger à toute vocation
révolutionnaire. Et quand ce genre de crise apparaît dans
l'histoire, elle ne peut s'y dissimuler longtemps, l'affrontement
social tend à la résoudre dans un sens ou dans un autre.
Leur manière d'être et d'agir est spécifique ; 1' « extrémisme »
des étudiants n'est pas accidentel, il reflète, malgré une
certaine naïveté, le fait qu'il n'existe aujoud'hui pour l'en-
semble des étudiants aucune issue en dehors d'un déclassement
progressif ou d'un changement profond de la société et de
ses besoins. Une lucidité particulière n'est pas requise pour
entrevoir le genre d'intégration que le capitalisme avancé
offre à l'ensemble des « intellectuels en formation », ni un
esprit de sacrifice spécial pour la refuser. Tous les attraits
flatteurs des anciens privilèges de la culture ont disparu.
Dans l'autoritarisme de l'école d'aujourd'hui, l'étudiant voit
l'aliénation du travail salarié de demain. Et alors son refus
est radical ; il en a la possibilité, car ses conditions de travail
collectives et ses conditions de vie sont souvent favorables
aux rassemblements et aux actions de groupe ; et il exige
que soient détruits immédiatement les mécanismes sociaux
actuels, car aucune « innovation » graduelle ne peut lui per-
mettre d'échapper à ce qu'on lui impose aujourd'hui et qu'il
subira demain.
des étudiants n'est pas accidentel, il reflète, malgré une
certaine naïveté, le fait qu'il n'existe aujoud'hui pour l'en-
semble des étudiants aucune issue en dehors d'un déclassement
progressif ou d'un changement profond de la société et de
ses besoins. Une lucidité particulière n'est pas requise pour
entrevoir le genre d'intégration que le capitalisme avancé
offre à l'ensemble des « intellectuels en formation », ni un
esprit de sacrifice spécial pour la refuser. Tous les attraits
flatteurs des anciens privilèges de la culture ont disparu.
Dans l'autoritarisme de l'école d'aujourd'hui, l'étudiant voit
l'aliénation du travail salarié de demain. Et alors son refus
est radical ; il en a la possibilité, car ses conditions de travail
collectives et ses conditions de vie sont souvent favorables
aux rassemblements et aux actions de groupe ; et il exige
que soient détruits immédiatement les mécanismes sociaux
actuels, car aucune « innovation » graduelle ne peut lui per-
mettre d'échapper à ce qu'on lui impose aujourd'hui et qu'il
subira demain.
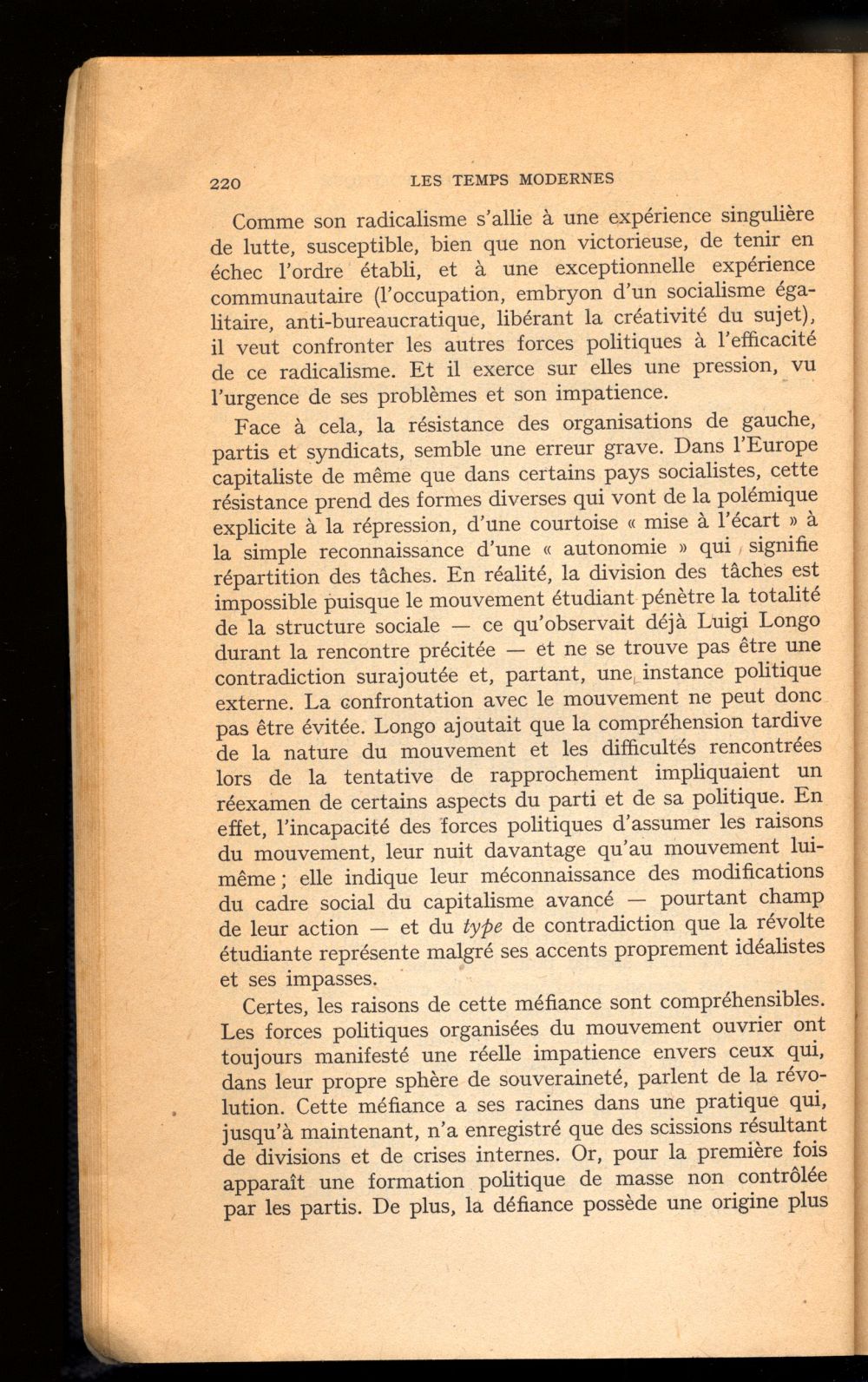

220
LES TEMPS MODERNES
Comme son radicalisme s'allie à une expérience singulière
de lutte, susceptible, bien que non victorieuse, de tenir en
échec l'ordre établi, et à une exceptionnelle expérience
communautaire (l'occupation, embryon d'un socialisme éga-
litaire, anti-bureaucratique, libérant la créativité du sujet),
il veut confronter les autres forces politiques à l'efficacité
de ce radicalisme. Et il exerce sur elles une pression, vu
l'urgence de ses problèmes et son impatience.
de lutte, susceptible, bien que non victorieuse, de tenir en
échec l'ordre établi, et à une exceptionnelle expérience
communautaire (l'occupation, embryon d'un socialisme éga-
litaire, anti-bureaucratique, libérant la créativité du sujet),
il veut confronter les autres forces politiques à l'efficacité
de ce radicalisme. Et il exerce sur elles une pression, vu
l'urgence de ses problèmes et son impatience.
Face à cela, la résistance des organisations de gauche,
partis et syndicats, semble une erreur grave. Dans l'Europe
capitaliste de même que dans certains pays socialistes, cette
résistance prend des formes diverses qui vont de la polémique
explicite à la répression, d'une courtoise « mise à l'écart » à
la simple reconnaissance d'une « autonomie » qui signifie
répartition des tâches. En réalité, la division des tâches est
impossible puisque le mouvement étudiant pénètre la totalité
de la structure sociale — ce qu'observait déjà Luigi Longo
durant la rencontre précitée — et ne se trouve pas être une
contradiction surajoutée et, partant, une instance politique
externe. La confrontation avec le mouvement ne peut donc
pas être évitée. Longo ajoutait que la compréhension tardive
de la nature du mouvement et les difficultés rencontrées
lors de la tentative de rapprochement impliquaient un
réexamen de certains aspects du parti et de sa politique. En
effet, l'incapacité des forces politiques d'assumer les raisons
du mouvement, leur nuit davantage qu'au mouvement lui-
même ; elle indique leur méconnaissance des modifications
du cadre social du capitalisme avancé — pourtant champ
de leur action — et du type de contradiction que la révolte
étudiante représente malgré ses accents proprement idéalistes
et ses impasses.
partis et syndicats, semble une erreur grave. Dans l'Europe
capitaliste de même que dans certains pays socialistes, cette
résistance prend des formes diverses qui vont de la polémique
explicite à la répression, d'une courtoise « mise à l'écart » à
la simple reconnaissance d'une « autonomie » qui signifie
répartition des tâches. En réalité, la division des tâches est
impossible puisque le mouvement étudiant pénètre la totalité
de la structure sociale — ce qu'observait déjà Luigi Longo
durant la rencontre précitée — et ne se trouve pas être une
contradiction surajoutée et, partant, une instance politique
externe. La confrontation avec le mouvement ne peut donc
pas être évitée. Longo ajoutait que la compréhension tardive
de la nature du mouvement et les difficultés rencontrées
lors de la tentative de rapprochement impliquaient un
réexamen de certains aspects du parti et de sa politique. En
effet, l'incapacité des forces politiques d'assumer les raisons
du mouvement, leur nuit davantage qu'au mouvement lui-
même ; elle indique leur méconnaissance des modifications
du cadre social du capitalisme avancé — pourtant champ
de leur action — et du type de contradiction que la révolte
étudiante représente malgré ses accents proprement idéalistes
et ses impasses.
Certes, les raisons de cette méfiance sont compréhensibles.
Les forces politiques organisées du mouvement ouvrier ont
toujours manifesté une réelle impatience envers ceux qui,
dans leur propre sphère de souveraineté, parlent de la révo-
lution. Cette méfiance a ses racines dans une pratique qui,
jusqu'à maintenant, n'a enregistré que des scissions résultant
de divisions et de crises internes. Or, pour la première fois
apparaît une formation politique de masse non contrôlée
par les partis. De plus, la défiance possède une origine plus
Les forces politiques organisées du mouvement ouvrier ont
toujours manifesté une réelle impatience envers ceux qui,
dans leur propre sphère de souveraineté, parlent de la révo-
lution. Cette méfiance a ses racines dans une pratique qui,
jusqu'à maintenant, n'a enregistré que des scissions résultant
de divisions et de crises internes. Or, pour la première fois
apparaît une formation politique de masse non contrôlée
par les partis. De plus, la défiance possède une origine plus
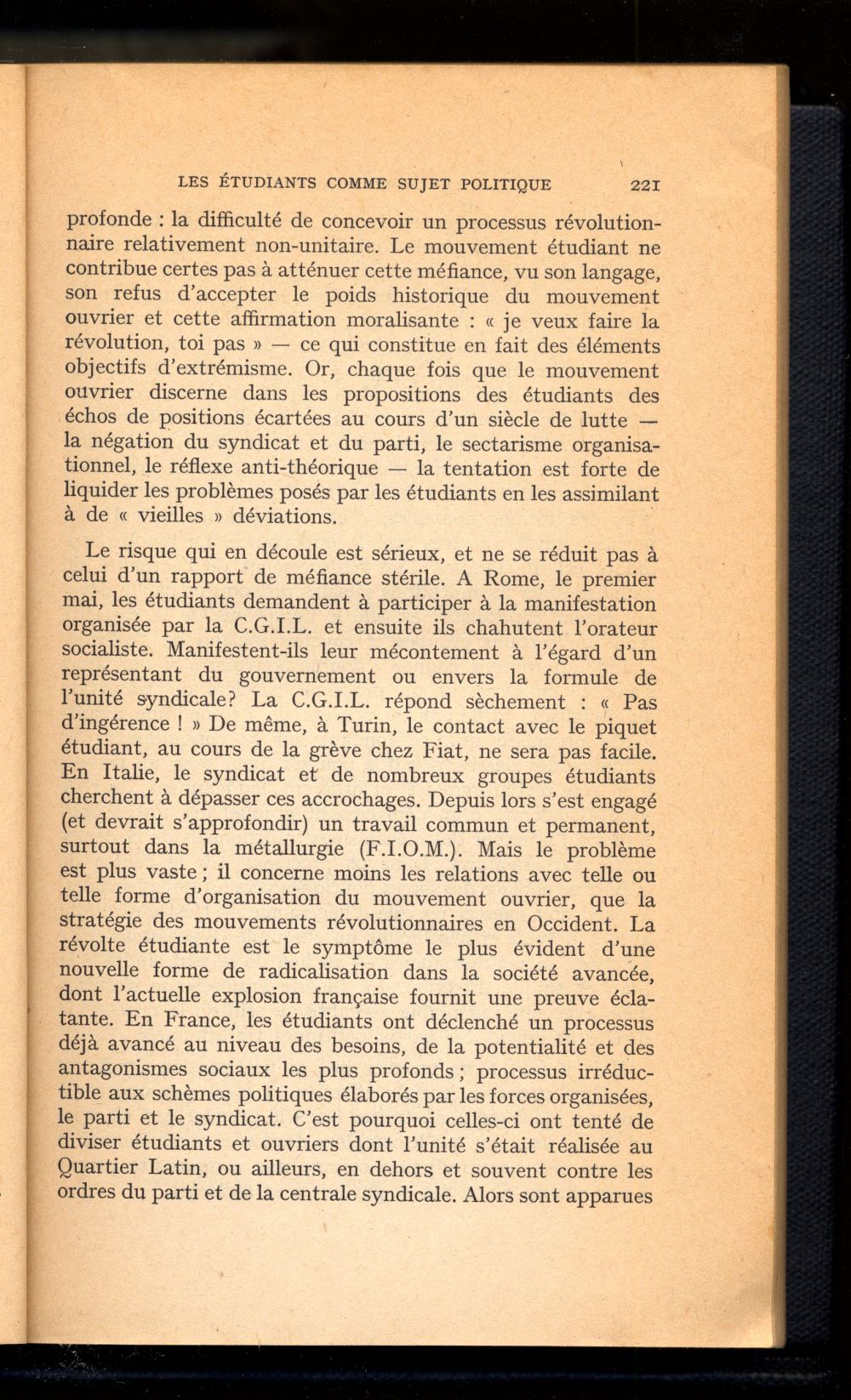

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
221
profonde : la difficulté de concevoir un processus révolution-
naire relativement non-unitaire. Le mouvement étudiant ne
contribue certes pas à atténuer cette méfiance, vu son langage,
son refus d'accepter le poids historique du mouvement
ouvrier et cette affirmation moralisante : « je veux faire la
révolution, toi pas » — ce qui constitue en fait des éléments
objectifs d'extrémisme. Or, chaque fois que le mouvement
ouvrier discerne dans les propositions des étudiants des
échos de positions écartées au cours d'un siècle de lutte —
la négation du syndicat et du parti, le sectarisme organisa-
tionnel, le réflexe anti-théorique — la tentation est forte de
liquider les problèmes posés par les étudiants en les assimilant
à de « vieilles » déviations.
naire relativement non-unitaire. Le mouvement étudiant ne
contribue certes pas à atténuer cette méfiance, vu son langage,
son refus d'accepter le poids historique du mouvement
ouvrier et cette affirmation moralisante : « je veux faire la
révolution, toi pas » — ce qui constitue en fait des éléments
objectifs d'extrémisme. Or, chaque fois que le mouvement
ouvrier discerne dans les propositions des étudiants des
échos de positions écartées au cours d'un siècle de lutte —
la négation du syndicat et du parti, le sectarisme organisa-
tionnel, le réflexe anti-théorique — la tentation est forte de
liquider les problèmes posés par les étudiants en les assimilant
à de « vieilles » déviations.
Le risque qui en découle est sérieux, et ne se réduit pas à
celui d'un rapport de méfiance stérile. A Rome, le premier
mai, les étudiants demandent à participer à la manifestation
organisée par la C.G.I.L. et ensuite ils chahutent l'orateur
socialiste. Manifestent-ils leur mécontement à l'égard d'un
représentant du gouvernement ou envers la formule de
l'unité syndicale? La C.G.I.L. répond sèchement : « Pas
d'ingérence ! » De même, à Turin, le contact avec le piquet
étudiant, au cours de la grève chez Fiat, ne sera pas facile.
En Italie, le syndicat et de nombreux groupes étudiants
cherchent à dépasser ces accrochages. Depuis lors s'est engagé
(et devrait s'approfondir) un travail commun et permanent,
surtout dans la métallurgie (F.I.O.M.). Mais le problème
est plus vaste ; il concerne moins les relations avec telle ou
telle forme d'organisation du mouvement ouvrier, que la
stratégie des mouvements révolutionnaires en Occident. La
révolte étudiante est le symptôme le plus évident d'une
nouvelle forme de radicalisation dans la société avancée,
dont l'actuelle explosion française fournit une preuve écla-
tante. En France, les étudiants ont déclenché un processus
déjà avancé au niveau des besoins, de la potentialité et des
antagonismes sociaux les plus profonds ; processus irréduc-
tible aux schèmes politiques élaborés par les forces organisées,
le parti et le syndicat. C'est pourquoi celles-ci ont tenté de
diviser étudiants et ouvriers dont l'unité s'était réalisée au
Quartier Latin, ou ailleurs, en dehors et souvent contre les
ordres du parti et de la centrale syndicale. Alors sont apparues
celui d'un rapport de méfiance stérile. A Rome, le premier
mai, les étudiants demandent à participer à la manifestation
organisée par la C.G.I.L. et ensuite ils chahutent l'orateur
socialiste. Manifestent-ils leur mécontement à l'égard d'un
représentant du gouvernement ou envers la formule de
l'unité syndicale? La C.G.I.L. répond sèchement : « Pas
d'ingérence ! » De même, à Turin, le contact avec le piquet
étudiant, au cours de la grève chez Fiat, ne sera pas facile.
En Italie, le syndicat et de nombreux groupes étudiants
cherchent à dépasser ces accrochages. Depuis lors s'est engagé
(et devrait s'approfondir) un travail commun et permanent,
surtout dans la métallurgie (F.I.O.M.). Mais le problème
est plus vaste ; il concerne moins les relations avec telle ou
telle forme d'organisation du mouvement ouvrier, que la
stratégie des mouvements révolutionnaires en Occident. La
révolte étudiante est le symptôme le plus évident d'une
nouvelle forme de radicalisation dans la société avancée,
dont l'actuelle explosion française fournit une preuve écla-
tante. En France, les étudiants ont déclenché un processus
déjà avancé au niveau des besoins, de la potentialité et des
antagonismes sociaux les plus profonds ; processus irréduc-
tible aux schèmes politiques élaborés par les forces organisées,
le parti et le syndicat. C'est pourquoi celles-ci ont tenté de
diviser étudiants et ouvriers dont l'unité s'était réalisée au
Quartier Latin, ou ailleurs, en dehors et souvent contre les
ordres du parti et de la centrale syndicale. Alors sont apparues
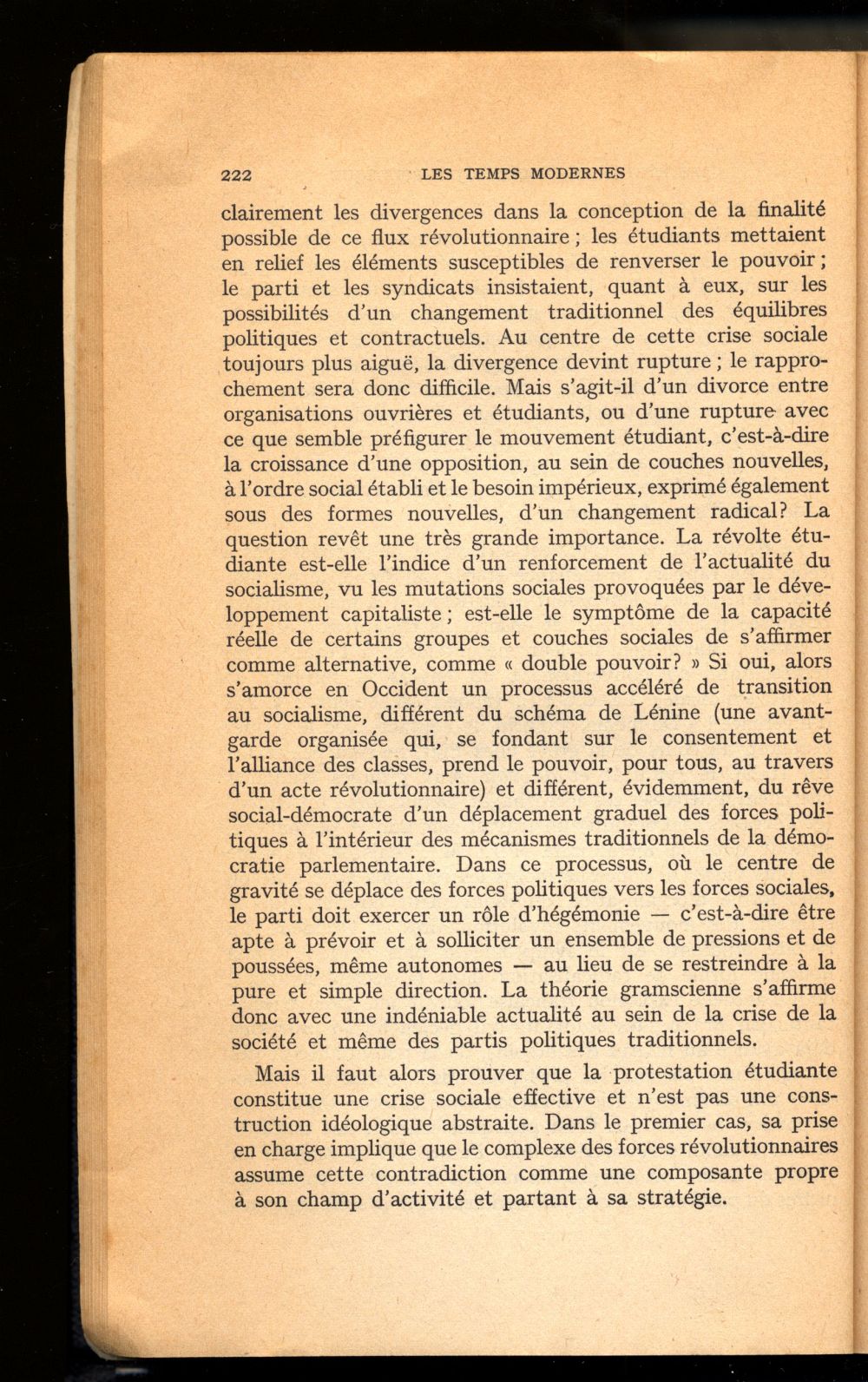

222
LES TEMPS MODERNES
clairement les divergences dans la conception de la finalité
possible de ce flux révolutionnaire ; les étudiants mettaient
en relief les éléments susceptibles de renverser le pouvoir ;
le parti et les syndicats insistaient, quant à eux, sur les
possibilités d'un changement traditionnel des équilibres
politiques et contractuels. Au centre de cette crise sociale
toujours plus aiguë, la divergence devint rupture ; le rappro-
chement sera donc difficile. Mais s'agit-il d'un divorce entre
organisations ouvrières et étudiants, ou d'une rupture avec
ce que semble préfigurer le mouvement étudiant, c'est-à-dire
la croissance d'une opposition, au sein de couches nouvelles,
à l'ordre social établi et le besoin impérieux, exprimé également
sous des formes nouvelles, d'un changement radical? La
question revêt une très grande importance. La révolte étu-
diante est-elle l'indice d'un renforcement de l'actualité du
socialisme, vu les mutations sociales provoquées par le déve-
loppement capitaliste ; est-elle le symptôme de la capacité
réelle de certains groupes et couches sociales de s'affirmer
comme alternative, comme « double pouvoir? » Si oui, alors
s'amorce en Occident un processus accéléré de transition
au socialisme, différent du schéma de Lénine (une avant-
garde organisée qui, se fondant sur le consentement et
l'alliance des classes, prend le pouvoir, pour tous, au travers
d'un acte révolutionnaire) et différent, évidemment, du rêve
social-démocrate d'un déplacement graduel des forces poli-
tiques à l'intérieur des mécanismes traditionnels de la démo-
cratie parlementaire. Dans ce processus, où le centre de
gravité se déplace des forces politiques vers les forces sociales,
le parti doit exercer un rôle d'hégémonie — c'est-à-dire être
apte à prévoir et à solliciter un ensemble de pressions et de
poussées, même autonomes — au lieu de se restreindre à la
pure et simple direction. La théorie gramscienne s'affirme
donc avec une indéniable actualité au sein de la crise de la
société et même des partis politiques traditionnels.
possible de ce flux révolutionnaire ; les étudiants mettaient
en relief les éléments susceptibles de renverser le pouvoir ;
le parti et les syndicats insistaient, quant à eux, sur les
possibilités d'un changement traditionnel des équilibres
politiques et contractuels. Au centre de cette crise sociale
toujours plus aiguë, la divergence devint rupture ; le rappro-
chement sera donc difficile. Mais s'agit-il d'un divorce entre
organisations ouvrières et étudiants, ou d'une rupture avec
ce que semble préfigurer le mouvement étudiant, c'est-à-dire
la croissance d'une opposition, au sein de couches nouvelles,
à l'ordre social établi et le besoin impérieux, exprimé également
sous des formes nouvelles, d'un changement radical? La
question revêt une très grande importance. La révolte étu-
diante est-elle l'indice d'un renforcement de l'actualité du
socialisme, vu les mutations sociales provoquées par le déve-
loppement capitaliste ; est-elle le symptôme de la capacité
réelle de certains groupes et couches sociales de s'affirmer
comme alternative, comme « double pouvoir? » Si oui, alors
s'amorce en Occident un processus accéléré de transition
au socialisme, différent du schéma de Lénine (une avant-
garde organisée qui, se fondant sur le consentement et
l'alliance des classes, prend le pouvoir, pour tous, au travers
d'un acte révolutionnaire) et différent, évidemment, du rêve
social-démocrate d'un déplacement graduel des forces poli-
tiques à l'intérieur des mécanismes traditionnels de la démo-
cratie parlementaire. Dans ce processus, où le centre de
gravité se déplace des forces politiques vers les forces sociales,
le parti doit exercer un rôle d'hégémonie — c'est-à-dire être
apte à prévoir et à solliciter un ensemble de pressions et de
poussées, même autonomes — au lieu de se restreindre à la
pure et simple direction. La théorie gramscienne s'affirme
donc avec une indéniable actualité au sein de la crise de la
société et même des partis politiques traditionnels.
Mais il faut alors prouver que la protestation étudiante
constitue une crise sociale effective et n'est pas une cons-
truction idéologique abstraite. Dans le premier cas, sa prise
en charge implique que le complexe des forces révolutionnaires
assume cette contradiction comme une composante propre
à son champ d'activité et partant à sa stratégie.
constitue une crise sociale effective et n'est pas une cons-
truction idéologique abstraite. Dans le premier cas, sa prise
en charge implique que le complexe des forces révolutionnaires
assume cette contradiction comme une composante propre
à son champ d'activité et partant à sa stratégie.
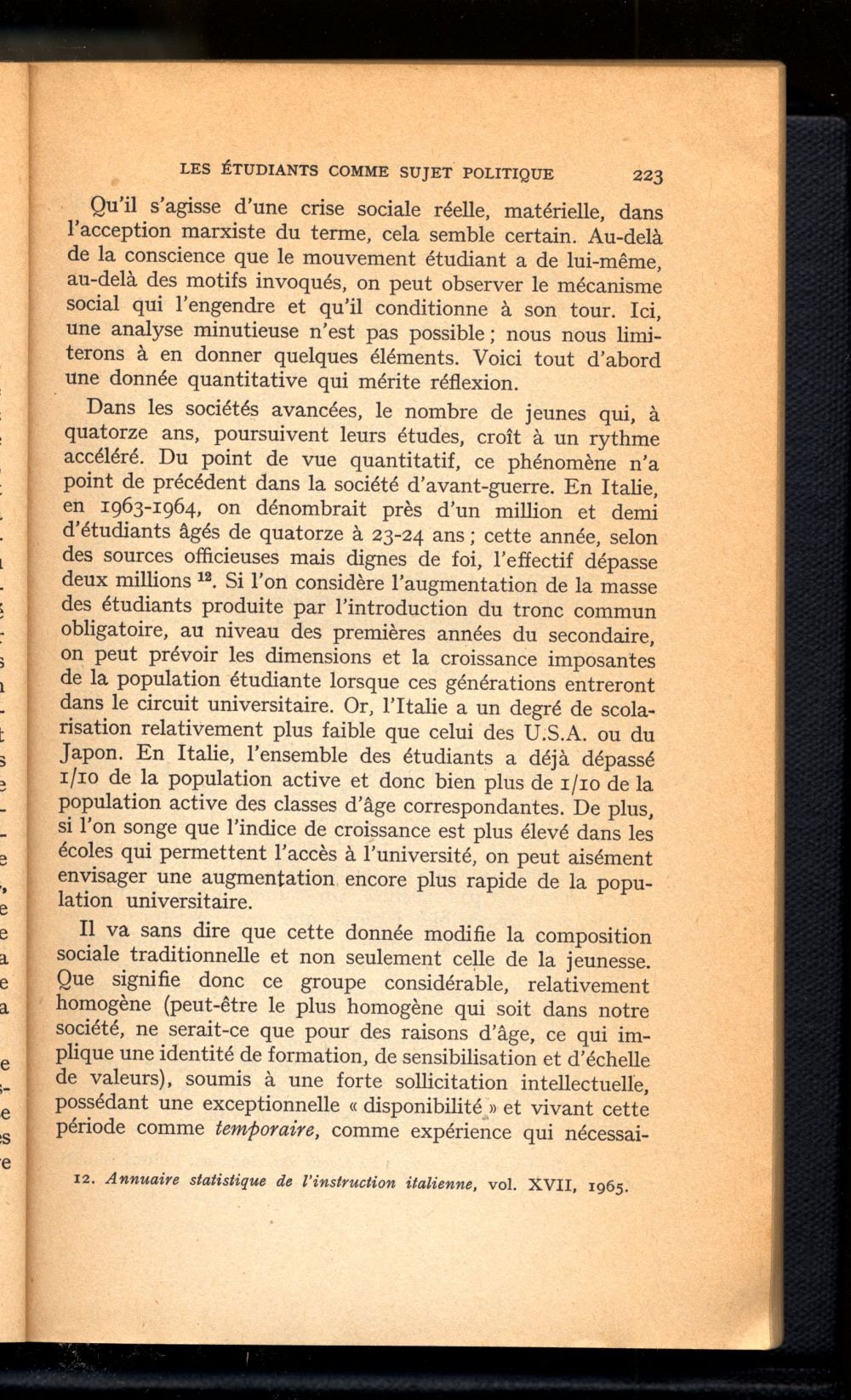

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
223
Qu'il s'agisse d'une crise sociale réelle, matérielle, dans
l'acception marxiste du terme, cela semble certain. Au-delà
de la conscience que le mouvement étudiant a de lui-même,
au-delà des motifs invoqués, on peut observer le mécanisme
social qui l'engendre et qu'il conditionne à son tour. Ici,
une analyse minutieuse n'est pas possible ; nous nous limi-
terons à en donner quelques éléments. Voici tout d'abord
une donnée quantitative qui mérite réflexion.
l'acception marxiste du terme, cela semble certain. Au-delà
de la conscience que le mouvement étudiant a de lui-même,
au-delà des motifs invoqués, on peut observer le mécanisme
social qui l'engendre et qu'il conditionne à son tour. Ici,
une analyse minutieuse n'est pas possible ; nous nous limi-
terons à en donner quelques éléments. Voici tout d'abord
une donnée quantitative qui mérite réflexion.
Dans les sociétés avancées, le nombre de jeunes qui, à
quatorze ans, poursuivent leurs études, croît à un rythme
accéléré. Du point de vue quantitatif, ce phénomène n'a
point de précédent dans la société d'avant-guerre. En Italie,
en 1963-1964, on dénombrait près d'un million et demi
d'étudiants âgés de quatorze à 23-24 ans ; cette année, selon
des sources officieuses mais dignes de foi, l'effectif dépasse
deux millions 12. Si l'on considère l'augmentation de la masse
des étudiants produite par l'introduction du tronc commun
obligatoire, au niveau des premières années du secondaire,
on peut prévoir les dimensions et la croissance imposantes
de la population étudiante lorsque ces générations entreront
dans le circuit universitaire. Or, l'Italie a un degré de scola-
risation relativement plus faible que celui des U.S.A. ou du
Japon. En Italie, l'ensemble des étudiants a déjà dépassé
i/io de la population active et donc bien plus de i/io de la
population active des classes d'âge correspondantes. De plus,
si l'on songe que l'indice de croissance est plus élevé dans les
écoles qui permettent l'accès à l'université, on peut aisément
envisager une augmentation encore plus rapide de la popu-
lation universitaire.
quatorze ans, poursuivent leurs études, croît à un rythme
accéléré. Du point de vue quantitatif, ce phénomène n'a
point de précédent dans la société d'avant-guerre. En Italie,
en 1963-1964, on dénombrait près d'un million et demi
d'étudiants âgés de quatorze à 23-24 ans ; cette année, selon
des sources officieuses mais dignes de foi, l'effectif dépasse
deux millions 12. Si l'on considère l'augmentation de la masse
des étudiants produite par l'introduction du tronc commun
obligatoire, au niveau des premières années du secondaire,
on peut prévoir les dimensions et la croissance imposantes
de la population étudiante lorsque ces générations entreront
dans le circuit universitaire. Or, l'Italie a un degré de scola-
risation relativement plus faible que celui des U.S.A. ou du
Japon. En Italie, l'ensemble des étudiants a déjà dépassé
i/io de la population active et donc bien plus de i/io de la
population active des classes d'âge correspondantes. De plus,
si l'on songe que l'indice de croissance est plus élevé dans les
écoles qui permettent l'accès à l'université, on peut aisément
envisager une augmentation encore plus rapide de la popu-
lation universitaire.
Il va sans dire que cette donnée modifie la composition
sociale traditionnelle et non seulement celle de la jeunesse.
Que signifie donc ce groupe considérable, relativement
homogène (peut-être le plus homogène qui soit dans notre
société, ne serait-ce que pour des raisons d'âge, ce qui im-
plique une identité de formation, de sensibilisation et d'échelle
de valeurs), soumis à une forte sollicitation intellectuelle,
possédant une exceptionnelle « disponibilité » et vivant cette
période comme temporaire, comme expérience qui nécessai-
sociale traditionnelle et non seulement celle de la jeunesse.
Que signifie donc ce groupe considérable, relativement
homogène (peut-être le plus homogène qui soit dans notre
société, ne serait-ce que pour des raisons d'âge, ce qui im-
plique une identité de formation, de sensibilisation et d'échelle
de valeurs), soumis à une forte sollicitation intellectuelle,
possédant une exceptionnelle « disponibilité » et vivant cette
période comme temporaire, comme expérience qui nécessai-
12. Annuaire statistique de l'instruction italienne, vol. XVII, 1965.
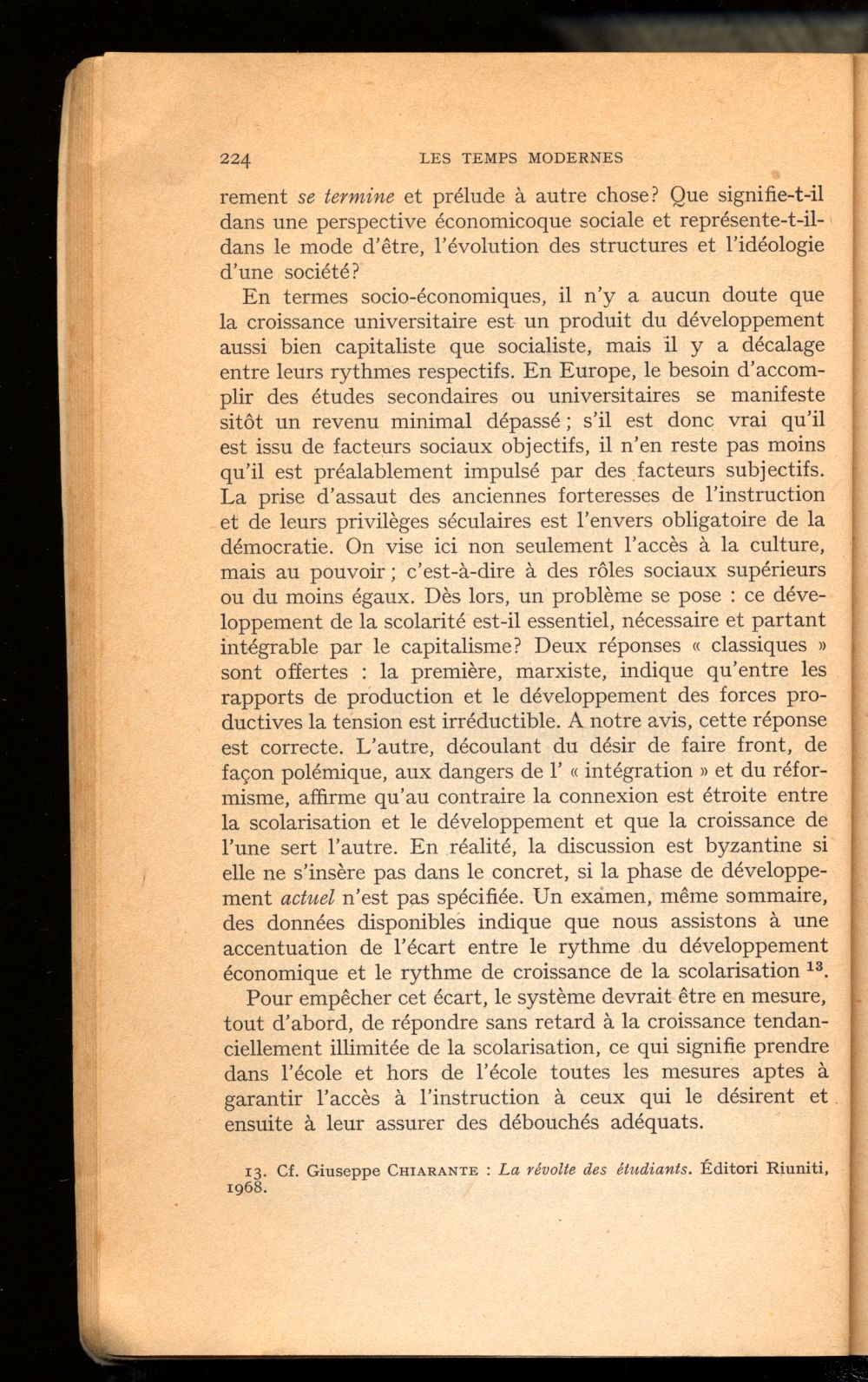

224
LES TEMPS MODERNES
rement se termine et prélude à autre chose? Que signifie-t-il
dans une perspective économicoque sociale et représente-t-il-
dans le mode d'être, l'évolution des structures et l'idéologie
d'une société?
dans une perspective économicoque sociale et représente-t-il-
dans le mode d'être, l'évolution des structures et l'idéologie
d'une société?
En termes socio-économiques, il n'y a aucun doute que
la croissance universitaire est un produit du développement
aussi bien capitaliste que socialiste, mais il y a décalage
entre leurs rythmes respectifs. En Europe, le besoin d'accom-
plir des études secondaires ou universitaires se manifeste
sitôt un revenu minimal dépassé ; s'il est donc vrai qu'il
est issu de facteurs sociaux objectifs, il n'en reste pas moins
qu'il est préalablement impulsé par des facteurs subjectifs.
La prise d'assaut des anciennes forteresses de l'instruction
et de leurs privilèges séculaires est l'envers obligatoire de la
démocratie. On vise ici non seulement l'accès à la culture,
mais au pouvoir ; c'est-à-dire à des rôles sociaux supérieurs
ou du moins égaux. Dès lors, un problème se pose : ce déve-
loppement de la scolarité est-il essentiel, nécessaire et partant
intégrable par le capitalisme? Deux réponses « classiques »
sont offertes : la première, marxiste, indique qu'entre les
rapports de production et le développement des forces pro-
ductives la tension est irréductible. A notre avis, cette réponse
est correcte. L'autre, découlant du désir de faire front, de
façon polémique, aux dangers de 1' « intégration » et du réfor-
misme, affirme qu'au contraire la connexion est étroite entre
la scolarisation et le développement et que la croissance de
l'une sert l'autre. En réalité, la discussion est byzantine si
elle ne s'insère pas dans le concret, si la phase de développe-
ment actuel n'est pas spécifiée. Un examen, même sommaire,
des données disponibles indique que nous assistons à une
accentuation de l'écart entre le rythme du développement
économique et le rythme de croissance de la scolarisation 13.
la croissance universitaire est un produit du développement
aussi bien capitaliste que socialiste, mais il y a décalage
entre leurs rythmes respectifs. En Europe, le besoin d'accom-
plir des études secondaires ou universitaires se manifeste
sitôt un revenu minimal dépassé ; s'il est donc vrai qu'il
est issu de facteurs sociaux objectifs, il n'en reste pas moins
qu'il est préalablement impulsé par des facteurs subjectifs.
La prise d'assaut des anciennes forteresses de l'instruction
et de leurs privilèges séculaires est l'envers obligatoire de la
démocratie. On vise ici non seulement l'accès à la culture,
mais au pouvoir ; c'est-à-dire à des rôles sociaux supérieurs
ou du moins égaux. Dès lors, un problème se pose : ce déve-
loppement de la scolarité est-il essentiel, nécessaire et partant
intégrable par le capitalisme? Deux réponses « classiques »
sont offertes : la première, marxiste, indique qu'entre les
rapports de production et le développement des forces pro-
ductives la tension est irréductible. A notre avis, cette réponse
est correcte. L'autre, découlant du désir de faire front, de
façon polémique, aux dangers de 1' « intégration » et du réfor-
misme, affirme qu'au contraire la connexion est étroite entre
la scolarisation et le développement et que la croissance de
l'une sert l'autre. En réalité, la discussion est byzantine si
elle ne s'insère pas dans le concret, si la phase de développe-
ment actuel n'est pas spécifiée. Un examen, même sommaire,
des données disponibles indique que nous assistons à une
accentuation de l'écart entre le rythme du développement
économique et le rythme de croissance de la scolarisation 13.
Pour empêcher cet écart, le système devrait être en mesure,
tout d'abord, de répondre sans retard à la croissance tendan-
ciellement illimitée de la scolarisation, ce qui signifie prendre
dans l'école et hors de l'école toutes les mesures aptes à
garantir l'accès à l'instruction à ceux qui le désirent et
ensuite à leur assurer des débouchés adéquats.
tout d'abord, de répondre sans retard à la croissance tendan-
ciellement illimitée de la scolarisation, ce qui signifie prendre
dans l'école et hors de l'école toutes les mesures aptes à
garantir l'accès à l'instruction à ceux qui le désirent et
ensuite à leur assurer des débouchés adéquats.
13. Cf. Giuseppe CHIARANTE : La révolte des étudiants. Éditori Riuniti,
1968.
1968.
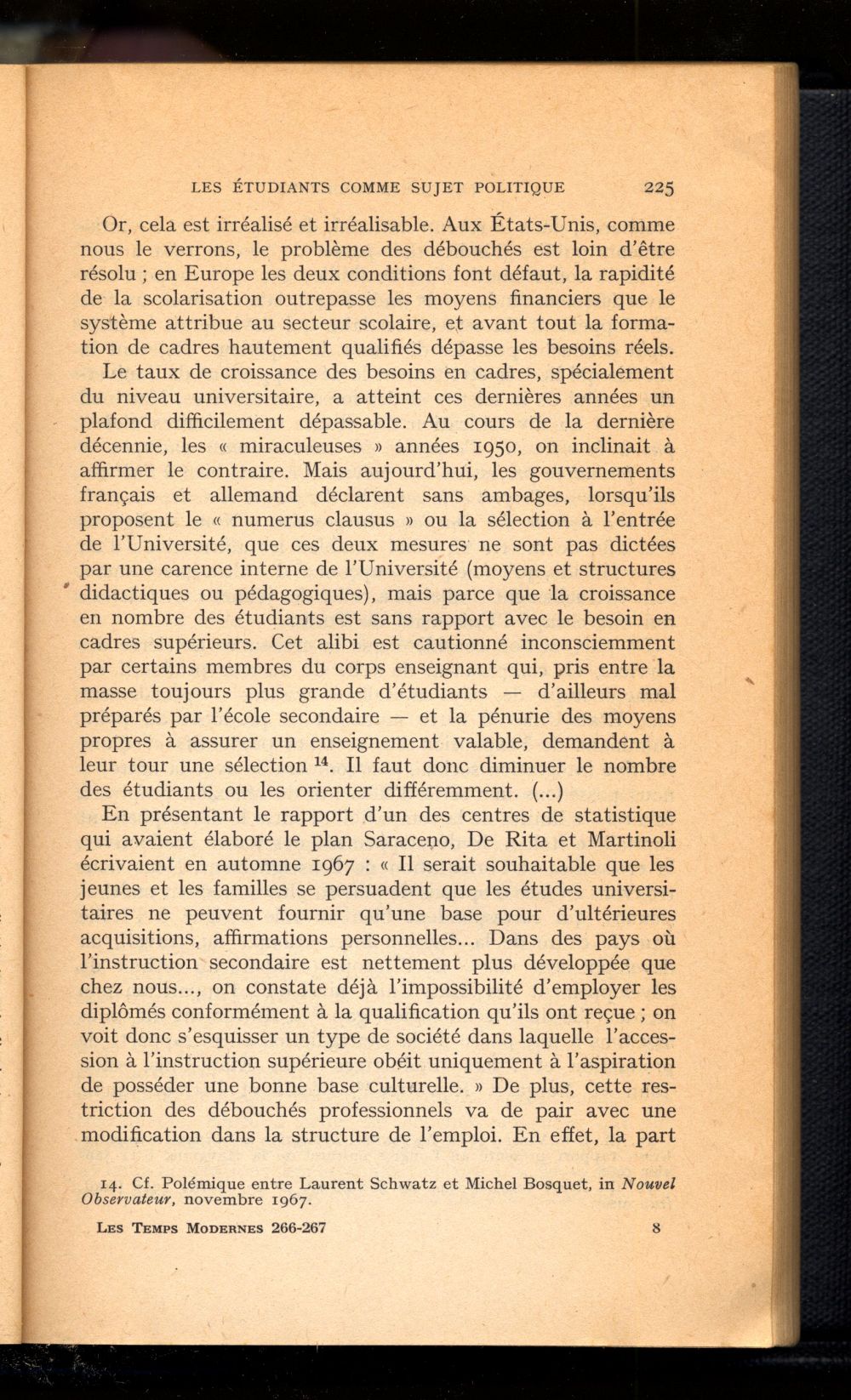

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
225
Or, cela est irréalisé et irréalisable. Aux États-Unis, comme
nous le verrons, le problème des débouchés est loin d'être
résolu ; en Europe les deux conditions font défaut, la rapidité
de la scolarisation outrepasse les moyens financiers que le
système attribue au secteur scolaire, et avant tout la forma-
tion de cadres hautement qualifiés dépasse les besoins réels.
nous le verrons, le problème des débouchés est loin d'être
résolu ; en Europe les deux conditions font défaut, la rapidité
de la scolarisation outrepasse les moyens financiers que le
système attribue au secteur scolaire, et avant tout la forma-
tion de cadres hautement qualifiés dépasse les besoins réels.
Le taux de croissance des besoins en cadres, spécialement
du niveau universitaire, a atteint ces dernières années un
plafond difficilement dépassable. Au cours de la dernière
décennie, les « miraculeuses » années 1950, on inclinait à
affirmer le contraire. Mais aujourd'hui, les gouvernements
français et allemand déclarent sans ambages, lorsqu'ils
proposent le « numerus clausus » ou la sélection à l'entrée
de l'Université, que ces deux mesures ne sont pas dictées
par une carence interne de l'Université (moyens et structures
didactiques ou pédagogiques), mais parce que la croissance
en nombre des étudiants est sans rapport avec le besoin en
cadres supérieurs. Cet alibi est cautionné inconsciemment
par certains membres du corps enseignant qui, pris entre la
masse toujours plus grande d'étudiants — d'ailleurs mal
préparés par l'école secondaire — et la pénurie des moyens
propres à assurer un enseignement valable, demandent à
leur tour une sélection 14. Il faut donc diminuer le nombre
des étudiants ou les orienter différemment. (...)
du niveau universitaire, a atteint ces dernières années un
plafond difficilement dépassable. Au cours de la dernière
décennie, les « miraculeuses » années 1950, on inclinait à
affirmer le contraire. Mais aujourd'hui, les gouvernements
français et allemand déclarent sans ambages, lorsqu'ils
proposent le « numerus clausus » ou la sélection à l'entrée
de l'Université, que ces deux mesures ne sont pas dictées
par une carence interne de l'Université (moyens et structures
didactiques ou pédagogiques), mais parce que la croissance
en nombre des étudiants est sans rapport avec le besoin en
cadres supérieurs. Cet alibi est cautionné inconsciemment
par certains membres du corps enseignant qui, pris entre la
masse toujours plus grande d'étudiants — d'ailleurs mal
préparés par l'école secondaire — et la pénurie des moyens
propres à assurer un enseignement valable, demandent à
leur tour une sélection 14. Il faut donc diminuer le nombre
des étudiants ou les orienter différemment. (...)
En présentant le rapport d'un des centres de statistique
qui avaient élaboré le plan Saraceno, De Rita et Martinoli
écrivaient en automne 1967 : « II serait souhaitable que les
jeunes et les familles se persuadent que les études universi-
taires ne peuvent fournir qu'une base pour d'ultérieures
acquisitions, affirmations personnelles... Dans des pays où
l'instruction secondaire est nettement plus développée que
chez nous..., on constate déjà l'impossibilité d'employer les
diplômés conformément à la qualification qu'ils ont reçue ; on
voit donc s'esquisser un type de société dans laquelle l'acces-
sion à l'instruction supérieure obéit uniquement à l'aspiration
de posséder une bonne base culturelle. » De plus, cette res-
triction des débouchés professionnels va de pair avec une
modification dans la structure de l'emploi. En effet, la part
qui avaient élaboré le plan Saraceno, De Rita et Martinoli
écrivaient en automne 1967 : « II serait souhaitable que les
jeunes et les familles se persuadent que les études universi-
taires ne peuvent fournir qu'une base pour d'ultérieures
acquisitions, affirmations personnelles... Dans des pays où
l'instruction secondaire est nettement plus développée que
chez nous..., on constate déjà l'impossibilité d'employer les
diplômés conformément à la qualification qu'ils ont reçue ; on
voit donc s'esquisser un type de société dans laquelle l'acces-
sion à l'instruction supérieure obéit uniquement à l'aspiration
de posséder une bonne base culturelle. » De plus, cette res-
triction des débouchés professionnels va de pair avec une
modification dans la structure de l'emploi. En effet, la part
14. Cf. Polémique entre Laurent Schwatz et Michel Bosquet, in Nouvel
Observateur, novembre 1967.
Observateur, novembre 1967.
LES TEMPS MODERNES 266-267 8
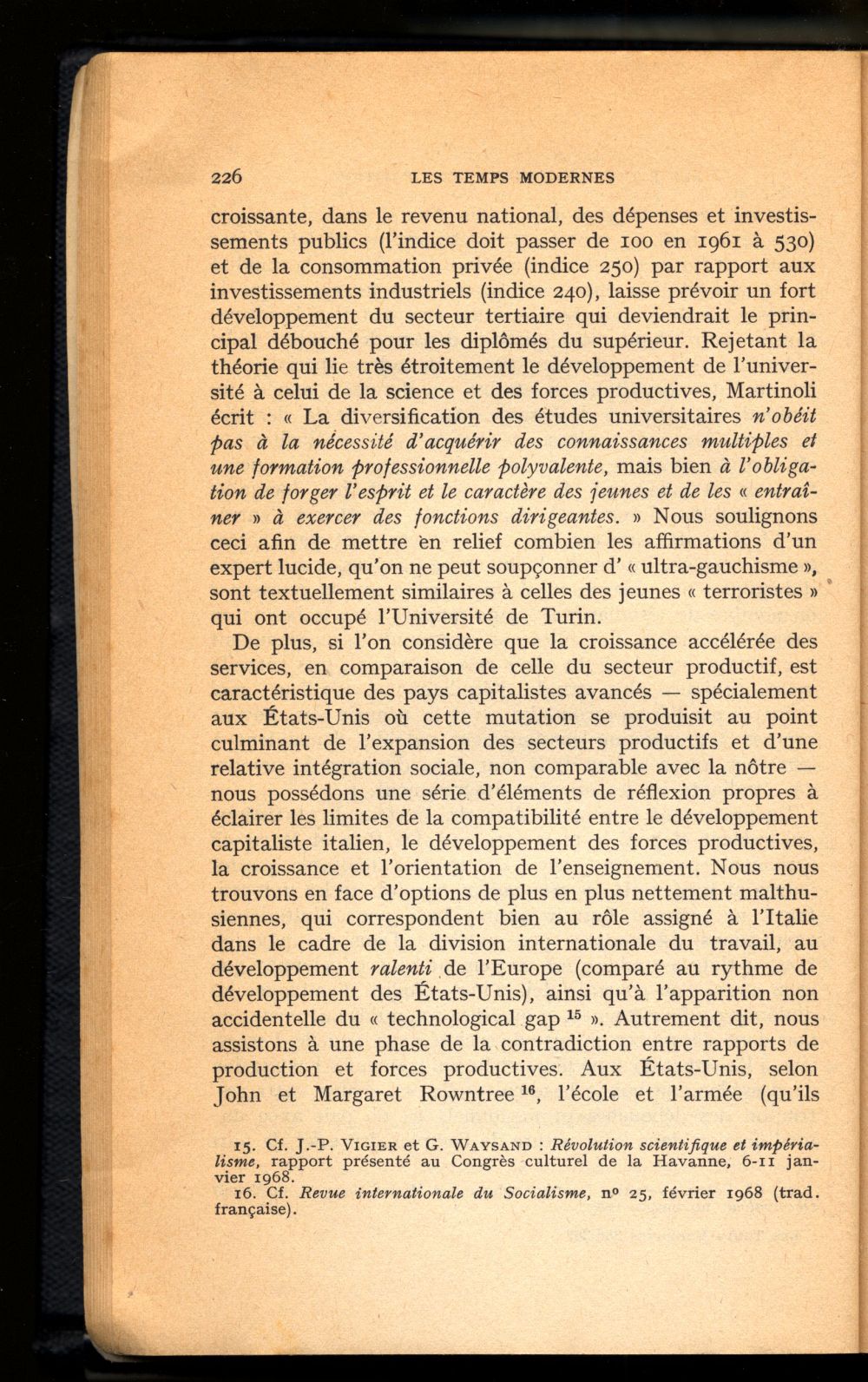

220
LES TEMPS MODERNES
croissante, dans le revenu national, des dépenses et investis-
sements publics (l'indice doit passer de 100 en 1961 à 530)
et de la consommation privée (indice 250) par rapport aux
investissements industriels (indice 240), laisse prévoir un fort
développement du secteur tertiaire qui deviendrait le prin-
cipal débouché pour les diplômés du supérieur. Rejetant la
théorie qui lie très étroitement le développement de l'univer-
sité à celui de la science et des forces productives, Martinoli
écrit : « La diversification des études universitaires n'obéit
pas à la nécessité d'acquérir des connaissances multiples et
une formation professionnelle polyvalente, mais bien à l'obliga-
tion de forger l'esprit et le caractère des jeunes et de les « entraî-
ner » à exercer des fonctions dirigeantes. » Nous soulignons
ceci afin de mettre en relief combien les affirmations d'un
expert lucide, qu'on ne peut soupçonner d' « ultra-gauchisme »,
sont textuellement similaires à celles des jeunes « terroristes »
qui ont occupé l'Université de Turin.
sements publics (l'indice doit passer de 100 en 1961 à 530)
et de la consommation privée (indice 250) par rapport aux
investissements industriels (indice 240), laisse prévoir un fort
développement du secteur tertiaire qui deviendrait le prin-
cipal débouché pour les diplômés du supérieur. Rejetant la
théorie qui lie très étroitement le développement de l'univer-
sité à celui de la science et des forces productives, Martinoli
écrit : « La diversification des études universitaires n'obéit
pas à la nécessité d'acquérir des connaissances multiples et
une formation professionnelle polyvalente, mais bien à l'obliga-
tion de forger l'esprit et le caractère des jeunes et de les « entraî-
ner » à exercer des fonctions dirigeantes. » Nous soulignons
ceci afin de mettre en relief combien les affirmations d'un
expert lucide, qu'on ne peut soupçonner d' « ultra-gauchisme »,
sont textuellement similaires à celles des jeunes « terroristes »
qui ont occupé l'Université de Turin.
De plus, si l'on considère que la croissance accélérée des
services, en comparaison de celle du secteur productif, est
caractéristique des pays capitalistes avancés — spécialement
aux États-Unis où cette mutation se produisit au point
culminant de l'expansion des secteurs productifs et d'une
relative intégration sociale, non comparable avec la nôtre —
nous possédons une série d'éléments de réflexion propres à
éclairer les limites de la compatibilité entre le développement
capitaliste italien, le développement des forces productives,
la croissance et l'orientation de l'enseignement. Nous nous
trouvons en face d'options de plus en plus nettement malthu-
siennes, qui correspondent bien au rôle assigné à l'Italie
dans le cadre de la division internationale du travail, au
développement ralenti de l'Europe (comparé au rythme de
développement des États-Unis), ainsi qu'à l'apparition non
accidentelle du « technological gap 15 ». Autrement dit, nous
assistons à une phase de la contradiction entre rapports de
production et forces productives. Aux États-Unis, selon
John et Margaret Rowntree16, l'école et l'armée (qu'ils
services, en comparaison de celle du secteur productif, est
caractéristique des pays capitalistes avancés — spécialement
aux États-Unis où cette mutation se produisit au point
culminant de l'expansion des secteurs productifs et d'une
relative intégration sociale, non comparable avec la nôtre —
nous possédons une série d'éléments de réflexion propres à
éclairer les limites de la compatibilité entre le développement
capitaliste italien, le développement des forces productives,
la croissance et l'orientation de l'enseignement. Nous nous
trouvons en face d'options de plus en plus nettement malthu-
siennes, qui correspondent bien au rôle assigné à l'Italie
dans le cadre de la division internationale du travail, au
développement ralenti de l'Europe (comparé au rythme de
développement des États-Unis), ainsi qu'à l'apparition non
accidentelle du « technological gap 15 ». Autrement dit, nous
assistons à une phase de la contradiction entre rapports de
production et forces productives. Aux États-Unis, selon
John et Margaret Rowntree16, l'école et l'armée (qu'ils
15. Cf. J.-P. VICIER et G. WAYSAND : Révolution scientifique et impéria-
lisme, rapport présenté au Congrès culturel de la Havanne, 6-n jan-
vier 1968.
lisme, rapport présenté au Congrès culturel de la Havanne, 6-n jan-
vier 1968.
16. Cf. Revue internationale du Socialisme, n° 25, février 1968 (trad.
française).
française).
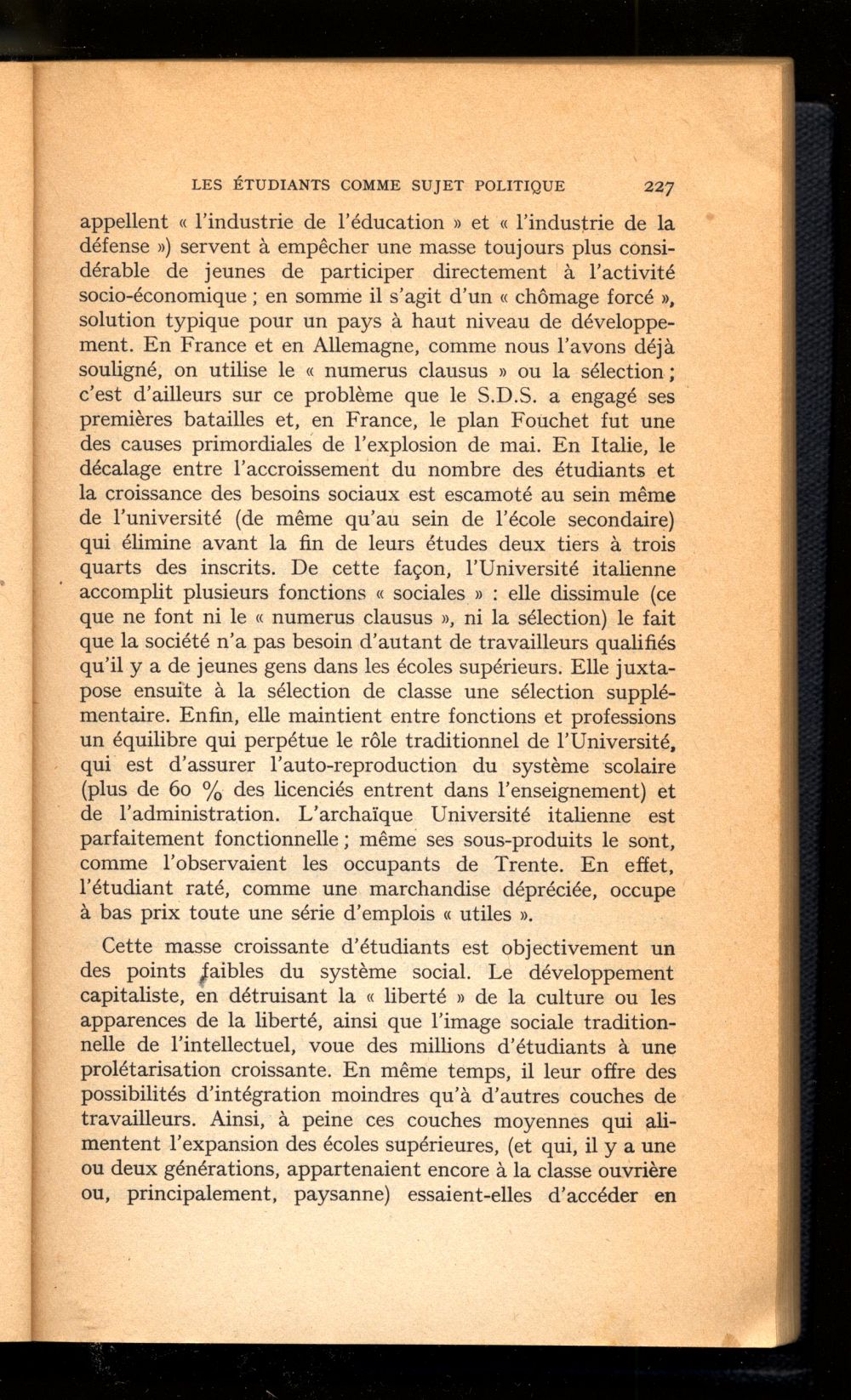

LES ÉTUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
227
appellent « l'industrie de l'éducation » et « l'industrie de la
défense ») servent à empêcher une masse toujours plus consi-
dérable de jeunes de participer directement à l'activité
socio-économique ; en somme il s'agit d'un « chômage forcé »,
solution typique pour un pays à haut niveau de développe-
ment. En France et en Allemagne, comme nous l'avons déjà
souligné, on utilise le « numerus clausus » ou la sélection ;
c'est d'ailleurs sur ce problème que le S.D.S. a engagé ses
premières batailles et, en France, le plan Fouchet fut une
des causes primordiales de l'explosion de mai. En Italie, le
décalage entre l'accroissement du nombre des étudiants et
la croissance des besoins sociaux est escamoté au sein même
de l'université (de même qu'au sein de l'école secondaire)
qui élimine avant la fin de leurs études deux tiers à trois
quarts des inscrits. De cette façon, l'Université italienne
accomplit plusieurs fonctions « sociales » : elle dissimule (ce
que ne font ni le « numerus clausus », ni la sélection) le fait
que la société n'a pas besoin d'autant de travailleurs qualifiés
qu'il y a de jeunes gens dans les écoles supérieurs. Elle juxta-
pose ensuite à la sélection de classe une sélection supplé-
mentaire. Enfin, elle maintient entre fonctions et professions
un équilibre qui perpétue le rôle traditionnel de l'Université,
qui est d'assurer l'auto-reproduction du système scolaire
(plus de 60 % des licenciés entrent dans l'enseignement) et
de l'administration. L'archaïque Université italienne est
parfaitement fonctionnelle ; même ses sous-produits le sont,
comme l'observaient les occupants de Trente. En effet,
l'étudiant raté, comme une marchandise dépréciée, occupe
à bas prix toute une série d'emplois « utiles ».
défense ») servent à empêcher une masse toujours plus consi-
dérable de jeunes de participer directement à l'activité
socio-économique ; en somme il s'agit d'un « chômage forcé »,
solution typique pour un pays à haut niveau de développe-
ment. En France et en Allemagne, comme nous l'avons déjà
souligné, on utilise le « numerus clausus » ou la sélection ;
c'est d'ailleurs sur ce problème que le S.D.S. a engagé ses
premières batailles et, en France, le plan Fouchet fut une
des causes primordiales de l'explosion de mai. En Italie, le
décalage entre l'accroissement du nombre des étudiants et
la croissance des besoins sociaux est escamoté au sein même
de l'université (de même qu'au sein de l'école secondaire)
qui élimine avant la fin de leurs études deux tiers à trois
quarts des inscrits. De cette façon, l'Université italienne
accomplit plusieurs fonctions « sociales » : elle dissimule (ce
que ne font ni le « numerus clausus », ni la sélection) le fait
que la société n'a pas besoin d'autant de travailleurs qualifiés
qu'il y a de jeunes gens dans les écoles supérieurs. Elle juxta-
pose ensuite à la sélection de classe une sélection supplé-
mentaire. Enfin, elle maintient entre fonctions et professions
un équilibre qui perpétue le rôle traditionnel de l'Université,
qui est d'assurer l'auto-reproduction du système scolaire
(plus de 60 % des licenciés entrent dans l'enseignement) et
de l'administration. L'archaïque Université italienne est
parfaitement fonctionnelle ; même ses sous-produits le sont,
comme l'observaient les occupants de Trente. En effet,
l'étudiant raté, comme une marchandise dépréciée, occupe
à bas prix toute une série d'emplois « utiles ».
Cette masse croissante d'étudiants est objectivement un
des points faibles du système social. Le développement
capitaliste, en détruisant la « liberté » de la culture ou les
apparences de la liberté, ainsi que l'image sociale tradition-
nelle de l'intellectuel, voue des millions d'étudiants à une
prolétarisation croissante. En même temps, il leur offre des
possibilités d'intégration moindres qu'à d'autres couches de
travailleurs. Ainsi, à peine ces couches moyennes qui ali-
mentent l'expansion des écoles supérieures, (et qui, il y a une
ou deux générations, appartenaient encore à la classe ouvrière
ou, principalement, paysanne) essaient-elles d'accéder en
des points faibles du système social. Le développement
capitaliste, en détruisant la « liberté » de la culture ou les
apparences de la liberté, ainsi que l'image sociale tradition-
nelle de l'intellectuel, voue des millions d'étudiants à une
prolétarisation croissante. En même temps, il leur offre des
possibilités d'intégration moindres qu'à d'autres couches de
travailleurs. Ainsi, à peine ces couches moyennes qui ali-
mentent l'expansion des écoles supérieures, (et qui, il y a une
ou deux générations, appartenaient encore à la classe ouvrière
ou, principalement, paysanne) essaient-elles d'accéder en
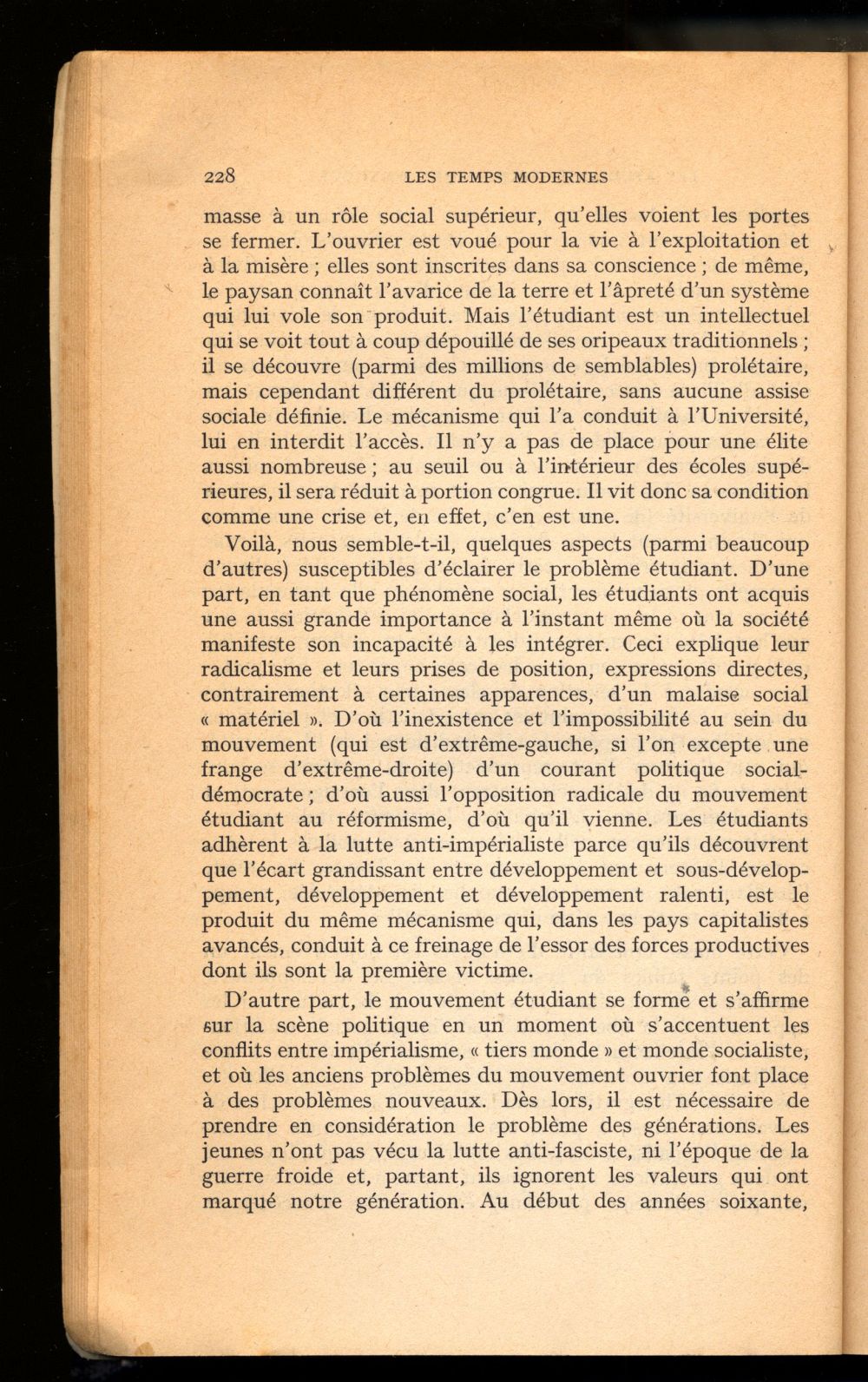

228
LES TEMPS MODERNES
masse à un rôle social supérieur, qu'elles voient les portes
se fermer. L'ouvrier est voué pour la vie à l'exploitation et
à la misère ; elles sont inscrites dans sa conscience ; de même,
le paysan connaît l'avarice de la terre et l'âpreté d'un système
qui lui vole son produit. Mais l'étudiant est un intellectuel
qui se voit tout à coup dépouillé de ses oripeaux traditionnels ;
il se découvre (parmi des millions de semblables) prolétaire,
mais cependant différent du prolétaire, sans aucune assise
sociale définie. Le mécanisme qui l'a conduit à l'Université,
lui en interdit l'accès. Il n'y a pas de place pour une élite
aussi nombreuse ; au seuil ou à l'intérieur des écoles supé-
rieures, il sera réduit à portion congrue. Il vit donc sa condition
comme une crise et, en effet, c'en est une.
se fermer. L'ouvrier est voué pour la vie à l'exploitation et
à la misère ; elles sont inscrites dans sa conscience ; de même,
le paysan connaît l'avarice de la terre et l'âpreté d'un système
qui lui vole son produit. Mais l'étudiant est un intellectuel
qui se voit tout à coup dépouillé de ses oripeaux traditionnels ;
il se découvre (parmi des millions de semblables) prolétaire,
mais cependant différent du prolétaire, sans aucune assise
sociale définie. Le mécanisme qui l'a conduit à l'Université,
lui en interdit l'accès. Il n'y a pas de place pour une élite
aussi nombreuse ; au seuil ou à l'intérieur des écoles supé-
rieures, il sera réduit à portion congrue. Il vit donc sa condition
comme une crise et, en effet, c'en est une.
Voilà, nous semble-t-il, quelques aspects (parmi beaucoup
d'autres) susceptibles d'éclairer le problème étudiant. D'une
part, en tant que phénomène social, les étudiants ont acquis
une aussi grande importance à l'instant même où la société
manifeste son incapacité à les intégrer. Ceci explique leur
radicalisme et leurs prises de position, expressions directes,
contrairement à certaines apparences, d'un malaise social
« matériel ». D'où l'inexistence et l'impossibilité au sein du
mouvement (qui est d'extrême-gauche, si l'on excepte une
frange d'extrême-droite) d'un courant politique social-
démocrate ; d'où aussi l'opposition radicale du mouvement
étudiant au réformisme, d'où qu'il vienne. Les étudiants
adhèrent à la lutte anti-impérialiste parce qu'ils découvrent
que l'écart grandissant entre développement et sous-dévelop-
pement, développement et développement ralenti, est le
produit du même mécanisme qui, dans les pays capitalistes
avancés, conduit à ce freinage de l'essor des forces productives
dont ils sont la première victime.
d'autres) susceptibles d'éclairer le problème étudiant. D'une
part, en tant que phénomène social, les étudiants ont acquis
une aussi grande importance à l'instant même où la société
manifeste son incapacité à les intégrer. Ceci explique leur
radicalisme et leurs prises de position, expressions directes,
contrairement à certaines apparences, d'un malaise social
« matériel ». D'où l'inexistence et l'impossibilité au sein du
mouvement (qui est d'extrême-gauche, si l'on excepte une
frange d'extrême-droite) d'un courant politique social-
démocrate ; d'où aussi l'opposition radicale du mouvement
étudiant au réformisme, d'où qu'il vienne. Les étudiants
adhèrent à la lutte anti-impérialiste parce qu'ils découvrent
que l'écart grandissant entre développement et sous-dévelop-
pement, développement et développement ralenti, est le
produit du même mécanisme qui, dans les pays capitalistes
avancés, conduit à ce freinage de l'essor des forces productives
dont ils sont la première victime.
D'autre part, le mouvement étudiant se forme et s'affirme
sur la scène politique en un moment où s'accentuent les
conflits entre impérialisme, « tiers monde » et monde socialiste,
et où les anciens problèmes du mouvement ouvrier font place
à des problèmes nouveaux. Dès lors, il est nécessaire de
prendre en considération le problème des générations. Les
jeunes n'ont pas vécu la lutte anti-fasciste, ni l'époque de la
guerre froide et, partant, ils ignorent les valeurs qui ont
marqué notre génération. Au début des années soixante,
sur la scène politique en un moment où s'accentuent les
conflits entre impérialisme, « tiers monde » et monde socialiste,
et où les anciens problèmes du mouvement ouvrier font place
à des problèmes nouveaux. Dès lors, il est nécessaire de
prendre en considération le problème des générations. Les
jeunes n'ont pas vécu la lutte anti-fasciste, ni l'époque de la
guerre froide et, partant, ils ignorent les valeurs qui ont
marqué notre génération. Au début des années soixante,
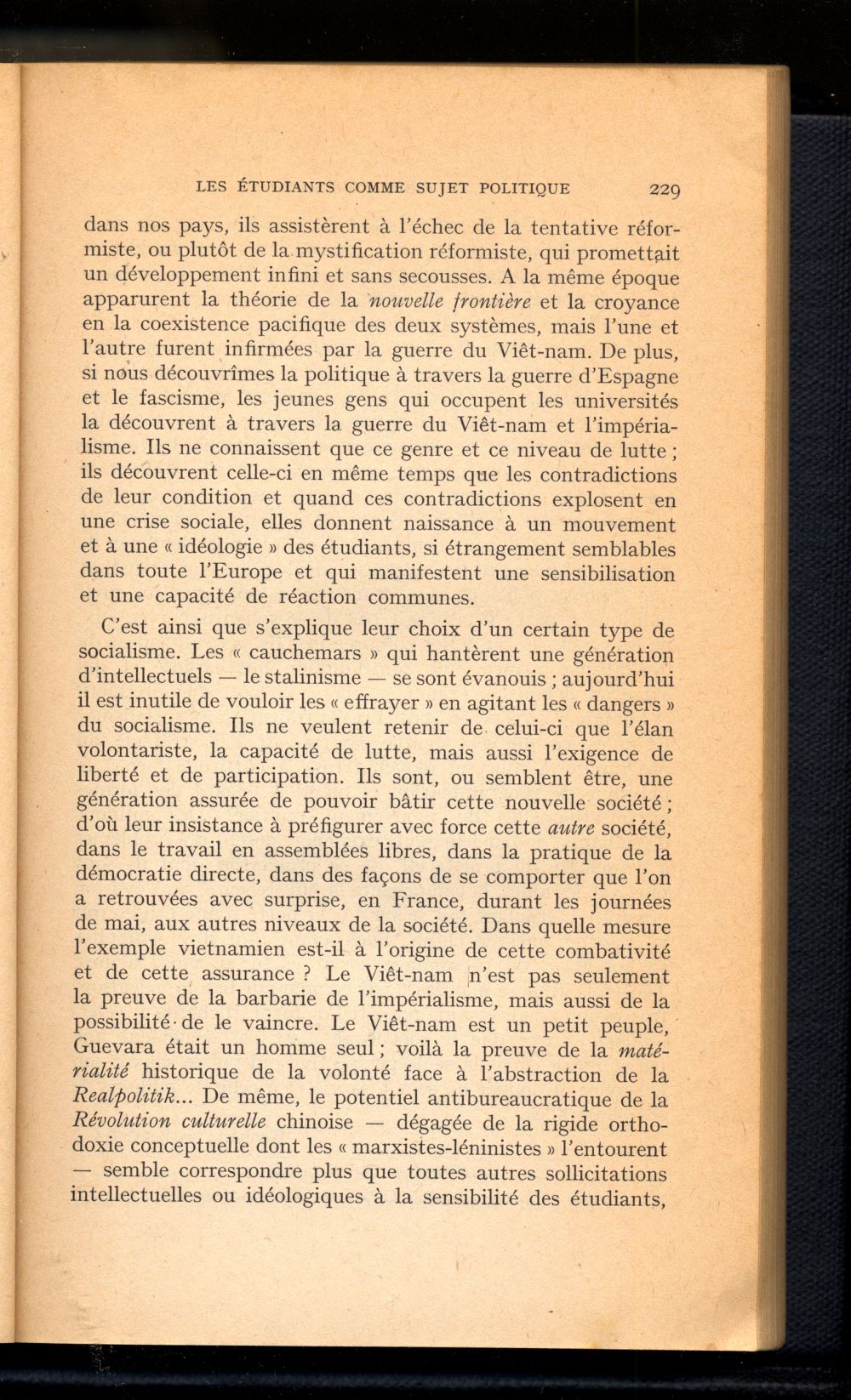

LES ETUDIANTS COMME SUJET POLITIQUE
229
dans nos pays, ils assistèrent à l'échec de la tentative réfor-
miste, ou plutôt de la mystification réformiste, qui promettait
un développement infini et sans secousses. A la même époque
apparurent la théorie de la nouvelle frontière et la croyance
en la coexistence pacifique clés deux systèmes, mais l'une et
l'autre furent infirmées par la guerre du Viêt-nam. De plus,
si nous découvrîmes la politique à travers la guerre d'Espagne
et le fascisme, les jeunes gens qui occupent les universités
la découvrent à travers la guerre du Viêt-nam et l'impéria-
lisme. Ils ne connaissent que ce genre et ce niveau de lutte ;
ils découvrent celle-ci en même temps que les contradictions
de leur condition et quand ces contradictions explosent en
une crise sociale, elles donnent naissance à un mouvement
et à une « idéologie » des étudiants, si étrangement semblables
dans toute l'Europe et qui manifestent une sensibilisation
et une capacité de réaction communes.
miste, ou plutôt de la mystification réformiste, qui promettait
un développement infini et sans secousses. A la même époque
apparurent la théorie de la nouvelle frontière et la croyance
en la coexistence pacifique clés deux systèmes, mais l'une et
l'autre furent infirmées par la guerre du Viêt-nam. De plus,
si nous découvrîmes la politique à travers la guerre d'Espagne
et le fascisme, les jeunes gens qui occupent les universités
la découvrent à travers la guerre du Viêt-nam et l'impéria-
lisme. Ils ne connaissent que ce genre et ce niveau de lutte ;
ils découvrent celle-ci en même temps que les contradictions
de leur condition et quand ces contradictions explosent en
une crise sociale, elles donnent naissance à un mouvement
et à une « idéologie » des étudiants, si étrangement semblables
dans toute l'Europe et qui manifestent une sensibilisation
et une capacité de réaction communes.
C'est ainsi que s'explique leur choix d'un certain type de
socialisme. Les « cauchemars » qui hantèrent une génération
d'intellectuels — le stalinisme — se sont évanouis ; aujourd'hui
il est inutile de vouloir les « effrayer » en agitant les « dangers »
du socialisme. Ils ne veulent retenir de celui-ci que l'élan
volontariste, la capacité de lutte, mais aussi l'exigence de
liberté et de participation. Ils sont, ou semblent être, une
génération assurée de pouvoir bâtir cette nouvelle société ;
d'où leur insistance à préfigurer avec force cette autre société,
dans le travail en assemblées libres, dans la pratique de la
démocratie directe, dans des façons de se comporter que l'on
a retrouvées avec surprise, en France, durant les journées
de mai, aux autres niveaux de la société. Dans quelle mesure
l'exemple vietnamien est-il à l'origine de cette combativité
et de cette assurance ? Le Viêt-nam n'est pas seulement
la preuve de la barbarie de l'impérialisme, mais aussi de la
possibilité • de le vaincre. Le Viêt-nam est un petit peuple,
Guevara était un homme seul ; voilà la preuve de la maté-
rialité historique de la volonté face à l'abstraction de la
Realpolitik... De même, le potentiel antibureaucratique de la
Révolution culturelle chinoise — dégagée de la rigide ortho-
doxie conceptuelle dont les « marxistes-léninistes » l'entourent
— semble correspondre plus que toutes autres sollicitations
intellectuelles ou idéologiques à la sensibilité des étudiants,
socialisme. Les « cauchemars » qui hantèrent une génération
d'intellectuels — le stalinisme — se sont évanouis ; aujourd'hui
il est inutile de vouloir les « effrayer » en agitant les « dangers »
du socialisme. Ils ne veulent retenir de celui-ci que l'élan
volontariste, la capacité de lutte, mais aussi l'exigence de
liberté et de participation. Ils sont, ou semblent être, une
génération assurée de pouvoir bâtir cette nouvelle société ;
d'où leur insistance à préfigurer avec force cette autre société,
dans le travail en assemblées libres, dans la pratique de la
démocratie directe, dans des façons de se comporter que l'on
a retrouvées avec surprise, en France, durant les journées
de mai, aux autres niveaux de la société. Dans quelle mesure
l'exemple vietnamien est-il à l'origine de cette combativité
et de cette assurance ? Le Viêt-nam n'est pas seulement
la preuve de la barbarie de l'impérialisme, mais aussi de la
possibilité • de le vaincre. Le Viêt-nam est un petit peuple,
Guevara était un homme seul ; voilà la preuve de la maté-
rialité historique de la volonté face à l'abstraction de la
Realpolitik... De même, le potentiel antibureaucratique de la
Révolution culturelle chinoise — dégagée de la rigide ortho-
doxie conceptuelle dont les « marxistes-léninistes » l'entourent
— semble correspondre plus que toutes autres sollicitations
intellectuelles ou idéologiques à la sensibilité des étudiants,
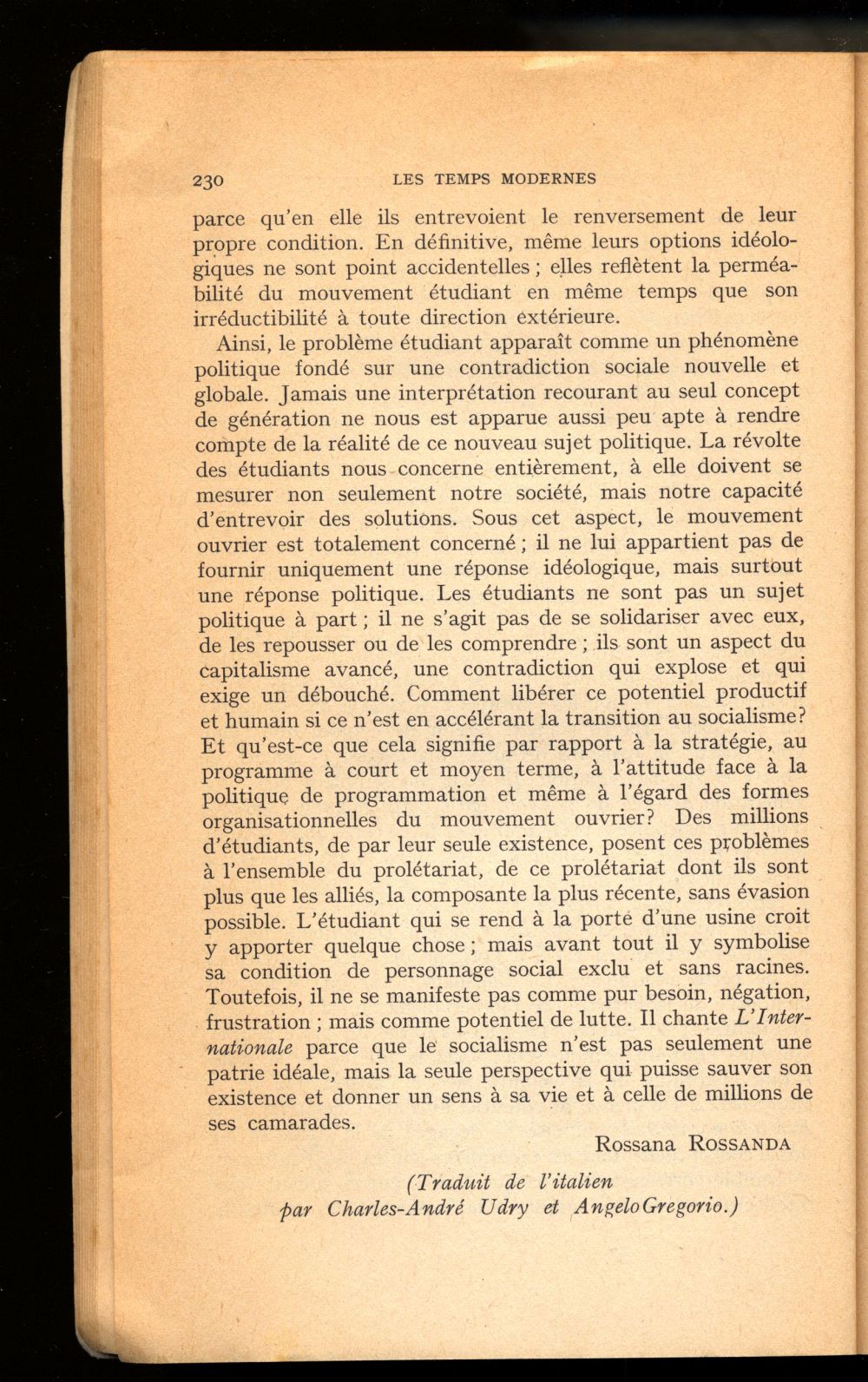

230
LES TEMPS MODERNES
parce qu'en elle ils entrevoient le renversement de leur
propre condition. En définitive, même leurs options idéolo-
giques ne sont point accidentelles ; elles reflètent la perméa-
bilité du mouvement étudiant en même temps que son
irréductibilité à toute direction extérieure.
propre condition. En définitive, même leurs options idéolo-
giques ne sont point accidentelles ; elles reflètent la perméa-
bilité du mouvement étudiant en même temps que son
irréductibilité à toute direction extérieure.
Ainsi, le problème étudiant apparaît comme un phénomène
politique fondé sur une contradiction sociale nouvelle et
globale. Jamais une interprétation recourant au seul concept
de génération ne nous est apparue aussi peu apte à rendre
compte de la réalité de ce nouveau sujet politique. La révolte
des étudiants nous concerne entièrement, à elle doivent se
mesurer non seulement notre société, mais notre capacité
d'entrevoir des solutions. Sous cet aspect, le mouvement
ouvrier est totalement concerné ; il ne lui appartient pas de
fournir uniquement une réponse idéologique, mais surtout
une réponse politique. Les étudiants ne sont pas un sujet
politique à part ; il ne s'agit pas de se solidariser avec eux,
de les repousser ou de les comprendre ; ils sont un aspect du
capitalisme avancé, une contradiction qui explose et qui
exige un débouché. Comment libérer ce potentiel productif
et humain si ce n'est en accélérant la transition au socialisme?
Et qu'est-ce que cela signifie par rapport à la stratégie, au
programme à court et moyen terme, à l'attitude face à la
politique de programmation et même à l'égard des formes
organisationnelles du mouvement ouvrier? Des millions
d'étudiants, de par leur seule existence, posent ces problèmes
à l'ensemble du prolétariat, de ce prolétariat dont ils sont
plus que les alliés, la composante la plus récente, sans évasion
possible. L'étudiant qui se rend à la porte d'une usine croit
y apporter quelque chose ; mais avant tout il y symbolise
sa condition de personnage social exclu et sans racines.
Toutefois, il ne se manifeste pas comme pur besoin, négation,
frustration ; mais comme potentiel de lutte. Il chante L'Inter-
nationale parce que le socialisme n'est pas seulement une
patrie idéale, mais la seule perspective qui puisse sauver son
existence et donner un sens à sa vie et à celle de millions de
ses camarades.
politique fondé sur une contradiction sociale nouvelle et
globale. Jamais une interprétation recourant au seul concept
de génération ne nous est apparue aussi peu apte à rendre
compte de la réalité de ce nouveau sujet politique. La révolte
des étudiants nous concerne entièrement, à elle doivent se
mesurer non seulement notre société, mais notre capacité
d'entrevoir des solutions. Sous cet aspect, le mouvement
ouvrier est totalement concerné ; il ne lui appartient pas de
fournir uniquement une réponse idéologique, mais surtout
une réponse politique. Les étudiants ne sont pas un sujet
politique à part ; il ne s'agit pas de se solidariser avec eux,
de les repousser ou de les comprendre ; ils sont un aspect du
capitalisme avancé, une contradiction qui explose et qui
exige un débouché. Comment libérer ce potentiel productif
et humain si ce n'est en accélérant la transition au socialisme?
Et qu'est-ce que cela signifie par rapport à la stratégie, au
programme à court et moyen terme, à l'attitude face à la
politique de programmation et même à l'égard des formes
organisationnelles du mouvement ouvrier? Des millions
d'étudiants, de par leur seule existence, posent ces problèmes
à l'ensemble du prolétariat, de ce prolétariat dont ils sont
plus que les alliés, la composante la plus récente, sans évasion
possible. L'étudiant qui se rend à la porte d'une usine croit
y apporter quelque chose ; mais avant tout il y symbolise
sa condition de personnage social exclu et sans racines.
Toutefois, il ne se manifeste pas comme pur besoin, négation,
frustration ; mais comme potentiel de lutte. Il chante L'Inter-
nationale parce que le socialisme n'est pas seulement une
patrie idéale, mais la seule perspective qui puisse sauver son
existence et donner un sens à sa vie et à celle de millions de
ses camarades.
Rossana ROSSANDA
(Traduit de l'italien
par Charles-André Udry et AngeloGregorio.)
par Charles-André Udry et AngeloGregorio.)
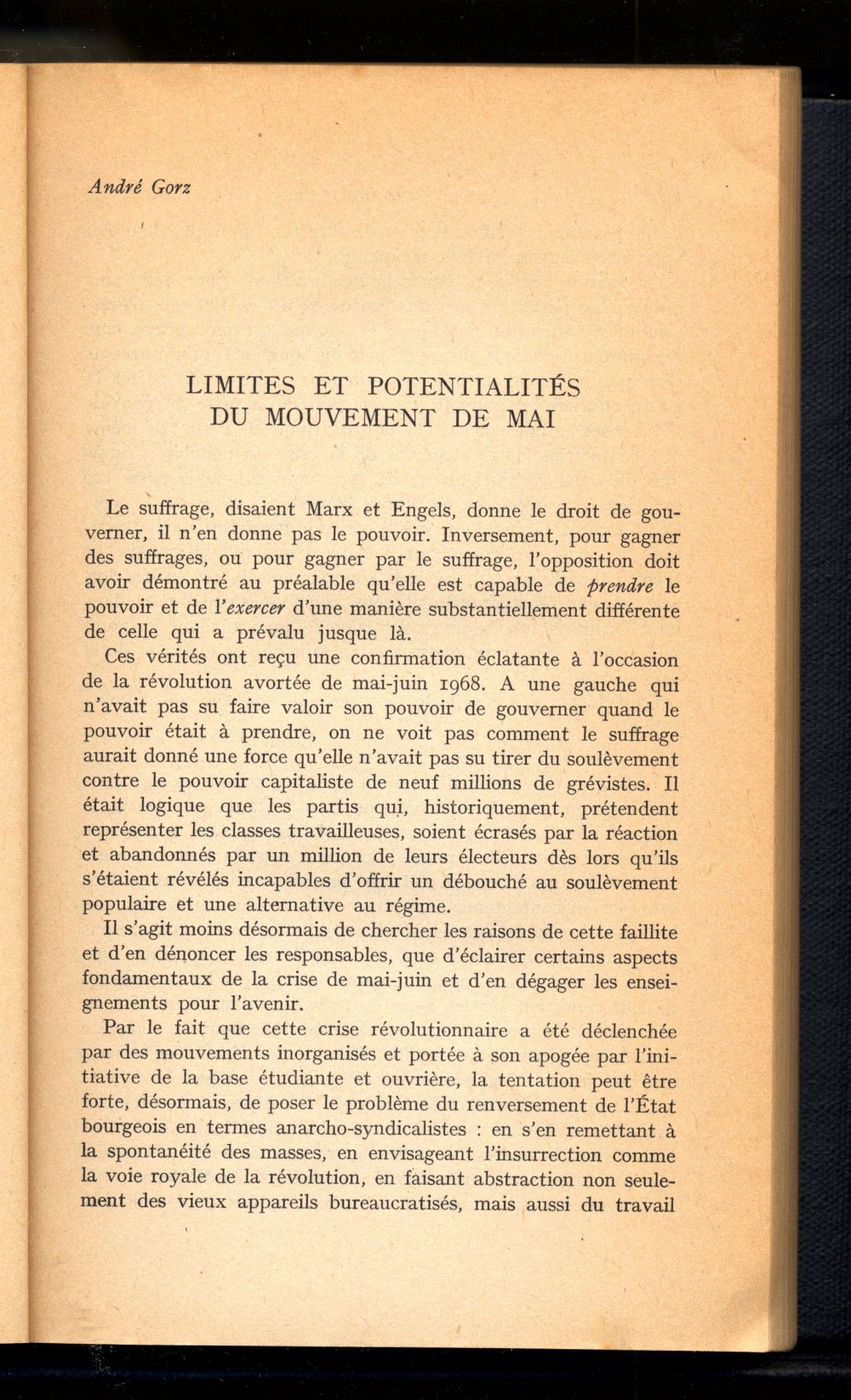

André Gorz
LIMITES ET POTENTIALITÉS
DU MOUVEMENT DE MAI
DU MOUVEMENT DE MAI
Le suffrage, disaient Marx et Engels, donne le droit de gou-
verner, il n'en donne pas le pouvoir. Inversement, pour gagner
des suffrages, ou pour gagner par le suffrage, l'opposition doit
avoir démontré au préalable qu'elle est capable de prendre le
pouvoir et de l'exercer d'une manière substantiellement différente
de celle qui a prévalu jusque là.
verner, il n'en donne pas le pouvoir. Inversement, pour gagner
des suffrages, ou pour gagner par le suffrage, l'opposition doit
avoir démontré au préalable qu'elle est capable de prendre le
pouvoir et de l'exercer d'une manière substantiellement différente
de celle qui a prévalu jusque là.
Ces vérités ont reçu une confirmation éclatante à l'occasion
de la révolution avortée de mai-juin 1968. A une gauche qui
n'avait pas su faire valoir son pouvoir de gouverner quand le
pouvoir était à prendre, on ne voit pas comment le suffrage
aurait donné une force qu'elle n'avait pas su tirer du soulèvement
contre le pouvoir capitaliste de neuf millions de grévistes. Il
était logique que les partis qui, historiquement, prétendent
représenter les classes travailleuses, soient écrasés par la réaction
et abandonnés par un million de leurs électeurs dès lors qu'ils
s'étaient révélés incapables d'offrir un débouché au soulèvement
populaire et une alternative au régime.
de la révolution avortée de mai-juin 1968. A une gauche qui
n'avait pas su faire valoir son pouvoir de gouverner quand le
pouvoir était à prendre, on ne voit pas comment le suffrage
aurait donné une force qu'elle n'avait pas su tirer du soulèvement
contre le pouvoir capitaliste de neuf millions de grévistes. Il
était logique que les partis qui, historiquement, prétendent
représenter les classes travailleuses, soient écrasés par la réaction
et abandonnés par un million de leurs électeurs dès lors qu'ils
s'étaient révélés incapables d'offrir un débouché au soulèvement
populaire et une alternative au régime.
Il s'agit moins désormais de chercher les raisons de cette faillite
et d'en dénoncer les responsables, que d'éclairer certains aspects
fondamentaux de la crise de mai-juin et d'en dégager les ensei-
gnements pour l'avenir.
et d'en dénoncer les responsables, que d'éclairer certains aspects
fondamentaux de la crise de mai-juin et d'en dégager les ensei-
gnements pour l'avenir.
Par le fait que cette crise révolutionnaire a été déclenchée
par des mouvements inorganisés et portée à son apogée par l'ini-
tiative de la base étudiante et ouvrière, la tentation peut être
forte, désormais, de poser le problème du renversement de l'État
bourgeois en termes anarcho-syndicalistes : en s'en remettant à
la spontanéité des masses, en envisageant l'insurrection comme
la voie royale de la révolution, en faisant abstraction non seule-
ment des vieux appareils bureaucratisés, mais aussi du travail
par des mouvements inorganisés et portée à son apogée par l'ini-
tiative de la base étudiante et ouvrière, la tentation peut être
forte, désormais, de poser le problème du renversement de l'État
bourgeois en termes anarcho-syndicalistes : en s'en remettant à
la spontanéité des masses, en envisageant l'insurrection comme
la voie royale de la révolution, en faisant abstraction non seule-
ment des vieux appareils bureaucratisés, mais aussi du travail
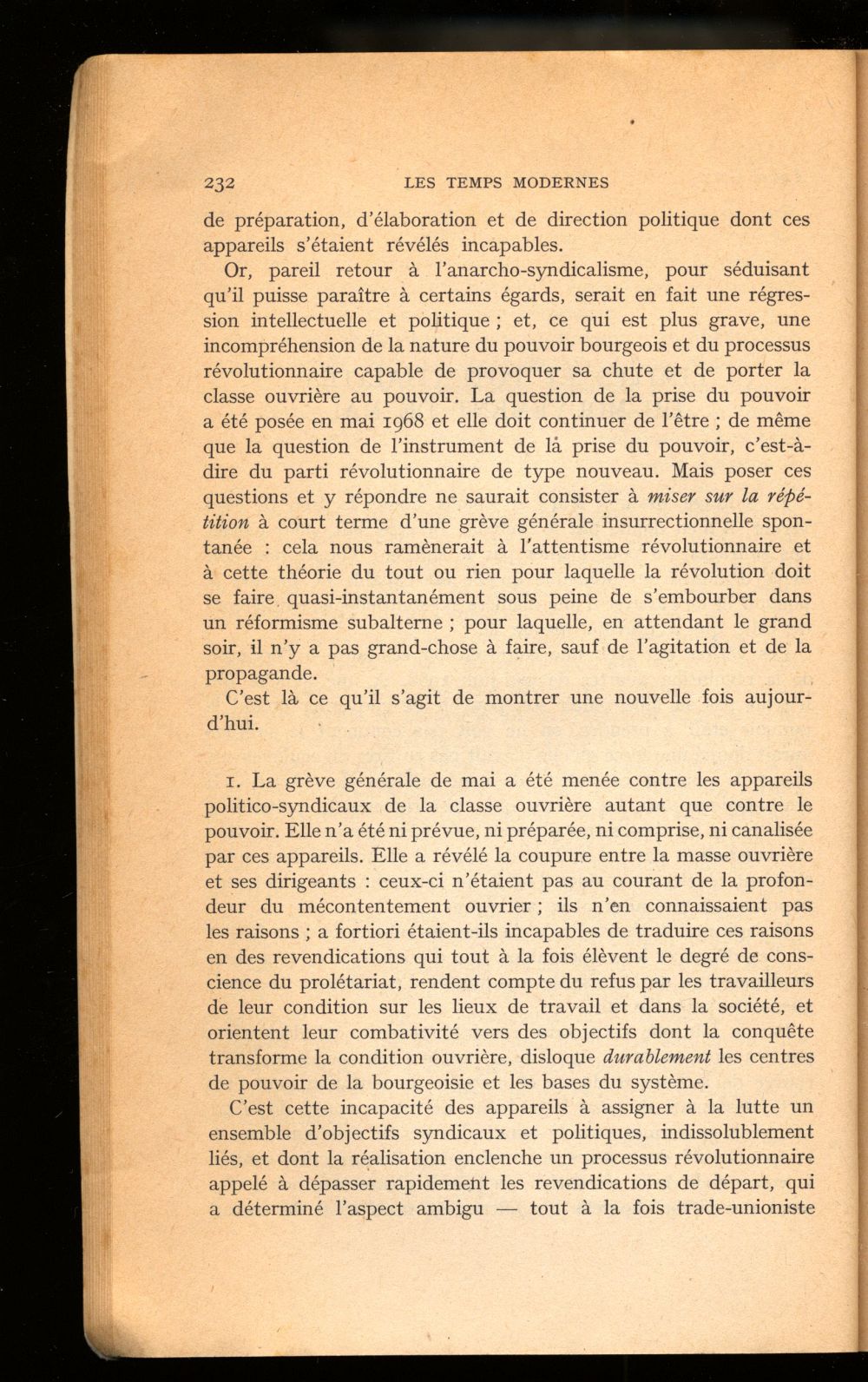

232
LES TEMPS MODERNES
de préparation, d'élaboration et de direction politique dont ces
appareils s'étaient révélés incapables.
appareils s'étaient révélés incapables.
Or, pareil retour à l'anarcho-syndicalisme, pour séduisant
qu'il puisse paraître à certains égards, serait en fait une régres-
sion intellectuelle et politique ; et, ce qui est plus grave, une
incompréhension de la nature du pouvoir bourgeois et du processus
révolutionnaire capable de provoquer sa chute et de porter la
classe ouvrière au pouvoir. La question de la prise du pouvoir
a été posée en mai ig68 et elle doit continuer de l'être ; de même
que la question de l'instrument de la prise du pouvoir, c'est-à-
dire du parti révolutionnaire de type nouveau. Mais poser ces
questions et y répondre ne saurait consister à miser sur la répé-
tition à court terme d'une grève générale insurrectionnelle spon-
tanée : cela nous ramènerait à l'attentisme révolutionnaire et
à cette théorie du tout ou rien pour laquelle la révolution doit
se faire quasi-instantanément sous peine de s'embourber dans
un réformisme subalterne ; pour laquelle, en attendant le grand
soir, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf de l'agitation et de la
propagande.
qu'il puisse paraître à certains égards, serait en fait une régres-
sion intellectuelle et politique ; et, ce qui est plus grave, une
incompréhension de la nature du pouvoir bourgeois et du processus
révolutionnaire capable de provoquer sa chute et de porter la
classe ouvrière au pouvoir. La question de la prise du pouvoir
a été posée en mai ig68 et elle doit continuer de l'être ; de même
que la question de l'instrument de la prise du pouvoir, c'est-à-
dire du parti révolutionnaire de type nouveau. Mais poser ces
questions et y répondre ne saurait consister à miser sur la répé-
tition à court terme d'une grève générale insurrectionnelle spon-
tanée : cela nous ramènerait à l'attentisme révolutionnaire et
à cette théorie du tout ou rien pour laquelle la révolution doit
se faire quasi-instantanément sous peine de s'embourber dans
un réformisme subalterne ; pour laquelle, en attendant le grand
soir, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf de l'agitation et de la
propagande.
C'est là ce qu'il s'agit de montrer une nouvelle fois aujour-
d'hui.
d'hui.
i. La grève générale de mai a été menée contre les appareils
politico-syndicaux de la classe ouvrière autant que contre le
pouvoir. Elle n'a été ni prévue, ni préparée, ni comprise, ni canalisée
par ces appareils. Elle a révélé la coupure entre la masse ouvrière
et ses dirigeants : ceux-ci n'étaient pas au courant de la profon-
deur du mécontentement ouvrier ; ils n'en connaissaient pas
les raisons ; a fortiori étaient-ils incapables de traduire ces raisons
en des revendications qui tout à la fois élèvent le degré de cons-
cience du prolétariat, rendent compte du refus par les travailleurs
de leur condition sur les lieux de travail et dans la société, et
orientent leur combativité vers des objectifs dont la conquête
transforme la condition ouvrière, disloque durablement les centres
de pouvoir de la bourgeoisie et les bases du système.
politico-syndicaux de la classe ouvrière autant que contre le
pouvoir. Elle n'a été ni prévue, ni préparée, ni comprise, ni canalisée
par ces appareils. Elle a révélé la coupure entre la masse ouvrière
et ses dirigeants : ceux-ci n'étaient pas au courant de la profon-
deur du mécontentement ouvrier ; ils n'en connaissaient pas
les raisons ; a fortiori étaient-ils incapables de traduire ces raisons
en des revendications qui tout à la fois élèvent le degré de cons-
cience du prolétariat, rendent compte du refus par les travailleurs
de leur condition sur les lieux de travail et dans la société, et
orientent leur combativité vers des objectifs dont la conquête
transforme la condition ouvrière, disloque durablement les centres
de pouvoir de la bourgeoisie et les bases du système.
C'est cette incapacité des appareils à assigner à la lutte un
ensemble d'objectifs syndicaux et politiques, indissolublement
liés, et dont la réalisation enclenche un processus révolutionnaire
appelé à dépasser rapidement les revendications de départ, qui
a déterminé l'aspect ambigu — tout à la fois trade-unioniste
ensemble d'objectifs syndicaux et politiques, indissolublement
liés, et dont la réalisation enclenche un processus révolutionnaire
appelé à dépasser rapidement les revendications de départ, qui
a déterminé l'aspect ambigu — tout à la fois trade-unioniste
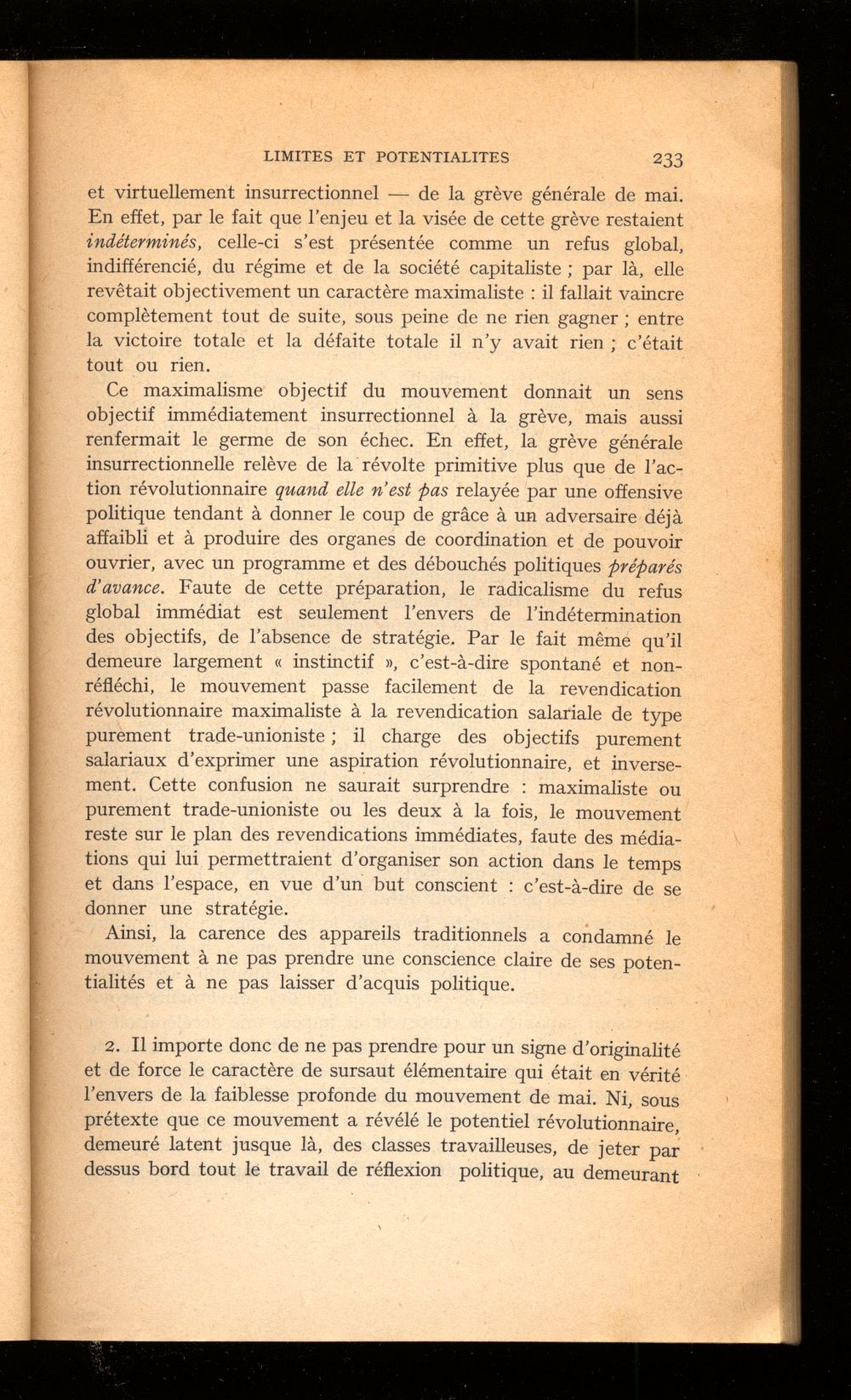

LIMITES ET POTENTIALITES
233
et virtuellement insurrectionnel — de la grève générale de mai.
En effet, par le fait que l'enjeu et la visée de cette grève restaient
indéterminés, celle-ci s'est présentée comme un refus global,
indifférencié, du régime et de la société capitaliste ; par là, elle
revêtait objectivement un caractère maximaliste : il fallait vaincre
complètement tout de suite, sous peine de ne rien gagner ; entre
la victoire totale et la défaite totale il n'y avait rien ; c'était
tout ou rien.
En effet, par le fait que l'enjeu et la visée de cette grève restaient
indéterminés, celle-ci s'est présentée comme un refus global,
indifférencié, du régime et de la société capitaliste ; par là, elle
revêtait objectivement un caractère maximaliste : il fallait vaincre
complètement tout de suite, sous peine de ne rien gagner ; entre
la victoire totale et la défaite totale il n'y avait rien ; c'était
tout ou rien.
Ce maximalisme objectif du mouvement donnait un sens
objectif immédiatement insurrectionnel à la grève, mais aussi
renfermait le germe de son échec. En effet, la grève générale
insurrectionnelle relève de la révolte primitive plus que de l'ac-
tion révolutionnaire quand elle n'est pas relayée par une offensive
politique tendant à donner le coup de grâce à un adversaire déjà
affaibli et à produire des organes de coordination et de pouvoir
ouvrier, avec un programme et des débouchés politiques préparés
d'avance. Faute de cette préparation, le radicalisme du refus
global immédiat est seulement l'envers de l'indétermination
des objectifs, de l'absence de stratégie. Par le fait même qu'il
demeure largement « instinctif », c'est-à-dire spontané et non-
réfléchi, le mouvement passe facilement de la revendication
révolutionnaire maximaliste à la revendication salariale de type
purement trade-unioniste ; il charge des objectifs purement
salariaux d'exprimer une aspiration révolutionnaire, et inverse-
ment. Cette confusion ne saurait surprendre : maximaliste ou
purement trade-unioniste ou les deux à la fois, le mouvement
reste sur le plan des revendications immédiates, faute des média-
tions qui lui permettraient d'organiser son action dans le temps
et dans l'espace, en vue d'un but conscient : c'est-à-dire de se
donner une stratégie.
objectif immédiatement insurrectionnel à la grève, mais aussi
renfermait le germe de son échec. En effet, la grève générale
insurrectionnelle relève de la révolte primitive plus que de l'ac-
tion révolutionnaire quand elle n'est pas relayée par une offensive
politique tendant à donner le coup de grâce à un adversaire déjà
affaibli et à produire des organes de coordination et de pouvoir
ouvrier, avec un programme et des débouchés politiques préparés
d'avance. Faute de cette préparation, le radicalisme du refus
global immédiat est seulement l'envers de l'indétermination
des objectifs, de l'absence de stratégie. Par le fait même qu'il
demeure largement « instinctif », c'est-à-dire spontané et non-
réfléchi, le mouvement passe facilement de la revendication
révolutionnaire maximaliste à la revendication salariale de type
purement trade-unioniste ; il charge des objectifs purement
salariaux d'exprimer une aspiration révolutionnaire, et inverse-
ment. Cette confusion ne saurait surprendre : maximaliste ou
purement trade-unioniste ou les deux à la fois, le mouvement
reste sur le plan des revendications immédiates, faute des média-
tions qui lui permettraient d'organiser son action dans le temps
et dans l'espace, en vue d'un but conscient : c'est-à-dire de se
donner une stratégie.
Ainsi, la carence des appareils traditionnels a condamné le
mouvement à ne pas prendre une conscience claire de ses poten-
tialités et à ne pas laisser d'acquis politique.
mouvement à ne pas prendre une conscience claire de ses poten-
tialités et à ne pas laisser d'acquis politique.
2. Il importe donc de ne pas prendre pour un signe d'originalité
et de force le caractère de sursaut élémentaire qui était en vérité
l'envers de la faiblesse profonde du mouvement de mai. Ni, sous
prétexte que ce mouvement a révélé le potentiel révolutionnaire,
demeuré latent jusque là, des classes travailleuses, de jeter par
dessus bord tout le travail de réflexion politique, au demeurant
et de force le caractère de sursaut élémentaire qui était en vérité
l'envers de la faiblesse profonde du mouvement de mai. Ni, sous
prétexte que ce mouvement a révélé le potentiel révolutionnaire,
demeuré latent jusque là, des classes travailleuses, de jeter par
dessus bord tout le travail de réflexion politique, au demeurant
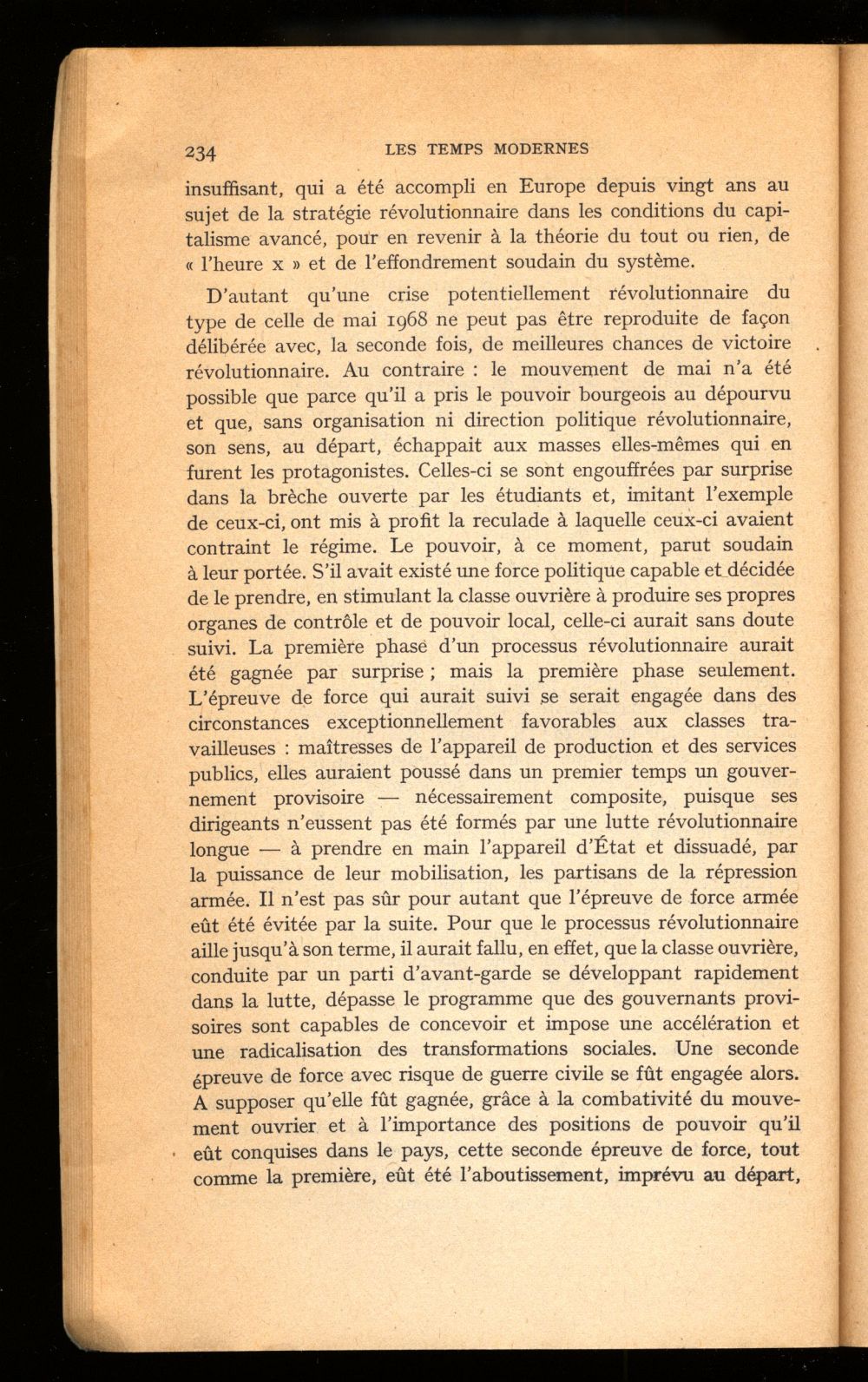

234
LES TEMPS MODERNES
insuffisant, qui a été accompli en Europe depuis vingt ans au
sujet de la stratégie révolutionnaire dans les conditions du capi-
talisme avancé, pour en revenir à la théorie du tout ou rien, de
« l'heure x » et de l'effondrement soudain du système.
sujet de la stratégie révolutionnaire dans les conditions du capi-
talisme avancé, pour en revenir à la théorie du tout ou rien, de
« l'heure x » et de l'effondrement soudain du système.
D'autant qu'une crise potentiellement révolutionnaire du
type de celle de mai 1968 ne peut pas être reproduite de façon
délibérée avec, la seconde fois, de meilleures chances de victoire
révolutionnaire. Au contraire : le mouvement de mai n'a été
possible que parce qu'il a pris le pouvoir bourgeois au dépourvu
et que, sans organisation ni direction politique révolutionnaire,
son sens, au départ, échappait aux masses elles-mêmes qui en
furent les protagonistes. Celles-ci se sont engouffrées par surprise
dans la brèche ouverte par les étudiants et, imitant l'exemple
de ceux-ci, ont mis à profit la reculade à laquelle ceux-ci avaient
contraint le régime. Le pouvoir, à ce moment, parut soudain
à leur portée. S'il avait existé une force politique capable et décidée
de le prendre, en stimulant la classe ouvrière à produire ses propres
organes de contrôle et de pouvoir local, celle-ci aurait sans doute
suivi. La première phase d'un processus révolutionnaire aurait
été gagnée par surprise ; mais la première phase seulement.
L'épreuve de force qui aurait suivi se serait engagée dans des
circonstances exceptionnellement favorables aux classes tra-
vailleuses : maîtresses de l'appareil de production et des services
publics, elles auraient poussé dans un premier temps un gouver-
nement provisoire — nécessairement composite, puisque ses
dirigeants n'eussent pas été formés par une lutte révolutionnaire
longue — à prendre en main l'appareil d'État et dissuadé, par
la puissance de leur mobilisation, les partisans de la répression
armée. Il n'est pas sûr pour autant que l'épreuve de force armée
eût été évitée par la suite. Pour que le processus révolutionnaire
aille jusqu'à son terme, il aurait fallu, en effet, que la classe ouvrière,
conduite par un parti d'avant-garde se développant rapidement
dans la lutte, dépasse le programme que des gouvernants provi-
soires sont capables de concevoir et impose une accélération et
une radicalisation des transformations sociales. Une seconde
épreuve de force avec risque de guerre civile se fût engagée alors.
A supposer qu'elle fût gagnée, grâce à la combativité du mouve-
ment ouvrier et à l'importance des positions de pouvoir qu'il
eût conquises dans le pays, cette seconde épreuve de force, tout
comme la première, eût été l'aboutissement, imprévu au départ,
type de celle de mai 1968 ne peut pas être reproduite de façon
délibérée avec, la seconde fois, de meilleures chances de victoire
révolutionnaire. Au contraire : le mouvement de mai n'a été
possible que parce qu'il a pris le pouvoir bourgeois au dépourvu
et que, sans organisation ni direction politique révolutionnaire,
son sens, au départ, échappait aux masses elles-mêmes qui en
furent les protagonistes. Celles-ci se sont engouffrées par surprise
dans la brèche ouverte par les étudiants et, imitant l'exemple
de ceux-ci, ont mis à profit la reculade à laquelle ceux-ci avaient
contraint le régime. Le pouvoir, à ce moment, parut soudain
à leur portée. S'il avait existé une force politique capable et décidée
de le prendre, en stimulant la classe ouvrière à produire ses propres
organes de contrôle et de pouvoir local, celle-ci aurait sans doute
suivi. La première phase d'un processus révolutionnaire aurait
été gagnée par surprise ; mais la première phase seulement.
L'épreuve de force qui aurait suivi se serait engagée dans des
circonstances exceptionnellement favorables aux classes tra-
vailleuses : maîtresses de l'appareil de production et des services
publics, elles auraient poussé dans un premier temps un gouver-
nement provisoire — nécessairement composite, puisque ses
dirigeants n'eussent pas été formés par une lutte révolutionnaire
longue — à prendre en main l'appareil d'État et dissuadé, par
la puissance de leur mobilisation, les partisans de la répression
armée. Il n'est pas sûr pour autant que l'épreuve de force armée
eût été évitée par la suite. Pour que le processus révolutionnaire
aille jusqu'à son terme, il aurait fallu, en effet, que la classe ouvrière,
conduite par un parti d'avant-garde se développant rapidement
dans la lutte, dépasse le programme que des gouvernants provi-
soires sont capables de concevoir et impose une accélération et
une radicalisation des transformations sociales. Une seconde
épreuve de force avec risque de guerre civile se fût engagée alors.
A supposer qu'elle fût gagnée, grâce à la combativité du mouve-
ment ouvrier et à l'importance des positions de pouvoir qu'il
eût conquises dans le pays, cette seconde épreuve de force, tout
comme la première, eût été l'aboutissement, imprévu au départ,
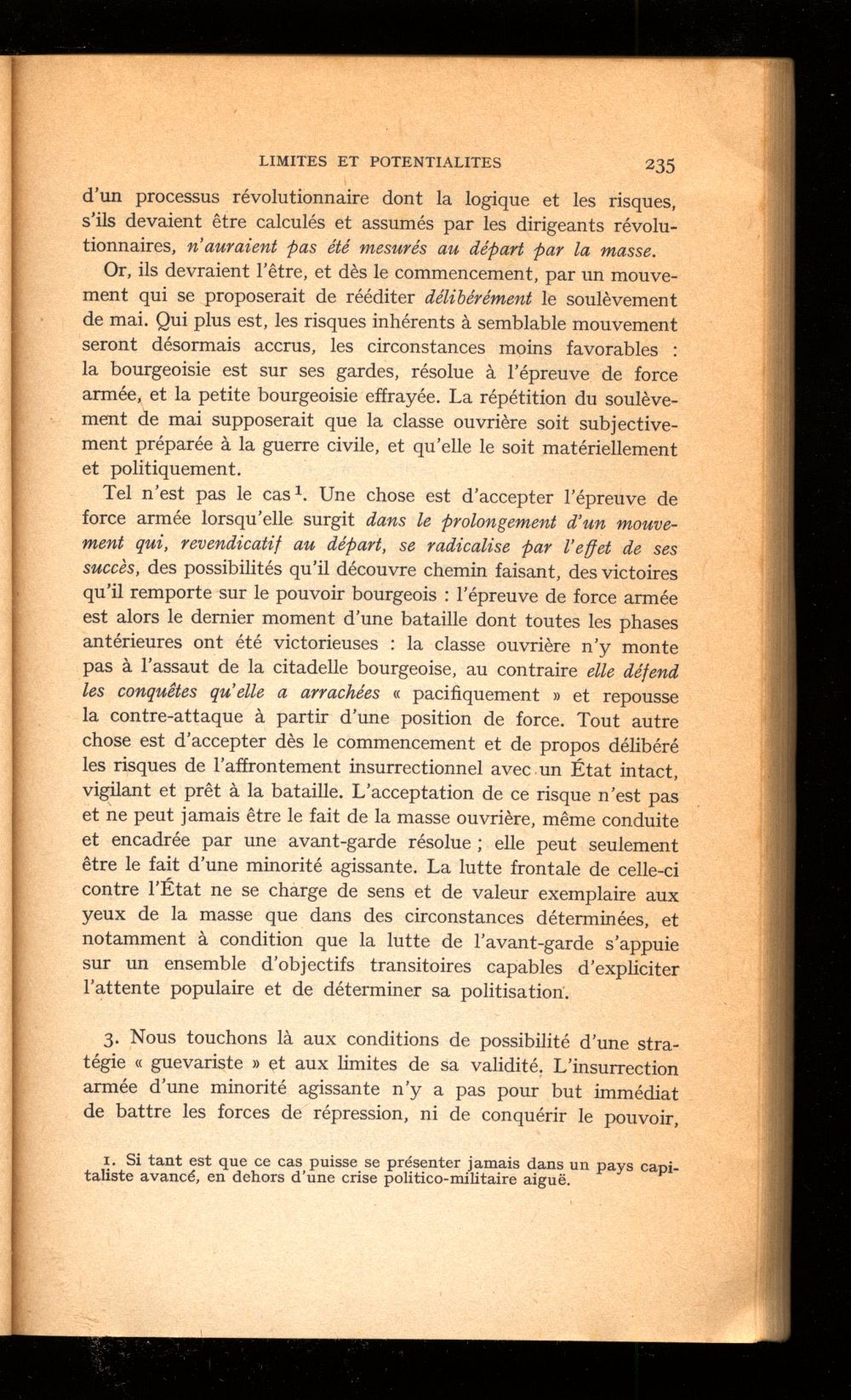

LIMITES ET POTENTIALITES
235
d'un processus révolutionnaire dont la logique et les risques,
s'ils devaient être calculés et assumés par les dirigeants révolu-
tionnaires, n'auraient pas été mesurés au départ par la masse.
s'ils devaient être calculés et assumés par les dirigeants révolu-
tionnaires, n'auraient pas été mesurés au départ par la masse.
Or, ils devraient l'être, et dès le commencement, par un mouve-
ment qui se proposerait de rééditer délibérément le soulèvement
de mai. Qui plus est, les risques inhérents à semblable mouvement
seront désormais accrus, les circonstances moins favorables :
la bourgeoisie est sur ses gardes, résolue à l'épreuve de force
armée, et la petite bourgeoisie effrayée. La répétition du soulève-
ment de mai supposerait que la classe ouvrière soit subjective-
ment préparée à la guerre civile, et qu'elle le soit matériellement
et politiquement.
ment qui se proposerait de rééditer délibérément le soulèvement
de mai. Qui plus est, les risques inhérents à semblable mouvement
seront désormais accrus, les circonstances moins favorables :
la bourgeoisie est sur ses gardes, résolue à l'épreuve de force
armée, et la petite bourgeoisie effrayée. La répétition du soulève-
ment de mai supposerait que la classe ouvrière soit subjective-
ment préparée à la guerre civile, et qu'elle le soit matériellement
et politiquement.
Tel n'est pas le cas1. Une chose est d'accepter l'épreuve de
force armée lorsqu'elle surgit dans le prolongement d'un mouve-
ment qui, revendicatif au départ, se radicalise par l'effet de ses
succès, des possibilités qu'il découvre chemin faisant, des victoires
qu'il remporte sur le pouvoir bourgeois : l'épreuve de force armée
est alors le dernier moment d'une bataille dont toutes les phases
antérieures ont été victorieuses : la classe ouvrière n'y monte
pas à l'assaut de la citadelle bourgeoise, au contraire elle défend
les conquêtes qu'elle a arrachées « pacifiquement » et repousse
la contre-attaque à partir d'une position de force. Tout autre
chose est d'accepter dès le commencement et de propos délibéré
les risques de l'affrontement insurrectionnel avec un État intact,
vigilant et prêt à la bataille. L'acceptation de ce risque n'est pas
et ne peut jamais être le fait de la masse ouvrière, même conduite
et encadrée par une avant-garde résolue ; elle peut seulement
être le fait d'une minorité agissante. La lutte frontale de celle-ci
contre l'État ne se charge de sens et de valeur exemplaire aux
yeux de la masse que dans des circonstances déterminées, et
notamment à condition que la lutte de l'avant-garde s'appuie
sur un ensemble d'objectifs transitoires capables d'expliciter
l'attente populaire et de déterminer sa politisation.
force armée lorsqu'elle surgit dans le prolongement d'un mouve-
ment qui, revendicatif au départ, se radicalise par l'effet de ses
succès, des possibilités qu'il découvre chemin faisant, des victoires
qu'il remporte sur le pouvoir bourgeois : l'épreuve de force armée
est alors le dernier moment d'une bataille dont toutes les phases
antérieures ont été victorieuses : la classe ouvrière n'y monte
pas à l'assaut de la citadelle bourgeoise, au contraire elle défend
les conquêtes qu'elle a arrachées « pacifiquement » et repousse
la contre-attaque à partir d'une position de force. Tout autre
chose est d'accepter dès le commencement et de propos délibéré
les risques de l'affrontement insurrectionnel avec un État intact,
vigilant et prêt à la bataille. L'acceptation de ce risque n'est pas
et ne peut jamais être le fait de la masse ouvrière, même conduite
et encadrée par une avant-garde résolue ; elle peut seulement
être le fait d'une minorité agissante. La lutte frontale de celle-ci
contre l'État ne se charge de sens et de valeur exemplaire aux
yeux de la masse que dans des circonstances déterminées, et
notamment à condition que la lutte de l'avant-garde s'appuie
sur un ensemble d'objectifs transitoires capables d'expliciter
l'attente populaire et de déterminer sa politisation.
3. Nous touchons là aux conditions de possibilité d'une stra-
tégie « guevariste » et aux limites de sa validité. L'insurrection
armée d'une minorité agissante n'y a pas pour but immédiat
de battre les forces de répression, ni de conquérir le pouvoir,
tégie « guevariste » et aux limites de sa validité. L'insurrection
armée d'une minorité agissante n'y a pas pour but immédiat
de battre les forces de répression, ni de conquérir le pouvoir,
i. Si tant est que ce cas puisse se présenter jamais dans un pays capi-
taliste avancé, en dehors d'une crise politico-militaire aiguë.
taliste avancé, en dehors d'une crise politico-militaire aiguë.
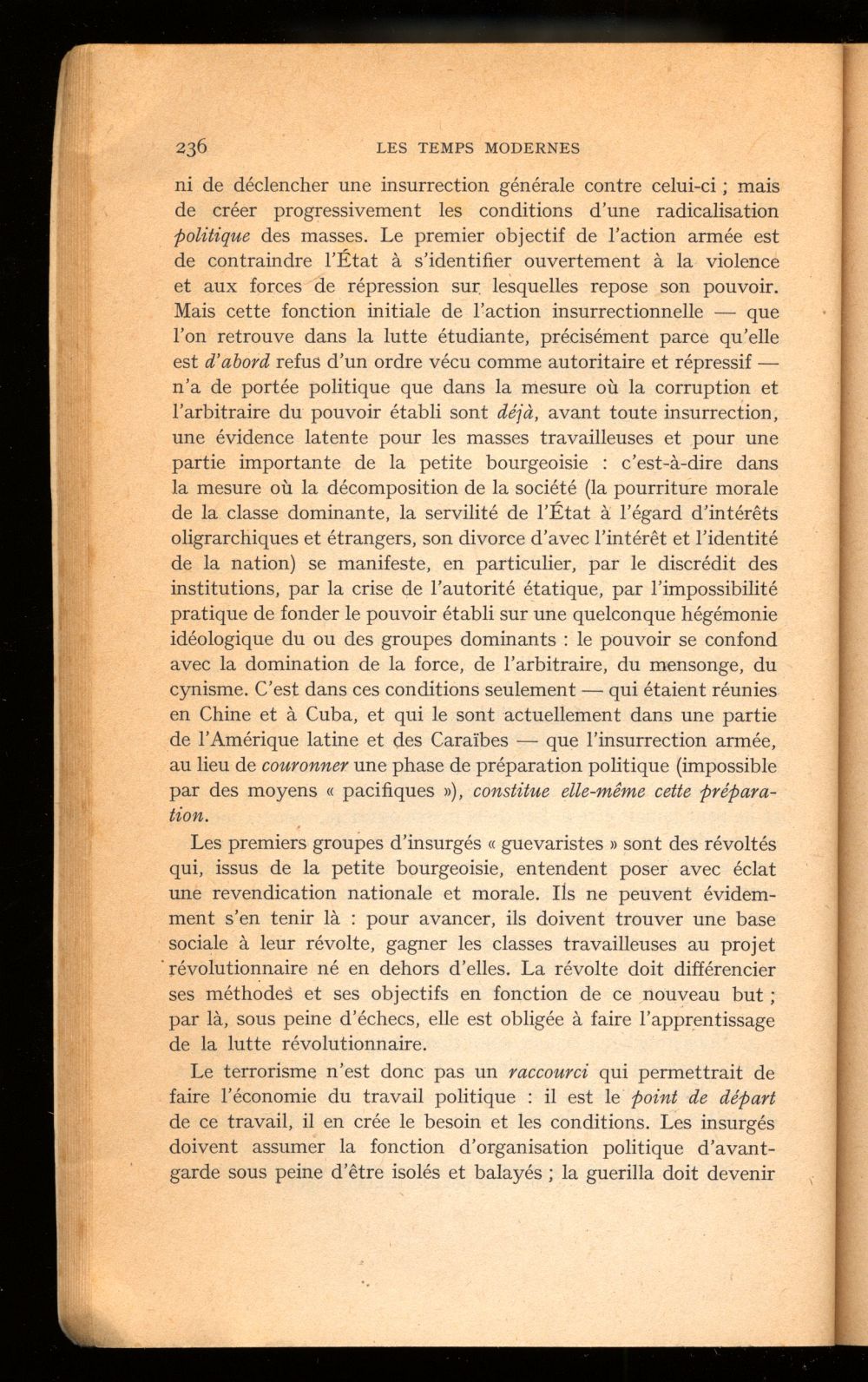

236
LES TEMPS MODERNES
ni de déclencher une insurrection générale contre celui-ci ; mais
de créer progressivement les conditions d'une radicalisation
politique des masses. Le premier objectif de l'action armée est
de contraindre l'État à s'identifier ouvertement à la violence
et aux forces de répression sur. lesquelles repose son pouvoir.
Mais cette fonction initiale de l'action insurrectionnelle — que
l'on retrouve dans la lutte étudiante, précisément parce qu'elle
est d'abord refus d'un ordre vécu comme autoritaire et répressif —
n'a de portée politique que dans la mesure où la corruption et
l'arbitraire du pouvoir établi sont déjà, avant toute insurrection,
une évidence latente pour les masses travailleuses et pour une
partie importante de la petite bourgeoisie : c'est-à-dire dans
la mesure où la décomposition de la société (la pourriture morale
de la classe dominante, la servilité de l'État à l'égard d'intérêts
oligrarchiques et étrangers, son divorce d'avec l'intérêt et l'identité
de la nation) se manifeste, en particulier, par le discrédit des
institutions, par la crise de l'autorité étatique, par l'impossibilité
pratique de fonder le pouvoir établi sur une quelconque hégémonie
idéologique du ou des groupes dominants : le pouvoir se confond
avec la domination de la force, de l'arbitraire, du mensonge, du
cynisme. C'est dans ces conditions seulement — qui étaient réunies
en Chine et à Cuba, et qui le sont actuellement dans une partie
de l'Amérique latine et des Caraïbes — que l'insurrection armée,
au lieu de couronner une phase de préparation politique (impossible
par des moyens « pacifiques »), constitue elle-même cette prépara-
tion.
de créer progressivement les conditions d'une radicalisation
politique des masses. Le premier objectif de l'action armée est
de contraindre l'État à s'identifier ouvertement à la violence
et aux forces de répression sur. lesquelles repose son pouvoir.
Mais cette fonction initiale de l'action insurrectionnelle — que
l'on retrouve dans la lutte étudiante, précisément parce qu'elle
est d'abord refus d'un ordre vécu comme autoritaire et répressif —
n'a de portée politique que dans la mesure où la corruption et
l'arbitraire du pouvoir établi sont déjà, avant toute insurrection,
une évidence latente pour les masses travailleuses et pour une
partie importante de la petite bourgeoisie : c'est-à-dire dans
la mesure où la décomposition de la société (la pourriture morale
de la classe dominante, la servilité de l'État à l'égard d'intérêts
oligrarchiques et étrangers, son divorce d'avec l'intérêt et l'identité
de la nation) se manifeste, en particulier, par le discrédit des
institutions, par la crise de l'autorité étatique, par l'impossibilité
pratique de fonder le pouvoir établi sur une quelconque hégémonie
idéologique du ou des groupes dominants : le pouvoir se confond
avec la domination de la force, de l'arbitraire, du mensonge, du
cynisme. C'est dans ces conditions seulement — qui étaient réunies
en Chine et à Cuba, et qui le sont actuellement dans une partie
de l'Amérique latine et des Caraïbes — que l'insurrection armée,
au lieu de couronner une phase de préparation politique (impossible
par des moyens « pacifiques »), constitue elle-même cette prépara-
tion.
Les premiers groupes d'insurgés « gucvaristes » sont des révoltés
qui, issus de la petite bourgeoisie, entendent poser avec éclat
une revendication nationale et morale. Ils ne peuvent évidem-
ment s'en tenir là : pour avancer, ils doivent trouver une base
sociale à leur révolte, gagner les classes travailleuses au projet
' révolutionnaire né en dehors d'elles. La révolte doit différencier
ses méthodes et ses objectifs en fonction de ce nouveau but ;
par là, sous peine d'échecs, elle est obligée à faire l'apprentissage
de la lutte révolutionnaire.
qui, issus de la petite bourgeoisie, entendent poser avec éclat
une revendication nationale et morale. Ils ne peuvent évidem-
ment s'en tenir là : pour avancer, ils doivent trouver une base
sociale à leur révolte, gagner les classes travailleuses au projet
' révolutionnaire né en dehors d'elles. La révolte doit différencier
ses méthodes et ses objectifs en fonction de ce nouveau but ;
par là, sous peine d'échecs, elle est obligée à faire l'apprentissage
de la lutte révolutionnaire.
Le terrorisme n'est donc pas un raccourci qui permettrait de
faire l'économie du travail politique : il est le point de départ
de ce travail, il en crée le besoin et les conditions. Les insurgés
doivent assumer la fonction d'organisation politique d'avant-
garde sous peine d'être isolés et balayés ; la guérilla doit devenir
faire l'économie du travail politique : il est le point de départ
de ce travail, il en crée le besoin et les conditions. Les insurgés
doivent assumer la fonction d'organisation politique d'avant-
garde sous peine d'être isolés et balayés ; la guérilla doit devenir
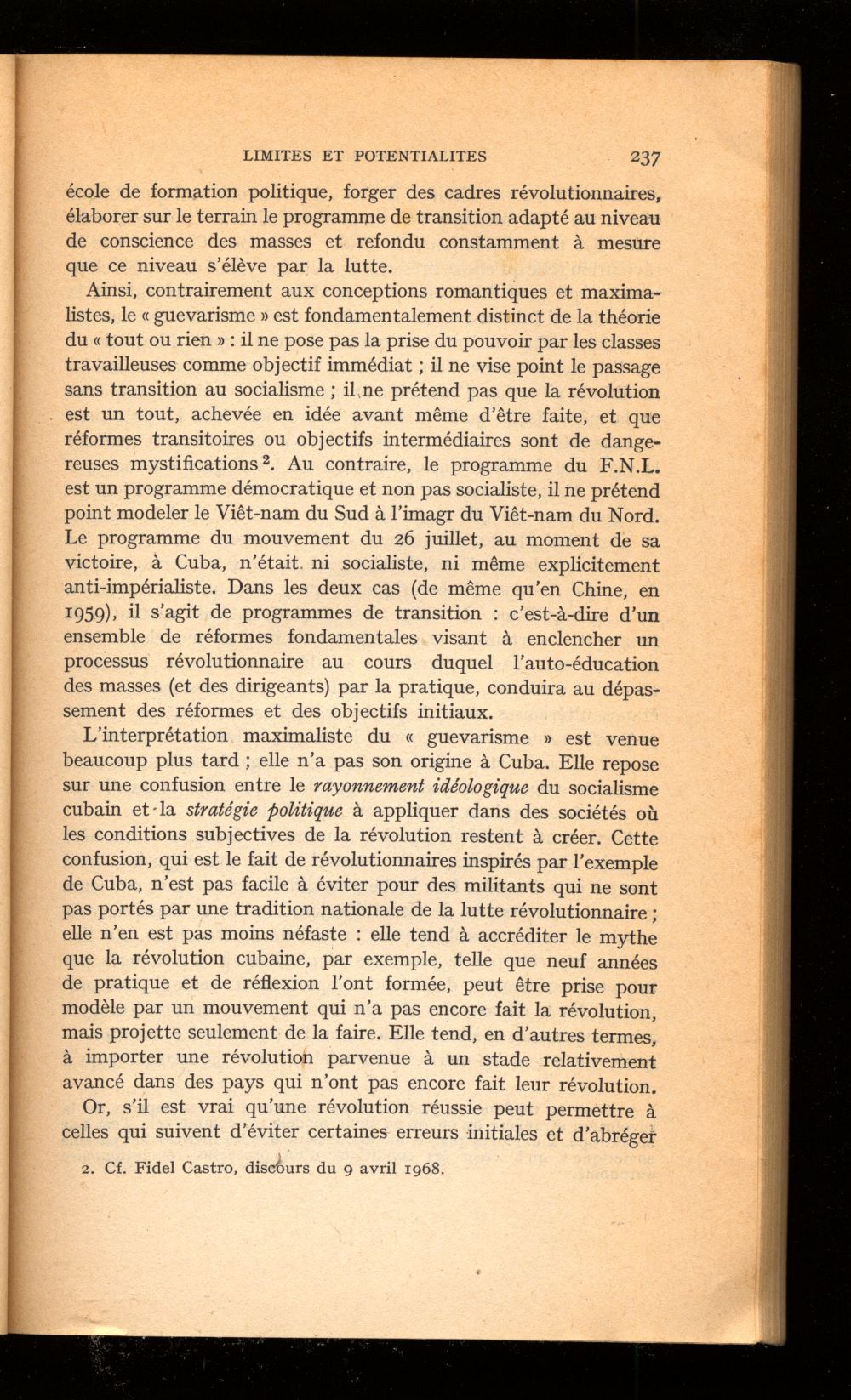

LIMITES ET POTENTIALITES
237
école de formation politique, forger des cadres révolutionnaires,
élaborer sur le terrain le programme de transition adapté au niveau
de conscience des masses et refondu constamment à mesure
que ce niveau s'élève par la lutte.
élaborer sur le terrain le programme de transition adapté au niveau
de conscience des masses et refondu constamment à mesure
que ce niveau s'élève par la lutte.
Ainsi, contrairement aux conceptions romantiques et maxima-
listes, le « guevarisme » est fondamentalement distinct de la théorie
du « tout ou rien » : il ne pose pas la prise du pouvoir par les classes
travailleuses comme objectif immédiat ; il ne vise point le passage
sans transition au socialisme ; il ne prétend pas que la révolution
est un tout, achevée en idée avant même d'être faite, et que
réformes transitoires ou objectifs intermédiaires sont de dange-
reuses mystifications2. Au contraire, le programme du F.N.L.
est un programme démocratique et non pas socialiste, il ne prétend
point modeler le Viêt-nam du Sud à l'imagr du Viêt-nam du Nord.
Le programme du mouvement du 26 juillet, au moment de sa
victoire, à Cuba, n'était ni socialiste, ni même explicitement
anti-impérialiste. Dans les deux cas (de même qu'en Chine, en
1959), il s'agit de programmes de transition : c'est-à-dire d'un
ensemble de réformes fondamentales visant à enclencher un
processus révolutionnaire au cours duquel l'auto-éducation
des masses (et des dirigeants) par la pratique, conduira au dépas-
sement des réformes et des objectifs initiaux.
listes, le « guevarisme » est fondamentalement distinct de la théorie
du « tout ou rien » : il ne pose pas la prise du pouvoir par les classes
travailleuses comme objectif immédiat ; il ne vise point le passage
sans transition au socialisme ; il ne prétend pas que la révolution
est un tout, achevée en idée avant même d'être faite, et que
réformes transitoires ou objectifs intermédiaires sont de dange-
reuses mystifications2. Au contraire, le programme du F.N.L.
est un programme démocratique et non pas socialiste, il ne prétend
point modeler le Viêt-nam du Sud à l'imagr du Viêt-nam du Nord.
Le programme du mouvement du 26 juillet, au moment de sa
victoire, à Cuba, n'était ni socialiste, ni même explicitement
anti-impérialiste. Dans les deux cas (de même qu'en Chine, en
1959), il s'agit de programmes de transition : c'est-à-dire d'un
ensemble de réformes fondamentales visant à enclencher un
processus révolutionnaire au cours duquel l'auto-éducation
des masses (et des dirigeants) par la pratique, conduira au dépas-
sement des réformes et des objectifs initiaux.
L'interprétation maximaliste du « guevarisme » est venue
beaucoup plus tard ; elle n'a pas son origine à Cuba. Elle repose
sur une confusion entre le rayonnement idéologique du socialisme
cubain et-la stratégie politique à appliquer dans des sociétés où
les conditions subjectives de la révolution restent à créer. Cette
confusion, qui est le fait de révolutionnaires inspirés par l'exemple
de Cuba, n'est pas facile à éviter pour des militants qui ne sont
pas portés par une tradition nationale de la lutte révolutionnaire ;
elle n'en est pas moins néfaste : elle tend à accréditer le mythe
que la révolution cubaine, par exemple, telle que neuf années
de pratique et de réflexion l'ont formée, peut être prise pour
modèle par un mouvement qui n'a pas encore fait la révolution,
mais projette seulement de la faire. Elle tend, en d'autres termes,
à importer une révolution parvenue à un stade relativement
avancé dans des pays qui n'ont pas encore fait leur révolution.
beaucoup plus tard ; elle n'a pas son origine à Cuba. Elle repose
sur une confusion entre le rayonnement idéologique du socialisme
cubain et-la stratégie politique à appliquer dans des sociétés où
les conditions subjectives de la révolution restent à créer. Cette
confusion, qui est le fait de révolutionnaires inspirés par l'exemple
de Cuba, n'est pas facile à éviter pour des militants qui ne sont
pas portés par une tradition nationale de la lutte révolutionnaire ;
elle n'en est pas moins néfaste : elle tend à accréditer le mythe
que la révolution cubaine, par exemple, telle que neuf années
de pratique et de réflexion l'ont formée, peut être prise pour
modèle par un mouvement qui n'a pas encore fait la révolution,
mais projette seulement de la faire. Elle tend, en d'autres termes,
à importer une révolution parvenue à un stade relativement
avancé dans des pays qui n'ont pas encore fait leur révolution.
Or, s'il est vrai qu'une révolution réussie peut permettre à
celles qui suivent d'éviter certaines erreurs initiales et d'abréger
celles qui suivent d'éviter certaines erreurs initiales et d'abréger
2. Cf. Fidel Castro, discours du 9 avril 1968.
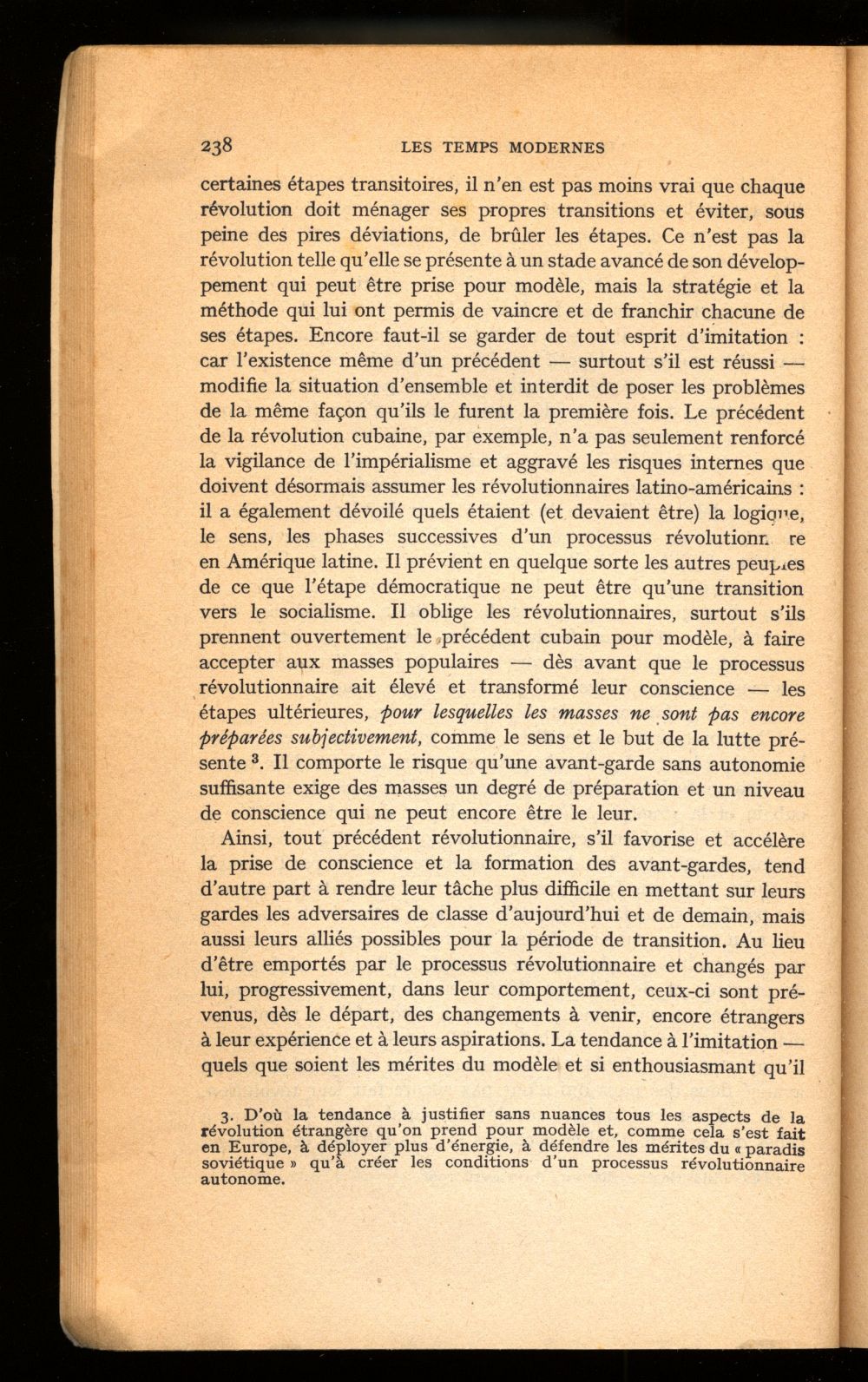

23»
LES TEMPS MODERNES
certaines étapes transitoires, il n'en est pas moins vrai que chaque
révolution doit ménager ses propres transitions et éviter, sous
peine des pires déviations, de brûler les étapes. Ce n'est pas la
révolution telle qu'elle se présente à un stade avancé de son dévelop-
pement qui peut être prise pour modèle, mais la stratégie et la
méthode qui lui ont permis de vaincre et de franchir chacune de
ses étapes. Encore faut-il se garder de tout esprit d'imitation :
car l'existence même d'un précédent — surtout s'il est réussi —
modifie la situation d'ensemble et interdit de poser les problèmes
de la même façon qu'ils le furent la première fois. Le précédent
de la révolution cubaine, par exemple, n'a pas seulement renforcé
la vigilance de l'impérialisme et aggravé les risques internes que
doivent désormais assumer les révolutionnaires latino-américains :
il a également dévoilé quels étaient (et devaient être) la logique,
le sens, les phases successives d'un processus révolutions re
en Amérique latine. Il prévient en quelque sorte les autres peupies
de ce que l'étape démocratique ne peut être qu'une transition
vers le socialisme. Il oblige les révolutionnaires, surtout s'ils
prennent ouvertement le précédent cubain pour modèle, à faire
accepter aux masses populaires — dès avant que le processus
révolutionnaire ait élevé et transformé leur conscience — les
étapes ultérieures, pour lesquelles les masses ne sont pas encore
préparées subjectivement, comme le sens et le but de la lutte pré-
sente 3. Il comporte le risque qu'une avant-garde sans autonomie
suffisante exige des masses un degré de préparation et un niveau
de conscience qui ne peut encore être le leur.
révolution doit ménager ses propres transitions et éviter, sous
peine des pires déviations, de brûler les étapes. Ce n'est pas la
révolution telle qu'elle se présente à un stade avancé de son dévelop-
pement qui peut être prise pour modèle, mais la stratégie et la
méthode qui lui ont permis de vaincre et de franchir chacune de
ses étapes. Encore faut-il se garder de tout esprit d'imitation :
car l'existence même d'un précédent — surtout s'il est réussi —
modifie la situation d'ensemble et interdit de poser les problèmes
de la même façon qu'ils le furent la première fois. Le précédent
de la révolution cubaine, par exemple, n'a pas seulement renforcé
la vigilance de l'impérialisme et aggravé les risques internes que
doivent désormais assumer les révolutionnaires latino-américains :
il a également dévoilé quels étaient (et devaient être) la logique,
le sens, les phases successives d'un processus révolutions re
en Amérique latine. Il prévient en quelque sorte les autres peupies
de ce que l'étape démocratique ne peut être qu'une transition
vers le socialisme. Il oblige les révolutionnaires, surtout s'ils
prennent ouvertement le précédent cubain pour modèle, à faire
accepter aux masses populaires — dès avant que le processus
révolutionnaire ait élevé et transformé leur conscience — les
étapes ultérieures, pour lesquelles les masses ne sont pas encore
préparées subjectivement, comme le sens et le but de la lutte pré-
sente 3. Il comporte le risque qu'une avant-garde sans autonomie
suffisante exige des masses un degré de préparation et un niveau
de conscience qui ne peut encore être le leur.
Ainsi, tout précédent révolutionnaire, s'il favorise et accélère
la prise de conscience et la formation des avant-gardes, tend
d'autre part à rendre leur tâche plus difficile en mettant sur leurs
gardes les adversaires de classe d'aujourd'hui et de demain, mais
aussi leurs alliés possibles pour la période de transition. Au lieu
d'être emportés par le processus révolutionnaire et changés par
lui, progressivement, dans leur comportement, ceux-ci sont pré-
venus, dès le départ, des changements à venir, encore étrangers
à leur expérience et à leurs aspirations. La tendance à l'imitation —
quels que soient les mérites du modèle et si enthousiasmant qu'il
la prise de conscience et la formation des avant-gardes, tend
d'autre part à rendre leur tâche plus difficile en mettant sur leurs
gardes les adversaires de classe d'aujourd'hui et de demain, mais
aussi leurs alliés possibles pour la période de transition. Au lieu
d'être emportés par le processus révolutionnaire et changés par
lui, progressivement, dans leur comportement, ceux-ci sont pré-
venus, dès le départ, des changements à venir, encore étrangers
à leur expérience et à leurs aspirations. La tendance à l'imitation —
quels que soient les mérites du modèle et si enthousiasmant qu'il
3. D'où la tendance à justifier sans nuances tous les aspects de la
révolution étrangère qu'on prend pour modèle et, comme cela s'est fait
en Europe, à déployer plus d'énergie, à défendre les mérites du « paradis
soviétique » qu'à créer les conditions d'un processus révolutionnaire
autonome.
révolution étrangère qu'on prend pour modèle et, comme cela s'est fait
en Europe, à déployer plus d'énergie, à défendre les mérites du « paradis
soviétique » qu'à créer les conditions d'un processus révolutionnaire
autonome.
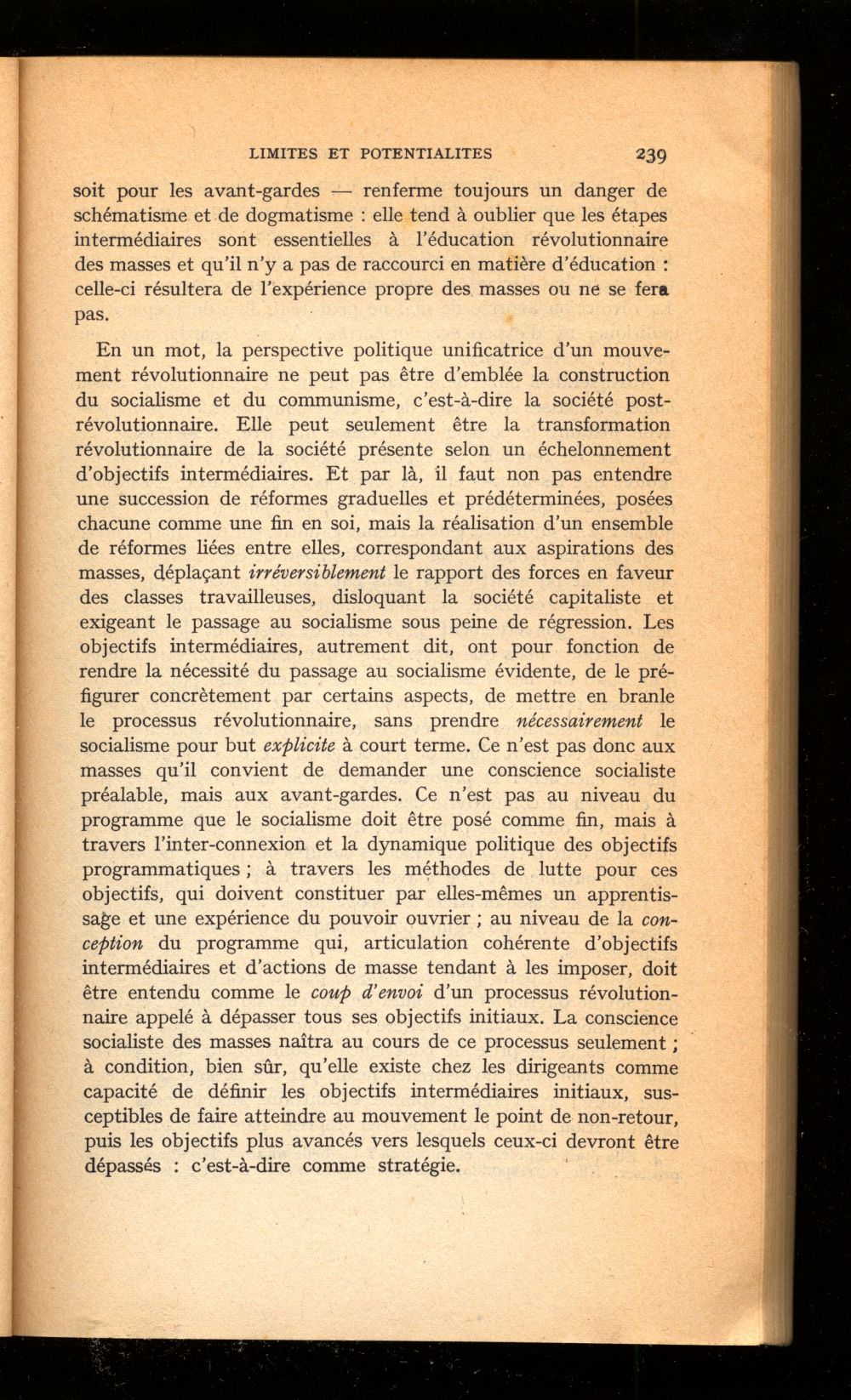

LIMITES ET POTENTIALITES
239
soit pour les avant-gardes — renferme toujours un danger de
schématisme et de dogmatisme : elle tend à oublier que les étapes
intermédiaires sont essentielles à l'éducation révolutionnaire
des masses et qu'il n'y a pas de raccourci en matière d'éducation :
celle-ci résultera de l'expérience propre des masses ou ne se fera
pas.
schématisme et de dogmatisme : elle tend à oublier que les étapes
intermédiaires sont essentielles à l'éducation révolutionnaire
des masses et qu'il n'y a pas de raccourci en matière d'éducation :
celle-ci résultera de l'expérience propre des masses ou ne se fera
pas.
En un mot, la perspective politique unificatrice d'un mouve-
ment révolutionnaire ne peut pas être d'emblée la construction
du socialisme et du communisme, c'est-à-dire la société post-
révolutionnaire. Elle peut seulement être la transformation
révolutionnaire de la société présente selon un échelonnement
d'objectifs intermédiaires. Et par là, il faut non pas entendre
une succession de réformes graduelles et prédéterminées, posées
chacune comme une fin en soi, mais la réalisation d'un ensemble
de réformes liées entre elles, correspondant aux aspirations des
masses, déplaçant irréversiblement le rapport des forces en faveur
des classes travailleuses, disloquant la société capitaliste et
exigeant le passage au socialisme sous peine de régression. Les
objectifs intermédiaires, autrement dit, ont pour fonction de
rendre la nécessité du passage au socialisme évidente, de le pré-
figurer concrètement par certains aspects, de mettre en branle
le processus révolutionnaire, sans prendre nécessairement le
socialisme pour but explicite à court terme. Ce n'est pas donc aux
masses qu'il convient de demander une conscience socialiste
préalable, mais aux avant-gardes. Ce n'est pas au niveau du
programme que le socialisme doit être posé comme fin, mais à
travers l'inter-connexion et la dynamique politique des objectifs
programmatiques ; à travers les méthodes de lutte pour ces
objectifs, qui doivent constituer par elles-mêmes un apprentis-
sage et une expérience du pouvoir ouvrier ; au niveau de la con-
ception du programme qui, articulation cohérente d'objectifs
intermédiaires et d'actions de masse tendant à les imposer, doit
être entendu comme le coup d'envoi d'un processus révolution-
naire appelé à dépasser tous ses objectifs initiaux. La conscience
socialiste des masses naîtra au cours de ce processus seulement ;
à condition, bien sûr, qu'elle existe chez les dirigeants comme
capacité de définir les objectifs intermédiaires initiaux, sus-
ceptibles de faire atteindre au mouvement le point de non-retour,
puis les objectifs plus avancés vers lesquels ceux-ci devront être
dépassés : c'est-à-dire comme stratégie.
ment révolutionnaire ne peut pas être d'emblée la construction
du socialisme et du communisme, c'est-à-dire la société post-
révolutionnaire. Elle peut seulement être la transformation
révolutionnaire de la société présente selon un échelonnement
d'objectifs intermédiaires. Et par là, il faut non pas entendre
une succession de réformes graduelles et prédéterminées, posées
chacune comme une fin en soi, mais la réalisation d'un ensemble
de réformes liées entre elles, correspondant aux aspirations des
masses, déplaçant irréversiblement le rapport des forces en faveur
des classes travailleuses, disloquant la société capitaliste et
exigeant le passage au socialisme sous peine de régression. Les
objectifs intermédiaires, autrement dit, ont pour fonction de
rendre la nécessité du passage au socialisme évidente, de le pré-
figurer concrètement par certains aspects, de mettre en branle
le processus révolutionnaire, sans prendre nécessairement le
socialisme pour but explicite à court terme. Ce n'est pas donc aux
masses qu'il convient de demander une conscience socialiste
préalable, mais aux avant-gardes. Ce n'est pas au niveau du
programme que le socialisme doit être posé comme fin, mais à
travers l'inter-connexion et la dynamique politique des objectifs
programmatiques ; à travers les méthodes de lutte pour ces
objectifs, qui doivent constituer par elles-mêmes un apprentis-
sage et une expérience du pouvoir ouvrier ; au niveau de la con-
ception du programme qui, articulation cohérente d'objectifs
intermédiaires et d'actions de masse tendant à les imposer, doit
être entendu comme le coup d'envoi d'un processus révolution-
naire appelé à dépasser tous ses objectifs initiaux. La conscience
socialiste des masses naîtra au cours de ce processus seulement ;
à condition, bien sûr, qu'elle existe chez les dirigeants comme
capacité de définir les objectifs intermédiaires initiaux, sus-
ceptibles de faire atteindre au mouvement le point de non-retour,
puis les objectifs plus avancés vers lesquels ceux-ci devront être
dépassés : c'est-à-dire comme stratégie.
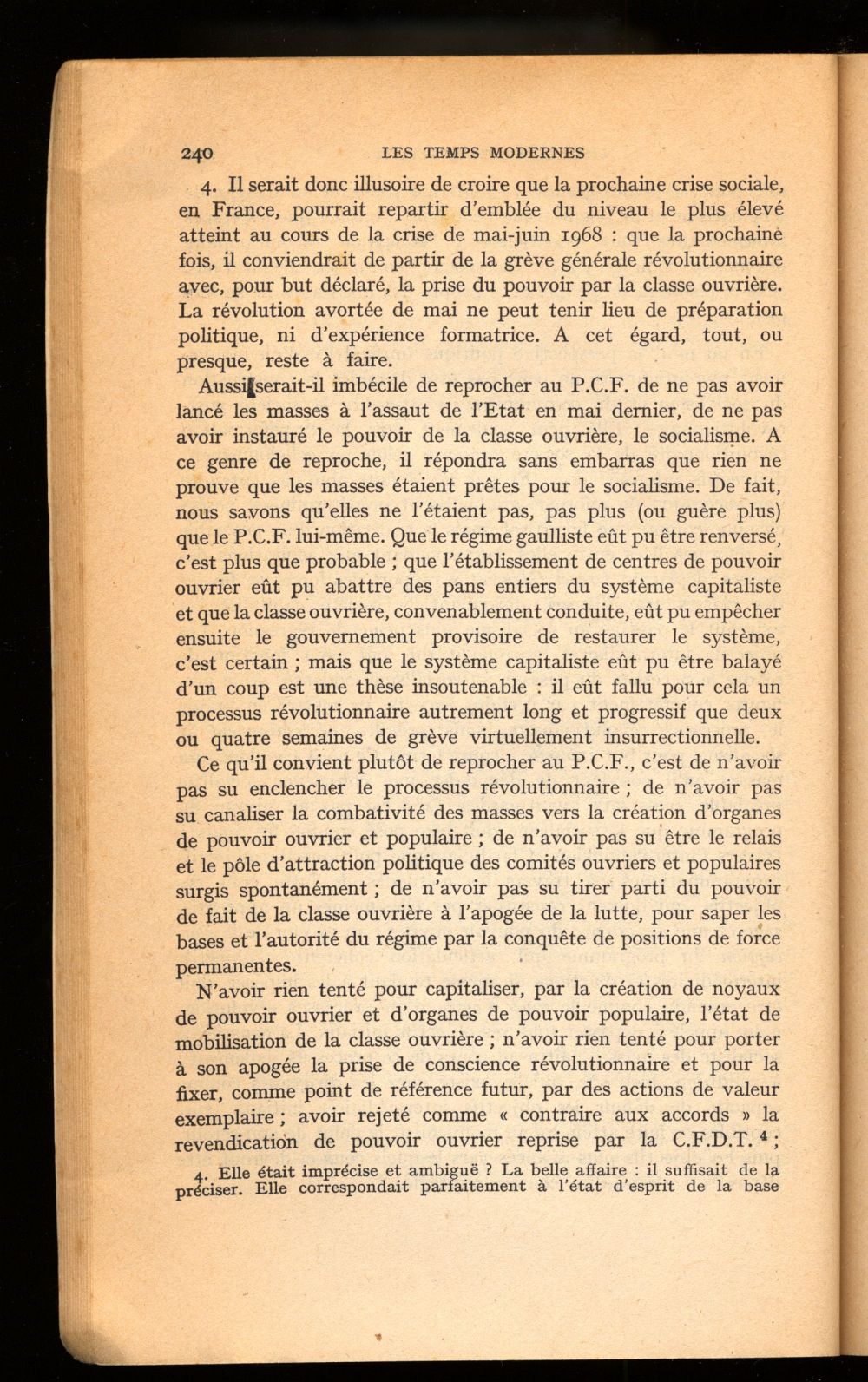

240
LES TEMPS MODERNES
4. Il serait donc illusoire de croire que la prochaine crise sociale,
en France, pourrait repartir d'emblée du niveau le plus élevé
atteint au cours de la crise de mai-juin 1968 : que la prochaine
fois, il conviendrait de partir de la grève générale révolutionnaire
avec, pour but déclaré, la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
La révolution avortée de mai ne peut tenir lieu de préparation
politique, ni d'expérience formatrice. A cet égard, tout, ou
presque, reste à faire.
en France, pourrait repartir d'emblée du niveau le plus élevé
atteint au cours de la crise de mai-juin 1968 : que la prochaine
fois, il conviendrait de partir de la grève générale révolutionnaire
avec, pour but déclaré, la prise du pouvoir par la classe ouvrière.
La révolution avortée de mai ne peut tenir lieu de préparation
politique, ni d'expérience formatrice. A cet égard, tout, ou
presque, reste à faire.
Aussi|serait-il imbécile de reprocher au P.C.F. de ne pas avoir
lancé les masses à l'assaut de l'Etat en mai dernier, de ne pas
avoir instauré le pouvoir de la classe ouvrière, le socialisme. A
ce genre de reproche, il répondra sans embarras que rien ne
prouve que les masses étaient prêtes pour le socialisme. De fait,
nous savons qu'elles ne l'étaient pas, pas plus (ou guère plus)
que le P.C.F. lui-même. Que le régime gaulliste eût pu être renversé,
c'est plus que probable ; que l'établissement de centres de pouvoir
ouvrier eût pu abattre des pans entiers du système capitaliste
et que la classe ouvrière, convenablement conduite, eût pu empêcher
ensuite le gouvernement provisoire de restaurer le système,
c'est certain ; mais que le système capitaliste eût pu être balayé
d'un coup est une thèse insoutenable : il eût fallu pour cela un
processus révolutionnaire autrement long et progressif que deux
ou quatre semaines de grève virtuellement insurrectionnelle.
lancé les masses à l'assaut de l'Etat en mai dernier, de ne pas
avoir instauré le pouvoir de la classe ouvrière, le socialisme. A
ce genre de reproche, il répondra sans embarras que rien ne
prouve que les masses étaient prêtes pour le socialisme. De fait,
nous savons qu'elles ne l'étaient pas, pas plus (ou guère plus)
que le P.C.F. lui-même. Que le régime gaulliste eût pu être renversé,
c'est plus que probable ; que l'établissement de centres de pouvoir
ouvrier eût pu abattre des pans entiers du système capitaliste
et que la classe ouvrière, convenablement conduite, eût pu empêcher
ensuite le gouvernement provisoire de restaurer le système,
c'est certain ; mais que le système capitaliste eût pu être balayé
d'un coup est une thèse insoutenable : il eût fallu pour cela un
processus révolutionnaire autrement long et progressif que deux
ou quatre semaines de grève virtuellement insurrectionnelle.
Ce qu'il convient plutôt de reprocher au P.C.F., c'est de n'avoir
pas su enclencher le processus révolutionnaire ; de n'avoir pas
su canaliser la combativité des masses vers la création d'organes
de pouvoir ouvrier et populaire ; de n'avoir pas su être le relais
et le pôle d'attraction politique des comités ouvriers et populaires
surgis spontanément ; de n'avoir pas su tirer parti du pouvoir
de fait de la classe ouvrière à l'apogée de la lutte, pour saper les
bases et l'autorité du régime par la conquête de positions de force
permanentes.
pas su enclencher le processus révolutionnaire ; de n'avoir pas
su canaliser la combativité des masses vers la création d'organes
de pouvoir ouvrier et populaire ; de n'avoir pas su être le relais
et le pôle d'attraction politique des comités ouvriers et populaires
surgis spontanément ; de n'avoir pas su tirer parti du pouvoir
de fait de la classe ouvrière à l'apogée de la lutte, pour saper les
bases et l'autorité du régime par la conquête de positions de force
permanentes.
N'avoir rien tenté pour capitaliser, par la création de noyaux
de pouvoir ouvrier et d'organes de pouvoir populaire, l'état de
mobilisation de la classe ouvrière ; n'avoir rien tenté pour porter
à son apogée la prise de conscience révolutionnaire et pour la
fixer, comme point de référence futur, par des actions de valeur
exemplaire ; avoir rejeté comme « contraire aux accords » la
revendication de pouvoir ouvrier reprise par la C.F.D.T. * ;
de pouvoir ouvrier et d'organes de pouvoir populaire, l'état de
mobilisation de la classe ouvrière ; n'avoir rien tenté pour porter
à son apogée la prise de conscience révolutionnaire et pour la
fixer, comme point de référence futur, par des actions de valeur
exemplaire ; avoir rejeté comme « contraire aux accords » la
revendication de pouvoir ouvrier reprise par la C.F.D.T. * ;
4. Elle était imprécise et ambiguë ? La belle affaire : il suffisait de la
préciser. Elle correspondait parfaitement à l'état d'esprit de la base
préciser. Elle correspondait parfaitement à l'état d'esprit de la base
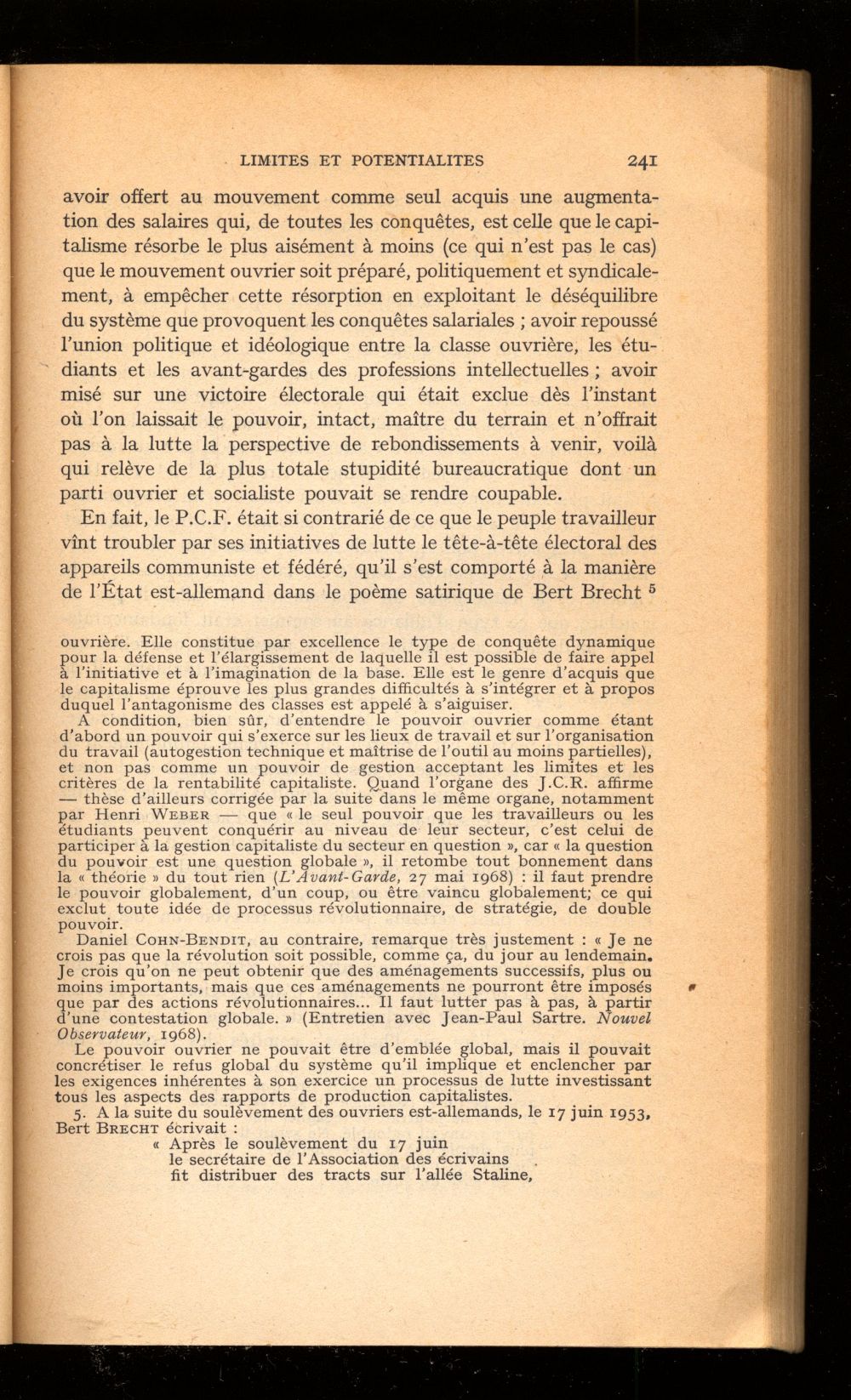

LIMITES ET POTENTIALITES
241
avoir offert au mouvement comme seul acquis une augmenta-
tion des salaires qui, de toutes les conquêtes, est celle que le capi-
talisme résorbe le plus aisément à moins (ce qui n'est pas le cas)
que le mouvement ouvrier soit préparé, politiquement et syndicale-
ment, à empêcher cette résorption en exploitant le déséquilibre
du système que provoquent les conquêtes salariales ; avoir repoussé
l'union politique et idéologique entre la classe ouvrière, les étu-
diants et les avant-gardes des professions intellectuelles ; avoir
misé sur une victoire électorale qui était exclue dès l'instant
où l'on laissait le pouvoir, intact, maître du terrain et n'offrait
pas à la lutte la perspective de rebondissements à venir, voilà
qui relève de la plus totale stupidité bureaucratique dont un
parti ouvrier et socialiste pouvait se rendre coupable.
tion des salaires qui, de toutes les conquêtes, est celle que le capi-
talisme résorbe le plus aisément à moins (ce qui n'est pas le cas)
que le mouvement ouvrier soit préparé, politiquement et syndicale-
ment, à empêcher cette résorption en exploitant le déséquilibre
du système que provoquent les conquêtes salariales ; avoir repoussé
l'union politique et idéologique entre la classe ouvrière, les étu-
diants et les avant-gardes des professions intellectuelles ; avoir
misé sur une victoire électorale qui était exclue dès l'instant
où l'on laissait le pouvoir, intact, maître du terrain et n'offrait
pas à la lutte la perspective de rebondissements à venir, voilà
qui relève de la plus totale stupidité bureaucratique dont un
parti ouvrier et socialiste pouvait se rendre coupable.
En fait, le P.C.F. était si contrarié de ce que le peuple travailleur
vînt troubler par ses initiatives de lutte le tête-à-tête électoral des
appareils communiste et fédéré, qu'il s'est comporté à la manière
de l'État est-allemand dans le poème satirique de Bert Brecht 5
vînt troubler par ses initiatives de lutte le tête-à-tête électoral des
appareils communiste et fédéré, qu'il s'est comporté à la manière
de l'État est-allemand dans le poème satirique de Bert Brecht 5
ouvrière. Elle constitue par excellence le type de conquête dynamique
pour la défense et l'élargissement de laquelle il est possible de faire appel
à l'initiative et à l'imagination de la base. Elle est le genre d'acquis que
le capitalisme éprouve les plus grandes difficultés à s'intégrer et à propos
duquel l'antagonisme des classes est appelé à s'aiguiser.
pour la défense et l'élargissement de laquelle il est possible de faire appel
à l'initiative et à l'imagination de la base. Elle est le genre d'acquis que
le capitalisme éprouve les plus grandes difficultés à s'intégrer et à propos
duquel l'antagonisme des classes est appelé à s'aiguiser.
A condition, bien sûr, d'entendre le pouvoir ouvrier comme étant
d'abord un pouvoir qui s'exerce sur les lieux de travail et sur l'organisation
du travail (autogestion technique et maîtrise de l'outil au moins partielles),
et non pas comme un pouvoir de gestion acceptant les limites et les
critères de la rentabilité capitaliste. Quand l'organe des J.C.R. affirme
— thèse d'ailleurs corrigée par la suite dans le même organe, notamment
par Henri WEBER — que « le seul pouvoir que les travailleurs ou les
étudiants peuvent conquérir au niveau de leur secteur, c'est celui de
participer à la gestion capitaliste du secteur en question », car « la question
du pouvoir est une question globale », il retombe tout bonnement dans
la « théorie » du tout rien (L'Avant-Garde, 27 mai 1968) : il faut prendre
le pouvoir globalement, d'un coup, ou être vaincu globalement; ce qui
exclut toute idée de processus révolutionnaire, de stratégie, de double
pouvoir.
d'abord un pouvoir qui s'exerce sur les lieux de travail et sur l'organisation
du travail (autogestion technique et maîtrise de l'outil au moins partielles),
et non pas comme un pouvoir de gestion acceptant les limites et les
critères de la rentabilité capitaliste. Quand l'organe des J.C.R. affirme
— thèse d'ailleurs corrigée par la suite dans le même organe, notamment
par Henri WEBER — que « le seul pouvoir que les travailleurs ou les
étudiants peuvent conquérir au niveau de leur secteur, c'est celui de
participer à la gestion capitaliste du secteur en question », car « la question
du pouvoir est une question globale », il retombe tout bonnement dans
la « théorie » du tout rien (L'Avant-Garde, 27 mai 1968) : il faut prendre
le pouvoir globalement, d'un coup, ou être vaincu globalement; ce qui
exclut toute idée de processus révolutionnaire, de stratégie, de double
pouvoir.
Daniel COHN-BENDIT, au contraire, remarque très justement : « Je ne
crois pas que la révolution soit possible, comme ça, du jour au lendemain.
Je crois qu'on ne peut obtenir que des aménagements successifs, plus ou
moins importants, mais que ces aménagements ne pourront être imposés
que par des actions révolutionnaires... Il faut lutter pas à pa,s, à partir
d'une contestation globale. » (Entretien avec Jean-Paul Sartre. Nouvel
Observateur, 1968).
crois pas que la révolution soit possible, comme ça, du jour au lendemain.
Je crois qu'on ne peut obtenir que des aménagements successifs, plus ou
moins importants, mais que ces aménagements ne pourront être imposés
que par des actions révolutionnaires... Il faut lutter pas à pa,s, à partir
d'une contestation globale. » (Entretien avec Jean-Paul Sartre. Nouvel
Observateur, 1968).
Le pouvoir ouvrier ne pouvait être d'emblée global, mais il pouvait
concrétiser le refus global du système qu'il implique et enclencher par
les exigences inhérentes à son exercice un processus de lutte investissant
tous les aspects des rapports de production capitalistes.
concrétiser le refus global du système qu'il implique et enclencher par
les exigences inhérentes à son exercice un processus de lutte investissant
tous les aspects des rapports de production capitalistes.
5. A la suite du soulèvement des ouvriers est-allemands, le 17 juin 1953,
Bert BRECHT écrivait :
Bert BRECHT écrivait :
« Après le soulèvement du 17 juin
le secrétaire de l'Association des écrivains
fit distribuer des tracts sur l'allée Staline,
le secrétaire de l'Association des écrivains
fit distribuer des tracts sur l'allée Staline,
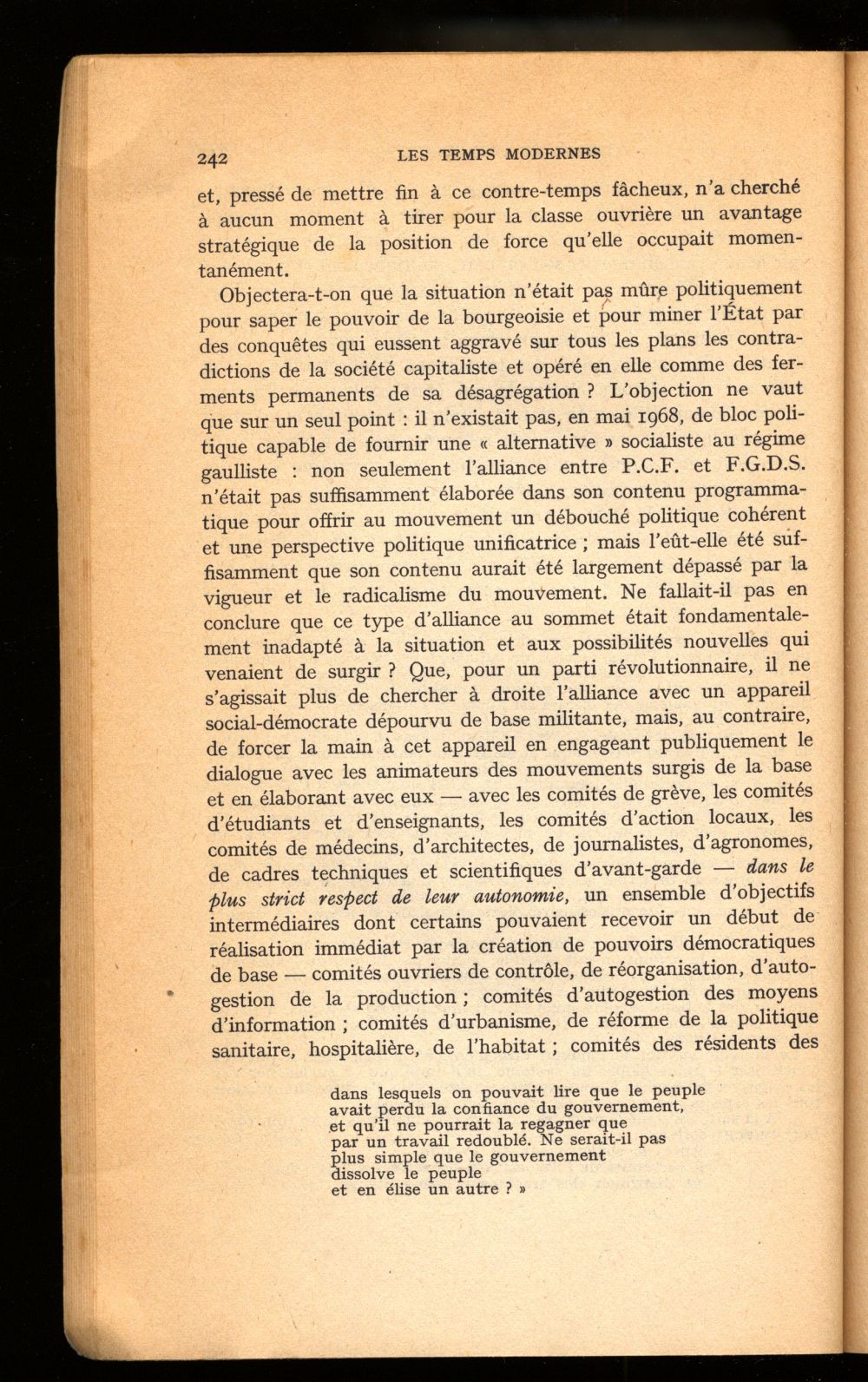

242
LES TEMPS MODERNES
et, pressé de mettre fin à ce contre-temps fâcheux, n'a cherché
à aucun moment à tirer pour la classe ouvrière un avantage
stratégique de la position de force qu'elle occupait momen-
tanément.
à aucun moment à tirer pour la classe ouvrière un avantage
stratégique de la position de force qu'elle occupait momen-
tanément.
Objectera-t-on que la situation n'était pas mûre politiquement
pour saper le pouvoir de la bourgeoisie et pour miner l'État par
des conquêtes qui eussent aggravé sur tous les plans les contra-
dictions de la société capitaliste et opéré en elle comme des fer-
ments permanents de sa désagrégation ? L'objection ne vaut
que sur un seul point : il n'existait pas, en mai 1968, de bloc poli-
tique capable de fournir une « alternative » socialiste au régime
gaulliste : non seulement l'alliance entre P.C.F. et F.G.D.S.
n'était pas suffisamment élaborée dans son contenu programma-
tique pour offrir au mouvement un débouché politique cohérent
et une perspective politique unificatrice ; mais l'eût-elle été suf-
fisamment que son contenu aurait été largement dépassé par la
vigueur et le radicalisme du mouvement. Ne fallait-il pas en
conclure que ce type d'alliance au sommet était fondamentale-
ment inadapté à la situation et aux possibilités nouvelles qui
venaient de surgir ? Que, pour un parti révolutionnaire, il ne
s'agissait plus de chercher à droite l'alliance avec un appareil
social-démocrate dépourvu de base militante, mais, au contraire,
de forcer la main à cet appareil en engageant publiquement le
dialogue avec les animateurs des mouvements surgis de la base
et en élaborant avec eux — avec les comités de grève, les comités
d'étudiants et d'enseignants, les comités d'action locaux, les
comités de médecins, d'architectes, de journalistes, d'agronomes,
de cadres techniques et scientifiques d'avant-garde — dans le
plus strict respect de leur autonomie, un ensemble d'objectifs
intermédiaires dont certains pouvaient recevoir un début de
réalisation immédiat par la création de pouvoirs démocratiques
de base — comités ouvriers de contrôle, de réorganisation, d'auto-
gestion de la production ; comités d'autogestion des moyens
d'information ; comités d'urbanisme, de réforme de la politique
sanitaire, hospitalière, de l'habitat ; comités des résidents des
pour saper le pouvoir de la bourgeoisie et pour miner l'État par
des conquêtes qui eussent aggravé sur tous les plans les contra-
dictions de la société capitaliste et opéré en elle comme des fer-
ments permanents de sa désagrégation ? L'objection ne vaut
que sur un seul point : il n'existait pas, en mai 1968, de bloc poli-
tique capable de fournir une « alternative » socialiste au régime
gaulliste : non seulement l'alliance entre P.C.F. et F.G.D.S.
n'était pas suffisamment élaborée dans son contenu programma-
tique pour offrir au mouvement un débouché politique cohérent
et une perspective politique unificatrice ; mais l'eût-elle été suf-
fisamment que son contenu aurait été largement dépassé par la
vigueur et le radicalisme du mouvement. Ne fallait-il pas en
conclure que ce type d'alliance au sommet était fondamentale-
ment inadapté à la situation et aux possibilités nouvelles qui
venaient de surgir ? Que, pour un parti révolutionnaire, il ne
s'agissait plus de chercher à droite l'alliance avec un appareil
social-démocrate dépourvu de base militante, mais, au contraire,
de forcer la main à cet appareil en engageant publiquement le
dialogue avec les animateurs des mouvements surgis de la base
et en élaborant avec eux — avec les comités de grève, les comités
d'étudiants et d'enseignants, les comités d'action locaux, les
comités de médecins, d'architectes, de journalistes, d'agronomes,
de cadres techniques et scientifiques d'avant-garde — dans le
plus strict respect de leur autonomie, un ensemble d'objectifs
intermédiaires dont certains pouvaient recevoir un début de
réalisation immédiat par la création de pouvoirs démocratiques
de base — comités ouvriers de contrôle, de réorganisation, d'auto-
gestion de la production ; comités d'autogestion des moyens
d'information ; comités d'urbanisme, de réforme de la politique
sanitaire, hospitalière, de l'habitat ; comités des résidents des
dans lesquels on pouvait lire que le peuple
avait perdu la confiance du gouvernement,
.et qu'il ne pourrait la regagner que
par un travail redoublé. Ne serait-il pas
plus simple que le gouvernement
dissolve le peuple
et en élise un autre ? »
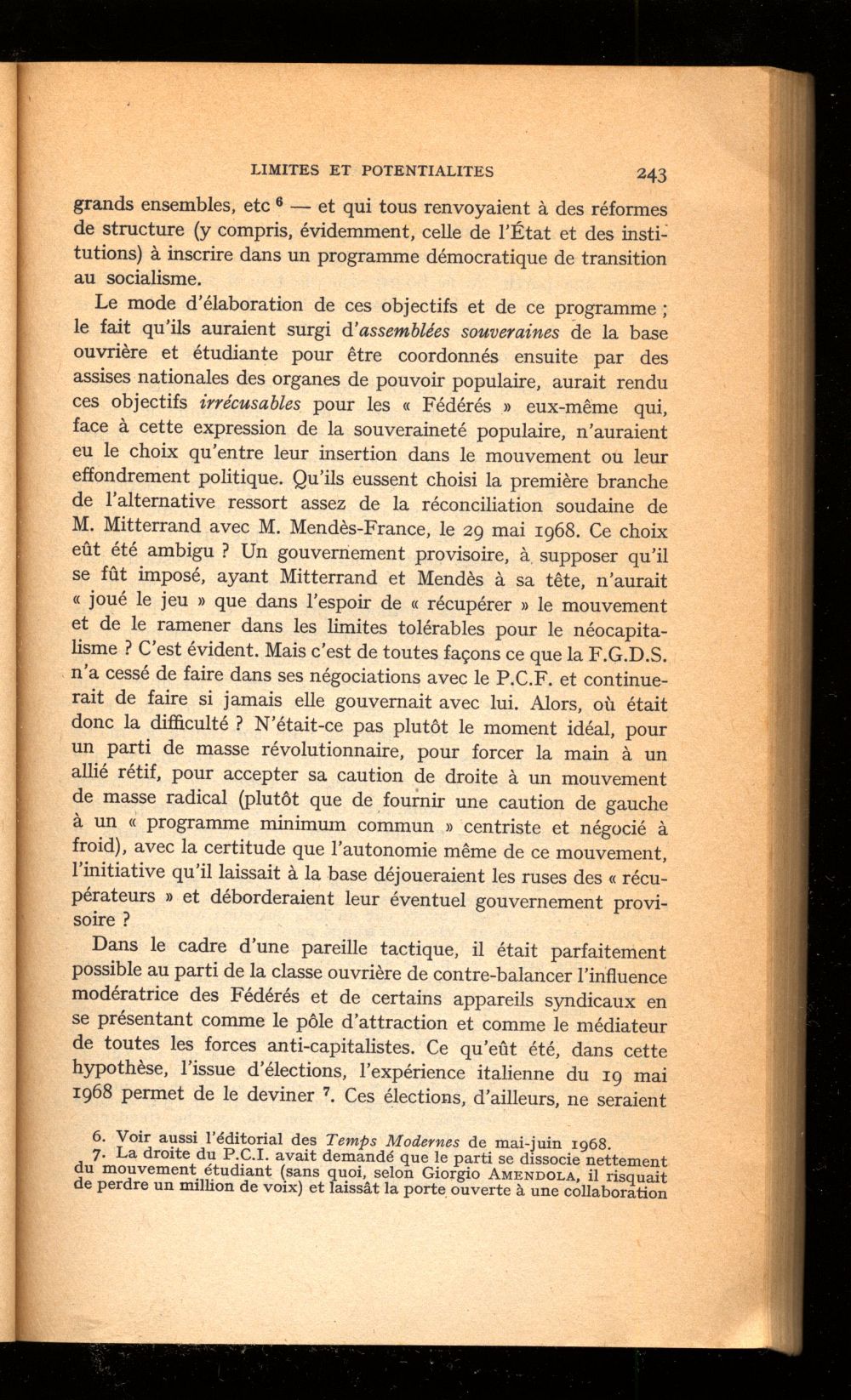

LIMITES ET POTENTIALITES
243
grands ensembles, etc 6 — et qui tous renvoyaient à des réformes
de structure (y compris, évidemment, celle de l'État et des insti-
tutions) à inscrire dans un programme démocratique de transition
au socialisme.
de structure (y compris, évidemment, celle de l'État et des insti-
tutions) à inscrire dans un programme démocratique de transition
au socialisme.
Le mode d'élaboration de ces objectifs et de ce programme ;
le fait qu'ils auraient surgi d'assemblées souveraines de la base
ouvrière et étudiante pour être coordonnés ensuite par des
assises nationales des organes de pouvoir populaire, aurait rendu
ces objectifs irrécusables pour les « Fédérés » eux-même qui,
face à cette expression de la souveraineté populaire, n'auraient
eu le choix qu'entre leur insertion dans le mouvement ou leur
effondrement politique. Qu'ils eussent choisi la première branche
de l'alternative ressort assez de la réconciliation soudaine de
M. Mitterrand avec M. Mendès-France, le 29 mai 1968. Ce choix
eût été ambigu ? Un gouvernement provisoire, à supposer qu'il
se fût imposé, ayant Mitterrand et Mendès à sa tête, n'aurait
« joué le jeu » que dans l'espoir de « récupérer » le mouvement
et de le ramener dans les limites tolérables pour le néocapita-
lisme ? C'est évident. Mais c'est de toutes façons ce que la F.G.D.S.
n'a cessé de faire dans ses négociations avec le P.C.F. et continue-
rait de faire si jamais elle gouvernait avec lui. Alors, où était
donc la difficulté ? N'était-ce pas plutôt le moment idéal, pour
un parti de masse révolutionnaire, pour forcer la main à un
allié rétif, pour accepter sa caution de droite à un mouvement
de masse radical (plutôt que de fournir une caution de gauche
à un « programme minimum commun » centriste et négocié à
froid), avec la certitude que l'autonomie même de ce mouvement,
l'initiative qu'il laissait à la base déjoueraient les ruses des « récu-
pérateurs » et déborderaient leur éventuel gouvernement provi-
soire ?
le fait qu'ils auraient surgi d'assemblées souveraines de la base
ouvrière et étudiante pour être coordonnés ensuite par des
assises nationales des organes de pouvoir populaire, aurait rendu
ces objectifs irrécusables pour les « Fédérés » eux-même qui,
face à cette expression de la souveraineté populaire, n'auraient
eu le choix qu'entre leur insertion dans le mouvement ou leur
effondrement politique. Qu'ils eussent choisi la première branche
de l'alternative ressort assez de la réconciliation soudaine de
M. Mitterrand avec M. Mendès-France, le 29 mai 1968. Ce choix
eût été ambigu ? Un gouvernement provisoire, à supposer qu'il
se fût imposé, ayant Mitterrand et Mendès à sa tête, n'aurait
« joué le jeu » que dans l'espoir de « récupérer » le mouvement
et de le ramener dans les limites tolérables pour le néocapita-
lisme ? C'est évident. Mais c'est de toutes façons ce que la F.G.D.S.
n'a cessé de faire dans ses négociations avec le P.C.F. et continue-
rait de faire si jamais elle gouvernait avec lui. Alors, où était
donc la difficulté ? N'était-ce pas plutôt le moment idéal, pour
un parti de masse révolutionnaire, pour forcer la main à un
allié rétif, pour accepter sa caution de droite à un mouvement
de masse radical (plutôt que de fournir une caution de gauche
à un « programme minimum commun » centriste et négocié à
froid), avec la certitude que l'autonomie même de ce mouvement,
l'initiative qu'il laissait à la base déjoueraient les ruses des « récu-
pérateurs » et déborderaient leur éventuel gouvernement provi-
soire ?
Dans le cadre d'une pareille tactique, il était parfaitement
possible au parti de la classe ouvrière de contre-balancer l'influence
modératrice des Fédérés et de certains appareils syndicaux en
se présentant comme le pôle d'attraction et comme le médiateur
de toutes les forces anti-capitalistes. Ce qu'eut été, dans cette
hypothèse, l'issue d'élections, l'expérience italienne du 19 mai
1968 permet de le deviner 7. Ces élections, d'ailleurs, ne seraient
possible au parti de la classe ouvrière de contre-balancer l'influence
modératrice des Fédérés et de certains appareils syndicaux en
se présentant comme le pôle d'attraction et comme le médiateur
de toutes les forces anti-capitalistes. Ce qu'eut été, dans cette
hypothèse, l'issue d'élections, l'expérience italienne du 19 mai
1968 permet de le deviner 7. Ces élections, d'ailleurs, ne seraient
6. Voir aussi l'éditorial des Temps Modernes de mai-juin 1968.
7. La droite du P.C.I. avait demandé que le parti se dissocie nettement
du mouvement étudiant {sans quoi, selon Giorgio AMENDOLA, il risquait
de perdre un million de voix) et laissât la porte ouverte à une collaboration
du mouvement étudiant {sans quoi, selon Giorgio AMENDOLA, il risquait
de perdre un million de voix) et laissât la porte ouverte à une collaboration
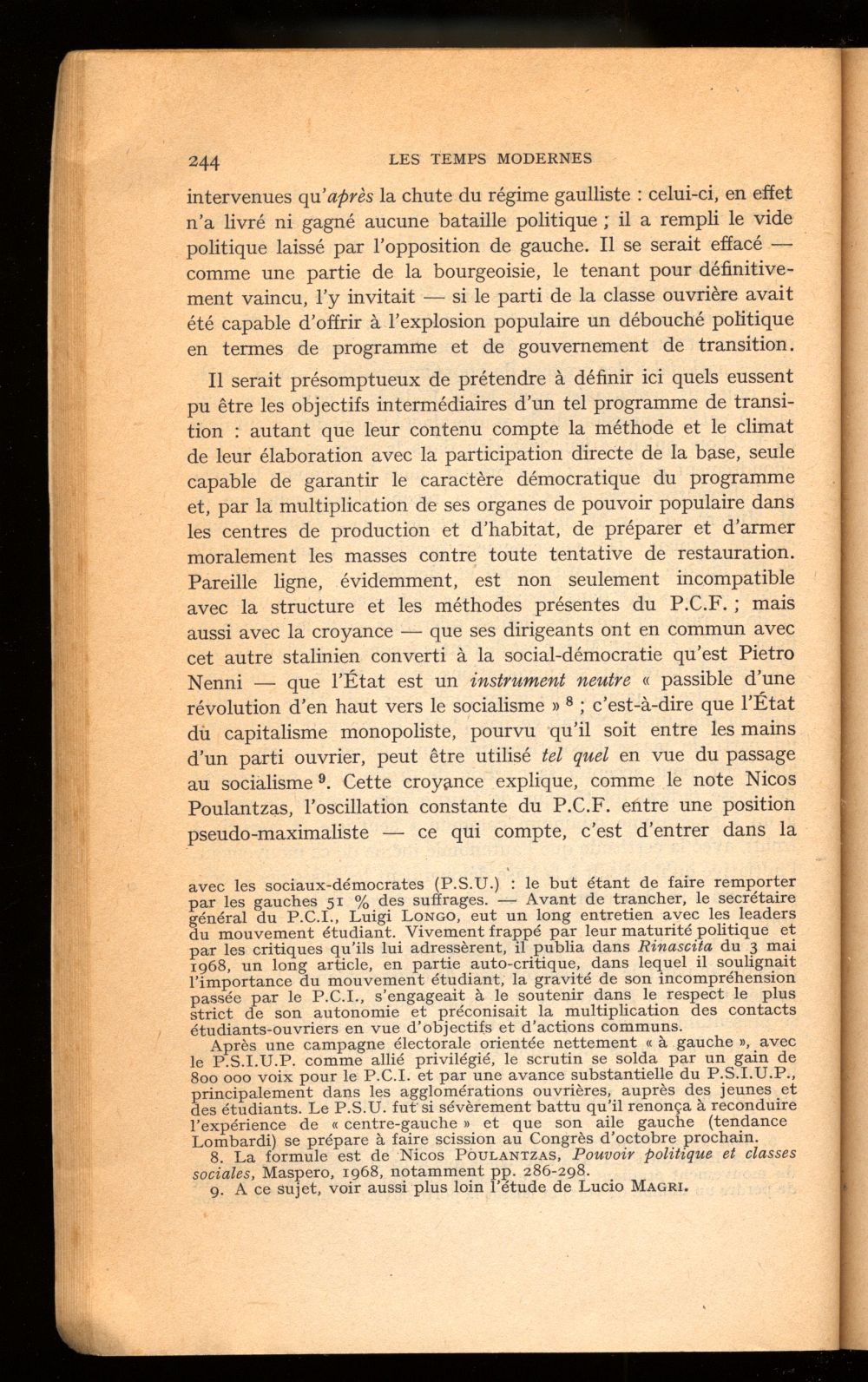

244
LES TEMPS MODERNES
intervenues qu'après la chute du régime gaulliste : celui-ci, en effet
n'a livré ni gagné aucune bataille politique ; il a rempli le vide
politique laissé par l'opposition de gauche. Il se serait effacé —
comme une partie de la bourgeoisie, le tenant pour définitive-
ment vaincu, l'y invitait — si le parti de la classe ouvrière avait
été capable d'offrir à l'explosion populaire un débouché politique
en termes de programme et de gouvernement de transition.
n'a livré ni gagné aucune bataille politique ; il a rempli le vide
politique laissé par l'opposition de gauche. Il se serait effacé —
comme une partie de la bourgeoisie, le tenant pour définitive-
ment vaincu, l'y invitait — si le parti de la classe ouvrière avait
été capable d'offrir à l'explosion populaire un débouché politique
en termes de programme et de gouvernement de transition.
Il serait présomptueux de prétendre à définir ici quels eussent
pu être les objectifs intermédiaires d'un tel programme de transi-
tion : autant que leur contenu compte la méthode et le climat
de leur élaboration avec la participation directe de la base, seule
capable de garantir le caractère démocratique du programme
et, par la multiplication de ses organes de pouvoir populaire dans
les centres de production et d'habitat, de préparer et d'armer
moralement les masses contre toute tentative de restauration.
Pareille ligne, évidemment, est non seulement incompatible
avec la structure et les méthodes présentes du P.C.F. ; mais
aussi avec la croyance — que ses dirigeants ont en commun avec
cet autre stalinien converti à la social-démocratie qu'est Pietro
Nenni — que l'État est un instrument neutre « passible d'une
révolution d'en haut vers le socialisme » 8 ; c'est-à-dire que l'État
dû capitalisme monopoliste, pourvu qu'il soit entre les mains
d'un parti ouvrier, peut être utilisé tel quel en vue du passage
au socialisme9. Cette croyance explique, comme le note Nicos
Poulantzas, l'oscillation constante du P.C.F. entre une position
pseudo-maximaliste — ce qui compte, c'est d'entrer dans la
pu être les objectifs intermédiaires d'un tel programme de transi-
tion : autant que leur contenu compte la méthode et le climat
de leur élaboration avec la participation directe de la base, seule
capable de garantir le caractère démocratique du programme
et, par la multiplication de ses organes de pouvoir populaire dans
les centres de production et d'habitat, de préparer et d'armer
moralement les masses contre toute tentative de restauration.
Pareille ligne, évidemment, est non seulement incompatible
avec la structure et les méthodes présentes du P.C.F. ; mais
aussi avec la croyance — que ses dirigeants ont en commun avec
cet autre stalinien converti à la social-démocratie qu'est Pietro
Nenni — que l'État est un instrument neutre « passible d'une
révolution d'en haut vers le socialisme » 8 ; c'est-à-dire que l'État
dû capitalisme monopoliste, pourvu qu'il soit entre les mains
d'un parti ouvrier, peut être utilisé tel quel en vue du passage
au socialisme9. Cette croyance explique, comme le note Nicos
Poulantzas, l'oscillation constante du P.C.F. entre une position
pseudo-maximaliste — ce qui compte, c'est d'entrer dans la
avec les sociaux-démocrates (P.S.U.) : le but étant de faire remporter
par les gauches 51 % des suffrages. — Avant de trancher, le secrétaire
général du P.C.I., Luigi LONGO, eut un long entretien avec les leaders
du mouvement étudiant. Vivement frappé par leur maturité politique et
par les critiques qu'ils lui adressèrent, il publia dans Rinascita du 3 mai
1968, un long article, en partie auto-critique, dans lequel il soulignait
l'importance du mouvement étudiant, la gravité de son incompréhension
passée par le P.C.I., s'engageait à le soutenir dans le respect le plus
strict de son autonomie et préconisait la multiplication des contacts
étudiants-ouvriers en vue d'objectifs et d'actions communs.
par les gauches 51 % des suffrages. — Avant de trancher, le secrétaire
général du P.C.I., Luigi LONGO, eut un long entretien avec les leaders
du mouvement étudiant. Vivement frappé par leur maturité politique et
par les critiques qu'ils lui adressèrent, il publia dans Rinascita du 3 mai
1968, un long article, en partie auto-critique, dans lequel il soulignait
l'importance du mouvement étudiant, la gravité de son incompréhension
passée par le P.C.I., s'engageait à le soutenir dans le respect le plus
strict de son autonomie et préconisait la multiplication des contacts
étudiants-ouvriers en vue d'objectifs et d'actions communs.
Après une campagne électorale orientée nettement « à gauche », avec
le P.S.I.U.P. comme allié privilégié, le scrutin se solda par un gain de
800 ooo voix pour le P.C.I. et par une avance substantielle du P.S.I.U.P.,
principalement dans les agglomérations ouvrières, auprès des jeunes et
des étudiants. Le P.S.U. fut si sévèrement battu qu'il renonça à reconduire
l'expérience de « centre-gauche » et que son aile gauche (tendance
Lombardi) se préparc à faire scission au Congrès d'octobre prochain.
le P.S.I.U.P. comme allié privilégié, le scrutin se solda par un gain de
800 ooo voix pour le P.C.I. et par une avance substantielle du P.S.I.U.P.,
principalement dans les agglomérations ouvrières, auprès des jeunes et
des étudiants. Le P.S.U. fut si sévèrement battu qu'il renonça à reconduire
l'expérience de « centre-gauche » et que son aile gauche (tendance
Lombardi) se préparc à faire scission au Congrès d'octobre prochain.
8. La formule est de Nicos POULANTZAS, Pouvoir politique et classes
sociales, Maspero, 1968, notamment pp. 286-298.
sociales, Maspero, 1968, notamment pp. 286-298.
g. A ce sujet, voir aussi plus loin l'étude de Lucio MAGRI.
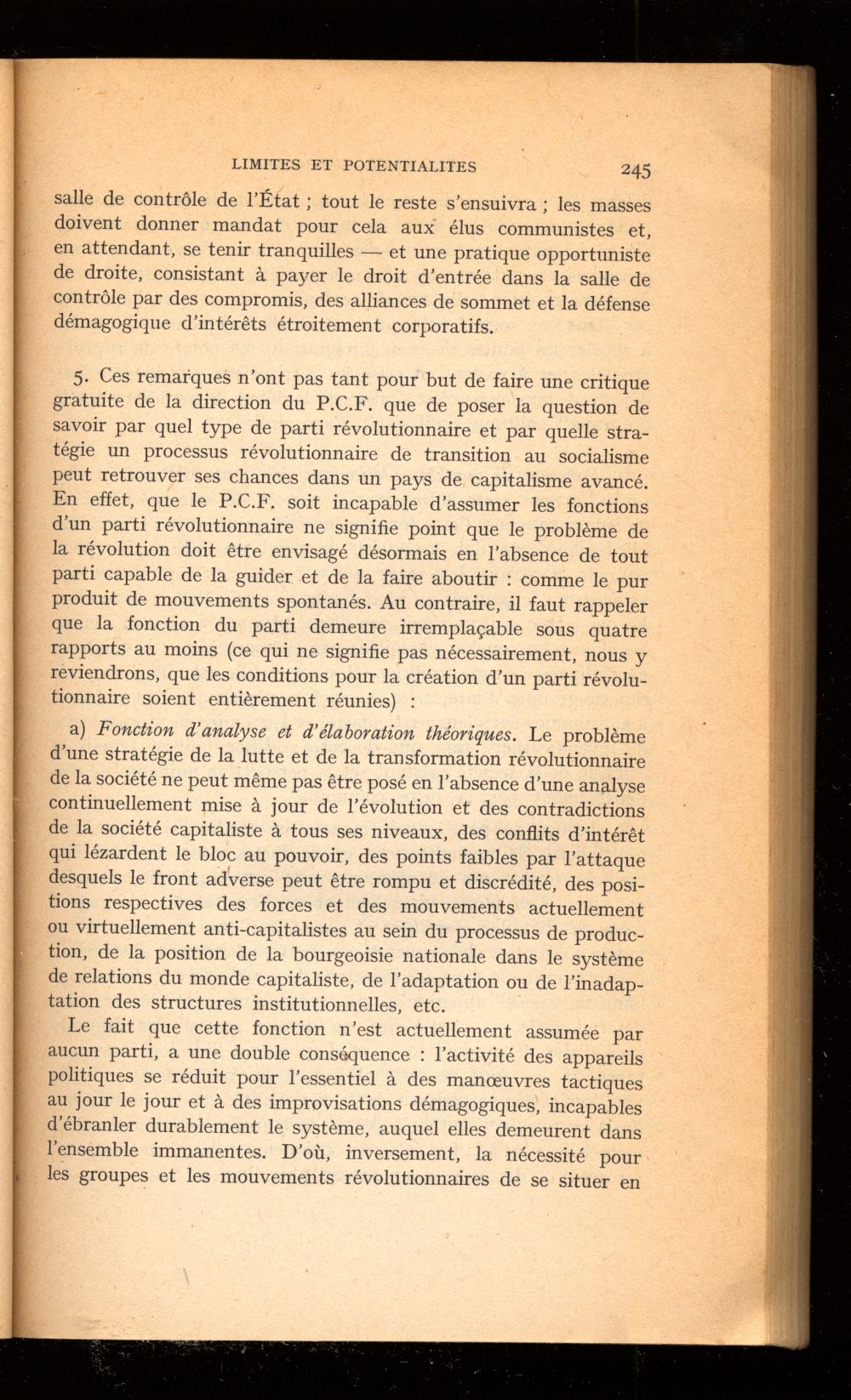

LIMITES ET POTENTIALITES 245
salle de contrôle de l'État ; tout le reste s'ensuivra ; les masses
doivent donner mandat pour cela aux élus communistes et,
en attendant, se tenir tranquilles — et une pratique opportuniste
de droite, consistant à payer le droit d'entrée dans la salle de
contrôle par des compromis, des alliances de sommet et la défense
démagogique d'intérêts étroitement corporatifs.
doivent donner mandat pour cela aux élus communistes et,
en attendant, se tenir tranquilles — et une pratique opportuniste
de droite, consistant à payer le droit d'entrée dans la salle de
contrôle par des compromis, des alliances de sommet et la défense
démagogique d'intérêts étroitement corporatifs.
5. Ces remarques n'ont pas tant pour but de faire une critique
gratuite de la direction du P.C.F. que de poser la question de
savoir par quel type de parti révolutionnaire et par quelle stra-
tégie un processus révolutionnaire de transition au socialisme
peut retrouver ses chances dans un pays de capitalisme avancé.
En effet, que le P.C.F. soit incapable d'assumer les fonctions
d'un parti révolutionnaire ne signifie point que le problème de
la révolution doit être envisagé désormais en l'absence de tout
parti capable de la guider et de la faire aboutir : comme le pur
produit de mouvements spontanés. Au contraire, il faut rappeler
que la fonction du parti demeure irremplaçable sous quatre
rapports au moins (ce qui ne signifie pas nécessairement, nous y
reviendrons, que les conditions pour la création d'un parti révolu-
tionnaire soient entièrement réunies) :
gratuite de la direction du P.C.F. que de poser la question de
savoir par quel type de parti révolutionnaire et par quelle stra-
tégie un processus révolutionnaire de transition au socialisme
peut retrouver ses chances dans un pays de capitalisme avancé.
En effet, que le P.C.F. soit incapable d'assumer les fonctions
d'un parti révolutionnaire ne signifie point que le problème de
la révolution doit être envisagé désormais en l'absence de tout
parti capable de la guider et de la faire aboutir : comme le pur
produit de mouvements spontanés. Au contraire, il faut rappeler
que la fonction du parti demeure irremplaçable sous quatre
rapports au moins (ce qui ne signifie pas nécessairement, nous y
reviendrons, que les conditions pour la création d'un parti révolu-
tionnaire soient entièrement réunies) :
a) Fonction d'analyse et d'élaboration théoriques. Le problème
d'une stratégie de la lutte et de la transformation révolutionnaire
de la société ne peut même pas être posé en l'absence d'une analyse
continuellement mise à jour de l'évolution et des contradictions
de la société capitaliste à tous ses niveaux, des conflits d'intérêt
qui lézardent le bloc au pouvoir, des points faibles par l'attaque
desquels le front adverse peut être rompu et discrédité, des posi-
tions respectives des forces et des mouvements actuellement
ou virtuellement anti-capitalistes au sein du processus de produc-
tion, de la position de la bourgeoisie nationale dans le système
de relations du monde capitaliste, de l'adaptation ou de l'inadap-
tation des structures institutionnelles, etc.
d'une stratégie de la lutte et de la transformation révolutionnaire
de la société ne peut même pas être posé en l'absence d'une analyse
continuellement mise à jour de l'évolution et des contradictions
de la société capitaliste à tous ses niveaux, des conflits d'intérêt
qui lézardent le bloc au pouvoir, des points faibles par l'attaque
desquels le front adverse peut être rompu et discrédité, des posi-
tions respectives des forces et des mouvements actuellement
ou virtuellement anti-capitalistes au sein du processus de produc-
tion, de la position de la bourgeoisie nationale dans le système
de relations du monde capitaliste, de l'adaptation ou de l'inadap-
tation des structures institutionnelles, etc.
Le fait que cette fonction n'est actuellement assumée par
aucun parti, a une double conséquence : l'activité des appareils
politiques se réduit pour l'essentiel à des manœuvres tactiques
au jour le jour et à des improvisations démagogiques, incapables
d'ébranler durablement le système, auquel elles demeurent dans
l'ensemble immanentes. D'où, inversement, la nécessité pour
les groupes et les mouvements révolutionnaires de se situer en
aucun parti, a une double conséquence : l'activité des appareils
politiques se réduit pour l'essentiel à des manœuvres tactiques
au jour le jour et à des improvisations démagogiques, incapables
d'ébranler durablement le système, auquel elles demeurent dans
l'ensemble immanentes. D'où, inversement, la nécessité pour
les groupes et les mouvements révolutionnaires de se situer en
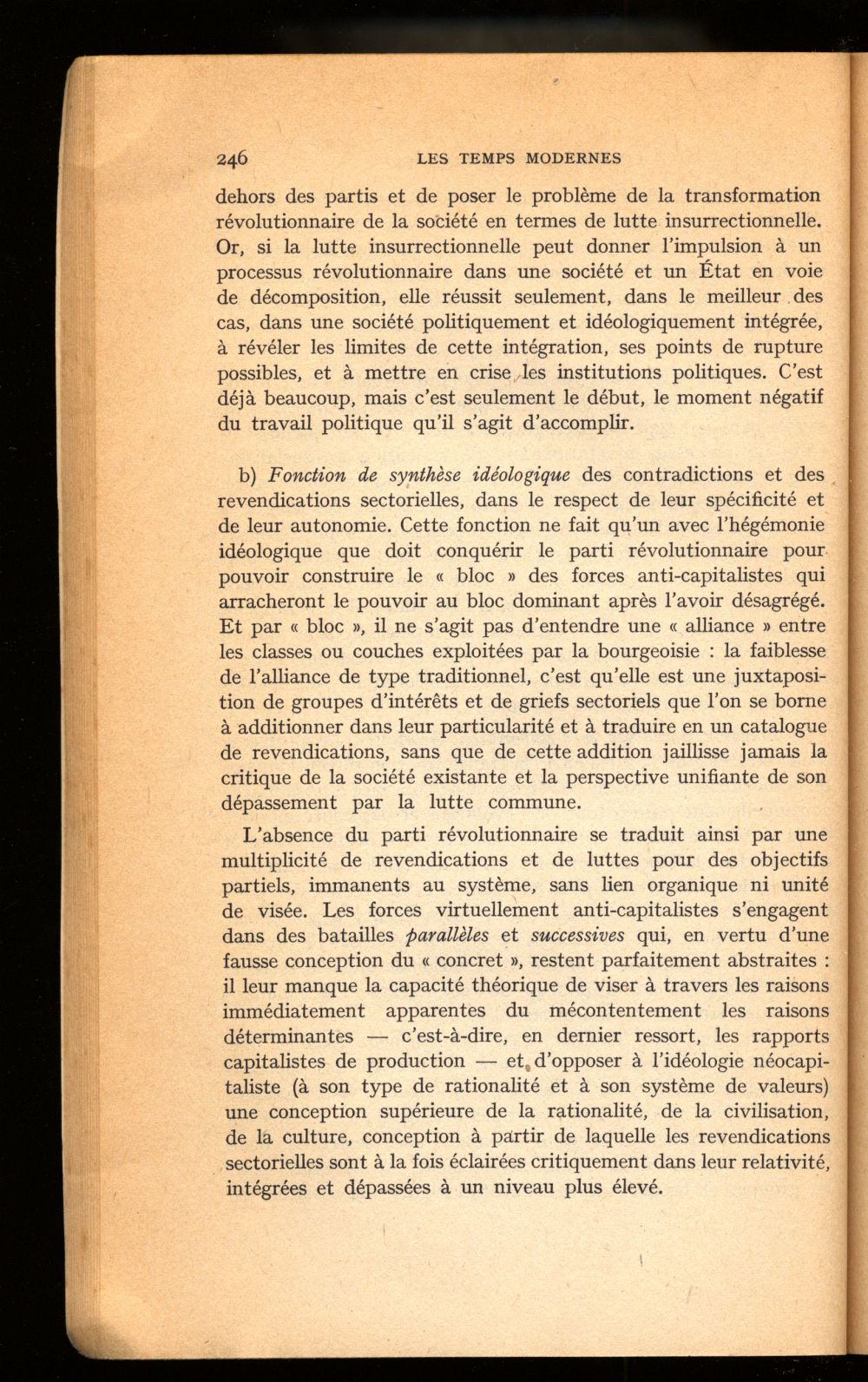

246 LES TEMPS MODERNES
dehors des partis et de poser le problème de la transformation
révolutionnaire de la société en termes de lutte insurrectionnelle.
Or, si la lutte insurrectionnelle peut donner l'impulsion à un
processus révolutionnaire dans une société et un État en voie
de décomposition, elle réussit seulement, dans le meilleur des
cas, dans une société politiquement et idéologiquement intégrée,
à révéler les limites de cette intégration, ses points de rupture
possibles, et à mettre en crise les institutions politiques. C'est
déjà beaucoup, mais c'est seulement le début, le moment négatif
du travail politique qu'il s'agit d'accomplir.
révolutionnaire de la société en termes de lutte insurrectionnelle.
Or, si la lutte insurrectionnelle peut donner l'impulsion à un
processus révolutionnaire dans une société et un État en voie
de décomposition, elle réussit seulement, dans le meilleur des
cas, dans une société politiquement et idéologiquement intégrée,
à révéler les limites de cette intégration, ses points de rupture
possibles, et à mettre en crise les institutions politiques. C'est
déjà beaucoup, mais c'est seulement le début, le moment négatif
du travail politique qu'il s'agit d'accomplir.
b) Fonction de synthèse idéologique des contradictions et des
revendications sectorielles, dans le respect de leur spécificité et
de leur autonomie. Cette fonction ne fait qu'un avec l'hégémonie
idéologique que doit conquérir le parti révolutionnaire pour
pouvoir construire le « bloc » des forces anti-capitalistes qui
arracheront le pouvoir au bloc dominant après l'avoir désagrégé.
Et par « bloc », il ne s'agit pas d'entendre une « alliance » entre
les classes ou couches exploitées par la bourgeoisie : la faiblesse
de l'alliance de type traditionnel, c'est qu'elle est une juxtaposi-
tion de groupes d'intérêts et de griefs sectoriels que l'on se borne
à additionner dans leur particularité et à traduire en un catalogue
de revendications, sans que de cette addition jaillisse jamais la
critique de la société existante et la perspective unifiante de son
dépassement par la lutte commune.
revendications sectorielles, dans le respect de leur spécificité et
de leur autonomie. Cette fonction ne fait qu'un avec l'hégémonie
idéologique que doit conquérir le parti révolutionnaire pour
pouvoir construire le « bloc » des forces anti-capitalistes qui
arracheront le pouvoir au bloc dominant après l'avoir désagrégé.
Et par « bloc », il ne s'agit pas d'entendre une « alliance » entre
les classes ou couches exploitées par la bourgeoisie : la faiblesse
de l'alliance de type traditionnel, c'est qu'elle est une juxtaposi-
tion de groupes d'intérêts et de griefs sectoriels que l'on se borne
à additionner dans leur particularité et à traduire en un catalogue
de revendications, sans que de cette addition jaillisse jamais la
critique de la société existante et la perspective unifiante de son
dépassement par la lutte commune.
L'absence du parti révolutionnaire se traduit ainsi par une
multiplicité de revendications et de luttes pour des objectifs
partiels, immanents au système, sans lien organique ni unité
de visée. Les forces virtuellement anti-capitalistes s'engagent
dans des batailles parallèles et successives qui, en vertu d'une
fausse conception du « concret », restent parfaitement abstraites :
il leur manque la capacité théorique de viser à travers les raisons
immédiatement apparentes du mécontentement les raisons
déterminantes — c'est-à-dire, en dernier ressort, les rapports
capitalistes de production — et d'opposer à l'idéologie néocapi-
taliste (à son type de rationalité et à son système de valeurs)
une conception supérieure de la rationalité, de la civilisation,
de la culture, conception à partir de laquelle les revendications
sectorielles sont à la fois éclairées critiquement dans leur relativité,
intégrées et dépassées à un niveau plus élevé.
multiplicité de revendications et de luttes pour des objectifs
partiels, immanents au système, sans lien organique ni unité
de visée. Les forces virtuellement anti-capitalistes s'engagent
dans des batailles parallèles et successives qui, en vertu d'une
fausse conception du « concret », restent parfaitement abstraites :
il leur manque la capacité théorique de viser à travers les raisons
immédiatement apparentes du mécontentement les raisons
déterminantes — c'est-à-dire, en dernier ressort, les rapports
capitalistes de production — et d'opposer à l'idéologie néocapi-
taliste (à son type de rationalité et à son système de valeurs)
une conception supérieure de la rationalité, de la civilisation,
de la culture, conception à partir de laquelle les revendications
sectorielles sont à la fois éclairées critiquement dans leur relativité,
intégrées et dépassées à un niveau plus élevé.
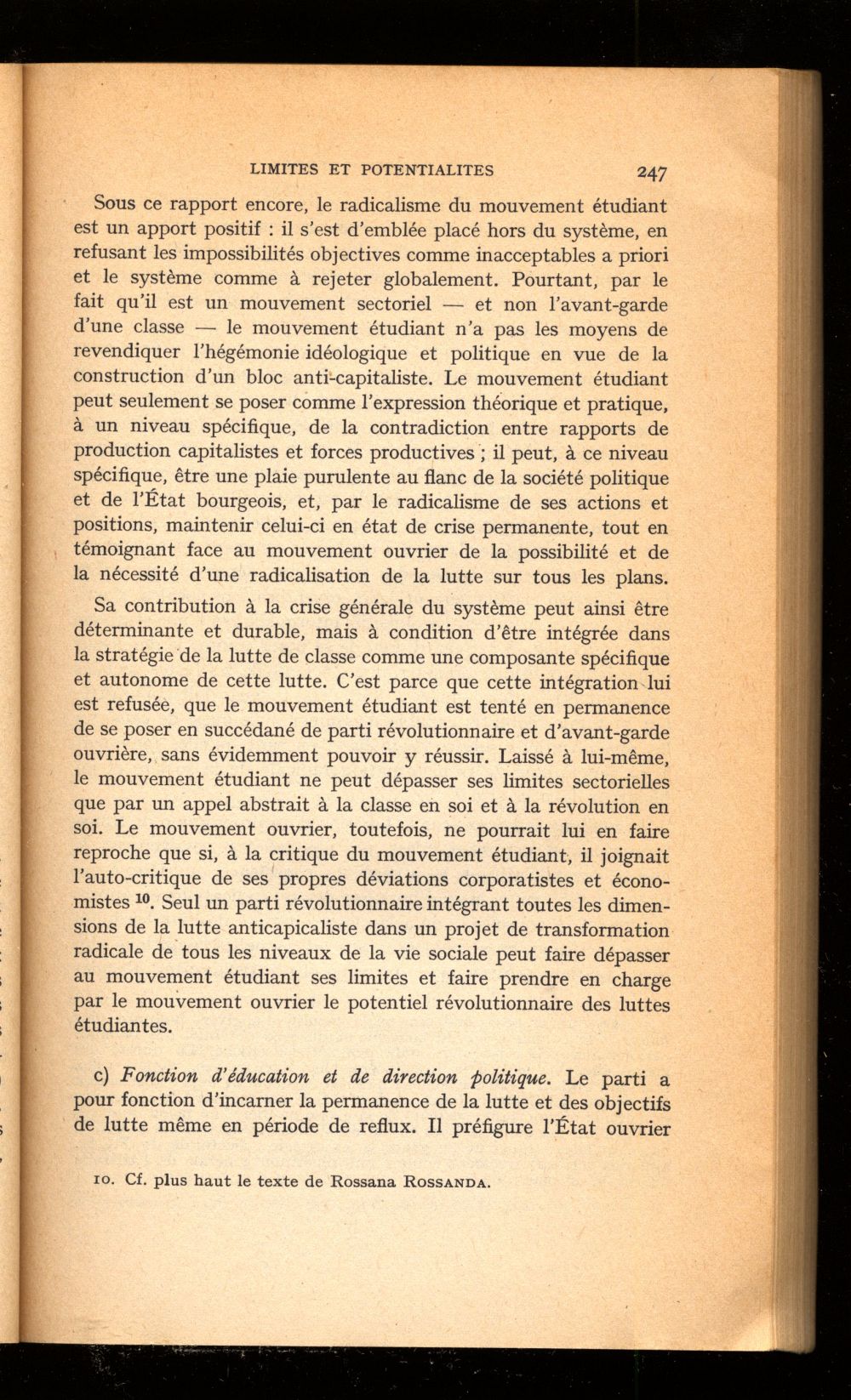

LIMITES ET POTENTIALITES 247
Sous ce rapport encore, le radicalisme du mouvement étudiant
est un apport positif : il s'est d'emblée placé hors du système, en
refusant les impossibilités objectives comme inacceptables a priori
et le système comme à rejeter globalement. Pourtant, par le
fait qu'il est un mouvement sectoriel — et non l'avant-garde
d'une classe — le mouvement étudiant n'a pas les moyens de
revendiquer l'hégémonie idéologique et politique en vue de la
construction d'un bloc anti-capitaliste. Le mouvement étudiant
peut seulement se poser comme l'expression théorique et pratique,
à un niveau spécifique, de la contradiction entre rapports de
production capitalistes et forces productives ; il peut, à ce niveau
spécifique, être une plaie purulente au flanc de la société politique
et de l'État bourgeois, et, par le radicalisme de ses actions et
positions, maintenir celui-ci en état de crise permanente, tout en
témoignant face au mouvement ouvrier de la possibilité et de
la nécessité d'une radicalisation de la lutte sur tous les plans.
est un apport positif : il s'est d'emblée placé hors du système, en
refusant les impossibilités objectives comme inacceptables a priori
et le système comme à rejeter globalement. Pourtant, par le
fait qu'il est un mouvement sectoriel — et non l'avant-garde
d'une classe — le mouvement étudiant n'a pas les moyens de
revendiquer l'hégémonie idéologique et politique en vue de la
construction d'un bloc anti-capitaliste. Le mouvement étudiant
peut seulement se poser comme l'expression théorique et pratique,
à un niveau spécifique, de la contradiction entre rapports de
production capitalistes et forces productives ; il peut, à ce niveau
spécifique, être une plaie purulente au flanc de la société politique
et de l'État bourgeois, et, par le radicalisme de ses actions et
positions, maintenir celui-ci en état de crise permanente, tout en
témoignant face au mouvement ouvrier de la possibilité et de
la nécessité d'une radicalisation de la lutte sur tous les plans.
Sa contribution à la crise générale du système peut ainsi être
déterminante et durable, mais à condition d'être intégrée dans
la stratégie de la lutte de classe comme une composante spécifique
et autonome de cette lutte. C'est parce que cette intégration lui
est refusée, que le mouvement étudiant est tenté en permanence
de se poser en succédané de parti révolutionnaire et d'avant-garde
ouvrière, sans évidemment pouvoir y réussir. Laissé à lui-même,
le mouvement étudiant ne peut dépasser ses limites sectorielles
que par un appel abstrait à la classe en soi et à la révolution en
soi. Le mouvement ouvrier, toutefois, ne pourrait lui en faire
reproche que si, à la critique du mouvement étudiant, il joignait
l'auto-critique de ses propres déviations corporatistes et écono-
mistes 10. Seul un parti révolutionnaire intégrant toutes les dimen-
sions de la lutte anticapicaliste dans un projet de transformation
radicale de tous les niveaux de la vie sociale peut faire dépasser
au mouvement étudiant ses limites et faire prendre en charge
par le mouvement ouvrier le potentiel révolutionnaire des luttes
étudiantes.
déterminante et durable, mais à condition d'être intégrée dans
la stratégie de la lutte de classe comme une composante spécifique
et autonome de cette lutte. C'est parce que cette intégration lui
est refusée, que le mouvement étudiant est tenté en permanence
de se poser en succédané de parti révolutionnaire et d'avant-garde
ouvrière, sans évidemment pouvoir y réussir. Laissé à lui-même,
le mouvement étudiant ne peut dépasser ses limites sectorielles
que par un appel abstrait à la classe en soi et à la révolution en
soi. Le mouvement ouvrier, toutefois, ne pourrait lui en faire
reproche que si, à la critique du mouvement étudiant, il joignait
l'auto-critique de ses propres déviations corporatistes et écono-
mistes 10. Seul un parti révolutionnaire intégrant toutes les dimen-
sions de la lutte anticapicaliste dans un projet de transformation
radicale de tous les niveaux de la vie sociale peut faire dépasser
au mouvement étudiant ses limites et faire prendre en charge
par le mouvement ouvrier le potentiel révolutionnaire des luttes
étudiantes.
c) Fonction d'éducation et de direction politique. Le parti a
pour fonction d'incarner la permanence de la lutte et des objectifs
de lutte même en période de reflux. Il préfigure l'État ouvrier
pour fonction d'incarner la permanence de la lutte et des objectifs
de lutte même en période de reflux. Il préfigure l'État ouvrier
10. Cf. plus haut le texte de Rossana ROSSANDA.
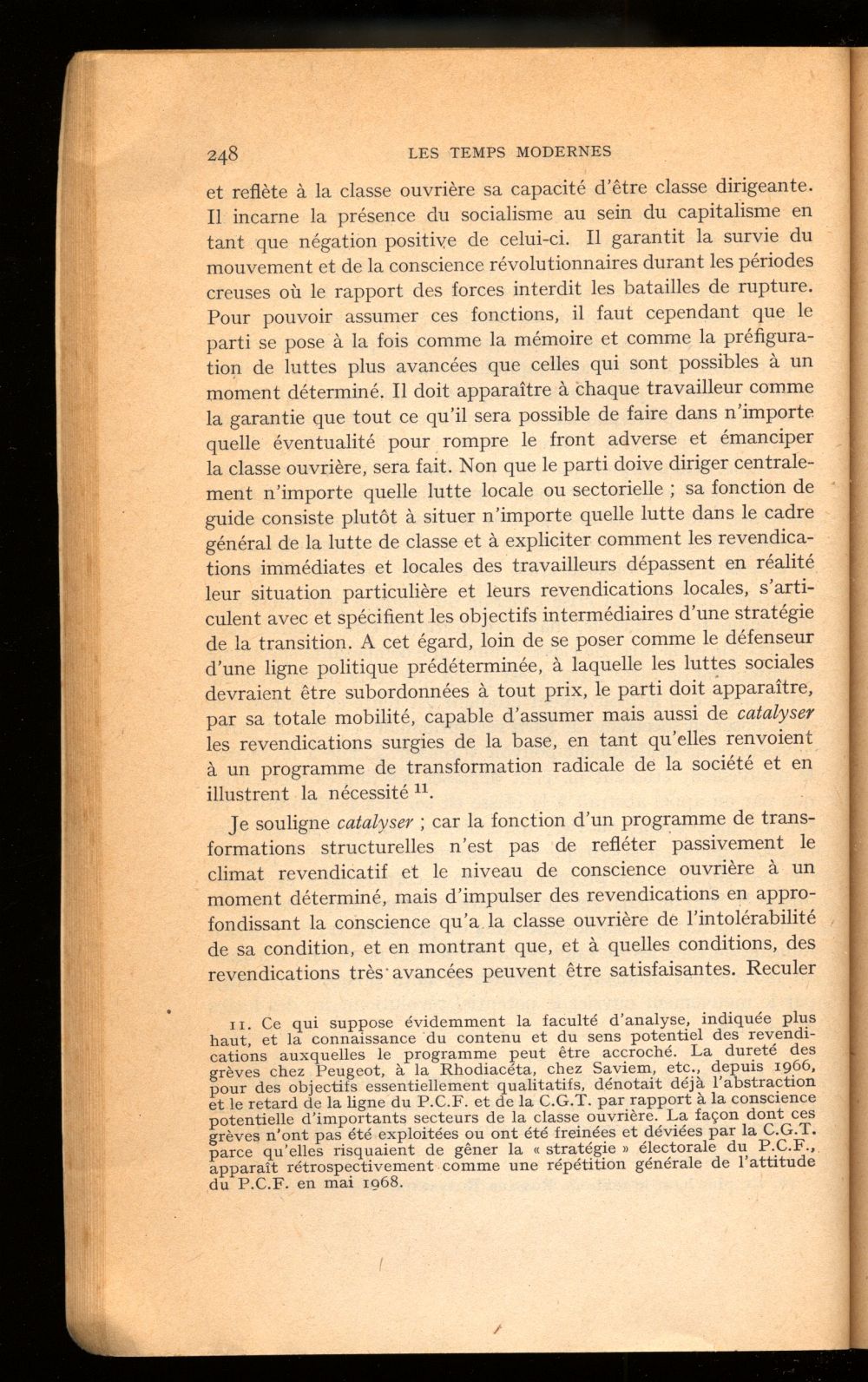

248
LES TEMPS MODERNES
et reflète à la classe ouvrière sa capacité d'être classe dirigeante.
Il incarne la présence du socialisme au sein du capitalisme en
tant que négation positive de celui-ci. Il garantit la survie du
mouvement et de la conscience révolutionnaires durant les périodes
creuses où le rapport des forces interdit les batailles de rupture.
Pour pouvoir assumer ces fonctions, il faut cependant que le
parti se pose à la fois comme la mémoire, et comme la préfigura-
tion de luttes plus avancées que celles qui sont possibles à un
moment déterminé. Il doit apparaître à chaque travailleur comme
la garantie que tout ce qu'il sera possible de faire dans n'importe
quelle éventualité pour rompre le front adverse et émanciper
la classe ouvrière, sera fait. Non que le parti doive diriger centrale-
ment n'importe quelle lutte locale ou sectorielle ; sa fonction de
guide consiste plutôt à situer n'importe quelle lutte dans le cadre
général de la lutte de classe et à expliciter comment les revendica-
tions immédiates et locales des travailleurs dépassent en réalité
leur situation particulière et leurs revendications locales, s'arti-
culent avec et spécifient les objectifs intermédiaires d'une stratégie
de la transition. A cet égard, loin de se poser comme le défenseur
d'une ligne politique prédéterminée, à laquelle les luttes sociales
devraient être subordonnées à tout prix, le parti doit apparaître,
par sa totale mobilité, capable d'assumer mais aussi de catalyser
les revendications surgies de la base, en tant qu'elles renvoient
à un programme de transformation radicale de la société et en
illustrent la nécessité 11.
Il incarne la présence du socialisme au sein du capitalisme en
tant que négation positive de celui-ci. Il garantit la survie du
mouvement et de la conscience révolutionnaires durant les périodes
creuses où le rapport des forces interdit les batailles de rupture.
Pour pouvoir assumer ces fonctions, il faut cependant que le
parti se pose à la fois comme la mémoire, et comme la préfigura-
tion de luttes plus avancées que celles qui sont possibles à un
moment déterminé. Il doit apparaître à chaque travailleur comme
la garantie que tout ce qu'il sera possible de faire dans n'importe
quelle éventualité pour rompre le front adverse et émanciper
la classe ouvrière, sera fait. Non que le parti doive diriger centrale-
ment n'importe quelle lutte locale ou sectorielle ; sa fonction de
guide consiste plutôt à situer n'importe quelle lutte dans le cadre
général de la lutte de classe et à expliciter comment les revendica-
tions immédiates et locales des travailleurs dépassent en réalité
leur situation particulière et leurs revendications locales, s'arti-
culent avec et spécifient les objectifs intermédiaires d'une stratégie
de la transition. A cet égard, loin de se poser comme le défenseur
d'une ligne politique prédéterminée, à laquelle les luttes sociales
devraient être subordonnées à tout prix, le parti doit apparaître,
par sa totale mobilité, capable d'assumer mais aussi de catalyser
les revendications surgies de la base, en tant qu'elles renvoient
à un programme de transformation radicale de la société et en
illustrent la nécessité 11.
Je souligne catalyser ; car la fonction d'un programme de trans-
formations structurelles n'est pas de refléter passivement le
climat revendicatif et le niveau de conscience ouvrière à un
moment déterminé, mais d'impulser des revendications en appro-
fondissant la conscience qu'a la classe ouvrière de l'intolérabilité
de sa condition, et en montrant que, et à quelles conditions, des
revendications très'avancées peuvent être satisfaisantes. Reculer
formations structurelles n'est pas de refléter passivement le
climat revendicatif et le niveau de conscience ouvrière à un
moment déterminé, mais d'impulser des revendications en appro-
fondissant la conscience qu'a la classe ouvrière de l'intolérabilité
de sa condition, et en montrant que, et à quelles conditions, des
revendications très'avancées peuvent être satisfaisantes. Reculer
il. Ce qui suppose évidemment la faculté d'analyse, indiquée plus
haut, et la connaissance du contenu et du sens potentiel des revendi-
cations auxquelles le programme peut être accroché. La dureté des
grèves chez Peugeot, à la Rhodiacéta, chez Saviem, etc., depuis 1966,
pour des objectifs essentiellement qualitatifs, dénotait déjà l'abstraction
et le retard de la ligne du P.C.F. et de la C.G.T. par rapport à la conscience
potentielle d'importants secteurs de la classe ouvrière. La façon dont ces
grèves n'ont pas été exploitées ou ont été freinées et déviées par la C.G.T.
parce qu'elles risquaient de gêner la « stratégie » électorale du P.C.F.,
apparaît rétrospectivement comme une répétition générale de l'attitude
du P.C.F. en mai 1068.
haut, et la connaissance du contenu et du sens potentiel des revendi-
cations auxquelles le programme peut être accroché. La dureté des
grèves chez Peugeot, à la Rhodiacéta, chez Saviem, etc., depuis 1966,
pour des objectifs essentiellement qualitatifs, dénotait déjà l'abstraction
et le retard de la ligne du P.C.F. et de la C.G.T. par rapport à la conscience
potentielle d'importants secteurs de la classe ouvrière. La façon dont ces
grèves n'ont pas été exploitées ou ont été freinées et déviées par la C.G.T.
parce qu'elles risquaient de gêner la « stratégie » électorale du P.C.F.,
apparaît rétrospectivement comme une répétition générale de l'attitude
du P.C.F. en mai 1068.
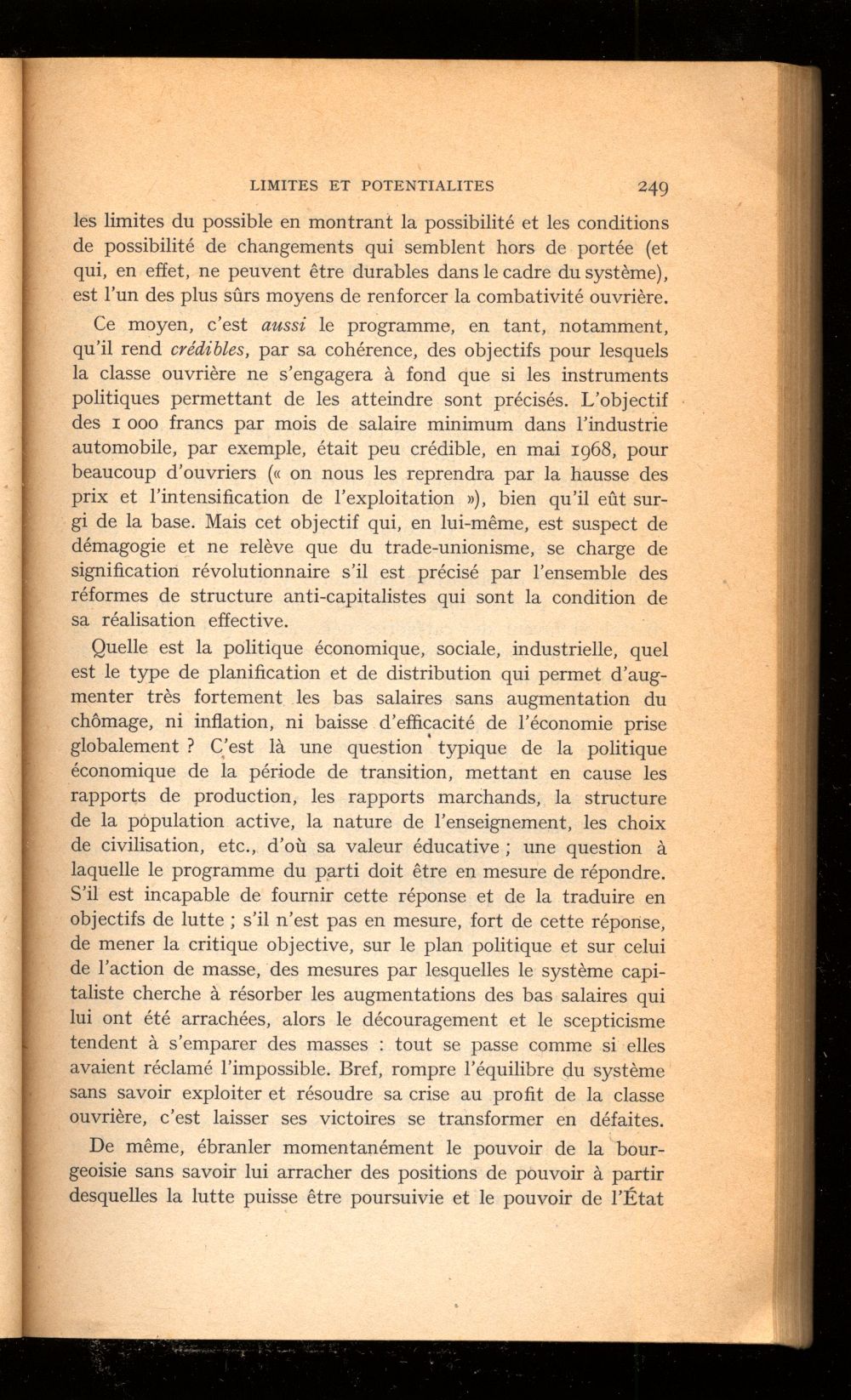

LIMITES ET POTENTIALITES
249
les limites du possible en montrant la possibilité et les conditions
de possibilité de changements qui semblent hors de portée (et
qui, en effet, ne peuvent être durables dans le cadre du système),
est l'un des plus sûrs moyens de renforcer la combativité ouvrière.
de possibilité de changements qui semblent hors de portée (et
qui, en effet, ne peuvent être durables dans le cadre du système),
est l'un des plus sûrs moyens de renforcer la combativité ouvrière.
Ce moyen, c'est aussi le programme, en tant, notamment,
qu'il rend crédibles, par sa cohérence, des objectifs pour lesquels
la classe ouvrière ne s'engagera à fond que si les instruments
politiques permettant de les atteindre sont précisés. L'objectif
des i ooo francs par mois de salaire minimum dans l'industrie
automobile, par exemple, était peu crédible, en mai 1968, pour
beaucoup d'ouvriers (« on nous les reprendra par la hausse des
prix et l'intensification de l'exploitation »), bien qu'il eût sur-
gi de la base. Mais cet objectif qui, en lui-même, est suspect de
démagogie et ne relève que du trade-unionisme, se charge de
signification révolutionnaire s'il est précisé par l'ensemble des
réformes de structure anti-capitalistes qui sont la condition de
sa réalisation effective.
qu'il rend crédibles, par sa cohérence, des objectifs pour lesquels
la classe ouvrière ne s'engagera à fond que si les instruments
politiques permettant de les atteindre sont précisés. L'objectif
des i ooo francs par mois de salaire minimum dans l'industrie
automobile, par exemple, était peu crédible, en mai 1968, pour
beaucoup d'ouvriers (« on nous les reprendra par la hausse des
prix et l'intensification de l'exploitation »), bien qu'il eût sur-
gi de la base. Mais cet objectif qui, en lui-même, est suspect de
démagogie et ne relève que du trade-unionisme, se charge de
signification révolutionnaire s'il est précisé par l'ensemble des
réformes de structure anti-capitalistes qui sont la condition de
sa réalisation effective.
Quelle est la politique économique, sociale, industrielle, quel
est le type de planification et de distribution qui permet d'aug-
menter très fortement les bas salaires sans augmentation du
chômage, ni inflation, ni baisse d'efficacité de l'économie prise
globalement ? C'est là une question typique de la politique
économique de la période de transition, mettant en cause les
rapports de production, les rapports marchands, la structure
de la population active, la nature de l'enseignement, les choix
de civilisation, etc., d'où sa valeur éducative ; une question à
laquelle le programme du parti doit être en mesure de répondre.
S'il est incapable de fournir cette réponse et de la traduire en
objectifs de lutte ; s'il n'est pas en mesure, fort de cette réponse,
de mener la critique objective, sur le plan politique et sur celui
de l'action de masse, des mesures par lesquelles le système capi-
taliste cherche à résorber les augmentations des bas salaires qui
lui ont été arrachées, alors le découragement et le scepticisme
tendent à s'emparer des masses : tout se passe comme si elles
avaient réclamé l'impossible. Bref, rompre l'équilibre du système
sans savoir exploiter et résoudre sa crise au profit de la classe
ouvrière, c'est laisser ses victoires se transformer en défaites.
est le type de planification et de distribution qui permet d'aug-
menter très fortement les bas salaires sans augmentation du
chômage, ni inflation, ni baisse d'efficacité de l'économie prise
globalement ? C'est là une question typique de la politique
économique de la période de transition, mettant en cause les
rapports de production, les rapports marchands, la structure
de la population active, la nature de l'enseignement, les choix
de civilisation, etc., d'où sa valeur éducative ; une question à
laquelle le programme du parti doit être en mesure de répondre.
S'il est incapable de fournir cette réponse et de la traduire en
objectifs de lutte ; s'il n'est pas en mesure, fort de cette réponse,
de mener la critique objective, sur le plan politique et sur celui
de l'action de masse, des mesures par lesquelles le système capi-
taliste cherche à résorber les augmentations des bas salaires qui
lui ont été arrachées, alors le découragement et le scepticisme
tendent à s'emparer des masses : tout se passe comme si elles
avaient réclamé l'impossible. Bref, rompre l'équilibre du système
sans savoir exploiter et résoudre sa crise au profit de la classe
ouvrière, c'est laisser ses victoires se transformer en défaites.
De même, ébranler momentanément le pouvoir de la bour-
geoisie sans savoir lui arracher des positions de pouvoir à partir
desquelles la lutte puisse être poursuivie et le pouvoir de l'État
geoisie sans savoir lui arracher des positions de pouvoir à partir
desquelles la lutte puisse être poursuivie et le pouvoir de l'État
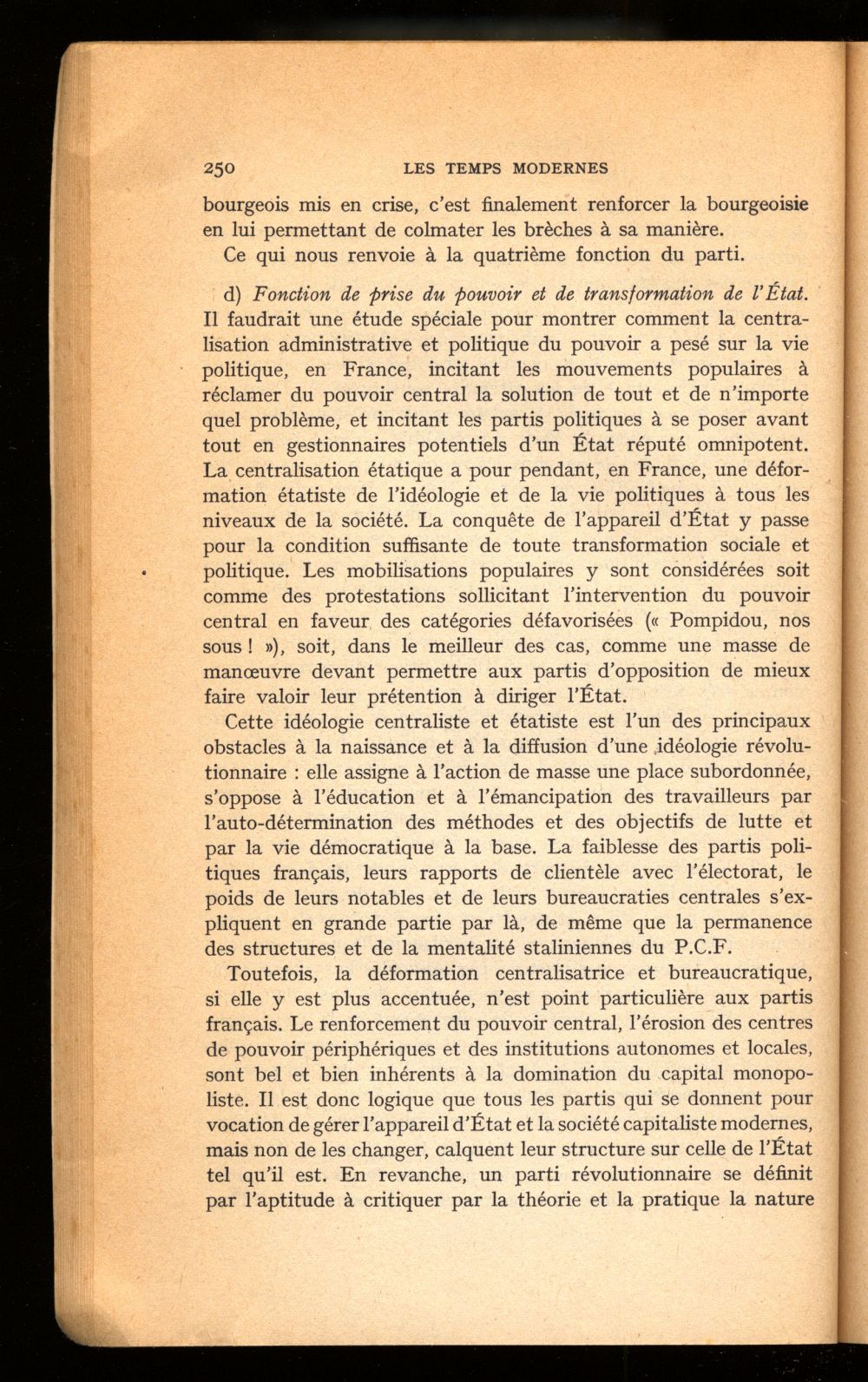

250
LES TEMPS MODERNES
bourgeois mis en crise, c'est finalement renforcer la bourgeoisie
en lui permettant de colmater les brèches à sa manière.
Ce qui nous renvoie à la quatrième fonction du parti.
en lui permettant de colmater les brèches à sa manière.
Ce qui nous renvoie à la quatrième fonction du parti.
d) Fonction de prise du pouvoir et de transformation de l'État.
Il faudrait une étude spéciale pour montrer comment la centra-
lisation administrative et politique du pouvoir a pesé sur la vie
politique, en France, incitant les mouvements populaires à
réclamer du pouvoir central la solution de tout et de n'importe
quel problème, et incitant les partis politiques à se poser avant
tout en gestionnaires potentiels d'un État réputé omnipotent.
La centralisation étatique a pour pendant, en France, une défor-
mation étatiste de l'idéologie et de la vie politiques à tous les
niveaux de la société. La conquête de l'appareil d'État y passe
pour la condition suffisante de toute transformation sociale et
politique. Les mobilisations populaires y sont considérées soit
comme des protestations sollicitant l'intervention du pouvoir
central en faveur des catégories défavorisées (« Pompidou, nos
sous ! »), soit, dans le meilleur des cas, comme une masse de
manœuvre devant permettre aux partis d'opposition de mieux
faire valoir leur prétention à diriger l'État.
Il faudrait une étude spéciale pour montrer comment la centra-
lisation administrative et politique du pouvoir a pesé sur la vie
politique, en France, incitant les mouvements populaires à
réclamer du pouvoir central la solution de tout et de n'importe
quel problème, et incitant les partis politiques à se poser avant
tout en gestionnaires potentiels d'un État réputé omnipotent.
La centralisation étatique a pour pendant, en France, une défor-
mation étatiste de l'idéologie et de la vie politiques à tous les
niveaux de la société. La conquête de l'appareil d'État y passe
pour la condition suffisante de toute transformation sociale et
politique. Les mobilisations populaires y sont considérées soit
comme des protestations sollicitant l'intervention du pouvoir
central en faveur des catégories défavorisées (« Pompidou, nos
sous ! »), soit, dans le meilleur des cas, comme une masse de
manœuvre devant permettre aux partis d'opposition de mieux
faire valoir leur prétention à diriger l'État.
Cette idéologie centraliste et étatiste est l'un des principaux
obstacles à la naissance et à la diffusion d'une idéologie révolu-
tionnaire : elle assigne à l'action de masse une place subordonnée,
s'oppose à l'éducation et à l'émancipation des travailleurs par
l'auto-détermination des méthodes et des objectifs de lutte et
par la vie démocratique à la base. La faiblesse des partis poli-
tiques français, leurs rapports de clientèle avec l'électorat, le
poids de leurs notables et de leurs bureaucraties centrales s'ex-
pliquent en grande partie par là, de même que la permanence
des structures et de la mentalité staliniennes du P.C.F.
obstacles à la naissance et à la diffusion d'une idéologie révolu-
tionnaire : elle assigne à l'action de masse une place subordonnée,
s'oppose à l'éducation et à l'émancipation des travailleurs par
l'auto-détermination des méthodes et des objectifs de lutte et
par la vie démocratique à la base. La faiblesse des partis poli-
tiques français, leurs rapports de clientèle avec l'électorat, le
poids de leurs notables et de leurs bureaucraties centrales s'ex-
pliquent en grande partie par là, de même que la permanence
des structures et de la mentalité staliniennes du P.C.F.
Toutefois, la déformation centralisatrice et bureaucratique,
si elle y est plus accentuée, n'est point particulière aux partis
français. Le renforcement du pouvoir central, l'érosion des centres
de pouvoir périphériques et des institutions autonomes et locales,
sont bel et bien inhérents à la domination du capital monopo-
liste. Il est donc logique que tous les partis qui se donnent pour
vocation de gérer l'appareil d'État et la société capitaliste modernes,
mais non de les changer, calquent leur structure sur celle de l'État
tel qu'il est. En revanche, un parti révolutionnaire se définit
par l'aptitude à critiquer par la théorie et la pratique la nature
si elle y est plus accentuée, n'est point particulière aux partis
français. Le renforcement du pouvoir central, l'érosion des centres
de pouvoir périphériques et des institutions autonomes et locales,
sont bel et bien inhérents à la domination du capital monopo-
liste. Il est donc logique que tous les partis qui se donnent pour
vocation de gérer l'appareil d'État et la société capitaliste modernes,
mais non de les changer, calquent leur structure sur celle de l'État
tel qu'il est. En revanche, un parti révolutionnaire se définit
par l'aptitude à critiquer par la théorie et la pratique la nature
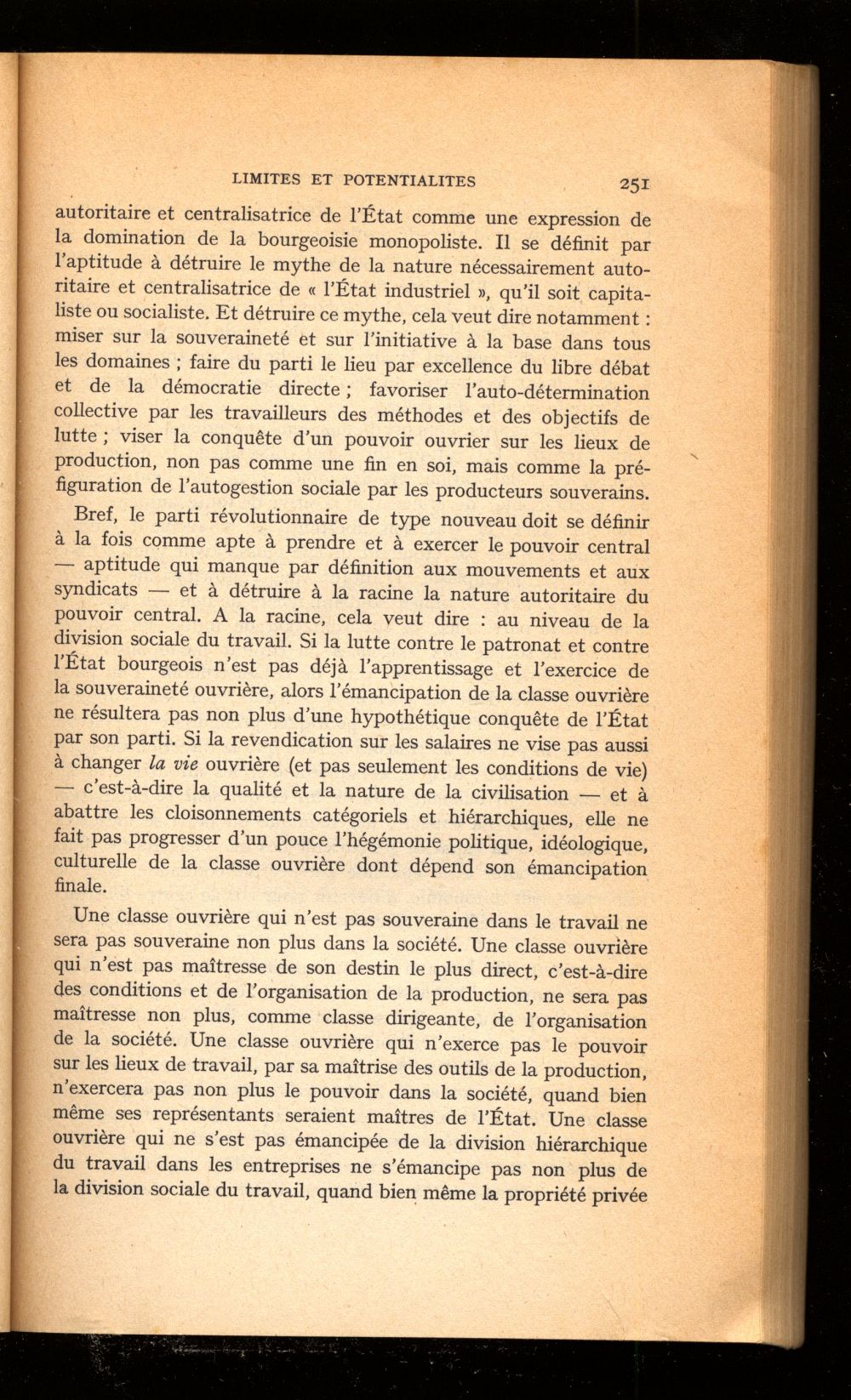

LIMITES ET POTENTIALITES
251
autoritaire et centralisatrice de l'État comme une expression de
la domination de la bourgeoisie monopoliste. Il se définit par
l'aptitude à détruire le mythe de la nature nécessairement auto-
ritaire et centralisatrice de « l'État industriel », qu'il soit capita-
liste ou socialiste. Et détruire ce mythe, cela veut dire notamment :
miser sur la souveraineté et sur l'initiative à la base dans tous
les domaines ; faire du parti le lieu par excellence du libre débat
et de la démocratie directe ; favoriser l'auto-détermination
collective par les travailleurs des méthodes et des objectifs de
lutte ; viser la conquête d'un pouvoir ouvrier sur les lieux de
production, non pas comme une fin en soi, mais comme la pré-
figuration de l'autogestion sociale par les producteurs souverains.
Bref, le parti révolutionnaire de type nouveau doit se définir
à la fois comme apte à prendre et à exercer le pouvoir central
la domination de la bourgeoisie monopoliste. Il se définit par
l'aptitude à détruire le mythe de la nature nécessairement auto-
ritaire et centralisatrice de « l'État industriel », qu'il soit capita-
liste ou socialiste. Et détruire ce mythe, cela veut dire notamment :
miser sur la souveraineté et sur l'initiative à la base dans tous
les domaines ; faire du parti le lieu par excellence du libre débat
et de la démocratie directe ; favoriser l'auto-détermination
collective par les travailleurs des méthodes et des objectifs de
lutte ; viser la conquête d'un pouvoir ouvrier sur les lieux de
production, non pas comme une fin en soi, mais comme la pré-
figuration de l'autogestion sociale par les producteurs souverains.
Bref, le parti révolutionnaire de type nouveau doit se définir
à la fois comme apte à prendre et à exercer le pouvoir central
— aptitude qui manque par définition aux mouvements et aux
syndicats — et à détruire à la racine la nature autoritaire du
pouvoir central. A la racine, cela veut dire : au niveau de la
division sociale du travail. Si la lutte contre le patronat et contre
l'État bourgeois n'est pas déjà l'apprentissage et l'exercice de
la souveraineté ouvrière, alors l'émancipation de la classe ouvrière
ne résultera pas non plus d'une hypothétique conquête de l'État
par son parti. Si la revendication sur les salaires ne vise pas aussi
à changer la vie ouvrière (et pas seulement les conditions de vie)
syndicats — et à détruire à la racine la nature autoritaire du
pouvoir central. A la racine, cela veut dire : au niveau de la
division sociale du travail. Si la lutte contre le patronat et contre
l'État bourgeois n'est pas déjà l'apprentissage et l'exercice de
la souveraineté ouvrière, alors l'émancipation de la classe ouvrière
ne résultera pas non plus d'une hypothétique conquête de l'État
par son parti. Si la revendication sur les salaires ne vise pas aussi
à changer la vie ouvrière (et pas seulement les conditions de vie)
— c'est-à-dire la qualité et la nature de la civilisation — et à
abattre les cloisonnements catégoriels et hiérarchiques, elle ne
fait pas progresser d'un pouce l'hégémonie politique, idéologique,
culturelle de la classe ouvrière dont dépend son émancipation
finale.
abattre les cloisonnements catégoriels et hiérarchiques, elle ne
fait pas progresser d'un pouce l'hégémonie politique, idéologique,
culturelle de la classe ouvrière dont dépend son émancipation
finale.
Une classe ouvrière qui n'est pas souveraine dans le travail ne
sera pas souveraine non plus dans la société. Une classe ouvrière
qui n'est pas maîtresse de son destin le plus direct, c'est-à-dire
des conditions et de l'organisation de la production, ne sera pas
maîtresse non plus, comme classe dirigeante, de l'organisation
de la société. Une classe ouvrière qui n'exerce pas le pouvoir
sur les lieux de travail, par sa maîtrise des outils de la production,
n'exercera pas non plus le pouvoir dans la société, quand bien
même ses représentants seraient maîtres de l'État. Une classe
ouvrière qui ne s'est pas émancipée de la division hiérarchique
du travail dans les entreprises ne s'émancipe pas non plus de
la division sociale du travail, quand bien même la propriété privée
sera pas souveraine non plus dans la société. Une classe ouvrière
qui n'est pas maîtresse de son destin le plus direct, c'est-à-dire
des conditions et de l'organisation de la production, ne sera pas
maîtresse non plus, comme classe dirigeante, de l'organisation
de la société. Une classe ouvrière qui n'exerce pas le pouvoir
sur les lieux de travail, par sa maîtrise des outils de la production,
n'exercera pas non plus le pouvoir dans la société, quand bien
même ses représentants seraient maîtres de l'État. Une classe
ouvrière qui ne s'est pas émancipée de la division hiérarchique
du travail dans les entreprises ne s'émancipe pas non plus de
la division sociale du travail, quand bien même la propriété privée
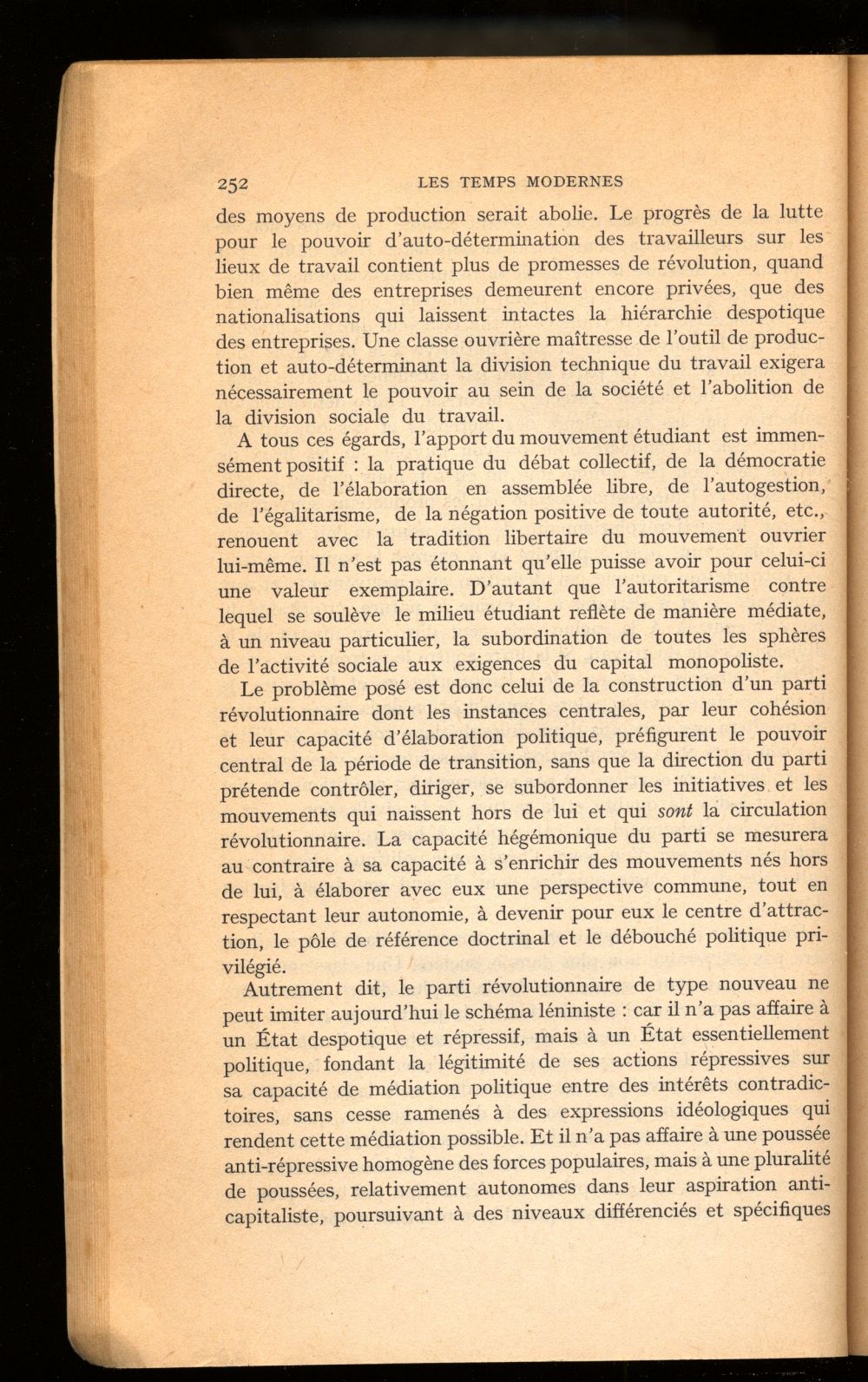

252
LES TEMPS MODERNES
des moyens de production serait abolie. Le progrès de la lutte
pour le pouvoir d'auto-détermination des travailleurs sur les
lieux de travail contient plus de promesses de révolution, quand
bien même des entreprises demeurent encore privées, que des
nationalisations qui laissent intactes la hiérarchie despotique
des entreprises. Une classe ouvrière maîtresse de l'outil de produc-
tion et auto-déterminant la division technique du travail exigera
nécessairement le pouvoir au sein de la société et l'abolition de
la division sociale du travail.
pour le pouvoir d'auto-détermination des travailleurs sur les
lieux de travail contient plus de promesses de révolution, quand
bien même des entreprises demeurent encore privées, que des
nationalisations qui laissent intactes la hiérarchie despotique
des entreprises. Une classe ouvrière maîtresse de l'outil de produc-
tion et auto-déterminant la division technique du travail exigera
nécessairement le pouvoir au sein de la société et l'abolition de
la division sociale du travail.
A tous ces égards, l'apport du mouvement étudiant est immen-
sément positif : la pratique du débat collectif, de la démocratie
directe, de l'élaboration en assemblée libre, de l'autogestion,
de l'égalitarisme, de la négation positive de toute autorité, etc.,
renouent avec la tradition libertaire du mouvement ouvrier
lui-même. Il n'est pas étonnant qu'elle puisse avoir pour celui-ci
une valeur exemplaire. D'autant que l'autoritarisme contre
lequel se soulève le milieu étudiant reflète de manière médiate,
à un niveau particulier, la subordination de toutes les sphères
de l'activité sociale aux exigences du capital monopoliste.
sément positif : la pratique du débat collectif, de la démocratie
directe, de l'élaboration en assemblée libre, de l'autogestion,
de l'égalitarisme, de la négation positive de toute autorité, etc.,
renouent avec la tradition libertaire du mouvement ouvrier
lui-même. Il n'est pas étonnant qu'elle puisse avoir pour celui-ci
une valeur exemplaire. D'autant que l'autoritarisme contre
lequel se soulève le milieu étudiant reflète de manière médiate,
à un niveau particulier, la subordination de toutes les sphères
de l'activité sociale aux exigences du capital monopoliste.
Le problème posé est donc celui de la construction d'un parti
révolutionnaire dont les instances centrales, par leur cohésion
et leur capacité d'élaboration politique, préfigurent le pouvoir
central de la période de transition, sans que la direction du parti
prétende contrôler, diriger, se subordonner les initiatives et les
mouvements qui naissent hors de lui et qui sont la circulation
révolutionnaire. La capacité hégémonique du parti se mesurera
au contraire à sa capacité à s'enrichir des mouvements nés hors
de lui, à élaborer avec eux une perspective commune, tout en
respectant leur autonomie, à devenir pour eux le centre d'attrac-
tion, le pôle de référence doctrinal et le débouché politique pri-
vilégié.
révolutionnaire dont les instances centrales, par leur cohésion
et leur capacité d'élaboration politique, préfigurent le pouvoir
central de la période de transition, sans que la direction du parti
prétende contrôler, diriger, se subordonner les initiatives et les
mouvements qui naissent hors de lui et qui sont la circulation
révolutionnaire. La capacité hégémonique du parti se mesurera
au contraire à sa capacité à s'enrichir des mouvements nés hors
de lui, à élaborer avec eux une perspective commune, tout en
respectant leur autonomie, à devenir pour eux le centre d'attrac-
tion, le pôle de référence doctrinal et le débouché politique pri-
vilégié.
Autrement dit, le parti révolutionnaire de type nouveau ne
peut imiter aujourd'hui le schéma léniniste : car il n'a pas affaire à
un État despotique et répressif, mais à un État essentiellement
politique, fondant la légitimité de ses actions répressives sur
sa capacité de médiation politique entre des intérêts contradic-
toires, sans cesse ramenés à des expressions idéologiques qui
rendent cette médiation possible. Et il n'a pas affaire à une poussée
anti-répressive homogène des forces populaires, mais à une pluralité
de poussées, relativement autonomes dans leur aspiration anti-
capitaliste, poursuivant à des niveaux différenciés et spécifiques
peut imiter aujourd'hui le schéma léniniste : car il n'a pas affaire à
un État despotique et répressif, mais à un État essentiellement
politique, fondant la légitimité de ses actions répressives sur
sa capacité de médiation politique entre des intérêts contradic-
toires, sans cesse ramenés à des expressions idéologiques qui
rendent cette médiation possible. Et il n'a pas affaire à une poussée
anti-répressive homogène des forces populaires, mais à une pluralité
de poussées, relativement autonomes dans leur aspiration anti-
capitaliste, poursuivant à des niveaux différenciés et spécifiques
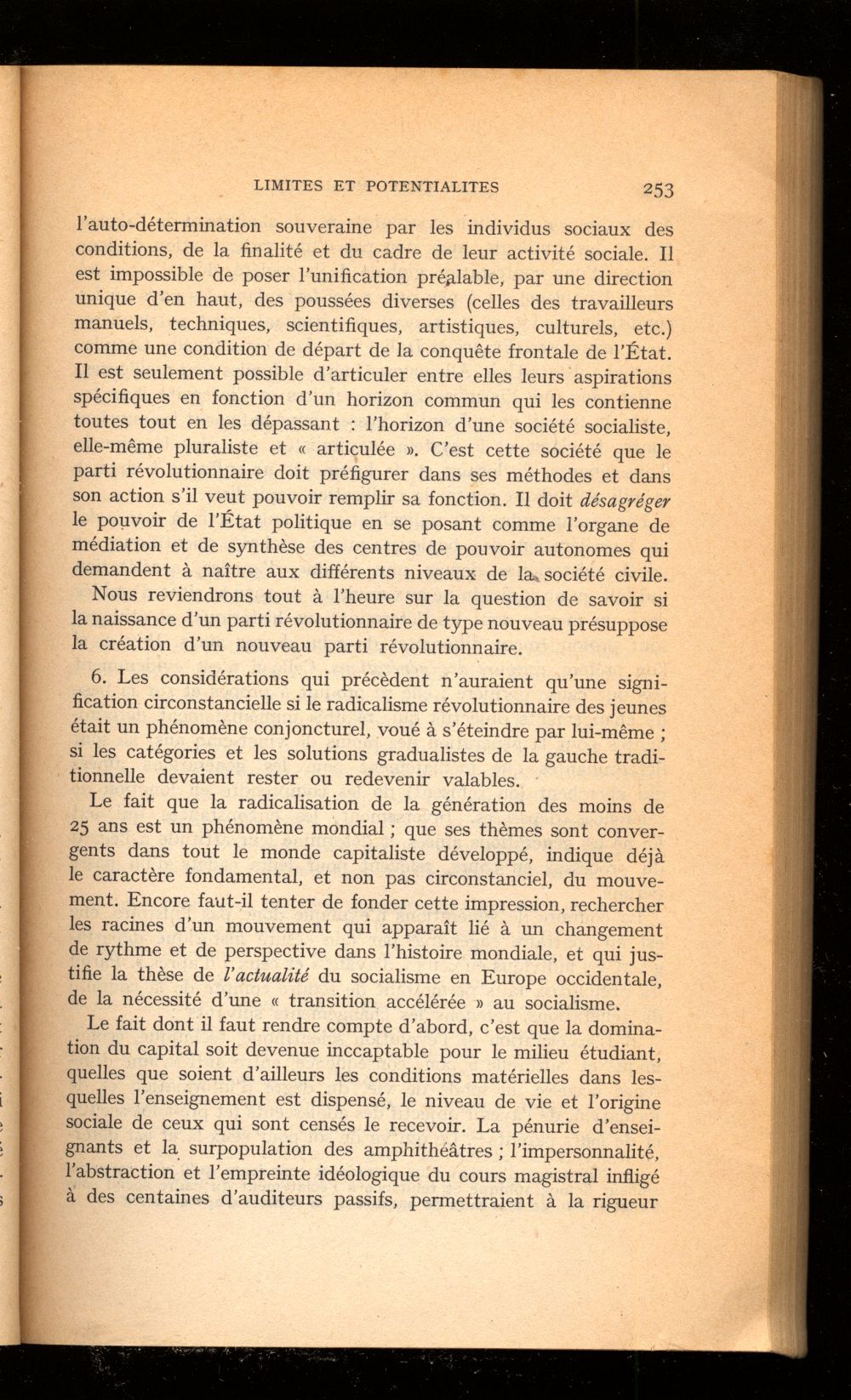

LIMITES ET POTENTIALITES
253
l'auto-détermination souveraine par les individus sociaux des
conditions, de la finalité et du cadre de leur activité sociale. Il
est impossible de poser l'unification préalable, par une direction
unique d'en haut, des poussées diverses (celles des travailleurs
manuels, techniques, scientifiques, artistiques, culturels, etc.)
comme une condition de départ de la conquête frontale de l'État.
Il est seulement possible d'articuler entre elles leurs aspirations
spécifiques en fonction d'un horizon commun qui les contienne
toutes tout en les dépassant : l'horizon d'une société socialiste,
elle-même pluraliste et « articulée ». C'est cette société que le
parti révolutionnaire doit préfigurer dans ses méthodes et dans
son action s'il veut pouvoir remplir sa fonction. Il doit désagréger
le pouvoir de l'État politique en se posant comme l'organe de
médiation et de synthèse des centres de pouvoir autonomes qui
demandent à naître aux différents niveaux de la, société civile.
Nous reviendrons tout à l'heure sur la question de savoir si
la naissance d'un parti révolutionnaire de type nouveau présuppose
la création d'un nouveau parti révolutionnaire.
conditions, de la finalité et du cadre de leur activité sociale. Il
est impossible de poser l'unification préalable, par une direction
unique d'en haut, des poussées diverses (celles des travailleurs
manuels, techniques, scientifiques, artistiques, culturels, etc.)
comme une condition de départ de la conquête frontale de l'État.
Il est seulement possible d'articuler entre elles leurs aspirations
spécifiques en fonction d'un horizon commun qui les contienne
toutes tout en les dépassant : l'horizon d'une société socialiste,
elle-même pluraliste et « articulée ». C'est cette société que le
parti révolutionnaire doit préfigurer dans ses méthodes et dans
son action s'il veut pouvoir remplir sa fonction. Il doit désagréger
le pouvoir de l'État politique en se posant comme l'organe de
médiation et de synthèse des centres de pouvoir autonomes qui
demandent à naître aux différents niveaux de la, société civile.
Nous reviendrons tout à l'heure sur la question de savoir si
la naissance d'un parti révolutionnaire de type nouveau présuppose
la création d'un nouveau parti révolutionnaire.
6. Les considérations qui précèdent n'auraient qu'une signi-
fication circonstancielle si le radicalisme révolutionnaire des jeunes
était un phénomène conjoncturel, voué à s'éteindre par lui-même ;
si les catégories et les solutions gradualistes de la gauche tradi-
tionnelle devaient rester ou redevenir valables.
fication circonstancielle si le radicalisme révolutionnaire des jeunes
était un phénomène conjoncturel, voué à s'éteindre par lui-même ;
si les catégories et les solutions gradualistes de la gauche tradi-
tionnelle devaient rester ou redevenir valables.
Le fait que la radicalisation de la génération des moins de
25 ans est un phénomène mondial ; que ses thèmes sont conver-
gents dans tout le monde capitaliste développé, indique déjà
le caractère fondamental, et non pas circonstanciel, du mouve-
ment. Encore faut-il tenter de fonder cette impression, rechercher
les racines d'un mouvement qui apparaît lié à un changement
de rythme et de perspective dans l'histoire mondiale, et qui jus-
tifie la thèse de l'actualité du socialisme en Europe occidentale,
de la nécessité d'une « transition accélérée » au socialisme.
25 ans est un phénomène mondial ; que ses thèmes sont conver-
gents dans tout le monde capitaliste développé, indique déjà
le caractère fondamental, et non pas circonstanciel, du mouve-
ment. Encore faut-il tenter de fonder cette impression, rechercher
les racines d'un mouvement qui apparaît lié à un changement
de rythme et de perspective dans l'histoire mondiale, et qui jus-
tifie la thèse de l'actualité du socialisme en Europe occidentale,
de la nécessité d'une « transition accélérée » au socialisme.
Le fait dont il faut rendre compte d'abord, c'est que la domina-
tion du capital soit devenue inccaptable pour le milieu étudiant,
quelles que soient d'ailleurs les conditions matérielles dans les-
quelles l'enseignement est dispensé, le niveau de vie et l'origine
sociale de ceux qui sont censés le recevoir. La pénurie d'ensei-
gnants et la surpopulation des amphithéâtres ; l'impersonnalité,
l'abstraction et l'empreinte idéologique du cours magistral infligé
à des centaines d'auditeurs passifs, permettraient à la rigueur
tion du capital soit devenue inccaptable pour le milieu étudiant,
quelles que soient d'ailleurs les conditions matérielles dans les-
quelles l'enseignement est dispensé, le niveau de vie et l'origine
sociale de ceux qui sont censés le recevoir. La pénurie d'ensei-
gnants et la surpopulation des amphithéâtres ; l'impersonnalité,
l'abstraction et l'empreinte idéologique du cours magistral infligé
à des centaines d'auditeurs passifs, permettraient à la rigueur
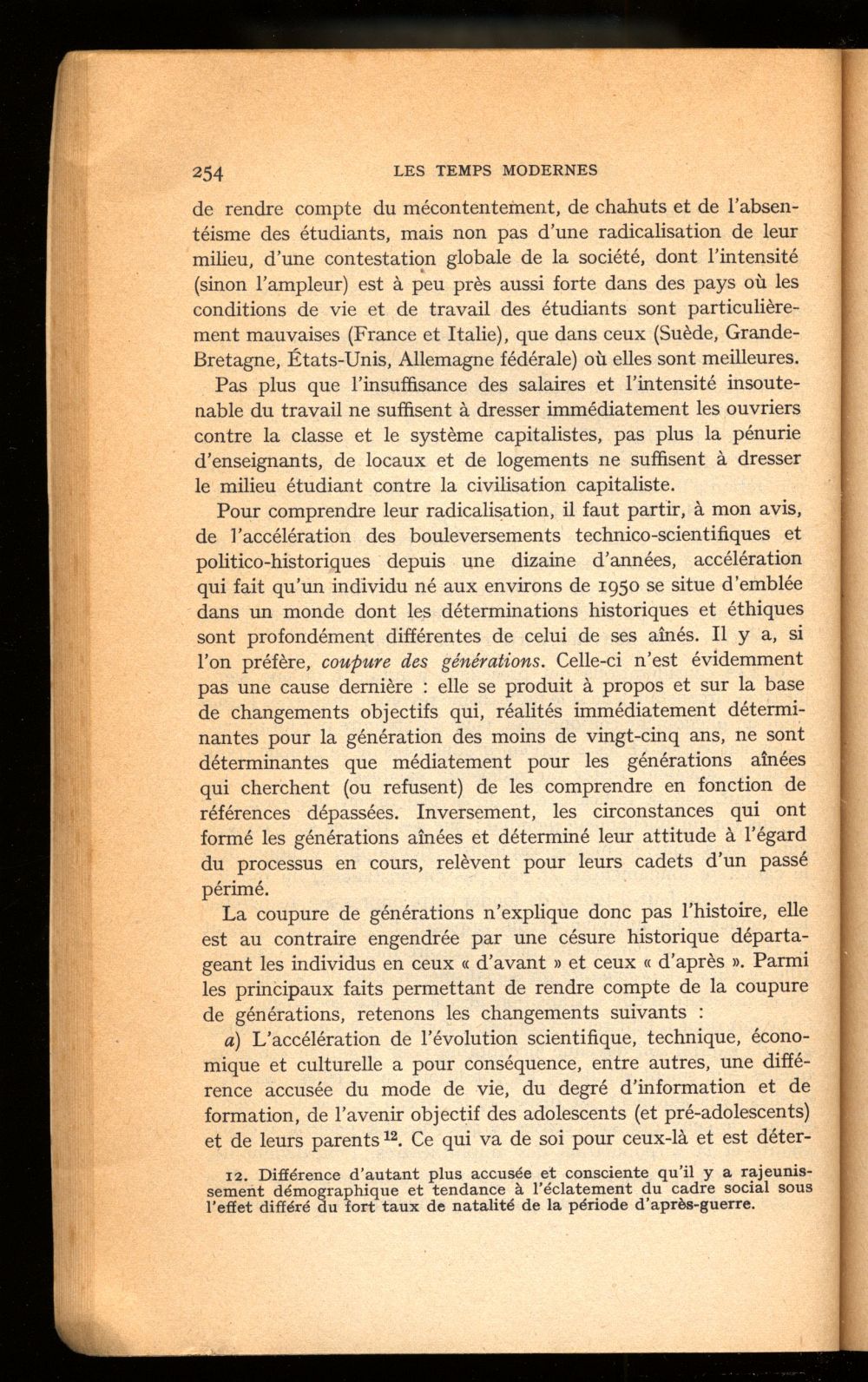

254
LES TEMPS MODERNES
de rendre compte du mécontentement, de chahuts et de l'absen-
téisme des étudiants, mais non pas d'une radicalisation de leur
milieu, d'une contestation globale de la société, dont l'intensité
(sinon l'ampleur) est à peu près aussi forte dans des pays où les
conditions de vie et de travail des étudiants sont particulière-
ment mauvaises (France et Italie), que dans ceux (Suède, Grande-
Bretagne, États-Unis, Allemagne fédérale) où elles sont meilleures.
téisme des étudiants, mais non pas d'une radicalisation de leur
milieu, d'une contestation globale de la société, dont l'intensité
(sinon l'ampleur) est à peu près aussi forte dans des pays où les
conditions de vie et de travail des étudiants sont particulière-
ment mauvaises (France et Italie), que dans ceux (Suède, Grande-
Bretagne, États-Unis, Allemagne fédérale) où elles sont meilleures.
Pas plus que l'insuffisance des salaires et l'intensité insoute-
nable du travail ne suffisent à dresser immédiatement les ouvriers
contre la classe et le système capitalistes, pas plus la pénurie
d'enseignants, de locaux et de logements ne suffisent à dresser
le milieu étudiant contre la civilisation capitaliste.
nable du travail ne suffisent à dresser immédiatement les ouvriers
contre la classe et le système capitalistes, pas plus la pénurie
d'enseignants, de locaux et de logements ne suffisent à dresser
le milieu étudiant contre la civilisation capitaliste.
Pour comprendre leur radicalisation, il faut partir, à mon avis,
de l'accélération des bouleversements technico-scientinques et
politico-historiques depuis une dizaine d'années, accélération
qui fait qu'un individu né aux environs de 1950 se situe d'emblée
dans un monde dont les déterminations historiques et éthiques
sont profondément différentes de celui de ses aînés. Il y a, si
l'on préfère, coupure des générations. Celle-ci n'est évidemment
pas une cause dernière : elle se produit à propos et sur la base
de changements objectifs qui, réalités immédiatement détermi-
nantes pour la génération des moins de vingt-cinq ans, ne sont
déterminantes que médiatement pour les générations aînées
qui cherchent (ou refusent) de les comprendre en fonction de
références dépassées. Inversement, les circonstances qui ont
formé les générations aînées et déterminé leur attitude à l'égard
du processus en cours, relèvent pour leurs cadets d'un passé
périmé.
de l'accélération des bouleversements technico-scientinques et
politico-historiques depuis une dizaine d'années, accélération
qui fait qu'un individu né aux environs de 1950 se situe d'emblée
dans un monde dont les déterminations historiques et éthiques
sont profondément différentes de celui de ses aînés. Il y a, si
l'on préfère, coupure des générations. Celle-ci n'est évidemment
pas une cause dernière : elle se produit à propos et sur la base
de changements objectifs qui, réalités immédiatement détermi-
nantes pour la génération des moins de vingt-cinq ans, ne sont
déterminantes que médiatement pour les générations aînées
qui cherchent (ou refusent) de les comprendre en fonction de
références dépassées. Inversement, les circonstances qui ont
formé les générations aînées et déterminé leur attitude à l'égard
du processus en cours, relèvent pour leurs cadets d'un passé
périmé.
La coupure de générations n'explique donc pas l'histoire, elle
est au contraire engendrée par une césure historique départa-
geant les individus en ceux « d'avant » et ceux « d'après ». Parmi
les principaux faits permettant de rendre compte de la coupure
de générations, retenons les changements suivants :
est au contraire engendrée par une césure historique départa-
geant les individus en ceux « d'avant » et ceux « d'après ». Parmi
les principaux faits permettant de rendre compte de la coupure
de générations, retenons les changements suivants :
a) L'accélération de l'évolution scientifique, technique, écono-
mique et culturelle a pour conséquence, entre autres, une diffé-
rence accusée du mode de vie, du degré d'information et de
formation, de l'avenir objectif des adolescents (et pré-adolescents)
et de leurs parents12. Ce qui va de soi pour ceux-là et est déter-
mique et culturelle a pour conséquence, entre autres, une diffé-
rence accusée du mode de vie, du degré d'information et de
formation, de l'avenir objectif des adolescents (et pré-adolescents)
et de leurs parents12. Ce qui va de soi pour ceux-là et est déter-
12. Différence d'autant plus accusée et consciente qu'il y a rajeunis-
sement démographique et tendance à l'éclatement du cadre social sous
l'effet différé du fort taux de natalité de la période d'après-guerre.
sement démographique et tendance à l'éclatement du cadre social sous
l'effet différé du fort taux de natalité de la période d'après-guerre.
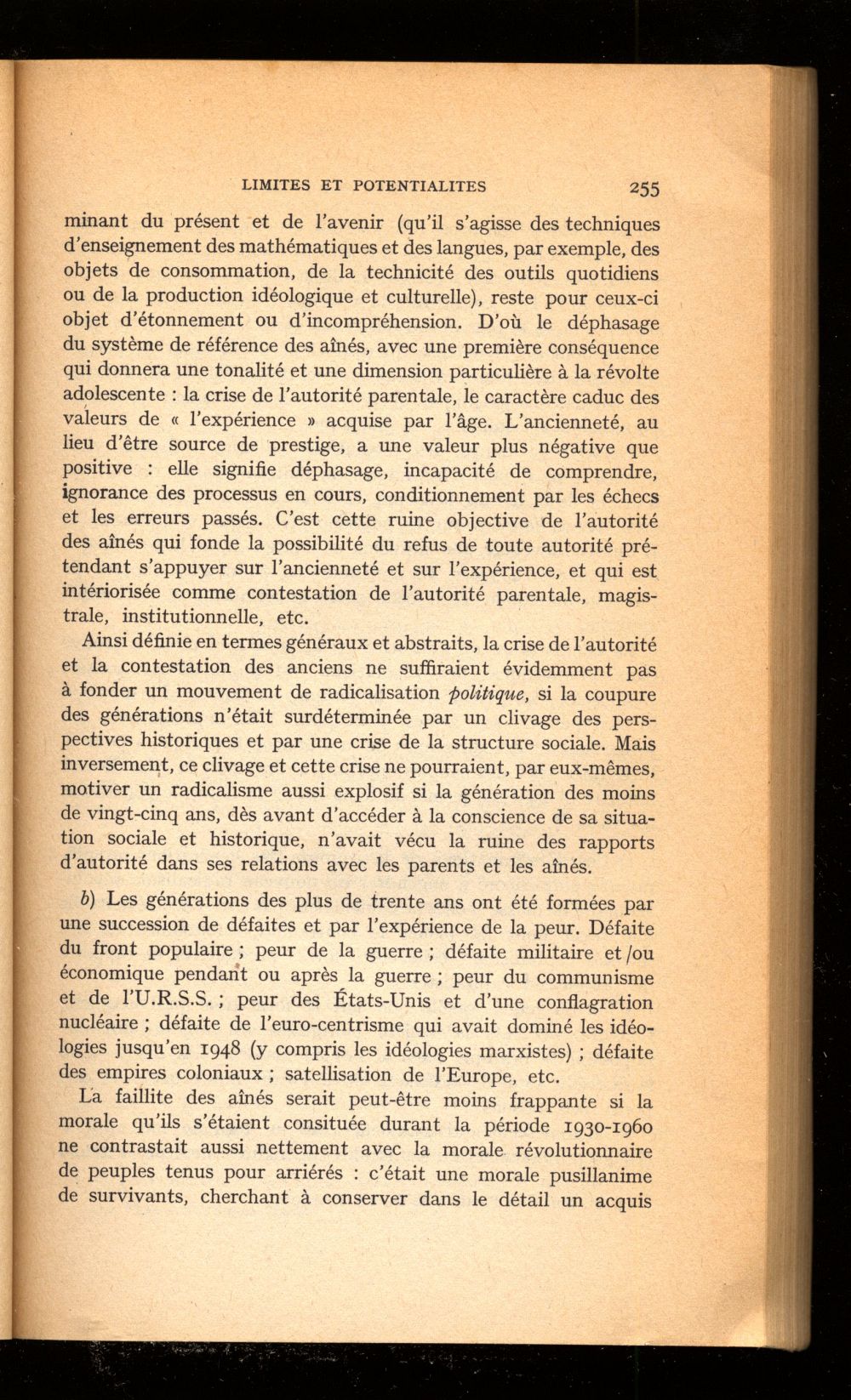

LIMITES ET POTENTIALITES
255
minant du présent et de l'avenir (qu'il s'agisse des techniques
d'enseignement des mathématiques et des langues, par exemple, des
objets de consommation, de la technicité des outils quotidiens
ou de la production idéologique et culturelle), reste pour ceux-ci
objet d'étonnement ou d'incompréhension. D'où le déphasage
du système de référence des aînés, avec une première conséquence
qui donnera une tonalité et une dimension particulière à la révolte
adolescente : la crise de l'autorité parentale, le caractère caduc des
valeurs de « l'expérience » acquise par l'âge. L'ancienneté, au
lieu d'être source de prestige, a une valeur plus négative que
positive : elle signifie déphasage, incapacité de comprendre,
ignorance des processus en cours, conditionnement par les échecs
et les erreurs passés. C'est cette ruine objective de l'autorité
des aînés qui fonde la possibilité du refus de toute autorité pré-
tendant s'appuyer sur l'ancienneté et sur l'expérience, et qui est
intériorisée comme contestation de l'autorité parentale, magis-
trale, institutionnelle, etc.
d'enseignement des mathématiques et des langues, par exemple, des
objets de consommation, de la technicité des outils quotidiens
ou de la production idéologique et culturelle), reste pour ceux-ci
objet d'étonnement ou d'incompréhension. D'où le déphasage
du système de référence des aînés, avec une première conséquence
qui donnera une tonalité et une dimension particulière à la révolte
adolescente : la crise de l'autorité parentale, le caractère caduc des
valeurs de « l'expérience » acquise par l'âge. L'ancienneté, au
lieu d'être source de prestige, a une valeur plus négative que
positive : elle signifie déphasage, incapacité de comprendre,
ignorance des processus en cours, conditionnement par les échecs
et les erreurs passés. C'est cette ruine objective de l'autorité
des aînés qui fonde la possibilité du refus de toute autorité pré-
tendant s'appuyer sur l'ancienneté et sur l'expérience, et qui est
intériorisée comme contestation de l'autorité parentale, magis-
trale, institutionnelle, etc.
Ainsi définie en termes généraux et abstraits, la crise de l'autorité
et la contestation des anciens ne suffiraient évidemment pas
à fonder un mouvement de radicalisation politique, si la coupure
des générations n'était surdéterminée par un clivage des pers-
pectives historiques et par une crise de la structure sociale. Mais
inversement, ce clivage et cette crise ne pourraient, par eux-mêmes,
motiver un radicalisme aussi explosif si la génération des moins
de vingt-cinq ans, dès avant d'accéder à la conscience de sa situa-
tion sociale et historique, n'avait vécu la ruine des rapports
d'autorité dans ses relations avec les parents et les aînés.
et la contestation des anciens ne suffiraient évidemment pas
à fonder un mouvement de radicalisation politique, si la coupure
des générations n'était surdéterminée par un clivage des pers-
pectives historiques et par une crise de la structure sociale. Mais
inversement, ce clivage et cette crise ne pourraient, par eux-mêmes,
motiver un radicalisme aussi explosif si la génération des moins
de vingt-cinq ans, dès avant d'accéder à la conscience de sa situa-
tion sociale et historique, n'avait vécu la ruine des rapports
d'autorité dans ses relations avec les parents et les aînés.
b) Les générations des plus de trente ans ont été formées par
une succession de défaites et par l'expérience de la peur. Défaite
du front populaire ; peur de la guerre ; défaite militaire et /ou
économique pendant ou après la guerre ; peur du communisme
et de l'U.R.S.S. ; peur des États-Unis et d'une conflagration
nucléaire ; défaite de l'euro-centrisme qui avait dominé les idéo-
logies jusqu'en 1948 (y compris les idéologies marxistes) ; défaite
des empires coloniaux ; satellisation de l'Europe, etc.
une succession de défaites et par l'expérience de la peur. Défaite
du front populaire ; peur de la guerre ; défaite militaire et /ou
économique pendant ou après la guerre ; peur du communisme
et de l'U.R.S.S. ; peur des États-Unis et d'une conflagration
nucléaire ; défaite de l'euro-centrisme qui avait dominé les idéo-
logies jusqu'en 1948 (y compris les idéologies marxistes) ; défaite
des empires coloniaux ; satellisation de l'Europe, etc.
La faillite des aînés serait peut-être moins frappante si la
morale qu'ils s'étaient consituée durant la période 1930-1960
ne contrastait aussi nettement avec la morale révolutionnaire
de peuples tenus pour arriérés : c'était une morale pusillanime
de survivants, cherchant à conserver dans le détail un acquis
morale qu'ils s'étaient consituée durant la période 1930-1960
ne contrastait aussi nettement avec la morale révolutionnaire
de peuples tenus pour arriérés : c'était une morale pusillanime
de survivants, cherchant à conserver dans le détail un acquis
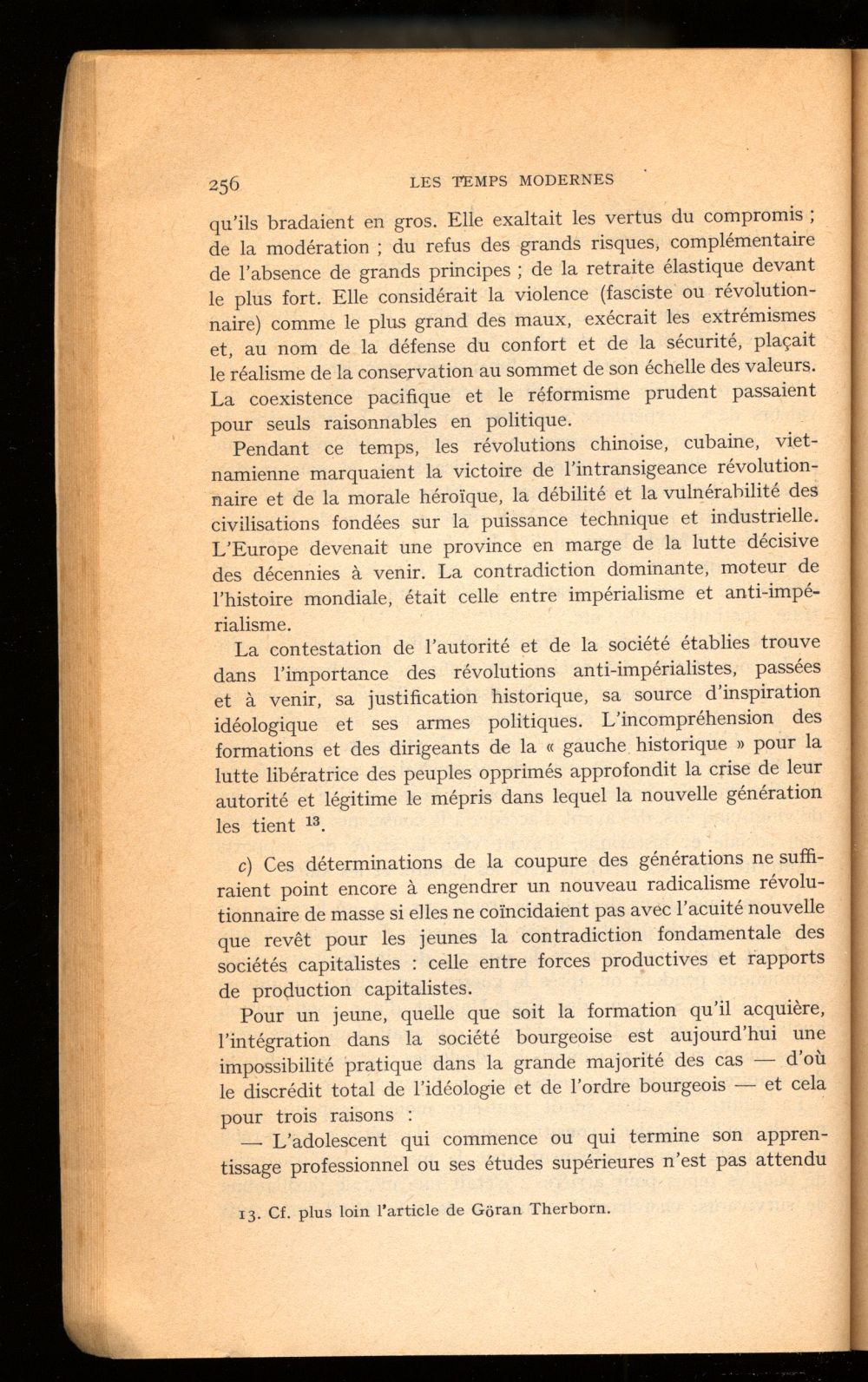

256
LES TÎÎMPS MODERNES
qu'ils bradaient en gros. Elle exaltait les vertus du compromis ;
de la modération ; du refus des grands risques, complémentaire
de l'absence de grands principes ; de la retraite élastique devant
le plus fort. Elle considérait la violence (fasciste ou révolution-
naire) comme le plus grand des maux, exécrait les extrémismes
et, au nom de la défense du confort et de la sécurité, plaçait
le réalisme de la conservation au sommet de son échelle des valeurs.
La coexistence pacifique et le réformisme prudent passaient
pour seuls raisonnables en politique.
de la modération ; du refus des grands risques, complémentaire
de l'absence de grands principes ; de la retraite élastique devant
le plus fort. Elle considérait la violence (fasciste ou révolution-
naire) comme le plus grand des maux, exécrait les extrémismes
et, au nom de la défense du confort et de la sécurité, plaçait
le réalisme de la conservation au sommet de son échelle des valeurs.
La coexistence pacifique et le réformisme prudent passaient
pour seuls raisonnables en politique.
Pendant ce temps, les révolutions chinoise, cubaine, viet-
namienne marquaient la victoire de l'intransigeance révolution-
naire et de la morale héroïque, la débilité et la vulnérabilité des
civilisations fondées sur la puissance technique et industrielle.
L'Europe devenait une province en marge de la lutte décisive
des décennies à venir. La contradiction dominante, moteur de
l'histoire mondiale, était celle entre impérialisme et anti-impé-
rialisme.
namienne marquaient la victoire de l'intransigeance révolution-
naire et de la morale héroïque, la débilité et la vulnérabilité des
civilisations fondées sur la puissance technique et industrielle.
L'Europe devenait une province en marge de la lutte décisive
des décennies à venir. La contradiction dominante, moteur de
l'histoire mondiale, était celle entre impérialisme et anti-impé-
rialisme.
La contestation de l'autorité et de la société établies trouve
dans l'importance des révolutions anti-impérialistes, passées
et à venir, sa justification historique, sa source d'inspiration
idéologique et ses armes politiques. L'incompréhension des
formations et des dirigeants de la « gauche historique » pour la
lutte libératrice des peuples opprimés approfondit la crise de leur
autorité et légitime le mépris dans lequel la nouvelle génération
les tient 13.
dans l'importance des révolutions anti-impérialistes, passées
et à venir, sa justification historique, sa source d'inspiration
idéologique et ses armes politiques. L'incompréhension des
formations et des dirigeants de la « gauche historique » pour la
lutte libératrice des peuples opprimés approfondit la crise de leur
autorité et légitime le mépris dans lequel la nouvelle génération
les tient 13.
c) Ces déterminations de la coupure des générations ne suffi-
raient point encore à engendrer un nouveau radicalisme révolu-
tionnaire de masse si elles ne coïncidaient pas avec l'acuité nouvelle
que revêt pour les jeunes la contradiction fondamentale des
sociétés capitalistes : celle entre forces productives et rapports
de production capitalistes.
raient point encore à engendrer un nouveau radicalisme révolu-
tionnaire de masse si elles ne coïncidaient pas avec l'acuité nouvelle
que revêt pour les jeunes la contradiction fondamentale des
sociétés capitalistes : celle entre forces productives et rapports
de production capitalistes.
Pour un jeune, quelle que soit la formation qu'il acquière,
l'intégration dans la société bourgeoise est aujourd'hui une
impossibilité pratique dans la grande majorité des cas — d'où
le discrédit total de l'idéologie et de l'ordre bourgeois — et cela
pour trois raisons :
l'intégration dans la société bourgeoise est aujourd'hui une
impossibilité pratique dans la grande majorité des cas — d'où
le discrédit total de l'idéologie et de l'ordre bourgeois — et cela
pour trois raisons :
— L'adolescent qui commence ou qui termine son appren-
tissage professionnel ou ses études supérieures n'est pas attendu
tissage professionnel ou ses études supérieures n'est pas attendu
13. Cf. plus loin l'article de Gjjran Therborn.
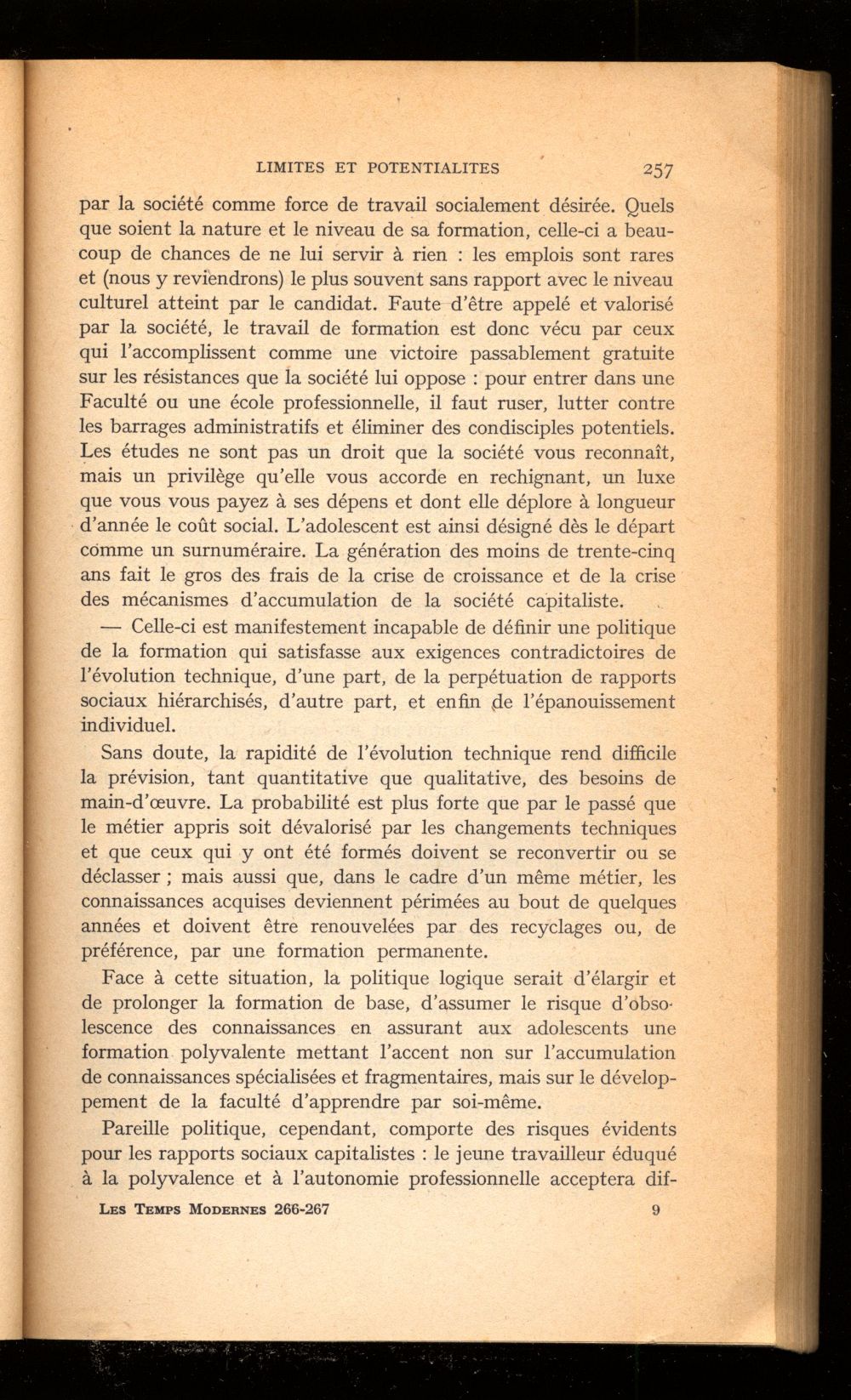

LIMITES ET POTENTIALITES
257
par la société comme force de travail socialement désirée. Quels
que soient la nature et le niveau de sa formation, celle-ci a beau-
coup de chances de ne lui servir à rien : les emplois sont rares
et (nous y reviendrons) le plus souvent sans rapport avec le niveau
culturel atteint par le candidat. Faute d'être appelé et valorisé
par la société, le travail de formation est donc vécu par ceux
qui l'accomplissent comme une victoire passablement gratuite
sur les résistances que la société lui oppose : pour entrer dans une
Faculté ou une école professionnelle, il faut ruser, lutter contre
les barrages administratifs et éliminer des condisciples potentiels.
Les études ne sont pas un droit que la société vous reconnaît,
mais un privilège qu'elle vous accorde en rechignant, un luxe
que vous vous payez à ses dépens et dont elle déplore à longueur
d'année le coût social. L'adolescent est ainsi désigné dès le départ
comme un surnuméraire. La génération des moins de trente-cinq
ans fait le gros des frais de la crise de croissance et de la crise
des mécanismes d'accumulation de la société capitaliste.
que soient la nature et le niveau de sa formation, celle-ci a beau-
coup de chances de ne lui servir à rien : les emplois sont rares
et (nous y reviendrons) le plus souvent sans rapport avec le niveau
culturel atteint par le candidat. Faute d'être appelé et valorisé
par la société, le travail de formation est donc vécu par ceux
qui l'accomplissent comme une victoire passablement gratuite
sur les résistances que la société lui oppose : pour entrer dans une
Faculté ou une école professionnelle, il faut ruser, lutter contre
les barrages administratifs et éliminer des condisciples potentiels.
Les études ne sont pas un droit que la société vous reconnaît,
mais un privilège qu'elle vous accorde en rechignant, un luxe
que vous vous payez à ses dépens et dont elle déplore à longueur
d'année le coût social. L'adolescent est ainsi désigné dès le départ
comme un surnuméraire. La génération des moins de trente-cinq
ans fait le gros des frais de la crise de croissance et de la crise
des mécanismes d'accumulation de la société capitaliste.
-— Celle-ci est manifestement incapable de définir une politique
de la formation qui satisfasse aux exigences contradictoires de
l'évolution technique, d'une part, de la perpétuation de rapports
sociaux hiérarchisés, d'autre part, et enfin de l'épanouissement
individuel.
de la formation qui satisfasse aux exigences contradictoires de
l'évolution technique, d'une part, de la perpétuation de rapports
sociaux hiérarchisés, d'autre part, et enfin de l'épanouissement
individuel.
Sans doute, la rapidité de l'évolution technique rend difficile
la prévision, tant quantitative que qualitative, des besoins de
main-d'œuvre. La probabilité est plus forte que par le passé que
le métier appris soit dévalorisé par les changements techniques
et que ceux qui y ont été formés doivent se reconvertir ou se
déclasser ; mais aussi que, dans le cadre d'un même métier, les
connaissances acquises deviennent périmées au bout de quelques
années et doivent être renouvelées par des recyclages ou, de
préférence, par une formation permanente.
la prévision, tant quantitative que qualitative, des besoins de
main-d'œuvre. La probabilité est plus forte que par le passé que
le métier appris soit dévalorisé par les changements techniques
et que ceux qui y ont été formés doivent se reconvertir ou se
déclasser ; mais aussi que, dans le cadre d'un même métier, les
connaissances acquises deviennent périmées au bout de quelques
années et doivent être renouvelées par des recyclages ou, de
préférence, par une formation permanente.
Face à cette situation, la politique logique serait d'élargir et
de prolonger la formation de base, d'assumer le risque d'obso-
lescence des connaissances en assurant aux adolescents une
formation polyvalente mettant l'accent non sur l'accumulation
de connaissances spécialisées et fragmentaires, mais sur le dévelop-
pement de la faculté d'apprendre par soi-même.
de prolonger la formation de base, d'assumer le risque d'obso-
lescence des connaissances en assurant aux adolescents une
formation polyvalente mettant l'accent non sur l'accumulation
de connaissances spécialisées et fragmentaires, mais sur le dévelop-
pement de la faculté d'apprendre par soi-même.
Pareille politique, cependant, comporte des risques évidents
pour les rapports sociaux capitalistes : le jeune travailleur éduqué
à la polyvalence et à l'autonomie professionnelle acceptera dif-
pour les rapports sociaux capitalistes : le jeune travailleur éduqué
à la polyvalence et à l'autonomie professionnelle acceptera dif-
LES TEMPS MODERNES 266-267 9
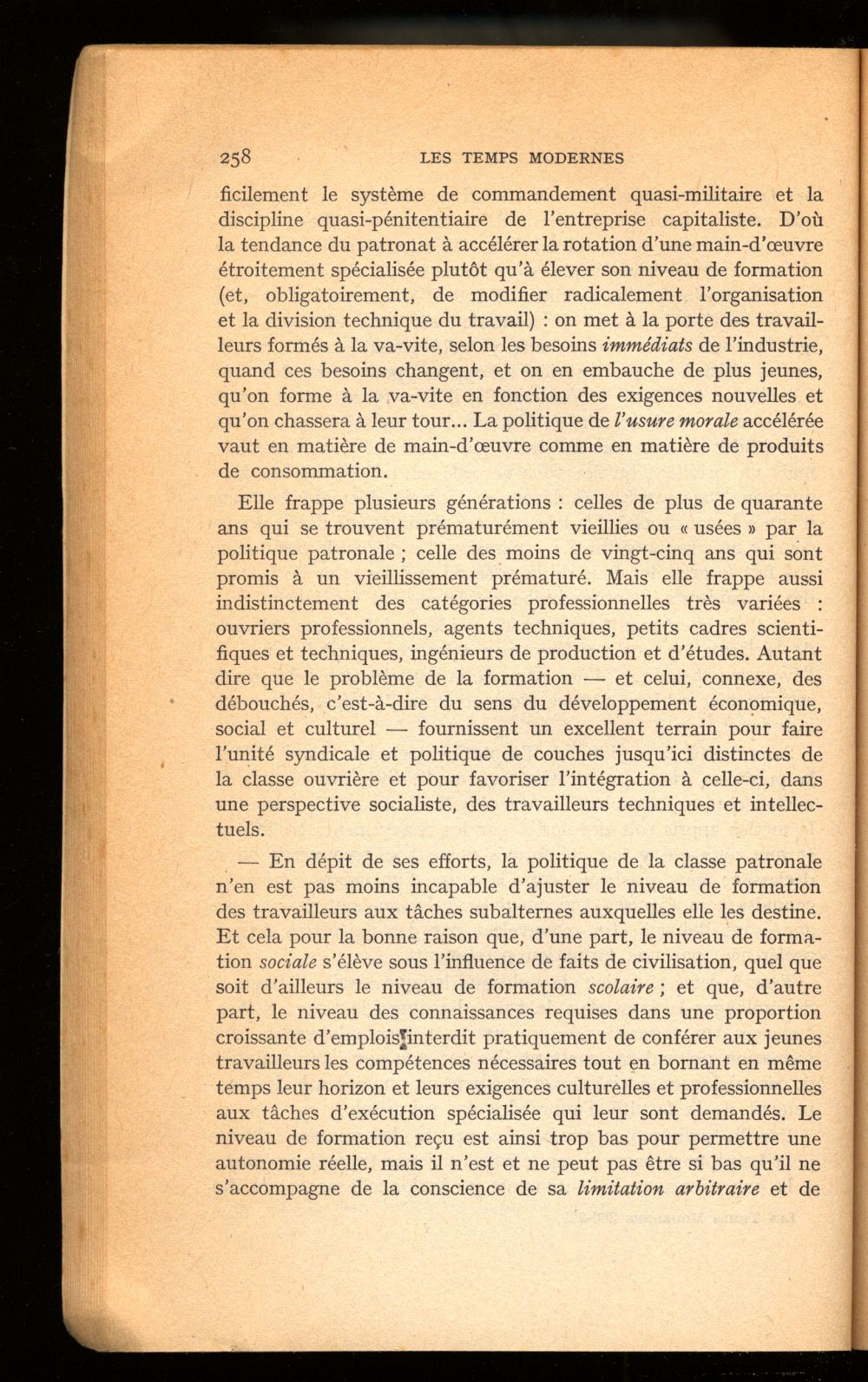

258 LES TEMPS MODERNES
ficilement le système de commandement quasi-militaire et la
discipline quasi-pénitentiaire de l'entreprise capitaliste. D'où
la tendance du patronat à accélérer la rotation d'une main-d'œuvre
étroitement spécialisée plutôt qu'à élever son niveau de formation
(et, obligatoirement, de modifier radicalement l'organisation
et la division technique du travail) : on met à la porte des travail-
leurs formés à la va-vite, selon les besoins immédiats de l'industrie,
quand ces besoins changent, et on en embauche de plus jeunes,
qu'on forme à la va-vite en fonction des exigences nouvelles et
qu'on chassera à leur tour... La politique de l'usure morale accélérée
vaut en matière de main-d'œuvre comme en matière de produits
de consommation.
discipline quasi-pénitentiaire de l'entreprise capitaliste. D'où
la tendance du patronat à accélérer la rotation d'une main-d'œuvre
étroitement spécialisée plutôt qu'à élever son niveau de formation
(et, obligatoirement, de modifier radicalement l'organisation
et la division technique du travail) : on met à la porte des travail-
leurs formés à la va-vite, selon les besoins immédiats de l'industrie,
quand ces besoins changent, et on en embauche de plus jeunes,
qu'on forme à la va-vite en fonction des exigences nouvelles et
qu'on chassera à leur tour... La politique de l'usure morale accélérée
vaut en matière de main-d'œuvre comme en matière de produits
de consommation.
Elle frappe plusieurs générations : celles de plus de quarante
ans qui se trouvent prématurément vieillies ou « usées » par la
politique patronale ; celle des moins de vingt-cinq ans qui sont
promis à un vieillissement prématuré. Mais elle frappe aussi
indistinctement des catégories professionnelles très variées :
ouvriers professionnels, agents techniques, petits cadres scienti-
fiques et techniques, ingénieurs de production et d'études. Autant
dire que le problème de la formation — et celui, connexe, des
débouchés, c'est-à-dire du sens du développement économique,
social et culturel — fournissent un excellent terrain pour faire
l'unité syndicale et politique de couches jusqu'ici distinctes de
la classe ouvrière et pour favoriser l'intégration à celle-ci, dans
une perspective socialiste, des travailleurs techniques et intellec-
tuels.
ans qui se trouvent prématurément vieillies ou « usées » par la
politique patronale ; celle des moins de vingt-cinq ans qui sont
promis à un vieillissement prématuré. Mais elle frappe aussi
indistinctement des catégories professionnelles très variées :
ouvriers professionnels, agents techniques, petits cadres scienti-
fiques et techniques, ingénieurs de production et d'études. Autant
dire que le problème de la formation — et celui, connexe, des
débouchés, c'est-à-dire du sens du développement économique,
social et culturel — fournissent un excellent terrain pour faire
l'unité syndicale et politique de couches jusqu'ici distinctes de
la classe ouvrière et pour favoriser l'intégration à celle-ci, dans
une perspective socialiste, des travailleurs techniques et intellec-
tuels.
— En dépit de ses efforts, la politique de la classe patronale
n'en est pas moins incapable d'ajuster le niveau de formation
des travailleurs aux tâches subalternes auxquelles elle les destine.
Et cela pour la bonne raison que, d'une part, le niveau de forma-
tion sociale s'élève sous l'influence de faits de civilisation, quel que
soit d'ailleurs le niveau de formation scolaire ; et que, d'autre
part, le niveau des connaissances requises dans une proportion
croissante d'emplois*interdit pratiquement de conférer aux jeunes
travailleurs les compétences nécessaires tout en bornant en même
temps leur horizon et leurs exigences culturelles et professionnelles
aux tâches d'exécution spécialisée qui leur sont demandés. Le
niveau de formation reçu est ainsi trop bas pour permettre une
autonomie réelle, mais il n'est et ne peut pas être si bas qu'il ne
s'accompagne de la conscience de sa limitation arbitraire et de
n'en est pas moins incapable d'ajuster le niveau de formation
des travailleurs aux tâches subalternes auxquelles elle les destine.
Et cela pour la bonne raison que, d'une part, le niveau de forma-
tion sociale s'élève sous l'influence de faits de civilisation, quel que
soit d'ailleurs le niveau de formation scolaire ; et que, d'autre
part, le niveau des connaissances requises dans une proportion
croissante d'emplois*interdit pratiquement de conférer aux jeunes
travailleurs les compétences nécessaires tout en bornant en même
temps leur horizon et leurs exigences culturelles et professionnelles
aux tâches d'exécution spécialisée qui leur sont demandés. Le
niveau de formation reçu est ainsi trop bas pour permettre une
autonomie réelle, mais il n'est et ne peut pas être si bas qu'il ne
s'accompagne de la conscience de sa limitation arbitraire et de
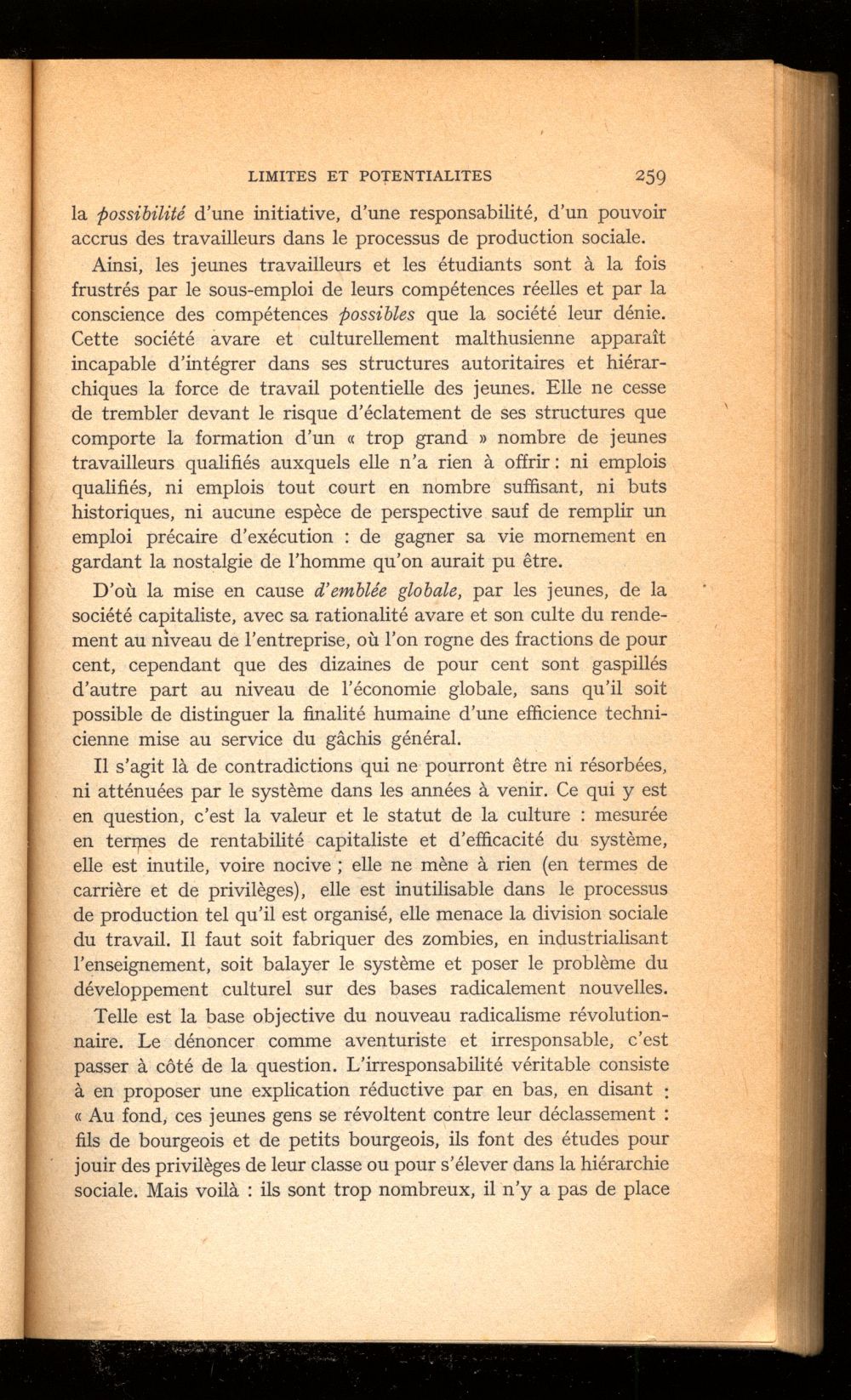

LIMITES ET POTENTIALITES
259
la possibilité d'une initiative, d'une responsabilité, d'un pouvoir
accrus des travailleurs dans le processus de production sociale.
accrus des travailleurs dans le processus de production sociale.
Ainsi, les jeunes travailleurs et les étudiants sont à la fois
frustrés par le sous-emploi de leurs compétences réelles et par la
conscience des compétences possibles que la société leur dénie.
Cette société avare et culturellement malthusienne apparaît
incapable d'intégrer dans ses structures autoritaires et hiérar-
chiques la force de travail potentielle des jeunes. Elle ne cesse
de trembler devant le risque d'éclatement de ses structures que
comporte la formation d'un « trop grand » nombre de jeunes
travailleurs qualifiés auxquels elle n'a rien à offrir : ni emplois
qualifiés, ni emplois tout court en nombre suffisant, ni buts
historiques, ni aucune espèce de perspective sauf de remplir un
emploi précaire d'exécution : de gagner sa vie mornement en
gardant la nostalgie de l'homme qu'on aurait pu être.
frustrés par le sous-emploi de leurs compétences réelles et par la
conscience des compétences possibles que la société leur dénie.
Cette société avare et culturellement malthusienne apparaît
incapable d'intégrer dans ses structures autoritaires et hiérar-
chiques la force de travail potentielle des jeunes. Elle ne cesse
de trembler devant le risque d'éclatement de ses structures que
comporte la formation d'un « trop grand » nombre de jeunes
travailleurs qualifiés auxquels elle n'a rien à offrir : ni emplois
qualifiés, ni emplois tout court en nombre suffisant, ni buts
historiques, ni aucune espèce de perspective sauf de remplir un
emploi précaire d'exécution : de gagner sa vie mornement en
gardant la nostalgie de l'homme qu'on aurait pu être.
D'où la mise en cause d'emblée globale, par les jeunes, de la
société capitaliste, avec sa rationalité avare et son culte du rende-
ment au niveau de l'entreprise, où l'on rogne des fractions de pour
cent, cependant que des dizaines de pour cent sont gaspillés
d'autre part au niveau de l'économie globale, sans qu'il soit
possible de distinguer la finalité humaine d'une efficience techni-
cienne mise au service du gâchis général.
société capitaliste, avec sa rationalité avare et son culte du rende-
ment au niveau de l'entreprise, où l'on rogne des fractions de pour
cent, cependant que des dizaines de pour cent sont gaspillés
d'autre part au niveau de l'économie globale, sans qu'il soit
possible de distinguer la finalité humaine d'une efficience techni-
cienne mise au service du gâchis général.
Il s'agit là de contradictions qui ne pourront être ni résorbées,
ni atténuées par le système dans les années à venir. Ce qui y est
en question, c'est la valeur et le statut de la culture : mesurée
en termes de rentabilité capitaliste et d'efficacité du système,
elle est inutile, voire nocive ; elle ne mène à rien (en termes de
carrière et de privilèges), elle est inutilisable dans le processus
de production tel qu'il est organisé, elle menace la division sociale
du travail. Il faut soit fabriquer des zombies, en industrialisant
l'enseignement, soit balayer le système et poser le problème du
développement culturel sur des bases radicalement nouvelles.
ni atténuées par le système dans les années à venir. Ce qui y est
en question, c'est la valeur et le statut de la culture : mesurée
en termes de rentabilité capitaliste et d'efficacité du système,
elle est inutile, voire nocive ; elle ne mène à rien (en termes de
carrière et de privilèges), elle est inutilisable dans le processus
de production tel qu'il est organisé, elle menace la division sociale
du travail. Il faut soit fabriquer des zombies, en industrialisant
l'enseignement, soit balayer le système et poser le problème du
développement culturel sur des bases radicalement nouvelles.
Telle est la base objective du nouveau radicalisme révolution-
naire. Le dénoncer comme aventuriste et irresponsable, c'est
passer à côté de la question. L'irresponsabilité véritable consiste
à en proposer une explication réductive par en bas, en disant :
« Au fond, ces jeunes gens se révoltent contre leur déclassement :
fils de bourgeois et de petits bourgeois, ils font des études pour
jouir des privilèges de leur classe ou pour s'élever dans la hiérarchie
sociale. Mais voilà : ils sont trop nombreux, il n'y a pas de place
naire. Le dénoncer comme aventuriste et irresponsable, c'est
passer à côté de la question. L'irresponsabilité véritable consiste
à en proposer une explication réductive par en bas, en disant :
« Au fond, ces jeunes gens se révoltent contre leur déclassement :
fils de bourgeois et de petits bourgeois, ils font des études pour
jouir des privilèges de leur classe ou pour s'élever dans la hiérarchie
sociale. Mais voilà : ils sont trop nombreux, il n'y a pas de place
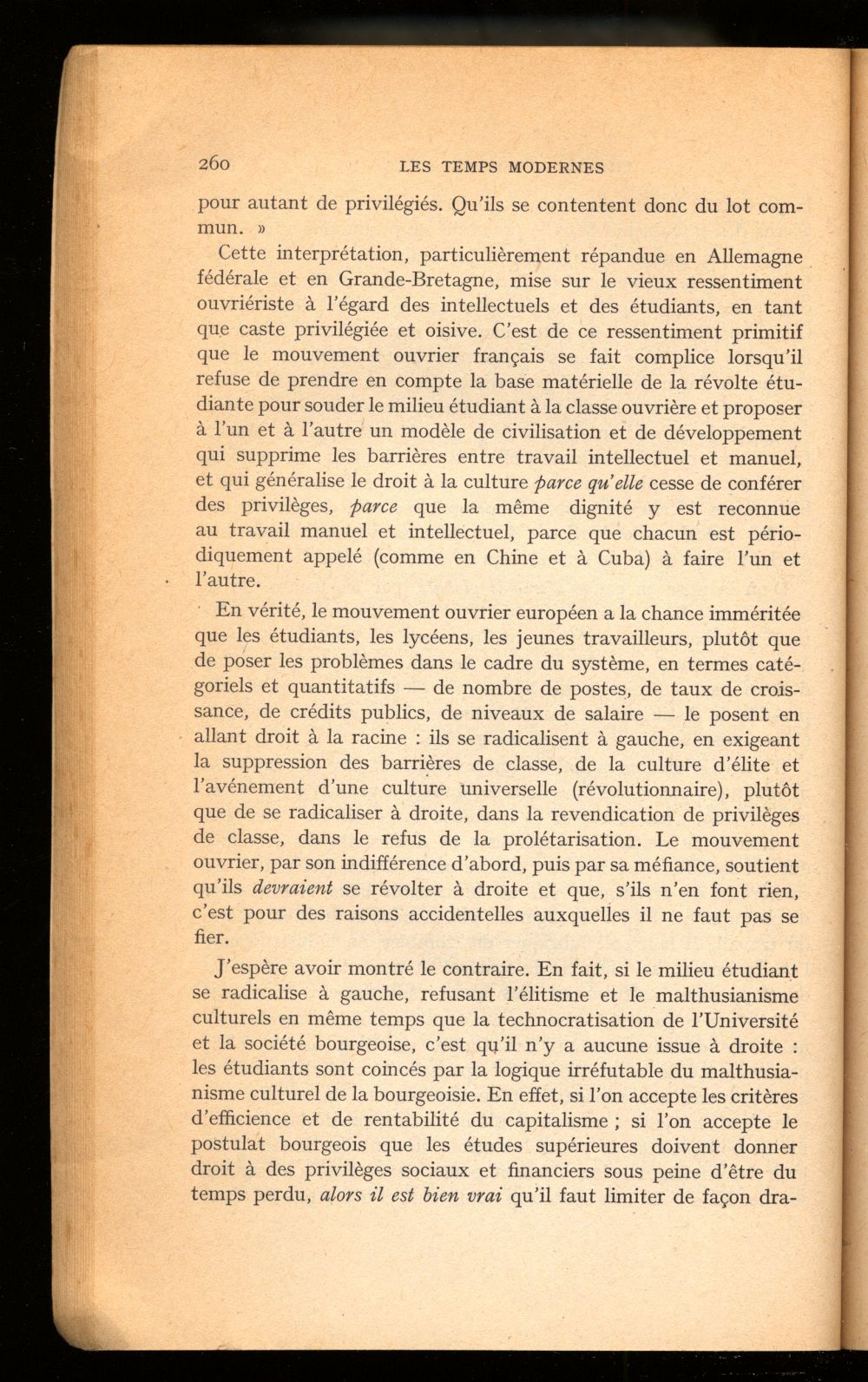

2ÔO
LES TEMPS MODERNES
pour autant de privilégiés. Qu'ils se contentent donc du lot com-
mun. »
mun. »
Cette interprétation, particulièrement répandue en Allemagne
fédérale et en Grande-Bretagne, mise sur le vieux ressentiment
ouvriériste à l'égard des intellectuels et des étudiants, en tant
que caste privilégiée et oisive. C'est de ce ressentiment primitif
que le mouvement ouvrier français se fait complice lorsqu'il
refuse de prendre en compte la base matérielle de la révolte étu-
diante pour souder le milieu étudiant à la classe ouvrière et proposer
à l'un et à l'autre un modèle de civilisation et de développement
qui supprime les barrières entre travail intellectuel et manuel,
et qui généralise le droit à la culture parce qu'elle cesse de conférer
des privilèges, parce que la même dignité y est reconnue
au travail manuel et intellectuel, parce que chacun est pério-
diquement appelé (comme en Chine et à Cuba) à faire l'un et
l'autre.
fédérale et en Grande-Bretagne, mise sur le vieux ressentiment
ouvriériste à l'égard des intellectuels et des étudiants, en tant
que caste privilégiée et oisive. C'est de ce ressentiment primitif
que le mouvement ouvrier français se fait complice lorsqu'il
refuse de prendre en compte la base matérielle de la révolte étu-
diante pour souder le milieu étudiant à la classe ouvrière et proposer
à l'un et à l'autre un modèle de civilisation et de développement
qui supprime les barrières entre travail intellectuel et manuel,
et qui généralise le droit à la culture parce qu'elle cesse de conférer
des privilèges, parce que la même dignité y est reconnue
au travail manuel et intellectuel, parce que chacun est pério-
diquement appelé (comme en Chine et à Cuba) à faire l'un et
l'autre.
En vérité, le mouvement ouvrier européen a la chance imméritée
que les étudiants, les lycéens, les jeunes travailleurs, plutôt que
de poser les problèmes dans le cadre du système, en termes caté-
goriels et quantitatifs — de nombre de postes, de taux de crois-
sance, de crédits publics, de niveaux de salaire — le posent en
allant droit à la racine : ils se radicalisent à gauche, en exigeant
la suppression des barrières de classe, de la culture d'élite et
l'avènement d'une culture universelle (révolutionnaire), plutôt
que de se radicaliser à droite, dans la revendication de privilèges
de classe, dans le refus de la prolétarisation. Le mouvement
ouvrier, par son indifférence d'abord, puis par sa méfiance, soutient
qu'ils devraient se révolter à droite et que, s'ils n'en font rien,
c'est pour des raisons accidentelles auxquelles il ne faut pas se
fier.
que les étudiants, les lycéens, les jeunes travailleurs, plutôt que
de poser les problèmes dans le cadre du système, en termes caté-
goriels et quantitatifs — de nombre de postes, de taux de crois-
sance, de crédits publics, de niveaux de salaire — le posent en
allant droit à la racine : ils se radicalisent à gauche, en exigeant
la suppression des barrières de classe, de la culture d'élite et
l'avènement d'une culture universelle (révolutionnaire), plutôt
que de se radicaliser à droite, dans la revendication de privilèges
de classe, dans le refus de la prolétarisation. Le mouvement
ouvrier, par son indifférence d'abord, puis par sa méfiance, soutient
qu'ils devraient se révolter à droite et que, s'ils n'en font rien,
c'est pour des raisons accidentelles auxquelles il ne faut pas se
fier.
J'espère avoir montré le contraire. En fait, si le milieu étudiant
se radicalise à gauche, refusant l'élitisme et le malthusianisme
culturels en même temps que la technocratisation de l'Université
et la société bourgeoise, c'est qu'il n'y a aucune issue à droite :
les étudiants sont coincés par la logique irréfutable du malthusia-
nisme culturel de la bourgeoisie. En effet, si l'on accepte les critères
d'efficience et de rentabilité du capitalisme ; si l'on accepte le
postulat bourgeois que les études supérieures doivent donner
droit à des privilèges sociaux et financiers sous peine d'être du
temps perdu, alors il est bien vrai qu'il faut limiter de façon dra-
se radicalise à gauche, refusant l'élitisme et le malthusianisme
culturels en même temps que la technocratisation de l'Université
et la société bourgeoise, c'est qu'il n'y a aucune issue à droite :
les étudiants sont coincés par la logique irréfutable du malthusia-
nisme culturel de la bourgeoisie. En effet, si l'on accepte les critères
d'efficience et de rentabilité du capitalisme ; si l'on accepte le
postulat bourgeois que les études supérieures doivent donner
droit à des privilèges sociaux et financiers sous peine d'être du
temps perdu, alors il est bien vrai qu'il faut limiter de façon dra-
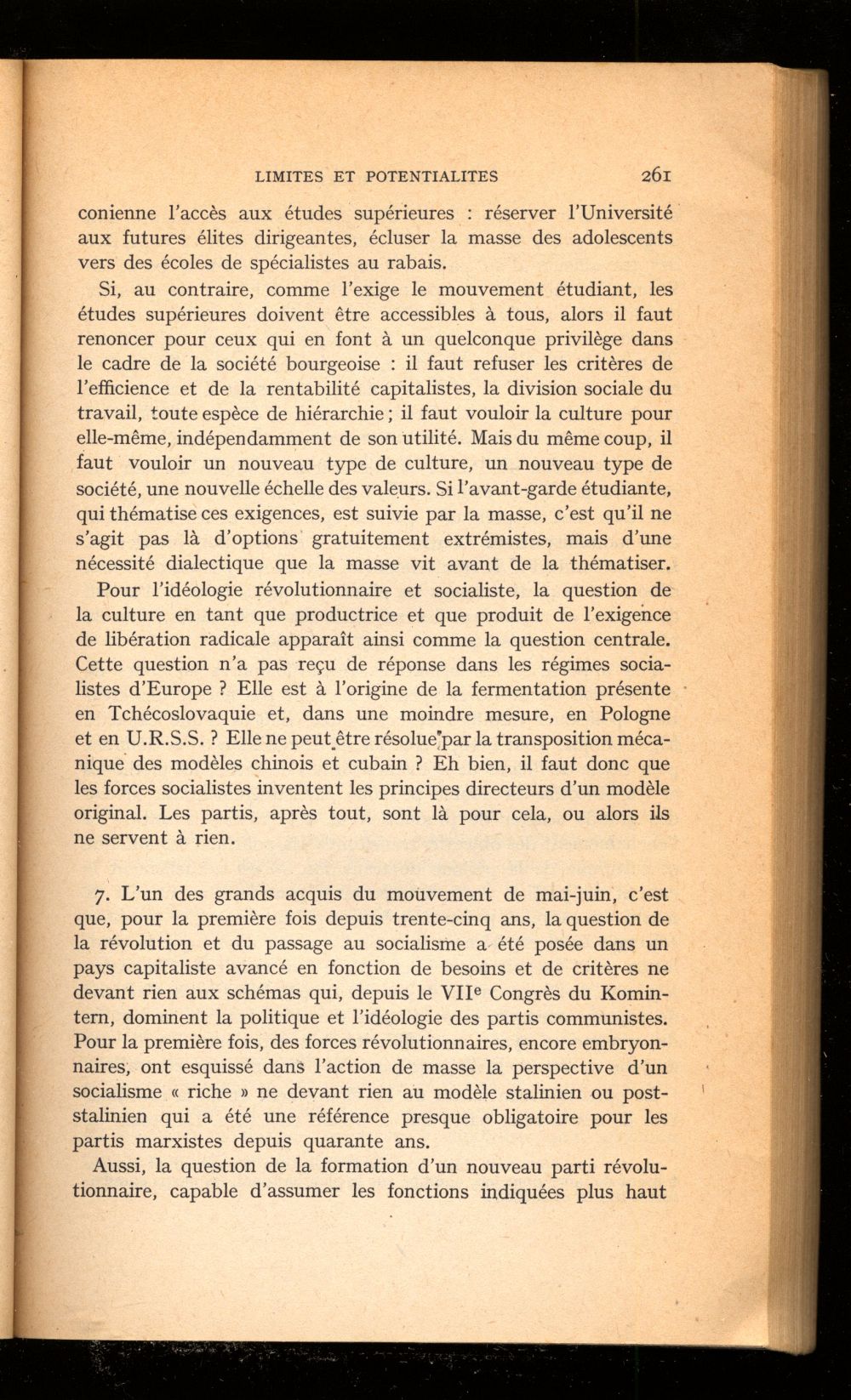

LIMITES ET POTENTIALITES
201
conienne l'accès aux études supérieures : réserver l'Université
aux futures élites dirigeantes, écluser la masse des adolescents
vers des écoles de spécialistes au rabais.
aux futures élites dirigeantes, écluser la masse des adolescents
vers des écoles de spécialistes au rabais.
Si, au contraire, comme l'exige le mouvement étudiant, les
études supérieures doivent être accessibles à tous, alors il faut
renoncer pour ceux qui en font à un quelconque privilège dans
le cadre de la société bourgeoise : il faut refuser les critères de
l'efficience et de la rentabilité capitalistes, la division sociale du
travail, toute espèce de hiérarchie ; il faut vouloir la culture pour
elle-même, indépendamment de son utilité. Mais du même coup, il
faut vouloir un nouveau type de culture, un nouveau type de
société, une nouvelle échelle des valeurs. Si l'avant-garde étudiante,
qui thématise ces exigences, est suivie par la masse, c'est qu'il ne
s'agit pas là d'options gratuitement extrémistes, mais d'une
nécessité dialectique que la masse vit avant de la thématiser.
études supérieures doivent être accessibles à tous, alors il faut
renoncer pour ceux qui en font à un quelconque privilège dans
le cadre de la société bourgeoise : il faut refuser les critères de
l'efficience et de la rentabilité capitalistes, la division sociale du
travail, toute espèce de hiérarchie ; il faut vouloir la culture pour
elle-même, indépendamment de son utilité. Mais du même coup, il
faut vouloir un nouveau type de culture, un nouveau type de
société, une nouvelle échelle des valeurs. Si l'avant-garde étudiante,
qui thématise ces exigences, est suivie par la masse, c'est qu'il ne
s'agit pas là d'options gratuitement extrémistes, mais d'une
nécessité dialectique que la masse vit avant de la thématiser.
Pour l'idéologie révolutionnaire et socialiste, la question de
la culture en tant que productrice et que produit de l'exigence
de libération radicale apparaît ainsi comme la question centrale.
Cette question n'a pas reçu de réponse dans les régimes socia-
listes d'Europe ? Elle est à l'origine de la fermentation présente
en Tchécoslovaquie et, dans une moindre mesure, en Pologne
et en U.R.S.S. ? Elle ne peut_être résolue'par la transposition méca-
nique des modèles chinois et cubain ? Eh bien, il faut donc que
les forces socialistes inventent les principes directeurs d'un modèle
original. Les partis, après tout, sont là pour cela, ou alors ils
ne servent à rien.
la culture en tant que productrice et que produit de l'exigence
de libération radicale apparaît ainsi comme la question centrale.
Cette question n'a pas reçu de réponse dans les régimes socia-
listes d'Europe ? Elle est à l'origine de la fermentation présente
en Tchécoslovaquie et, dans une moindre mesure, en Pologne
et en U.R.S.S. ? Elle ne peut_être résolue'par la transposition méca-
nique des modèles chinois et cubain ? Eh bien, il faut donc que
les forces socialistes inventent les principes directeurs d'un modèle
original. Les partis, après tout, sont là pour cela, ou alors ils
ne servent à rien.
7. L'un des grands acquis du mouvement de mai-juin, c'est
que, pour la première fois depuis trente-cinq ans, la question de
la révolution et du passage au socialisme a été posée dans un
pays capitaliste avancé en fonction de besoins et de critères ne
devant rien aux schémas qui, depuis le VIIe Congrès du Komin-
tern, dominent la politique et l'idéologie des partis communistes.
Pour la première fois, des forces révolutionnaires, encore embryon-
naires, ont esquissé dans l'action de masse la perspective d'un
socialisme « riche » ne devant rien au modèle stalinien ou post-
stalinien qui a été une référence presque obligatoire pour les
partis marxistes depuis quarante ans.
que, pour la première fois depuis trente-cinq ans, la question de
la révolution et du passage au socialisme a été posée dans un
pays capitaliste avancé en fonction de besoins et de critères ne
devant rien aux schémas qui, depuis le VIIe Congrès du Komin-
tern, dominent la politique et l'idéologie des partis communistes.
Pour la première fois, des forces révolutionnaires, encore embryon-
naires, ont esquissé dans l'action de masse la perspective d'un
socialisme « riche » ne devant rien au modèle stalinien ou post-
stalinien qui a été une référence presque obligatoire pour les
partis marxistes depuis quarante ans.
Aussi, la question de la formation d'un nouveau parti révolu-
tionnaire, capable d'assumer les fonctions indiquées plus haut
tionnaire, capable d'assumer les fonctions indiquées plus haut
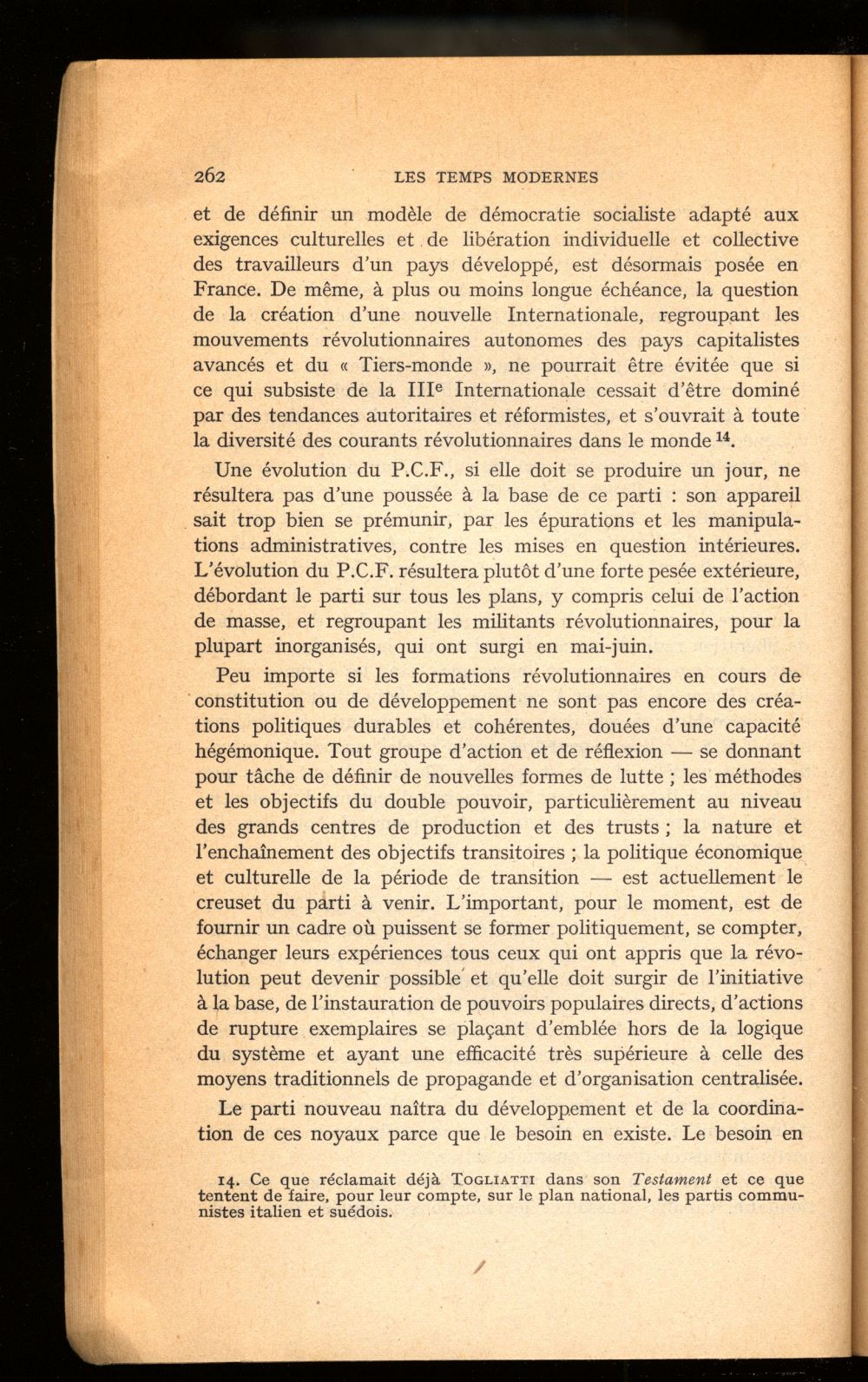

202
LES TEMPS MODERNES
et de définir un modèle de démocratie socialiste adapté aux
exigences culturelles et de libération individuelle et collective
des travailleurs d'un pays développé, est désormais posée en
France. De même, à plus ou moins longue échéance, la question
de la création d'une nouvelle Internationale, regroupant les
mouvements révolutionnaires autonomes des pays capitalistes
avancés et du « Tiers-monde », ne pourrait être évitée que si
ce qui subsiste de la IIIe Internationale cessait d'être dominé
par des tendances autoritaires et réformistes, et s'ouvrait à toute
la diversité des courants révolutionnaires dans le monde M.
exigences culturelles et de libération individuelle et collective
des travailleurs d'un pays développé, est désormais posée en
France. De même, à plus ou moins longue échéance, la question
de la création d'une nouvelle Internationale, regroupant les
mouvements révolutionnaires autonomes des pays capitalistes
avancés et du « Tiers-monde », ne pourrait être évitée que si
ce qui subsiste de la IIIe Internationale cessait d'être dominé
par des tendances autoritaires et réformistes, et s'ouvrait à toute
la diversité des courants révolutionnaires dans le monde M.
Une évolution du P.C.F., si elle doit se produire un jour, ne
résultera pas d'une poussée à la base de ce parti : son appareil
. sait trop bien se prémunir, par les épurations et les manipula-
tions administratives, contre les mises en question intérieures.
L'évolution du P.C.F. résultera plutôt d'une forte pesée extérieure,
débordant le parti sur tous les plans, y compris celui de l'action
de masse, et regroupant les militants révolutionnaires, pour la
plupart inorganisés, qui ont surgi en mai-juin.
résultera pas d'une poussée à la base de ce parti : son appareil
. sait trop bien se prémunir, par les épurations et les manipula-
tions administratives, contre les mises en question intérieures.
L'évolution du P.C.F. résultera plutôt d'une forte pesée extérieure,
débordant le parti sur tous les plans, y compris celui de l'action
de masse, et regroupant les militants révolutionnaires, pour la
plupart inorganisés, qui ont surgi en mai-juin.
Peu importe si les formations révolutionnaires en cours de
constitution ou de développement ne sont pas encore des créa-
tions politiques durables et cohérentes, douées d'une capacité
hégémonique. Tout groupe d'action et de réflexion — se donnant
pour tâche de définir de nouvelles formes de lutte ; les méthodes
et les objectifs du double pouvoir, particulièrement au niveau
des grands centres de production et des trusts ; la nature et
l'enchaînement des objectifs transitoires ; la politique économique
et culturelle de la période de transition — est actuellement le
creuset du parti à venir. L'important, pour le moment, est de
fournir un cadre où puissent se former politiquement, se compter,
échanger leurs expériences tous ceux qui ont appris que la révo-
lution peut devenir possible et qu'elle doit surgir de l'initiative
à la base, de l'instauration de pouvoirs populaires directs, d'actions
de rupture exemplaires se plaçant d'emblée hors de la logique
du système et ayant une efficacité très supérieure à celle des
moyens traditionnels de propagande et d'organisation centralisée.
constitution ou de développement ne sont pas encore des créa-
tions politiques durables et cohérentes, douées d'une capacité
hégémonique. Tout groupe d'action et de réflexion — se donnant
pour tâche de définir de nouvelles formes de lutte ; les méthodes
et les objectifs du double pouvoir, particulièrement au niveau
des grands centres de production et des trusts ; la nature et
l'enchaînement des objectifs transitoires ; la politique économique
et culturelle de la période de transition — est actuellement le
creuset du parti à venir. L'important, pour le moment, est de
fournir un cadre où puissent se former politiquement, se compter,
échanger leurs expériences tous ceux qui ont appris que la révo-
lution peut devenir possible et qu'elle doit surgir de l'initiative
à la base, de l'instauration de pouvoirs populaires directs, d'actions
de rupture exemplaires se plaçant d'emblée hors de la logique
du système et ayant une efficacité très supérieure à celle des
moyens traditionnels de propagande et d'organisation centralisée.
Le parti nouveau naîtra du développement et de la coordina-
tion de ces noyaux parce que le besoin en existe. Le besoin en
tion de ces noyaux parce que le besoin en existe. Le besoin en
14. Ce que réclamait déjà TOGUATTI clans son Testament et ce que
tentent de faire, pour leur compte, sur le plan national, les partis commu-
nistes italien et suédois.
tentent de faire, pour leur compte, sur le plan national, les partis commu-
nistes italien et suédois.
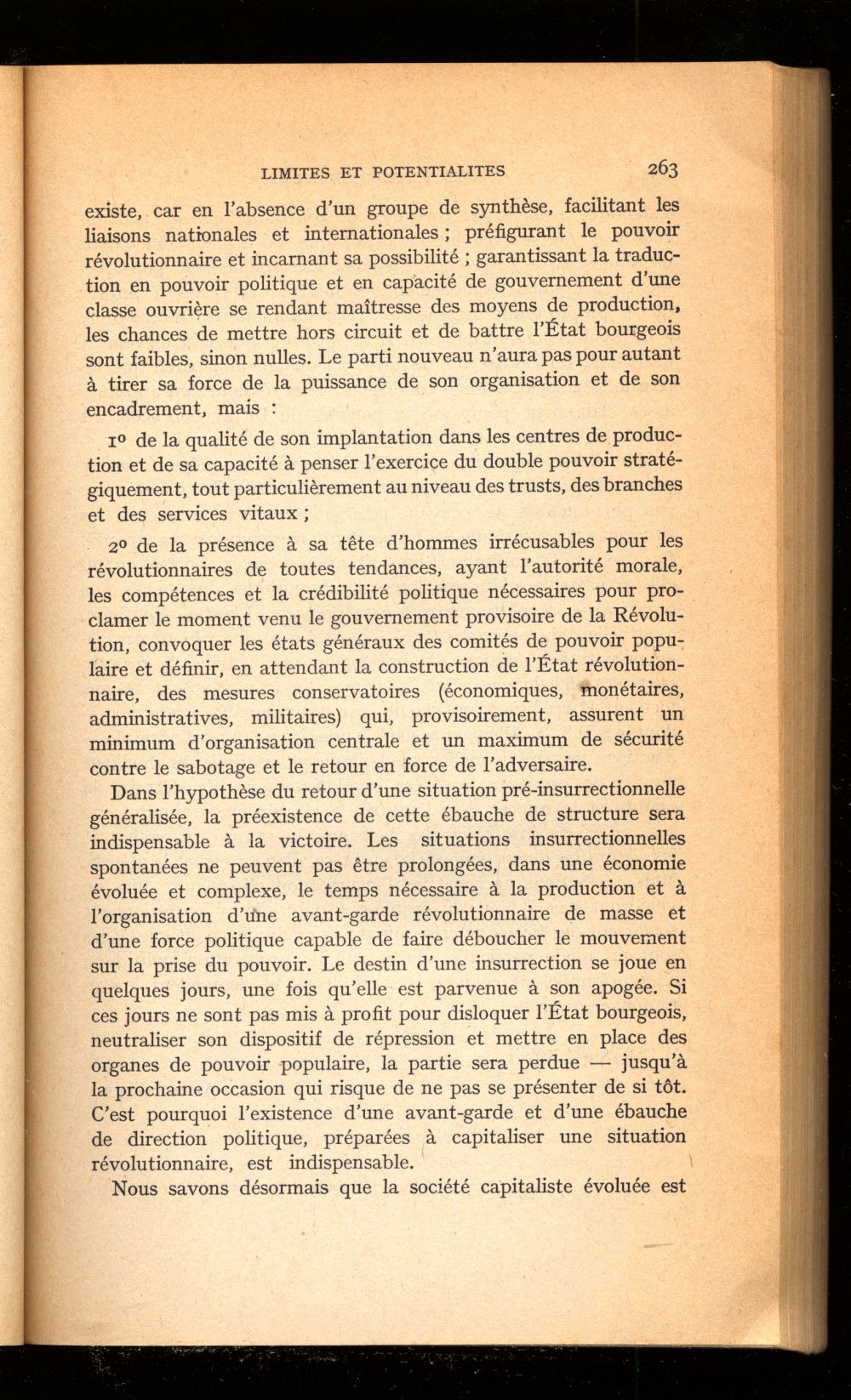

LIMITES ET POTENTIALITES
263
existe, car en l'absence d'un groupe de synthèse, facilitant les
liaisons nationales et internationales ; préfigurant le pouvoir
révolutionnaire et incarnant sa possibilité ; garantissant la traduc-
tion en pouvoir politique et en capacité de gouvernement d'une
classe ouvrière se rendant maîtresse des moyens de production,
les chances de mettre hors circuit et de battre l'État bourgeois
sont faibles, sinon nulles. Le parti nouveau n'aura pas pour autant
à tirer sa force de la puissance de son organisation et de son
encadrement, mais :
liaisons nationales et internationales ; préfigurant le pouvoir
révolutionnaire et incarnant sa possibilité ; garantissant la traduc-
tion en pouvoir politique et en capacité de gouvernement d'une
classe ouvrière se rendant maîtresse des moyens de production,
les chances de mettre hors circuit et de battre l'État bourgeois
sont faibles, sinon nulles. Le parti nouveau n'aura pas pour autant
à tirer sa force de la puissance de son organisation et de son
encadrement, mais :
i° de la qualité de son implantation dans les centres de produc-
tion et de sa capacité à penser l'exercice du double pouvoir straté-
giquement, tout particulièrement au niveau des trusts, des branches
et des services vitaux ;
tion et de sa capacité à penser l'exercice du double pouvoir straté-
giquement, tout particulièrement au niveau des trusts, des branches
et des services vitaux ;
2° de la présence à sa tête d'hommes irrécusables pour les
révolutionnaires de toutes tendances, ayant l'autorité morale,
les compétences et la crédibilité politique nécessaires pour pro-
clamer le moment venu le gouvernement provisoire de la Révolu-
tion, convoquer les états généraux des comités de pouvoir popu-
laire et définir, en attendant la construction de l'État révolution-
naire, des mesures conservatoires (économiques, monétaires,
administratives, militaires) qui, provisoirement, assurent un
minimum d'organisation centrale et un maximum de sécurité
contre le sabotage et le retour en force de l'adversaire.
révolutionnaires de toutes tendances, ayant l'autorité morale,
les compétences et la crédibilité politique nécessaires pour pro-
clamer le moment venu le gouvernement provisoire de la Révolu-
tion, convoquer les états généraux des comités de pouvoir popu-
laire et définir, en attendant la construction de l'État révolution-
naire, des mesures conservatoires (économiques, monétaires,
administratives, militaires) qui, provisoirement, assurent un
minimum d'organisation centrale et un maximum de sécurité
contre le sabotage et le retour en force de l'adversaire.
Dans l'hypothèse du retour d'une situation pré-insurrectionnelle
généralisée, la préexistence de cette ébauche de structure sera
indispensable à la victoire. Les situations insurrectionnelles
spontanées ne peuvent pas être prolongées, dans une économie
évoluée et complexe, le temps nécessaire à la production et à
l'organisation d'une avant-garde révolutionnaire de masse et
d'une force politique capable de faire déboucher le mouvement
sur la prise du pouvoir. Le destin d'une insurrection se joue en
quelques jours, une fois qu'elle est parvenue à son apogée. Si
ces jours ne sont pas mis à profit pour disloquer l'État bourgeois,
neutraliser son dispositif de répression et mettre en place des
organes de pouvoir populaire, la partie sera perdue — jusqu'à
la prochaine occasion qui risque de ne pas se présenter de si tôt.
C'est pourquoi l'existence d'une avant-garde et d'une ébauche
de direction politique, préparées à capitaliser une situation
révolutionnaire, est indispensable.
généralisée, la préexistence de cette ébauche de structure sera
indispensable à la victoire. Les situations insurrectionnelles
spontanées ne peuvent pas être prolongées, dans une économie
évoluée et complexe, le temps nécessaire à la production et à
l'organisation d'une avant-garde révolutionnaire de masse et
d'une force politique capable de faire déboucher le mouvement
sur la prise du pouvoir. Le destin d'une insurrection se joue en
quelques jours, une fois qu'elle est parvenue à son apogée. Si
ces jours ne sont pas mis à profit pour disloquer l'État bourgeois,
neutraliser son dispositif de répression et mettre en place des
organes de pouvoir populaire, la partie sera perdue — jusqu'à
la prochaine occasion qui risque de ne pas se présenter de si tôt.
C'est pourquoi l'existence d'une avant-garde et d'une ébauche
de direction politique, préparées à capitaliser une situation
révolutionnaire, est indispensable.
Nous savons désormais que la société capitaliste évoluée est
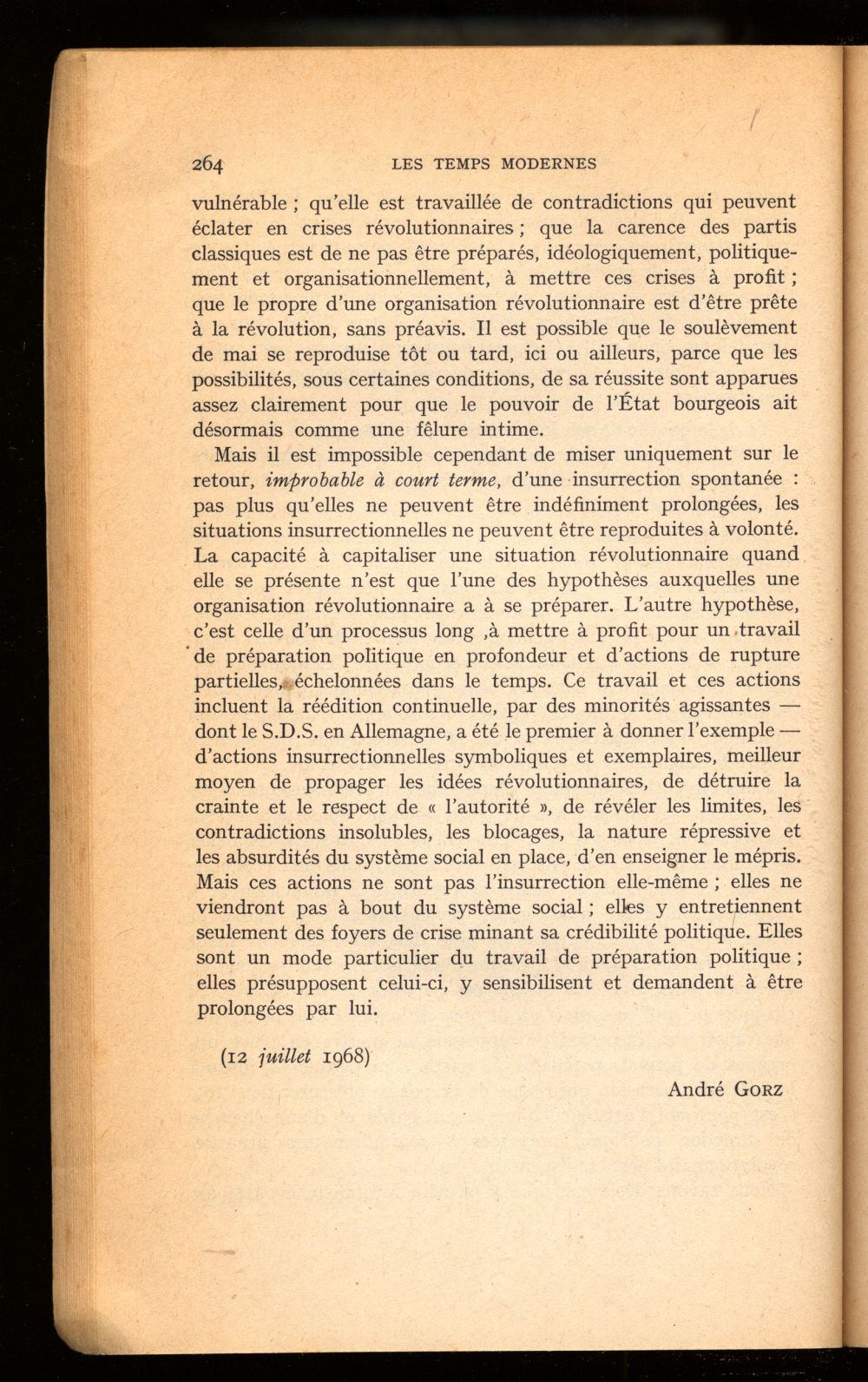

264
LES TEMPS MODERNES
vulnérable ; qu'elle est travaillée de contradictions qui peuvent
éclater en crises révolutionnaires ; que la carence des partis
classiques est de ne pas être préparés, idéologiquement, politique-
ment et organisationnellement, à mettre ces crises à profit ;
que le propre d'une organisation révolutionnaire est d'être prête
à la révolution, sans préavis. Il est possible que le soulèvement
de mai se reproduise tôt ou tard, ici ou ailleurs, parce que les
possibilités, sous certaines conditions, de sa réussite sont apparues
assez clairement pour que le pouvoir de l'État bourgeois ait
désormais comme une fêlure intime.
éclater en crises révolutionnaires ; que la carence des partis
classiques est de ne pas être préparés, idéologiquement, politique-
ment et organisationnellement, à mettre ces crises à profit ;
que le propre d'une organisation révolutionnaire est d'être prête
à la révolution, sans préavis. Il est possible que le soulèvement
de mai se reproduise tôt ou tard, ici ou ailleurs, parce que les
possibilités, sous certaines conditions, de sa réussite sont apparues
assez clairement pour que le pouvoir de l'État bourgeois ait
désormais comme une fêlure intime.
Mais il est impossible cependant de miser uniquement sur le
retour, improbable à court terme, d'une insurrection spontanée :
pas plus qu'elles ne peuvent être indéfiniment prolongées, les
situations insurrectionnelles ne peuvent être reproduites à volonté.
La capacité à capitaliser une situation révolutionnaire quand
elle se présente n'est que l'une des hypothèses auxquelles une
organisation révolutionnaire a à se préparer. L'autre hypothèse,
c'est celle d'un processus long ,à mettre à profit pour un travail
' de préparation politique en profondeur et d'actions de rupture
partielles, échelonnées dans le temps. Ce travail et ces actions
incluent la réédition continuelle, par des minorités agissantes —
dont le S.D.S. en Allemagne, a été le premier à donner l'exemple —
d'actions insurrectionnelles symboliques et exemplaires, meilleur
moyen de propager les idées révolutionnaires, de détruire la
crainte et le respect de « l'autorité », de révéler les limites, les
contradictions insolubles, les blocages, la nature répressive et
les absurdités du système social en place, d'en enseigner le mépris.
Mais ces actions ne sont pas l'insurrection elle-même ; elles ne
viendront pas à bout du système social ; elfes y entretiennent
seulement des foyers de crise minant sa crédibilité politique. Elles
sont un mode particulier du travail de préparation politique ;
elles présupposent celui-ci, y sensibilisent et demandent à être
prolongées par lui.
retour, improbable à court terme, d'une insurrection spontanée :
pas plus qu'elles ne peuvent être indéfiniment prolongées, les
situations insurrectionnelles ne peuvent être reproduites à volonté.
La capacité à capitaliser une situation révolutionnaire quand
elle se présente n'est que l'une des hypothèses auxquelles une
organisation révolutionnaire a à se préparer. L'autre hypothèse,
c'est celle d'un processus long ,à mettre à profit pour un travail
' de préparation politique en profondeur et d'actions de rupture
partielles, échelonnées dans le temps. Ce travail et ces actions
incluent la réédition continuelle, par des minorités agissantes —
dont le S.D.S. en Allemagne, a été le premier à donner l'exemple —
d'actions insurrectionnelles symboliques et exemplaires, meilleur
moyen de propager les idées révolutionnaires, de détruire la
crainte et le respect de « l'autorité », de révéler les limites, les
contradictions insolubles, les blocages, la nature répressive et
les absurdités du système social en place, d'en enseigner le mépris.
Mais ces actions ne sont pas l'insurrection elle-même ; elles ne
viendront pas à bout du système social ; elfes y entretiennent
seulement des foyers de crise minant sa crédibilité politique. Elles
sont un mode particulier du travail de préparation politique ;
elles présupposent celui-ci, y sensibilisent et demandent à être
prolongées par lui.
(12 juillet 1968)
André GORZ
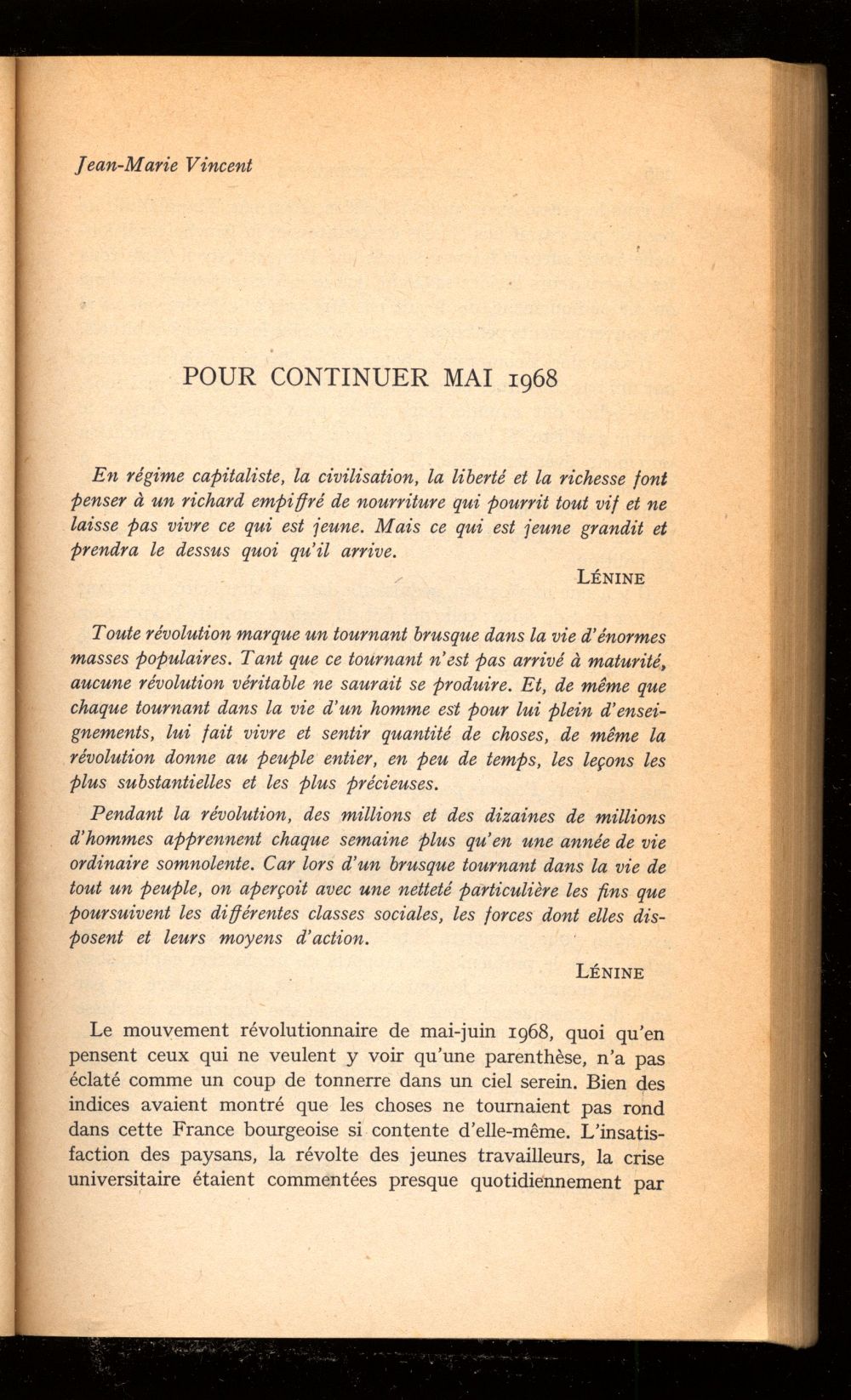

Jean-Marie Vincent
POUR CONTINUER MAI 1968
En régime capitaliste, la civilisation, la liberté et la richesse font
penser à un richard empiffré de nourriture qui pourrit tout vif et ne
laisse pas vivre ce qui est jeune. Mais ce qui est jeune grandit et
prendra le dessus quoi qu'il arrive.
penser à un richard empiffré de nourriture qui pourrit tout vif et ne
laisse pas vivre ce qui est jeune. Mais ce qui est jeune grandit et
prendra le dessus quoi qu'il arrive.
LÉNINE
Toute révolution marque un tournant brusque dans la vie d'énormes
masses populaires. Tant que ce tournant n'est pas arrivé à maturité,
aucune révolution véritable ne saurait se produire. Et, de même que
chaque tournant dans la vie d'un homme est pour lui plein d'ensei-
gnements, lui fait vivre et sentir quantité de choses, de même la
révolution donne au peuple entier, en peu de temps, les leçons les
plus substantielles et les plus précieuses.
masses populaires. Tant que ce tournant n'est pas arrivé à maturité,
aucune révolution véritable ne saurait se produire. Et, de même que
chaque tournant dans la vie d'un homme est pour lui plein d'ensei-
gnements, lui fait vivre et sentir quantité de choses, de même la
révolution donne au peuple entier, en peu de temps, les leçons les
plus substantielles et les plus précieuses.
Pendant la révolution, des millions et des dizaines de millions
d'hommes apprennent chaque semaine plus qu'en une année de vie
ordinaire somnolente. Car lors d'un brusque tournant dans la vie de
tout un peuple, on aperçoit avec une netteté particulière les fins que
poursuivent les différentes classes sociales, les forces dont elles dis-
posent et leurs moyens d'action.
d'hommes apprennent chaque semaine plus qu'en une année de vie
ordinaire somnolente. Car lors d'un brusque tournant dans la vie de
tout un peuple, on aperçoit avec une netteté particulière les fins que
poursuivent les différentes classes sociales, les forces dont elles dis-
posent et leurs moyens d'action.
LÉNINE
Le mouvement révolutionnaire de mai-juin 1968, quoi qu'en
pensent ceux qui ne veulent y voir qu'une parenthèse, n'a pas
éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Bien des
indices avaient montré que les choses ne tournaient pas rond
dans cette France bourgeoise si contente d'elle-même. L'insatis-
faction des paysans, la révolte des jeunes travailleurs, la crise
universitaire étaient commentées presque quotidiennement par
pensent ceux qui ne veulent y voir qu'une parenthèse, n'a pas
éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Bien des
indices avaient montré que les choses ne tournaient pas rond
dans cette France bourgeoise si contente d'elle-même. L'insatis-
faction des paysans, la révolte des jeunes travailleurs, la crise
universitaire étaient commentées presque quotidiennement par
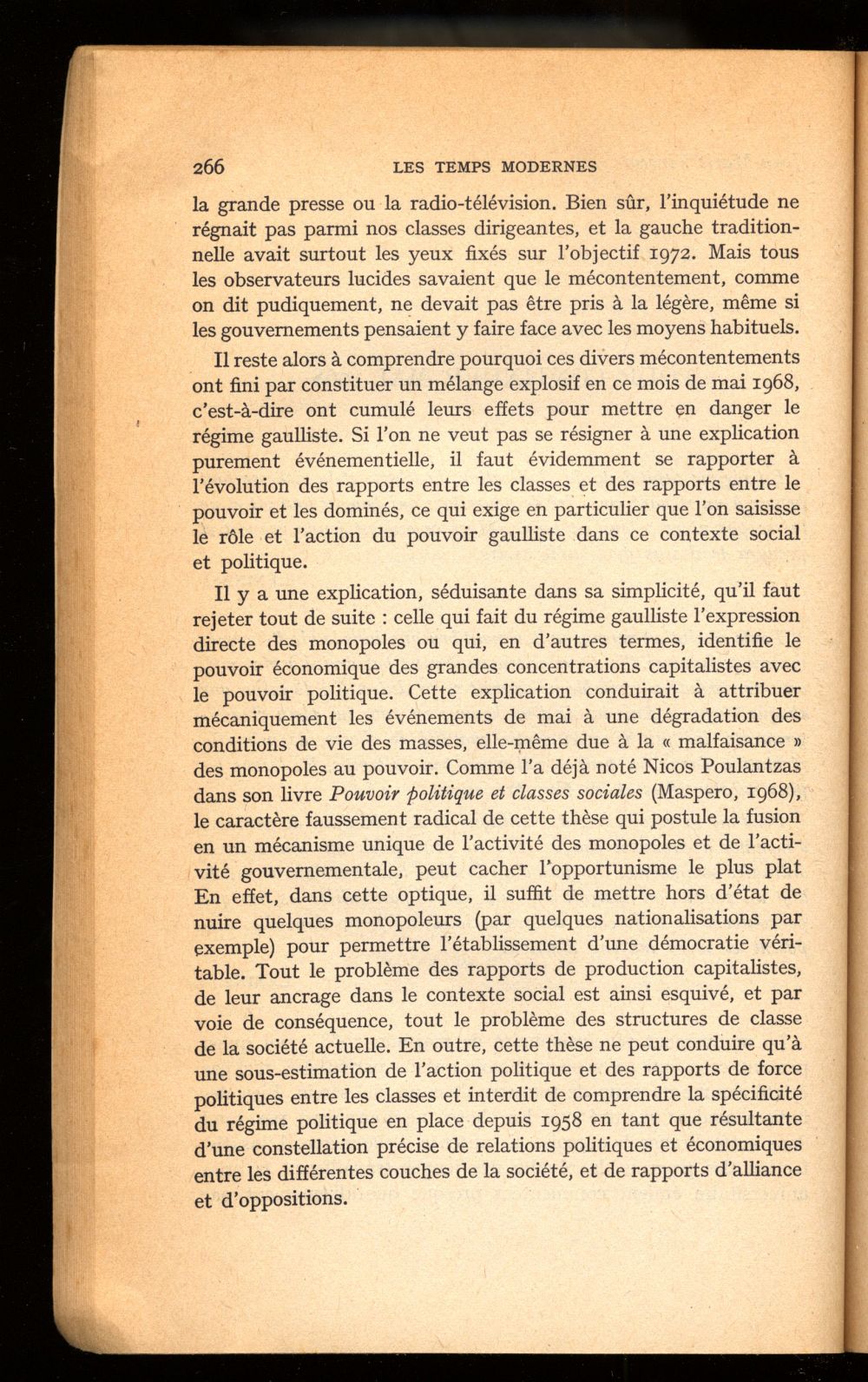

266
LES TEMPS MODERNES
la grande presse ou la radio-télévision. Bien sûr, l'inquiétude ne
régnait pas parmi nos classes dirigeantes, et la gauche tradition-
nelle avait surtout les yeux fixés sur l'objectif 1972. Mais tous
les observateurs lucides savaient que le mécontentement, comme
on dit pudiquement, ne devait pas être pris à la légère, même si
les gouvernements pensaient y faire face avec les moyens habituels.
Il reste alors à comprendre pourquoi ces divers mécontentements
ont fini par constituer un mélange explosif en ce mois de mai 1968,
c'est-à-dire ont cumulé leurs effets pour mettre en danger le
régime gaulliste. Si l'on ne veut pas se résigner à une explication
purement événementielle, il faut évidemment se rapporter à
l'évolution des rapports entre les classes et des rapports entre le
pouvoir et les dominés, ce qui exige en particulier que l'on saisisse
le rôle et l'action du pouvoir gaulliste dans ce contexte social
et politique.
régnait pas parmi nos classes dirigeantes, et la gauche tradition-
nelle avait surtout les yeux fixés sur l'objectif 1972. Mais tous
les observateurs lucides savaient que le mécontentement, comme
on dit pudiquement, ne devait pas être pris à la légère, même si
les gouvernements pensaient y faire face avec les moyens habituels.
Il reste alors à comprendre pourquoi ces divers mécontentements
ont fini par constituer un mélange explosif en ce mois de mai 1968,
c'est-à-dire ont cumulé leurs effets pour mettre en danger le
régime gaulliste. Si l'on ne veut pas se résigner à une explication
purement événementielle, il faut évidemment se rapporter à
l'évolution des rapports entre les classes et des rapports entre le
pouvoir et les dominés, ce qui exige en particulier que l'on saisisse
le rôle et l'action du pouvoir gaulliste dans ce contexte social
et politique.
Il y a une explication, séduisante dans sa simplicité, qu'il faut
rejeter tout de suite : celle qui fait du régime gaulliste l'expression
directe des monopoles ou qui, en d'autres termes, identifie le
pouvoir économique des grandes concentrations capitalistes avec
le pouvoir politique. Cette explication conduirait à attribuer
mécaniquement les événements de mai à une dégradation des
conditions de vie des masses, elle-même due à la « malfaisance »
des monopoles au pouvoir. Comme l'a déjà noté Nicos Poulantzas
dans son livre Pouvoir politique et classes sociales (Maspero, 1968),
le caractère faussement radical de cette thèse qui postule la fusion
en un mécanisme unique de l'activité des monopoles et de l'acti-
vité gouvernementale, peut cacher l'opportunisme le plus plat
En effet, dans cette optique, il suffit de mettre hors d'état de
nuire quelques monopoleurs (par quelques nationalisations par
exemple) pour permettre l'établissement d'une démocratie véri-
table. Tout le problème des rapports de production capitalistes,
de leur ancrage dans le contexte social est ainsi esquivé, et par
voie de conséquence, tout le problème des structures de classe
de la société actuelle. En outre, cette thèse ne peut conduire qu'à
une sous-estimation de l'action politique et des rapports de force
politiques entre les classes et interdit de comprendre la spécificité
du régime politique en place depuis 1958 en tant que résultante
d'une constellation précise de relations politiques et économiques
entre les différentes couches de la société, et de rapports d'alliance
et d'oppositions.
rejeter tout de suite : celle qui fait du régime gaulliste l'expression
directe des monopoles ou qui, en d'autres termes, identifie le
pouvoir économique des grandes concentrations capitalistes avec
le pouvoir politique. Cette explication conduirait à attribuer
mécaniquement les événements de mai à une dégradation des
conditions de vie des masses, elle-même due à la « malfaisance »
des monopoles au pouvoir. Comme l'a déjà noté Nicos Poulantzas
dans son livre Pouvoir politique et classes sociales (Maspero, 1968),
le caractère faussement radical de cette thèse qui postule la fusion
en un mécanisme unique de l'activité des monopoles et de l'acti-
vité gouvernementale, peut cacher l'opportunisme le plus plat
En effet, dans cette optique, il suffit de mettre hors d'état de
nuire quelques monopoleurs (par quelques nationalisations par
exemple) pour permettre l'établissement d'une démocratie véri-
table. Tout le problème des rapports de production capitalistes,
de leur ancrage dans le contexte social est ainsi esquivé, et par
voie de conséquence, tout le problème des structures de classe
de la société actuelle. En outre, cette thèse ne peut conduire qu'à
une sous-estimation de l'action politique et des rapports de force
politiques entre les classes et interdit de comprendre la spécificité
du régime politique en place depuis 1958 en tant que résultante
d'une constellation précise de relations politiques et économiques
entre les différentes couches de la société, et de rapports d'alliance
et d'oppositions.
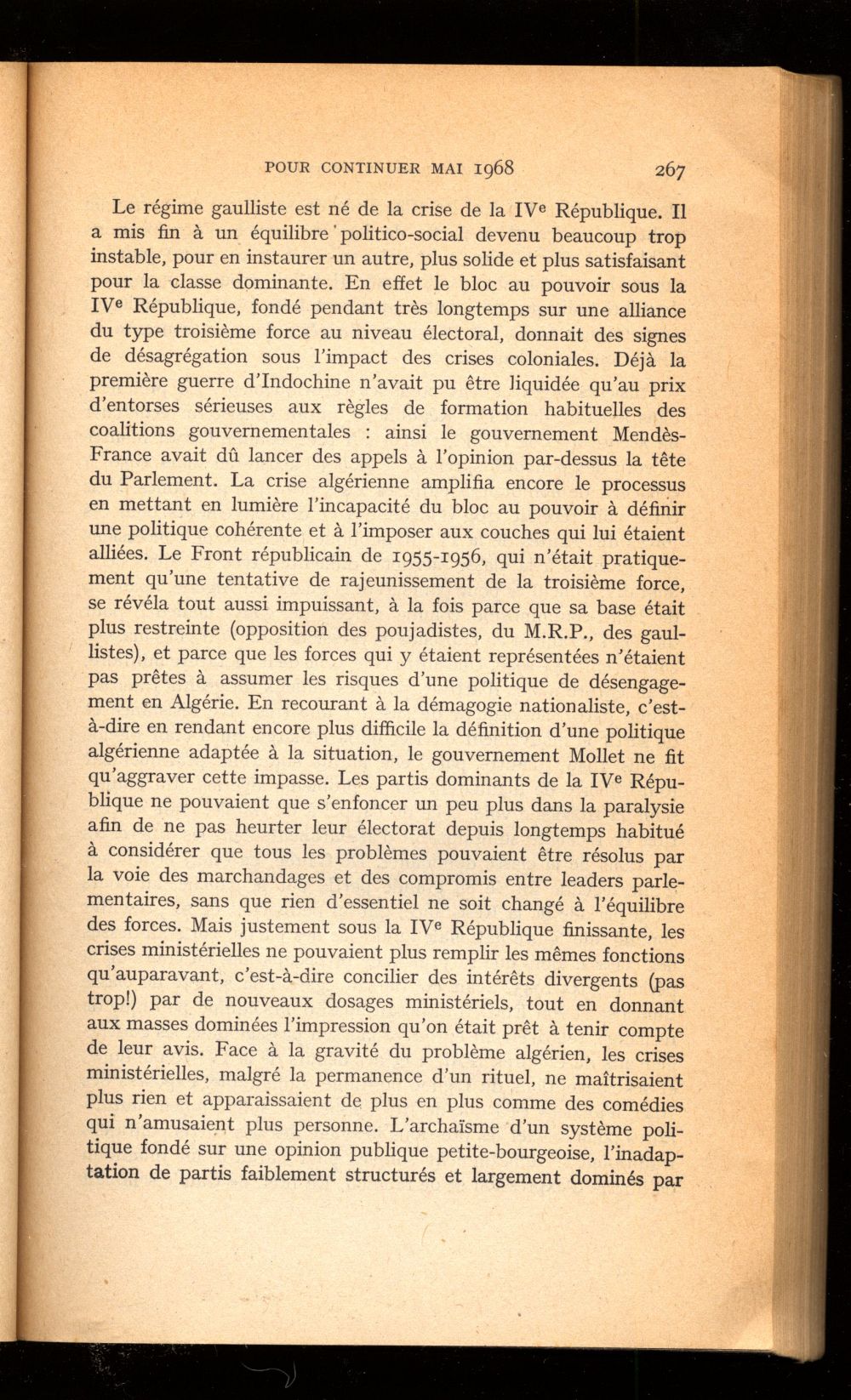

POUR CONTINUER MAI K
267
Le régime gaulliste est né de la crise de la IVe République. Il
a mis fin à un équilibre ' politico-social devenu beaucoup trop
instable, pour en instaurer un autre, plus solide et plus satisfaisant
pour la classe dominante. En effet le bloc au pouvoir sous la
IVe République, fondé pendant très longtemps sur une alliance
du type troisième force au niveau électoral, donnait des signes
de désagrégation sous l'impact des crises coloniales. Déjà la
première guerre d'Indochine n'avait pu être liquidée qu'au prix
d'entorses sérieuses aux règles de formation habituelles des
coalitions gouvernementales : ainsi le gouvernement Mendès-
France avait dû lancer des appels à l'opinion par-dessus la tête
du Parlement. La crise algérienne amplifia encore le processus
en mettant en lumière l'incapacité du bloc au pouvoir à définir
une politique cohérente et à l'imposer aux couches qui lui étaient
alliées. Le Front républicain de 1955-1956, qui n'était pratique-
ment qu'une tentative de rajeunissement de la troisième force,
se révéla tout aussi impuissant, à la fois parce que sa base était
plus restreinte (opposition des poujadistes, du M.R.P., des gaul-
listes), et parce que les forces qui y étaient représentées n'étaient
pas prêtes à assumer les risques d'une politique de désengage-
ment en Algérie. En recourant à la démagogie nationaliste, c'est-
à-dire en rendant encore plus difficile la définition d'une politique
algérienne adaptée à la situation, le gouvernement Mollet ne fit
qu'aggraver cette impasse. Les partis dominants de la IVe Répu-
blique ne pouvaient que s'enfoncer un peu plus dans la paralysie
afin de ne pas heurter leur électorat depuis longtemps habitué
à considérer que tous les problèmes pouvaient être résolus par
la voie des marchandages et des compromis entre leaders parle-
mentaires, sans que rien d'essentiel ne soit changé à l'équilibre
des forces. Mais justement sous la IVe République finissante, les
crises ministérielles ne pouvaient plus remplir les mêmes fonctions
qu'auparavant, c'est-à-dire concilier des intérêts divergents (pas
trop!) par de nouveaux dosages ministériels, tout en donnant
aux masses dominées l'impression qu'on était prêt à tenir compte
de leur avis. Face à la gravité du problème algérien, les crises
ministérielles, malgré la permanence d'un rituel, ne maîtrisaient
plus rien et apparaissaient de plus en plus comme des comédies
qui n'amusaient plus personne. L'archaïsme d'un système poli-
tique fondé sur une opinion publique petite-bourgeoise, l'inadap-
tation de partis faiblement structurés et largement dominés par
a mis fin à un équilibre ' politico-social devenu beaucoup trop
instable, pour en instaurer un autre, plus solide et plus satisfaisant
pour la classe dominante. En effet le bloc au pouvoir sous la
IVe République, fondé pendant très longtemps sur une alliance
du type troisième force au niveau électoral, donnait des signes
de désagrégation sous l'impact des crises coloniales. Déjà la
première guerre d'Indochine n'avait pu être liquidée qu'au prix
d'entorses sérieuses aux règles de formation habituelles des
coalitions gouvernementales : ainsi le gouvernement Mendès-
France avait dû lancer des appels à l'opinion par-dessus la tête
du Parlement. La crise algérienne amplifia encore le processus
en mettant en lumière l'incapacité du bloc au pouvoir à définir
une politique cohérente et à l'imposer aux couches qui lui étaient
alliées. Le Front républicain de 1955-1956, qui n'était pratique-
ment qu'une tentative de rajeunissement de la troisième force,
se révéla tout aussi impuissant, à la fois parce que sa base était
plus restreinte (opposition des poujadistes, du M.R.P., des gaul-
listes), et parce que les forces qui y étaient représentées n'étaient
pas prêtes à assumer les risques d'une politique de désengage-
ment en Algérie. En recourant à la démagogie nationaliste, c'est-
à-dire en rendant encore plus difficile la définition d'une politique
algérienne adaptée à la situation, le gouvernement Mollet ne fit
qu'aggraver cette impasse. Les partis dominants de la IVe Répu-
blique ne pouvaient que s'enfoncer un peu plus dans la paralysie
afin de ne pas heurter leur électorat depuis longtemps habitué
à considérer que tous les problèmes pouvaient être résolus par
la voie des marchandages et des compromis entre leaders parle-
mentaires, sans que rien d'essentiel ne soit changé à l'équilibre
des forces. Mais justement sous la IVe République finissante, les
crises ministérielles ne pouvaient plus remplir les mêmes fonctions
qu'auparavant, c'est-à-dire concilier des intérêts divergents (pas
trop!) par de nouveaux dosages ministériels, tout en donnant
aux masses dominées l'impression qu'on était prêt à tenir compte
de leur avis. Face à la gravité du problème algérien, les crises
ministérielles, malgré la permanence d'un rituel, ne maîtrisaient
plus rien et apparaissaient de plus en plus comme des comédies
qui n'amusaient plus personne. L'archaïsme d'un système poli-
tique fondé sur une opinion publique petite-bourgeoise, l'inadap-
tation de partis faiblement structurés et largement dominés par
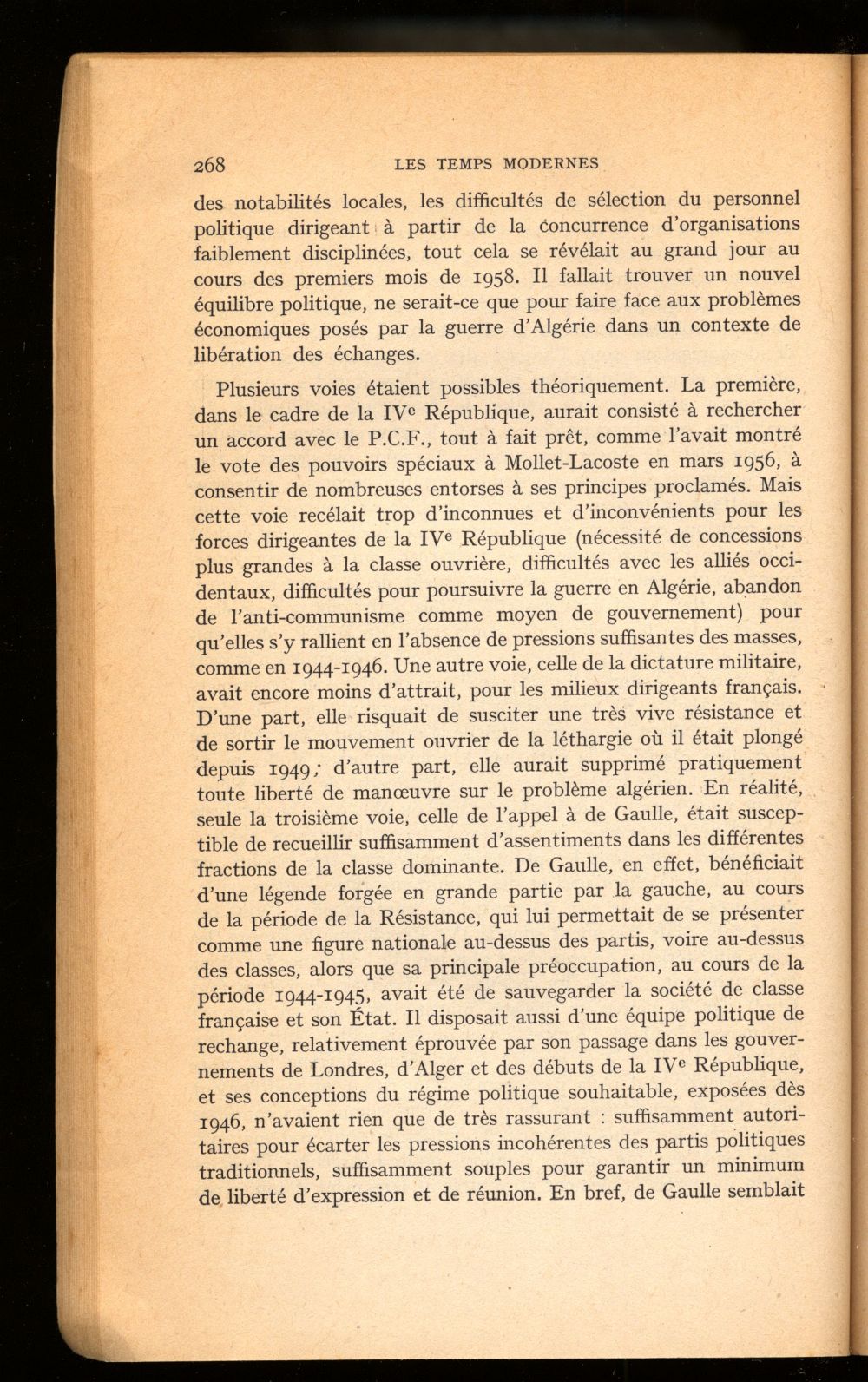

268
LES TEMPS MODERNES
des notabilités locales, les difficultés de sélection du personnel
politique dirigeant à partir de la concurrence d'organisations
faiblement disciplinées, tout cela se révélait au grand jour au
cours des premiers mois de 1958. Il fallait trouver un nouvel
équilibre politique, ne serait-ce que pour faire face aux problèmes
économiques posés par la guerre d'Algérie dans un contexte de
libération des échanges.
politique dirigeant à partir de la concurrence d'organisations
faiblement disciplinées, tout cela se révélait au grand jour au
cours des premiers mois de 1958. Il fallait trouver un nouvel
équilibre politique, ne serait-ce que pour faire face aux problèmes
économiques posés par la guerre d'Algérie dans un contexte de
libération des échanges.
Plusieurs voies étaient possibles théoriquement. La première,
dans le cadre de la IVe République, aurait consisté à rechercher
un accord avec le P.C.F., tout à fait prêt, comme l'avait montré
le vote des pouvoirs spéciaux à Mollet-Lacoste en mars 1956, à
consentir de nombreuses entorses à ses principes proclamés. Mais
cette voie recelait trop d'inconnues et d'inconvénients pour les
forces dirigeantes de la IVe République (nécessité de concessions
plus grandes à la classe ouvrière, difficultés avec les alliés occi-
dentaux, difficultés pour poursuivre la guerre en Algérie, abandon
de l'anti-communisme comme moyen de gouvernement) pour
qu'elles s'y rallient en l'absence de pressions suffisantes des masses,
comme en 1944-1946. Une autre voie, celle de la dictature militaire,
avait encore moins d'attrait, pour les milieux dirigeants français.
D'une part, elle risquait de susciter une très vive résistance et
de sortir le mouvement ouvrier de la léthargie où il était plongé
depuis 1949; d'autre part, elle aurait supprimé pratiquement
toute liberté de manœuvre sur le problème algérien. En réalité,
seule la troisième voie, celle de l'appel à de Gaulle, était suscep-
tible de recueillir suffisamment d'assentiments dans les différentes
fractions de la classe dominante. De Gaulle, en effet, bénéficiait
d'une légende forgée en grande partie par la gauche, au cours
de la période de la Résistance, qui lui permettait de se présenter
comme une figure nationale au-dessus des partis, voire au-dessus
des classes, alors que sa principale préoccupation, au cours de la
période 1944-1945, avait été de sauvegarder la société de classe
française et son État. Il disposait aussi d'une équipe politique de
rechange, relativement éprouvée par son passage dans les gouver-
nements de Londres, d'Alger et des débuts de la IVe République,
et ses conceptions du régime politique souhaitable, exposées dès
1946, n'avaient rien que de très rassurant : suffisamment autori-
taires pour écarter les pressions incohérentes des partis politiques
traditionnels, suffisamment souples pour garantir un minimum
de liberté d'expression et de réunion. En bref, de Gaulle semblait
dans le cadre de la IVe République, aurait consisté à rechercher
un accord avec le P.C.F., tout à fait prêt, comme l'avait montré
le vote des pouvoirs spéciaux à Mollet-Lacoste en mars 1956, à
consentir de nombreuses entorses à ses principes proclamés. Mais
cette voie recelait trop d'inconnues et d'inconvénients pour les
forces dirigeantes de la IVe République (nécessité de concessions
plus grandes à la classe ouvrière, difficultés avec les alliés occi-
dentaux, difficultés pour poursuivre la guerre en Algérie, abandon
de l'anti-communisme comme moyen de gouvernement) pour
qu'elles s'y rallient en l'absence de pressions suffisantes des masses,
comme en 1944-1946. Une autre voie, celle de la dictature militaire,
avait encore moins d'attrait, pour les milieux dirigeants français.
D'une part, elle risquait de susciter une très vive résistance et
de sortir le mouvement ouvrier de la léthargie où il était plongé
depuis 1949; d'autre part, elle aurait supprimé pratiquement
toute liberté de manœuvre sur le problème algérien. En réalité,
seule la troisième voie, celle de l'appel à de Gaulle, était suscep-
tible de recueillir suffisamment d'assentiments dans les différentes
fractions de la classe dominante. De Gaulle, en effet, bénéficiait
d'une légende forgée en grande partie par la gauche, au cours
de la période de la Résistance, qui lui permettait de se présenter
comme une figure nationale au-dessus des partis, voire au-dessus
des classes, alors que sa principale préoccupation, au cours de la
période 1944-1945, avait été de sauvegarder la société de classe
française et son État. Il disposait aussi d'une équipe politique de
rechange, relativement éprouvée par son passage dans les gouver-
nements de Londres, d'Alger et des débuts de la IVe République,
et ses conceptions du régime politique souhaitable, exposées dès
1946, n'avaient rien que de très rassurant : suffisamment autori-
taires pour écarter les pressions incohérentes des partis politiques
traditionnels, suffisamment souples pour garantir un minimum
de liberté d'expression et de réunion. En bref, de Gaulle semblait
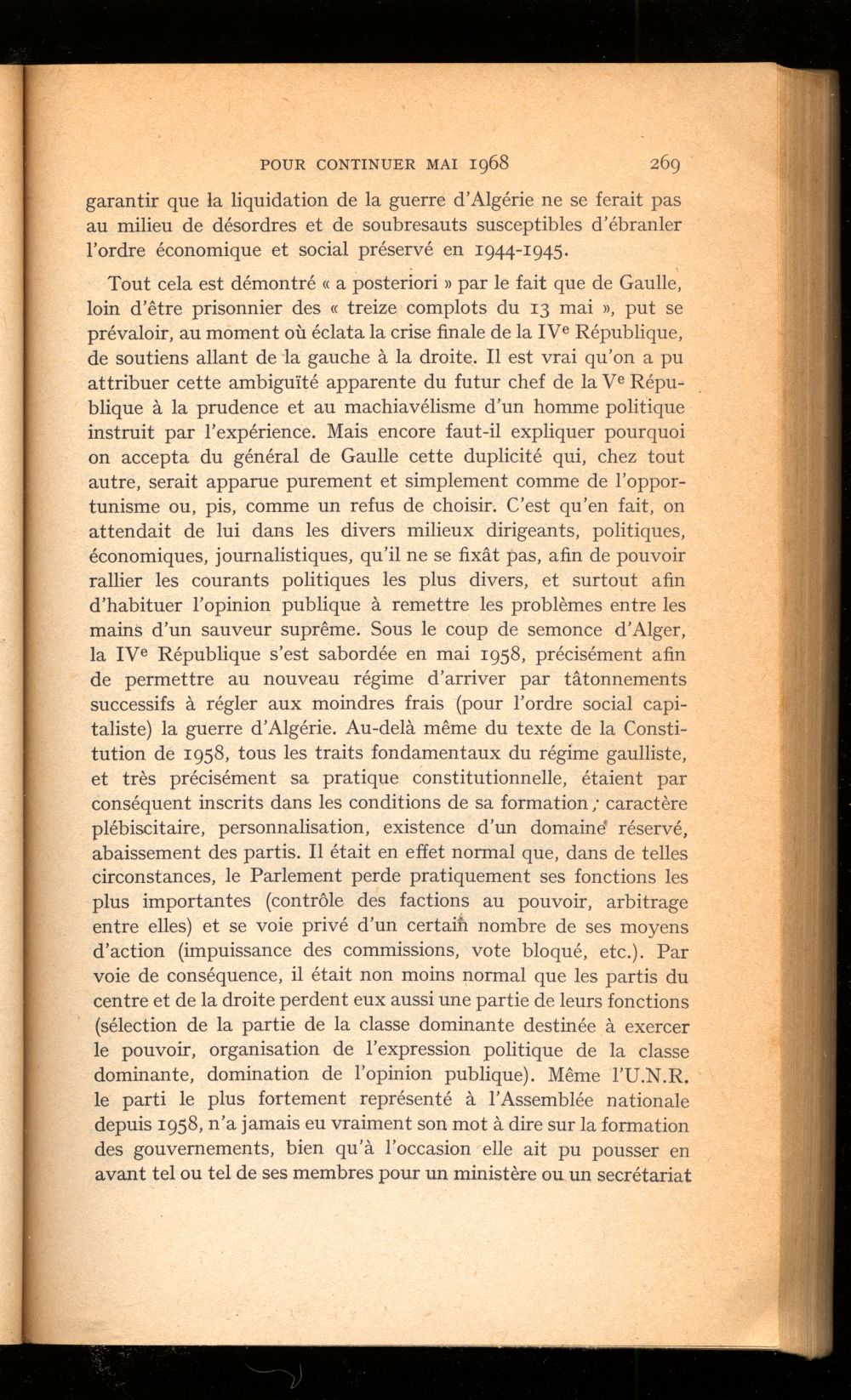

POUR CONTINUER MAI 1968
269
garantir que la liquidation de la guerre d'Algérie ne se ferait pas
au milieu de désordres et de soubresauts susceptibles d'ébranler
l'ordre économique et social préservé en 1944-1945.
au milieu de désordres et de soubresauts susceptibles d'ébranler
l'ordre économique et social préservé en 1944-1945.
Tout cela est démontré « a posteriori » par le fait que de Gaulle,
loin d'être prisonnier des « treize complots du 13 mai », put se
prévaloir, au moment où éclata la crise finale de la IVe République,
de soutiens allant de la gauche à la droite. Il est vrai qu'on a pu
attribuer cette ambiguïté apparente du futur chef de la Ve Répu-
blique à la prudence et au machiavélisme d'un homme politique
instruit par l'expérience. Mais encore faut-il expliquer pourquoi
on accepta du général de Gaulle cette duplicité qui, chez tout
autre, serait apparue purement et simplement comme de l'oppor-
tunisme ou, pis, comme un refus de choisir. C'est qu'en fait, on
attendait de lui dans les divers milieux dirigeants, politiques,
économiques, journalistiques, qu'il ne se fixât pas, afin de pouvoir
rallier les courants politiques les plus divers, et surtout afin
d'habituer l'opinion publique à remettre les problèmes entre les
mains d'un sauveur suprême. Sous le coup de semonce d'Alger,
la IVe République s'est sabordée en mai 1958, précisément afin
de permettre au nouveau régime d'arriver par tâtonnements
successifs à régler aux moindres frais (pour l'ordre social capi-
taliste) la guerre d'Algérie. Au-delà même du texte de la Consti-
tution de 1958, tous les traits fondamentaux du régime gaulliste,
et très précisément sa pratique constitutionnelle, étaient par
conséquent inscrits dans les conditions de sa formation; caractère
plébiscitaire, personnalisation, existence d'un domaine réservé,
abaissement des partis. Il était en effet normal que, dans de telles
circonstances, le Parlement perde pratiquement ses fonctions les
plus importantes (contrôle des factions au pouvoir, arbitrage
entre elles) et se voie privé d'un certain nombre de ses moyens
d'action (impuissance des commissions, vote bloqué, etc.). Par
voie de conséquence, il était non moins normal que les partis du
centre et de la droite perdent eux aussi une partie de leurs fonctions
(sélection de la partie de la classe dominante destinée à exercer
le pouvoir, organisation de l'expression politique de la classe
dominante, domination de l'opinion publique). Même l'U.N.R.
le parti le plus fortement représenté à l'Assemblée nationale
depuis 1958, n'a jamais eu vraiment son mot à dire sur la formation
des gouvernements, bien qu'à l'occasion elle ait pu pousser en
avant tel ou tel de ses membres pour un ministère ou un secrétariat
loin d'être prisonnier des « treize complots du 13 mai », put se
prévaloir, au moment où éclata la crise finale de la IVe République,
de soutiens allant de la gauche à la droite. Il est vrai qu'on a pu
attribuer cette ambiguïté apparente du futur chef de la Ve Répu-
blique à la prudence et au machiavélisme d'un homme politique
instruit par l'expérience. Mais encore faut-il expliquer pourquoi
on accepta du général de Gaulle cette duplicité qui, chez tout
autre, serait apparue purement et simplement comme de l'oppor-
tunisme ou, pis, comme un refus de choisir. C'est qu'en fait, on
attendait de lui dans les divers milieux dirigeants, politiques,
économiques, journalistiques, qu'il ne se fixât pas, afin de pouvoir
rallier les courants politiques les plus divers, et surtout afin
d'habituer l'opinion publique à remettre les problèmes entre les
mains d'un sauveur suprême. Sous le coup de semonce d'Alger,
la IVe République s'est sabordée en mai 1958, précisément afin
de permettre au nouveau régime d'arriver par tâtonnements
successifs à régler aux moindres frais (pour l'ordre social capi-
taliste) la guerre d'Algérie. Au-delà même du texte de la Consti-
tution de 1958, tous les traits fondamentaux du régime gaulliste,
et très précisément sa pratique constitutionnelle, étaient par
conséquent inscrits dans les conditions de sa formation; caractère
plébiscitaire, personnalisation, existence d'un domaine réservé,
abaissement des partis. Il était en effet normal que, dans de telles
circonstances, le Parlement perde pratiquement ses fonctions les
plus importantes (contrôle des factions au pouvoir, arbitrage
entre elles) et se voie privé d'un certain nombre de ses moyens
d'action (impuissance des commissions, vote bloqué, etc.). Par
voie de conséquence, il était non moins normal que les partis du
centre et de la droite perdent eux aussi une partie de leurs fonctions
(sélection de la partie de la classe dominante destinée à exercer
le pouvoir, organisation de l'expression politique de la classe
dominante, domination de l'opinion publique). Même l'U.N.R.
le parti le plus fortement représenté à l'Assemblée nationale
depuis 1958, n'a jamais eu vraiment son mot à dire sur la formation
des gouvernements, bien qu'à l'occasion elle ait pu pousser en
avant tel ou tel de ses membres pour un ministère ou un secrétariat
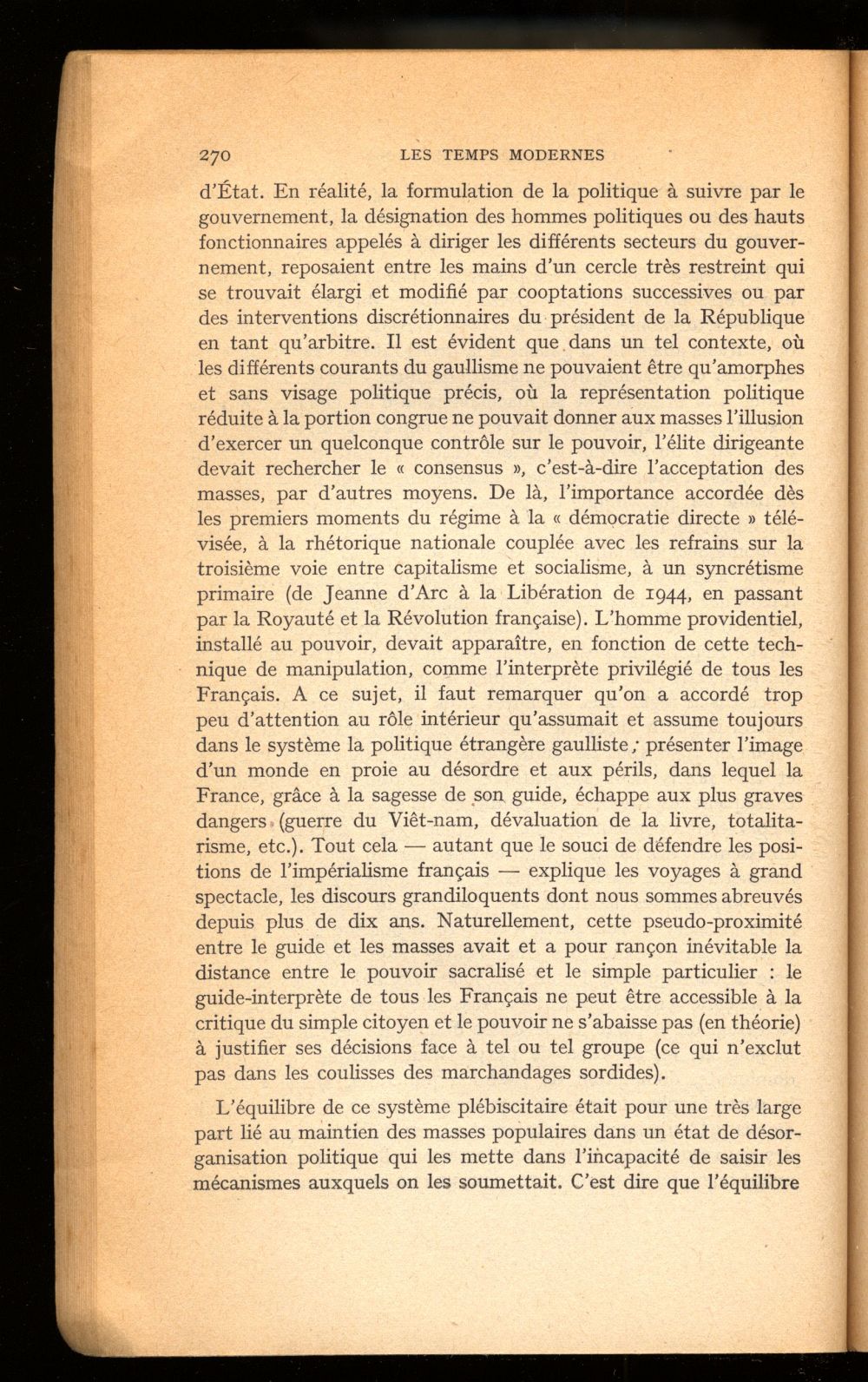

270
LES TEMPS MODERNES
d'État. En réalité, la formulation de la politique à suivre par le
gouvernement, la désignation des hommes politiques ou des hauts
fonctionnaires appelés à diriger les différents secteurs du gouver-
nement, reposaient entre les mains d'un cercle très restreint qui
se trouvait élargi et modifié par cooptations successives ou par
des interventions discrétionnaires du président de la République
en tant qu'arbitre. Il est évident que dans un tel contexte, où
les différents courants du gaullisme ne pouvaient être qu'amorphes
et sans visage politique précis, où la représentation politique
réduite à la portion congrue ne pouvait donner aux masses l'illusion
d'exercer un quelconque contrôle sur le pouvoir, l'élite dirigeante
devait rechercher le « consensus », c'est-à-dire l'acceptation des
masses, par d'autres moyens. De là, l'importance accordée dès
les premiers moments du régime à la « démocratie directe » télé-
visée, à la rhétorique nationale couplée avec les refrains sur la
troisième voie entre capitalisme et socialisme, à un syncrétisme
primaire (de Jeanne d'Arc à la Libération de 1944, en passant
par la Royauté et la Révolution française). L'homme providentiel,
installé au pouvoir, devait apparaître, en fonction de cette tech-
nique de manipulation, comme l'interprète privilégié de tous les
Français. A ce sujet, il faut remarquer qu'on a accordé trop
peu d'attention au rôle intérieur qu'assumait et assume toujours
dans le système la politique étrangère gaulliste; présenter l'image
d'un monde en proie au désordre et aux périls, dans lequel la
France, grâce à la sagesse de son guide, échappe aux plus graves
dangers (guerre du Viêt-nam, dévaluation de la livre, totalita-
risme, etc.). Tout cela — autant que le souci de défendre les posi-
tions de l'impérialisme français — explique les voyages à grand
spectacle, les discours grandiloquents dont nous sommes abreuvés
depuis plus de dix ans. Naturellement, cette pseudo-proximité
entre le guide et les masses avait et a pour rançon inévitable la
distance entre le pouvoir sacralisé et le simple particulier : le
guide-interprète de tous les Français ne peut être accessible à la
critique du simple citoyen et le pouvoir ne s'abaisse pas (en théorie)
à justifier ses décisions face à tel ou tel groupe (ce qui n'exclut
pas dans les coulisses des marchandages sordides).
gouvernement, la désignation des hommes politiques ou des hauts
fonctionnaires appelés à diriger les différents secteurs du gouver-
nement, reposaient entre les mains d'un cercle très restreint qui
se trouvait élargi et modifié par cooptations successives ou par
des interventions discrétionnaires du président de la République
en tant qu'arbitre. Il est évident que dans un tel contexte, où
les différents courants du gaullisme ne pouvaient être qu'amorphes
et sans visage politique précis, où la représentation politique
réduite à la portion congrue ne pouvait donner aux masses l'illusion
d'exercer un quelconque contrôle sur le pouvoir, l'élite dirigeante
devait rechercher le « consensus », c'est-à-dire l'acceptation des
masses, par d'autres moyens. De là, l'importance accordée dès
les premiers moments du régime à la « démocratie directe » télé-
visée, à la rhétorique nationale couplée avec les refrains sur la
troisième voie entre capitalisme et socialisme, à un syncrétisme
primaire (de Jeanne d'Arc à la Libération de 1944, en passant
par la Royauté et la Révolution française). L'homme providentiel,
installé au pouvoir, devait apparaître, en fonction de cette tech-
nique de manipulation, comme l'interprète privilégié de tous les
Français. A ce sujet, il faut remarquer qu'on a accordé trop
peu d'attention au rôle intérieur qu'assumait et assume toujours
dans le système la politique étrangère gaulliste; présenter l'image
d'un monde en proie au désordre et aux périls, dans lequel la
France, grâce à la sagesse de son guide, échappe aux plus graves
dangers (guerre du Viêt-nam, dévaluation de la livre, totalita-
risme, etc.). Tout cela — autant que le souci de défendre les posi-
tions de l'impérialisme français — explique les voyages à grand
spectacle, les discours grandiloquents dont nous sommes abreuvés
depuis plus de dix ans. Naturellement, cette pseudo-proximité
entre le guide et les masses avait et a pour rançon inévitable la
distance entre le pouvoir sacralisé et le simple particulier : le
guide-interprète de tous les Français ne peut être accessible à la
critique du simple citoyen et le pouvoir ne s'abaisse pas (en théorie)
à justifier ses décisions face à tel ou tel groupe (ce qui n'exclut
pas dans les coulisses des marchandages sordides).
L'équilibre de ce système plébiscitaire était pour une très large
part lié au maintien des masses populaires dans un état de désor-
ganisation politique qui les mette dans l'incapacité de saisir les
mécanismes auxquels on les soumettait. C'est dire que l'équilibre
part lié au maintien des masses populaires dans un état de désor-
ganisation politique qui les mette dans l'incapacité de saisir les
mécanismes auxquels on les soumettait. C'est dire que l'équilibre
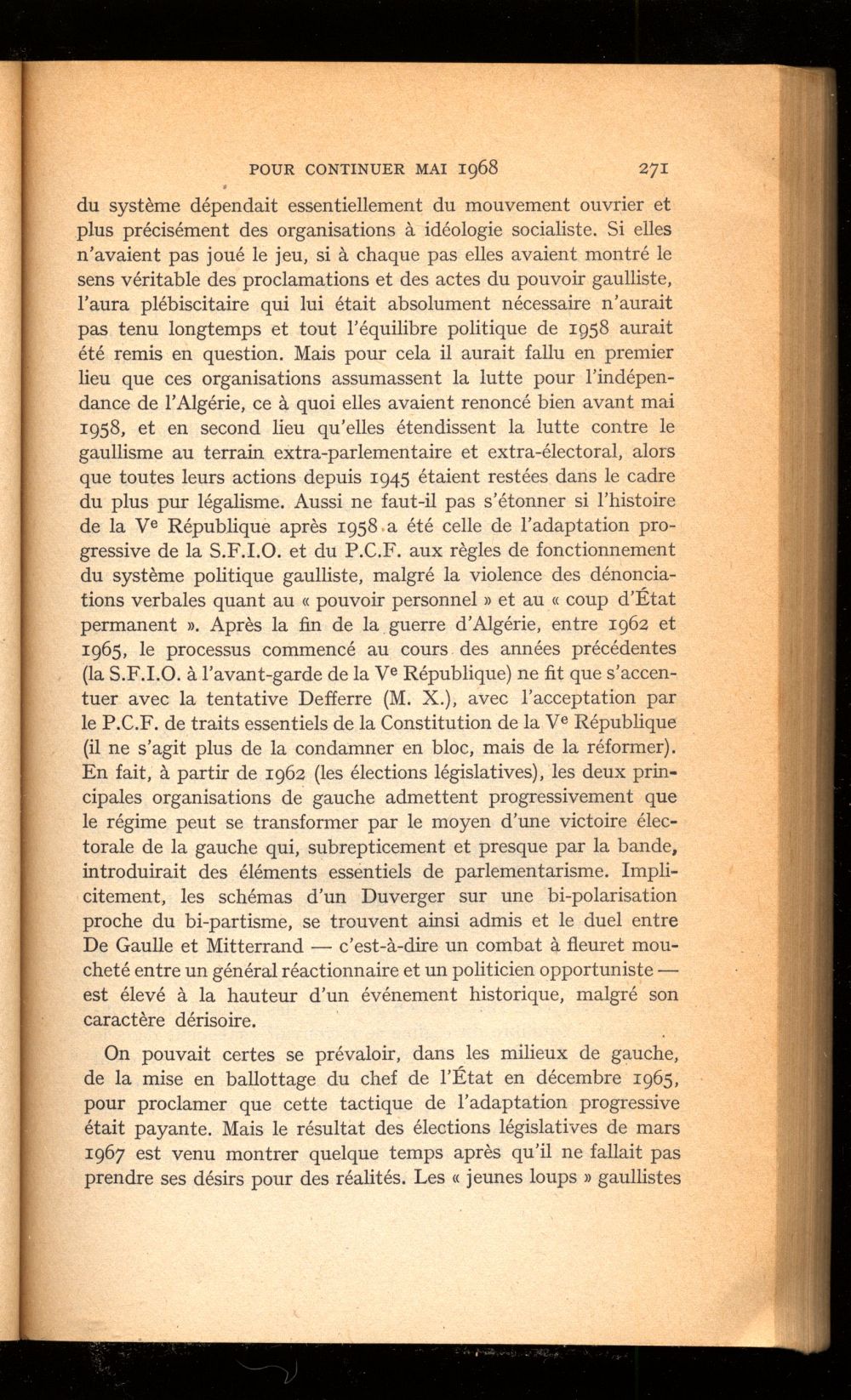

POUR CONTINUER MAI 1968
271
du système dépendait essentiellement du mouvement ouvrier et
plus précisément des organisations à idéologie socialiste. Si elles
n'avaient pas joué le jeu, si à chaque pas elles avaient montré le
sens véritable des proclamations et des actes du pouvoir gaulliste,
l'aura plébiscitaire qui lui était absolument nécessaire n'aurait
pas tenu longtemps et tout l'équilibre politique de 1958 aurait
été remis en question. Mais pour cela il aurait fallu en premier
lieu que ces organisations assumassent la lutte pour l'indépen-
dance de l'Algérie, ce à quoi elles avaient renoncé bien avant mai
1958, et en second lieu qu'elles étendissent la lutte contre le
gaullisme au terrain extra-parlementaire et extra-électoral, alors
que toutes leurs actions depuis 1945 étaient restées dans le cadre
du plus pur légalisme. Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'histoire
de la Ve République après 1958 a été celle de l'adaptation pro-
gressive de la S.F.I.O. et du P.C.F. aux règles de fonctionnement
du système politique gaulliste, malgré la violence des dénoncia-
tions verbales quant au « pouvoir personnel » et au « coup d'État
permanent ». Après la fin de la guerre d'Algérie, entre 1962 et
1965, le processus commencé au cours des années précédentes
(la S.F.I.O. à l'avant-garde de la Ve République) ne fit que s'accen-
tuer avec la tentative Defferre (M. X.), avec l'acceptation par
le P.C.F. de traits essentiels de la Constitution de la Ve République
(il ne s'agit plus de la condamner en bloc, mais de la réformer).
En fait, à partir de 1962 (les élections législatives), les deux prin-
cipales organisations de gauche admettent progressivement que
le régime peut se transformer par le moyen d'une victoire élec-
torale de la gauche qui, subrepticement et presque par la bande,
introduirait des éléments essentiels de parlementarisme. Impli-
citement, les schémas d'un Duverger sur une bi-polarisation
proche du bi-partisme, se trouvent ainsi admis et le duel entre
De Gaulle et Mitterrand — c'est-à-dire un combat à fleuret mou-
cheté entre un général réactionnaire et un politicien opportuniste —
est élevé à la hauteur d'un événement historique, malgré son
caractère dérisoire.
plus précisément des organisations à idéologie socialiste. Si elles
n'avaient pas joué le jeu, si à chaque pas elles avaient montré le
sens véritable des proclamations et des actes du pouvoir gaulliste,
l'aura plébiscitaire qui lui était absolument nécessaire n'aurait
pas tenu longtemps et tout l'équilibre politique de 1958 aurait
été remis en question. Mais pour cela il aurait fallu en premier
lieu que ces organisations assumassent la lutte pour l'indépen-
dance de l'Algérie, ce à quoi elles avaient renoncé bien avant mai
1958, et en second lieu qu'elles étendissent la lutte contre le
gaullisme au terrain extra-parlementaire et extra-électoral, alors
que toutes leurs actions depuis 1945 étaient restées dans le cadre
du plus pur légalisme. Aussi ne faut-il pas s'étonner si l'histoire
de la Ve République après 1958 a été celle de l'adaptation pro-
gressive de la S.F.I.O. et du P.C.F. aux règles de fonctionnement
du système politique gaulliste, malgré la violence des dénoncia-
tions verbales quant au « pouvoir personnel » et au « coup d'État
permanent ». Après la fin de la guerre d'Algérie, entre 1962 et
1965, le processus commencé au cours des années précédentes
(la S.F.I.O. à l'avant-garde de la Ve République) ne fit que s'accen-
tuer avec la tentative Defferre (M. X.), avec l'acceptation par
le P.C.F. de traits essentiels de la Constitution de la Ve République
(il ne s'agit plus de la condamner en bloc, mais de la réformer).
En fait, à partir de 1962 (les élections législatives), les deux prin-
cipales organisations de gauche admettent progressivement que
le régime peut se transformer par le moyen d'une victoire élec-
torale de la gauche qui, subrepticement et presque par la bande,
introduirait des éléments essentiels de parlementarisme. Impli-
citement, les schémas d'un Duverger sur une bi-polarisation
proche du bi-partisme, se trouvent ainsi admis et le duel entre
De Gaulle et Mitterrand — c'est-à-dire un combat à fleuret mou-
cheté entre un général réactionnaire et un politicien opportuniste —
est élevé à la hauteur d'un événement historique, malgré son
caractère dérisoire.
On pouvait certes se prévaloir, dans les milieux de gauche,
de la mise en ballottage du chef de l'État en décembre 1965,
pour proclamer que cette tactique de l'adaptation progressive
était payante. Mais le résultat des élections législatives de mars
1967 est venu montrer quelque temps après qu'il ne fallait pas
prendre ses désirs pour des réalités. Les « jeunes loups » gaullistes
de la mise en ballottage du chef de l'État en décembre 1965,
pour proclamer que cette tactique de l'adaptation progressive
était payante. Mais le résultat des élections législatives de mars
1967 est venu montrer quelque temps après qu'il ne fallait pas
prendre ses désirs pour des réalités. Les « jeunes loups » gaullistes
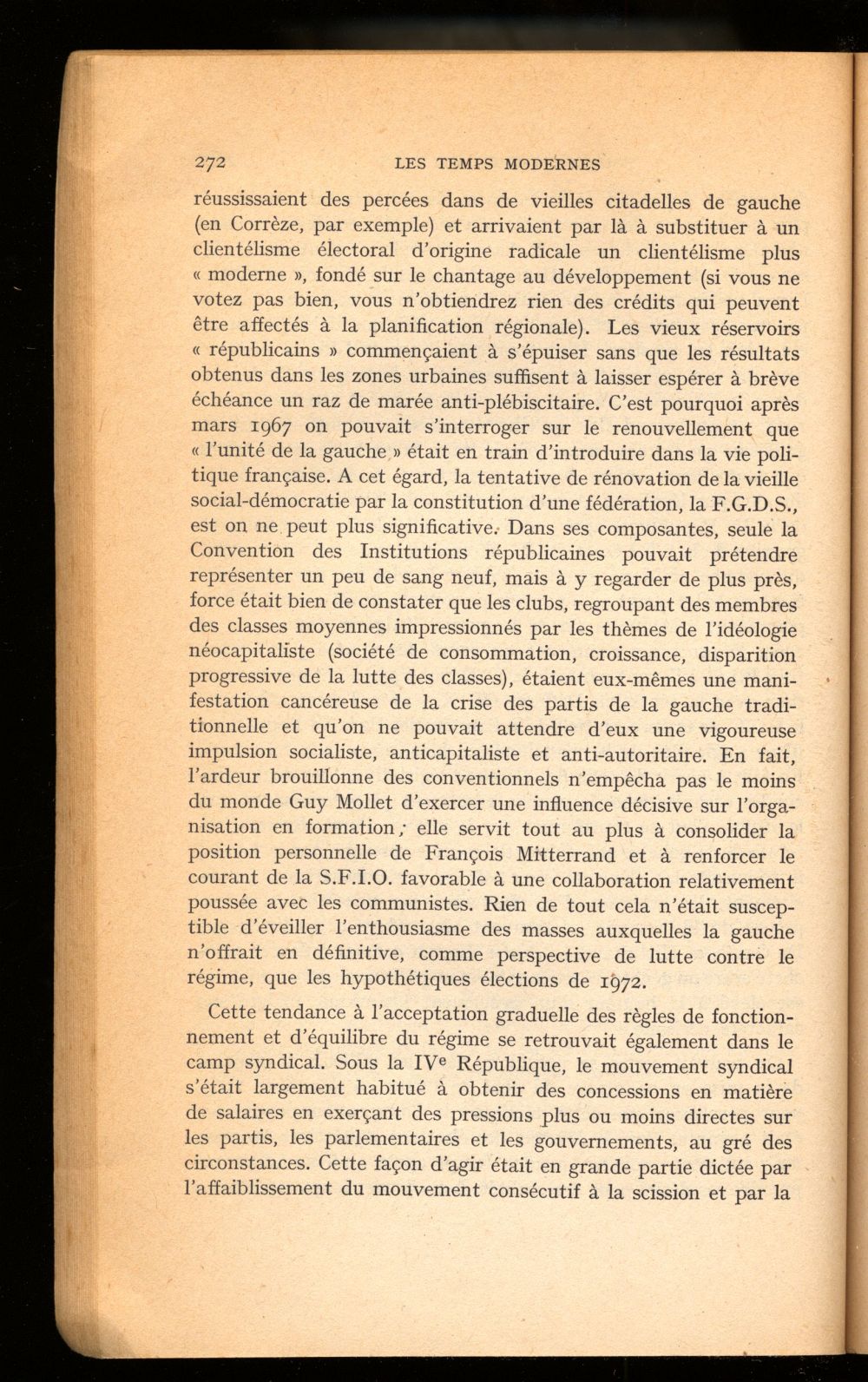

272
LES TEMPS MODERNES
réussissaient des percées dans de vieilles citadelles de gauche
(en Corrèze, par exemple) et arrivaient par là à substituer à un
clientélisme électoral d'origine radicale un clientélisme plus
« moderne », fondé sur le chantage au développement (si vous ne
votez pas bien, vous n'obtiendrez rien des crédits qui peuvent
être affectés à la planification régionale). Les vieux réservoirs
« républicains » commençaient à s'épuiser sans que les résultats
obtenus dans les zones urbaines suffisent à laisser espérer à brève
échéance un raz de marée anti-plébiscitaire. C'est pourquoi après
mars 1967 on pouvait s'interroger sur le renouvellement que
« l'unité de la gauche » était en train d'introduire dans la vie poli-
tique française. A cet égard, la tentative de rénovation de la vieille
social-démocratie par la constitution d'une fédération, la F.G.D.S.,
est on ne peut plus significative. Dans ses composantes, seule la
Convention des Institutions républicaines pouvait prétendre
représenter un peu de sang neuf, mais à y regarder de plus près,
force était bien de constater que les clubs, regroupant des membres
des classes moyennes impressionnés par les thèmes de l'idéologie
néocapitaliste (société de consommation, croissance, disparition
progressive de la lutte des classes), étaient eux-mêmes une mani-
festation cancéreuse de la crise des partis de la gauche tradi-
tionnelle et qu'on ne pouvait attendre d'eux une vigoureuse
impulsion socialiste, anticapitaliste et anti-autoritaire. En fait,
l'ardeur brouillonne des conventionnels n'empêcha pas le moins
du monde Guy Mollet d'exercer une influence décisive sur l'orga-
nisation en formation; elle servit tout au plus à consolider la
position personnelle de François Mitterrand et à renforcer le
courant de la S.F.I.O. favorable à une collaboration relativement
poussée avec les communistes. Rien de tout cela n'était suscep-
tible d'éveiller l'enthousiasme des masses auxquelles la gauche
n'offrait en définitive, comme perspective de lutte contre le
régime, que les hypothétiques élections de 1972.
(en Corrèze, par exemple) et arrivaient par là à substituer à un
clientélisme électoral d'origine radicale un clientélisme plus
« moderne », fondé sur le chantage au développement (si vous ne
votez pas bien, vous n'obtiendrez rien des crédits qui peuvent
être affectés à la planification régionale). Les vieux réservoirs
« républicains » commençaient à s'épuiser sans que les résultats
obtenus dans les zones urbaines suffisent à laisser espérer à brève
échéance un raz de marée anti-plébiscitaire. C'est pourquoi après
mars 1967 on pouvait s'interroger sur le renouvellement que
« l'unité de la gauche » était en train d'introduire dans la vie poli-
tique française. A cet égard, la tentative de rénovation de la vieille
social-démocratie par la constitution d'une fédération, la F.G.D.S.,
est on ne peut plus significative. Dans ses composantes, seule la
Convention des Institutions républicaines pouvait prétendre
représenter un peu de sang neuf, mais à y regarder de plus près,
force était bien de constater que les clubs, regroupant des membres
des classes moyennes impressionnés par les thèmes de l'idéologie
néocapitaliste (société de consommation, croissance, disparition
progressive de la lutte des classes), étaient eux-mêmes une mani-
festation cancéreuse de la crise des partis de la gauche tradi-
tionnelle et qu'on ne pouvait attendre d'eux une vigoureuse
impulsion socialiste, anticapitaliste et anti-autoritaire. En fait,
l'ardeur brouillonne des conventionnels n'empêcha pas le moins
du monde Guy Mollet d'exercer une influence décisive sur l'orga-
nisation en formation; elle servit tout au plus à consolider la
position personnelle de François Mitterrand et à renforcer le
courant de la S.F.I.O. favorable à une collaboration relativement
poussée avec les communistes. Rien de tout cela n'était suscep-
tible d'éveiller l'enthousiasme des masses auxquelles la gauche
n'offrait en définitive, comme perspective de lutte contre le
régime, que les hypothétiques élections de 1972.
Cette tendance à l'acceptation graduelle des règles de fonction-
nement et d'équilibre du régime se retrouvait également dans le
camp syndical. Sous la IVe République, le mouvement syndical
s'était largement habitué à obtenir des concessions en matière
de salaires en exerçant des pressions plus ou moins directes sur
les partis, les parlementaires et les gouvernements, au gré des
circonstances. Cette façon d'agir était en grande partie dictée par
l'affaiblissement du mouvement consécutif à la scission et par la
nement et d'équilibre du régime se retrouvait également dans le
camp syndical. Sous la IVe République, le mouvement syndical
s'était largement habitué à obtenir des concessions en matière
de salaires en exerçant des pressions plus ou moins directes sur
les partis, les parlementaires et les gouvernements, au gré des
circonstances. Cette façon d'agir était en grande partie dictée par
l'affaiblissement du mouvement consécutif à la scission et par la
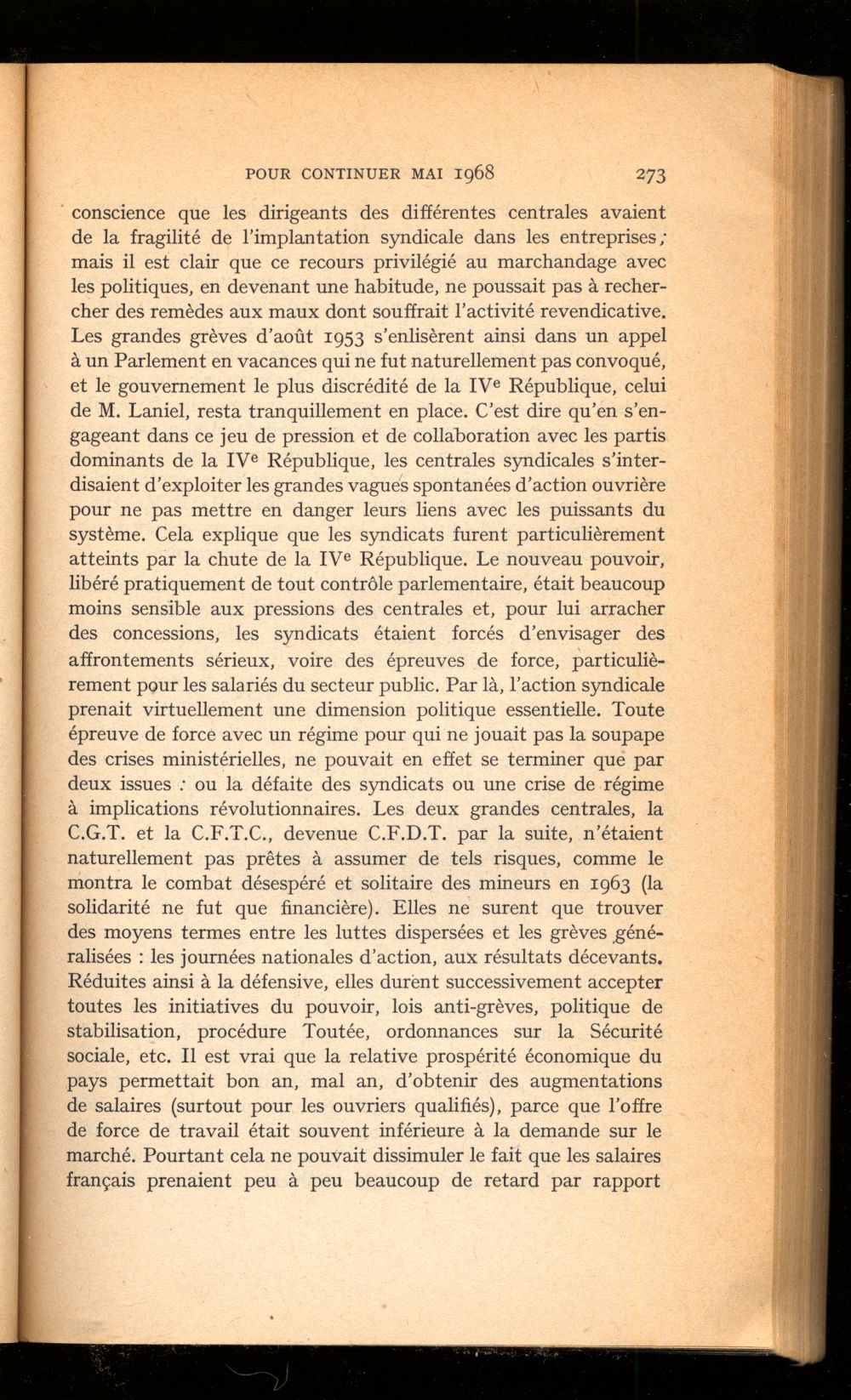

POUR CONTINUER MAI 1968
273
conscience que les dirigeants des différentes centrales avaient
de la fragilité de l'implantation syndicale dans les entreprises;
mais il est clair que ce recours privilégié au marchandage avec
les politiques, en devenant une habitude, ne poussait pas à recher-
cher des remèdes aux maux dont souffrait l'activité revendicative.
Les grandes grèves d'août 1953 s'enlisèrent ainsi dans un appel
à un Parlement en vacances qui ne fut naturellement pas convoqué,
et le gouvernement le plus discrédité de la IVe République, celui
de M. Laniel, resta tranquillement en place. C'est dire qu'en s'en-
gageant dans ce jeu de pression et de collaboration avec les partis
dominants de la IVe République, les centrales syndicales s'inter-
disaient d'exploiter les grandes vagues spontanées d'action ouvrière
pour ne pas mettre en danger leurs liens avec les puissants du
système. Cela explique que les syndicats furent particulièrement
atteints par la chute de la IVe République. Le nouveau pouvoir,
libéré pratiquement de tout contrôle parlementaire, était beaucoup
moins sensible aux pressions des centrales et, pour lui arracher
des concessions, les syndicats étaient forcés d'envisager des
affrontements sérieux, voire des épreuves de force, particuliè-
rement pour les salariés du secteur public. Par là, l'action syndicale
prenait virtuellement une dimension politique essentielle. Toute
épreuve de force avec un régime pour qui ne jouait pas la soupape
des crises ministérielles, ne pouvait en effet se terminer que par
deux issues : ou la défaite des syndicats ou une crise de régime
à implications révolutionnaires. Les deux grandes centrales, la
C.G.T. et la C.F.T.C., devenue C.F.D.T. par la suite, n'étaient
naturellement pas prêtes à assumer de tels risques, comme le
montra le combat désespéré et solitaire des mineurs en 1963 (la
solidarité ne fut que financière). Elles ne surent que trouver
des moyens termes entre les luttes dispersées et les grèves .géné-
ralisées : les journées nationales d'action, aux résultats décevants.
Réduites ainsi à la défensive, elles durent successivement accepter
toutes les initiatives du pouvoir, lois anti-grèves, politique de
stabilisation, procédure Toutée, ordonnances sur la Sécurité
sociale, etc. Il est vrai que la relative prospérité économique du
pays permettait bon an, mal an, d'obtenir des augmentations
de salaires (surtout pour les ouvriers qualifiés), parce que l'offre
de force de travail était souvent inférieure à la demande sur le
marché. Pourtant cela ne pouvait dissimuler le fait que les salaires
français prenaient peu à peu beaucoup de retard par rapport
de la fragilité de l'implantation syndicale dans les entreprises;
mais il est clair que ce recours privilégié au marchandage avec
les politiques, en devenant une habitude, ne poussait pas à recher-
cher des remèdes aux maux dont souffrait l'activité revendicative.
Les grandes grèves d'août 1953 s'enlisèrent ainsi dans un appel
à un Parlement en vacances qui ne fut naturellement pas convoqué,
et le gouvernement le plus discrédité de la IVe République, celui
de M. Laniel, resta tranquillement en place. C'est dire qu'en s'en-
gageant dans ce jeu de pression et de collaboration avec les partis
dominants de la IVe République, les centrales syndicales s'inter-
disaient d'exploiter les grandes vagues spontanées d'action ouvrière
pour ne pas mettre en danger leurs liens avec les puissants du
système. Cela explique que les syndicats furent particulièrement
atteints par la chute de la IVe République. Le nouveau pouvoir,
libéré pratiquement de tout contrôle parlementaire, était beaucoup
moins sensible aux pressions des centrales et, pour lui arracher
des concessions, les syndicats étaient forcés d'envisager des
affrontements sérieux, voire des épreuves de force, particuliè-
rement pour les salariés du secteur public. Par là, l'action syndicale
prenait virtuellement une dimension politique essentielle. Toute
épreuve de force avec un régime pour qui ne jouait pas la soupape
des crises ministérielles, ne pouvait en effet se terminer que par
deux issues : ou la défaite des syndicats ou une crise de régime
à implications révolutionnaires. Les deux grandes centrales, la
C.G.T. et la C.F.T.C., devenue C.F.D.T. par la suite, n'étaient
naturellement pas prêtes à assumer de tels risques, comme le
montra le combat désespéré et solitaire des mineurs en 1963 (la
solidarité ne fut que financière). Elles ne surent que trouver
des moyens termes entre les luttes dispersées et les grèves .géné-
ralisées : les journées nationales d'action, aux résultats décevants.
Réduites ainsi à la défensive, elles durent successivement accepter
toutes les initiatives du pouvoir, lois anti-grèves, politique de
stabilisation, procédure Toutée, ordonnances sur la Sécurité
sociale, etc. Il est vrai que la relative prospérité économique du
pays permettait bon an, mal an, d'obtenir des augmentations
de salaires (surtout pour les ouvriers qualifiés), parce que l'offre
de force de travail était souvent inférieure à la demande sur le
marché. Pourtant cela ne pouvait dissimuler le fait que les salaires
français prenaient peu à peu beaucoup de retard par rapport
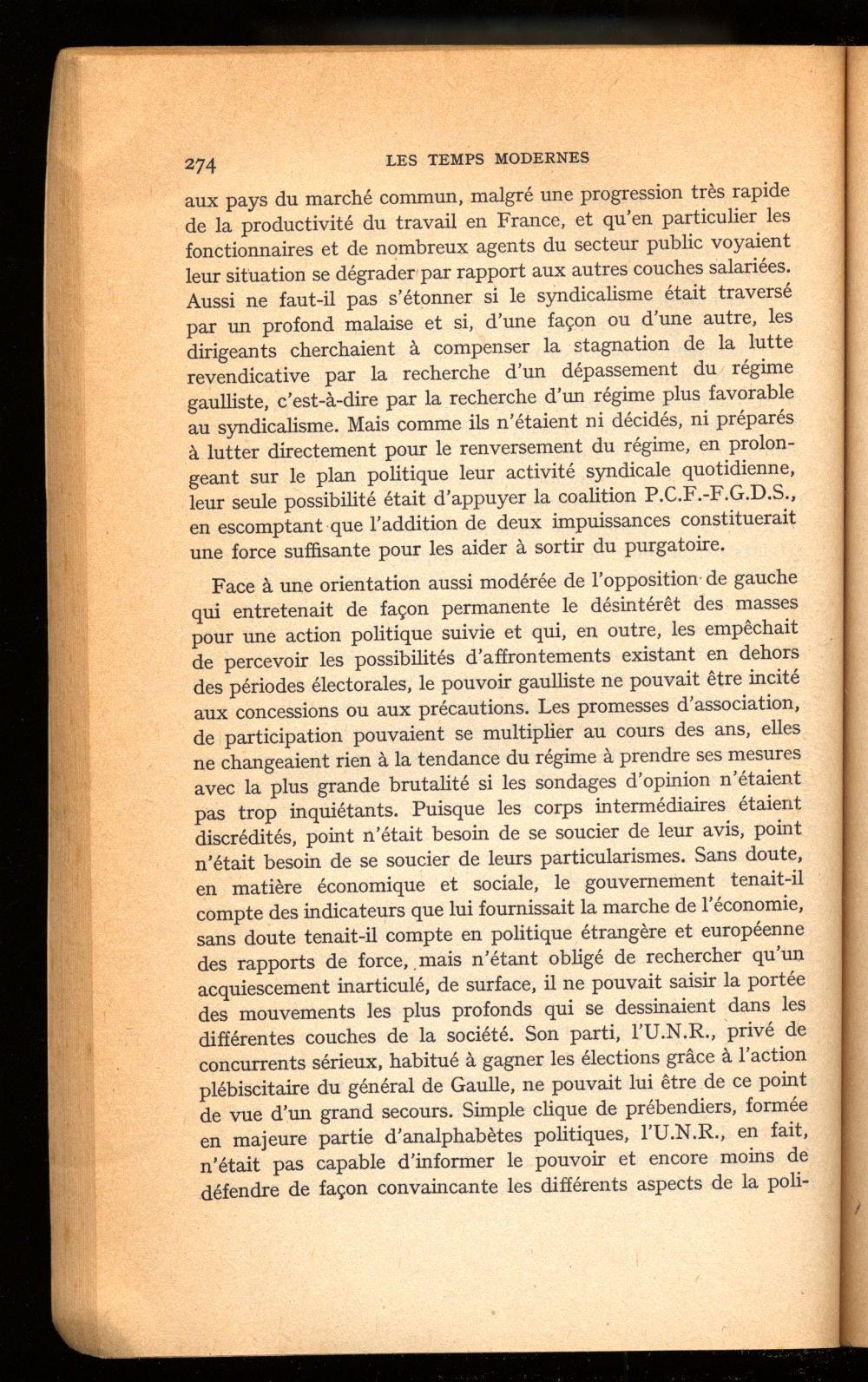

274
LES TEMPS MODERNES
aux pays du marché commun, malgré une progression très rapide
de la productivité du travail en France, et qu'en particulier les
fonctionnaires et de nombreux agents du secteur public voyaient
leur situation se dégrader par rapport aux autres couches salariées.
Aussi ne faut-il pas s'étonner si le syndicalisme était traversé
par un profond malaise et si, d'une façon ou d'une autre, les
dirigeants cherchaient à compenser la stagnation de la lutte
revendicative par la recherche d'un dépassement du régime
gaulliste, c'est-à-dire par la recherche d'un régime plus favorable
au syndicalisme. Mais comme ils n'étaient ni décidés, ni préparés
à lutter directement pour le renversement du régime, en prolon-
geant sur le plan politique leur activité syndicale quotidienne,
leur seule possibilité était d'appuyer la coalition P.C.F.-F.G.D.S.,
en escomptant que l'addition de deux impuissances constituerait
une force suffisante pour les aider à sortir du purgatoire.
de la productivité du travail en France, et qu'en particulier les
fonctionnaires et de nombreux agents du secteur public voyaient
leur situation se dégrader par rapport aux autres couches salariées.
Aussi ne faut-il pas s'étonner si le syndicalisme était traversé
par un profond malaise et si, d'une façon ou d'une autre, les
dirigeants cherchaient à compenser la stagnation de la lutte
revendicative par la recherche d'un dépassement du régime
gaulliste, c'est-à-dire par la recherche d'un régime plus favorable
au syndicalisme. Mais comme ils n'étaient ni décidés, ni préparés
à lutter directement pour le renversement du régime, en prolon-
geant sur le plan politique leur activité syndicale quotidienne,
leur seule possibilité était d'appuyer la coalition P.C.F.-F.G.D.S.,
en escomptant que l'addition de deux impuissances constituerait
une force suffisante pour les aider à sortir du purgatoire.
Face à une orientation aussi modérée de l'opposition de gauche
qui entretenait de façon permanente le désintérêt des masses
pour une action politique suivie et qui, en outre, les empêchait
de percevoir les possibilités d'affrontements existant en dehors
des périodes électorales, le pouvoir gaulliste ne pouvait être incité
aux concessions ou aux précautions. Les promesses d'association,
de participation pouvaient se multiplier au cours des ans, elles
ne changeaient rien à la tendance du régime à prendre ses mesures
avec la plus grande brutalité si les sondages d'opinion n'étaient
pas trop inquiétants. Puisque les corps intermédiaires étaient
discrédités, point n'était besoin de se soucier de leur avis, point
n'était besoin de se soucier de leurs particularismes. Sans doute,
en matière économique et sociale, le gouvernement tenait-il
compte des indicateurs que lui fournissait la marche de l'économie,
sans doute tenait-il compte en politique étrangère et européenne
des rapports de force, mais n'étant obligé de rechercher qu'un
acquiescement inarticulé, de surface, il ne pouvait saisir la portée
des mouvements les plus profonds qui se dessinaient dans les
différentes couches de la société. Son parti, l'U.N.R., privé de
concurrents sérieux, habitué à gagner les élections grâce à l'action
plébiscitaire du général de Gaulle, ne pouvait lui être de ce point
de vue d'un grand secours. Simple clique de prébendiers, formée
en majeure partie d'analphabètes politiques, l'U.N.R., en fait,
n'était pas capable d'informer le pouvoir et encore moins de
défendre de façon convaincante les différents aspects de la poli-
qui entretenait de façon permanente le désintérêt des masses
pour une action politique suivie et qui, en outre, les empêchait
de percevoir les possibilités d'affrontements existant en dehors
des périodes électorales, le pouvoir gaulliste ne pouvait être incité
aux concessions ou aux précautions. Les promesses d'association,
de participation pouvaient se multiplier au cours des ans, elles
ne changeaient rien à la tendance du régime à prendre ses mesures
avec la plus grande brutalité si les sondages d'opinion n'étaient
pas trop inquiétants. Puisque les corps intermédiaires étaient
discrédités, point n'était besoin de se soucier de leur avis, point
n'était besoin de se soucier de leurs particularismes. Sans doute,
en matière économique et sociale, le gouvernement tenait-il
compte des indicateurs que lui fournissait la marche de l'économie,
sans doute tenait-il compte en politique étrangère et européenne
des rapports de force, mais n'étant obligé de rechercher qu'un
acquiescement inarticulé, de surface, il ne pouvait saisir la portée
des mouvements les plus profonds qui se dessinaient dans les
différentes couches de la société. Son parti, l'U.N.R., privé de
concurrents sérieux, habitué à gagner les élections grâce à l'action
plébiscitaire du général de Gaulle, ne pouvait lui être de ce point
de vue d'un grand secours. Simple clique de prébendiers, formée
en majeure partie d'analphabètes politiques, l'U.N.R., en fait,
n'était pas capable d'informer le pouvoir et encore moins de
défendre de façon convaincante les différents aspects de la poli-
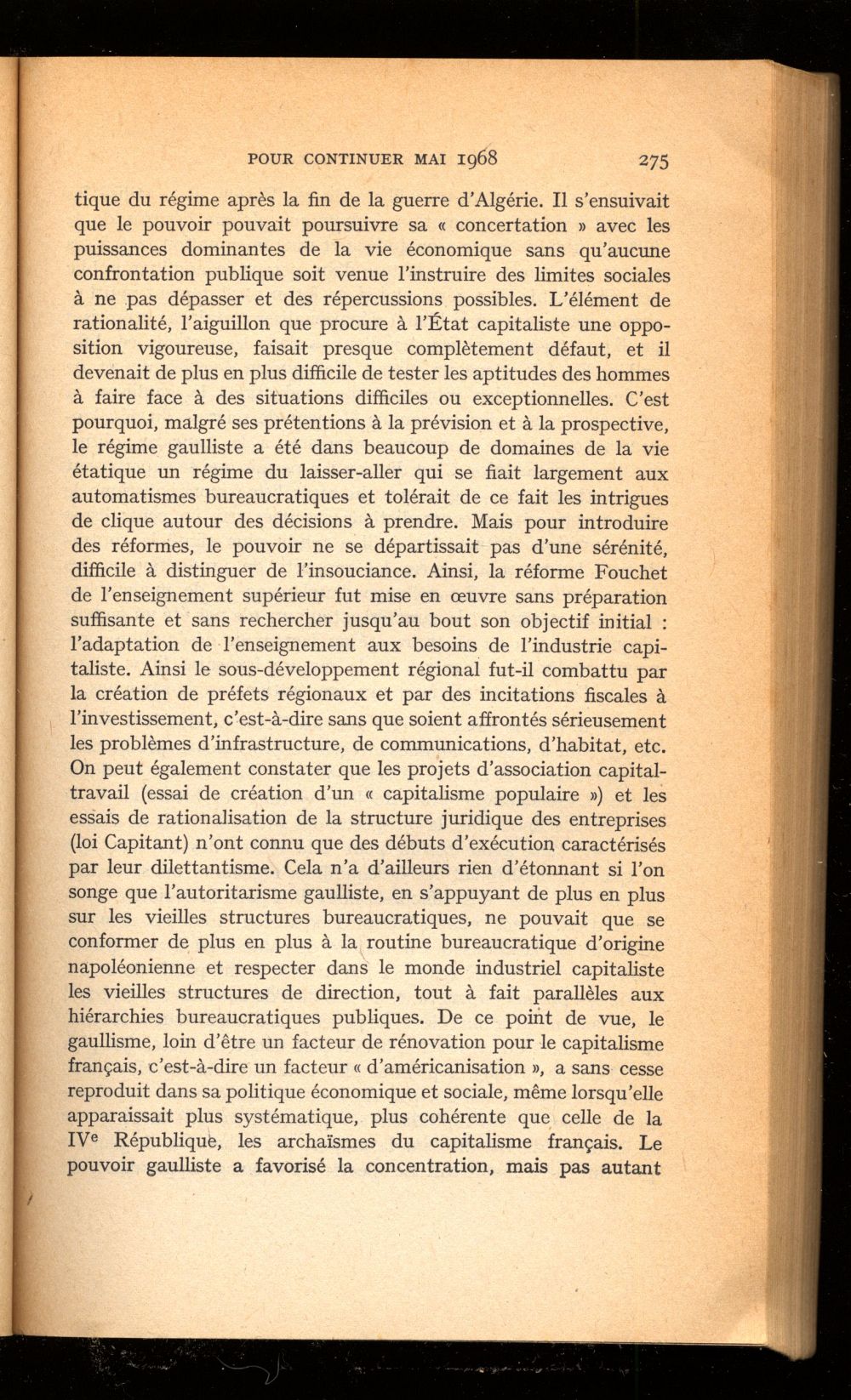

POUR CONTINUER MAI IQÔS
275
tique du régime après la fin de la guerre d'Algérie. Il s'ensuivait
que le pouvoir pouvait poursuivre sa « concertation » avec les
puissances dominantes de la vie économique sans qu'aucune
confrontation publique soit venue l'instruire des limites sociales
à ne pas dépasser et des répercussions possibles. L'élément de
rationalité, l'aiguillon que procure à l'Etat capitaliste une oppo-
sition vigoureuse, faisait presque complètement défaut, et il
devenait de plus en plus difficile de tester les aptitudes des hommes
à faire face à des situations difficiles ou exceptionnelles. C'est
pourquoi, malgré ses prétentions à la prévision et à la prospective,
le régime gaulliste a été dans beaucoup de domaines de la vie
étatique un régime du laisser-aller qui se fiait largement aux
automatismes bureaucratiques et tolérait de ce fait les intrigues
de clique autour des décisions à prendre. Mais pour introduire
des réformes, le pouvoir ne se départissait pas d'une sérénité,
difficile à distinguer de l'insouciance. Ainsi, la réforme Fouchet
de l'enseignement supérieur fut mise en œuvre sans préparation
suffisante et sans rechercher jusqu'au bout son objectif initial :
l'adaptation de l'enseignement aux besoins de l'industrie capi-
taliste. Ainsi le sous-développement régional fut-il combattu par
la création de préfets régionaux et par des incitations fiscales à
l'investissement, c'est-à-dire sans que soient affrontés sérieusement
les problèmes d'infrastructure, de communications, d'habitat, etc.
On peut également constater que les projets d'association capital-
travail (essai de création d'un « capitalisme populaire ») et les
essais de rationalisation de la structure juridique des entreprises
(loi Capitant) n'ont connu que des débuts d'exécution caractérisés
par leur dilettantisme. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant si l'on
songe que l'autoritarisme gaulliste, en s'appuyant de plus en plus
sur les vieilles structures bureaucratiques, ne pouvait que se
conformer de plus en plus à la routine bureaucratique d'origine
napoléonienne et respecter dans le monde industriel capitaliste
les vieilles structures de direction, tout à fait parallèles aux
hiérarchies bureaucratiques publiques. De ce point de vue, le
gaullisme, loin d'être un facteur de rénovation pour le capitalisme
français, c'est-à-dire un facteur « d'américanisation », a sans cesse
reproduit dans sa politique économique et sociale, même lorsqu'elle
apparaissait plus systématique, plus cohérente que celle de la
IVe République, les archaïsmes du capitalisme français. Le
pouvoir gaulliste a favorisé la concentration, mais pas autant
que le pouvoir pouvait poursuivre sa « concertation » avec les
puissances dominantes de la vie économique sans qu'aucune
confrontation publique soit venue l'instruire des limites sociales
à ne pas dépasser et des répercussions possibles. L'élément de
rationalité, l'aiguillon que procure à l'Etat capitaliste une oppo-
sition vigoureuse, faisait presque complètement défaut, et il
devenait de plus en plus difficile de tester les aptitudes des hommes
à faire face à des situations difficiles ou exceptionnelles. C'est
pourquoi, malgré ses prétentions à la prévision et à la prospective,
le régime gaulliste a été dans beaucoup de domaines de la vie
étatique un régime du laisser-aller qui se fiait largement aux
automatismes bureaucratiques et tolérait de ce fait les intrigues
de clique autour des décisions à prendre. Mais pour introduire
des réformes, le pouvoir ne se départissait pas d'une sérénité,
difficile à distinguer de l'insouciance. Ainsi, la réforme Fouchet
de l'enseignement supérieur fut mise en œuvre sans préparation
suffisante et sans rechercher jusqu'au bout son objectif initial :
l'adaptation de l'enseignement aux besoins de l'industrie capi-
taliste. Ainsi le sous-développement régional fut-il combattu par
la création de préfets régionaux et par des incitations fiscales à
l'investissement, c'est-à-dire sans que soient affrontés sérieusement
les problèmes d'infrastructure, de communications, d'habitat, etc.
On peut également constater que les projets d'association capital-
travail (essai de création d'un « capitalisme populaire ») et les
essais de rationalisation de la structure juridique des entreprises
(loi Capitant) n'ont connu que des débuts d'exécution caractérisés
par leur dilettantisme. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant si l'on
songe que l'autoritarisme gaulliste, en s'appuyant de plus en plus
sur les vieilles structures bureaucratiques, ne pouvait que se
conformer de plus en plus à la routine bureaucratique d'origine
napoléonienne et respecter dans le monde industriel capitaliste
les vieilles structures de direction, tout à fait parallèles aux
hiérarchies bureaucratiques publiques. De ce point de vue, le
gaullisme, loin d'être un facteur de rénovation pour le capitalisme
français, c'est-à-dire un facteur « d'américanisation », a sans cesse
reproduit dans sa politique économique et sociale, même lorsqu'elle
apparaissait plus systématique, plus cohérente que celle de la
IVe République, les archaïsmes du capitalisme français. Le
pouvoir gaulliste a favorisé la concentration, mais pas autant
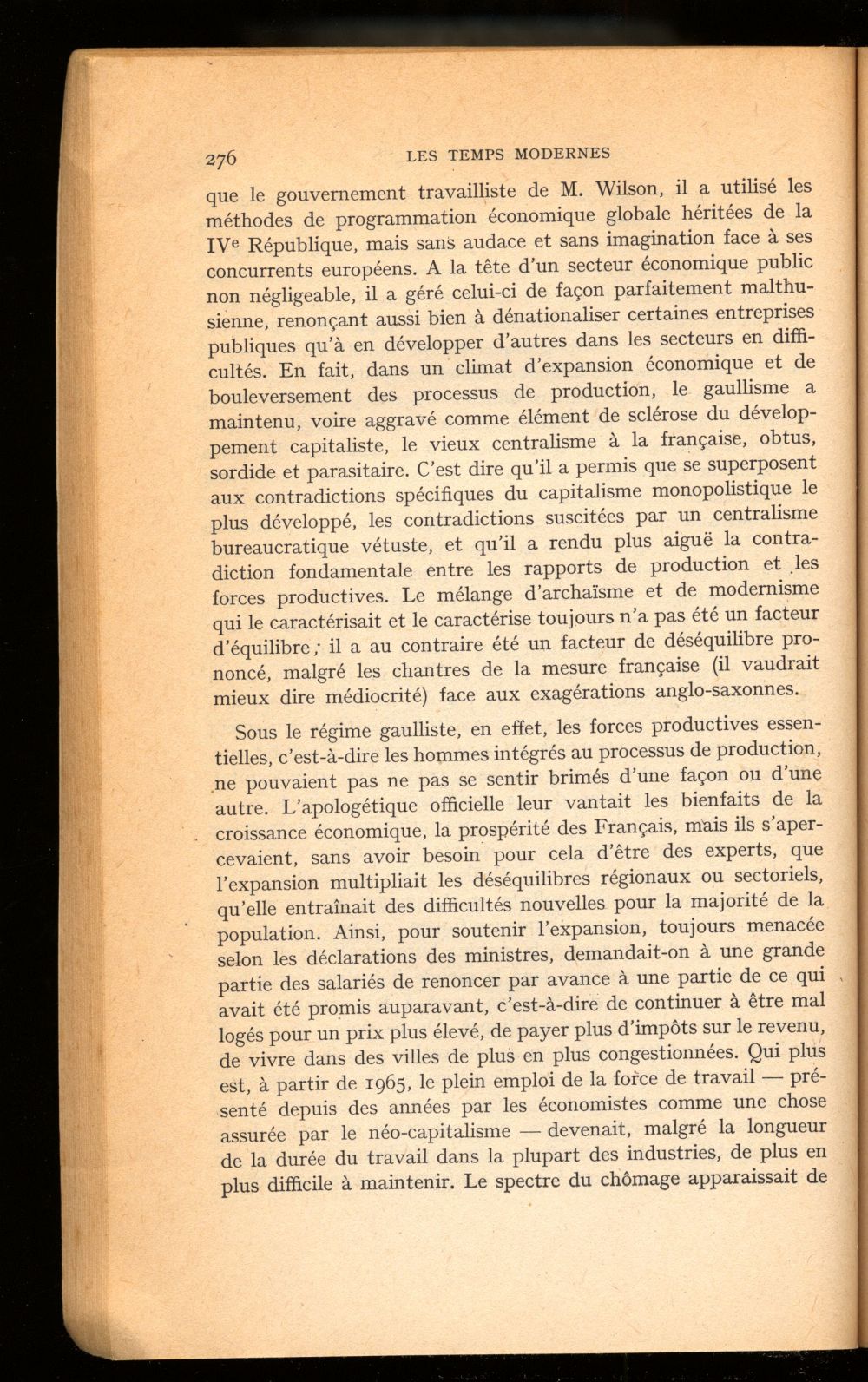

276 LES TEMPS MODERNES
que le gouvernement travailliste de M. Wilson, il a utilisé les
méthodes de programmation économique globale héritées de la
IVe République, mais sans audace et sans imagination face à ses
concurrents européens. A la tête d'un secteur économique public
non négligeable, il a géré celui-ci de façon parfaitement malthu-
sienne, renonçant aussi bien à dénationaliser certaines entreprises
publiques qu'à en développer d'autres dans les secteurs en diffi-
cultés. En fait, dans un climat d'expansion économique et de
bouleversement des processus de production, le gaullisme a
maintenu, voire aggravé comme élément de sclérose du dévelop-
pement capitaliste, le vieux centralisme à la française, obtus,
sordide et parasitaire. C'est dire qu'il a permis que se superposent
aux contradictions spécifiques du capitalisme monopolistique le
plus développé, les contradictions suscitées par un centralisme
bureaucratique vétusté, et qu'il a rendu plus aiguë la contra-
diction fondamentale entre les rapports de production et les
forces productives. Le mélange d'archaïsme et de modernisme
qui le caractérisait et le caractérise toujours n'a pas été un facteur
d'équilibre; il a au contraire été un facteur de déséquilibre pro-
noncé, malgré les chantres de la mesure française (il vaudrait
mieux dire médiocrité) face aux exagérations anglo-saxonnes.
méthodes de programmation économique globale héritées de la
IVe République, mais sans audace et sans imagination face à ses
concurrents européens. A la tête d'un secteur économique public
non négligeable, il a géré celui-ci de façon parfaitement malthu-
sienne, renonçant aussi bien à dénationaliser certaines entreprises
publiques qu'à en développer d'autres dans les secteurs en diffi-
cultés. En fait, dans un climat d'expansion économique et de
bouleversement des processus de production, le gaullisme a
maintenu, voire aggravé comme élément de sclérose du dévelop-
pement capitaliste, le vieux centralisme à la française, obtus,
sordide et parasitaire. C'est dire qu'il a permis que se superposent
aux contradictions spécifiques du capitalisme monopolistique le
plus développé, les contradictions suscitées par un centralisme
bureaucratique vétusté, et qu'il a rendu plus aiguë la contra-
diction fondamentale entre les rapports de production et les
forces productives. Le mélange d'archaïsme et de modernisme
qui le caractérisait et le caractérise toujours n'a pas été un facteur
d'équilibre; il a au contraire été un facteur de déséquilibre pro-
noncé, malgré les chantres de la mesure française (il vaudrait
mieux dire médiocrité) face aux exagérations anglo-saxonnes.
Sous le régime gaulliste, en effet, les forces productives essen-
tielles, c'est-à-dire les hommes intégrés au processus de production,
,ne pouvaient pas ne pas se sentir brimés d'une façon ou d'une
autre. L'apologétique officielle leur vantait les bienfaits de la
croissance économique, la prospérité des Français, mais ils s'aper-
cevaient, sans avoir besoin pour cela d'être des experts, que
l'expansion multipliait les déséquilibres régionaux ou sectoriels,
qu'elle entraînait des difficultés nouvelles pour la majorité de la
population. Ainsi, pour soutenir l'expansion, toujours menacée
selon les déclarations des ministres, demandait-on à une grande
partie des salariés de renoncer par avance à une partie de ce qui
avait été promis auparavant, c'est-à-dire de continuer à être mal
logés pour un prix plus élevé, de payer plus d'impôts sur le revenu,
de vivre dans des villes de plus en plus congestionnées. Qui plus
est, à partir de 1965, le plein emploi de la force de travail — pré-
senté depuis des années par les économistes comme une chose
assurée par le néo-capitalisme — devenait, malgré la longueur
de la durée du travail dans la plupart des industries, de plus en
plus difficile à maintenir. Le spectre du chômage apparaissait de
tielles, c'est-à-dire les hommes intégrés au processus de production,
,ne pouvaient pas ne pas se sentir brimés d'une façon ou d'une
autre. L'apologétique officielle leur vantait les bienfaits de la
croissance économique, la prospérité des Français, mais ils s'aper-
cevaient, sans avoir besoin pour cela d'être des experts, que
l'expansion multipliait les déséquilibres régionaux ou sectoriels,
qu'elle entraînait des difficultés nouvelles pour la majorité de la
population. Ainsi, pour soutenir l'expansion, toujours menacée
selon les déclarations des ministres, demandait-on à une grande
partie des salariés de renoncer par avance à une partie de ce qui
avait été promis auparavant, c'est-à-dire de continuer à être mal
logés pour un prix plus élevé, de payer plus d'impôts sur le revenu,
de vivre dans des villes de plus en plus congestionnées. Qui plus
est, à partir de 1965, le plein emploi de la force de travail — pré-
senté depuis des années par les économistes comme une chose
assurée par le néo-capitalisme — devenait, malgré la longueur
de la durée du travail dans la plupart des industries, de plus en
plus difficile à maintenir. Le spectre du chômage apparaissait de
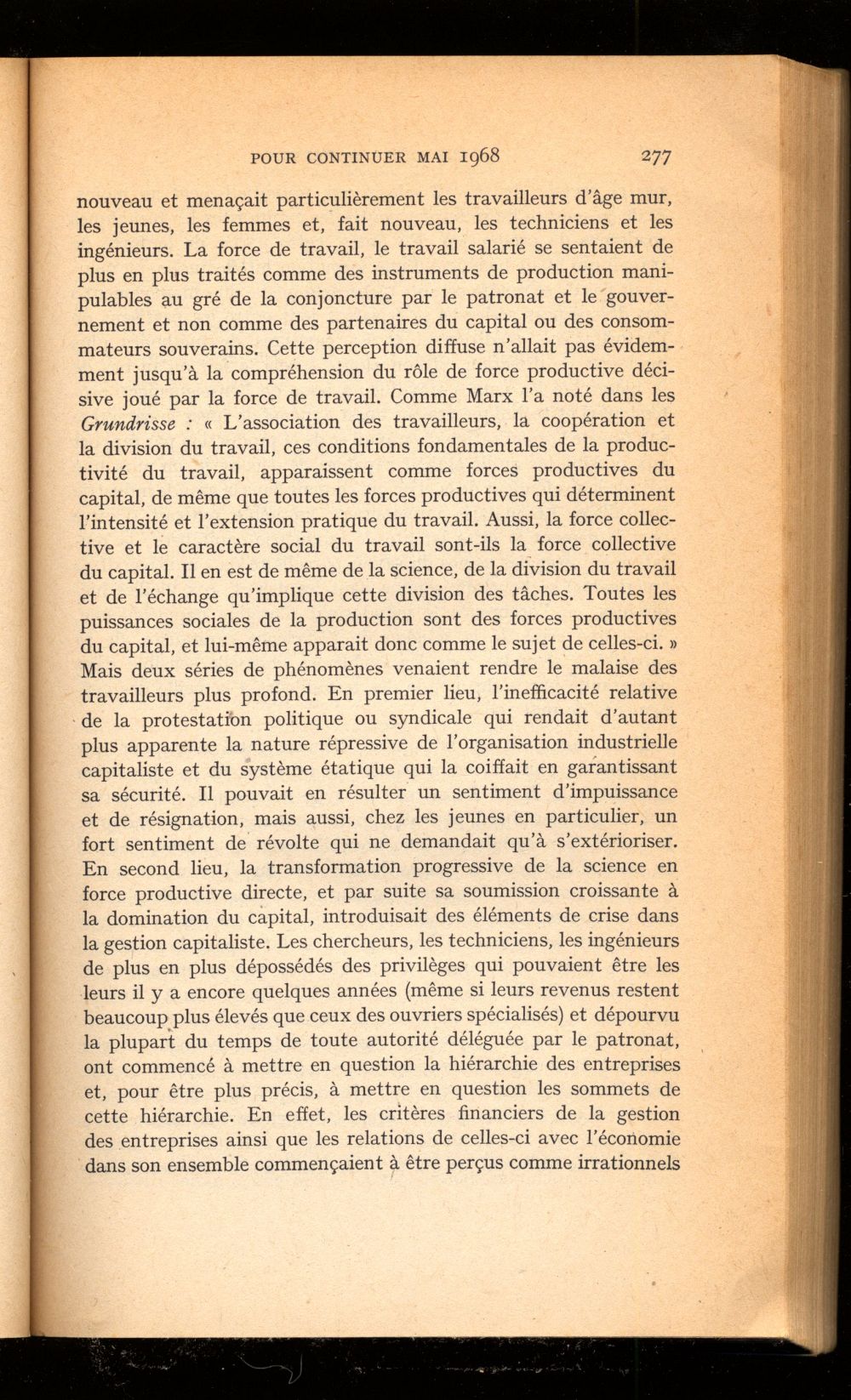

POUR CONTINUER MAI ig68
277
nouveau et menaçait particulièrement les travailleurs d'âge mur,
les jeunes, les femmes et, fait nouveau, les techniciens et les
ingénieurs. La force de travail, le travail salarié se sentaient de
plus en plus traités comme des instruments de production mani-
pulables au gré de la conjoncture par le patronat et le gouver-
nement et non comme des partenaires du capital ou des consom-
mateurs souverains. Cette perception diffuse n'allait pas évidem-
ment jusqu'à la compréhension du rôle de force productive déci-
sive joué par la force de travail. Comme Marx l'a noté dans les
Grundrisse : « L'association des travailleurs, la coopération et
la division du travail, ces conditions fondamentales de la produc-
tivité du travail, apparaissent comme forces productives du
capital, de même que toutes les forces productives qui déterminent
l'intensité et l'extension pratique du travail. Aussi, la force collec-
tive et le caractère social du travail sont-ils la force collective
du capital. Il en est de même de la science, de la division du travail
et de l'échange qu'impliqué cette division des tâches. Toutes les
puissances sociales de la production sont des forces productives
du capital, et lui-même apparaît donc comme le sujet de celles-ci. »
Mais deux séries de phénomènes venaient rendre le malaise des
travailleurs plus profond. En premier lieu, l'inefficacité relative
de la protestation politique ou syndicale qui rendait d'autant
plus apparente la nature répressive de l'organisation industrielle
capitaliste et du système étatique qui la coiffait en garantissant
sa sécurité. Il pouvait en résulter un sentiment d'impuissance
et de résignation, mais aussi, chez les jeunes en particulier, un
fort sentiment de révolte qui ne demandait qu'à s'extérioriser.
En second lieu, la transformation progressive de la science en
force productive directe, et par suite sa soumission croissante à
la domination du capital, introduisait des éléments de crise dans
la gestion capitaliste. Les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs
de plus en plus dépossédés des privilèges qui pouvaient être les
leurs il y a encore quelques années (même si leurs revenus restent
beaucoup plus élevés que ceux des ouvriers spécialisés) et dépourvu
la plupart du temps de toute autorité déléguée par le patronat,
ont commencé à mettre en question la hiérarchie des entreprises
et, pour être plus précis, à mettre en question les sommets de
cette hiérarchie. En effet, les critères financiers de la gestion
des entreprises ainsi que les relations de celles-ci avec l'économie
dans son ensemble commençaient à être perçus comme irrationnels
les jeunes, les femmes et, fait nouveau, les techniciens et les
ingénieurs. La force de travail, le travail salarié se sentaient de
plus en plus traités comme des instruments de production mani-
pulables au gré de la conjoncture par le patronat et le gouver-
nement et non comme des partenaires du capital ou des consom-
mateurs souverains. Cette perception diffuse n'allait pas évidem-
ment jusqu'à la compréhension du rôle de force productive déci-
sive joué par la force de travail. Comme Marx l'a noté dans les
Grundrisse : « L'association des travailleurs, la coopération et
la division du travail, ces conditions fondamentales de la produc-
tivité du travail, apparaissent comme forces productives du
capital, de même que toutes les forces productives qui déterminent
l'intensité et l'extension pratique du travail. Aussi, la force collec-
tive et le caractère social du travail sont-ils la force collective
du capital. Il en est de même de la science, de la division du travail
et de l'échange qu'impliqué cette division des tâches. Toutes les
puissances sociales de la production sont des forces productives
du capital, et lui-même apparaît donc comme le sujet de celles-ci. »
Mais deux séries de phénomènes venaient rendre le malaise des
travailleurs plus profond. En premier lieu, l'inefficacité relative
de la protestation politique ou syndicale qui rendait d'autant
plus apparente la nature répressive de l'organisation industrielle
capitaliste et du système étatique qui la coiffait en garantissant
sa sécurité. Il pouvait en résulter un sentiment d'impuissance
et de résignation, mais aussi, chez les jeunes en particulier, un
fort sentiment de révolte qui ne demandait qu'à s'extérioriser.
En second lieu, la transformation progressive de la science en
force productive directe, et par suite sa soumission croissante à
la domination du capital, introduisait des éléments de crise dans
la gestion capitaliste. Les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs
de plus en plus dépossédés des privilèges qui pouvaient être les
leurs il y a encore quelques années (même si leurs revenus restent
beaucoup plus élevés que ceux des ouvriers spécialisés) et dépourvu
la plupart du temps de toute autorité déléguée par le patronat,
ont commencé à mettre en question la hiérarchie des entreprises
et, pour être plus précis, à mettre en question les sommets de
cette hiérarchie. En effet, les critères financiers de la gestion
des entreprises ainsi que les relations de celles-ci avec l'économie
dans son ensemble commençaient à être perçus comme irrationnels
1
0l
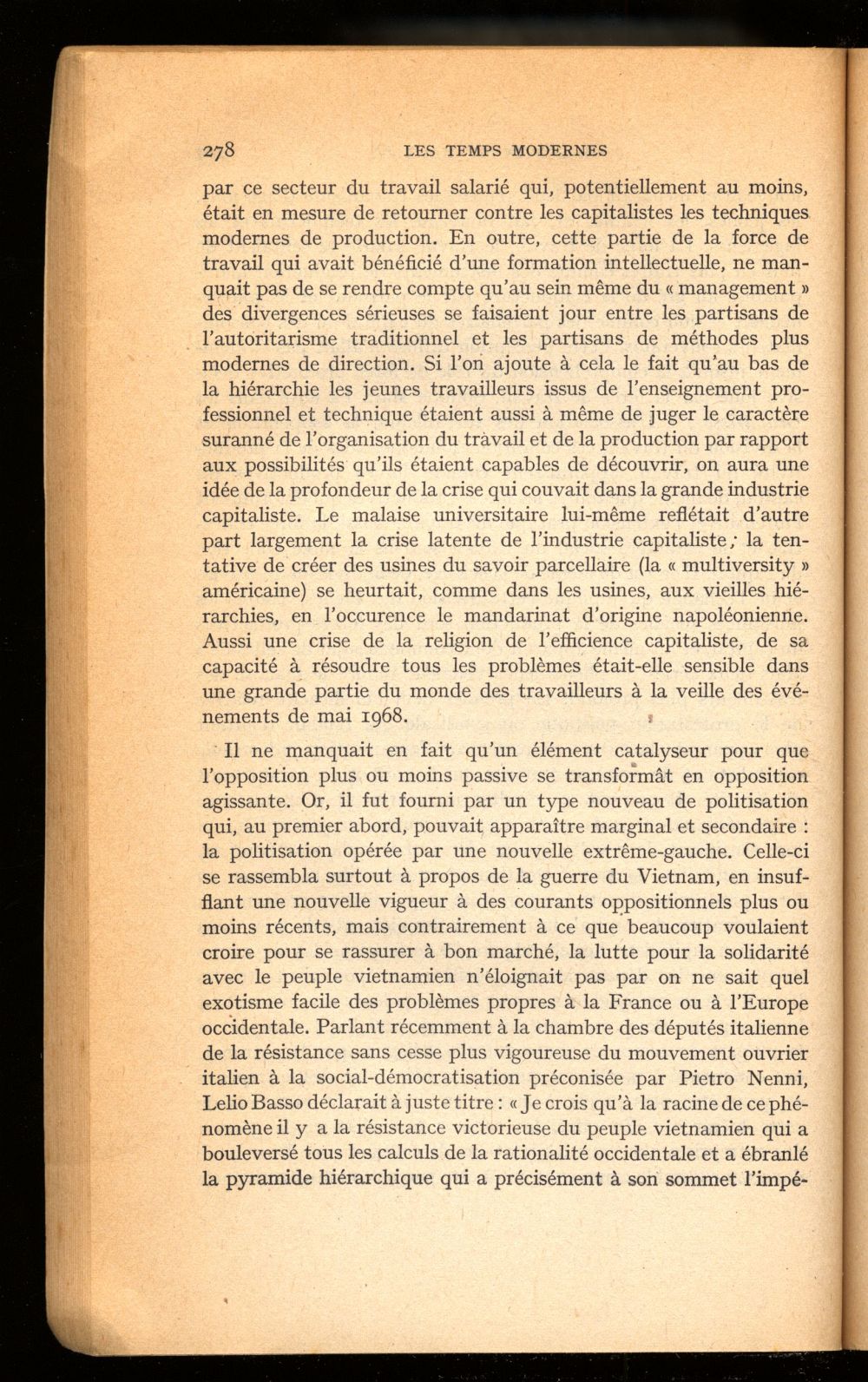

278 LES TEMPS MODERNES
par ce secteur du travail salarié qui, potentiellement au moins,
était en mesure de retourner contre les capitalistes les techniques
modernes de production. En outre, cette partie de la force de
travail qui avait bénéficié d'une formation intellectuelle, ne man-
quait pas de se rendre compte qu'au sein même du « management »
des divergences sérieuses se faisaient jour entre les partisans de
l'autoritarisme traditionnel et les partisans de méthodes plus
modernes de direction. Si l'on ajoute à cela le fait qu'au bas de
la hiérarchie les jeunes travailleurs issus de l'enseignement pro-
fessionnel et technique étaient aussi à même de juger le caractère
suranné de l'organisation du travail et de la production par rapport
aux possibilités qu'ils étaient capables de découvrir, on aura une
idée de la profondeur de la crise qui couvait dans la grande industrie
capitaliste. Le malaise universitaire lui-même reflétait d'autre
part largement la crise latente de l'industrie capitaliste; la ten-
tative de créer des usines du savoir parcellaire (la « multiversity »
américaine) se heurtait, comme dans les usines, aux vieilles hié-
rarchies, en l'occurence le mandarinat d'origine napoléonienne.
Aussi une crise de la religion de l'efficience capitaliste, de sa
capacité à résoudre tous les problèmes était-elle sensible dans
une grande partie du monde des travailleurs à la veille des évé-
nements de mai 1968.
était en mesure de retourner contre les capitalistes les techniques
modernes de production. En outre, cette partie de la force de
travail qui avait bénéficié d'une formation intellectuelle, ne man-
quait pas de se rendre compte qu'au sein même du « management »
des divergences sérieuses se faisaient jour entre les partisans de
l'autoritarisme traditionnel et les partisans de méthodes plus
modernes de direction. Si l'on ajoute à cela le fait qu'au bas de
la hiérarchie les jeunes travailleurs issus de l'enseignement pro-
fessionnel et technique étaient aussi à même de juger le caractère
suranné de l'organisation du travail et de la production par rapport
aux possibilités qu'ils étaient capables de découvrir, on aura une
idée de la profondeur de la crise qui couvait dans la grande industrie
capitaliste. Le malaise universitaire lui-même reflétait d'autre
part largement la crise latente de l'industrie capitaliste; la ten-
tative de créer des usines du savoir parcellaire (la « multiversity »
américaine) se heurtait, comme dans les usines, aux vieilles hié-
rarchies, en l'occurence le mandarinat d'origine napoléonienne.
Aussi une crise de la religion de l'efficience capitaliste, de sa
capacité à résoudre tous les problèmes était-elle sensible dans
une grande partie du monde des travailleurs à la veille des évé-
nements de mai 1968.
Il ne manquait en fait qu'un élément catalyseur pour que
l'opposition plus ou moins passive se transformât en opposition
agissante. Or, il fut fourni par un type nouveau de politisation
qui, au premier abord, pouvait apparaître marginal et secondaire :
la politisation opérée par une nouvelle extrême-gauche. Celle-ci
se rassembla surtout à propos de la guerre du Vietnam, en insuf-
flant une nouvelle vigueur à des courants oppositionnels plus ou
moins récents, mais contrairement à ce que beaucoup voulaient
croire pour se rassurer à bon marché, la lutte pour la solidarité
avec le peuple vietnamien n'éloignait pas par on ne sait quel
exotisme facile des problèmes propres à la France ou à l'Europe
occidentale. Parlant récemment à la chambre des députés italienne
de la résistance sans cesse plus vigoureuse du mouvement ouvrier
italien à la social-démocratisation préconisée par Pietro Nenni,
Lelio Basso déclarait à juste titre : « Je crois qu'à la racine de ce phé-
nomène il y a la résistance victorieuse du peuple vietnamien qui a
bouleversé tous les calculs de la rationalité occidentale et a ébranlé
la pyramide hiérarchique qui a précisément à son sommet l'impé-
l'opposition plus ou moins passive se transformât en opposition
agissante. Or, il fut fourni par un type nouveau de politisation
qui, au premier abord, pouvait apparaître marginal et secondaire :
la politisation opérée par une nouvelle extrême-gauche. Celle-ci
se rassembla surtout à propos de la guerre du Vietnam, en insuf-
flant une nouvelle vigueur à des courants oppositionnels plus ou
moins récents, mais contrairement à ce que beaucoup voulaient
croire pour se rassurer à bon marché, la lutte pour la solidarité
avec le peuple vietnamien n'éloignait pas par on ne sait quel
exotisme facile des problèmes propres à la France ou à l'Europe
occidentale. Parlant récemment à la chambre des députés italienne
de la résistance sans cesse plus vigoureuse du mouvement ouvrier
italien à la social-démocratisation préconisée par Pietro Nenni,
Lelio Basso déclarait à juste titre : « Je crois qu'à la racine de ce phé-
nomène il y a la résistance victorieuse du peuple vietnamien qui a
bouleversé tous les calculs de la rationalité occidentale et a ébranlé
la pyramide hiérarchique qui a précisément à son sommet l'impé-
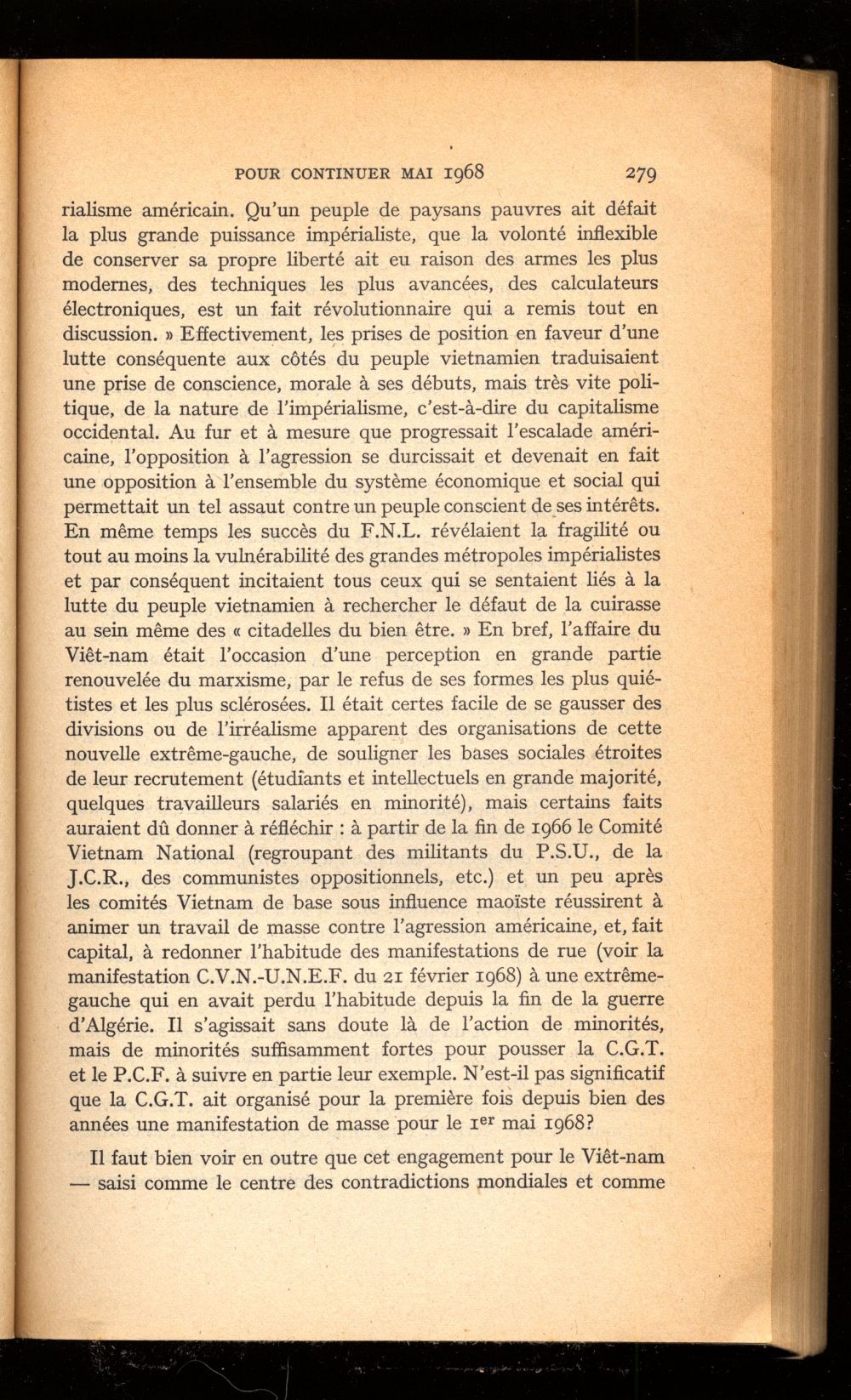

POUR CONTINUER MAI 1968
279
rialisme américain. Qu'un peuple de paysans pauvres ait défait
la plus grande puissance impérialiste, que la volonté inflexible
de conserver sa propre liberté ait eu raison des armes les plus
modernes, des techniques les plus avancées, des calculateurs
électroniques, est un fait révolutionnaire qui a remis tout en
discussion. » Effectivement, les prises de position en faveur d'une
lutte conséquente aux côtés du peuple vietnamien traduisaient
une prise de conscience, morale à ses débuts, mais très vite poli-
tique, de la nature de l'impérialisme, c'est-à-dire du capitalisme
occidental. Au fur et à mesure que progressait l'escalade améri-
caine, l'opposition à l'agression se durcissait et devenait en fait
une opposition à l'ensemble du système économique et social qui
permettait un tel assaut contre un peuple conscient de ses intérêts.
En même temps les succès du F.N.L. révélaient la fragilité ou
tout au moins la vulnérabilité des grandes métropoles impérialistes
et par conséquent incitaient tous ceux qui se sentaient liés à la
lutte du peuple vietnamien à rechercher le défaut de la cuirasse
au sein même des « citadelles du bien être. » En bref, l'affaire du
Viêt-nam était l'occasion d'une perception en grande partie
renouvelée du marxisme, par le refus de ses formes les plus quié-
tistes et les plus sclérosées. Il était certes facile de se gausser des
divisions ou de l'irréalisme apparent des organisations de cette
nouvelle extrême-gauche, de souligner les bases sociales étroites
de leur recrutement (étudiants et intellectuels en grande majorité,
quelques travailleurs salariés en minorité), mais certains faits
auraient dû donner à réfléchir : à partir de la fin de 1966 le Comité
Vietnam National (regroupant des militants du P.S.U., de la
J.C.R., des communistes oppositionnels, etc.) et un peu après
les comités Vietnam de base sous influence maoïste réussirent à
animer un travail de masse contre l'agression américaine, et, fait
capital, à redonner l'habitude des manifestations de rue (voir la
manifestation C.V.N.-U.N.E.F. du 21 février 1968) à une extrême-
gauche qui en avait perdu l'habitude depuis la fin de la guerre
d'Algérie. Il s'agissait sans doute là de l'action de minorités,
mais de minorités suffisamment fortes pour pousser la C.G.T.
et le P.C.F. à suivre en partie leur exemple. N'est-il pas significatif
que la C.G.T. ait organisé pour la première fois depuis bien des
années une manifestation de masse pour le Ier mai 1968?
la plus grande puissance impérialiste, que la volonté inflexible
de conserver sa propre liberté ait eu raison des armes les plus
modernes, des techniques les plus avancées, des calculateurs
électroniques, est un fait révolutionnaire qui a remis tout en
discussion. » Effectivement, les prises de position en faveur d'une
lutte conséquente aux côtés du peuple vietnamien traduisaient
une prise de conscience, morale à ses débuts, mais très vite poli-
tique, de la nature de l'impérialisme, c'est-à-dire du capitalisme
occidental. Au fur et à mesure que progressait l'escalade améri-
caine, l'opposition à l'agression se durcissait et devenait en fait
une opposition à l'ensemble du système économique et social qui
permettait un tel assaut contre un peuple conscient de ses intérêts.
En même temps les succès du F.N.L. révélaient la fragilité ou
tout au moins la vulnérabilité des grandes métropoles impérialistes
et par conséquent incitaient tous ceux qui se sentaient liés à la
lutte du peuple vietnamien à rechercher le défaut de la cuirasse
au sein même des « citadelles du bien être. » En bref, l'affaire du
Viêt-nam était l'occasion d'une perception en grande partie
renouvelée du marxisme, par le refus de ses formes les plus quié-
tistes et les plus sclérosées. Il était certes facile de se gausser des
divisions ou de l'irréalisme apparent des organisations de cette
nouvelle extrême-gauche, de souligner les bases sociales étroites
de leur recrutement (étudiants et intellectuels en grande majorité,
quelques travailleurs salariés en minorité), mais certains faits
auraient dû donner à réfléchir : à partir de la fin de 1966 le Comité
Vietnam National (regroupant des militants du P.S.U., de la
J.C.R., des communistes oppositionnels, etc.) et un peu après
les comités Vietnam de base sous influence maoïste réussirent à
animer un travail de masse contre l'agression américaine, et, fait
capital, à redonner l'habitude des manifestations de rue (voir la
manifestation C.V.N.-U.N.E.F. du 21 février 1968) à une extrême-
gauche qui en avait perdu l'habitude depuis la fin de la guerre
d'Algérie. Il s'agissait sans doute là de l'action de minorités,
mais de minorités suffisamment fortes pour pousser la C.G.T.
et le P.C.F. à suivre en partie leur exemple. N'est-il pas significatif
que la C.G.T. ait organisé pour la première fois depuis bien des
années une manifestation de masse pour le Ier mai 1968?
Il faut bien voir en outre que cet engagement pour le Viêt-nam
— saisi comme le centre des contradictions mondiales et comme
— saisi comme le centre des contradictions mondiales et comme
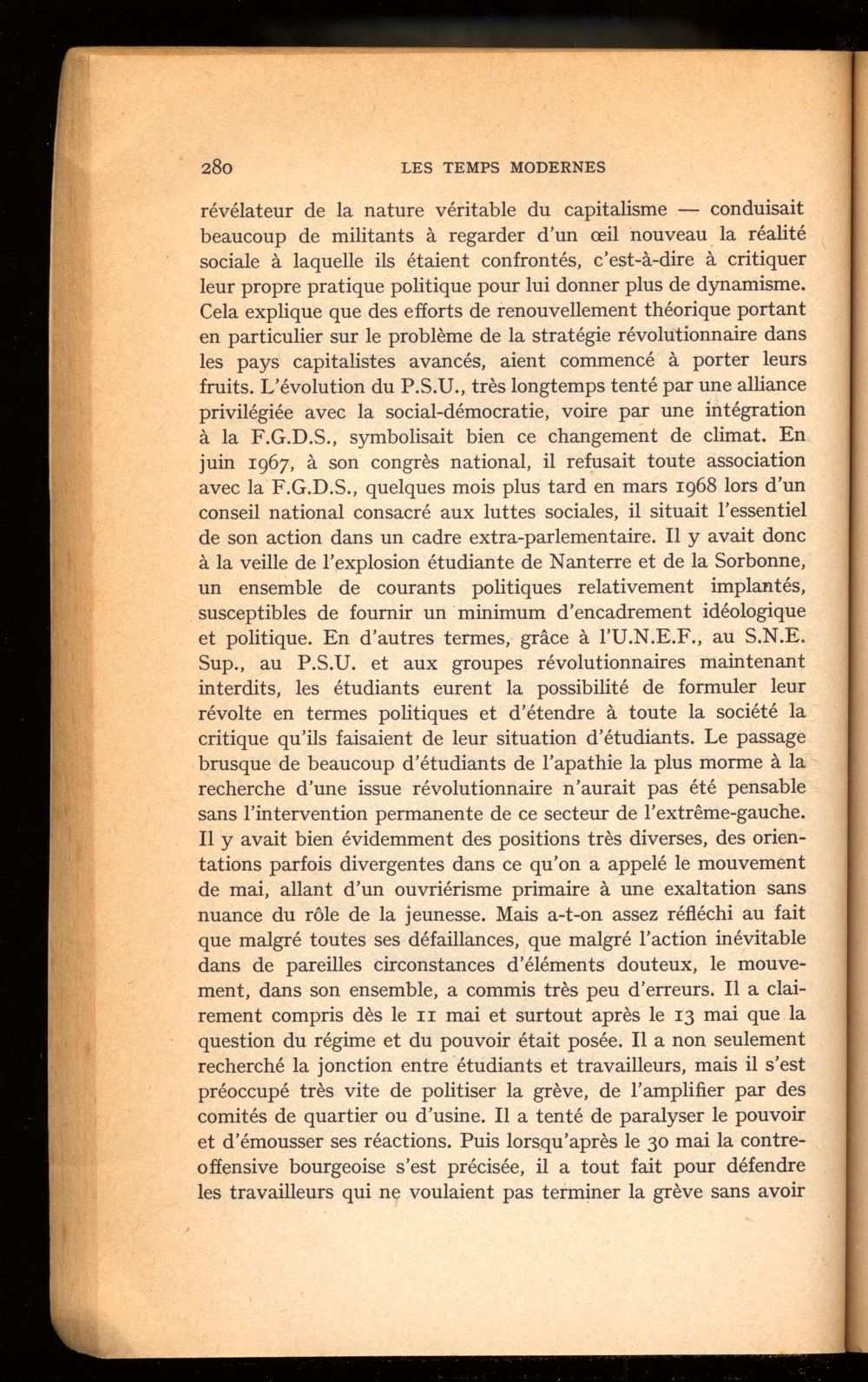

280
LES TEMPS MODERNES
révélateur de la nature véritable du capitalisme — conduisait
beaucoup de militants à regarder d'un œil nouveau la réalité
sociale à laquelle ils étaient confrontés, c'est-à-dire à critiquer
leur propre pratique politique pour lui donner plus de dynamisme.
Cela explique que des efforts de renouvellement théorique portant
en particulier sur le problème de la stratégie révolutionnaire dans
les pays capitalistes avancés, aient commencé à porter leurs
fruits. L'évolution du P.S.U., très longtemps tenté par une alliance
privilégiée avec la social-démocratie, voire par une intégration
à la F.G.D.S., symbolisait bien ce changement de climat. En
juin 1967, à son congrès national, il refusait toute association
avec la F.G.D.S., quelques mois plus tard en mars 1968 lors d'un
conseil national consacré aux luttes sociales, il situait l'essentiel
de son action dans un cadre extra-parlementaire. Il y avait donc
à la veille de l'explosion étudiante de Nanterre et de la Sorbonne,
un ensemble de courants politiques relativement implantés,
susceptibles de fournir un minimum d'encadrement idéologique
et politique. En d'autres termes, grâce à l'U.N.E.F., au S.N.E.
Sup., au P.S.U. et aux groupes révolutionnaires maintenant
interdits, les étudiants eurent la possibilité de formuler leur
révolte en termes politiques et d'étendre à toute la société la
critique qu'ils faisaient de leur situation d'étudiants. Le passage
brusque de beaucoup d'étudiants de l'apathie la plus morme à la
recherche d'une issue révolutionnaire n'aurait pas été pensable
sans l'intervention permanente de ce secteur de l'extrême-gauche.
Il y avait bien évidemment des positions très diverses, des orien-
tations parfois divergentes dans ce qu'on a appelé le mouvement
de mai, allant d'un ouvriérisme primaire à une exaltation sans
nuance du rôle de la jeunesse. Mais a-t-on assez réfléchi au fait
que malgré toutes ses défaillances, que malgré l'action inévitable
dans de pareilles circonstances d'éléments douteux, le mouve-
ment, dans son ensemble, a commis très peu d'erreurs. Il a clai-
rement compris dès le n mai et surtout après le 13 mai que la
question du régime et du pouvoir était posée. Il a non seulement
recherché la jonction entre étudiants et travailleurs, mais il s'est
préoccupé très vite de politiser la grève, de l'amplifier par des
comités de quartier ou d'usine. Il a tenté de paralyser le pouvoir
et d'émousser ses réactions. Puis lorsqu'après le 30 mai la contre-
offensive bourgeoise s'est précisée, il a tout fait pour défendre
les travailleurs qui ne voulaient pas terminer la grève sans avoir
beaucoup de militants à regarder d'un œil nouveau la réalité
sociale à laquelle ils étaient confrontés, c'est-à-dire à critiquer
leur propre pratique politique pour lui donner plus de dynamisme.
Cela explique que des efforts de renouvellement théorique portant
en particulier sur le problème de la stratégie révolutionnaire dans
les pays capitalistes avancés, aient commencé à porter leurs
fruits. L'évolution du P.S.U., très longtemps tenté par une alliance
privilégiée avec la social-démocratie, voire par une intégration
à la F.G.D.S., symbolisait bien ce changement de climat. En
juin 1967, à son congrès national, il refusait toute association
avec la F.G.D.S., quelques mois plus tard en mars 1968 lors d'un
conseil national consacré aux luttes sociales, il situait l'essentiel
de son action dans un cadre extra-parlementaire. Il y avait donc
à la veille de l'explosion étudiante de Nanterre et de la Sorbonne,
un ensemble de courants politiques relativement implantés,
susceptibles de fournir un minimum d'encadrement idéologique
et politique. En d'autres termes, grâce à l'U.N.E.F., au S.N.E.
Sup., au P.S.U. et aux groupes révolutionnaires maintenant
interdits, les étudiants eurent la possibilité de formuler leur
révolte en termes politiques et d'étendre à toute la société la
critique qu'ils faisaient de leur situation d'étudiants. Le passage
brusque de beaucoup d'étudiants de l'apathie la plus morme à la
recherche d'une issue révolutionnaire n'aurait pas été pensable
sans l'intervention permanente de ce secteur de l'extrême-gauche.
Il y avait bien évidemment des positions très diverses, des orien-
tations parfois divergentes dans ce qu'on a appelé le mouvement
de mai, allant d'un ouvriérisme primaire à une exaltation sans
nuance du rôle de la jeunesse. Mais a-t-on assez réfléchi au fait
que malgré toutes ses défaillances, que malgré l'action inévitable
dans de pareilles circonstances d'éléments douteux, le mouve-
ment, dans son ensemble, a commis très peu d'erreurs. Il a clai-
rement compris dès le n mai et surtout après le 13 mai que la
question du régime et du pouvoir était posée. Il a non seulement
recherché la jonction entre étudiants et travailleurs, mais il s'est
préoccupé très vite de politiser la grève, de l'amplifier par des
comités de quartier ou d'usine. Il a tenté de paralyser le pouvoir
et d'émousser ses réactions. Puis lorsqu'après le 30 mai la contre-
offensive bourgeoise s'est précisée, il a tout fait pour défendre
les travailleurs qui ne voulaient pas terminer la grève sans avoir
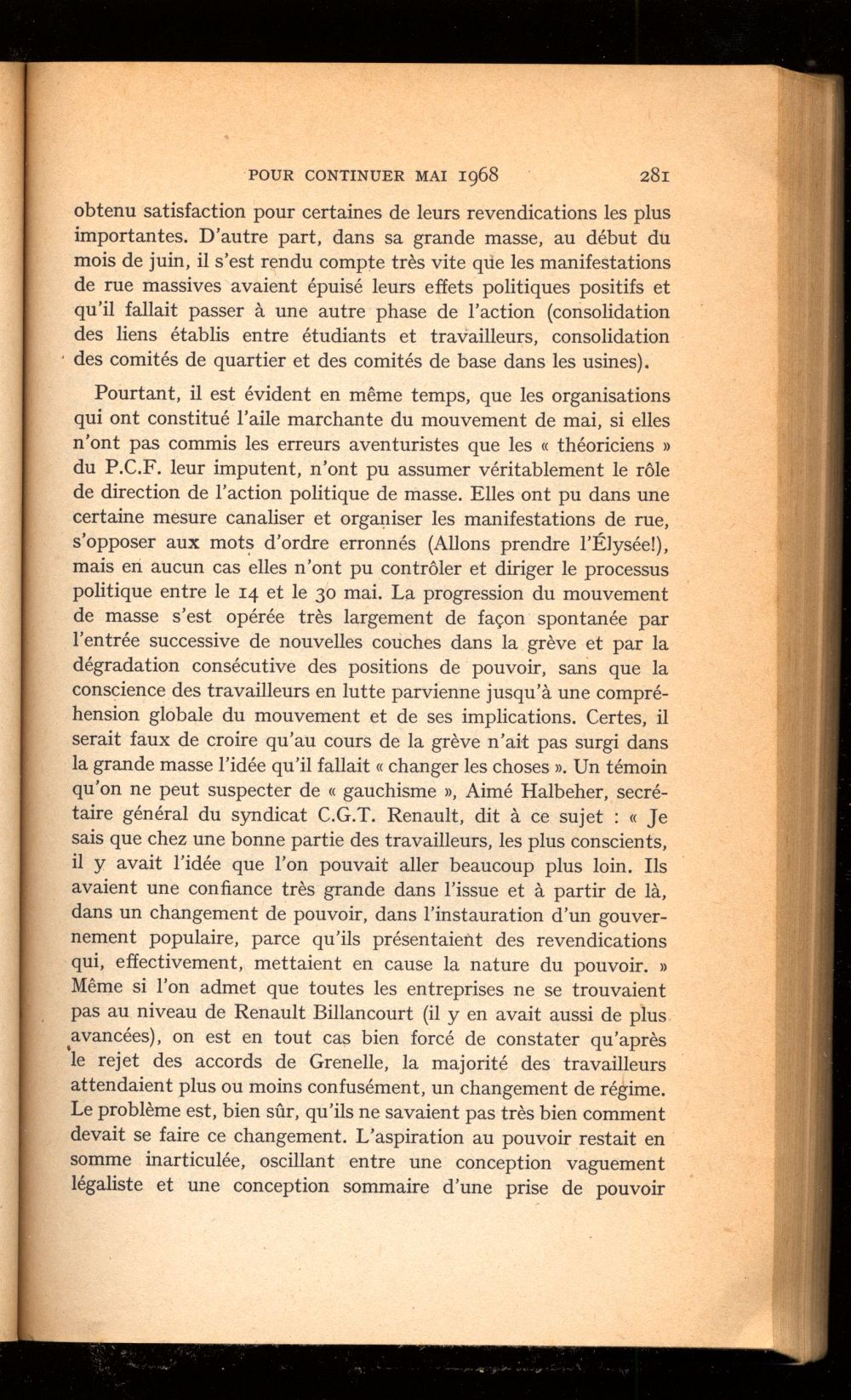

POUR CONTINUER MAI 1968
28l
obtenu satisfaction pour certaines de leurs revendications les plus
importantes. D'autre part, dans sa grande masse, au début du
mois de juin, il s'est rendu compte très vite que les manifestations
de rue massives avaient épuisé leurs effets politiques positifs et
qu'il fallait passer à une autre phase de l'action (consolidation
des liens établis entre étudiants et travailleurs, consolidation
des comités de quartier et des comités de base dans les usines).
importantes. D'autre part, dans sa grande masse, au début du
mois de juin, il s'est rendu compte très vite que les manifestations
de rue massives avaient épuisé leurs effets politiques positifs et
qu'il fallait passer à une autre phase de l'action (consolidation
des liens établis entre étudiants et travailleurs, consolidation
des comités de quartier et des comités de base dans les usines).
Pourtant, il est évident en même temps, que les organisations
qui ont constitué l'aile marchante du mouvement de mai, si elles
n'ont pas commis les erreurs aventuristes que les « théoriciens »
du P.C.F. leur imputent, n'ont pu assumer véritablement le rôle
de direction de l'action politique de masse. Elles ont pu dans une
certaine mesure canaliser et organiser les manifestations de rue,
s'opposer aux mots d'ordre erronnés (Allons prendre l'Elysée!),
mais en aucun cas elles n'ont pu contrôler et diriger le processus
politique entre le 14 et le 30 mai. La progression du mouvement
de masse s'est opérée très largement de façon spontanée par
l'entrée successive de nouvelles couches dans la grève et par la
dégradation consécutive des positions de pouvoir, sans que la
conscience des travailleurs en lutte parvienne jusqu'à une compré-
hension globale du mouvement et de ses implications. Certes, il
serait faux de croire qu'au cours de la grève n'ait pas surgi dans
la grande masse l'idée qu'il fallait « changer les choses ». Un témoin
qu'on ne peut suspecter de « gauchisme », Aimé Halbeher, secré-
taire général du syndicat C.G.T. Renault, dit à ce sujet : « Je
sais que chez une bonne partie des travailleurs, les plus conscients,
il y avait l'idée que l'on pouvait aller beaucoup plus loin. Ils
avaient une confiance très grande dans l'issue et à partir de là,
dans un changement de pouvoir, dans l'instauration d'un gouver-
nement populaire, parce qu'ils présentaient des revendications
qui, effectivement, mettaient en cause la nature du pouvoir. »
Même si l'on admet que toutes les entreprises ne se trouvaient
pas au niveau de Renault Billancourt (il y en avait aussi de plus
avancées), on est en tout cas bien forcé de constater qu'après
le rejet des accords de Grenelle, la majorité des travailleurs
attendaient plus ou moins confusément, un changement de régime.
Le problème est, bien sûr, qu'ils ne savaient pas très bien comment
devait se faire ce changement. L'aspiration au pouvoir restait en
somme inarticulée, oscillant entre une conception vaguement
légaliste et une conception sommaire d'une prise de pouvoir
qui ont constitué l'aile marchante du mouvement de mai, si elles
n'ont pas commis les erreurs aventuristes que les « théoriciens »
du P.C.F. leur imputent, n'ont pu assumer véritablement le rôle
de direction de l'action politique de masse. Elles ont pu dans une
certaine mesure canaliser et organiser les manifestations de rue,
s'opposer aux mots d'ordre erronnés (Allons prendre l'Elysée!),
mais en aucun cas elles n'ont pu contrôler et diriger le processus
politique entre le 14 et le 30 mai. La progression du mouvement
de masse s'est opérée très largement de façon spontanée par
l'entrée successive de nouvelles couches dans la grève et par la
dégradation consécutive des positions de pouvoir, sans que la
conscience des travailleurs en lutte parvienne jusqu'à une compré-
hension globale du mouvement et de ses implications. Certes, il
serait faux de croire qu'au cours de la grève n'ait pas surgi dans
la grande masse l'idée qu'il fallait « changer les choses ». Un témoin
qu'on ne peut suspecter de « gauchisme », Aimé Halbeher, secré-
taire général du syndicat C.G.T. Renault, dit à ce sujet : « Je
sais que chez une bonne partie des travailleurs, les plus conscients,
il y avait l'idée que l'on pouvait aller beaucoup plus loin. Ils
avaient une confiance très grande dans l'issue et à partir de là,
dans un changement de pouvoir, dans l'instauration d'un gouver-
nement populaire, parce qu'ils présentaient des revendications
qui, effectivement, mettaient en cause la nature du pouvoir. »
Même si l'on admet que toutes les entreprises ne se trouvaient
pas au niveau de Renault Billancourt (il y en avait aussi de plus
avancées), on est en tout cas bien forcé de constater qu'après
le rejet des accords de Grenelle, la majorité des travailleurs
attendaient plus ou moins confusément, un changement de régime.
Le problème est, bien sûr, qu'ils ne savaient pas très bien comment
devait se faire ce changement. L'aspiration au pouvoir restait en
somme inarticulée, oscillant entre une conception vaguement
légaliste et une conception sommaire d'une prise de pouvoir
'ff
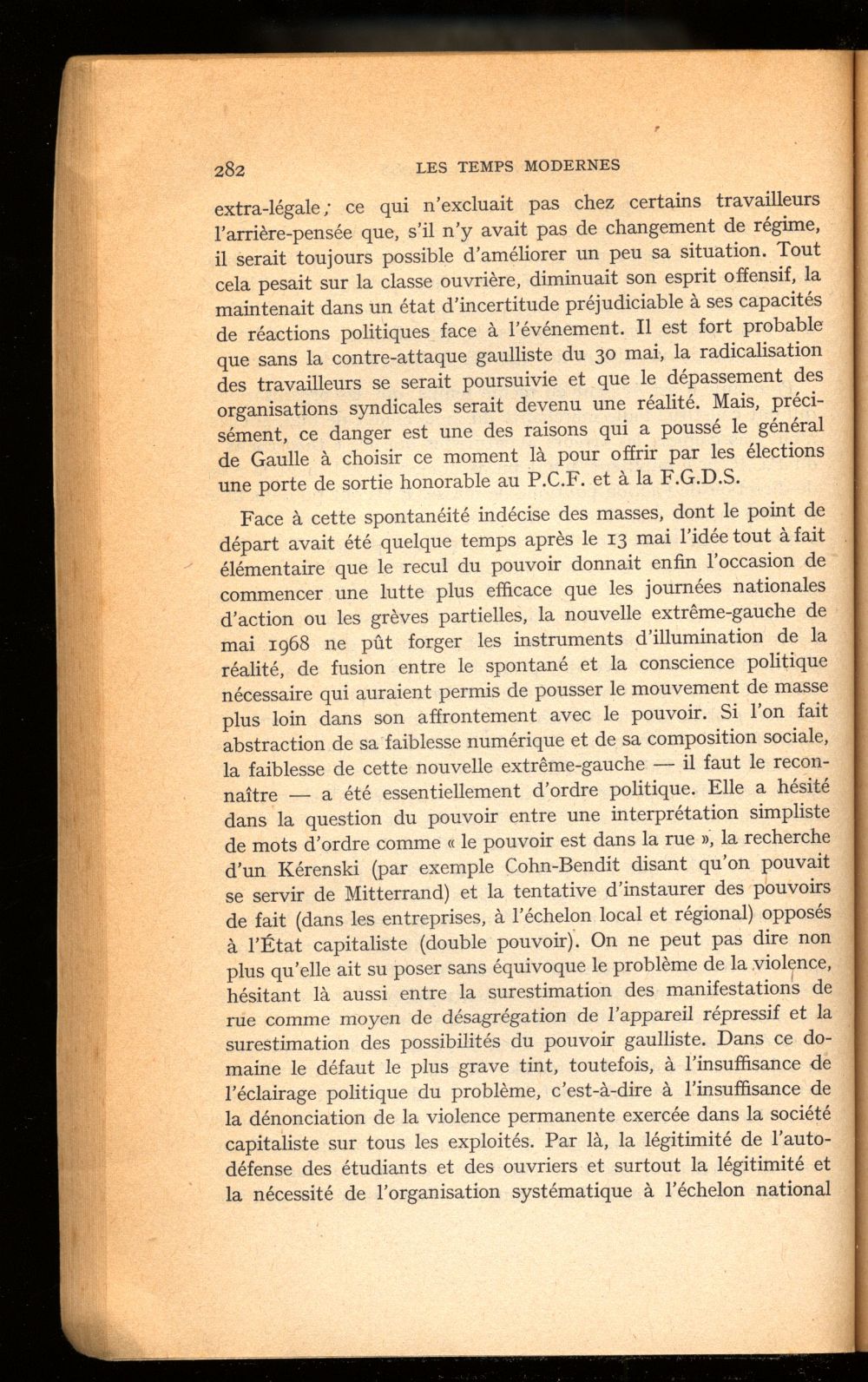

282
LES TEMPS MODERNES
extra-légale; ce qui n'excluait pas chez certains travailleurs
l'arrière-pensée que, s'il n'y avait pas de changement de régime,
il serait toujours possible d'améliorer un peu sa situation. Tout
cela pesait sur la classe ouvrière, diminuait son esprit offensif, la
maintenait dans un état d'incertitude préjudiciable à ses capacités
de réactions politiques face à l'événement. Il est fort probable
que sans la contre-attaque gaulliste du 30 mai, la radicalisation
des travailleurs se serait poursuivie et que le dépassement des
organisations syndicales serait devenu une réalité. Mais, préci-
sément, ce danger est une des raisons qui a poussé le général
de Gaulle à choisir ce moment là pour offrir par les élections
une porte de sortie honorable au P.C.F. et à la F.G.D.S.
l'arrière-pensée que, s'il n'y avait pas de changement de régime,
il serait toujours possible d'améliorer un peu sa situation. Tout
cela pesait sur la classe ouvrière, diminuait son esprit offensif, la
maintenait dans un état d'incertitude préjudiciable à ses capacités
de réactions politiques face à l'événement. Il est fort probable
que sans la contre-attaque gaulliste du 30 mai, la radicalisation
des travailleurs se serait poursuivie et que le dépassement des
organisations syndicales serait devenu une réalité. Mais, préci-
sément, ce danger est une des raisons qui a poussé le général
de Gaulle à choisir ce moment là pour offrir par les élections
une porte de sortie honorable au P.C.F. et à la F.G.D.S.
Face à cette spontanéité indécise des masses, dont le point de
départ avait été quelque temps après le 13 mai l'idée tout à fait
élémentaire que le recul du pouvoir donnait enfin l'occasion de
commencer une lutte plus efficace que les journées nationales
d'action ou les grèves partielles, la nouvelle extrême-gauche de
mai 1968 ne pût forger les instruments d'illumination de la
réalité, de fusion entre le spontané et la conscience politique
nécessaire qui auraient permis de pousser le mouvement de masse
plus loin dans son affrontement avec le pouvoir. Si l'on fait
abstraction de sa faiblesse numérique et de sa composition sociale,
la faiblesse de cette nouvelle extrême-gauche — il faut le recon-
naître — a été essentiellement d'ordre politique. Elle a hésité
dans la question du pouvoir entre une interprétation simpliste
de mots d'ordre comme « le pouvoir est dans la rue », la recherche
d'un Kérenski (par exemple Cohn-Bendit disant qu'on pouvait
se servir de Mitterrand) et la tentative d'instaurer des pouvoirs
de fait (dans les entreprises, à l'échelon local et régional) opposés
à l'État capitaliste (double pouvoir). On ne peut pas dire non
plus qu'elle ait su poser sans équivoque le problème de la violence,
hésitant là aussi entre la surestimation des manifestations de
rue comme moyen de désagrégation de l'appareil répressif et la
surestimation des possibilités du pouvoir gaulliste. Dans ce do-
maine le défaut le plus grave tint, toutefois, à l'insuffisance de
l'éclairage politique du problème, c'est-à-dire à l'insuffisance de
la dénonciation de la violence permanente exercée dans la société
capitaliste sur tous les exploités. Par là, la légitimité de l'auto-
défense des étudiants et des ouvriers et surtout la légitimité et
la nécessité de l'organisation systématique à l'échelon national
départ avait été quelque temps après le 13 mai l'idée tout à fait
élémentaire que le recul du pouvoir donnait enfin l'occasion de
commencer une lutte plus efficace que les journées nationales
d'action ou les grèves partielles, la nouvelle extrême-gauche de
mai 1968 ne pût forger les instruments d'illumination de la
réalité, de fusion entre le spontané et la conscience politique
nécessaire qui auraient permis de pousser le mouvement de masse
plus loin dans son affrontement avec le pouvoir. Si l'on fait
abstraction de sa faiblesse numérique et de sa composition sociale,
la faiblesse de cette nouvelle extrême-gauche — il faut le recon-
naître — a été essentiellement d'ordre politique. Elle a hésité
dans la question du pouvoir entre une interprétation simpliste
de mots d'ordre comme « le pouvoir est dans la rue », la recherche
d'un Kérenski (par exemple Cohn-Bendit disant qu'on pouvait
se servir de Mitterrand) et la tentative d'instaurer des pouvoirs
de fait (dans les entreprises, à l'échelon local et régional) opposés
à l'État capitaliste (double pouvoir). On ne peut pas dire non
plus qu'elle ait su poser sans équivoque le problème de la violence,
hésitant là aussi entre la surestimation des manifestations de
rue comme moyen de désagrégation de l'appareil répressif et la
surestimation des possibilités du pouvoir gaulliste. Dans ce do-
maine le défaut le plus grave tint, toutefois, à l'insuffisance de
l'éclairage politique du problème, c'est-à-dire à l'insuffisance de
la dénonciation de la violence permanente exercée dans la société
capitaliste sur tous les exploités. Par là, la légitimité de l'auto-
défense des étudiants et des ouvriers et surtout la légitimité et
la nécessité de l'organisation systématique à l'échelon national
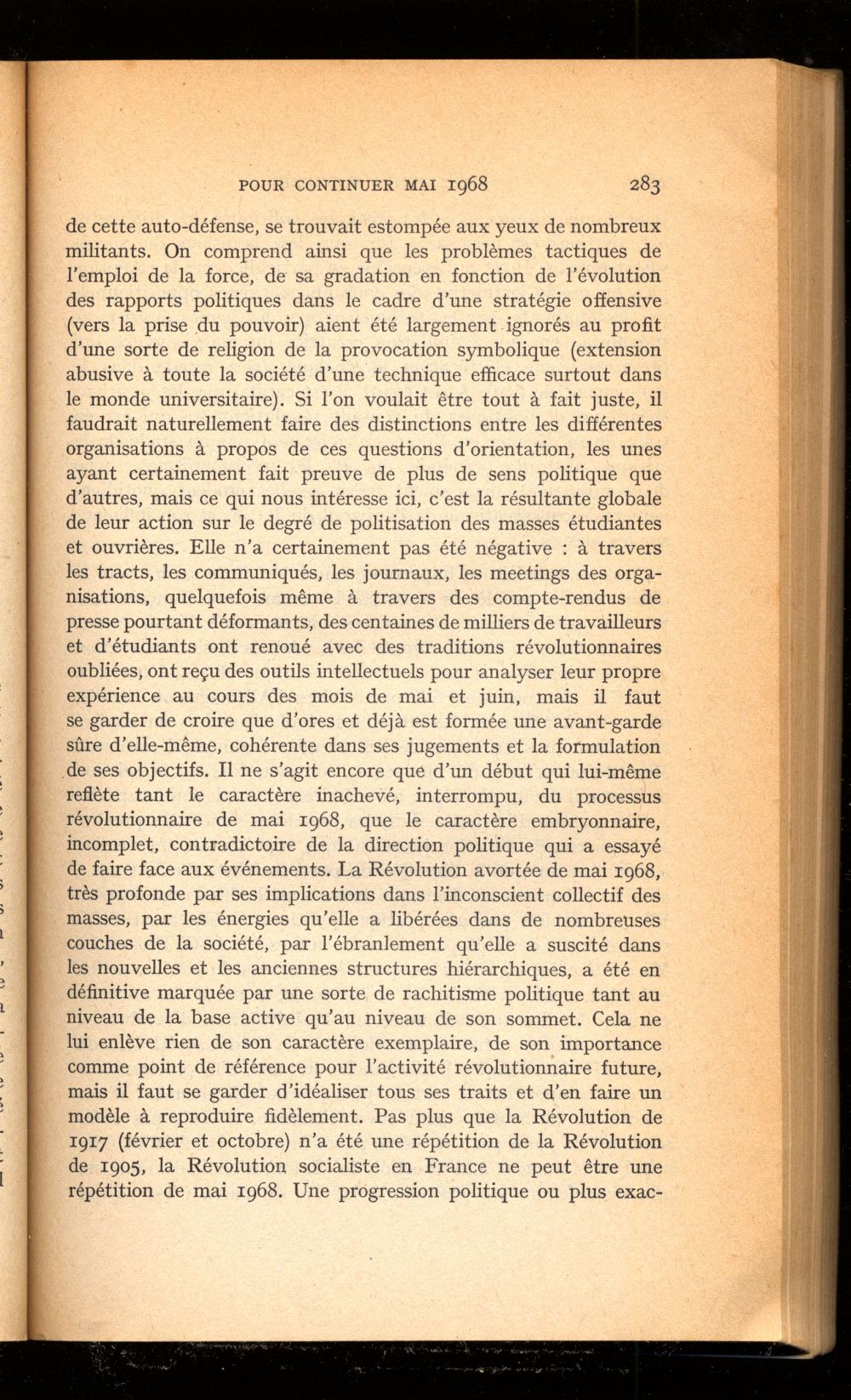

POUR CONTINUER MAI 1968
283
de cette auto-défense, se trouvait estompée aux yeux de nombreux
militants. On comprend ainsi que les problèmes tactiques de
l'emploi de la force, de sa gradation en fonction de l'évolution
des rapports politiques dans le cadre d'une stratégie offensive
(vers la prise du pouvoir) aient été largement ignorés au profit
d'une sorte de religion de la provocation symbolique (extension
abusive à toute la société d'une technique efficace surtout dans
le monde universitaire). Si l'on voulait être tout à fait juste, il
faudrait naturellement faire des distinctions entre les différentes
organisations à propos de ces questions d'orientation, les unes
ayant certainement fait preuve de plus de sens politique que
d'autres, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la résultante globale
de leur action sur le degré de politisation des masses étudiantes
et ouvrières. Elle n'a certainement pas été négative : à travers
les tracts, les communiqués, les journaux, les meetings des orga-
nisations, quelquefois même à travers des compte-rendus de
presse pourtant déformants, des centaines de milliers de travailleurs
et d'étudiants ont renoué avec des traditions révolutionnaires
oubliées, ont reçu des outils intellectuels pour analyser leur propre
expérience au cours des mois de mai et juin, mais il faut
se garder de croire que d'ores et déjà est formée une avant-garde
sûre d'elle-même, cohérente dans ses jugements et la formulation
.de ses objectifs. Il ne s'agit encore que d'un début qui lui-même
reflète tant le caractère inachevé, interrompu, du processus
révolutionnaire de mai 1968, que le caractère embryonnaire,
incomplet, contradictoire de la direction politique qui a essayé
de faire face aux événements. La Révolution avortée de mai 1968,
très profonde par ses implications dans l'inconscient collectif des
masses, par les énergies qu'elle a libérées dans de nombreuses
couches de la société, par l'ébranlement qu'elle a suscité dans
les nouvelles et les anciennes structures hiérarchiques, a été en
définitive marquée par une sorte de rachitisme politique tant au
niveau de la base active qu'au niveau de son sommet. Cela ne
lui enlève rien de son caractère exemplaire, de son importance
comme point de référence pour l'activité révolutionnaire future,
mais il faut se garder d'idéaliser tous ses traits et d'en faire un
modèle à reproduire fidèlement. Pas plus que la Révolution de
1917 (février et octobre) n'a été une répétition de la Révolution
de 1905, la Révolution socialiste en France ne peut être une
répétition de mai 1968. Une progression politique ou plus exac-
militants. On comprend ainsi que les problèmes tactiques de
l'emploi de la force, de sa gradation en fonction de l'évolution
des rapports politiques dans le cadre d'une stratégie offensive
(vers la prise du pouvoir) aient été largement ignorés au profit
d'une sorte de religion de la provocation symbolique (extension
abusive à toute la société d'une technique efficace surtout dans
le monde universitaire). Si l'on voulait être tout à fait juste, il
faudrait naturellement faire des distinctions entre les différentes
organisations à propos de ces questions d'orientation, les unes
ayant certainement fait preuve de plus de sens politique que
d'autres, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la résultante globale
de leur action sur le degré de politisation des masses étudiantes
et ouvrières. Elle n'a certainement pas été négative : à travers
les tracts, les communiqués, les journaux, les meetings des orga-
nisations, quelquefois même à travers des compte-rendus de
presse pourtant déformants, des centaines de milliers de travailleurs
et d'étudiants ont renoué avec des traditions révolutionnaires
oubliées, ont reçu des outils intellectuels pour analyser leur propre
expérience au cours des mois de mai et juin, mais il faut
se garder de croire que d'ores et déjà est formée une avant-garde
sûre d'elle-même, cohérente dans ses jugements et la formulation
.de ses objectifs. Il ne s'agit encore que d'un début qui lui-même
reflète tant le caractère inachevé, interrompu, du processus
révolutionnaire de mai 1968, que le caractère embryonnaire,
incomplet, contradictoire de la direction politique qui a essayé
de faire face aux événements. La Révolution avortée de mai 1968,
très profonde par ses implications dans l'inconscient collectif des
masses, par les énergies qu'elle a libérées dans de nombreuses
couches de la société, par l'ébranlement qu'elle a suscité dans
les nouvelles et les anciennes structures hiérarchiques, a été en
définitive marquée par une sorte de rachitisme politique tant au
niveau de la base active qu'au niveau de son sommet. Cela ne
lui enlève rien de son caractère exemplaire, de son importance
comme point de référence pour l'activité révolutionnaire future,
mais il faut se garder d'idéaliser tous ses traits et d'en faire un
modèle à reproduire fidèlement. Pas plus que la Révolution de
1917 (février et octobre) n'a été une répétition de la Révolution
de 1905, la Révolution socialiste en France ne peut être une
répétition de mai 1968. Une progression politique ou plus exac-
'
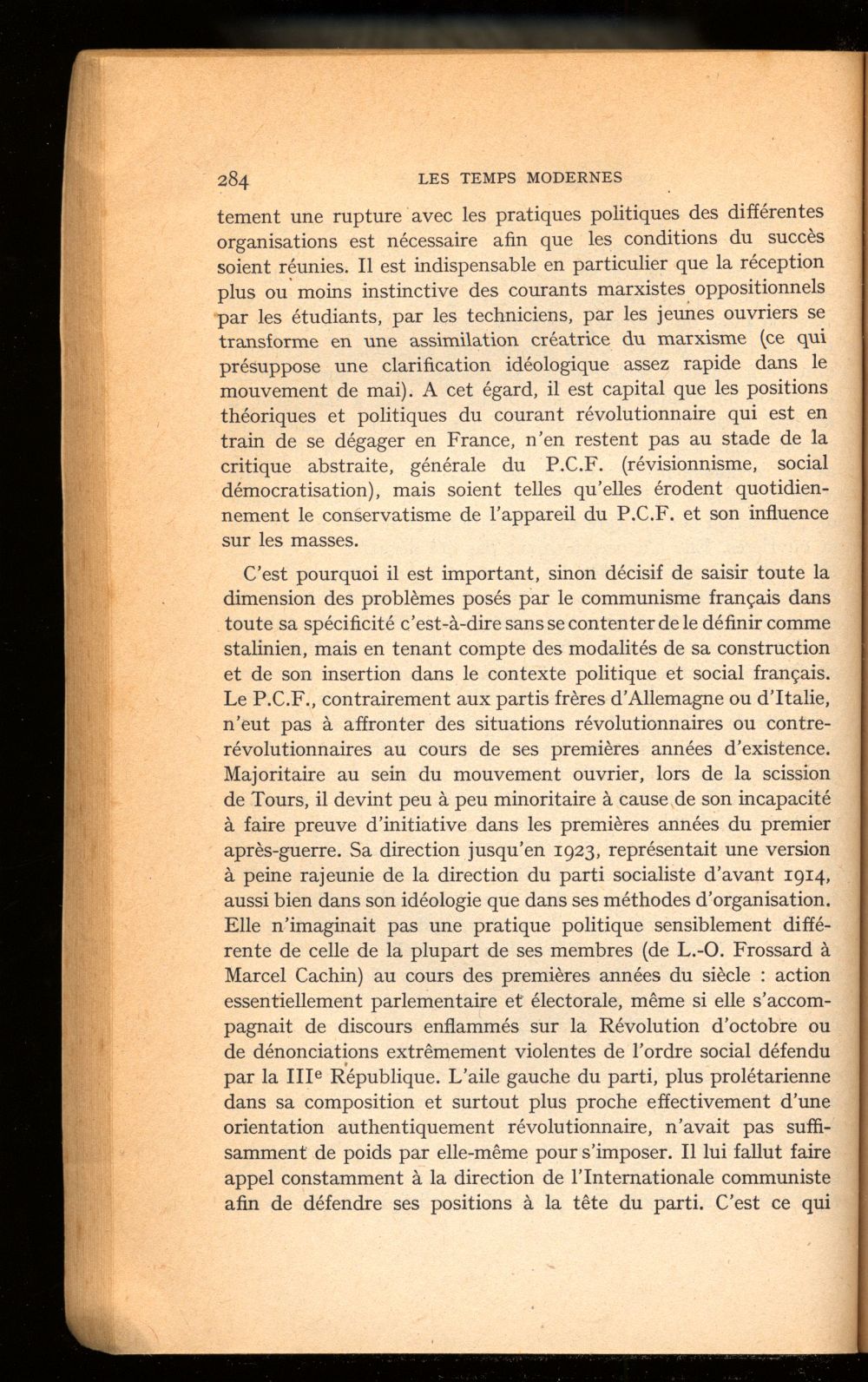

284 LES TEMPS MODERNES
tement une rupture avec les pratiques politiques des différentes
organisations est nécessaire afin que les conditions du succès
soient réunies. Il est indispensable en particulier que la réception
plus ou moins instinctive des courants marxistes oppositionnels
par les étudiants, par les techniciens, par les jeunes ouvriers se
transforme en une assimilation créatrice du marxisme (ce qui
présuppose une clarification idéologique assez rapide dans le
mouvement de mai). A cet égard, il est capital que les positions
théoriques et politiques du courant révolutionnaire qui est en
train de se dégager en France, n'en restent pas au stade de la
critique abstraite, générale du P.C.F. (révisionnisme, social
démocratisation), mais soient telles qu'elles érodent quotidien-
nement le conservatisme de l'appareil du P.C.F. et son influence
sur les masses.
organisations est nécessaire afin que les conditions du succès
soient réunies. Il est indispensable en particulier que la réception
plus ou moins instinctive des courants marxistes oppositionnels
par les étudiants, par les techniciens, par les jeunes ouvriers se
transforme en une assimilation créatrice du marxisme (ce qui
présuppose une clarification idéologique assez rapide dans le
mouvement de mai). A cet égard, il est capital que les positions
théoriques et politiques du courant révolutionnaire qui est en
train de se dégager en France, n'en restent pas au stade de la
critique abstraite, générale du P.C.F. (révisionnisme, social
démocratisation), mais soient telles qu'elles érodent quotidien-
nement le conservatisme de l'appareil du P.C.F. et son influence
sur les masses.
C'est pourquoi il est important, sinon décisif de saisir toute la
dimension des problèmes posés par le communisme français dans
toute sa spécificité c'est-à-dire sans se contenter de le définir comme
stalinien, mais en tenant compte des modalités de sa construction
et de son insertion dans le contexte politique et social français.
Le P.C.F., contrairement aux partis frères d'Allemagne ou d'Italie,
n'eut pas à affronter des situations révolutionnaires ou contre-
révolutionnaires au cours de ses premières années d'existence.
Majoritaire au sein du mouvement ouvrier, lors de la scission
de Tours, il devint peu à peu minoritaire à cause de son incapacité
à faire preuve d'initiative dans les premières années du premier
après-guerre. Sa direction jusqu'en 1923, représentait une version
à peine rajeunie de la direction du parti socialiste d'avant 1914,
aussi bien dans son idéologie que dans ses méthodes d'organisation.
Elle n'imaginait pas une pratique politique sensiblement diffé-
rente de celle de la plupart de ses membres (de L.-O. Frossard à
Marcel Cachin) au cours des premières années du siècle : action
essentiellement parlementaire et électorale, même si elle s'accom-
pagnait de discours enflammés sur la Révolution d'octobre ou
de dénonciations extrêmement violentes de l'ordre social défendu
par la IIIe République. L'aile gauche du parti, plus prolétarienne
dans sa composition et surtout plus proche effectivement d'une
orientation authentiquement révolutionnaire, n'avait pas suffi-
samment de poids par elle-même pour s'imposer. Il lui fallut faire
appel constamment à la direction de l'Internationale communiste
afin de défendre ses positions à la tête du parti. C'est ce qui
dimension des problèmes posés par le communisme français dans
toute sa spécificité c'est-à-dire sans se contenter de le définir comme
stalinien, mais en tenant compte des modalités de sa construction
et de son insertion dans le contexte politique et social français.
Le P.C.F., contrairement aux partis frères d'Allemagne ou d'Italie,
n'eut pas à affronter des situations révolutionnaires ou contre-
révolutionnaires au cours de ses premières années d'existence.
Majoritaire au sein du mouvement ouvrier, lors de la scission
de Tours, il devint peu à peu minoritaire à cause de son incapacité
à faire preuve d'initiative dans les premières années du premier
après-guerre. Sa direction jusqu'en 1923, représentait une version
à peine rajeunie de la direction du parti socialiste d'avant 1914,
aussi bien dans son idéologie que dans ses méthodes d'organisation.
Elle n'imaginait pas une pratique politique sensiblement diffé-
rente de celle de la plupart de ses membres (de L.-O. Frossard à
Marcel Cachin) au cours des premières années du siècle : action
essentiellement parlementaire et électorale, même si elle s'accom-
pagnait de discours enflammés sur la Révolution d'octobre ou
de dénonciations extrêmement violentes de l'ordre social défendu
par la IIIe République. L'aile gauche du parti, plus prolétarienne
dans sa composition et surtout plus proche effectivement d'une
orientation authentiquement révolutionnaire, n'avait pas suffi-
samment de poids par elle-même pour s'imposer. Il lui fallut faire
appel constamment à la direction de l'Internationale communiste
afin de défendre ses positions à la tête du parti. C'est ce qui
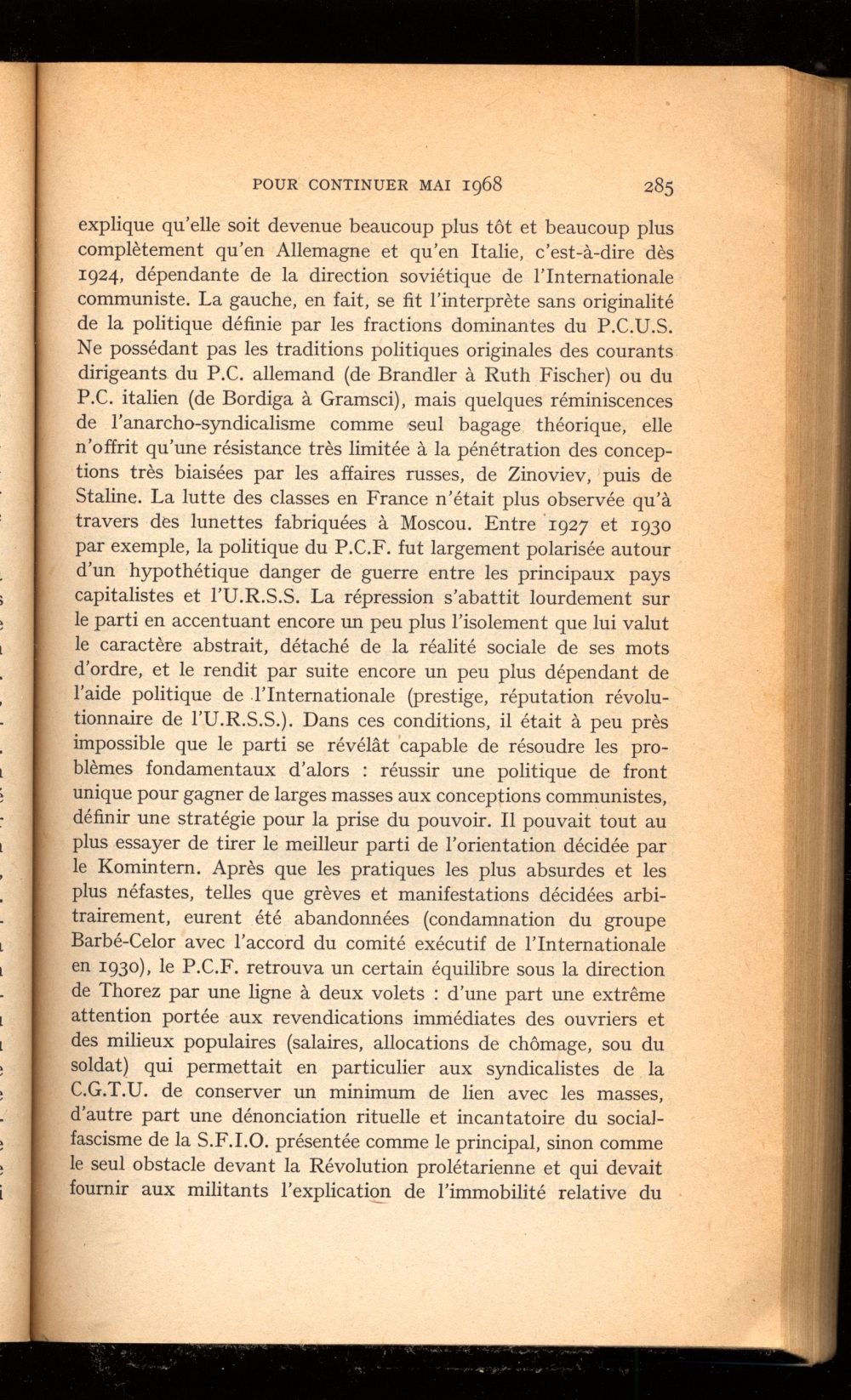

POUR CONTINUER MAI IQÔ8
285
5 '
fl
explique qu'elle soit devenue beaucoup plus tôt et beaucoup plus
complètement qu'en Allemagne et qu'en Italie, c'est-à-dire dès
1924, dépendante de la direction soviétique de l'Internationale
communiste. La gauche, en fait, se fit l'interprète sans originalité
de la politique définie par les fractions dominantes du P.C.U.S.
Ne possédant pas les traditions politiques originales des courants
dirigeants du P.C. allemand (de Brandler à Ruth Fischer) ou du
P.C. italien (de Bordiga à Gramsci), mais quelques réminiscences
de l'anarcho-syndicalisme comme seul bagage théorique, elle
n'offrit qu'une résistance très limitée à la pénétration des concep-
tions très biaisées par les affaires russes, de Zinoviev, puis de
Staline. La lutte des classes en France n'était plus observée qu'à
travers des lunettes fabriquées à Moscou. Entre 1927 et 1930
par exemple, la politique du P.C.F. fut largement polarisée autour
d'un hypothétique danger de guerre entre les principaux pays
capitalistes et l'U.R.S.S. La répression s'abattit lourdement sur
le parti en accentuant encore un peu plus l'isolement que lui valut
le caractère abstrait, détaché de la réalité sociale de ses mots
d'ordre, et le rendit par suite encore un peu plus dépendant de
l'aide politique de l'Internationale (prestige, réputation révolu-
tionnaire de l'U.R.S.S.). Dans ces conditions, il était à peu près
impossible que le parti se révélât capable de résoudre les pro-
blèmes fondamentaux d'alors : réussir une politique de front
unique pour gagner de larges masses aux conceptions communistes,
définir une stratégie pour la prise du pouvoir. Il pouvait tout au
plus essayer de tirer le meilleur parti de l'orientation décidée par
le Komintern. Après que les pratiques les plus absurdes et les
plus néfastes, telles que grèves et manifestations décidées arbi-
trairement, eurent été abandonnées (condamnation du groupe
Barbé-Celor avec l'accord du comité exécutif de l'Internationale
en 1930), le P.C.F. retrouva un certain équilibre sous la direction
de Thorez par une ligne à deux volets : d'une part une extrême
attention portée aux revendications immédiates des ouvriers et
des milieux populaires (salaires, allocations de chômage, sou du
soldat) qui permettait en particulier aux syndicalistes de la
C.G.T.U. de conserver un minimum de lien avec les masses,
d'autre part une dénonciation rituelle et incantatoire du social-
fascisme de la S.F.I.O. présentée comme le principal, sinon comme
le seul obstacle devant la Révolution prolétarienne et qui devait
fournir aux militants l'explication de l'immobilité relative du
complètement qu'en Allemagne et qu'en Italie, c'est-à-dire dès
1924, dépendante de la direction soviétique de l'Internationale
communiste. La gauche, en fait, se fit l'interprète sans originalité
de la politique définie par les fractions dominantes du P.C.U.S.
Ne possédant pas les traditions politiques originales des courants
dirigeants du P.C. allemand (de Brandler à Ruth Fischer) ou du
P.C. italien (de Bordiga à Gramsci), mais quelques réminiscences
de l'anarcho-syndicalisme comme seul bagage théorique, elle
n'offrit qu'une résistance très limitée à la pénétration des concep-
tions très biaisées par les affaires russes, de Zinoviev, puis de
Staline. La lutte des classes en France n'était plus observée qu'à
travers des lunettes fabriquées à Moscou. Entre 1927 et 1930
par exemple, la politique du P.C.F. fut largement polarisée autour
d'un hypothétique danger de guerre entre les principaux pays
capitalistes et l'U.R.S.S. La répression s'abattit lourdement sur
le parti en accentuant encore un peu plus l'isolement que lui valut
le caractère abstrait, détaché de la réalité sociale de ses mots
d'ordre, et le rendit par suite encore un peu plus dépendant de
l'aide politique de l'Internationale (prestige, réputation révolu-
tionnaire de l'U.R.S.S.). Dans ces conditions, il était à peu près
impossible que le parti se révélât capable de résoudre les pro-
blèmes fondamentaux d'alors : réussir une politique de front
unique pour gagner de larges masses aux conceptions communistes,
définir une stratégie pour la prise du pouvoir. Il pouvait tout au
plus essayer de tirer le meilleur parti de l'orientation décidée par
le Komintern. Après que les pratiques les plus absurdes et les
plus néfastes, telles que grèves et manifestations décidées arbi-
trairement, eurent été abandonnées (condamnation du groupe
Barbé-Celor avec l'accord du comité exécutif de l'Internationale
en 1930), le P.C.F. retrouva un certain équilibre sous la direction
de Thorez par une ligne à deux volets : d'une part une extrême
attention portée aux revendications immédiates des ouvriers et
des milieux populaires (salaires, allocations de chômage, sou du
soldat) qui permettait en particulier aux syndicalistes de la
C.G.T.U. de conserver un minimum de lien avec les masses,
d'autre part une dénonciation rituelle et incantatoire du social-
fascisme de la S.F.I.O. présentée comme le principal, sinon comme
le seul obstacle devant la Révolution prolétarienne et qui devait
fournir aux militants l'explication de l'immobilité relative du
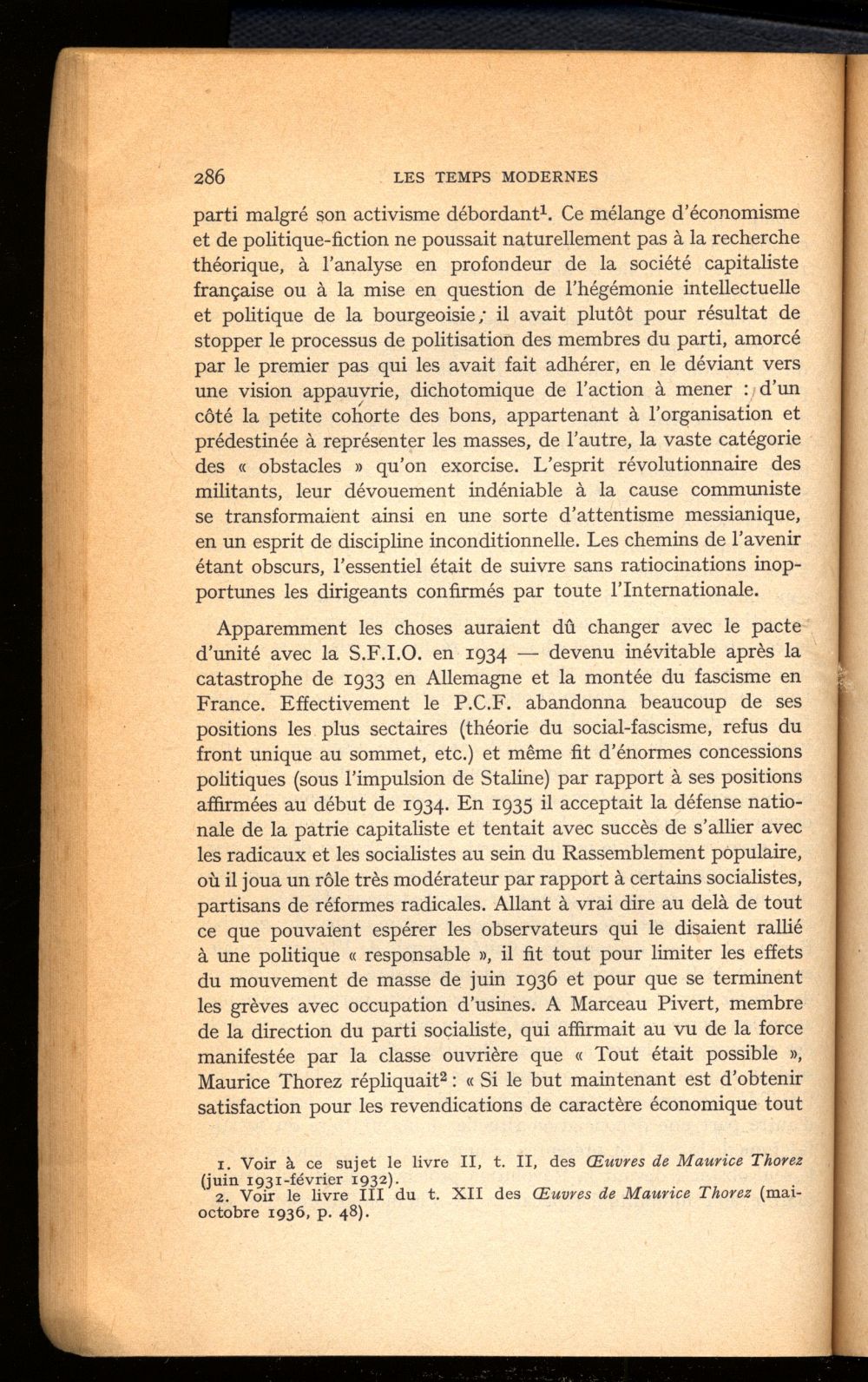

286
LES TEMPS MODERNES
parti malgré son activisme débordant1. Ce mélange d'économisme
et de politique-fiction ne poussait naturellement pas à la recherche
théorique, à l'analyse en profondeur de la société capitaliste
française ou à la mise en question de l'hégémonie intellectuelle
et politique de la bourgeoisie; il avait plutôt pour résultat de
stopper le processus de politisation des membres du parti, amorcé
par le premier pas qui les avait fait adhérer, en le déviant vers
une vision appauvrie, dichotomique de l'action à mener : d'un
côté la petite cohorte des bons, appartenant à l'organisation et
prédestinée à représenter les masses, de l'autre, la vaste catégorie
des « obstacles » qu'on exorcise. L'esprit révolutionnaire des
militants, leur dévouement indéniable à la cause communiste
se transformaient ainsi en une sorte d'attentisme messianique,
en un esprit de discipline inconditionnelle. Les chemins de l'avenir
étant obscurs, l'essentiel était de suivre sans ratiocinations inop-
portunes les dirigeants confirmés par toute l'Internationale.
et de politique-fiction ne poussait naturellement pas à la recherche
théorique, à l'analyse en profondeur de la société capitaliste
française ou à la mise en question de l'hégémonie intellectuelle
et politique de la bourgeoisie; il avait plutôt pour résultat de
stopper le processus de politisation des membres du parti, amorcé
par le premier pas qui les avait fait adhérer, en le déviant vers
une vision appauvrie, dichotomique de l'action à mener : d'un
côté la petite cohorte des bons, appartenant à l'organisation et
prédestinée à représenter les masses, de l'autre, la vaste catégorie
des « obstacles » qu'on exorcise. L'esprit révolutionnaire des
militants, leur dévouement indéniable à la cause communiste
se transformaient ainsi en une sorte d'attentisme messianique,
en un esprit de discipline inconditionnelle. Les chemins de l'avenir
étant obscurs, l'essentiel était de suivre sans ratiocinations inop-
portunes les dirigeants confirmés par toute l'Internationale.
Apparemment les choses auraient dû changer avec le pacte
d'unité avec la S.F.I.O. en 1934 — devenu inévitable après la
catastrophe de 1933 en Allemagne et la montée du fascisme en
France. Effectivement le P.C.F. abandonna beaucoup de ses
positions les plus sectaires (théorie du social-fascisme, refus du
front unique au sommet, etc.) et même fit d'énormes concessions
politiques (sous l'impulsion de Staline) par rapport à ses positions
affirmées au début de 1934. En 1935 il acceptait la défense natio-
nale de la patrie capitaliste et tentait avec succès de s'allier avec
les radicaux et les socialistes au sein du Rassemblement populaire,
où il joua un rôle très modérateur par rapport à certains socialistes,
partisans de réformes radicales. Allant à vrai dire au delà de tout
ce que pouvaient espérer les observateurs qui le disaient rallié
à une politique « responsable », il fit tout pour limiter les effets
du mouvement de masse de juin 1936 et pour que se terminent
les grèves avec occupation d'usines. A Marceau Pivert, membre
de la direction du parti socialiste, qui affirmait au vu de la force
manifestée par la classe ouvrière que « Tout était possible »,
Maurice Thorez répliquait2 : « Si le but maintenant est d'obtenir
satisfaction pour les revendications de caractère économique tout
d'unité avec la S.F.I.O. en 1934 — devenu inévitable après la
catastrophe de 1933 en Allemagne et la montée du fascisme en
France. Effectivement le P.C.F. abandonna beaucoup de ses
positions les plus sectaires (théorie du social-fascisme, refus du
front unique au sommet, etc.) et même fit d'énormes concessions
politiques (sous l'impulsion de Staline) par rapport à ses positions
affirmées au début de 1934. En 1935 il acceptait la défense natio-
nale de la patrie capitaliste et tentait avec succès de s'allier avec
les radicaux et les socialistes au sein du Rassemblement populaire,
où il joua un rôle très modérateur par rapport à certains socialistes,
partisans de réformes radicales. Allant à vrai dire au delà de tout
ce que pouvaient espérer les observateurs qui le disaient rallié
à une politique « responsable », il fit tout pour limiter les effets
du mouvement de masse de juin 1936 et pour que se terminent
les grèves avec occupation d'usines. A Marceau Pivert, membre
de la direction du parti socialiste, qui affirmait au vu de la force
manifestée par la classe ouvrière que « Tout était possible »,
Maurice Thorez répliquait2 : « Si le but maintenant est d'obtenir
satisfaction pour les revendications de caractère économique tout
1. Voir à ce sujet le livre II, t. II, des Œuvres de Maurice Thorez
(juin I93i-févricr 1932).
(juin I93i-févricr 1932).
2. Voir le livre III du t. XII des Œuvres de Maurice Thorez (mai-
octobre 1936, p. 48).
octobre 1936, p. 48).
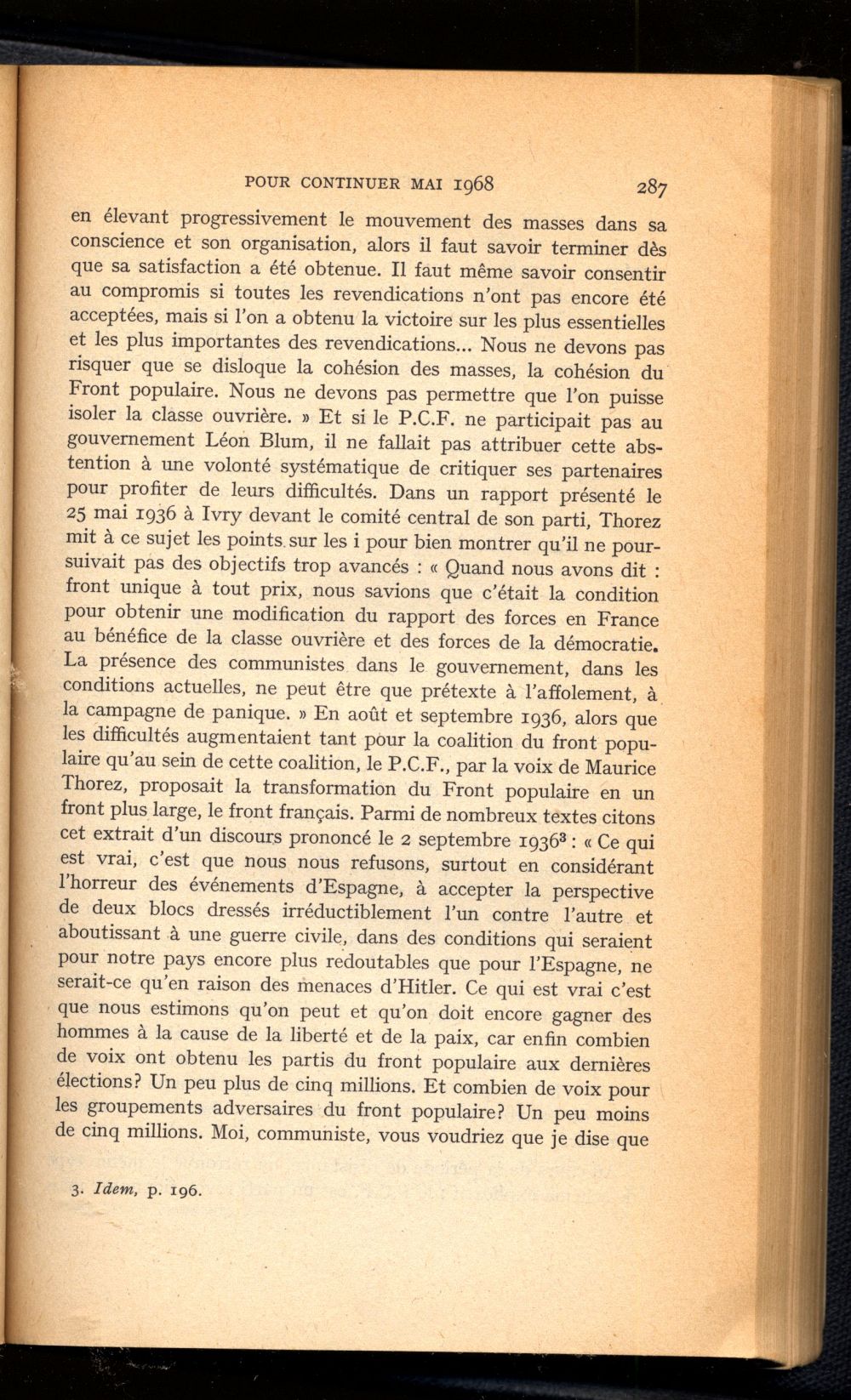

POUR CONTINUER MAI 1968
287
en élevant progressivement le mouvement des masses dans sa
conscience et son organisation, alors il faut savoir terminer dès
que sa satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir
au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été
acceptées, mais si l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles
et les plus importantes des revendications... Nous ne devons pas
risquer que se disloque la cohésion des masses, la cohésion du
Front populaire. Nous ne devons pas permettre que l'on puisse
isoler la classe ouvrière. » Et si le P.C. F. ne participait pas au
gouvernement Léon Blum, il ne fallait pas attribuer cette abs-
tention à une volonté systématique de critiquer ses partenaires
pour profiter de leurs difficultés. Dans un rapport présenté le
25 mai 1936 à Ivry devant le comité central de son parti, Thorez
mit à ce sujet les points sur les i pour bien montrer qu'il ne pour-
suivait pas des objectifs trop avancés : « Quand nous avons dit :
front unique à tout prix, nous savions que c'était la condition
pour obtenir une modification du rapport des forces en France
au bénéfice de la classe ouvrière et des forces de la démocratie.
La présence des communistes dans le gouvernement, dans les
conditions actuelles, ne peut être que prétexte à l'affolement, à
la campagne de panique. » En août et septembre 1936, alors que
les difficultés augmentaient tant pour la coalition du front popu-
laire qu'au sein de cette coalition, le P.C. F., par la voix de Maurice
Thorez, proposait la transformation du Front populaire en un
front plus large, le front français. Parmi de nombreux textes citons
cet extrait d'un discours prononcé le 2 septembre I93Ô3 : « Ce qui
est vrai, c'est que nous nous refusons, surtout en considérant
l'horreur des événements d'Espagne, à accepter la perspective
de deux blocs dressés irréductiblement l'un contre l'autre et
aboutissant à une guerre civile, dans des conditions qui seraient
pour notre pays encore plus redoutables que pour l'Espagne, ne
serait-ce qu'en raison des menaces d'Hitler. Ce qui est vrai c'est
que nous estimons qu'on peut et qu'on doit encore gagner des
hommes à la cause de la liberté et de la paix, car enfin combien
de voix ont obtenu les partis du front populaire aux dernières
élections? Un peu plus de cinq millions. Et combien de voix pour
les groupements adversaires du front populaire? Un peu moins
de cinq millions. Moi, communiste, vous voudriez que je dise que
conscience et son organisation, alors il faut savoir terminer dès
que sa satisfaction a été obtenue. Il faut même savoir consentir
au compromis si toutes les revendications n'ont pas encore été
acceptées, mais si l'on a obtenu la victoire sur les plus essentielles
et les plus importantes des revendications... Nous ne devons pas
risquer que se disloque la cohésion des masses, la cohésion du
Front populaire. Nous ne devons pas permettre que l'on puisse
isoler la classe ouvrière. » Et si le P.C. F. ne participait pas au
gouvernement Léon Blum, il ne fallait pas attribuer cette abs-
tention à une volonté systématique de critiquer ses partenaires
pour profiter de leurs difficultés. Dans un rapport présenté le
25 mai 1936 à Ivry devant le comité central de son parti, Thorez
mit à ce sujet les points sur les i pour bien montrer qu'il ne pour-
suivait pas des objectifs trop avancés : « Quand nous avons dit :
front unique à tout prix, nous savions que c'était la condition
pour obtenir une modification du rapport des forces en France
au bénéfice de la classe ouvrière et des forces de la démocratie.
La présence des communistes dans le gouvernement, dans les
conditions actuelles, ne peut être que prétexte à l'affolement, à
la campagne de panique. » En août et septembre 1936, alors que
les difficultés augmentaient tant pour la coalition du front popu-
laire qu'au sein de cette coalition, le P.C. F., par la voix de Maurice
Thorez, proposait la transformation du Front populaire en un
front plus large, le front français. Parmi de nombreux textes citons
cet extrait d'un discours prononcé le 2 septembre I93Ô3 : « Ce qui
est vrai, c'est que nous nous refusons, surtout en considérant
l'horreur des événements d'Espagne, à accepter la perspective
de deux blocs dressés irréductiblement l'un contre l'autre et
aboutissant à une guerre civile, dans des conditions qui seraient
pour notre pays encore plus redoutables que pour l'Espagne, ne
serait-ce qu'en raison des menaces d'Hitler. Ce qui est vrai c'est
que nous estimons qu'on peut et qu'on doit encore gagner des
hommes à la cause de la liberté et de la paix, car enfin combien
de voix ont obtenu les partis du front populaire aux dernières
élections? Un peu plus de cinq millions. Et combien de voix pour
les groupements adversaires du front populaire? Un peu moins
de cinq millions. Moi, communiste, vous voudriez que je dise que
l
3. Idem, p. 196.
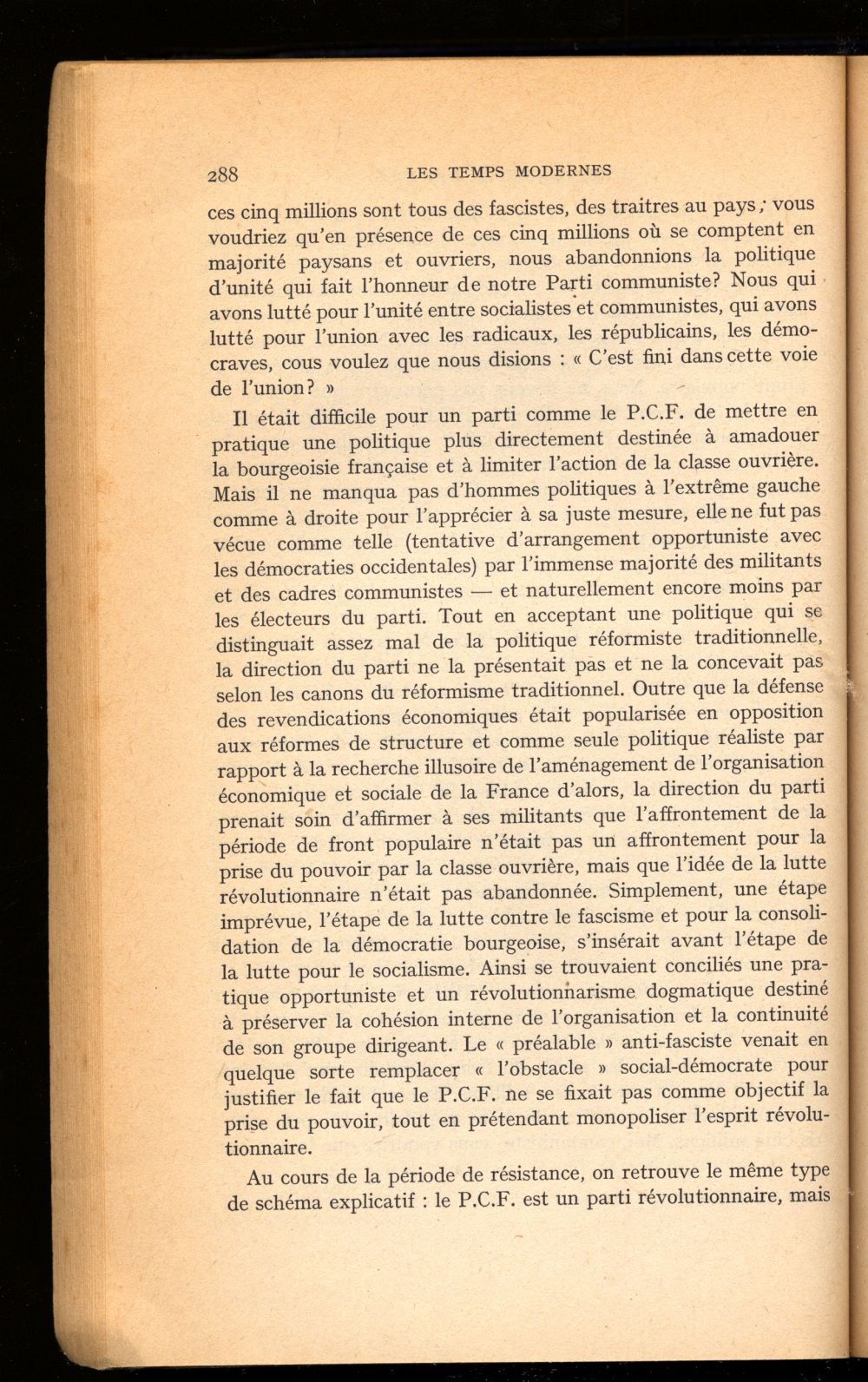

288
LES TEMPS MODERNES
ces cinq millions sont tous des fascistes, des traîtres au pays ; vous
voudriez qu'en présence de ces cinq millions où se comptent en
majorité paysans et ouvriers, nous abandonnions la politique
d'unité qui fait l'honneur de notre Parti communiste? Nous qui
avons lutté pour l'unité entre socialistes et communistes, qui avons
lutté pour l'union avec les radicaux, les républicains, les démo-
craves, cous voulez que nous disions : « C'est fini dans cette voie
de l'union? »
voudriez qu'en présence de ces cinq millions où se comptent en
majorité paysans et ouvriers, nous abandonnions la politique
d'unité qui fait l'honneur de notre Parti communiste? Nous qui
avons lutté pour l'unité entre socialistes et communistes, qui avons
lutté pour l'union avec les radicaux, les républicains, les démo-
craves, cous voulez que nous disions : « C'est fini dans cette voie
de l'union? »
II était difficile pour un parti comme le P.C.F. de mettre en
pratique une politique plus directement destinée à amadouer
la bourgeoisie française et à limiter l'action de la classe ouvrière.
Mais il ne manqua pas d'hommes politiques à l'extrême gauche
comme à droite pour l'apprécier à sa juste mesure, elle ne fut pas
vécue comme telle (tentative d'arrangement opportuniste avec
les démocraties occidentales) par l'immense majorité des militants
et des cadres communistes — et naturellement encore moins par
les électeurs du parti. Tout en acceptant une politique qui se
distinguait assez mal de la politique réformiste traditionnelle,
la direction du parti ne la présentait pas et ne la concevait pas
selon les canons du réformisme traditionnel. Outre que la défense
des revendications économiques était popularisée en opposition
aux réformes de structure et comme seule politique réaliste par
rapport à la recherche illusoire de l'aménagement de l'organisation
économique et sociale de la France d'alors, la direction du parti
prenait soin d'affirmer à ses militants que l'affrontement de la
période de front populaire n'était pas un affrontement pour la
prise du pouvoir par la classe ouvrière, mais que l'idée de la lutte
révolutionnaire n'était pas abandonnée. Simplement, une étape
imprévue, l'étape de la lutte contre le fascisme et pour la consoli-
dation de la démocratie bourgeoise, s'insérait avant l'étape de
la lutte pour le socialisme. Ainsi se trouvaient conciliés une pra-
tique opportuniste et un révolutionnarisme dogmatique destiné
à préserver la cohésion interne de l'organisation et la continuité
de son groupe dirigeant. Le « préalable » anti-fasciste venait en
quelque sorte remplacer « l'obstacle » social-démocrate pour
justifier le fait que le P.C.F. ne se fixait pas comme objectif la
prise du pouvoir, tout en prétendant monopoliser l'esprit révolu-
tionnaire.
pratique une politique plus directement destinée à amadouer
la bourgeoisie française et à limiter l'action de la classe ouvrière.
Mais il ne manqua pas d'hommes politiques à l'extrême gauche
comme à droite pour l'apprécier à sa juste mesure, elle ne fut pas
vécue comme telle (tentative d'arrangement opportuniste avec
les démocraties occidentales) par l'immense majorité des militants
et des cadres communistes — et naturellement encore moins par
les électeurs du parti. Tout en acceptant une politique qui se
distinguait assez mal de la politique réformiste traditionnelle,
la direction du parti ne la présentait pas et ne la concevait pas
selon les canons du réformisme traditionnel. Outre que la défense
des revendications économiques était popularisée en opposition
aux réformes de structure et comme seule politique réaliste par
rapport à la recherche illusoire de l'aménagement de l'organisation
économique et sociale de la France d'alors, la direction du parti
prenait soin d'affirmer à ses militants que l'affrontement de la
période de front populaire n'était pas un affrontement pour la
prise du pouvoir par la classe ouvrière, mais que l'idée de la lutte
révolutionnaire n'était pas abandonnée. Simplement, une étape
imprévue, l'étape de la lutte contre le fascisme et pour la consoli-
dation de la démocratie bourgeoise, s'insérait avant l'étape de
la lutte pour le socialisme. Ainsi se trouvaient conciliés une pra-
tique opportuniste et un révolutionnarisme dogmatique destiné
à préserver la cohésion interne de l'organisation et la continuité
de son groupe dirigeant. Le « préalable » anti-fasciste venait en
quelque sorte remplacer « l'obstacle » social-démocrate pour
justifier le fait que le P.C.F. ne se fixait pas comme objectif la
prise du pouvoir, tout en prétendant monopoliser l'esprit révolu-
tionnaire.
Au cours de la période de résistance, on retrouve le même type
de schéma explicatif : le P.C.F. est un parti révolutionnaire, mais
de schéma explicatif : le P.C.F. est un parti révolutionnaire, mais
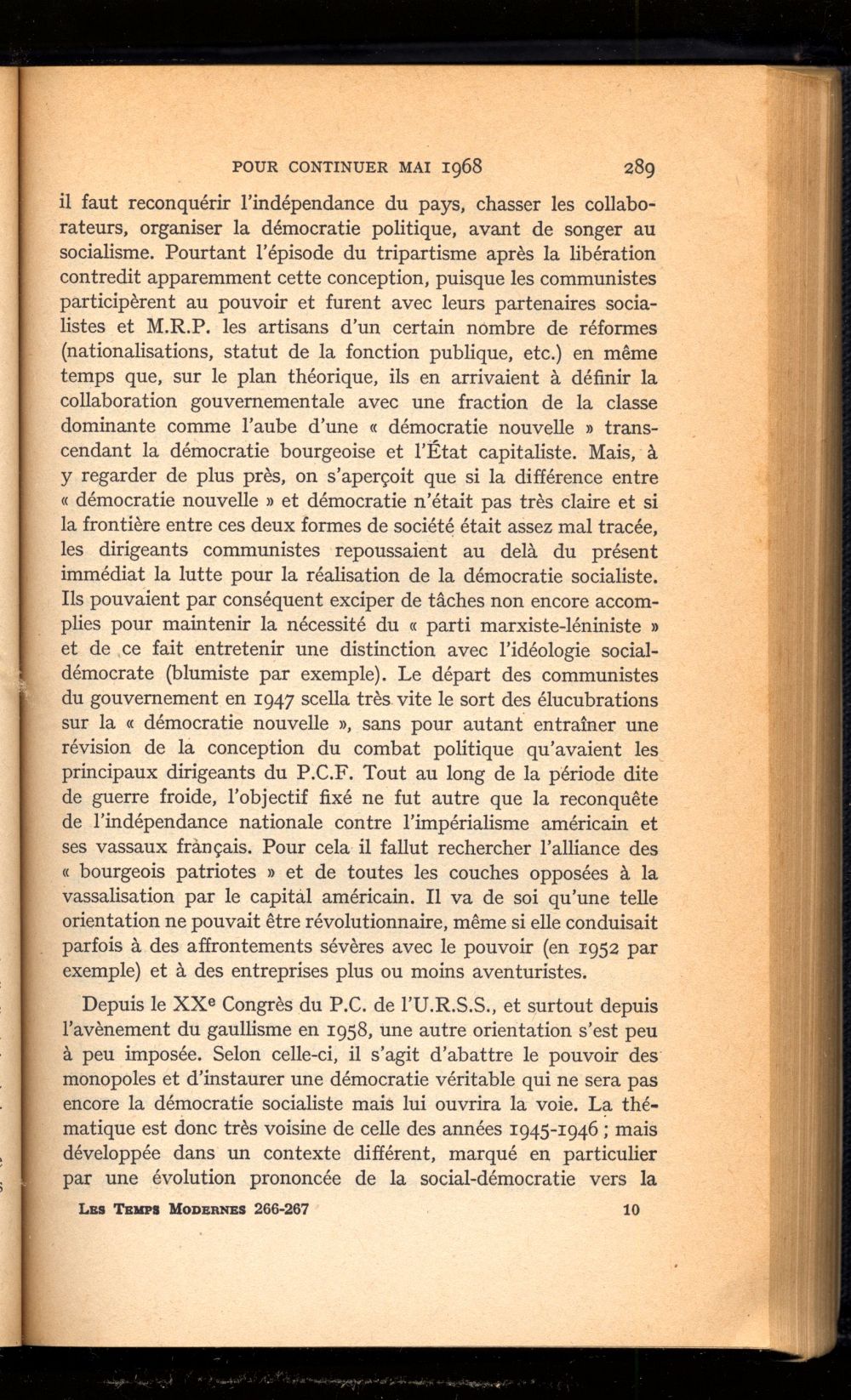

POUR CONTINUER MAI 1968
289
il faut reconquérir l'indépendance du pays, chasser les collabo-
rateurs, organiser la démocratie politique, avant de songer au
socialisme. Pourtant l'épisode du tripartisme après la libération
contredit apparemment cette conception, puisque les communistes
participèrent au pouvoir et furent avec leurs partenaires socia-
listes et M.R.P. les artisans d'un certain nombre de réformes
(nationalisations, statut de la fonction publique, etc.) en même
temps que, sur le plan théorique, ils en arrivaient à définir la
collaboration gouvernementale avec une fraction de la classe
dominante comme l'aube d'une « démocratie nouvelle » trans-
cendant la démocratie bourgeoise et l'État capitaliste. Mais, à
y regarder de plus près, on s'aperçoit que si la différence entre
« démocratie nouvelle » et démocratie n'était pas très claire et si
la frontière entre ces deux formes de société était assez mal tracée,
les dirigeants communistes repoussaient au delà du présent
immédiat la lutte pour la réalisation de la démocratie socialiste.
Ils pouvaient par conséquent exciper de tâches non encore accom-
plies pour maintenir la nécessité du « parti marxiste-léniniste »
et de ce fait entretenir une distinction avec l'idéologie social-
démocrate (blumiste par exemple). Le départ des communistes
du gouvernement en 1947 scella très vite le sort des élucubrations
sur la « démocratie nouvelle », sans pour autant entraîner une
révision de la conception du combat politique qu'avaient les
principaux dirigeants du P.C.F. Tout au long de la période dite
de guerre froide, l'objectif fixé ne fut autre que la reconquête
de l'indépendance nationale contre l'impérialisme américain et
ses vassaux français. Pour cela il fallut rechercher l'alliance des
« bourgeois patriotes » et de toutes les couches opposées à la
vassalisation par le capital américain. Il va de soi qu'une telle
orientation ne pouvait être révolutionnaire, même si elle conduisait
parfois à des affrontements sévères avec le pouvoir (en 1952 par
exemple) et à des entreprises plus ou moins aventuristes.
rateurs, organiser la démocratie politique, avant de songer au
socialisme. Pourtant l'épisode du tripartisme après la libération
contredit apparemment cette conception, puisque les communistes
participèrent au pouvoir et furent avec leurs partenaires socia-
listes et M.R.P. les artisans d'un certain nombre de réformes
(nationalisations, statut de la fonction publique, etc.) en même
temps que, sur le plan théorique, ils en arrivaient à définir la
collaboration gouvernementale avec une fraction de la classe
dominante comme l'aube d'une « démocratie nouvelle » trans-
cendant la démocratie bourgeoise et l'État capitaliste. Mais, à
y regarder de plus près, on s'aperçoit que si la différence entre
« démocratie nouvelle » et démocratie n'était pas très claire et si
la frontière entre ces deux formes de société était assez mal tracée,
les dirigeants communistes repoussaient au delà du présent
immédiat la lutte pour la réalisation de la démocratie socialiste.
Ils pouvaient par conséquent exciper de tâches non encore accom-
plies pour maintenir la nécessité du « parti marxiste-léniniste »
et de ce fait entretenir une distinction avec l'idéologie social-
démocrate (blumiste par exemple). Le départ des communistes
du gouvernement en 1947 scella très vite le sort des élucubrations
sur la « démocratie nouvelle », sans pour autant entraîner une
révision de la conception du combat politique qu'avaient les
principaux dirigeants du P.C.F. Tout au long de la période dite
de guerre froide, l'objectif fixé ne fut autre que la reconquête
de l'indépendance nationale contre l'impérialisme américain et
ses vassaux français. Pour cela il fallut rechercher l'alliance des
« bourgeois patriotes » et de toutes les couches opposées à la
vassalisation par le capital américain. Il va de soi qu'une telle
orientation ne pouvait être révolutionnaire, même si elle conduisait
parfois à des affrontements sévères avec le pouvoir (en 1952 par
exemple) et à des entreprises plus ou moins aventuristes.
Depuis le XX<= Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., et surtout depuis
l'avènement du gaullisme en 1958, une autre orientation s'est peu
à peu imposée. Selon celle-ci, il s'agit d'abattre le pouvoir des
monopoles et d'instaurer une démocratie véritable qui ne sera pas
encore la démocratie socialiste mais lui ouvrira la voie. La thé-
matique est donc très voisine de celle des années 1945-1946 ; mais
développée dans un contexte différent, marqué en particulier
par une évolution prononcée de la social-démocratie vers la
l'avènement du gaullisme en 1958, une autre orientation s'est peu
à peu imposée. Selon celle-ci, il s'agit d'abattre le pouvoir des
monopoles et d'instaurer une démocratie véritable qui ne sera pas
encore la démocratie socialiste mais lui ouvrira la voie. La thé-
matique est donc très voisine de celle des années 1945-1946 ; mais
développée dans un contexte différent, marqué en particulier
par une évolution prononcée de la social-démocratie vers la
LES TEMPS MODERNES 266-267 10
f!
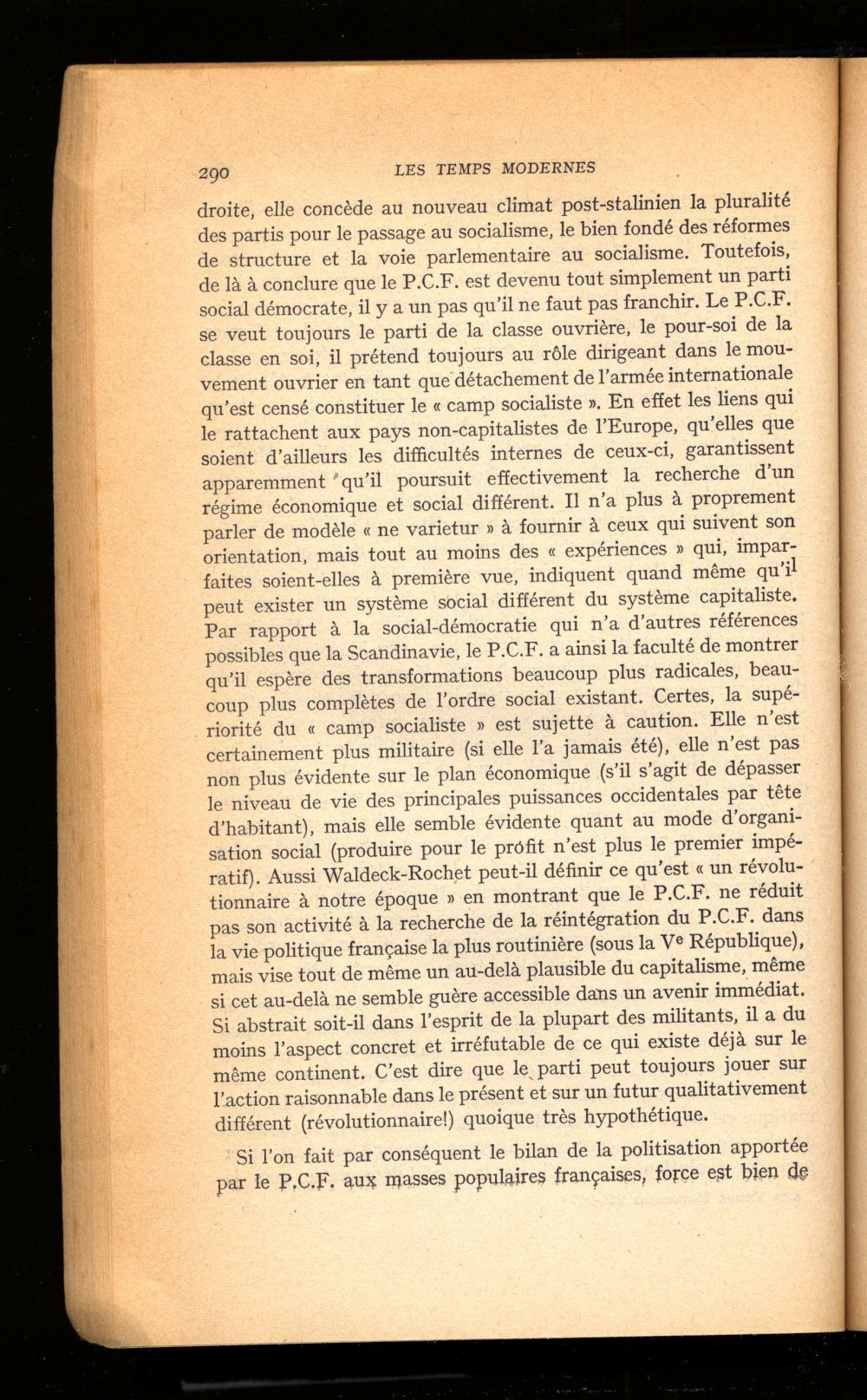

2QO
LES TEMPS MODERNES
droite, elle concède au nouveau climat post-stalinien la pluralité
des partis pour le passage au socialisme, le bien fondé des réformes
de structure et la voie parlementaire au socialisme. Toutefois,
de là à conclure que le P.C.F. est devenu tout simplement un parti
social démocrate, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Le P.C.F.
se veut toujours le parti de la classe ouvrière, le pour-soi de la
classe en soi, il prétend toujours au rôle dirigeant dans le mou-
vement ouvrier en tant que détachement de l'armée internationale
qu'est censé constituer le « camp socialiste ». En effet les liens qui
le rattachent aux pays non-capitalistes de l'Europe, qu'elles que
soient d'ailleurs les difficultés internes de ceux-ci, garantissent
apparemment qu'il poursuit effectivement la recherche d'un
régime économique et social différent. Il n'a plus à proprement
parler de modèle « ne varietur » à fournir à ceux qui suivent son
orientation, mais tout au moins des « expériences » qui, impar-
faites soient-elles à première vue, indiquent quand même qu'il
peut exister un système social différent du système capitaliste.
Par rapport à la social-démocratie qui n'a d'autres références
possibles que la Scandinavie, le P.C.F. a ainsi la faculté de montrer
qu'il espère des transformations beaucoup plus radicales, beau-
coup plus complètes de l'ordre social existant. Certes, la supé-
riorité du « camp socialiste » est sujette à caution. Elle n'est
certainement plus militaire (si elle l'a jamais été), elle n'est pas
non plus évidente sur le plan économique (s'il s'agit de dépasser
le niveau de vie des principales puissances occidentales par tête
d'habitant), mais elle semble évidente quant au mode d'organi-
sation social (produire pour le profit n'est plus le premier impé-
ratif). Aussi Waldeck-Rochet peut-il définir ce qu'est « un révolu-
tionnaire à notre époque » en montrant que le P.C.F. ne réduit
pas son activité à la recherche de la réintégration du P.C.F. dans
la vie politique française la plus routinière (sous la Ve République),
mais vise tout de même un au-delà plausible du capitalisme, même
si cet au-delà ne semble guère accessible dans un avenir immédiat.
Si abstrait soit-il dans l'esprit de la plupart des militants, il a du
moins l'aspect concret et irréfutable de ce qui existe déjà sur le
même continent. C'est dire que le parti peut toujours jouer sur
l'action raisonnable dans le présent et sur un futur qualitativement
différent (révolutionnaire!) quoique très hypothétique.
des partis pour le passage au socialisme, le bien fondé des réformes
de structure et la voie parlementaire au socialisme. Toutefois,
de là à conclure que le P.C.F. est devenu tout simplement un parti
social démocrate, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Le P.C.F.
se veut toujours le parti de la classe ouvrière, le pour-soi de la
classe en soi, il prétend toujours au rôle dirigeant dans le mou-
vement ouvrier en tant que détachement de l'armée internationale
qu'est censé constituer le « camp socialiste ». En effet les liens qui
le rattachent aux pays non-capitalistes de l'Europe, qu'elles que
soient d'ailleurs les difficultés internes de ceux-ci, garantissent
apparemment qu'il poursuit effectivement la recherche d'un
régime économique et social différent. Il n'a plus à proprement
parler de modèle « ne varietur » à fournir à ceux qui suivent son
orientation, mais tout au moins des « expériences » qui, impar-
faites soient-elles à première vue, indiquent quand même qu'il
peut exister un système social différent du système capitaliste.
Par rapport à la social-démocratie qui n'a d'autres références
possibles que la Scandinavie, le P.C.F. a ainsi la faculté de montrer
qu'il espère des transformations beaucoup plus radicales, beau-
coup plus complètes de l'ordre social existant. Certes, la supé-
riorité du « camp socialiste » est sujette à caution. Elle n'est
certainement plus militaire (si elle l'a jamais été), elle n'est pas
non plus évidente sur le plan économique (s'il s'agit de dépasser
le niveau de vie des principales puissances occidentales par tête
d'habitant), mais elle semble évidente quant au mode d'organi-
sation social (produire pour le profit n'est plus le premier impé-
ratif). Aussi Waldeck-Rochet peut-il définir ce qu'est « un révolu-
tionnaire à notre époque » en montrant que le P.C.F. ne réduit
pas son activité à la recherche de la réintégration du P.C.F. dans
la vie politique française la plus routinière (sous la Ve République),
mais vise tout de même un au-delà plausible du capitalisme, même
si cet au-delà ne semble guère accessible dans un avenir immédiat.
Si abstrait soit-il dans l'esprit de la plupart des militants, il a du
moins l'aspect concret et irréfutable de ce qui existe déjà sur le
même continent. C'est dire que le parti peut toujours jouer sur
l'action raisonnable dans le présent et sur un futur qualitativement
différent (révolutionnaire!) quoique très hypothétique.
Si l'on fait par conséquent le bilan de la politisation apportée
par le P.C.F. aux masses populaires françaises, force est bien dp
par le P.C.F. aux masses populaires françaises, force est bien dp
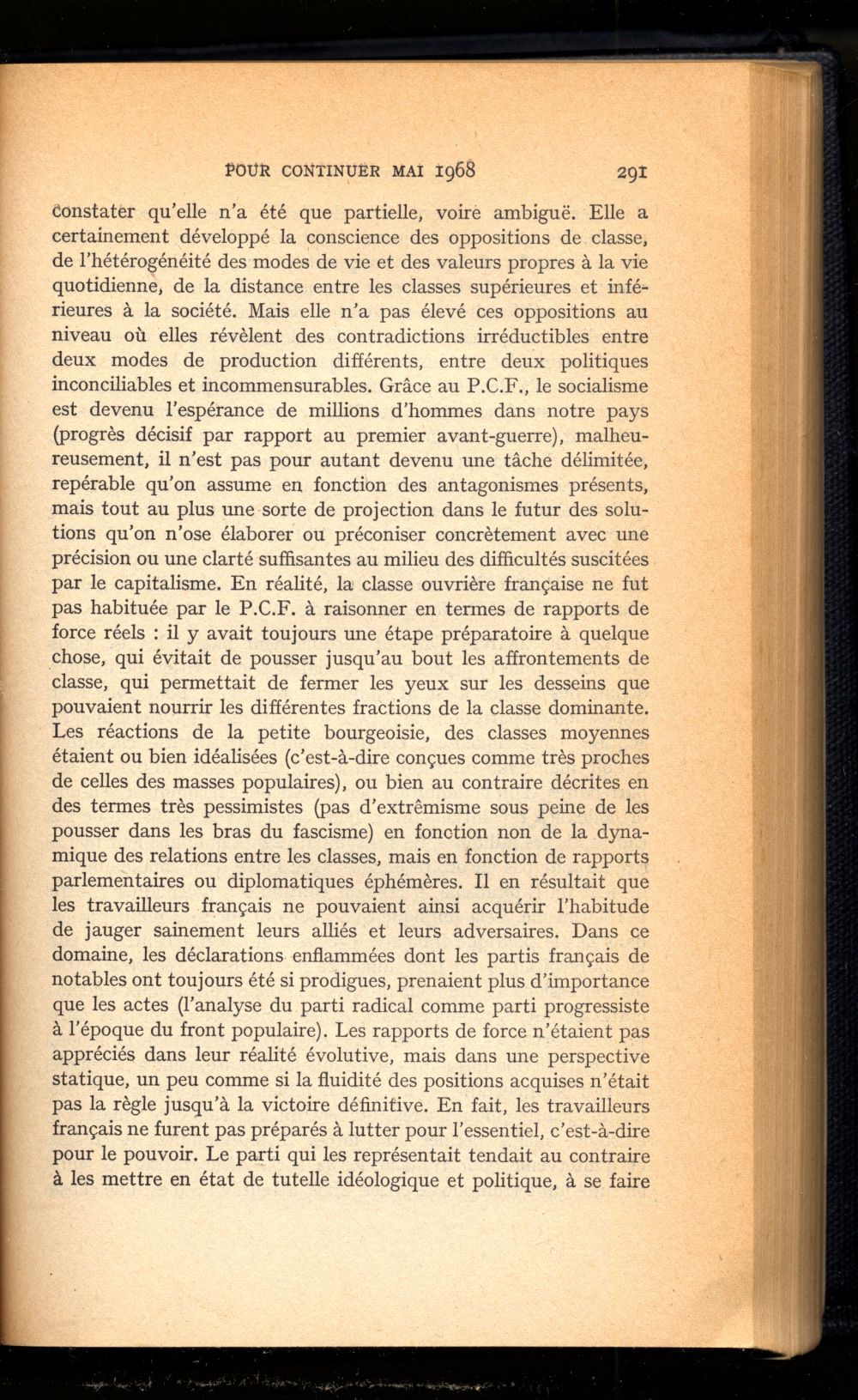

POUR CONTINUER MAI 1968
29!
Constater qu'elle n'a été que partielle, voire ambiguë. Elle a
certainement développé la conscience des oppositions de classe,
de l'hétérogénéité des modes de vie et des valeurs propres à la vie
quotidienne, de la distance entre les classes supérieures et infé-
rieures à la société. Mais elle n'a pas élevé ces oppositions au
niveau où elles révèlent des contradictions irréductibles entre
deux modes de production différents, entre deux politiques
inconciliables et incommensurables. Grâce au P.C.F., le socialisme
est devenu l'espérance de millions d'hommes dans notre pays
(progrès décisif par rapport au premier avant-guerre), malheu-
reusement, il n'est pas pour autant devenu une tâche délimitée,
repérable qu'on assume en fonction des antagonismes présents,
mais tout au plus une sorte de projection dans le futur des solu-
tions qu'on n'ose élaborer ou préconiser concrètement avec une
précision ou une clarté suffisantes au milieu des difficultés suscitées
par le capitalisme. En réalité, la classe ouvrière française ne fut
pas habituée par le P.C.F. à raisonner en termes de rapports de
force réels : il y avait toujours une étape préparatoire à quelque
chose, qui évitait de pousser jusqu'au bout les affrontements de
classe, qui permettait de fermer les yeux sur les desseins que
pouvaient nourrir les différentes fractions de la classe dominante.
Les réactions de la petite bourgeoisie, des classes moyennes
étaient ou bien idéalisées (c'est-à-dire conçues comme très proches
de celles des masses populaires), ou bien au contraire décrites en
des termes très pessimistes (pas d'extrémisme sous peine de les
pousser dans les bras du fascisme) en fonction non de la dyna-
mique des relations entre les classes, mais en fonction de rapports
parlementaires ou diplomatiques éphémères. Il en résultait que
les travailleurs français ne pouvaient ainsi acquérir l'habitude
de jauger sainement leurs alliés et leurs adversaires. Dans ce
domaine, les déclarations enflammées dont les partis français de
notables ont toujours été si prodigues, prenaient plus d'importance
que les actes (l'analyse du parti radical comme parti progressiste
à l'époque du front populaire). Les rapports de force n'étaient pas
appréciés dans leur réalité évolutive, mais dans une perspective
statique, un peu comme si la fluidité des positions acquises n'était
pas la règle jusqu'à la victoire définitive. En fait, les travailleurs
français ne furent pas préparés à lutter pour l'essentiel, c'est-à-dire
pour le pouvoir. Le parti qui les représentait tendait au contraire
à les mettre en état de tutelle idéologique et politique, à se faire
certainement développé la conscience des oppositions de classe,
de l'hétérogénéité des modes de vie et des valeurs propres à la vie
quotidienne, de la distance entre les classes supérieures et infé-
rieures à la société. Mais elle n'a pas élevé ces oppositions au
niveau où elles révèlent des contradictions irréductibles entre
deux modes de production différents, entre deux politiques
inconciliables et incommensurables. Grâce au P.C.F., le socialisme
est devenu l'espérance de millions d'hommes dans notre pays
(progrès décisif par rapport au premier avant-guerre), malheu-
reusement, il n'est pas pour autant devenu une tâche délimitée,
repérable qu'on assume en fonction des antagonismes présents,
mais tout au plus une sorte de projection dans le futur des solu-
tions qu'on n'ose élaborer ou préconiser concrètement avec une
précision ou une clarté suffisantes au milieu des difficultés suscitées
par le capitalisme. En réalité, la classe ouvrière française ne fut
pas habituée par le P.C.F. à raisonner en termes de rapports de
force réels : il y avait toujours une étape préparatoire à quelque
chose, qui évitait de pousser jusqu'au bout les affrontements de
classe, qui permettait de fermer les yeux sur les desseins que
pouvaient nourrir les différentes fractions de la classe dominante.
Les réactions de la petite bourgeoisie, des classes moyennes
étaient ou bien idéalisées (c'est-à-dire conçues comme très proches
de celles des masses populaires), ou bien au contraire décrites en
des termes très pessimistes (pas d'extrémisme sous peine de les
pousser dans les bras du fascisme) en fonction non de la dyna-
mique des relations entre les classes, mais en fonction de rapports
parlementaires ou diplomatiques éphémères. Il en résultait que
les travailleurs français ne pouvaient ainsi acquérir l'habitude
de jauger sainement leurs alliés et leurs adversaires. Dans ce
domaine, les déclarations enflammées dont les partis français de
notables ont toujours été si prodigues, prenaient plus d'importance
que les actes (l'analyse du parti radical comme parti progressiste
à l'époque du front populaire). Les rapports de force n'étaient pas
appréciés dans leur réalité évolutive, mais dans une perspective
statique, un peu comme si la fluidité des positions acquises n'était
pas la règle jusqu'à la victoire définitive. En fait, les travailleurs
français ne furent pas préparés à lutter pour l'essentiel, c'est-à-dire
pour le pouvoir. Le parti qui les représentait tendait au contraire
à les mettre en état de tutelle idéologique et politique, à se faire


292
LES TEMPS MODERNES
déléguer par eux la dure tâche de l'affrontement avec la bour-
geoisie. De cette façon s'instauraient entre le parti et la classe
des rapports fort éloignés des rapports prévus par Marx entre une
avant-garde révolutionnaire et une masse de plus en plus cons-
ciente des difficultés à surmonter pour abattre l'exploitation
capitaliste. Le parti s'enfonçait dans les manœuvres de sommet
et les manipulations bureaucratiques tandis que les masses ne
sortaient qu'à demi et par intermittence de la passivité que leur
impose le système capitaliste. Dans ce contexte, considéré natu-
rellement comme normal par les dirigeants communistes, toute
irruption des masses sur la scène politique en dehors des formes
« éprouvées » de mobilisation ne pouvait et ne peut apparaître
qu'irrationnelle ou bien encore ne peuvent et ne peut qu'être
le fruit de manœuvres obscures. Malgré son caractère ridicule,
la théorie du complot gaullistes-gauchistes, développée par
Waldeck-Rochet dans son analyse du mouvement de mai, était
tout à fait dans la logique de ce mode de penser et d'agir.
geoisie. De cette façon s'instauraient entre le parti et la classe
des rapports fort éloignés des rapports prévus par Marx entre une
avant-garde révolutionnaire et une masse de plus en plus cons-
ciente des difficultés à surmonter pour abattre l'exploitation
capitaliste. Le parti s'enfonçait dans les manœuvres de sommet
et les manipulations bureaucratiques tandis que les masses ne
sortaient qu'à demi et par intermittence de la passivité que leur
impose le système capitaliste. Dans ce contexte, considéré natu-
rellement comme normal par les dirigeants communistes, toute
irruption des masses sur la scène politique en dehors des formes
« éprouvées » de mobilisation ne pouvait et ne peut apparaître
qu'irrationnelle ou bien encore ne peuvent et ne peut qu'être
le fruit de manœuvres obscures. Malgré son caractère ridicule,
la théorie du complot gaullistes-gauchistes, développée par
Waldeck-Rochet dans son analyse du mouvement de mai, était
tout à fait dans la logique de ce mode de penser et d'agir.
Une telle analyse n'absout certainement pas le P.C.F., mais
elle montre que le processus de social-démocratisation qu'il subit
depuis des années n'est ni simple, ni rectiligne. Pour conserver
sa position de parti dominant dans le mouvement ouvrier français,
acquise historiquement contre la social-démocratie classique,
il doit maintenir un minimum d'originalité par rapport à ses
partenaires, d'où la définition perpétuellement recommencée d'une
orthodoxie ^révolutionnaire ». Pour conserver la confiance de ses
cadres, de ses militants, de ses sympathisants qui dans leur majo-
rité ne sont pas encore réconciliés avec l'idée d'un simple aména-
gement du capitalisme, il lui faut continuer à polémiquer contre
le réformisme. Cela implique que pour obtenir sa « réintégration
dans la vie politique française » (c'est-à-dire son acceptation par
la bourgeoisie), il lui faut admettre d'être tiraillé, écartelé entre
les concessions à faire pour prouver sa bonne volonté aux « démo-
crates et autres républicains », et les concessions à ne pas faire
pour conserver ses liens avec le secteur anti-capitaliste de l'opinion.
La contradiction qui n'est encore que lancinante, peut à la longue
devenir insupportable, et il est vraisemblable alors que la majorité
des dirigeants communistes tombera du mauvais côté ; mais son
existence même permet aux forces révolutionnaires de réagir
et d'intervenir pour transformer la social-démocratisation lente
en suite ininterrompue de crises. Mais, attention! S'il est une chose
elle montre que le processus de social-démocratisation qu'il subit
depuis des années n'est ni simple, ni rectiligne. Pour conserver
sa position de parti dominant dans le mouvement ouvrier français,
acquise historiquement contre la social-démocratie classique,
il doit maintenir un minimum d'originalité par rapport à ses
partenaires, d'où la définition perpétuellement recommencée d'une
orthodoxie ^révolutionnaire ». Pour conserver la confiance de ses
cadres, de ses militants, de ses sympathisants qui dans leur majo-
rité ne sont pas encore réconciliés avec l'idée d'un simple aména-
gement du capitalisme, il lui faut continuer à polémiquer contre
le réformisme. Cela implique que pour obtenir sa « réintégration
dans la vie politique française » (c'est-à-dire son acceptation par
la bourgeoisie), il lui faut admettre d'être tiraillé, écartelé entre
les concessions à faire pour prouver sa bonne volonté aux « démo-
crates et autres républicains », et les concessions à ne pas faire
pour conserver ses liens avec le secteur anti-capitaliste de l'opinion.
La contradiction qui n'est encore que lancinante, peut à la longue
devenir insupportable, et il est vraisemblable alors que la majorité
des dirigeants communistes tombera du mauvais côté ; mais son
existence même permet aux forces révolutionnaires de réagir
et d'intervenir pour transformer la social-démocratisation lente
en suite ininterrompue de crises. Mais, attention! S'il est une chose
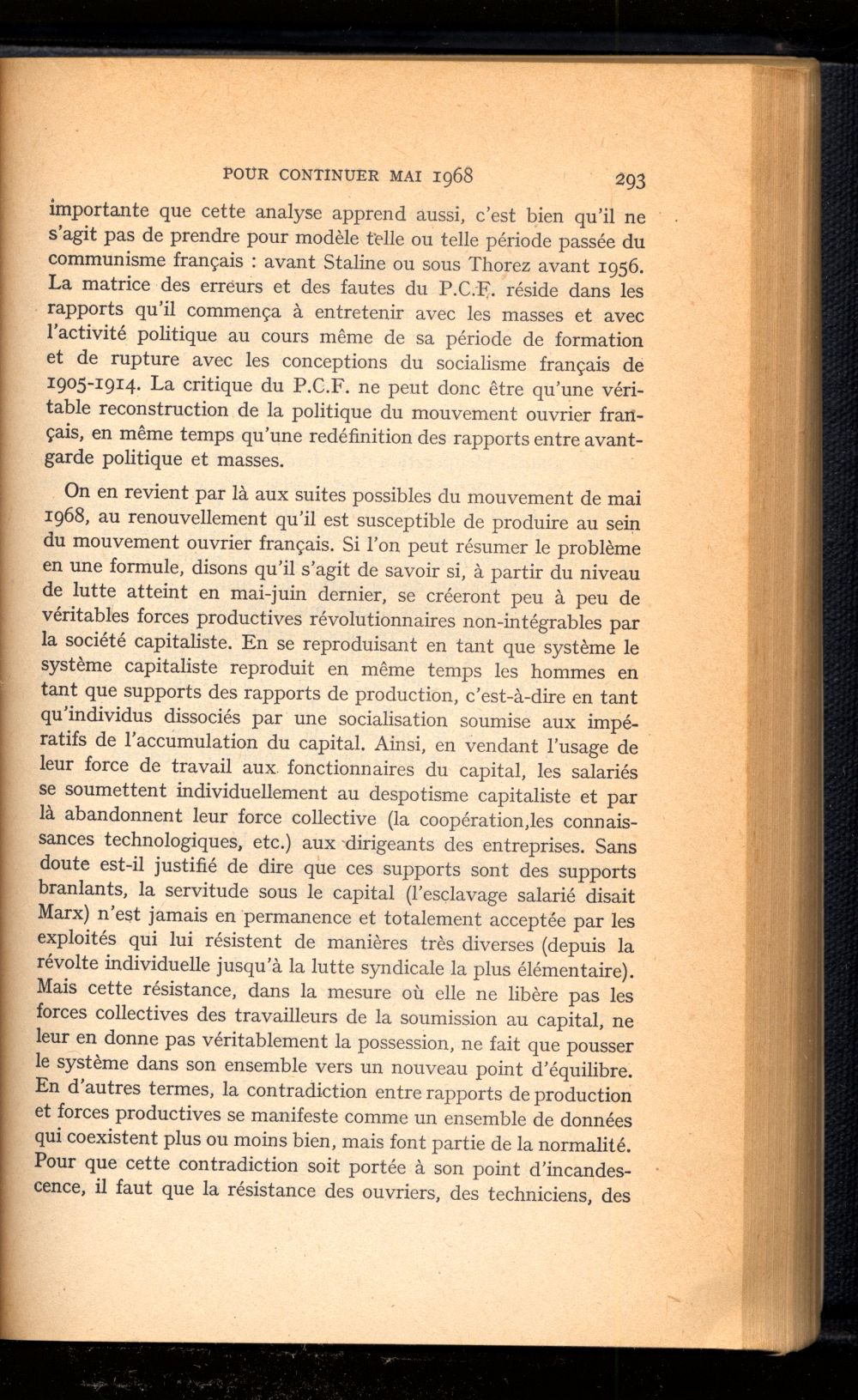

POUR CONTINUER MAI 1968
293
importante que cette analyse apprend aussi, c'est bien qu'il ne
s'agit pas de prendre pour modèle telle ou telle période passée du
communisme français : avant Staline ou sous Thorez avant 1956.
La matrice des erreurs et des fautes du P.C.F. réside dans les
rapports qu'il commença à entretenir avec les masses et avec
l'activité politique au cours même de sa période de formation
et de rupture avec les conceptions du socialisme français de
1905-1914. La critique du P.C.F. ne peut donc être qu'une véri-
table reconstruction de la politique du mouvement ouvrier fran-
çais, en même temps qu'une redéfinition des rapports entre avant-
garde politique et masses.
s'agit pas de prendre pour modèle telle ou telle période passée du
communisme français : avant Staline ou sous Thorez avant 1956.
La matrice des erreurs et des fautes du P.C.F. réside dans les
rapports qu'il commença à entretenir avec les masses et avec
l'activité politique au cours même de sa période de formation
et de rupture avec les conceptions du socialisme français de
1905-1914. La critique du P.C.F. ne peut donc être qu'une véri-
table reconstruction de la politique du mouvement ouvrier fran-
çais, en même temps qu'une redéfinition des rapports entre avant-
garde politique et masses.
On en revient par là aux suites possibles du mouvement de mai
1968, au renouvellement qu'il est susceptible de produire au sein
du mouvement ouvrier français. Si l'on peut résumer le problème
en une formule, disons qu'il s'agit de savoir si, à partir du niveau
de lutte atteint en mai-juin dernier, se créeront peu à peu de
véritables forces productives révolutionnaires non-intégrables par
la société capitaliste. En se reproduisant en tant que système le
système capitaliste reproduit en même temps les hommes en
tant que supports des rapports de production, c'est-à-dire en tant
qu'individus dissociés par une socialisation soumise aux impé-
ratifs de l'accumulation du capital. Ainsi, en vendant l'usage de
leur force de travail aux fonctionnaires du capital, les salariés
se soumettent individuellement au despotisme capitaliste et par
là abandonnent leur force collective (la coopération,les connais-
sances technologiques, etc.) aux -dirigeants des entreprises. Sans
doute est-il justifié de dire que ces supports sont des supports
branlants, la servitude sous le capital (l'esclavage salarié disait
Marx) n'est jamais en permanence et totalement acceptée par les
exploités qui lui résistent de manières très diverses (depuis la
révolte individuelle jusqu'à la lutte syndicale la plus élémentaire).
Mais cette résistance, dans la mesure où elle ne libère pas les
forces collectives des travailleurs de la soumission au capital, ne
leur en donne pas véritablement la possession, ne fait que pousser
le système dans son ensemble vers un nouveau point d'équilibre.
En d'autres termes, la contradiction entre rapports de production
et forces productives se manifeste comme un ensemble de données
qui coexistent plus ou moins bien, mais font partie de la normalité.
Pour que cette contradiction soit portée à son point d'incandes-
cence, il faut que la résistance des ouvriers, des techniciens, des
1968, au renouvellement qu'il est susceptible de produire au sein
du mouvement ouvrier français. Si l'on peut résumer le problème
en une formule, disons qu'il s'agit de savoir si, à partir du niveau
de lutte atteint en mai-juin dernier, se créeront peu à peu de
véritables forces productives révolutionnaires non-intégrables par
la société capitaliste. En se reproduisant en tant que système le
système capitaliste reproduit en même temps les hommes en
tant que supports des rapports de production, c'est-à-dire en tant
qu'individus dissociés par une socialisation soumise aux impé-
ratifs de l'accumulation du capital. Ainsi, en vendant l'usage de
leur force de travail aux fonctionnaires du capital, les salariés
se soumettent individuellement au despotisme capitaliste et par
là abandonnent leur force collective (la coopération,les connais-
sances technologiques, etc.) aux -dirigeants des entreprises. Sans
doute est-il justifié de dire que ces supports sont des supports
branlants, la servitude sous le capital (l'esclavage salarié disait
Marx) n'est jamais en permanence et totalement acceptée par les
exploités qui lui résistent de manières très diverses (depuis la
révolte individuelle jusqu'à la lutte syndicale la plus élémentaire).
Mais cette résistance, dans la mesure où elle ne libère pas les
forces collectives des travailleurs de la soumission au capital, ne
leur en donne pas véritablement la possession, ne fait que pousser
le système dans son ensemble vers un nouveau point d'équilibre.
En d'autres termes, la contradiction entre rapports de production
et forces productives se manifeste comme un ensemble de données
qui coexistent plus ou moins bien, mais font partie de la normalité.
Pour que cette contradiction soit portée à son point d'incandes-
cence, il faut que la résistance des ouvriers, des techniciens, des
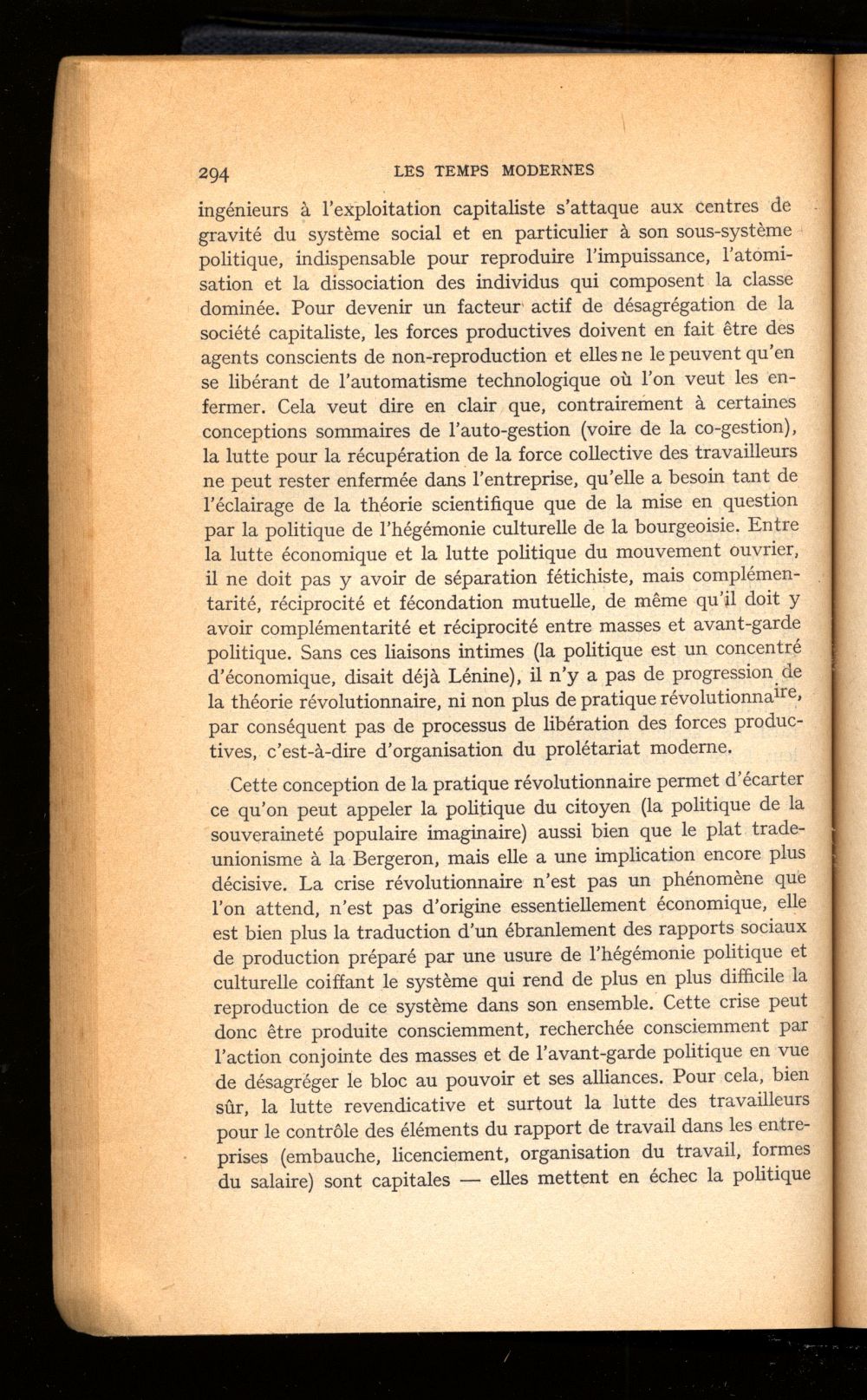

294
LES TEMPS MODERNES
ingénieurs à l'exploitation capitaliste s'attaque aux centres de
gravité du système social et en particulier à son sous-système
politique, indispensable pour reproduire l'impuissance, l'atomi-
sation et la dissociation des individus qui composent la classe
dominée. Pour devenir un facteur actif de désagrégation de la
société capitaliste, les forces productives doivent en fait être des
agents conscients de non-reproduction et elles ne le peuvent qu'en
se libérant de l'automatisme technologique où l'on veut les en-
fermer. Cela veut dire en clair que, contrairement à certaines
conceptions sommaires de l'auto-gestion (voire de la co-gestion),
la lutte pour la récupération de la force collective des travailleurs
ne peut rester enfermée dans l'entreprise, qu'elle a besoin tant de
l'éclairage de la théorie scientifique que de la mise en question
par la politique de l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie. Entre
la lutte économique et la lutte politique du mouvement ouvrier,
il ne doit pas y avoir de séparation fétichiste, mais complémen-
tarité, réciprocité et fécondation mutuelle, de même qu'il doit y
avoir complémentarité et réciprocité entre masses et avant-garde
politique. Sans ces liaisons intimes (la politique est un concentré
d'économique, disait déjà Lénine), il n'y a pas de progression clé
la théorie révolutionnaire, ni non plus de pratique révolutionnalre>
par conséquent pas de processus de libération des forces produc-
tives, c'est-à-dire d'organisation du prolétariat moderne.
gravité du système social et en particulier à son sous-système
politique, indispensable pour reproduire l'impuissance, l'atomi-
sation et la dissociation des individus qui composent la classe
dominée. Pour devenir un facteur actif de désagrégation de la
société capitaliste, les forces productives doivent en fait être des
agents conscients de non-reproduction et elles ne le peuvent qu'en
se libérant de l'automatisme technologique où l'on veut les en-
fermer. Cela veut dire en clair que, contrairement à certaines
conceptions sommaires de l'auto-gestion (voire de la co-gestion),
la lutte pour la récupération de la force collective des travailleurs
ne peut rester enfermée dans l'entreprise, qu'elle a besoin tant de
l'éclairage de la théorie scientifique que de la mise en question
par la politique de l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie. Entre
la lutte économique et la lutte politique du mouvement ouvrier,
il ne doit pas y avoir de séparation fétichiste, mais complémen-
tarité, réciprocité et fécondation mutuelle, de même qu'il doit y
avoir complémentarité et réciprocité entre masses et avant-garde
politique. Sans ces liaisons intimes (la politique est un concentré
d'économique, disait déjà Lénine), il n'y a pas de progression clé
la théorie révolutionnaire, ni non plus de pratique révolutionnalre>
par conséquent pas de processus de libération des forces produc-
tives, c'est-à-dire d'organisation du prolétariat moderne.
Cette conception de la pratique révolutionnaire permet d'écarter
ce qu'on peut appeler la politique du citoyen (la politique de la
souveraineté populaire imaginaire) aussi bien que le plat trade-
unionisrne à la Bergeron, mais elle a une implication encore plus
décisive. La crise révolutionnaire n'est pas un phénomène que
l'on attend, n'est pas d'origine essentiellement économique, elle
est bien plus la traduction d'un ébranlement des rapports sociaux
de production préparé par une usure de l'hégémonie politique et
culturelle coiffant le système qui rend de plus en plus difficile la
reproduction de ce système dans son ensemble. Cette crise peut
donc être produite consciemment, recherchée consciemment par
l'action conjointe des masses et de l'avant-garde politique en vue
de désagréger le bloc au pouvoir et ses alliances. Pour cela, bien
sûr, la lutte revendicative et surtout la lutte des travailleurs
pour le contrôle des éléments du rapport de travail dans les entre-
prises (embauche, licenciement, organisation du travail, formes
du salaire) sont capitales — elles mettent en échec la politique
ce qu'on peut appeler la politique du citoyen (la politique de la
souveraineté populaire imaginaire) aussi bien que le plat trade-
unionisrne à la Bergeron, mais elle a une implication encore plus
décisive. La crise révolutionnaire n'est pas un phénomène que
l'on attend, n'est pas d'origine essentiellement économique, elle
est bien plus la traduction d'un ébranlement des rapports sociaux
de production préparé par une usure de l'hégémonie politique et
culturelle coiffant le système qui rend de plus en plus difficile la
reproduction de ce système dans son ensemble. Cette crise peut
donc être produite consciemment, recherchée consciemment par
l'action conjointe des masses et de l'avant-garde politique en vue
de désagréger le bloc au pouvoir et ses alliances. Pour cela, bien
sûr, la lutte revendicative et surtout la lutte des travailleurs
pour le contrôle des éléments du rapport de travail dans les entre-
prises (embauche, licenciement, organisation du travail, formes
du salaire) sont capitales — elles mettent en échec la politique
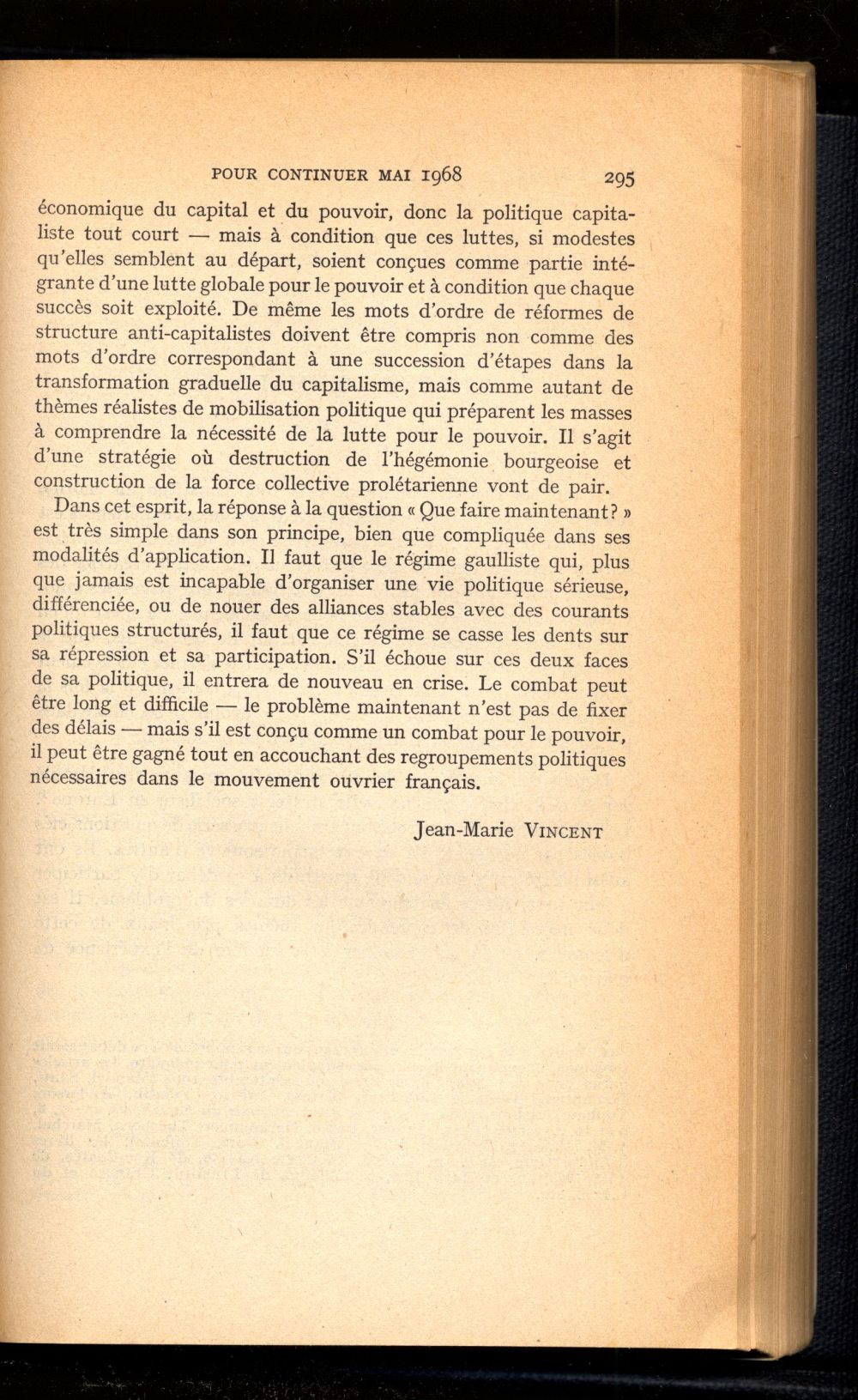

POUR CONTINUER MAI 1968
295
économique du capital et du pouvoir, donc la politique capita-
liste tout court —• mais à condition que ces luttes, si modestes
qu'elles semblent au départ, soient conçues comme partie inté-
grante d'une lutte globale pour le pouvoir et à condition que chaque
succès soit exploité. De même les mots d'ordre de réformes de
structure anti-capitalistes doivent être compris non comme des
mots d'ordre correspondant à une succession d'étapes dans la
transformation graduelle du capitalisme, mais comme autant de
thèmes réalistes de mobilisation politique qui préparent les masses
à comprendre la nécessité de la lutte pour le pouvoir. Il s'agit
d'une stratégie où destruction de l'hégémonie bourgeoise et
construction de la force collective prolétarienne vont de pair.
liste tout court —• mais à condition que ces luttes, si modestes
qu'elles semblent au départ, soient conçues comme partie inté-
grante d'une lutte globale pour le pouvoir et à condition que chaque
succès soit exploité. De même les mots d'ordre de réformes de
structure anti-capitalistes doivent être compris non comme des
mots d'ordre correspondant à une succession d'étapes dans la
transformation graduelle du capitalisme, mais comme autant de
thèmes réalistes de mobilisation politique qui préparent les masses
à comprendre la nécessité de la lutte pour le pouvoir. Il s'agit
d'une stratégie où destruction de l'hégémonie bourgeoise et
construction de la force collective prolétarienne vont de pair.
Dans cet esprit, la réponse à la question « Que faire maintenant? »
est très simple dans son principe, bien que compliqiiée dans ses
modalités d'application. Il faut que le régime gaulliste qui, plus
que jamais est incapable d'organiser une vie politique sérieuse,
différenciée, ou de nouer des alliances stables avec des courants
politiques structurés, il faut que ce régime se casse les dents sur
sa répression et sa participation. S'il échoue sur ces deux faces
de sa politique, il entrera de nouveau en crise. Le combat peut
être long et difficile — le problème maintenant n'est pas de fixer
des délais — mais s'il est conçu comme un combat pour le pouvoir,
il peut être gagné tout en accouchant des regroupements politiques
nécessaires dans le mouvement ouvrier français.
est très simple dans son principe, bien que compliqiiée dans ses
modalités d'application. Il faut que le régime gaulliste qui, plus
que jamais est incapable d'organiser une vie politique sérieuse,
différenciée, ou de nouer des alliances stables avec des courants
politiques structurés, il faut que ce régime se casse les dents sur
sa répression et sa participation. S'il échoue sur ces deux faces
de sa politique, il entrera de nouveau en crise. Le combat peut
être long et difficile — le problème maintenant n'est pas de fixer
des délais — mais s'il est conçu comme un combat pour le pouvoir,
il peut être gagné tout en accouchant des regroupements politiques
nécessaires dans le mouvement ouvrier français.
Jean-Marie VINCENT
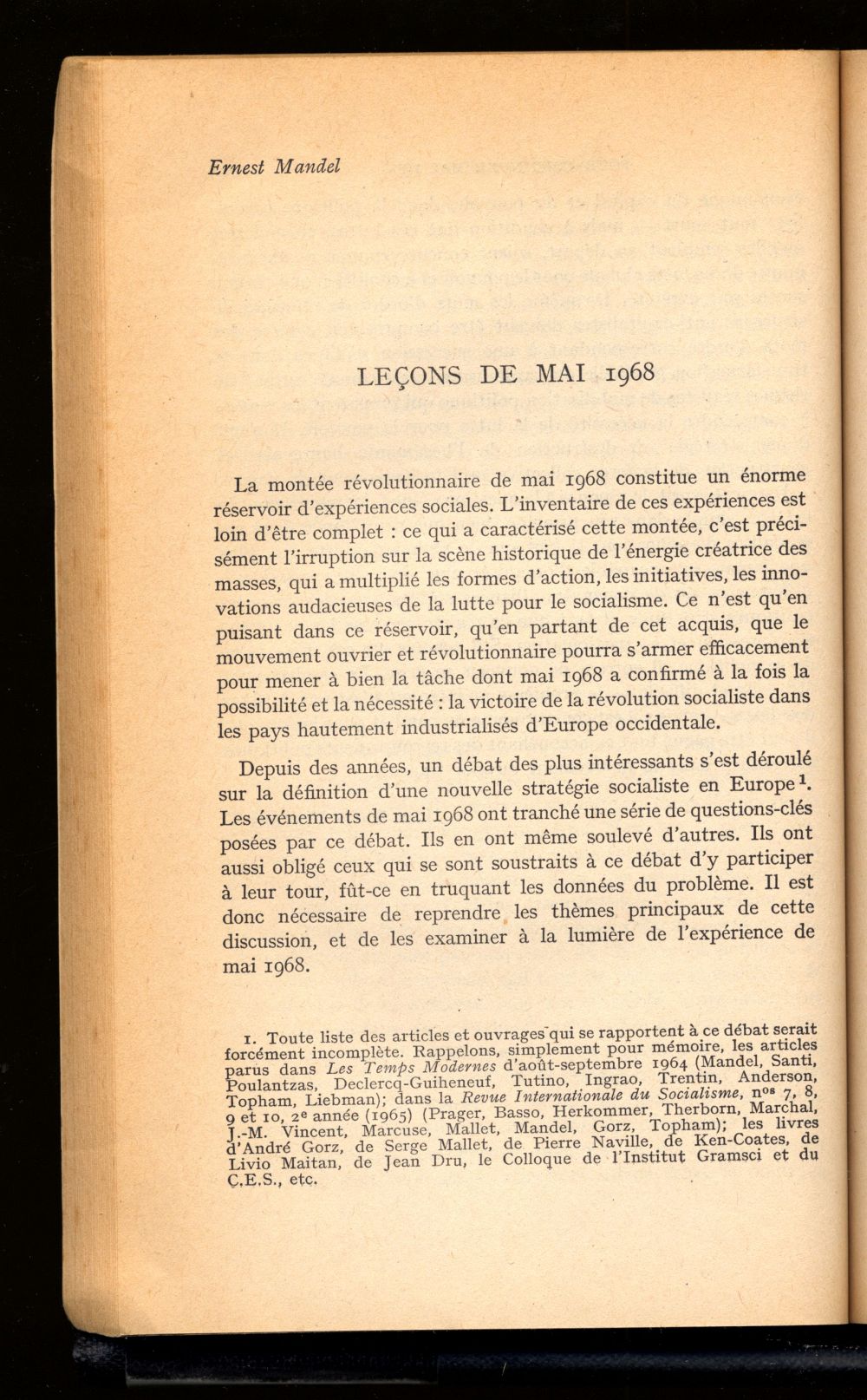

Ernest Manuel
LEÇONS DE MAI 1968
I
La montée révolutionnaire de mai 1968 constitue un énorme
réservoir d'expériences sociales. L'inventaire de ces expériences est
loin d'être complet : ce qui a caractérisé cette montée, c'est préci-
sément l'irruption sur la scène historique de l'énergie créatrice des
masses, qui a multiplié les formes d'action, les initiatives, les inno-
vations audacieuses de la lutte pour le socialisme. Ce n'est qu'en
puisant dans ce réservoir, qu'en partant de cet acquis, que le
mouvement ouvrier et révolutionnaire pourra s'armer efficacement
pour mener à bien la tâche dont mai 1968 a confirmé à la fois la
possibilité et la nécessité : la victoire de la révolution socialiste dans
les pays hautement industrialisés d'Europe occidentale.
réservoir d'expériences sociales. L'inventaire de ces expériences est
loin d'être complet : ce qui a caractérisé cette montée, c'est préci-
sément l'irruption sur la scène historique de l'énergie créatrice des
masses, qui a multiplié les formes d'action, les initiatives, les inno-
vations audacieuses de la lutte pour le socialisme. Ce n'est qu'en
puisant dans ce réservoir, qu'en partant de cet acquis, que le
mouvement ouvrier et révolutionnaire pourra s'armer efficacement
pour mener à bien la tâche dont mai 1968 a confirmé à la fois la
possibilité et la nécessité : la victoire de la révolution socialiste dans
les pays hautement industrialisés d'Europe occidentale.
Depuis des années, un débat des plus intéressants s'est déroulé
sur la définition d'une nouvelle stratégie socialiste en Europe1.
Les événements de mai 1968 ont tranché une série de questions-clés
posées par ce débat. Ils en ont même soulevé d'autres. Ils ont
aussi obligé ceux qui se sont soustraits à ce débat d'y participer
à leur tour, fût-ce en truquant les données du problème. Il est
donc nécessaire de reprendre les thèmes principaux de cette
discussion, et de les examiner à la lumière de l'expérience de
mai 1968.
sur la définition d'une nouvelle stratégie socialiste en Europe1.
Les événements de mai 1968 ont tranché une série de questions-clés
posées par ce débat. Ils en ont même soulevé d'autres. Ils ont
aussi obligé ceux qui se sont soustraits à ce débat d'y participer
à leur tour, fût-ce en truquant les données du problème. Il est
donc nécessaire de reprendre les thèmes principaux de cette
discussion, et de les examiner à la lumière de l'expérience de
mai 1968.
i. Toute liste des articles et ouvrages'qui se rapportent à ce débat serait
forcément incomplète. Rappelons, simplement pour mémoire, les articles
parus dans Les Temps Modernes d'août-septembre 1964 (Mandel, Santi,
Poulantzas, Declercq-Guilieneuf, Tutino, Ingrao, Trentin, Andersen,
Topham, Liebman); dans la Revue Internationale du Socialisme, nos 7, 8,
9 et 10, 2e année (1965) (Pragcr, Basso, Herkommer, Therborn, Marchai,
J.-M. Vincent, Marcuse, Mallet, Mandel, Gorz, Topham); les livres
d'André Gorz, de Serge Mallet, de Pierre Naville, de Ken-Coates, de
Livio Maitan, de Jean Dru, le Colloque de l'Institut Gramsci et du
C.E.S., etc.
forcément incomplète. Rappelons, simplement pour mémoire, les articles
parus dans Les Temps Modernes d'août-septembre 1964 (Mandel, Santi,
Poulantzas, Declercq-Guilieneuf, Tutino, Ingrao, Trentin, Andersen,
Topham, Liebman); dans la Revue Internationale du Socialisme, nos 7, 8,
9 et 10, 2e année (1965) (Pragcr, Basso, Herkommer, Therborn, Marchai,
J.-M. Vincent, Marcuse, Mallet, Mandel, Gorz, Topham); les livres
d'André Gorz, de Serge Mallet, de Pierre Naville, de Ken-Coates, de
Livio Maitan, de Jean Dru, le Colloque de l'Institut Gramsci et du
C.E.S., etc.
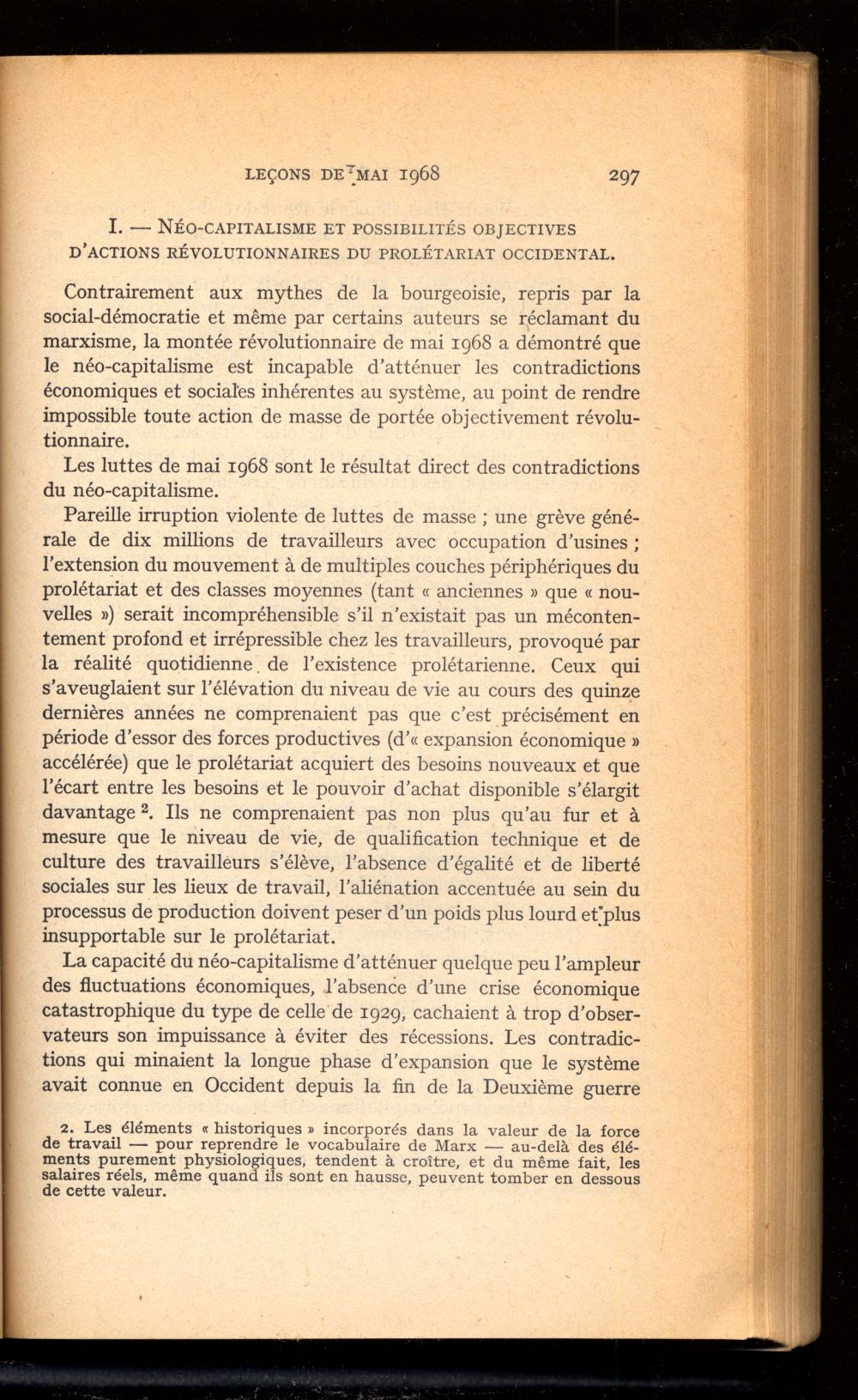

LEÇONS DE^MAI I
297
I. •— NÉO-CAPITALISME ET POSSIBILITÉS OBJECTIVES
D'ACTIONS RÉVOLUTIONNAIRES DU PROLÉTARIAT OCCIDENTAL.
D'ACTIONS RÉVOLUTIONNAIRES DU PROLÉTARIAT OCCIDENTAL.
Contrairement aux mythes de la bourgeoisie, repris par la
social-démocratie et même par certains auteurs se réclamant du
marxisme, la montée révolutionnaire de mai 1968 a démontré que
le néo-capitalisme est incapable d'atténuer les contradictions
économiques et sociales inhérentes au système, au point de rendre
impossible toute action de masse de portée objectivement révolu-
tionnaire.
social-démocratie et même par certains auteurs se réclamant du
marxisme, la montée révolutionnaire de mai 1968 a démontré que
le néo-capitalisme est incapable d'atténuer les contradictions
économiques et sociales inhérentes au système, au point de rendre
impossible toute action de masse de portée objectivement révolu-
tionnaire.
Les luttes de mai 1968 sont le résultat direct des contradictions
du néo-capitalisme.
du néo-capitalisme.
Pareille irruption violente de luttes de masse ; une grève géné-
rale de dix millions de travailleurs avec occupation d'usines ;
l'extension du mouvement à de multiples couches périphériques du
prolétariat et des classes moyennes (tant « anciennes » que « nou-
velles ») serait incompréhensible s'il n'existait pas un méconten-
tement profond et irrépressible chez les travailleurs, provoqué par
la réalité quotidienne de l'existence prolétarienne. Ceux qui
s'aveuglaient sur l'élévation du niveau de vie au cours des quinze
dernières années ne comprenaient pas que c'est précisément en
période d'essor des forces productives (d'« expansion économique »
accélérée) que le prolétariat acquiert des besoins nouveaux et que
l'écart entre les besoins et le pouvoir d'achat disponible s'élargit
davantage z. Ils ne comprenaient pas non plus qu'au fur et à
mesure que le niveau de vie, de qualification technique et de
culture des travailleurs s'élève, l'absence d'égalité et de liberté
sociales sur les lieux de travail, l'aliénation accentuée au sein du
processus de production doivent peser d'un poids plus lourd et'plus
insupportable sur le prolétariat.
rale de dix millions de travailleurs avec occupation d'usines ;
l'extension du mouvement à de multiples couches périphériques du
prolétariat et des classes moyennes (tant « anciennes » que « nou-
velles ») serait incompréhensible s'il n'existait pas un méconten-
tement profond et irrépressible chez les travailleurs, provoqué par
la réalité quotidienne de l'existence prolétarienne. Ceux qui
s'aveuglaient sur l'élévation du niveau de vie au cours des quinze
dernières années ne comprenaient pas que c'est précisément en
période d'essor des forces productives (d'« expansion économique »
accélérée) que le prolétariat acquiert des besoins nouveaux et que
l'écart entre les besoins et le pouvoir d'achat disponible s'élargit
davantage z. Ils ne comprenaient pas non plus qu'au fur et à
mesure que le niveau de vie, de qualification technique et de
culture des travailleurs s'élève, l'absence d'égalité et de liberté
sociales sur les lieux de travail, l'aliénation accentuée au sein du
processus de production doivent peser d'un poids plus lourd et'plus
insupportable sur le prolétariat.
La capacité du néo-capitalisme d'atténuer quelque peu l'ampleur
des fluctuations économiques, l'absence d'une crise économique
catastrophique du type de celle de 1929, cachaient à trop d'obser-
vateurs son impuissance à éviter des récessions. Les contradic-
tions qui minaient la longue phase d'expansion que le système
avait connue en Occident depuis la fin de la Deuxième guerre
des fluctuations économiques, l'absence d'une crise économique
catastrophique du type de celle de 1929, cachaient à trop d'obser-
vateurs son impuissance à éviter des récessions. Les contradic-
tions qui minaient la longue phase d'expansion que le système
avait connue en Occident depuis la fin de la Deuxième guerre
2. Les éléments « historiques » incorporés dans la valeur de la force
de travail — pour reprendre le vocabulaire de Marx — au-delà des élé-
ments purement physiologiques, tendent à croître, et du même fait, les
salaires réels, même quand ils sont en hausse, peuvent tomber en dessous
de cette valeur.
de travail — pour reprendre le vocabulaire de Marx — au-delà des élé-
ments purement physiologiques, tendent à croître, et du même fait, les
salaires réels, même quand ils sont en hausse, peuvent tomber en dessous
de cette valeur.
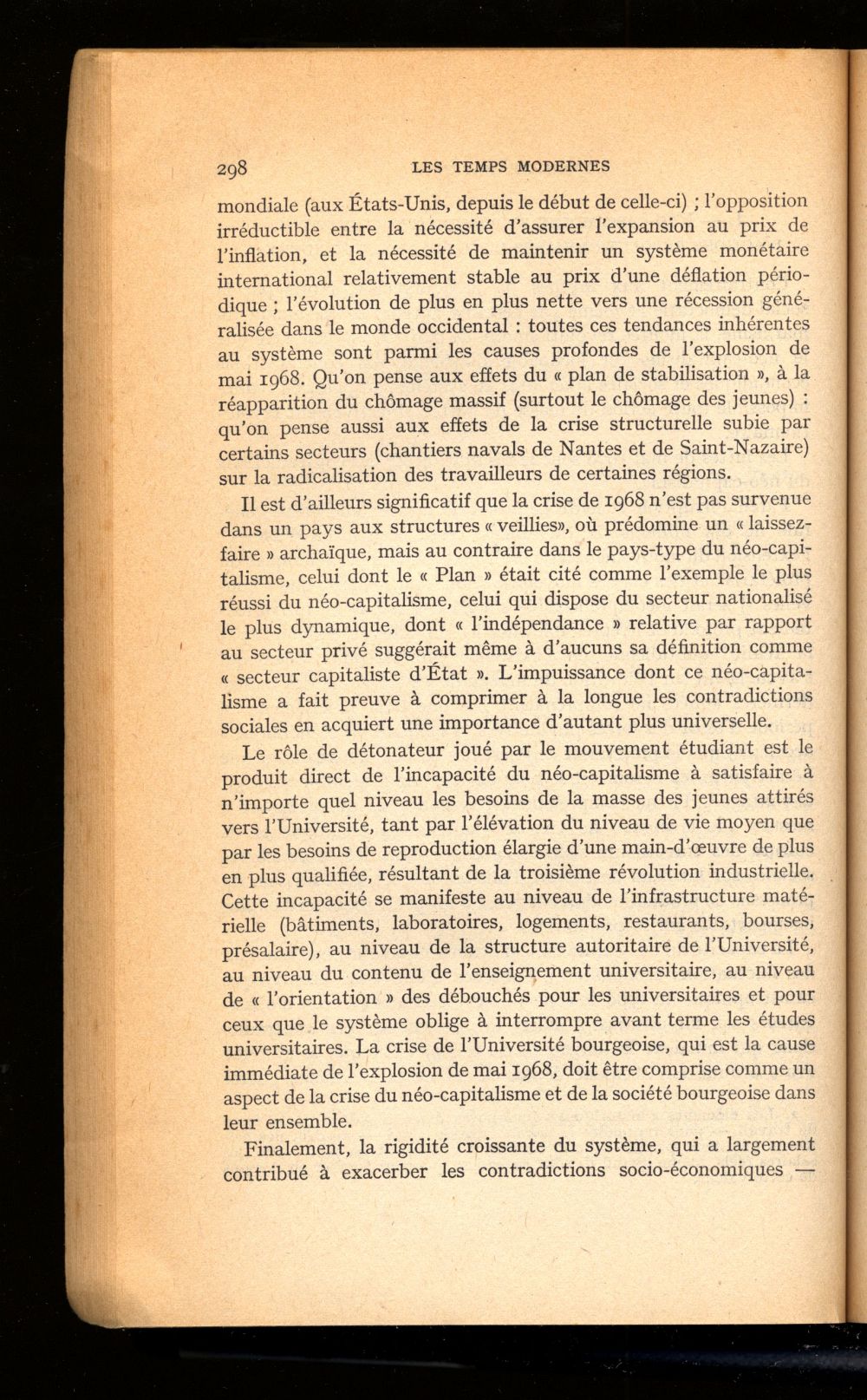

2g8 LES TEMPS MODERNES
mondiale (aux États-Unis, depuis le début de celle-ci) ; l'opposition
irréductible entre la nécessité d'assurer l'expansion au prix de
l'inflation, et la nécessité de maintenir un système monétaire
international relativement stable au prix d'une déflation pério-
dique ; l'évolution de plus en plus nette vers une récession géné-
ralisée dans le monde occidental : toutes ces tendances inhérentes
au système sont parmi les causes profondes de l'explosion de
mai 1968. Qu'on pense aux effets du « plan de stabilisation », à la
réapparition du chômage massif (surtout le chômage des jeunes) :
qu'on pense aussi aux effets de la crise structurelle subie par
certains secteurs (chantiers navals de Nantes et de Saint-Nazaire)
sur la radicalisation des travailleurs de certaines régions.
irréductible entre la nécessité d'assurer l'expansion au prix de
l'inflation, et la nécessité de maintenir un système monétaire
international relativement stable au prix d'une déflation pério-
dique ; l'évolution de plus en plus nette vers une récession géné-
ralisée dans le monde occidental : toutes ces tendances inhérentes
au système sont parmi les causes profondes de l'explosion de
mai 1968. Qu'on pense aux effets du « plan de stabilisation », à la
réapparition du chômage massif (surtout le chômage des jeunes) :
qu'on pense aussi aux effets de la crise structurelle subie par
certains secteurs (chantiers navals de Nantes et de Saint-Nazaire)
sur la radicalisation des travailleurs de certaines régions.
Il est d'ailleurs significatif que la crise de 1968 n'est pas survenue
dans un pays aux structures « veillies», où prédomine un « laissez-
faire » archaïque, mais au contraire dans le pays-type du néo-capi-
talisme, celui dont le « Plan » était cité comme l'exemple le plus
réussi du néo-capitalisme, celui qui dispose du secteur nationalisé
le plus dynamique, dont « l'indépendance » relative par rapport
au secteur privé suggérait même à d'aucuns sa définition comme
« secteur capitaliste d'État ». L'impuissance dont ce néo-capita-
lisme a fait preuve à comprimer à la longue les contradictions
sociales en acquiert une importance d'autant plus universelle.
dans un pays aux structures « veillies», où prédomine un « laissez-
faire » archaïque, mais au contraire dans le pays-type du néo-capi-
talisme, celui dont le « Plan » était cité comme l'exemple le plus
réussi du néo-capitalisme, celui qui dispose du secteur nationalisé
le plus dynamique, dont « l'indépendance » relative par rapport
au secteur privé suggérait même à d'aucuns sa définition comme
« secteur capitaliste d'État ». L'impuissance dont ce néo-capita-
lisme a fait preuve à comprimer à la longue les contradictions
sociales en acquiert une importance d'autant plus universelle.
Le rôle de détonateur joué par le mouvement étudiant est le
produit direct de l'incapacité du néo-capitalisme à satisfaire à
n'importe quel niveau les besoins de la masse des jeunes attirés
vers l'Université, tant par l'élévation du niveau de vie moyen que
par les besoins de reproduction élargie d'une main-d'œuvre de plus
en plus qualifiée, résultant de la troisième révolution industrielle.
Cette incapacité se manifeste au niveau de l'infrastructure maté-
rielle (bâtiments, laboratoires, logements, restaurants, bourses,
présalaire), au niveau de la structure autoritaire de l'Université,
au niveau du contenu de l'enseignement universitaire, au niveau
de « l'orientation » des débouchés pour les universitaires et pour
ceux que le système oblige à interrompre avant terme les études
universitaires. La crise de l'Université bourgeoise, qui est la cause
immédiate de l'explosion de mai 1968, doit être comprise comme un
aspect de la crise du néo-capitalisme et de la société bourgeoise dans
leur ensemble.
produit direct de l'incapacité du néo-capitalisme à satisfaire à
n'importe quel niveau les besoins de la masse des jeunes attirés
vers l'Université, tant par l'élévation du niveau de vie moyen que
par les besoins de reproduction élargie d'une main-d'œuvre de plus
en plus qualifiée, résultant de la troisième révolution industrielle.
Cette incapacité se manifeste au niveau de l'infrastructure maté-
rielle (bâtiments, laboratoires, logements, restaurants, bourses,
présalaire), au niveau de la structure autoritaire de l'Université,
au niveau du contenu de l'enseignement universitaire, au niveau
de « l'orientation » des débouchés pour les universitaires et pour
ceux que le système oblige à interrompre avant terme les études
universitaires. La crise de l'Université bourgeoise, qui est la cause
immédiate de l'explosion de mai 1968, doit être comprise comme un
aspect de la crise du néo-capitalisme et de la société bourgeoise dans
leur ensemble.
Finalement, la rigidité croissante du système, qui a largement
contribué à exacerber les contradictions socio-économiques •—
contribué à exacerber les contradictions socio-économiques •—
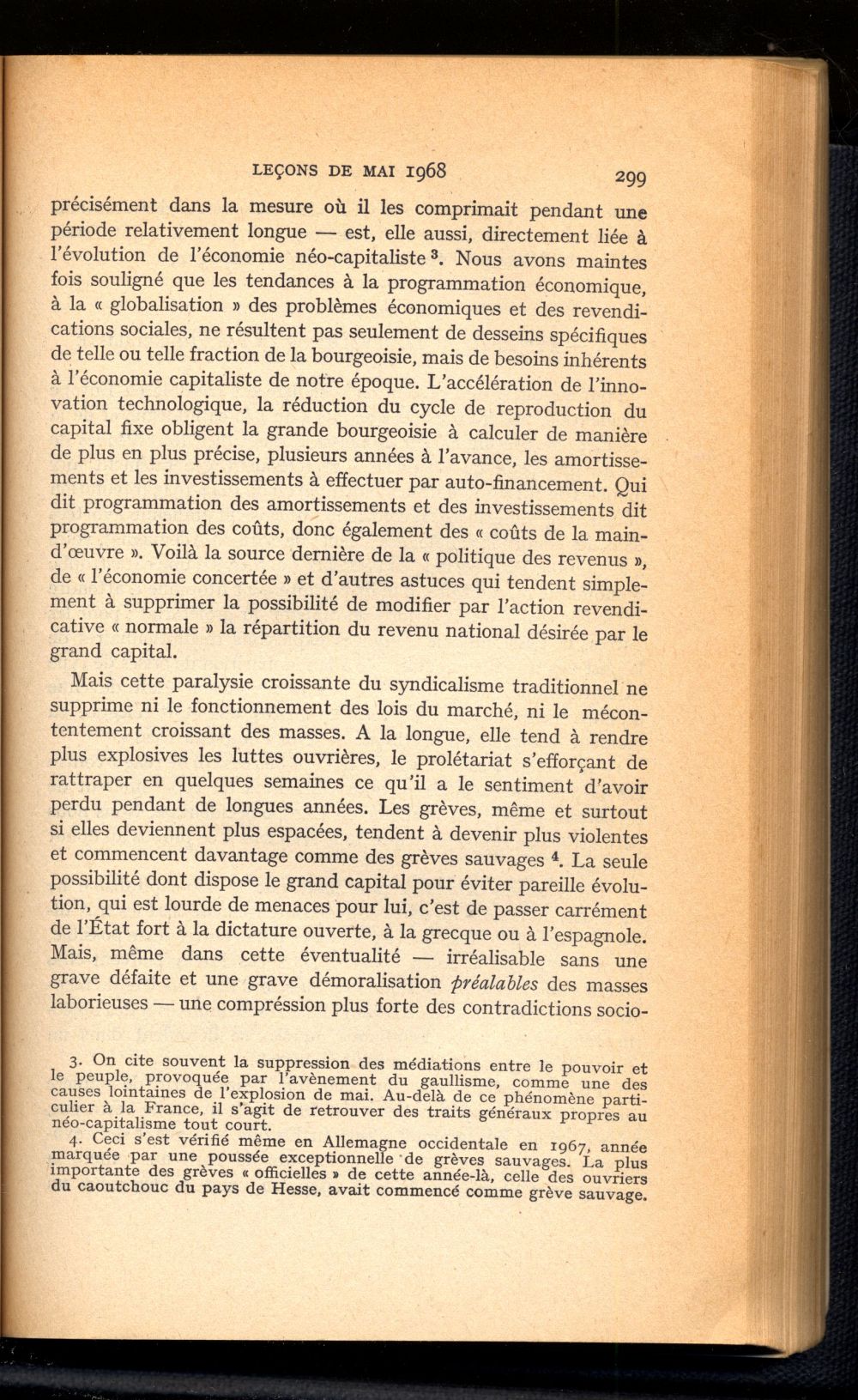

LEÇONS DE MAI 1968
299
précisément dans la mesure où il les comprimait pendant une
période relativement longue — est, elle aussi, directement liée à
l'évolution de l'économie néo-capitaliste3. Nous avons maintes
fois souligné que les tendances à la programmation économique,
à la « globalisation » des problèmes économiques et des revendi-
cations sociales, ne résultent pas seulement de desseins spécifiques
de telle ou telle fraction de la bourgeoisie, mais de besoins inhérents
à l'économie capitaliste de notre époque. L'accélération de l'inno-
vation technologique, la réduction du cycle de reproduction du
capital fixe obligent la grande bourgeoisie à calculer de manière
de plus en plus précise, plusieurs années à l'avance, les amortisse-
ments et les investissements à effectuer par auto-financement. Qui
dit programmation des amortissements et des investissements dit
programmation des coûts, donc également des « coûts de la main-
d'œuvre ». Voilà la source dernière de la « politique des revenus »,
de « l'économie concertée » et d'autres astuces qui tendent simple-
ment à supprimer la possibilité de modifier par l'action revendi-
cative « normale » la répartition du revenu national désirée par le
grand capital.
période relativement longue — est, elle aussi, directement liée à
l'évolution de l'économie néo-capitaliste3. Nous avons maintes
fois souligné que les tendances à la programmation économique,
à la « globalisation » des problèmes économiques et des revendi-
cations sociales, ne résultent pas seulement de desseins spécifiques
de telle ou telle fraction de la bourgeoisie, mais de besoins inhérents
à l'économie capitaliste de notre époque. L'accélération de l'inno-
vation technologique, la réduction du cycle de reproduction du
capital fixe obligent la grande bourgeoisie à calculer de manière
de plus en plus précise, plusieurs années à l'avance, les amortisse-
ments et les investissements à effectuer par auto-financement. Qui
dit programmation des amortissements et des investissements dit
programmation des coûts, donc également des « coûts de la main-
d'œuvre ». Voilà la source dernière de la « politique des revenus »,
de « l'économie concertée » et d'autres astuces qui tendent simple-
ment à supprimer la possibilité de modifier par l'action revendi-
cative « normale » la répartition du revenu national désirée par le
grand capital.
Mais cette paralysie croissante du syndicalisme traditionnel ne
supprime ni le fonctionnement des lois du marché, ni le mécon-
tentement croissant des masses. A la longue, elle tend à rendre
plus explosives les luttes ouvrières, le prolétariat s'efforçant de
rattraper en quelques semaines ce qu'il a le sentiment d'avoir
perdu pendant de longues années. Les grèves, même et surtout
si elles deviennent plus espacées, tendent à devenir plus violentes
et commencent davantage comme des grèves sauvages 4. La seule
possibilité dont dispose le grand capital pour éviter pareille évolu-
tion, qui est lourde de menaces pour lui, c'est de passer carrément
de l'État fort à la dictature ouverte, à la grecque ou à l'espagnole.
Mais, même dans cette éventualité •—• irréalisable sans une
grave défaite et une grave démoralisation préalables des masses
laborieuses — une compression plus forte des contradictions socio-
supprime ni le fonctionnement des lois du marché, ni le mécon-
tentement croissant des masses. A la longue, elle tend à rendre
plus explosives les luttes ouvrières, le prolétariat s'efforçant de
rattraper en quelques semaines ce qu'il a le sentiment d'avoir
perdu pendant de longues années. Les grèves, même et surtout
si elles deviennent plus espacées, tendent à devenir plus violentes
et commencent davantage comme des grèves sauvages 4. La seule
possibilité dont dispose le grand capital pour éviter pareille évolu-
tion, qui est lourde de menaces pour lui, c'est de passer carrément
de l'État fort à la dictature ouverte, à la grecque ou à l'espagnole.
Mais, même dans cette éventualité •—• irréalisable sans une
grave défaite et une grave démoralisation préalables des masses
laborieuses — une compression plus forte des contradictions socio-
3. On cite souvent la suppression des médiations entre Je pouvoir et
le peuple, provoquée par l'avènement du gaullisme, comme une des
causes lointaines de l'explosion de mai. Au-delà de ce phénomène parti-
culier à la France, il s'agit de retrouver des traits généraux propres au
néo-capitalisme tout court.
le peuple, provoquée par l'avènement du gaullisme, comme une des
causes lointaines de l'explosion de mai. Au-delà de ce phénomène parti-
culier à la France, il s'agit de retrouver des traits généraux propres au
néo-capitalisme tout court.
4. Ceci s'est vérifié même en Allemagne occidentale en 1967, année
marquée par une poussée exceptionnelle de grèves sauvages. La plus
importante des grèves « officielles » de cette année-là, celle des ouvriers
du caoutchouc du pays de Hesse, avait commencé comme grève sauvage.
marquée par une poussée exceptionnelle de grèves sauvages. La plus
importante des grèves « officielles » de cette année-là, celle des ouvriers
du caoutchouc du pays de Hesse, avait commencé comme grève sauvage.
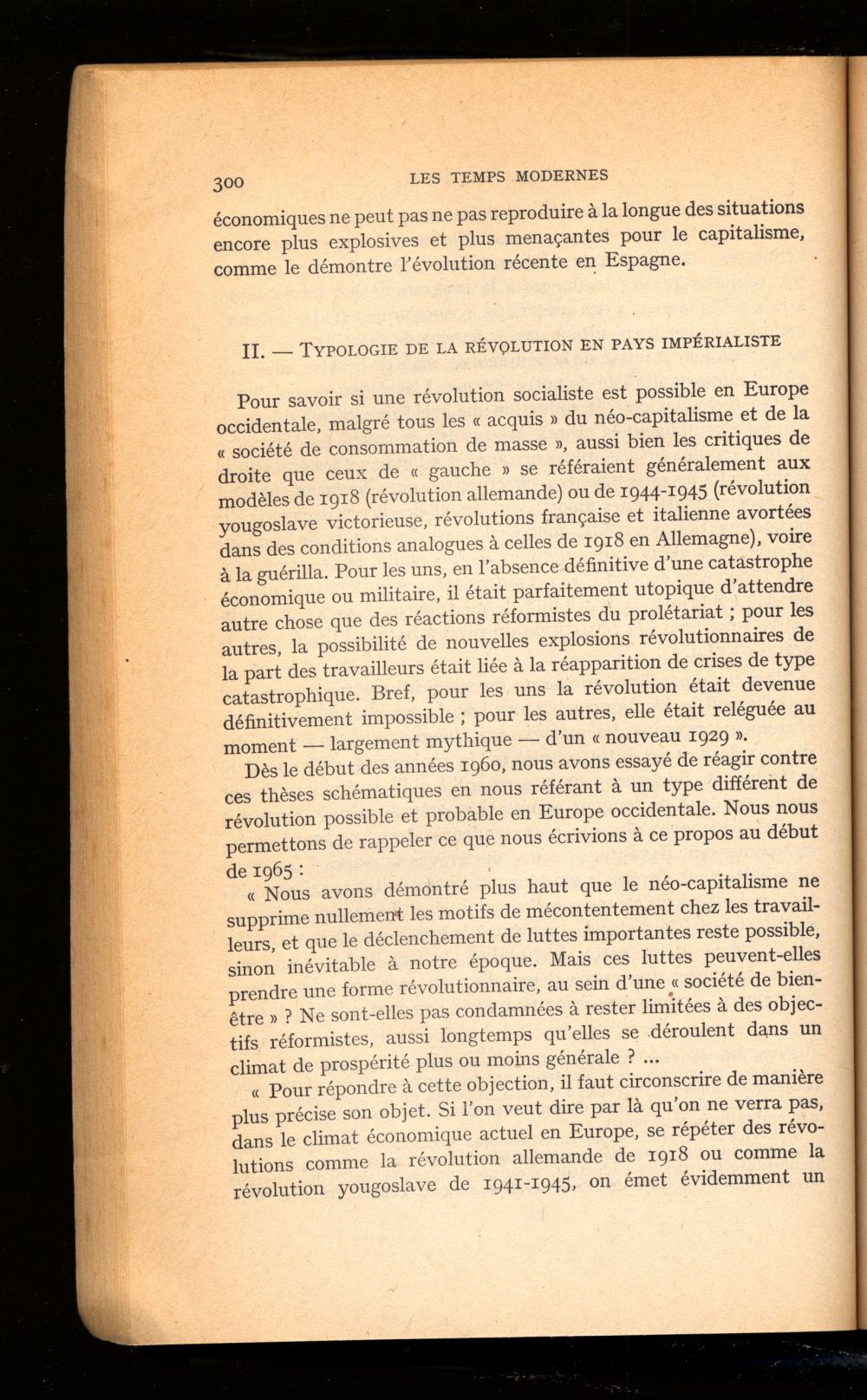

300
LES TEMPS MODERNES
économiques ne peut pas ne pas reproduire à la longue des situations
encore plus explosives et plus menaçantes pour le capitalisme,
comme le démontre l'évolution récente en Espagne.
encore plus explosives et plus menaçantes pour le capitalisme,
comme le démontre l'évolution récente en Espagne.
II. — TYPOLOGIE DE LA RÉVOLUTION EN PAYS IMPÉRIALISTE
Pour savoir si une révolution socialiste est possible en Europe
occidentale, malgré tous les « acquis » du néo-capitalisme et de la
« société de consommation de masse », aussi bien les critiques de
droite que ceux de « gauche » se référaient généralement aux
modèles de 1918 (révolution allemande) ou de 1944-1945 (révolution
yougoslave victorieuse, révolutions française et italienne avortées
dans des conditions analogues à celles de 1918 en Allemagne), voire
à la guérilla. Pour les uns, en l'absence définitive d'une catastrophe
économique ou militaire, il était parfaitement utopique d'attendre
autre chose que des réactions réformistes du prolétariat ; pour les
autres, la possibilité de nouvelles explosions révolutionnaires de
la part des travailleiirs était liée à la réapparition de crises de type
catastrophique. Bref, pour les uns la révolution était devenue
définitivement impossible ; pour les autres, elle était reléguée au
moment — largement mythique — d'un « nouveau 1929 ».
occidentale, malgré tous les « acquis » du néo-capitalisme et de la
« société de consommation de masse », aussi bien les critiques de
droite que ceux de « gauche » se référaient généralement aux
modèles de 1918 (révolution allemande) ou de 1944-1945 (révolution
yougoslave victorieuse, révolutions française et italienne avortées
dans des conditions analogues à celles de 1918 en Allemagne), voire
à la guérilla. Pour les uns, en l'absence définitive d'une catastrophe
économique ou militaire, il était parfaitement utopique d'attendre
autre chose que des réactions réformistes du prolétariat ; pour les
autres, la possibilité de nouvelles explosions révolutionnaires de
la part des travailleiirs était liée à la réapparition de crises de type
catastrophique. Bref, pour les uns la révolution était devenue
définitivement impossible ; pour les autres, elle était reléguée au
moment — largement mythique — d'un « nouveau 1929 ».
Dès le début des années 1960, nous avons essayé de réagir contre
ces thèses schématiques en nous référant à un type différent de
révolution possible et probable en Europe occidentale. Nous nous
permettons de rappeler ce que nous écrivions à ce propos au début
de 1965 :
ces thèses schématiques en nous référant à un type différent de
révolution possible et probable en Europe occidentale. Nous nous
permettons de rappeler ce que nous écrivions à ce propos au début
de 1965 :
« Nous avons démontré plus haut que le néo-capitalisme ne
supprime nullement les motifs de mécontentement chez les travail-
leurs, et q'ae le déclenchement de luttes importantes reste possible,
sinon inévitable à. notre époque. Mais ces luttes peuvent-elles
prendre une forme révolutionnaire, au sein d'une « société de bien-
être » ? Ne sont-elles pas condamnées à rester limitées à des objec-
tifs réformistes, aussi longtemps qu'elles se déroulent dans un
climat de prospérité plus ou moins générale ? ...
supprime nullement les motifs de mécontentement chez les travail-
leurs, et q'ae le déclenchement de luttes importantes reste possible,
sinon inévitable à. notre époque. Mais ces luttes peuvent-elles
prendre une forme révolutionnaire, au sein d'une « société de bien-
être » ? Ne sont-elles pas condamnées à rester limitées à des objec-
tifs réformistes, aussi longtemps qu'elles se déroulent dans un
climat de prospérité plus ou moins générale ? ...
« Pour répondre à cette objection, il faut circonscrire de manière
plus précise son objet. Si l'on veut dire par là qu'on ne verra pas,
dans le climat économique actuel en Europe, se répéter des révo-
lutions comme la révolution allemande de 1918 ou comme la
révolution yougoslave de 1941-1945, on émet évidemment un
plus précise son objet. Si l'on veut dire par là qu'on ne verra pas,
dans le climat économique actuel en Europe, se répéter des révo-
lutions comme la révolution allemande de 1918 ou comme la
révolution yougoslave de 1941-1945, on émet évidemment un
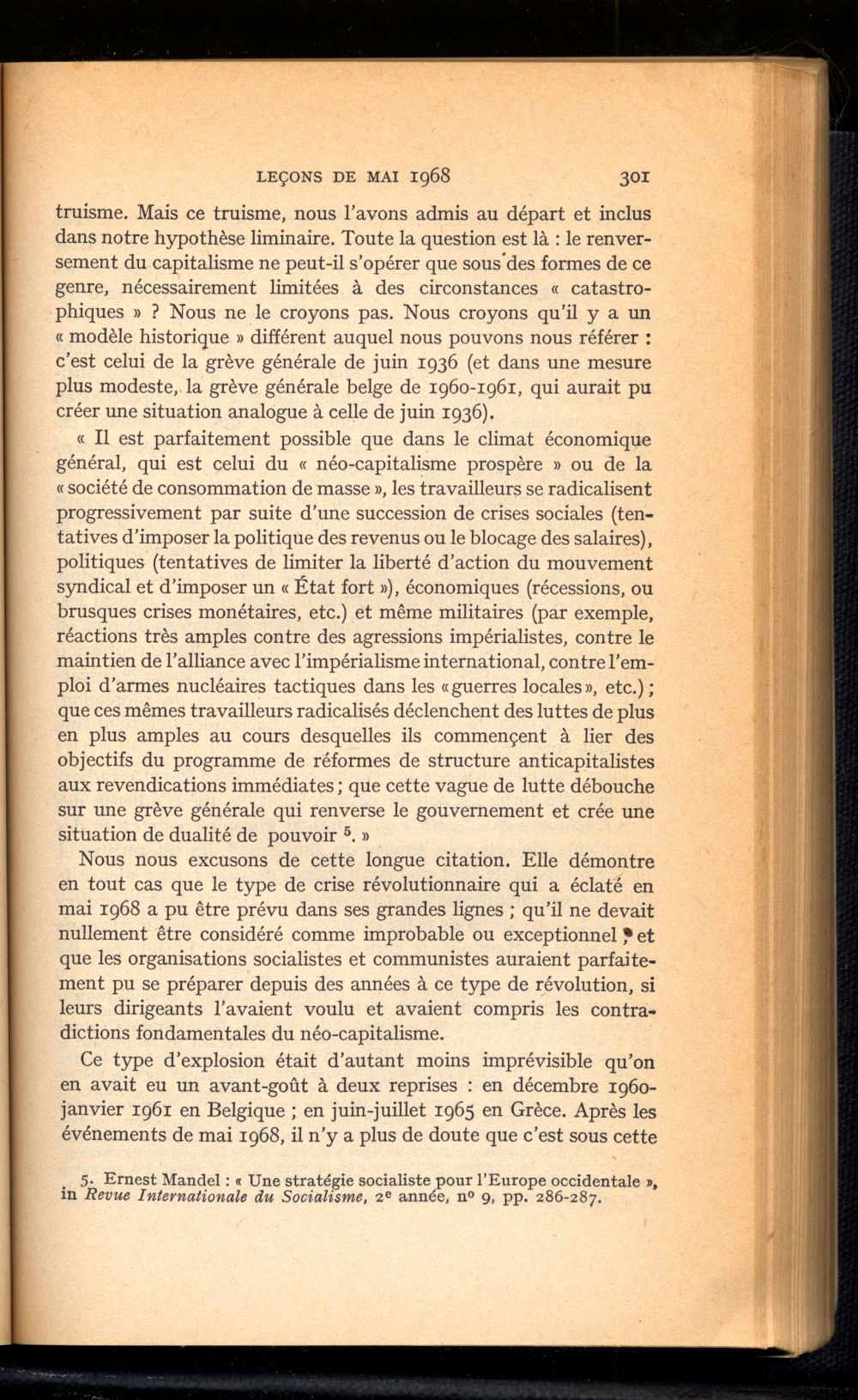

LEÇONS DE MAI IQÔS
301
truisme. Mais ce truisme, nous l'avons admis au départ et inclus
dans notre hypothèse liminaire. Toute la question est là : le renver-
sement du capitalisme ne peut-il s'opérer que sous'des formes de ce
genre, nécessairement limitées à des circonstances « catastro-
phiques » ? Nous ne le croyons pas. Nous croyons qu'il y a un
« modèle historique » différent auquel nous pouvons nous référer :
c'est celui de la grève générale de juin 1936 (et dans une mesure
plus modeste, la grève générale belge de 1960-1961, qui aurait pu
créer une situation analogue à celle de juin 1936).
dans notre hypothèse liminaire. Toute la question est là : le renver-
sement du capitalisme ne peut-il s'opérer que sous'des formes de ce
genre, nécessairement limitées à des circonstances « catastro-
phiques » ? Nous ne le croyons pas. Nous croyons qu'il y a un
« modèle historique » différent auquel nous pouvons nous référer :
c'est celui de la grève générale de juin 1936 (et dans une mesure
plus modeste, la grève générale belge de 1960-1961, qui aurait pu
créer une situation analogue à celle de juin 1936).
« II est parfaitement possible que dans le climat économique
général, qui est celui du « néo-capitalisme prospère » ou de la
« société de consommation de masse », les travailleurs se radicalisent
progressivement par suite d'une succession de crises sociales (ten-
tatives d'imposer la politique des revenus ou le blocage des salaires),
politiques (tentatives de limiter la liberté d'action du mouvement
syndical et d'imposer un « État fort »), économiques (récessions, ou
brusques crises monétaires, etc.) et même militaires (par exemple,
réactions très amples contre des agressions impérialistes, contre le
maintien de l'alliance avec l'impérialisme international, contre l'em-
ploi d'armes nucléaires tactiques dans les «guerres locales», etc.);
que ces mêmes travailleurs radicalisés déclenchent des luttes de plus
en plus amples au cours desquelles ils commencent à lier des
objectifs du programme de réformes de structure anticapitalistes
aux revendications immédiates ; que cette vague de lutte débouche
sur une grève générale qui renverse le gouvernement et crée une
situation de dualité de pouvoir 5. »
général, qui est celui du « néo-capitalisme prospère » ou de la
« société de consommation de masse », les travailleurs se radicalisent
progressivement par suite d'une succession de crises sociales (ten-
tatives d'imposer la politique des revenus ou le blocage des salaires),
politiques (tentatives de limiter la liberté d'action du mouvement
syndical et d'imposer un « État fort »), économiques (récessions, ou
brusques crises monétaires, etc.) et même militaires (par exemple,
réactions très amples contre des agressions impérialistes, contre le
maintien de l'alliance avec l'impérialisme international, contre l'em-
ploi d'armes nucléaires tactiques dans les «guerres locales», etc.);
que ces mêmes travailleurs radicalisés déclenchent des luttes de plus
en plus amples au cours desquelles ils commencent à lier des
objectifs du programme de réformes de structure anticapitalistes
aux revendications immédiates ; que cette vague de lutte débouche
sur une grève générale qui renverse le gouvernement et crée une
situation de dualité de pouvoir 5. »
Nous nous excusons de cette longue citation. Elle démontre
en tout cas que le type de crise révolutionnaire qui a éclaté en
mai 1968 a pu être prévu dans ses grandes lignes ; qu'il ne devait
nullement être considéré comme improbable ou exceptionnel * et
que les organisations socialistes et communistes auraient parfaite-
ment pu se préparer depuis des années à ce type de révolution, si
leurs dirigeants l'avaient voulu et avaient compris les contra-
dictions fondamentales du néo-capitalisme.
en tout cas que le type de crise révolutionnaire qui a éclaté en
mai 1968 a pu être prévu dans ses grandes lignes ; qu'il ne devait
nullement être considéré comme improbable ou exceptionnel * et
que les organisations socialistes et communistes auraient parfaite-
ment pu se préparer depuis des années à ce type de révolution, si
leurs dirigeants l'avaient voulu et avaient compris les contra-
dictions fondamentales du néo-capitalisme.
Ce type d'explosion était d'autant moins imprévisible qu'on
en avait eu un avant-goût à deux reprises : en décembre 1960-
janvier 1961 en Belgique ; en juin-juillet 1965 en Grèce. Après les
événements de mai 1968, il n'y a plus de doute que c'est sous cette
en avait eu un avant-goût à deux reprises : en décembre 1960-
janvier 1961 en Belgique ; en juin-juillet 1965 en Grèce. Après les
événements de mai 1968, il n'y a plus de doute que c'est sous cette
5. Ernest Mandel : « Une stratégie socialiste pour l'Europe occidentale »,
in Revue Internationale du Socialisme, 2e année, n° 9, pp. 286-287.
in Revue Internationale du Socialisme, 2e année, n° 9, pp. 286-287.
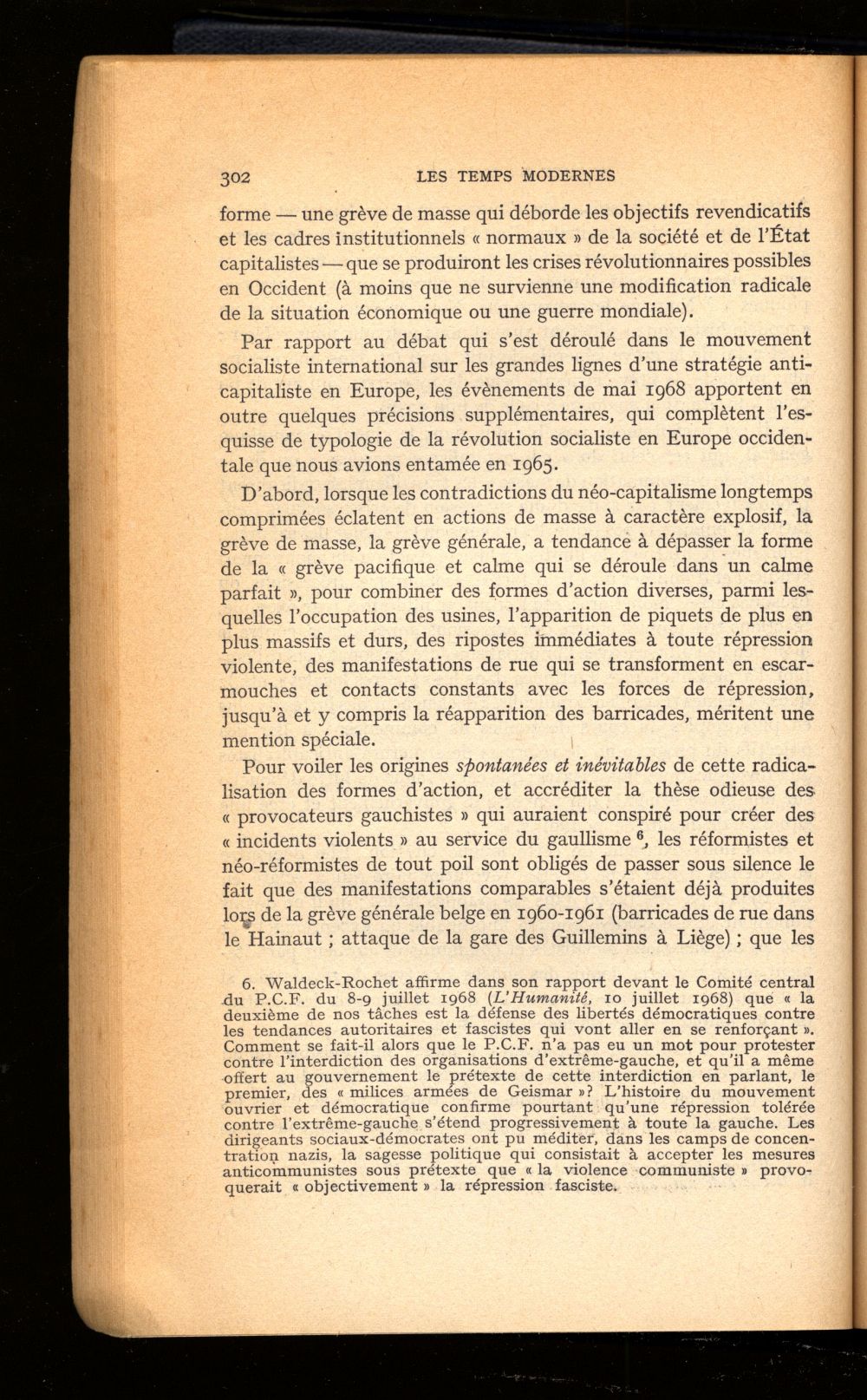

302
LES TEMPS MODERNES
forme — une grève de masse qui déborde les objectifs revendicatifs
et les cadres institutionnels « normaux » de la société et de l'État
capitalistes — que se produiront les crises révolutionnaires possibles
en Occident (à moins que ne survienne une modification radicale
de la situation économique ou une guerre mondiale).
et les cadres institutionnels « normaux » de la société et de l'État
capitalistes — que se produiront les crises révolutionnaires possibles
en Occident (à moins que ne survienne une modification radicale
de la situation économique ou une guerre mondiale).
Par rapport au débat qui s'est déroulé dans le mouvement
socialiste international sur les grandes lignes d'une stratégie anti-
capitaliste en Europe, les événements de mai 1968 apportent en
outre quelques précisions supplémentaires, qui complètent l'es-
quisse de typologie de la révolution socialiste en Europe occiden-
tale que nous avions entamée en 1965.
socialiste international sur les grandes lignes d'une stratégie anti-
capitaliste en Europe, les événements de mai 1968 apportent en
outre quelques précisions supplémentaires, qui complètent l'es-
quisse de typologie de la révolution socialiste en Europe occiden-
tale que nous avions entamée en 1965.
D'abord, lorsque les contradictions du néo-capitalisme longtemps
comprimées éclatent en actions de masse à caractère explosif, la
grève de masse, la grève générale, a tendance à dépasser la forme
de la « grève pacifique et calme qui se déroule dans un calme
parfait », pour combiner des formes d'action diverses, parmi les-
quelles l'occupation des usines, l'apparition de piquets de plus en
plus massifs et durs, des ripostes immédiates à toute répression
violente, des manifestations de rue qui se transforment en escar-
mouches et contacts constants avec les forces de répression,
jusqu'à et y compris la réapparition des barricades, méritent une
mention spéciale.
comprimées éclatent en actions de masse à caractère explosif, la
grève de masse, la grève générale, a tendance à dépasser la forme
de la « grève pacifique et calme qui se déroule dans un calme
parfait », pour combiner des formes d'action diverses, parmi les-
quelles l'occupation des usines, l'apparition de piquets de plus en
plus massifs et durs, des ripostes immédiates à toute répression
violente, des manifestations de rue qui se transforment en escar-
mouches et contacts constants avec les forces de répression,
jusqu'à et y compris la réapparition des barricades, méritent une
mention spéciale.
Pour voiler les origines spontanées et inévitables de cette radica-
lisation des formes d'action, et accréditer la thèse odieuse des
« provocateurs gauchistes » qui auraient conspiré pour créer des
« incidents violents » au service du gaullisme 6, les réformistes et
néo-réformistes de tout poil sont obligés de passer sous silence le
fait que des manifestations comparables s'étaient déjà produites
lors de la grève générale belge en 1960-1961 (barricades de rue dans
le Hainaut ; attaque de la gare des Guillemins à Liège) ; que les
lisation des formes d'action, et accréditer la thèse odieuse des
« provocateurs gauchistes » qui auraient conspiré pour créer des
« incidents violents » au service du gaullisme 6, les réformistes et
néo-réformistes de tout poil sont obligés de passer sous silence le
fait que des manifestations comparables s'étaient déjà produites
lors de la grève générale belge en 1960-1961 (barricades de rue dans
le Hainaut ; attaque de la gare des Guillemins à Liège) ; que les
6. Waldeck-Rochct affirme dans son rapport devant le Comité central
.du P.C.F. du 8-9 juillet 1968 (L'Humanité, 10 juillet 1968) que « la
deuxième de nos tâches est la défense des libertés démocratiques contre
les tendances autoritaires et fascistes qui vont aller en se renforçant ».
Comment se fait-il alors que le P.C.F. n'a pas eu un mot pour protester
contre l'interdiction des organisations d'extrême-gauche, et qu'il a même
offert au gouvernement le prétexte de cette interdiction en parlant, le
premier, des « milices armées de Geismar »? L'histoire du mouvement
ouvrier et démocratique confirme pourtant qu'une répression tolérée
contre l'extrême-gauche s'étend progressivement à toute la gauche. Les
dirigeants sociaux-démocrates ont pu méditer, dans les camps de concen-
tration nazis, la sagesse politique qui consistait à accepter les mesures
anticommunistes sous prétexte que « la violence communiste » provo-
querait « objectivement » la répression fasciste.
.du P.C.F. du 8-9 juillet 1968 (L'Humanité, 10 juillet 1968) que « la
deuxième de nos tâches est la défense des libertés démocratiques contre
les tendances autoritaires et fascistes qui vont aller en se renforçant ».
Comment se fait-il alors que le P.C.F. n'a pas eu un mot pour protester
contre l'interdiction des organisations d'extrême-gauche, et qu'il a même
offert au gouvernement le prétexte de cette interdiction en parlant, le
premier, des « milices armées de Geismar »? L'histoire du mouvement
ouvrier et démocratique confirme pourtant qu'une répression tolérée
contre l'extrême-gauche s'étend progressivement à toute la gauche. Les
dirigeants sociaux-démocrates ont pu méditer, dans les camps de concen-
tration nazis, la sagesse politique qui consistait à accepter les mesures
anticommunistes sous prétexte que « la violence communiste » provo-
querait « objectivement » la répression fasciste.
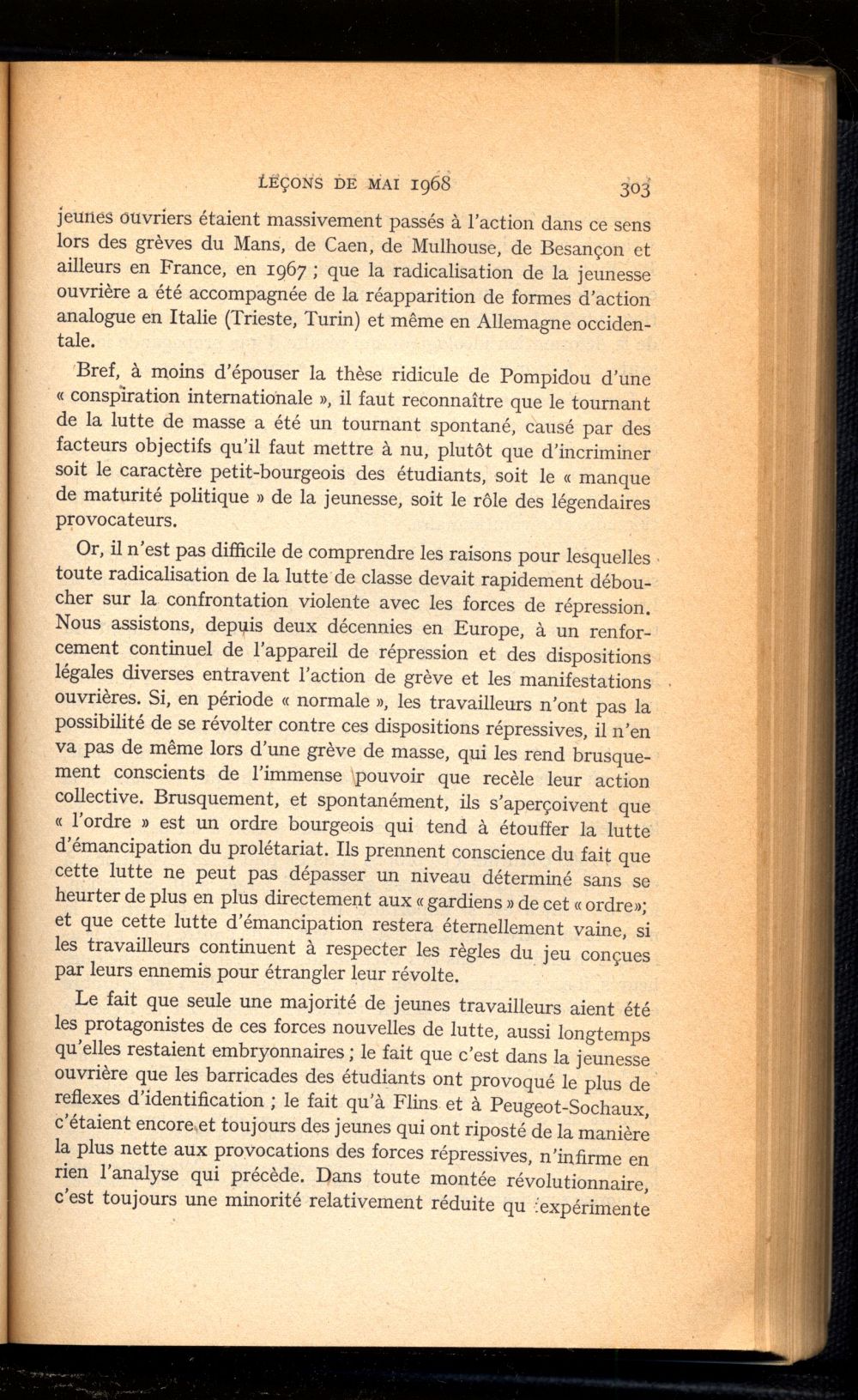

LEÇONS DE MAI 1968
303
jeunes ouvriers étaient massivement passés à l'action dans ce sens
lors des grèves du Mans, de Caen, de Mulhouse, de Besançon et
ailleurs en France, en 1967 ; que la radicalisation de la jeunesse
ouvrière a été accompagnée de la réapparition de formes d'action
analogue en Italie (Trieste, Turin) et même en Allemagne occiden-
tale.
lors des grèves du Mans, de Caen, de Mulhouse, de Besançon et
ailleurs en France, en 1967 ; que la radicalisation de la jeunesse
ouvrière a été accompagnée de la réapparition de formes d'action
analogue en Italie (Trieste, Turin) et même en Allemagne occiden-
tale.
Bref, à moins d'épouser la thèse ridicule de Pompidou d'une
« conspiration internationale », il faut reconnaître que le tournant
de la lutte de masse a été un tournant spontané, causé par des
facteurs objectifs qu'il faut mettre à nu, plutôt que d'incriminer
soit le caractère petit-bourgeois des étudiants, soit le « manque
de maturité politique » de la jeunesse, soit le rôle des légendaires
provocateurs.
« conspiration internationale », il faut reconnaître que le tournant
de la lutte de masse a été un tournant spontané, causé par des
facteurs objectifs qu'il faut mettre à nu, plutôt que d'incriminer
soit le caractère petit-bourgeois des étudiants, soit le « manque
de maturité politique » de la jeunesse, soit le rôle des légendaires
provocateurs.
Or, il n'est pas difficile de comprendre les raisons pour lesquelles
toute radicalisation de la lutte de classe devait rapidement débou-
cher sur la confrontation violente avec les forces de répression.
Nous assistons, depuis deux décennies en Europe, à un renfor-
cement continuel de l'appareil de répression et des dispositions
légales diverses entravent l'action de grève et les manifestations
ouvrières. Si, en période « normale », les travailleurs n'ont pas la
possibilité de se révolter contre ces dispositions répressives, il n'en
va pas de même lors d'une grève de masse, qui les rend brusque-
ment conscients de l'immense pouvoir que recèle leur action
collective. Brusquement, et spontanément, ils s'aperçoivent que
« l'ordre » est un ordre bourgeois qui tend à étouffer la lutte
d'émancipation du prolétariat. Ils prennent conscience du fait que
cette lutte ne peut pas dépasser un niveau déterminé sans se
heurter de plus en plus directement aux « gardiens » de cet « ordre»;
et que cette lutte d'émancipation restera éternellement vaine, si
les travailleurs continuent à respecter les règles du jeu conçues
par leurs ennemis pour étrangler leur révolte.
toute radicalisation de la lutte de classe devait rapidement débou-
cher sur la confrontation violente avec les forces de répression.
Nous assistons, depuis deux décennies en Europe, à un renfor-
cement continuel de l'appareil de répression et des dispositions
légales diverses entravent l'action de grève et les manifestations
ouvrières. Si, en période « normale », les travailleurs n'ont pas la
possibilité de se révolter contre ces dispositions répressives, il n'en
va pas de même lors d'une grève de masse, qui les rend brusque-
ment conscients de l'immense pouvoir que recèle leur action
collective. Brusquement, et spontanément, ils s'aperçoivent que
« l'ordre » est un ordre bourgeois qui tend à étouffer la lutte
d'émancipation du prolétariat. Ils prennent conscience du fait que
cette lutte ne peut pas dépasser un niveau déterminé sans se
heurter de plus en plus directement aux « gardiens » de cet « ordre»;
et que cette lutte d'émancipation restera éternellement vaine, si
les travailleurs continuent à respecter les règles du jeu conçues
par leurs ennemis pour étrangler leur révolte.
Le fait que seule une majorité de jeunes travailleurs aient été
les protagonistes de ces forces nouvelles de lutte, aussi longtemps
qu'elles restaient embryonnaires ; le fait que c'est dans la jeunesse
ouvrière que les barricades des étudiants ont provoqué le plus de
réflexes d'identification ; le fait qu'à Flins et à Peugeot-Sochaux,
c'étaient encore et toujours des jeunes qui ont riposté de la manière
la plus nette aux provocations des forces répressives, n'infirme en
rien l'analyse qui précède. Dans toute montée révolutionnaire,
c'est toujours une minorité relativement réduite qu l'expérimente
les protagonistes de ces forces nouvelles de lutte, aussi longtemps
qu'elles restaient embryonnaires ; le fait que c'est dans la jeunesse
ouvrière que les barricades des étudiants ont provoqué le plus de
réflexes d'identification ; le fait qu'à Flins et à Peugeot-Sochaux,
c'étaient encore et toujours des jeunes qui ont riposté de la manière
la plus nette aux provocations des forces répressives, n'infirme en
rien l'analyse qui précède. Dans toute montée révolutionnaire,
c'est toujours une minorité relativement réduite qu l'expérimente
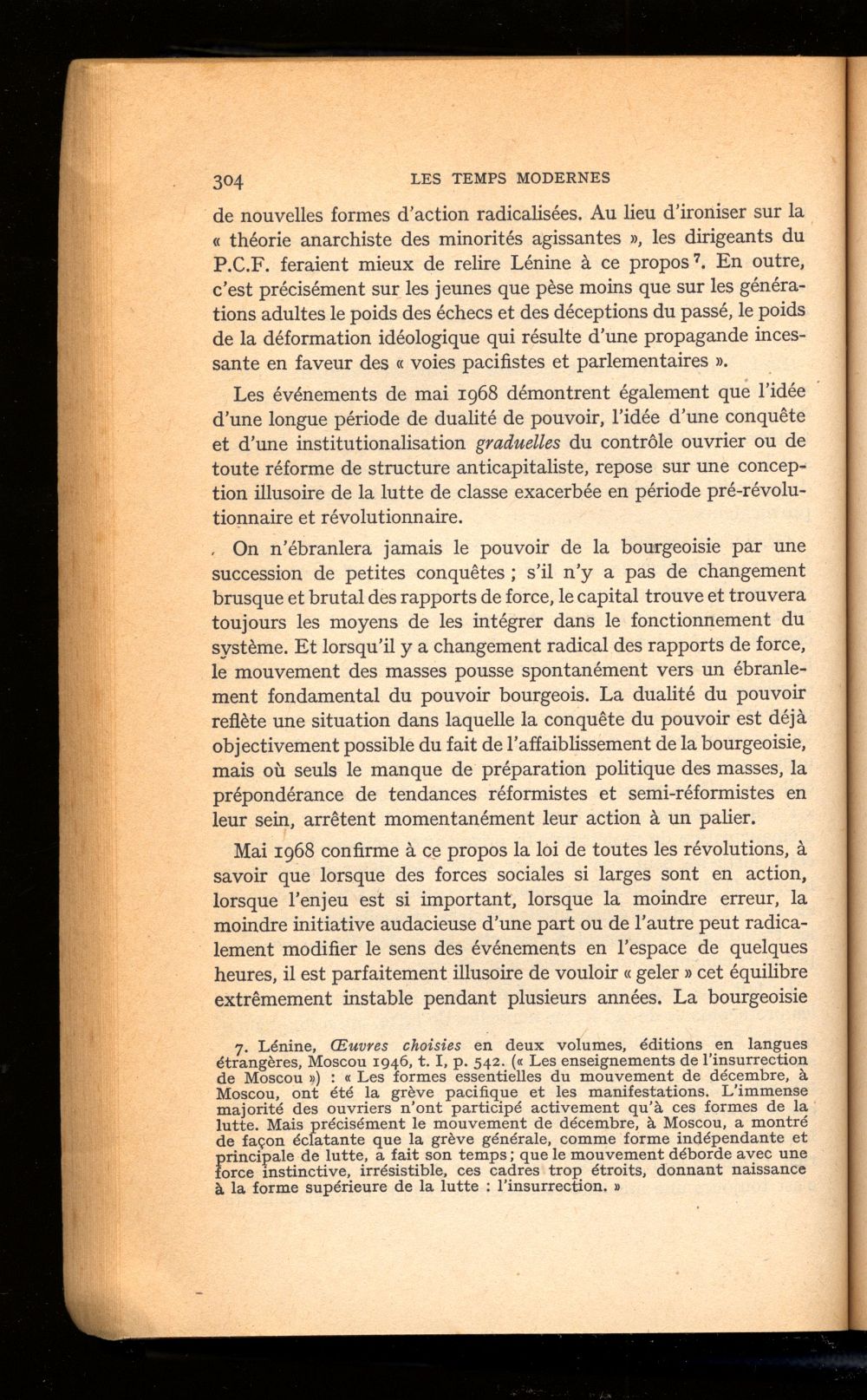

304
LES TEMPS MODERNES
de nouvelles formes d'action radicalisées. Au lieu d'ironiser sur la
« théorie anarchiste des minorités agissantes », les dirigeants du
P.C.F. feraient mieux de relire Lénine à ce propos7. En outre,
c'est précisément sur les jeunes que pèse moins que sur les généra-
tions adultes le poids des échecs et des déceptions du passé, le poids
de la déformation idéologique qui résulte d'une propagande inces-
sante en faveur des « voies pacifistes et parlementaires ».
« théorie anarchiste des minorités agissantes », les dirigeants du
P.C.F. feraient mieux de relire Lénine à ce propos7. En outre,
c'est précisément sur les jeunes que pèse moins que sur les généra-
tions adultes le poids des échecs et des déceptions du passé, le poids
de la déformation idéologique qui résulte d'une propagande inces-
sante en faveur des « voies pacifistes et parlementaires ».
Les événements de mai 1968 démontrent également que l'idée
d'une longue période de dualité de pouvoir, l'idée d'une conquête
et d'une institutionalisation graduelles du contrôle ouvrier ou de
toute réforme de structure anticapitaliste, repose sur une concep-
tion illusoire de la lutte de classe exacerbée en période pré-révolu-
tionnaire et révolutionnaire.
d'une longue période de dualité de pouvoir, l'idée d'une conquête
et d'une institutionalisation graduelles du contrôle ouvrier ou de
toute réforme de structure anticapitaliste, repose sur une concep-
tion illusoire de la lutte de classe exacerbée en période pré-révolu-
tionnaire et révolutionnaire.
, On n'ébranlera jamais le pouvoir de la bourgeoisie par une
succession de petites conquêtes ; s'il n'y a pas de changement
brusque et brutal des rapports de force, le capital trouve et trouvera
toujours les moyens de les intégrer dans le fonctionnement du
système. Et lorsqu'il y a changement radical des rapports de force,
le mouvement des masses pousse spontanément vers un ébranle-
ment fondamental du pouvoir bourgeois. La dualité du pouvoir
reflète une situation dans laquelle la conquête du pouvoir est déjà
objectivement possible du fait de l'affaiblissement de la bourgeoisie,
mais où seuls le manque de préparation politique des masses, la
prépondérance de tendances réformistes et semi-réformistes en
leur sein, arrêtent momentanément leur action à un palier.
succession de petites conquêtes ; s'il n'y a pas de changement
brusque et brutal des rapports de force, le capital trouve et trouvera
toujours les moyens de les intégrer dans le fonctionnement du
système. Et lorsqu'il y a changement radical des rapports de force,
le mouvement des masses pousse spontanément vers un ébranle-
ment fondamental du pouvoir bourgeois. La dualité du pouvoir
reflète une situation dans laquelle la conquête du pouvoir est déjà
objectivement possible du fait de l'affaiblissement de la bourgeoisie,
mais où seuls le manque de préparation politique des masses, la
prépondérance de tendances réformistes et semi-réformistes en
leur sein, arrêtent momentanément leur action à un palier.
Mai 1968 confirme à ce propos la loi de toutes les révolutions, à
savoir que lorsque des forces sociales si larges sont en action,
lorsque l'enjeu est si important, lorsque la moindre erreur, la
moindre initiative audacieuse d'une part ou de l'autre peut radica-
lement modifier le sens des événements en l'espace de quelques
heures, il est parfaitement illusoire de vouloir « geler » cet équilibre
extrêmement instable pendant plusieurs années. La bourgeoisie
savoir que lorsque des forces sociales si larges sont en action,
lorsque l'enjeu est si important, lorsque la moindre erreur, la
moindre initiative audacieuse d'une part ou de l'autre peut radica-
lement modifier le sens des événements en l'espace de quelques
heures, il est parfaitement illusoire de vouloir « geler » cet équilibre
extrêmement instable pendant plusieurs années. La bourgeoisie
7. Lénine, Œuvres choisies en deux volumes, éditions en langues
étrangères, Moscou 1946, t. I, p. 542. (« Les enseignements de l'insurrection
de Moscou ») : « Les formes essentielles du mouvement de décembre, à
Moscou, ont été la grève pacifique et les manifestations. L'immense
majorité des ouvriers n'ont participé activement qu'à ces formes de la
lutte. Mais précisément le mouvement de décembre, à Moscou, a montré
de façon éclatante que la grève générale, comme forme indépendante et
principale de lutte, a fait son temps ; que le mouvement déborde avec une
force instinctive, irrésistible, ces cadres trop étroits, donnant naissance
à la forme supérieure de la lutte : l'insurrection. »
étrangères, Moscou 1946, t. I, p. 542. (« Les enseignements de l'insurrection
de Moscou ») : « Les formes essentielles du mouvement de décembre, à
Moscou, ont été la grève pacifique et les manifestations. L'immense
majorité des ouvriers n'ont participé activement qu'à ces formes de la
lutte. Mais précisément le mouvement de décembre, à Moscou, a montré
de façon éclatante que la grève générale, comme forme indépendante et
principale de lutte, a fait son temps ; que le mouvement déborde avec une
force instinctive, irrésistible, ces cadres trop étroits, donnant naissance
à la forme supérieure de la lutte : l'insurrection. »
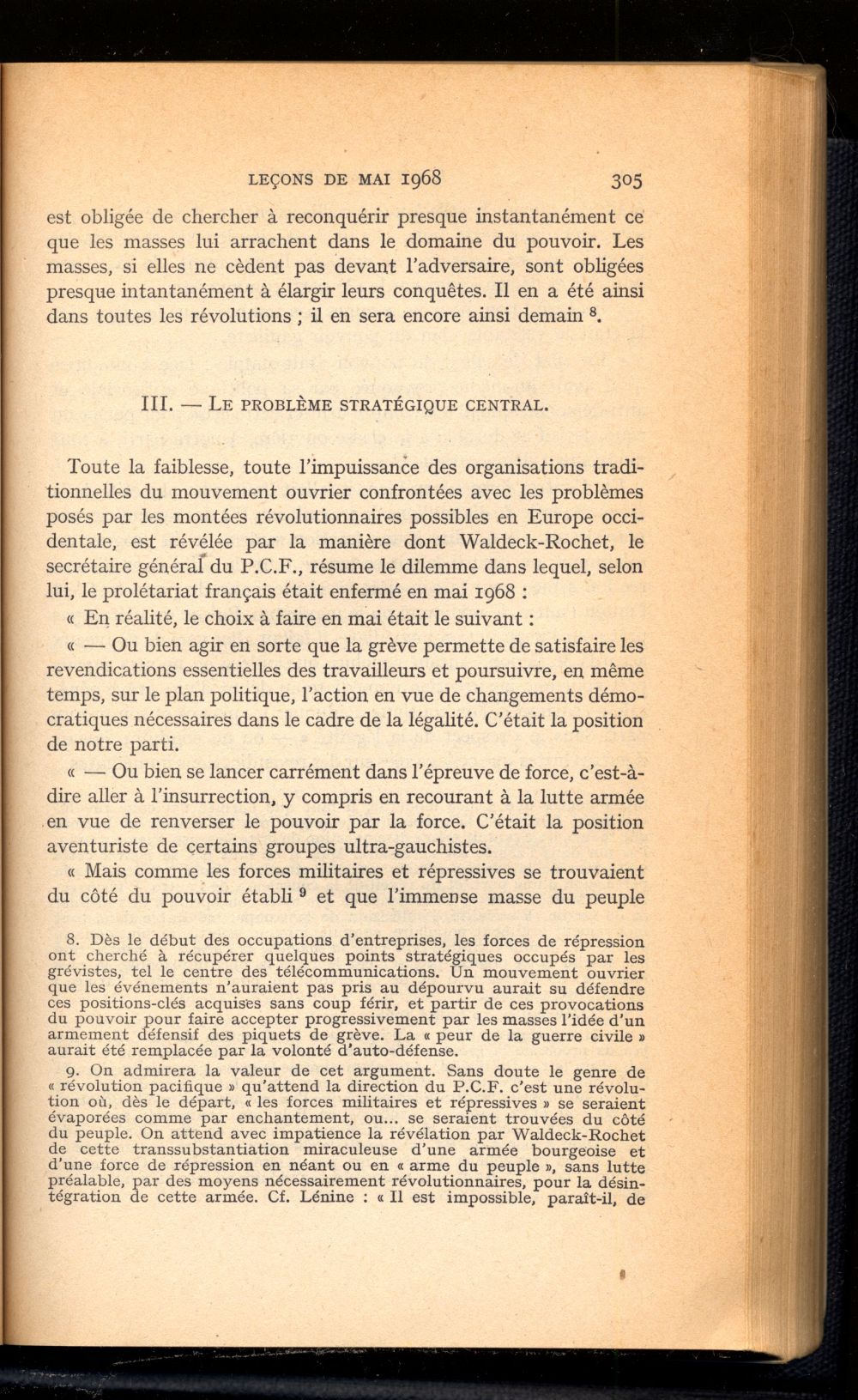

LEÇONS DE MAI IQÔS
305
est obligée de chercher à reconquérir presque instantanément ce
que les masses lui arrachent dans le domaine du pouvoir. Les
masses, si elles ne cèdent pas devant l'adversaire, sont obligées
presque intantanément à élargir leurs conquêtes. Il en a été ainsi
dans toutes les révolutions ; il en sera encore ainsi demain 8.
que les masses lui arrachent dans le domaine du pouvoir. Les
masses, si elles ne cèdent pas devant l'adversaire, sont obligées
presque intantanément à élargir leurs conquêtes. Il en a été ainsi
dans toutes les révolutions ; il en sera encore ainsi demain 8.
III. — LE PROBLÈME STRATÉGIQUE CENTRAL.
Toute la faiblesse, toute l'impuissance des organisations tradi-
tionnelles du mouvement ouvrier confrontées avec les problèmes
posés par les montées révolutionnaires possibles en Europe occi-
dentale, est révélée par la manière dont Waldeck-Rochet, le
secrétaire général du P.C.F., résume le dilemme dans lequel, selon
lui, le prolétariat français était enfermé en mai 1968 :
tionnelles du mouvement ouvrier confrontées avec les problèmes
posés par les montées révolutionnaires possibles en Europe occi-
dentale, est révélée par la manière dont Waldeck-Rochet, le
secrétaire général du P.C.F., résume le dilemme dans lequel, selon
lui, le prolétariat français était enfermé en mai 1968 :
« En réalité, le choix à faire en mai était le suivant :
« — Ou bien agir en sorte que la grève permette de satisfaire les
revendications essentielles des travailleurs et poursuivre, en même
temps, sur le plan politique, l'action en vue de changements démo-
cratiques nécessaires dans le cadre de la légalité. C'était la position
de notre parti.
revendications essentielles des travailleurs et poursuivre, en même
temps, sur le plan politique, l'action en vue de changements démo-
cratiques nécessaires dans le cadre de la légalité. C'était la position
de notre parti.
« — Ou bien se lancer carrément dans l'épreuve de force, c'est-à-
dire aller à l'insurrection, y compris en recourant à la lutte armée
en vue de renverser le pouvoir par la force. C'était la position
aventuriste de certains groupes ultra-gauchistes.
dire aller à l'insurrection, y compris en recourant à la lutte armée
en vue de renverser le pouvoir par la force. C'était la position
aventuriste de certains groupes ultra-gauchistes.
« Mais comme les forces militaires et répressives se trouvaient
du côté du pouvoir établi 9 et que l'immense masse du peuple
du côté du pouvoir établi 9 et que l'immense masse du peuple
8. Dès le début des occupations d'entreprises, les forces de répression
ont cherché à récupérer quelques points stratégiques occupés par les
grévistes, tel le centre des télécommunications. Un mouvement ouvrier
que les événements n'auraient pas pris au dépourvu aurait su défendre
ces positions-clés acquises sans coup férir, et partir de ces provocations
du pouvoir pour faire accepter progressivement par les masses l'idée d'un
armement défensif des piquets de grève. La « peur de la guerre civile »
aurait été remplacée par la volonté d'auto-défense.
ont cherché à récupérer quelques points stratégiques occupés par les
grévistes, tel le centre des télécommunications. Un mouvement ouvrier
que les événements n'auraient pas pris au dépourvu aurait su défendre
ces positions-clés acquises sans coup férir, et partir de ces provocations
du pouvoir pour faire accepter progressivement par les masses l'idée d'un
armement défensif des piquets de grève. La « peur de la guerre civile »
aurait été remplacée par la volonté d'auto-défense.
9. On admirera la valeur de cet argument. Sans doute le genre de
« révolution pacifique » qu'attend la direction du P.C.F. c'est une révolu-
tion où, dès le départ, « les forces militaires et répressives » se seraient
évaporées comme par enchantement, ou... se seraient trouvées du côté
du peuple. On attend avec impatience la révélation par Waldeck-Rochet
de cette transsubstantiation miraculeuse d'une armée bourgeoise et
d'une force de répression en néant ou en « arme du peuple », sans lutte
préalable, par des moyens nécessairement révolutionnaires, pour la désin-
tégration de cette armée. Cf. Lénine : « II est impossible, paraît-il, de
« révolution pacifique » qu'attend la direction du P.C.F. c'est une révolu-
tion où, dès le départ, « les forces militaires et répressives » se seraient
évaporées comme par enchantement, ou... se seraient trouvées du côté
du peuple. On attend avec impatience la révélation par Waldeck-Rochet
de cette transsubstantiation miraculeuse d'une armée bourgeoise et
d'une force de répression en néant ou en « arme du peuple », sans lutte
préalable, par des moyens nécessairement révolutionnaires, pour la désin-
tégration de cette armée. Cf. Lénine : « II est impossible, paraît-il, de
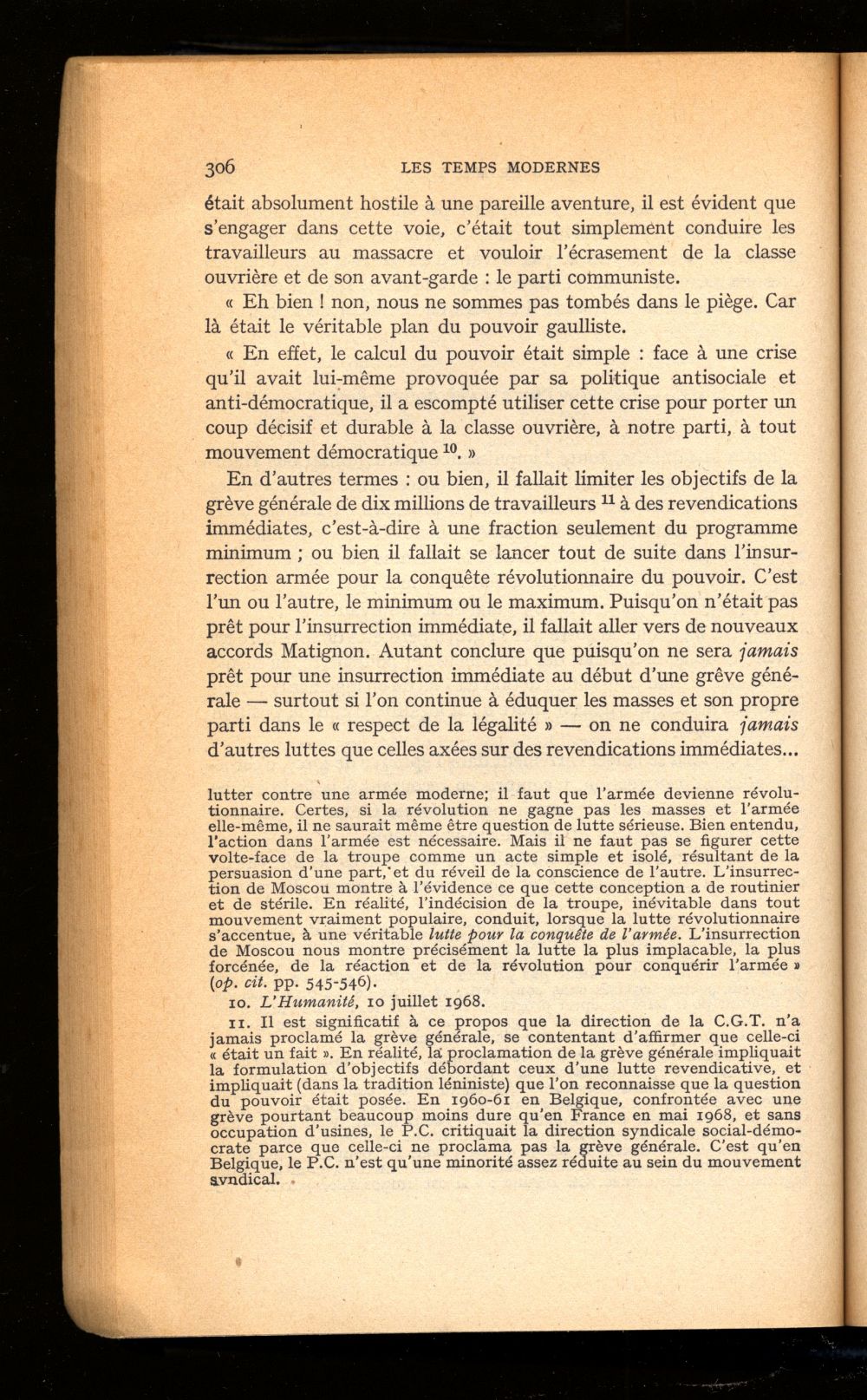

306
LES TEMPS MODERNES
était absolument hostile à une pareille aventure, il est évident que
s'engager dans cette voie, c'était tout simplement conduire les
travailleurs au massacre et vouloir l'écrasement de la classe
ouvrière et de son avant-garde : le parti communiste.
s'engager dans cette voie, c'était tout simplement conduire les
travailleurs au massacre et vouloir l'écrasement de la classe
ouvrière et de son avant-garde : le parti communiste.
« Eh bien ! non, nous ne sommes pas tombés dans le piège. Car
là était le véritable plan du pouvoir gaulliste.
là était le véritable plan du pouvoir gaulliste.
« En effet, le calcul du pouvoir était simple : face à une crise
qu'il avait lui-même provoquée par sa politique antisociale et
anti-démocratique, il a escompté utiliser cette crise pour porter un
coup décisif et durable à la classe ouvrière, à notre parti, à tout
mouvement démocratique10. »
qu'il avait lui-même provoquée par sa politique antisociale et
anti-démocratique, il a escompté utiliser cette crise pour porter un
coup décisif et durable à la classe ouvrière, à notre parti, à tout
mouvement démocratique10. »
En d'autres termes : ou bien, il fallait limiter les objectifs de la
grève générale de dix millions de travailleurs u à des revendications
immédiates, c'est-à-dire à une fraction seulement du programme
minimum ; ou bien il fallait se lancer tout de suite dans l'insur-
rection armée pour la conquête révolutionnaire du pouvoir. C'est
l'un ou l'autre, le minimum ou le maximum. Puisqu'on n'était pas
prêt pour l'insurrection immédiate, il fallait aller vers de nouveaux
accords Matignon. Autant conclure que puisqu'on ne sera jamais
prêt pour une insurrection immédiate au début d'une grève géné-
rale —• surtout si l'on continue à éduquer les masses et son propre
parti dans le « respect de la légalité » — on ne conduira jamais
d'autres luttes que celles axées sur des revendications immédiates...
grève générale de dix millions de travailleurs u à des revendications
immédiates, c'est-à-dire à une fraction seulement du programme
minimum ; ou bien il fallait se lancer tout de suite dans l'insur-
rection armée pour la conquête révolutionnaire du pouvoir. C'est
l'un ou l'autre, le minimum ou le maximum. Puisqu'on n'était pas
prêt pour l'insurrection immédiate, il fallait aller vers de nouveaux
accords Matignon. Autant conclure que puisqu'on ne sera jamais
prêt pour une insurrection immédiate au début d'une grève géné-
rale —• surtout si l'on continue à éduquer les masses et son propre
parti dans le « respect de la légalité » — on ne conduira jamais
d'autres luttes que celles axées sur des revendications immédiates...
lutter contre une armée moderne; il faut que l'armée devienne révolu-
tionnaire. Certes, si la révolution ne gagne pas les masses et l'armée
elle-même, il ne saurait même être question de lutte sérieuse. Bien entendu,
l'action dans l'armée est nécessaire. Mais il ne faut pas se figurer cette
volte-face de la troupe comme un acte simple et isolé, résultant de la
persuasion d'une part,"et du réveil de la conscience de l'autre. L'insurrec-
tion de Moscou montre à l'évidence ce que cette conception a de routinier
et de stérile. En réalité, l'indécision de la troupe, inévitable dans tout
mouvement vraiment populaire, conduit, lorsque la lutte révolutionnaire
s'accentue, à une véritable lutte pour la conquête de l'armée. L'insurrection
de Moscou nous montre précisément la lutte la plus implacable, la plus
forcenée, de la réaction et de la révolution pour conquérir l'armée »
(op. cit. pp. 545-546)-
tionnaire. Certes, si la révolution ne gagne pas les masses et l'armée
elle-même, il ne saurait même être question de lutte sérieuse. Bien entendu,
l'action dans l'armée est nécessaire. Mais il ne faut pas se figurer cette
volte-face de la troupe comme un acte simple et isolé, résultant de la
persuasion d'une part,"et du réveil de la conscience de l'autre. L'insurrec-
tion de Moscou montre à l'évidence ce que cette conception a de routinier
et de stérile. En réalité, l'indécision de la troupe, inévitable dans tout
mouvement vraiment populaire, conduit, lorsque la lutte révolutionnaire
s'accentue, à une véritable lutte pour la conquête de l'armée. L'insurrection
de Moscou nous montre précisément la lutte la plus implacable, la plus
forcenée, de la réaction et de la révolution pour conquérir l'armée »
(op. cit. pp. 545-546)-
ïo. L'Humanité, 10 juillet 1968.
il. Il est significatif à ce propos que la direction de la C.G.T. n'a
jamais proclamé la grève générale, se contentant d'affirmer que celle-ci
« était un fait ». En réalité, la' proclamation de la grève générale impliquait
la formulation d'objectifs débordant ceux d'une lutte revendicative, et
impliquait (dans la tradition léniniste) que l'on reconnaisse que la question
du pouvoir était posée. En 1960-61 en Belgique, confrontée avec une
grève pourtant beaucoup moins dure qu'en France en mai 1968, et sans
occupation d'usines, le P.C. critiquait la direction syndicale social-démo-
crate parce que celle-ci ne proclama, pas la grève générale. C'est qu'eu
Belgique, le P.C. n'est qu'une minorité assez réduite au sein du mouvement
avndical.
jamais proclamé la grève générale, se contentant d'affirmer que celle-ci
« était un fait ». En réalité, la' proclamation de la grève générale impliquait
la formulation d'objectifs débordant ceux d'une lutte revendicative, et
impliquait (dans la tradition léniniste) que l'on reconnaisse que la question
du pouvoir était posée. En 1960-61 en Belgique, confrontée avec une
grève pourtant beaucoup moins dure qu'en France en mai 1968, et sans
occupation d'usines, le P.C. critiquait la direction syndicale social-démo-
crate parce que celle-ci ne proclama, pas la grève générale. C'est qu'eu
Belgique, le P.C. n'est qu'une minorité assez réduite au sein du mouvement
avndical.
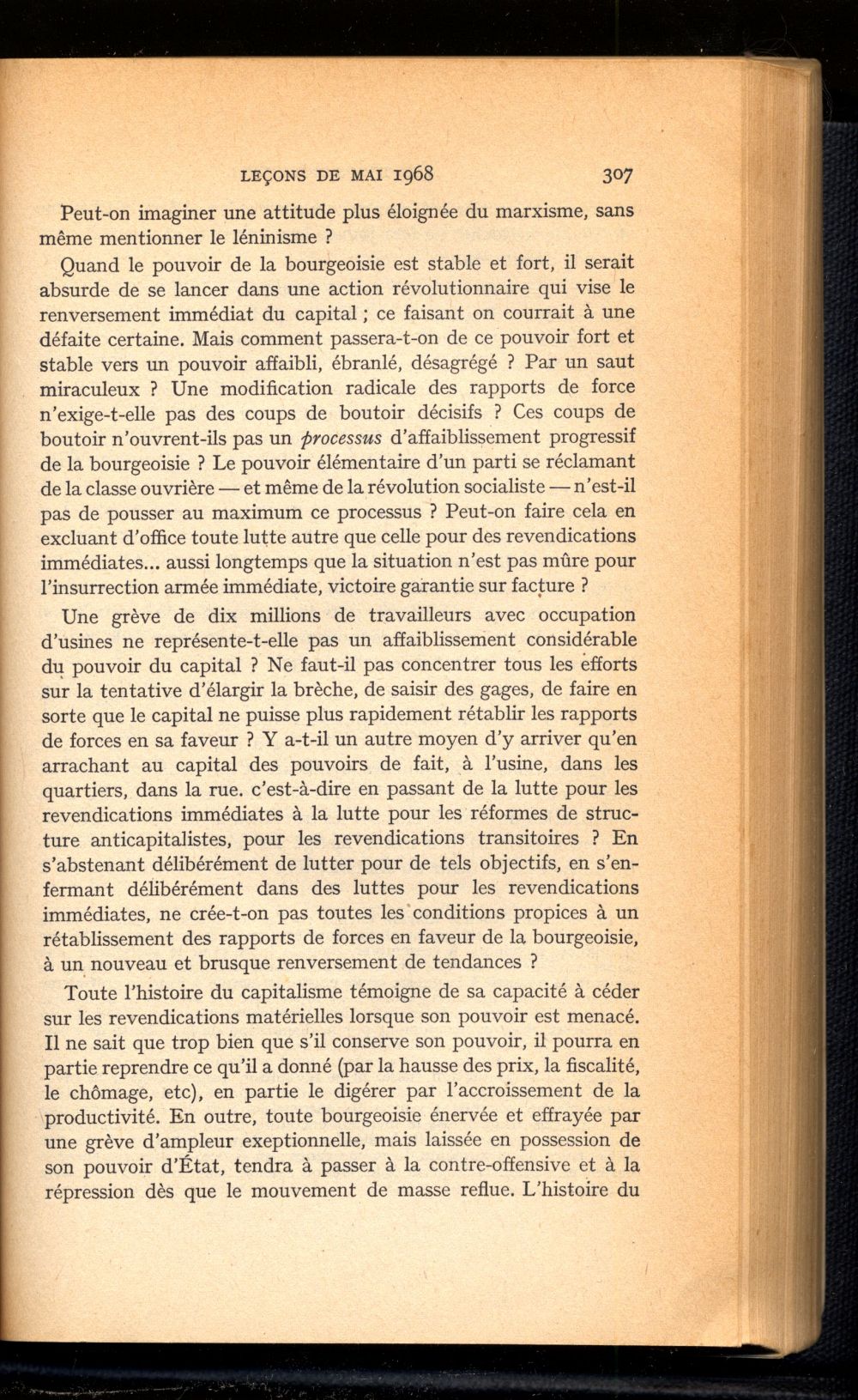

LEÇONS DE MAI IQÔ8
307
Peut-on imaginer une attitude plus éloignée du marxisme, sans
même mentionner le léninisme ?
même mentionner le léninisme ?
Quand le pouvoir de la bourgeoisie est stable et fort, il serait
absurde de se lancer dans une action révolutionnaire qui vise le
renversement immédiat du capital ; ce faisant on courrait à une
défaite certaine. Mais comment passera-t-on de ce pouvoir fort et
stable vers un pouvoir affaibli, ébranlé, désagrégé ? Par un saut
miraculeux ? Une modification radicale des rapports de force
n'exige-t-elle pas des coups de boutoir décisifs ? Ces coups de
boutoir n'ouvrent-ils pas un processus d'affaiblissement progressif
de la bourgeoisie ? Le pouvoir élémentaire d'un parti se réclamant
de la classe ouvrière •— et même de la révolution socialiste — n'est-il
pas de pousser au maximum ce processus ? Peut-on faire cela en
excluant d'office toute lutte autre que celle pour des revendications
immédiates... aussi longtemps que la situation n'est pas mûre pour
l'insurrection armée immédiate, victoire garantie sur facture ?
absurde de se lancer dans une action révolutionnaire qui vise le
renversement immédiat du capital ; ce faisant on courrait à une
défaite certaine. Mais comment passera-t-on de ce pouvoir fort et
stable vers un pouvoir affaibli, ébranlé, désagrégé ? Par un saut
miraculeux ? Une modification radicale des rapports de force
n'exige-t-elle pas des coups de boutoir décisifs ? Ces coups de
boutoir n'ouvrent-ils pas un processus d'affaiblissement progressif
de la bourgeoisie ? Le pouvoir élémentaire d'un parti se réclamant
de la classe ouvrière •— et même de la révolution socialiste — n'est-il
pas de pousser au maximum ce processus ? Peut-on faire cela en
excluant d'office toute lutte autre que celle pour des revendications
immédiates... aussi longtemps que la situation n'est pas mûre pour
l'insurrection armée immédiate, victoire garantie sur facture ?
Une grève de dix millions de travailleurs avec occupation
d'usines ne représente-t-elle pas un affaiblissement considérable
du pouvoir du capital ? Ne faut-il pas concentrer tous les efforts
sur la tentative d'élargir la brèche, de saisir des gages, de faire en
sorte que le capital ne puisse plus rapidement rétablir les rapports
de forces en sa faveur ? Y a-t-il un autre moyen d'y arriver qu'en
arrachant au capital des pouvoirs de fait, à l'usine, dans les
quartiers, dans la rue. c'est-à-dire en passant de la lutte pour les
revendications immédiates à la lutte pour les réformes de struc-
ture anticapitalistes, pour les revendications transitoires ? En
s'abstenant délibérément de lutter pour de tels objectifs, en s'en-
fermant délibérément dans des luttes pour les revendications
immédiates, ne crée-t-on pas toutes les conditions propices à un
rétablissement des rapports de forces en faveur de la bourgeoisie,
à un nouveau et brusque renversement de tendances ?
d'usines ne représente-t-elle pas un affaiblissement considérable
du pouvoir du capital ? Ne faut-il pas concentrer tous les efforts
sur la tentative d'élargir la brèche, de saisir des gages, de faire en
sorte que le capital ne puisse plus rapidement rétablir les rapports
de forces en sa faveur ? Y a-t-il un autre moyen d'y arriver qu'en
arrachant au capital des pouvoirs de fait, à l'usine, dans les
quartiers, dans la rue. c'est-à-dire en passant de la lutte pour les
revendications immédiates à la lutte pour les réformes de struc-
ture anticapitalistes, pour les revendications transitoires ? En
s'abstenant délibérément de lutter pour de tels objectifs, en s'en-
fermant délibérément dans des luttes pour les revendications
immédiates, ne crée-t-on pas toutes les conditions propices à un
rétablissement des rapports de forces en faveur de la bourgeoisie,
à un nouveau et brusque renversement de tendances ?
Toute l'histoire du capitalisme témoigne de sa capacité à céder
sur les revendications matérielles lorsque son pouvoir est menacé.
Il ne sait que trop bien que s'il conserve son pouvoir, il pourra en
partie reprendre ce qu'il a donné (par la hausse des prix, la fiscalité,
le chômage, etc), en partie le digérer par l'accroissement de la
productivité. En outre, toute bourgeoisie énervée et effrayée par
une grève d'ampleur exeptionnelle, mais laissée en possession de
son pouvoir d'État, tendra à passer à la contre-offensive et à la
répression dès que le mouvement de masse reflue. L'histoire du
sur les revendications matérielles lorsque son pouvoir est menacé.
Il ne sait que trop bien que s'il conserve son pouvoir, il pourra en
partie reprendre ce qu'il a donné (par la hausse des prix, la fiscalité,
le chômage, etc), en partie le digérer par l'accroissement de la
productivité. En outre, toute bourgeoisie énervée et effrayée par
une grève d'ampleur exeptionnelle, mais laissée en possession de
son pouvoir d'État, tendra à passer à la contre-offensive et à la
répression dès que le mouvement de masse reflue. L'histoire du
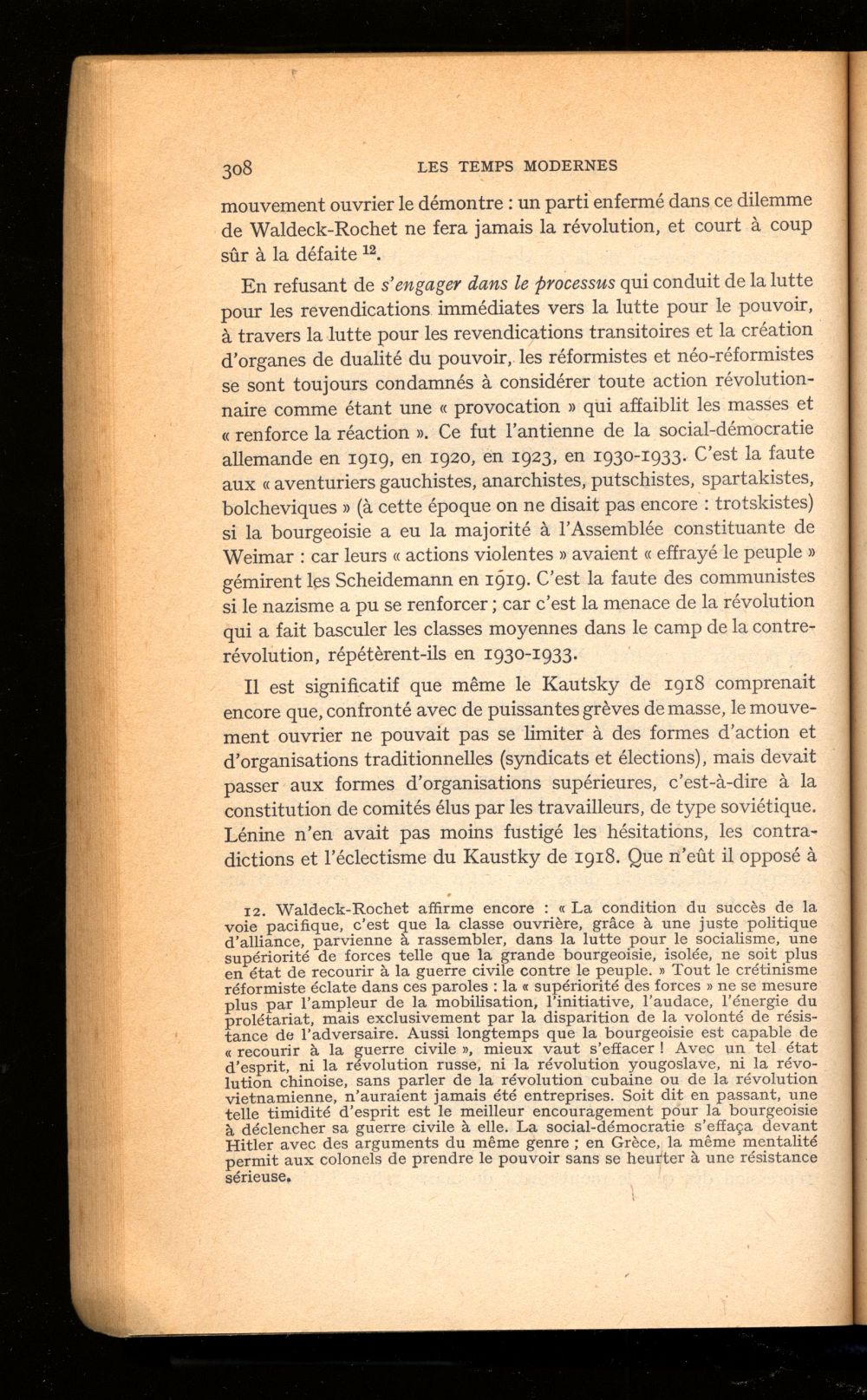

3o8
LES TEMPS MODERNES
mouvement ouvrier le démontre : un parti enfermé dans ce dilemme
de Waldeck-Rochet ne fera jamais la révolution, et court à coup
sûr à la défaite 12.
de Waldeck-Rochet ne fera jamais la révolution, et court à coup
sûr à la défaite 12.
En refusant de s'engager dans le processus qui conduit de la lutte
pour les revendications immédiates vers la lutte pour le pouvoir,
à travers la lutte pour les revendications transitoires et la création
d'organes de dualité du pouvoir, les réformistes et néo-réformistes
se sont toujours condamnés à considérer toute action révolution-
naire comme étant une « provocation » qui affaiblit les masses et
« renforce la réaction ». Ce fut l'antienne de la social-démocratie
allemande en 1919, en 1920, en 1923, en 1930-1933. C'est la faute
aux « aventuriers gauchistes, anarchistes, putschistes, spartakistes,
bolcheviques » (à cette époque on ne disait pas encore : trotskistes)
si la bourgeoisie a eu la majorité à l'Assemblée constituante de
Weimar : car leurs « actions violentes » avaient « effrayé le peuple »
gémirent les Scheidemann en 1919. C'est la faute des communistes
si le nazisme a pu se renforcer ; car c'est la menace de la révolution
qui a fait basculer les classes moyennes dans le camp de la contre-
révolution, répétèrent-ils en 1930-1933.
pour les revendications immédiates vers la lutte pour le pouvoir,
à travers la lutte pour les revendications transitoires et la création
d'organes de dualité du pouvoir, les réformistes et néo-réformistes
se sont toujours condamnés à considérer toute action révolution-
naire comme étant une « provocation » qui affaiblit les masses et
« renforce la réaction ». Ce fut l'antienne de la social-démocratie
allemande en 1919, en 1920, en 1923, en 1930-1933. C'est la faute
aux « aventuriers gauchistes, anarchistes, putschistes, spartakistes,
bolcheviques » (à cette époque on ne disait pas encore : trotskistes)
si la bourgeoisie a eu la majorité à l'Assemblée constituante de
Weimar : car leurs « actions violentes » avaient « effrayé le peuple »
gémirent les Scheidemann en 1919. C'est la faute des communistes
si le nazisme a pu se renforcer ; car c'est la menace de la révolution
qui a fait basculer les classes moyennes dans le camp de la contre-
révolution, répétèrent-ils en 1930-1933.
Il est significatif que même le Kautsky de 1918 comprenait
encore que, confronté avec de puissantes grèves de masse, le mouve-
ment ouvrier ne pouvait pas se limiter à des formes d'action et
d'organisations traditionnelles (syndicats et élections), mais devait
passer aux formes d'organisations supérieures, c'est-à-dire à la
constitution de comités élus par les travailleurs, de type soviétique.
Lénine n'en avait pas moins fustigé les hésitations, les contra-
dictions et l'éclectisme du Kaustky de 1918. Que n'eût il opposé à
encore que, confronté avec de puissantes grèves de masse, le mouve-
ment ouvrier ne pouvait pas se limiter à des formes d'action et
d'organisations traditionnelles (syndicats et élections), mais devait
passer aux formes d'organisations supérieures, c'est-à-dire à la
constitution de comités élus par les travailleurs, de type soviétique.
Lénine n'en avait pas moins fustigé les hésitations, les contra-
dictions et l'éclectisme du Kaustky de 1918. Que n'eût il opposé à
12. Waldeck-Rochet affirme encore : « La condition du succès de la
voie pacifique, c'est que la classe ouvrière, grâce à une juste politique
d'alliance, parvienne à rassembler, dans la lutte pour le socialisme, une
supériorité de forces telle que la grande bourgeoisie, isolée, ne soit plus
en état de recourir à la guerre civile contre le peuple. » Tout le crétinisme
réformiste éclate dans ces paroles : la « supériorité des forces » ne se mesure
plus par l'ampleur de la mobilisation, l'initiative, l'audace, l'énergie du
voie pacifique, c'est que la classe ouvrière, grâce à une juste politique
d'alliance, parvienne à rassembler, dans la lutte pour le socialisme, une
supériorité de forces telle que la grande bourgeoisie, isolée, ne soit plus
en état de recourir à la guerre civile contre le peuple. » Tout le crétinisme
réformiste éclate dans ces paroles : la « supériorité des forces » ne se mesure
plus par l'ampleur de la mobilisation, l'initiative, l'audace, l'énergie du
d'esprit, ni la révolution russe, ni la révolution yougoslave, ni la révo-
lution chinoise, sans parler de la révolution cubaine ou de la révolution
vietnamienne, n'auraient jamais été entreprises. Soit dit en passant, une
telle timidité d'esprit est le meilleur encouragement pour la bourgeoisie
à déclencher sa guerre civile à elle. La social-démocratie s'effaça devant
Hitler avec des arguments du même genre ; en Grèce, la même mentalité
permit aux colonels de prendre le pouvoir sans se heurter à une résistance
sérieuse.
lution chinoise, sans parler de la révolution cubaine ou de la révolution
vietnamienne, n'auraient jamais été entreprises. Soit dit en passant, une
telle timidité d'esprit est le meilleur encouragement pour la bourgeoisie
à déclencher sa guerre civile à elle. La social-démocratie s'effaça devant
Hitler avec des arguments du même genre ; en Grèce, la même mentalité
permit aux colonels de prendre le pouvoir sans se heurter à une résistance
sérieuse.
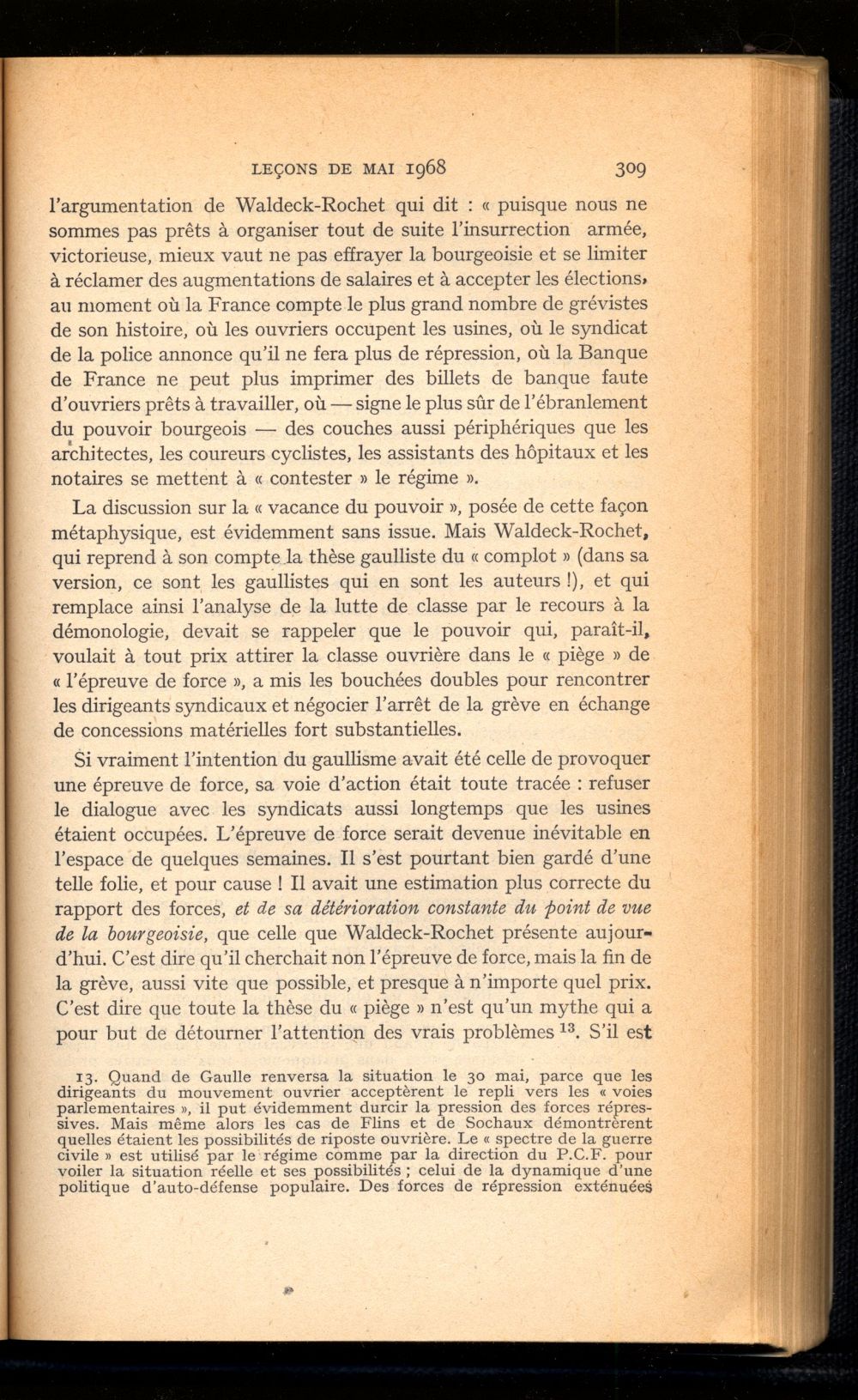

LEÇONS DE MAI I
309
l'argumentation de Waldeck-Rochet qui dit : « puisque nous ne
sommes pas prêts à organiser tout de suite l'insurrection armée,
victorieuse, mieux vaut ne pas effrayer la bourgeoisie et se limiter
à réclamer des augmentations de salaires et à accepter les élections»
au moment où la France compte le plus grand nombre de grévistes
de son histoire, où les ouvriers occupent les usines, où le syndicat
de la police annonce qu'il ne fera plus de répression, où la Banque
de France ne peut plus imprimer des billets de banque faute
d'ouvriers prêts à travailler, où — signe le plus sûr de l'ébranlement
du pouvoir bourgeois — des couches aussi périphériques que les
architectes, les coureurs cyclistes, les assistants des hôpitaux et les
notaires se mettent à « contester » le régime ».
sommes pas prêts à organiser tout de suite l'insurrection armée,
victorieuse, mieux vaut ne pas effrayer la bourgeoisie et se limiter
à réclamer des augmentations de salaires et à accepter les élections»
au moment où la France compte le plus grand nombre de grévistes
de son histoire, où les ouvriers occupent les usines, où le syndicat
de la police annonce qu'il ne fera plus de répression, où la Banque
de France ne peut plus imprimer des billets de banque faute
d'ouvriers prêts à travailler, où — signe le plus sûr de l'ébranlement
du pouvoir bourgeois — des couches aussi périphériques que les
architectes, les coureurs cyclistes, les assistants des hôpitaux et les
notaires se mettent à « contester » le régime ».
La discussion sur la « vacance du pouvoir », posée de cette façon
métaphysique, est évidemment sans issue. Mais Waldeck-Rochet,
qui reprend à son compte la thèse gaulliste du « complot » (dans sa
version, ce sont les gaullistes qui en sont les auteurs !), et qui
remplace ainsi l'analyse de la lutte de classe par le recours à la
démonologie, devait se rappeler que le pouvoir qui, paraît-il,
voulait à tout prix attirer la classe ouvrière dans le « piège » de
« l'épreuve de force », a mis les bouchées doubles pour rencontrer
les dirigeants syndicaux et négocier l'arrêt de la grève en échange
de concessions matérielles fort substantielles.
métaphysique, est évidemment sans issue. Mais Waldeck-Rochet,
qui reprend à son compte la thèse gaulliste du « complot » (dans sa
version, ce sont les gaullistes qui en sont les auteurs !), et qui
remplace ainsi l'analyse de la lutte de classe par le recours à la
démonologie, devait se rappeler que le pouvoir qui, paraît-il,
voulait à tout prix attirer la classe ouvrière dans le « piège » de
« l'épreuve de force », a mis les bouchées doubles pour rencontrer
les dirigeants syndicaux et négocier l'arrêt de la grève en échange
de concessions matérielles fort substantielles.
Si vraiment l'intention du gaullisme avait été celle de provoquer
une épreuve de force, sa voie d'action était toute tracée : refuser
le dialogue avec les syndicats aussi longtemps que les usines
étaient occupées. L'épreuve de force serait devenue inévitable en
l'espace de quelques semaines. Il s'est pourtant bien gardé d'une
telle folie, et pour cause ! Il avait une estimation plus correcte du
rapport des forces, et de sa détérioration constante du point de vue
de la bourgeoisie, que celle que Waldeck-Rochet présente aujour-
d'hui. C'est dire qu'il cherchait non l'épreuve de force, mais la fin de
la grève, aussi vite que possible, et presque à n'importe quel prix.
C'est dire que toute la thèse du « piège » n'est qu'un mythe qui a
pour but de détourner l'attention des vrais problèmes 13. S'il est
une épreuve de force, sa voie d'action était toute tracée : refuser
le dialogue avec les syndicats aussi longtemps que les usines
étaient occupées. L'épreuve de force serait devenue inévitable en
l'espace de quelques semaines. Il s'est pourtant bien gardé d'une
telle folie, et pour cause ! Il avait une estimation plus correcte du
rapport des forces, et de sa détérioration constante du point de vue
de la bourgeoisie, que celle que Waldeck-Rochet présente aujour-
d'hui. C'est dire qu'il cherchait non l'épreuve de force, mais la fin de
la grève, aussi vite que possible, et presque à n'importe quel prix.
C'est dire que toute la thèse du « piège » n'est qu'un mythe qui a
pour but de détourner l'attention des vrais problèmes 13. S'il est
13. Quand de Gaulle renversa la situation le 30 mai, parce que les
dirigeants du mouvement ouvrier acceptèrent le repli vers les « voies
parlementaires », il put évidemment durcir la pression des forces répres-
sives. Mais même alors les cas de Flins et de Sochaux démontrèrent
quelles étaient les possibilités de riposte ouvrière. Le « spectre de la guerre
civile » est utilisé par le régime comme par la direction du P.C.F. pour
voiler la situation réelle et ses possibilités ; celui de la dynamique d'une
politique d'auto-défcnse populaire. Des forces de répression exténuées
dirigeants du mouvement ouvrier acceptèrent le repli vers les « voies
parlementaires », il put évidemment durcir la pression des forces répres-
sives. Mais même alors les cas de Flins et de Sochaux démontrèrent
quelles étaient les possibilités de riposte ouvrière. Le « spectre de la guerre
civile » est utilisé par le régime comme par la direction du P.C.F. pour
voiler la situation réelle et ses possibilités ; celui de la dynamique d'une
politique d'auto-défcnse populaire. Des forces de répression exténuées
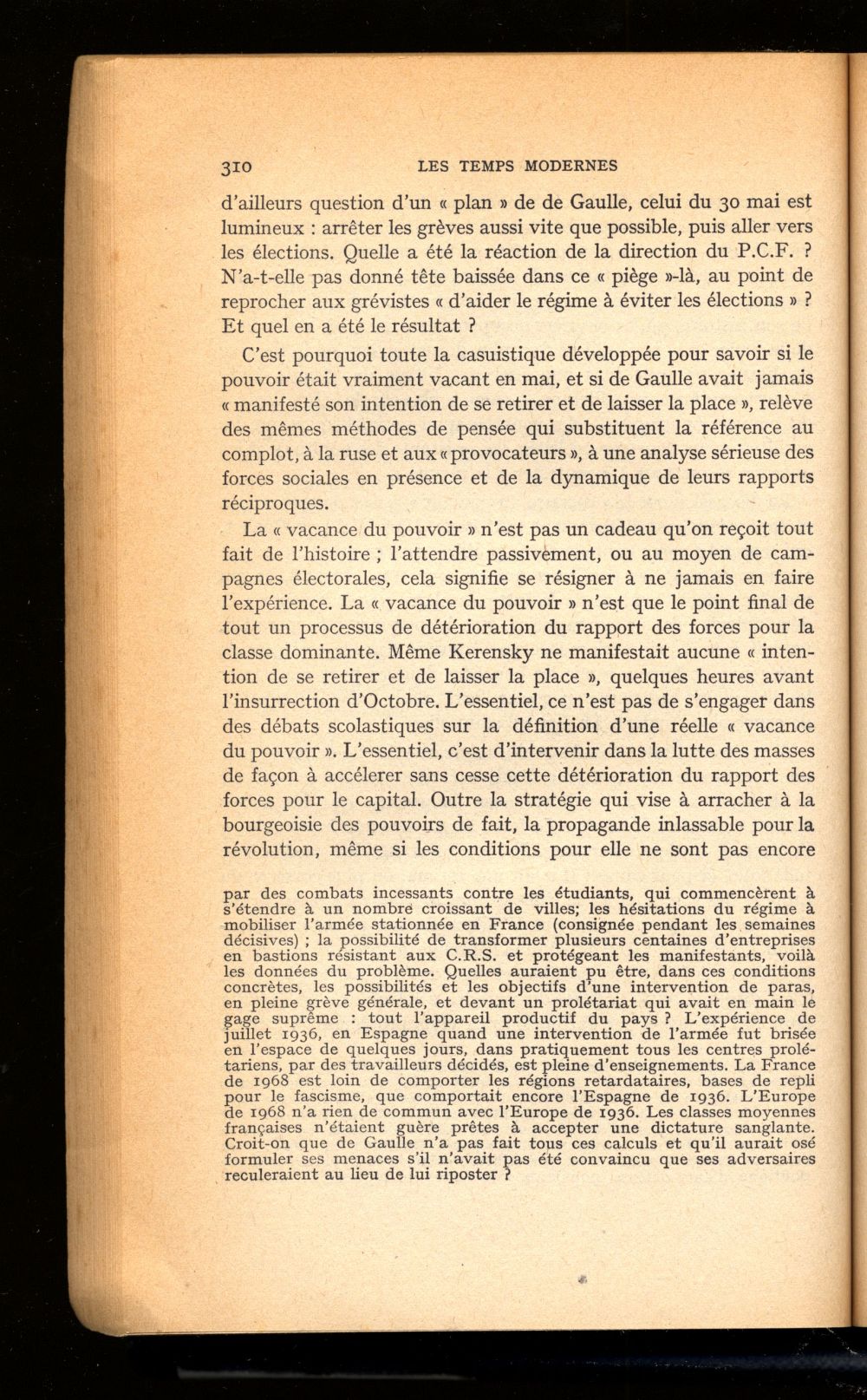

310
LES TEMPS MODERNES
d'ailleurs question d'un « plan » de de Gaulle, celui du 30 mai est
lumineux : arrêter les grèves aussi vite que possible, puis aller vers
les élections. Quelle a été la réaction de la direction du P.C.F. ?
N'a-t-elle pas donné tête baissée dans ce « piège »-là, au point de
reprocher aux grévistes « d'aider le régime à éviter les élections » ?
Et quel en a été le résultat ?
lumineux : arrêter les grèves aussi vite que possible, puis aller vers
les élections. Quelle a été la réaction de la direction du P.C.F. ?
N'a-t-elle pas donné tête baissée dans ce « piège »-là, au point de
reprocher aux grévistes « d'aider le régime à éviter les élections » ?
Et quel en a été le résultat ?
C'est pourquoi toute la casuistique développée pour savoir si le
pouvoir était vraiment vacant en mai, et si de Gaulle avait jamais
« manifesté son intention de se retirer et de laisser la place », relève
des mêmes méthodes de pensée qui substituent la référence au
complot, à la ruse et aux « provocateurs », à une analyse sérieuse des
forces sociales en présence et de la dynamique de leurs rapports
réciproques.
pouvoir était vraiment vacant en mai, et si de Gaulle avait jamais
« manifesté son intention de se retirer et de laisser la place », relève
des mêmes méthodes de pensée qui substituent la référence au
complot, à la ruse et aux « provocateurs », à une analyse sérieuse des
forces sociales en présence et de la dynamique de leurs rapports
réciproques.
La « vacance du pouvoir » n'est pas un cadeau qu'on reçoit tout
fait de l'histoire ; l'attendre passivement, ou au moyen de cam-
pagnes électorales, cela signifie se résigner à ne jamais en faire
l'expérience. La « vacance du pouvoir » n'est que le point final de
tout un processus de détérioration du rapport des forces pour la
classe dominante. Même Kerensky ne manifestait aucune « inten-
tion de se retirer et de laisser la place », quelques heures avant
l'insurrection d'Octobre. L'essentiel, ce n'est pas de s'engager dans
des débats scolastiques sur la définition d'une réelle « vacance
du pouvoir ». L'essentiel, c'est d'intervenir dans la lutte des masses
de façon à accélérer sans cesse cette détérioration du rapport des
forces pour le capital. Outre la stratégie qui vise à arracher à la
bourgeoisie des pouvoirs de fait, la propagande inlassable pour la
révolution, même si les conditions pour elle ne sont pas encore
fait de l'histoire ; l'attendre passivement, ou au moyen de cam-
pagnes électorales, cela signifie se résigner à ne jamais en faire
l'expérience. La « vacance du pouvoir » n'est que le point final de
tout un processus de détérioration du rapport des forces pour la
classe dominante. Même Kerensky ne manifestait aucune « inten-
tion de se retirer et de laisser la place », quelques heures avant
l'insurrection d'Octobre. L'essentiel, ce n'est pas de s'engager dans
des débats scolastiques sur la définition d'une réelle « vacance
du pouvoir ». L'essentiel, c'est d'intervenir dans la lutte des masses
de façon à accélérer sans cesse cette détérioration du rapport des
forces pour le capital. Outre la stratégie qui vise à arracher à la
bourgeoisie des pouvoirs de fait, la propagande inlassable pour la
révolution, même si les conditions pour elle ne sont pas encore
par des combats incessants contre les étudiants, qui commencèrent à
s'étendre à un nombre croissant de villes; les hésitations du régime à
mobiliser l'armée stationnée en France (consignée pendant les semaines
décisives) ; la possibilité de transformer plusieurs centaines d'entreprises
en bastions résistant aux C.R.S. et protégeant les manifestants, voilà
les données du problème. Quelles auraient pu être, dans ces conditions
concrètes, les possibilités et les objectifs d'une intervention de paras,
en pleine grève générale, et devant un prolétariat qui avait en main le
gage suprême : tout l'appareil productif du pays ? L'expérience de
juillet 1936, en Espagne quand une intervention de l'armée fut brisée
en l'espace de quelques jours, dans pratiquement tous les centres prolé-
tariens, par des travailleurs décidés, est pleine d'enseignements. La France
de 1968 est loin de comporter les régions retardataires, bases de repli
pour le fascisme, que comportait encore l'Espagne de 1936. L'Europe
de 1968 n'a rien de commun avec l'Europe de 1936. Les classes moyennes
françaises n'étaient guère prêtes à accepter une dictature sanglante.
Croit-on que de Gaulle n'a pas fait tous ces calculs et qu'il aurait osé
formuler ses menaces s'il n'avait pas été convaincu que ses adversaires
reculeraient au lieu de lui riposter ?
s'étendre à un nombre croissant de villes; les hésitations du régime à
mobiliser l'armée stationnée en France (consignée pendant les semaines
décisives) ; la possibilité de transformer plusieurs centaines d'entreprises
en bastions résistant aux C.R.S. et protégeant les manifestants, voilà
les données du problème. Quelles auraient pu être, dans ces conditions
concrètes, les possibilités et les objectifs d'une intervention de paras,
en pleine grève générale, et devant un prolétariat qui avait en main le
gage suprême : tout l'appareil productif du pays ? L'expérience de
juillet 1936, en Espagne quand une intervention de l'armée fut brisée
en l'espace de quelques jours, dans pratiquement tous les centres prolé-
tariens, par des travailleurs décidés, est pleine d'enseignements. La France
de 1968 est loin de comporter les régions retardataires, bases de repli
pour le fascisme, que comportait encore l'Espagne de 1936. L'Europe
de 1968 n'a rien de commun avec l'Europe de 1936. Les classes moyennes
françaises n'étaient guère prêtes à accepter une dictature sanglante.
Croit-on que de Gaulle n'a pas fait tous ces calculs et qu'il aurait osé
formuler ses menaces s'il n'avait pas été convaincu que ses adversaires
reculeraient au lieu de lui riposter ?
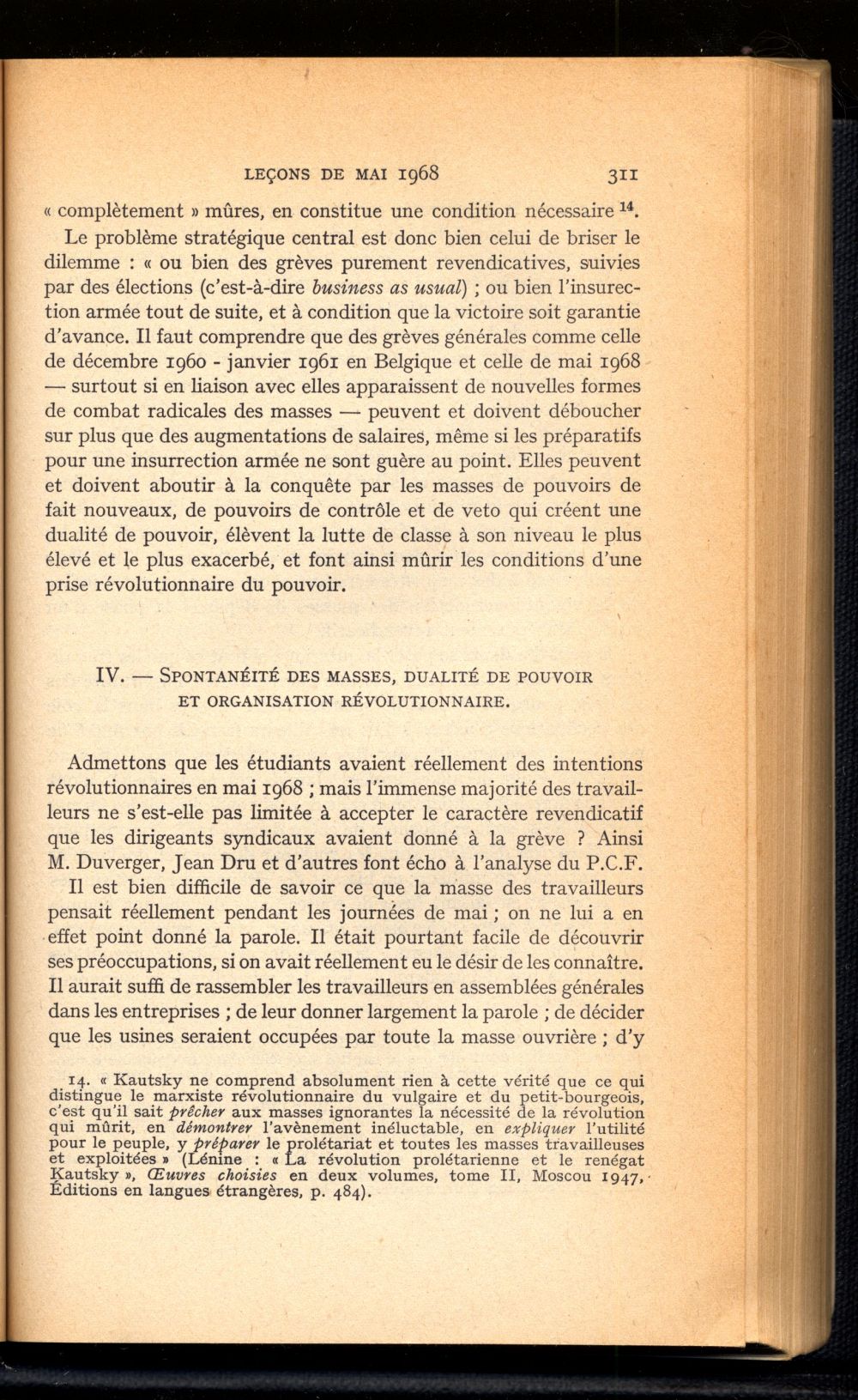

LEÇONS DE MAI 1968 311
« complètement » mûres, en constitue une condition nécessaire 14.
Le problème stratégique central est donc bien celui de briser le
dilemme : « ou bien des grèves purement revendicatives, suivies
par des élections (c'est-à-dire business as usual) ; ou bien l'insurec-
tion armée tout de suite, et à condition que la victoire soit garantie
d'avance. Il faut comprendre que des grèves générales comme celle
de décembre 1960 - janvier 1961 en Belgique et celle de mai 1968
—• surtout si en liaison avec elles apparaissent de nouvelles formes
de combat radicales des masses — peuvent et doivent déboucher
sur plus que des augmentations de salaires, même si les préparatifs
pour une insurrection armée ne sont guère au point. Elles peuvent
et doivent aboutir à la conquête par les masses de pouvoirs de
fait nouveaux, de pouvoirs de contrôle et de veto qui créent une
dualité de pouvoir, élèvent la lutte de classe à son niveau le plus
élevé et le plus exacerbé, et font ainsi mûrir les conditions d'une
prise révolutionnaire du pouvoir.
Le problème stratégique central est donc bien celui de briser le
dilemme : « ou bien des grèves purement revendicatives, suivies
par des élections (c'est-à-dire business as usual) ; ou bien l'insurec-
tion armée tout de suite, et à condition que la victoire soit garantie
d'avance. Il faut comprendre que des grèves générales comme celle
de décembre 1960 - janvier 1961 en Belgique et celle de mai 1968
—• surtout si en liaison avec elles apparaissent de nouvelles formes
de combat radicales des masses — peuvent et doivent déboucher
sur plus que des augmentations de salaires, même si les préparatifs
pour une insurrection armée ne sont guère au point. Elles peuvent
et doivent aboutir à la conquête par les masses de pouvoirs de
fait nouveaux, de pouvoirs de contrôle et de veto qui créent une
dualité de pouvoir, élèvent la lutte de classe à son niveau le plus
élevé et le plus exacerbé, et font ainsi mûrir les conditions d'une
prise révolutionnaire du pouvoir.
IV. — SPONTANÉITÉ DES MASSES, DUALITÉ DE POUVOIR
ET ORGANISATION RÉVOLUTIONNAIRE.
Admettons que les étudiants avaient réellement des intentions
révolutionnaires en mai 1968 ; mais l'immense majorité des travail-
leurs ne s'est-elle pas limitée à accepter le caractère revendicatif
que les dirigeants syndicaux avaient donné à la grève ? Ainsi
M. Duverger, Jean Dru et d'autres font écho à l'analyse du P.C.F.
révolutionnaires en mai 1968 ; mais l'immense majorité des travail-
leurs ne s'est-elle pas limitée à accepter le caractère revendicatif
que les dirigeants syndicaux avaient donné à la grève ? Ainsi
M. Duverger, Jean Dru et d'autres font écho à l'analyse du P.C.F.
Il est bien difficile de savoir ce que la masse des travailleurs
pensait réellement pendant les journées de mai ; on ne lui a en
effet point donné la parole. Il était pourtant facile de découvrir
ses préoccupations, si on avait réellement eu le désir de les connaître.
Il aurait suffi de rassembler les travailleurs en assemblées générales
dans les entreprises ; de leur donner largement la parole ; de décider
que les usines seraient occupées par toute la masse ouvrière ; d'y
pensait réellement pendant les journées de mai ; on ne lui a en
effet point donné la parole. Il était pourtant facile de découvrir
ses préoccupations, si on avait réellement eu le désir de les connaître.
Il aurait suffi de rassembler les travailleurs en assemblées générales
dans les entreprises ; de leur donner largement la parole ; de décider
que les usines seraient occupées par toute la masse ouvrière ; d'y
14. « Kautsky ne comprend absolument rien à cette vérité que ce qui
distingue le marxiste révolutionnaire du vulgaire et du petit-bourgeois,
c'est qu'il sait prêcher aux masses ignorantes la nécessité de la révolution
qui mûrit, en démontrer l'avènement inéluctable, en expliquer l'utilité
pour le peuple, y préparer le prolétariat et toutes les masses travailleuses
et exploitées » (Lénine : <c La révolution prolétarienne et le renégat
Kautsky», Œuvres choisies en deux volumes, tome II, Moscou 1947,-
Éditions en langues étrangères, p. 484).
distingue le marxiste révolutionnaire du vulgaire et du petit-bourgeois,
c'est qu'il sait prêcher aux masses ignorantes la nécessité de la révolution
qui mûrit, en démontrer l'avènement inéluctable, en expliquer l'utilité
pour le peuple, y préparer le prolétariat et toutes les masses travailleuses
et exploitées » (Lénine : <c La révolution prolétarienne et le renégat
Kautsky», Œuvres choisies en deux volumes, tome II, Moscou 1947,-
Éditions en langues étrangères, p. 484).
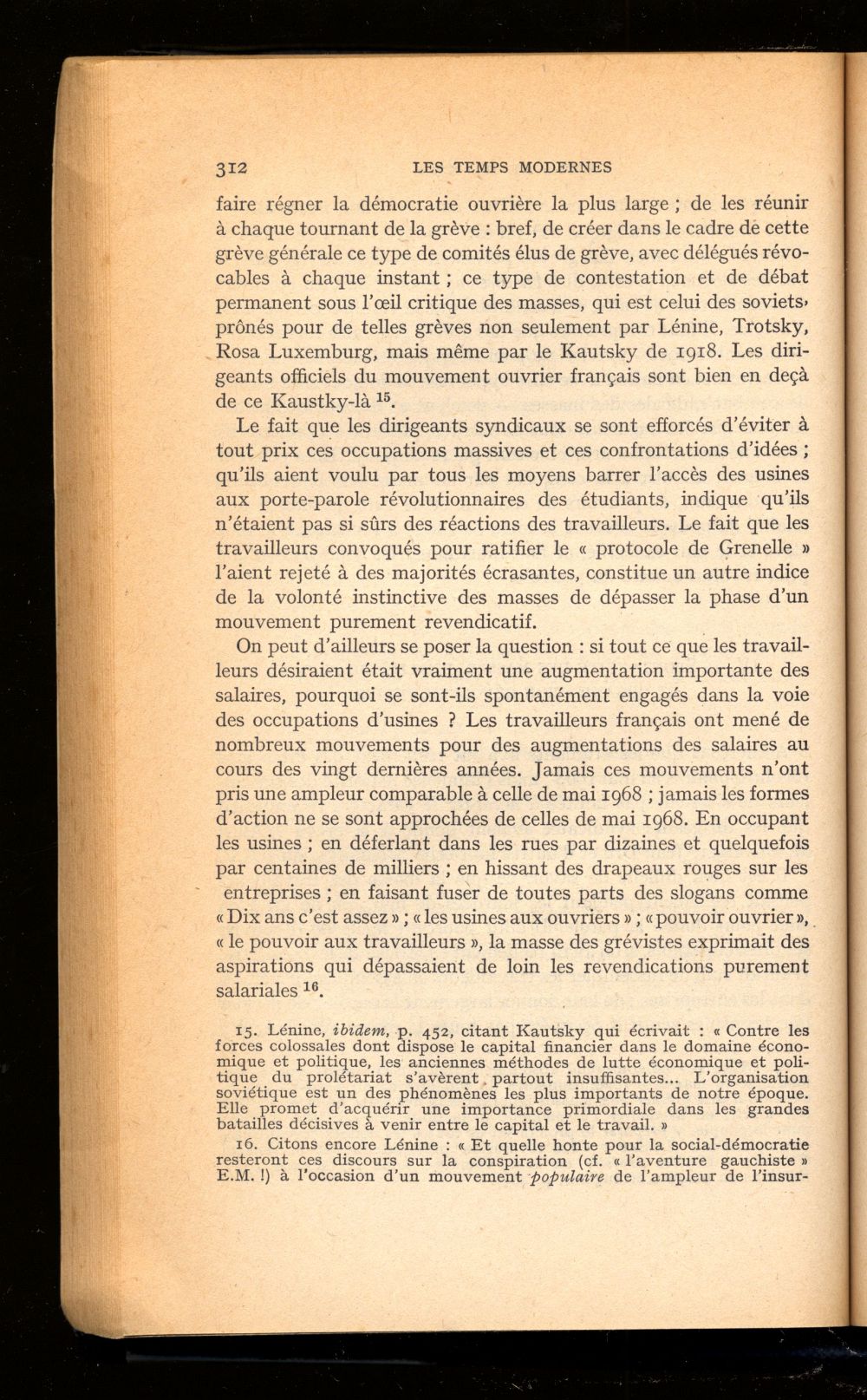

312
LES TEMPS MODERNES
faire régner la démocratie ouvrière la plus large ; de les réunir
à chaque tournant de la grève : bref, de créer dans le cadre de cette
grève générale ce type de comités élus de grève, avec délégués révo-
cables à chaque instant ; ce type de contestation et de débat
permanent sous l'œil critique des masses, qui est celui des soviets»
prônés pour de telles grèves non seulement par Lénine, Trotsky,
Rosa Luxemburg, mais même par le Kautsky de 1918. Les diri-
geants officiels du mouvement ouvrier français sont bien en deçà
de ce Kaustky-là 1S.
à chaque tournant de la grève : bref, de créer dans le cadre de cette
grève générale ce type de comités élus de grève, avec délégués révo-
cables à chaque instant ; ce type de contestation et de débat
permanent sous l'œil critique des masses, qui est celui des soviets»
prônés pour de telles grèves non seulement par Lénine, Trotsky,
Rosa Luxemburg, mais même par le Kautsky de 1918. Les diri-
geants officiels du mouvement ouvrier français sont bien en deçà
de ce Kaustky-là 1S.
Le fait que les dirigeants syndicaux se sont efforcés d'éviter à
tout prix ces occupations massives et ces confrontations d'idées ;
qu'ils aient voulu par tous les moyens barrer l'accès des usines
aux porte-parole révolutionnaires des étudiants, indique qu'ils
n'étaient pas si sûrs des réactions des travailleurs. Le fait que les
travailleurs convoqués pour ratifier le « protocole de Grenelle »
l'aient rejeté à des majorités écrasantes, constitue un autre indice
de la volonté instinctive des masses de dépasser la phase d'un
mouvement purement revendicatif.
tout prix ces occupations massives et ces confrontations d'idées ;
qu'ils aient voulu par tous les moyens barrer l'accès des usines
aux porte-parole révolutionnaires des étudiants, indique qu'ils
n'étaient pas si sûrs des réactions des travailleurs. Le fait que les
travailleurs convoqués pour ratifier le « protocole de Grenelle »
l'aient rejeté à des majorités écrasantes, constitue un autre indice
de la volonté instinctive des masses de dépasser la phase d'un
mouvement purement revendicatif.
On peut d'ailleurs se poser la question : si tout ce que les travail-
leurs désiraient était vraiment une augmentation importante des
salaires, pourquoi se sont-ils spontanément engagés dans la voie
des occupations d'usines ? Les travailleurs français ont mené de
nombreux mouvements pour des augmentations des salaires au
cours des vingt dernières années. Jamais ces mouvements n'ont
pris une ampleur comparable à celle de mai 1968 ; jamais les formes
d'action ne se sont approchées de celles de mai 1968. En occupant
les usines ; en déferlant dans les rues par dizaines et quelquefois
par centaines de milliers ; en hissant des drapeaux rouges sur les
entreprises ; en faisant fuser de toutes parts des slogans comme
« Dix ans c'est assez » ; « les usines aux ouvriers » ; « pouvoir ouvrier »,
« le pouvoir aux travailleurs », la masse des grévistes exprimait des
aspirations qui dépassaient de loin les revendications purement
salariales 16.
leurs désiraient était vraiment une augmentation importante des
salaires, pourquoi se sont-ils spontanément engagés dans la voie
des occupations d'usines ? Les travailleurs français ont mené de
nombreux mouvements pour des augmentations des salaires au
cours des vingt dernières années. Jamais ces mouvements n'ont
pris une ampleur comparable à celle de mai 1968 ; jamais les formes
d'action ne se sont approchées de celles de mai 1968. En occupant
les usines ; en déferlant dans les rues par dizaines et quelquefois
par centaines de milliers ; en hissant des drapeaux rouges sur les
entreprises ; en faisant fuser de toutes parts des slogans comme
« Dix ans c'est assez » ; « les usines aux ouvriers » ; « pouvoir ouvrier »,
« le pouvoir aux travailleurs », la masse des grévistes exprimait des
aspirations qui dépassaient de loin les revendications purement
salariales 16.
15. Lénine, ibidem, p. 452, citant Kautsky qui écrivait : « Contre les
forces colossales dont dispose le capital financier dans le domaine écono-
mique et politique, les anciennes méthodes de lutte économique et poli-
tique du prolétariat s'avèrent . partout insuffisantes... L'organisation
soviétique est un des phénomènes les plus importants de notre époque.
Elle promet d'acquérir une importance primordiale dans les grandes
batailles décisives à venir entre le capital et le travail. »
forces colossales dont dispose le capital financier dans le domaine écono-
mique et politique, les anciennes méthodes de lutte économique et poli-
tique du prolétariat s'avèrent . partout insuffisantes... L'organisation
soviétique est un des phénomènes les plus importants de notre époque.
Elle promet d'acquérir une importance primordiale dans les grandes
batailles décisives à venir entre le capital et le travail. »
16. Citons encore Lénine : « Et quelle honte pour la social-démocratie
resteront ces discours sur la conspiration (cf. « l'aventure gauchiste »
E.M. !) à l'occasion d'un mouvement populaire de l'ampleur de l'insur-
resteront ces discours sur la conspiration (cf. « l'aventure gauchiste »
E.M. !) à l'occasion d'un mouvement populaire de l'ampleur de l'insur-
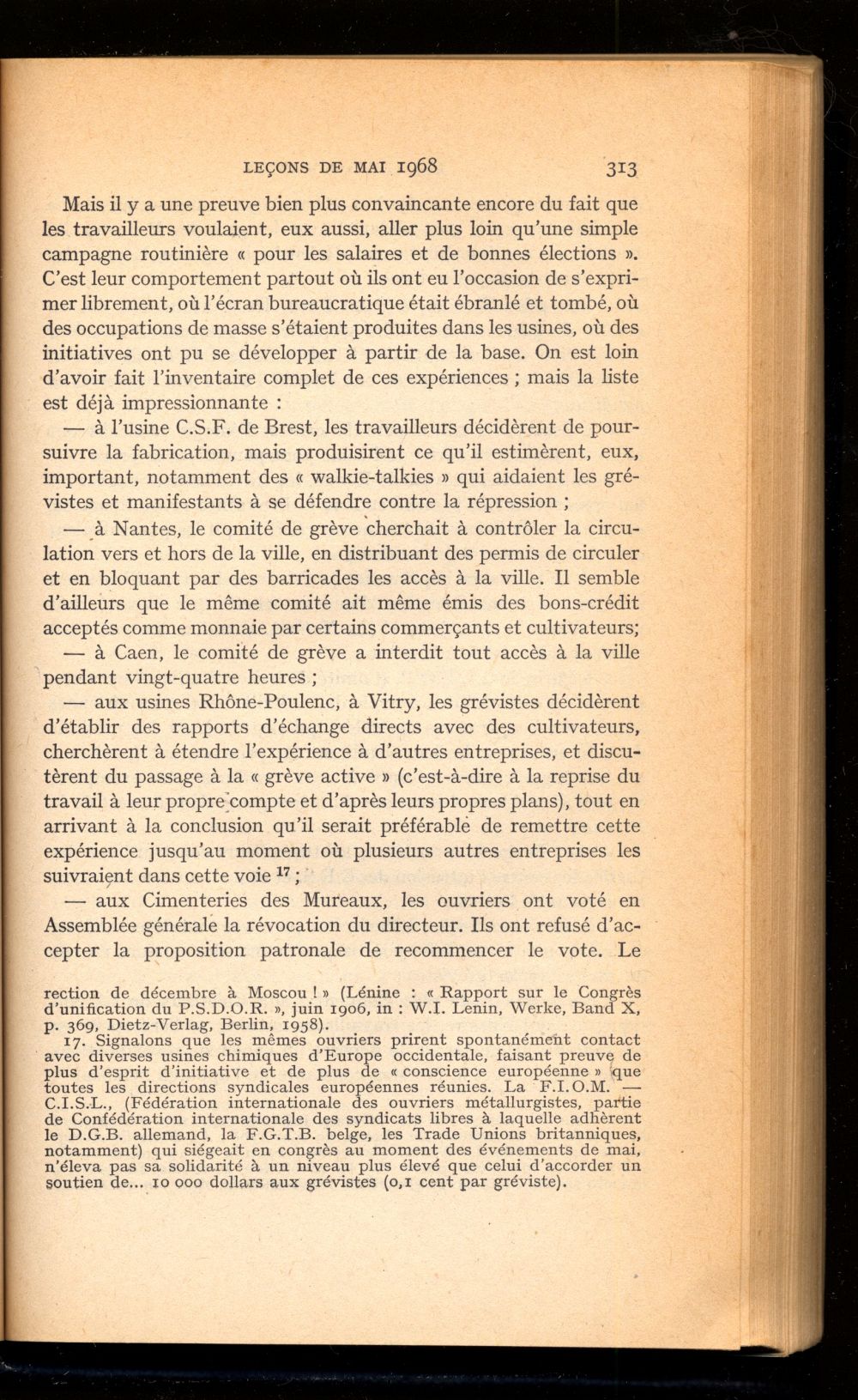

LEÇONS DE MAI IQÔS
313
Mais il y a une preuve bien plus convaincante encore du fait que
les travailleurs voulaient, eux aussi, aller plus loin qu'une simple
campagne routinière « pour les salaires et de bonnes élections ».
C'est leur comportement partout où ils ont eu l'occasion de s'expri-
mer librement, où l'écran bureaucratique était ébranlé et tombé, où
des occupations de masse s'étaient produites dans les usines, où des
initiatives ont pu se développer à partir de la base. On est loin
d'avoir fait l'inventaire complet de ces expériences ; mais la liste
est déjà impressionnante :
les travailleurs voulaient, eux aussi, aller plus loin qu'une simple
campagne routinière « pour les salaires et de bonnes élections ».
C'est leur comportement partout où ils ont eu l'occasion de s'expri-
mer librement, où l'écran bureaucratique était ébranlé et tombé, où
des occupations de masse s'étaient produites dans les usines, où des
initiatives ont pu se développer à partir de la base. On est loin
d'avoir fait l'inventaire complet de ces expériences ; mais la liste
est déjà impressionnante :
— à l'usine C.S.F. de Brest, les travailleurs décidèrent de pour-
suivre la fabrication, mais produisirent ce qu'il estimèrent, eux,
important, notamment des « walkie-talkies » qui aidaient les gré-
vistes et manifestants à se défendre contre la répression ;
suivre la fabrication, mais produisirent ce qu'il estimèrent, eux,
important, notamment des « walkie-talkies » qui aidaient les gré-
vistes et manifestants à se défendre contre la répression ;
—• à Nantes, le comité de grève cherchait à contrôler la circu-
lation vers et hors de la ville, en distribuant des permis de circuler
et en bloquant par des barricades les accès à la ville. Il semble
d'ailleurs que le même comité ait même émis des bons-crédit
acceptés comme monnaie par certains commerçants et cultivateurs;
lation vers et hors de la ville, en distribuant des permis de circuler
et en bloquant par des barricades les accès à la ville. Il semble
d'ailleurs que le même comité ait même émis des bons-crédit
acceptés comme monnaie par certains commerçants et cultivateurs;
-— à Caen, le comité de grève a interdit tout accès à la ville
pendant vingt-quatre heures ;
pendant vingt-quatre heures ;
— aux usines Rhône-Poulenc, à Vitry, les grévistes décidèrent
d'établir des rapports d'échange directs avec des cultivateurs,
cherchèrent à étendre l'expérience à d'autres entreprises, et discu-
tèrent du passage à la « grève active » (c'est-à-dire à la reprise du
travail à leur propre compte et d'après leurs propres plans), tout en
arrivant à la conclusion qu'il serait préférable de remettre cette
expérience jusqu'au moment où plusieurs autres entreprises les
suivraient dans cette voie 17 ;
d'établir des rapports d'échange directs avec des cultivateurs,
cherchèrent à étendre l'expérience à d'autres entreprises, et discu-
tèrent du passage à la « grève active » (c'est-à-dire à la reprise du
travail à leur propre compte et d'après leurs propres plans), tout en
arrivant à la conclusion qu'il serait préférable de remettre cette
expérience jusqu'au moment où plusieurs autres entreprises les
suivraient dans cette voie 17 ;
•— aux Cimenteries des Mureaux, les ouvriers ont voté en
Assemblée générale la révocation du directeur. Ils ont refusé d'ac-
cepter la proposition patronale de recommencer le vote. Le
Assemblée générale la révocation du directeur. Ils ont refusé d'ac-
cepter la proposition patronale de recommencer le vote. Le
rection de décembre à Moscou ! » (Lénine : « Rapport sur le Congrès
d'unification du P.S.D.O.R. », juin 1906, in : W.I. Lenin, Wcrke, Bancï X,
p. 369, Dietz-Vcrlag, Berlin, 1958).
d'unification du P.S.D.O.R. », juin 1906, in : W.I. Lenin, Wcrke, Bancï X,
p. 369, Dietz-Vcrlag, Berlin, 1958).
17. Signalons que les mêmes ouvriers prirent spontanément contact
avec diverses usines chimiques d'Europe occidentale, faisant preuve de
plus d'esprit d'initiative et de plus de « conscience européenne » que
toutes les directions syndicales européennes réunies. La F.I.O.M. —
C.I.S.L., (Fédération internationale des ouvriers métallurgistes, partie
de Confédération internationale des syndicats libres à laquelle adhèrent
le D.G.B. allemand, la F.G.T.B. belge, les Trade Unions britanniques,
notamment) qui siégeait en congrès au moment des événements de mai,
n'éleva pas sa solidarité à un niveau plus élevé que celui d'accorder un
soutien de... 10 ooo dollars aux grévistes (o,i cent par gréviste).
avec diverses usines chimiques d'Europe occidentale, faisant preuve de
plus d'esprit d'initiative et de plus de « conscience européenne » que
toutes les directions syndicales européennes réunies. La F.I.O.M. —
C.I.S.L., (Fédération internationale des ouvriers métallurgistes, partie
de Confédération internationale des syndicats libres à laquelle adhèrent
le D.G.B. allemand, la F.G.T.B. belge, les Trade Unions britanniques,
notamment) qui siégeait en congrès au moment des événements de mai,
n'éleva pas sa solidarité à un niveau plus élevé que celui d'accorder un
soutien de... 10 ooo dollars aux grévistes (o,i cent par gréviste).
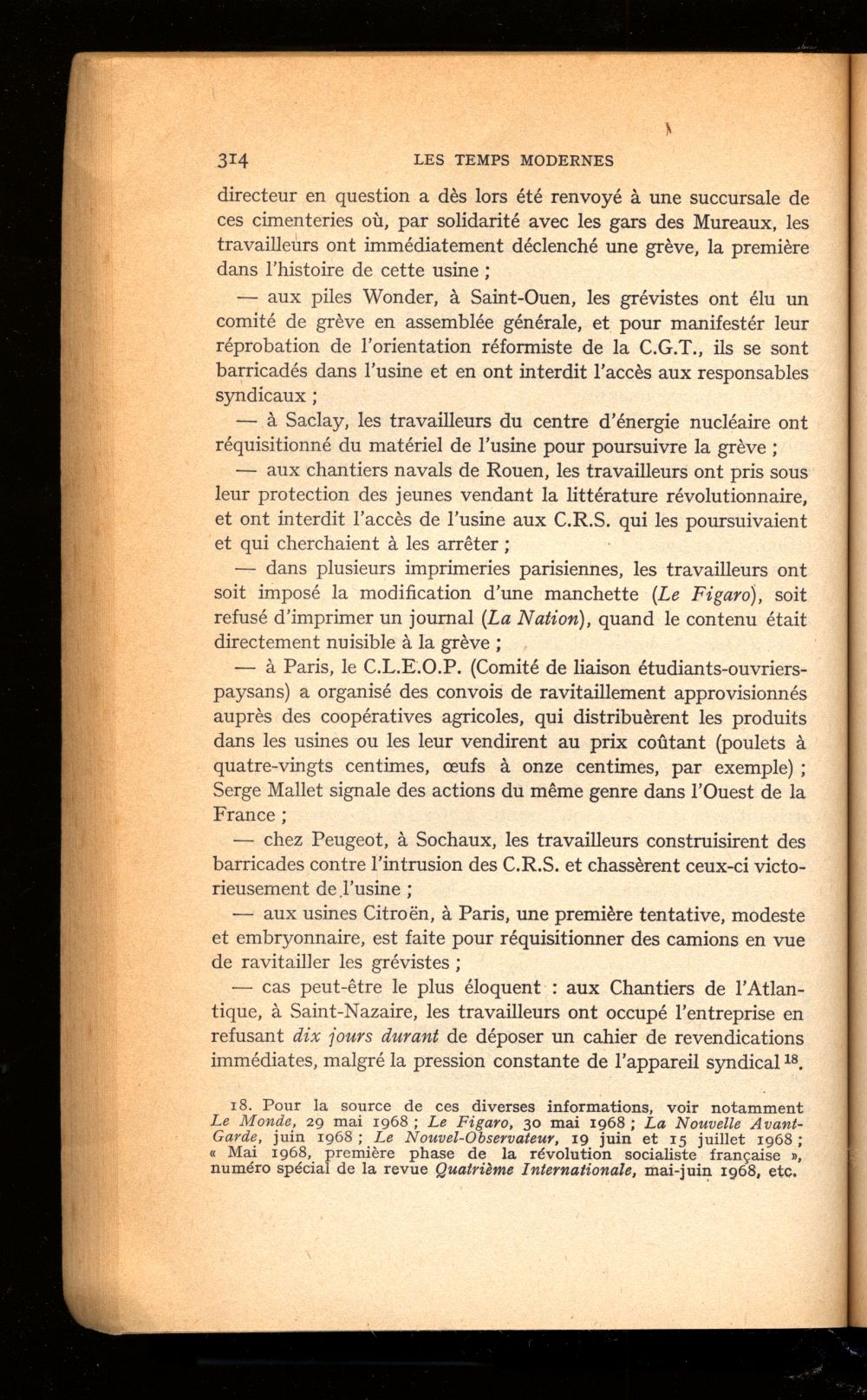

LES TEMPS MODERNES
directeur en question a dès lors été renvoyé à une succursale de
ces cimenteries où, par solidarité avec les gars des Mureaux, les
travailleurs ont immédiatement déclenché une grève, la première
dans l'histoire de cette usine ;
ces cimenteries où, par solidarité avec les gars des Mureaux, les
travailleurs ont immédiatement déclenché une grève, la première
dans l'histoire de cette usine ;
— aux piles Wonder, à Saint-Ouen, les grévistes ont élu un
comité de grève en assemblée générale, et pour manifester leur
réprobation de l'orientation réformiste de la C.G.T., ils se sont
barricadés dans l'usine et en ont interdit l'accès aux responsables
syndicaux ;
comité de grève en assemblée générale, et pour manifester leur
réprobation de l'orientation réformiste de la C.G.T., ils se sont
barricadés dans l'usine et en ont interdit l'accès aux responsables
syndicaux ;
— à Saclay, les travailleurs du centre d'énergie nucléaire ont
réquisitionné du matériel de l'usine pour poursuivre la grève ;
réquisitionné du matériel de l'usine pour poursuivre la grève ;
— aux chantiers navals de Rouen, les travailleurs ont pris sous
leur protection des jeunes vendant la littérature révolutionnaire,
et ont interdit l'accès de l'usine aux C.R.S. qui les poursuivaient
et qui cherchaient à les arrêter ;
leur protection des jeunes vendant la littérature révolutionnaire,
et ont interdit l'accès de l'usine aux C.R.S. qui les poursuivaient
et qui cherchaient à les arrêter ;
— dans plusieurs imprimeries parisiennes, les travailleurs ont
soit imposé la modification d'une manchette (Le Figaro), soit
refusé d'imprimer un journal (La Nation), quand le contenu était
directement nuisible à la grève ;
soit imposé la modification d'une manchette (Le Figaro), soit
refusé d'imprimer un journal (La Nation), quand le contenu était
directement nuisible à la grève ;
•— à Paris, le C.L.E.O.P. (Comité de liaison étudiants-ouvriers-
paysans) a organisé des convois de ravitaillement approvisionnés
auprès des coopératives agricoles, qui distribuèrent les produits
dans les usines ou les leur vendirent au prix coûtant (poulets à
quatre-vingts centimes, œufs à onze centimes, par exemple) ;
Serge Mallet signale des actions du même genre dans l'Ouest de la
France ;
paysans) a organisé des convois de ravitaillement approvisionnés
auprès des coopératives agricoles, qui distribuèrent les produits
dans les usines ou les leur vendirent au prix coûtant (poulets à
quatre-vingts centimes, œufs à onze centimes, par exemple) ;
Serge Mallet signale des actions du même genre dans l'Ouest de la
France ;
— chez Peugeot, à Sochaux, les travailleurs construisirent des
barricades contre l'intrusion des C.R.S. et chassèrent ceux-ci victo-
rieusement de .l'usine ;
barricades contre l'intrusion des C.R.S. et chassèrent ceux-ci victo-
rieusement de .l'usine ;
— aux usines Citroën, à Paris, une première tentative, modeste
et embryonnaire, est faite pour réquisitionner des camions en vue
de ravitailler les grévistes ;
et embryonnaire, est faite pour réquisitionner des camions en vue
de ravitailler les grévistes ;
— cas peut-être le plus éloquent : aux Chantiers de l'Atlan-
tique, à Saint-Nazaire, les travailleurs ont occupé l'entreprise en
refusant dix jours durant de déposer un cahier de revendications
immédiates, malgré la pression constante de l'appareil syndical18.
tique, à Saint-Nazaire, les travailleurs ont occupé l'entreprise en
refusant dix jours durant de déposer un cahier de revendications
immédiates, malgré la pression constante de l'appareil syndical18.
18. Pour la source de ces diverses informations, voir notamment
Le Monde, 29 mai 1968 ; Le Figaro, 30 mai 1968 ; La Nouvelle Avant-
Garde, juin 1968 ; Le Nouvel-Observateur, 19 juin et 15 juillet 1968 ;
« Mai 1968, première phase de la révolution socialiste française »,
numéro spécial de la revue Quatrième Internationale, mai-juin 1968, etc.
Le Monde, 29 mai 1968 ; Le Figaro, 30 mai 1968 ; La Nouvelle Avant-
Garde, juin 1968 ; Le Nouvel-Observateur, 19 juin et 15 juillet 1968 ;
« Mai 1968, première phase de la révolution socialiste française »,
numéro spécial de la revue Quatrième Internationale, mai-juin 1968, etc.
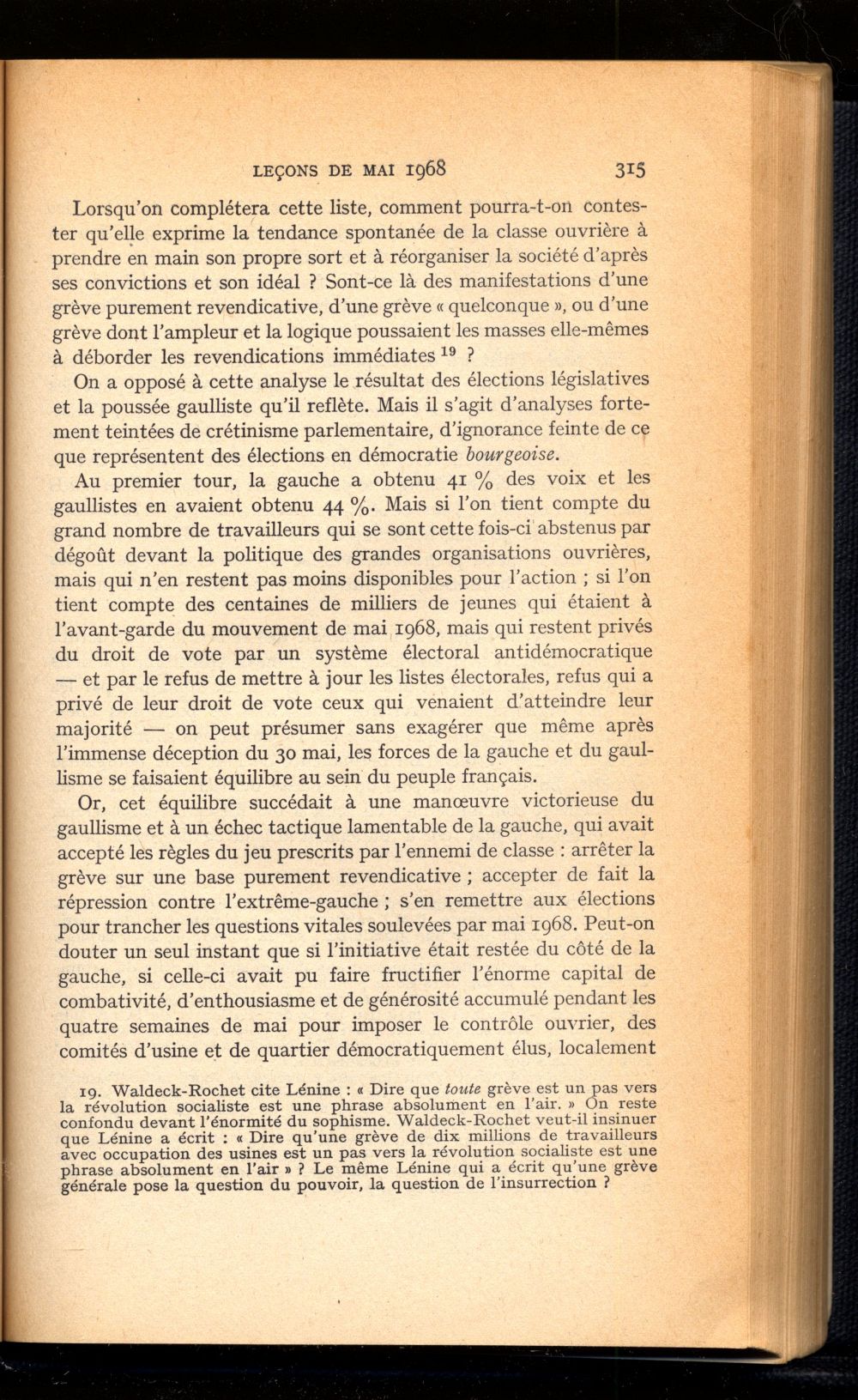

LEÇONS DE MAI 1968
315
Lorsqu'on complétera cette liste, comment pourra-t-on contes-
ter qu'elle exprime la tendance spontanée de la classe ouvrière à
prendre en main son propre sort et à réorganiser la société d'après
ses convictions et son idéal ? Sont-ce là des manifestations d'une
grève purement revendicative, d'une grève « quelconque », ou d'une
grève dont l'ampleur et la logique poussaient les masses elle-mêmes
à déborder les revendications immédiates 19 ?
ter qu'elle exprime la tendance spontanée de la classe ouvrière à
prendre en main son propre sort et à réorganiser la société d'après
ses convictions et son idéal ? Sont-ce là des manifestations d'une
grève purement revendicative, d'une grève « quelconque », ou d'une
grève dont l'ampleur et la logique poussaient les masses elle-mêmes
à déborder les revendications immédiates 19 ?
On a opposé à cette analyse le résultat des élections législatives
et la poussée gaulliste qu'il reflète. Mais il s'agit d'analyses forte-
ment teintées de crétinisme parlementaire, d'ignorance feinte de ce
que représentent des élections en démocratie bourgeoise.
et la poussée gaulliste qu'il reflète. Mais il s'agit d'analyses forte-
ment teintées de crétinisme parlementaire, d'ignorance feinte de ce
que représentent des élections en démocratie bourgeoise.
Au premier tour, la gauche a obtenu 41 % des voix et les
gaullistes en avaient obtenu 44 %. Mais si l'on tient compte du
grand nombre de travailleurs qui se sont cette fois-ci abstenus par
dégoût devant la politique des grandes organisations ouvrières,
mais qui n'en restent pas moins disponibles pour l'action ; si l'on
tient compte des centaines de milliers de jeunes qui étaient à
l'avant-garde du mouvement de mai 1968, mais qui restent privés
du droit de vote par un système électoral antidémocratique
— et par le refus de mettre à jour les listes électorales, refus qui a
privé de leur droit de vote ceux qui venaient d'atteindre leur
majorité — on peut présumer sans exagérer que même après
l'immense déception du 30 mai, les forces de la gauche et du gaul-
lisme se faisaient équilibre au sein du peuple français.
gaullistes en avaient obtenu 44 %. Mais si l'on tient compte du
grand nombre de travailleurs qui se sont cette fois-ci abstenus par
dégoût devant la politique des grandes organisations ouvrières,
mais qui n'en restent pas moins disponibles pour l'action ; si l'on
tient compte des centaines de milliers de jeunes qui étaient à
l'avant-garde du mouvement de mai 1968, mais qui restent privés
du droit de vote par un système électoral antidémocratique
— et par le refus de mettre à jour les listes électorales, refus qui a
privé de leur droit de vote ceux qui venaient d'atteindre leur
majorité — on peut présumer sans exagérer que même après
l'immense déception du 30 mai, les forces de la gauche et du gaul-
lisme se faisaient équilibre au sein du peuple français.
Or, cet équilibre succédait à une manœuvre victorieuse du
gaullisme et à un échec tactique lamentable de la gauche, qui avait
accepté les règles du jeu prescrits par l'ennemi de classe : arrêter la
grève sur une base purement revendicative ; accepter de fait la
répression contre l'extrême-gauche ; s'en remettre aux élections
pour trancher les questions vitales soulevées par mai 1968. Peut-on
douter un seul instant que si l'initiative était restée du côté de la
gauche, si celle-ci avait pu faire fructifier l'énorme capital de
combativité, d'enthousiasme et de générosité accumulé pendant les
quatre semaines de mai pour imposer le contrôle ouvrier, des
comités d'usine et de quartier démocratiquement élus, localement
gaullisme et à un échec tactique lamentable de la gauche, qui avait
accepté les règles du jeu prescrits par l'ennemi de classe : arrêter la
grève sur une base purement revendicative ; accepter de fait la
répression contre l'extrême-gauche ; s'en remettre aux élections
pour trancher les questions vitales soulevées par mai 1968. Peut-on
douter un seul instant que si l'initiative était restée du côté de la
gauche, si celle-ci avait pu faire fructifier l'énorme capital de
combativité, d'enthousiasme et de générosité accumulé pendant les
quatre semaines de mai pour imposer le contrôle ouvrier, des
comités d'usine et de quartier démocratiquement élus, localement
19. Waldeck-Rochet cite Lénine : « Dire que toute grève est un pas vers
la révolution socialiste est une phrase absolument en l'air. » On reste
confondu devant l'énormité du sophisme. Waldeck-Rochet veut-il insinuer
que Lénine a écrit : « Dire qu'une grève de dix millions de travailleurs
avec occupation des usines est un pas vers la révolution socialiste est une
phrase absolument en l'air » ? Le même Lénine qui a écrit qu'une grève
générale pose la question du pouvoir, la question de l'insurrection ?
la révolution socialiste est une phrase absolument en l'air. » On reste
confondu devant l'énormité du sophisme. Waldeck-Rochet veut-il insinuer
que Lénine a écrit : « Dire qu'une grève de dix millions de travailleurs
avec occupation des usines est un pas vers la révolution socialiste est une
phrase absolument en l'air » ? Le même Lénine qui a écrit qu'une grève
générale pose la question du pouvoir, la question de l'insurrection ?
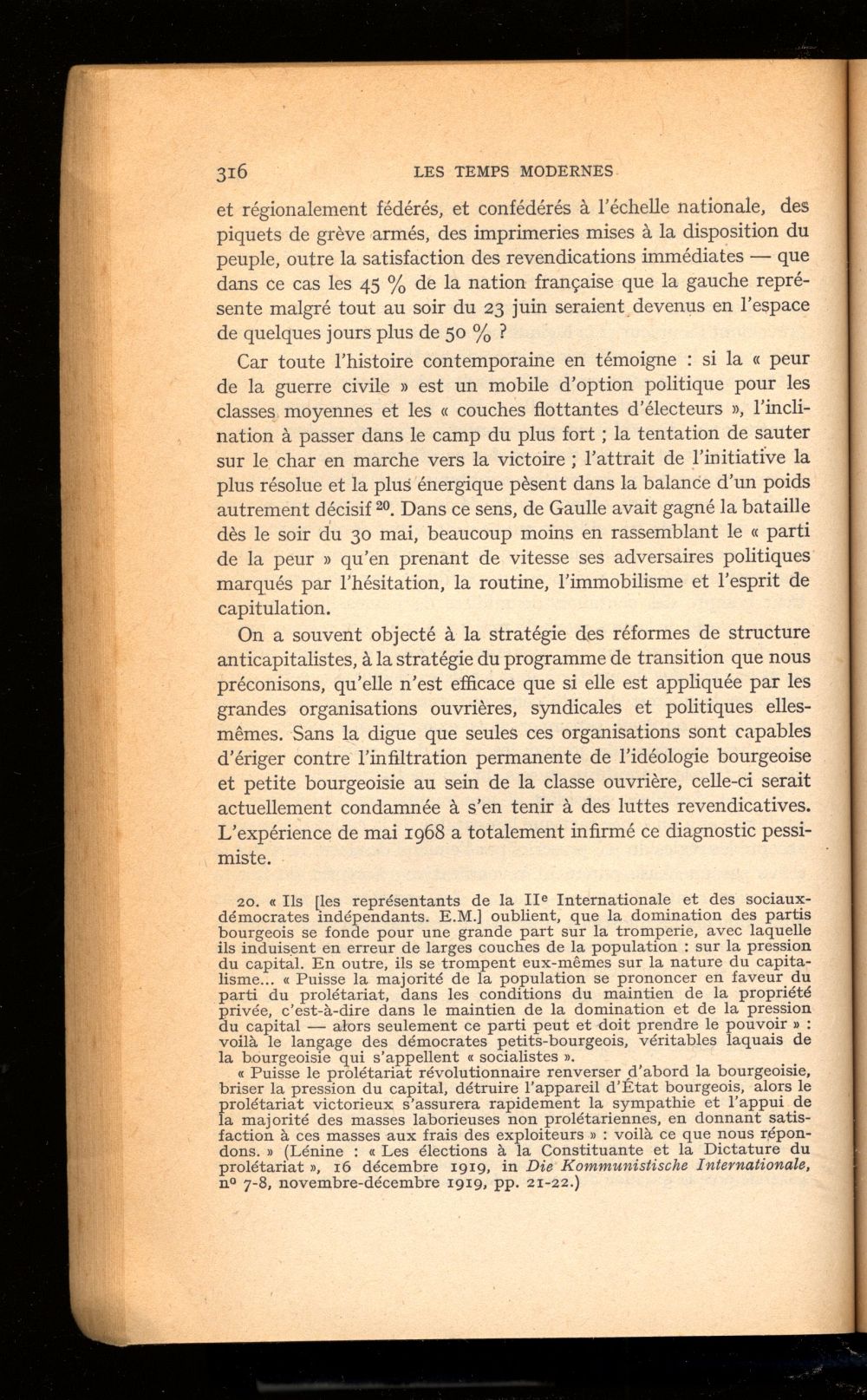

3l6 LES TEMPS MODERNES
et rcgionalement fédérés, et confédérés à l'échelle nationale, des
piquets de grève armés, des imprimeries mises à la disposition du
peuple, outre la satisfaction des revendications immédiates — que
dans ce cas les 45 % de la nation française que la gauche repré-
sente malgré tout au soir du 23 juin seraient devenus en l'espace
de quelques jours plus de 50 % ?
piquets de grève armés, des imprimeries mises à la disposition du
peuple, outre la satisfaction des revendications immédiates — que
dans ce cas les 45 % de la nation française que la gauche repré-
sente malgré tout au soir du 23 juin seraient devenus en l'espace
de quelques jours plus de 50 % ?
Car toute l'histoire contemporaine en témoigne : si la « peur
de la guerre civile » est un mobile d'option politique pour les
classes moyennes et les « couches flottantes d'électeurs », l'incli-
nation à passer dans le camp du plus fort ; la tentation de sauter
sur le char en marche vers la victoire ; l'attrait de l'initiative la
plus résolue et la plus énergique pèsent dans la balance d'un poids
autrement décisif20. Dans ce sens, de Gaulle avait gagné la bataille
dès le soir du 30 mai, beaucoup moins en rassemblant le « parti
de la peur » qu'en prenant de vitesse ses adversaires politiques
marqués par l'hésitation, la routine, l'immobilisme et l'esprit de
capitulation.
de la guerre civile » est un mobile d'option politique pour les
classes moyennes et les « couches flottantes d'électeurs », l'incli-
nation à passer dans le camp du plus fort ; la tentation de sauter
sur le char en marche vers la victoire ; l'attrait de l'initiative la
plus résolue et la plus énergique pèsent dans la balance d'un poids
autrement décisif20. Dans ce sens, de Gaulle avait gagné la bataille
dès le soir du 30 mai, beaucoup moins en rassemblant le « parti
de la peur » qu'en prenant de vitesse ses adversaires politiques
marqués par l'hésitation, la routine, l'immobilisme et l'esprit de
capitulation.
On a souvent objecté à la stratégie des réformes de structure
anticapitalistes, à la stratégie du programme de transition que nous
préconisons, qu'elle n'est efficace que si elle est appliquée par les
grandes organisations ouvrières, syndicales et politiques elles-
mêmes. Sans la digue que seules ces organisations sont capables
d'ériger contre l'infiltration permanente de l'idéologie bourgeoise
et petite bourgeoisie au sein de la classe ouvrière, celle-ci serait
actuellement condamnée à s'en tenir à des luttes revendicatives.
L'expérience de mai 1968 a totalement infirmé ce diagnostic pessi-
miste.
anticapitalistes, à la stratégie du programme de transition que nous
préconisons, qu'elle n'est efficace que si elle est appliquée par les
grandes organisations ouvrières, syndicales et politiques elles-
mêmes. Sans la digue que seules ces organisations sont capables
d'ériger contre l'infiltration permanente de l'idéologie bourgeoise
et petite bourgeoisie au sein de la classe ouvrière, celle-ci serait
actuellement condamnée à s'en tenir à des luttes revendicatives.
L'expérience de mai 1968 a totalement infirmé ce diagnostic pessi-
miste.
20. « Ils [les représentants de la IIe Internationale et des sociaux-
démocrates indépendants. E.M.] oublient, que la domination des partis
bourgeois se fonde pour une grande part sur la tromperie, avec laquelle
ils induisent en erreur de larges couches de la population : sur la pression
du capital. En outre, ils se trompent eux-mêmes sur la nature du capita-
lisme... « Puisse la majorité de la population se prononcer en faveur du
parti du prolétariat, dans les conditions du maintien de la propriété
privée, c'est-à-dire dans le maintien de la domination et de la pression
du capital — alors seulement ce parti peut et doit prendre le pouvoir » :
voilà le langage des démocrates petits-bourgeois, véritables laquais de
la bourgeoisie qui s'appellent « socialistes ».
démocrates indépendants. E.M.] oublient, que la domination des partis
bourgeois se fonde pour une grande part sur la tromperie, avec laquelle
ils induisent en erreur de larges couches de la population : sur la pression
du capital. En outre, ils se trompent eux-mêmes sur la nature du capita-
lisme... « Puisse la majorité de la population se prononcer en faveur du
parti du prolétariat, dans les conditions du maintien de la propriété
privée, c'est-à-dire dans le maintien de la domination et de la pression
du capital — alors seulement ce parti peut et doit prendre le pouvoir » :
voilà le langage des démocrates petits-bourgeois, véritables laquais de
la bourgeoisie qui s'appellent « socialistes ».
« Puisse le prolétariat révolutionnaire renverser d'abord la bourgeoisie,
briser la pression du capital, détruire l'appareil d'État bourgeois, alors le
prolétariat victorieux s'assurera rapidement la sympathie et l'appui de
la majorité des masses laborieuses non prolétariennes, en donnant satis-
faction à ces masses aux frais des exploiteurs » : voilà ce que nous répon-
dons. » (Lénine : « Les élections à la Constituante et la Dictature du
prolétariat », 16 décembre 1919, in Die Kommunislische Internationale,
n° 7-8, novembre-décembre 1919, pp. 21-22.)
briser la pression du capital, détruire l'appareil d'État bourgeois, alors le
prolétariat victorieux s'assurera rapidement la sympathie et l'appui de
la majorité des masses laborieuses non prolétariennes, en donnant satis-
faction à ces masses aux frais des exploiteurs » : voilà ce que nous répon-
dons. » (Lénine : « Les élections à la Constituante et la Dictature du
prolétariat », 16 décembre 1919, in Die Kommunislische Internationale,
n° 7-8, novembre-décembre 1919, pp. 21-22.)
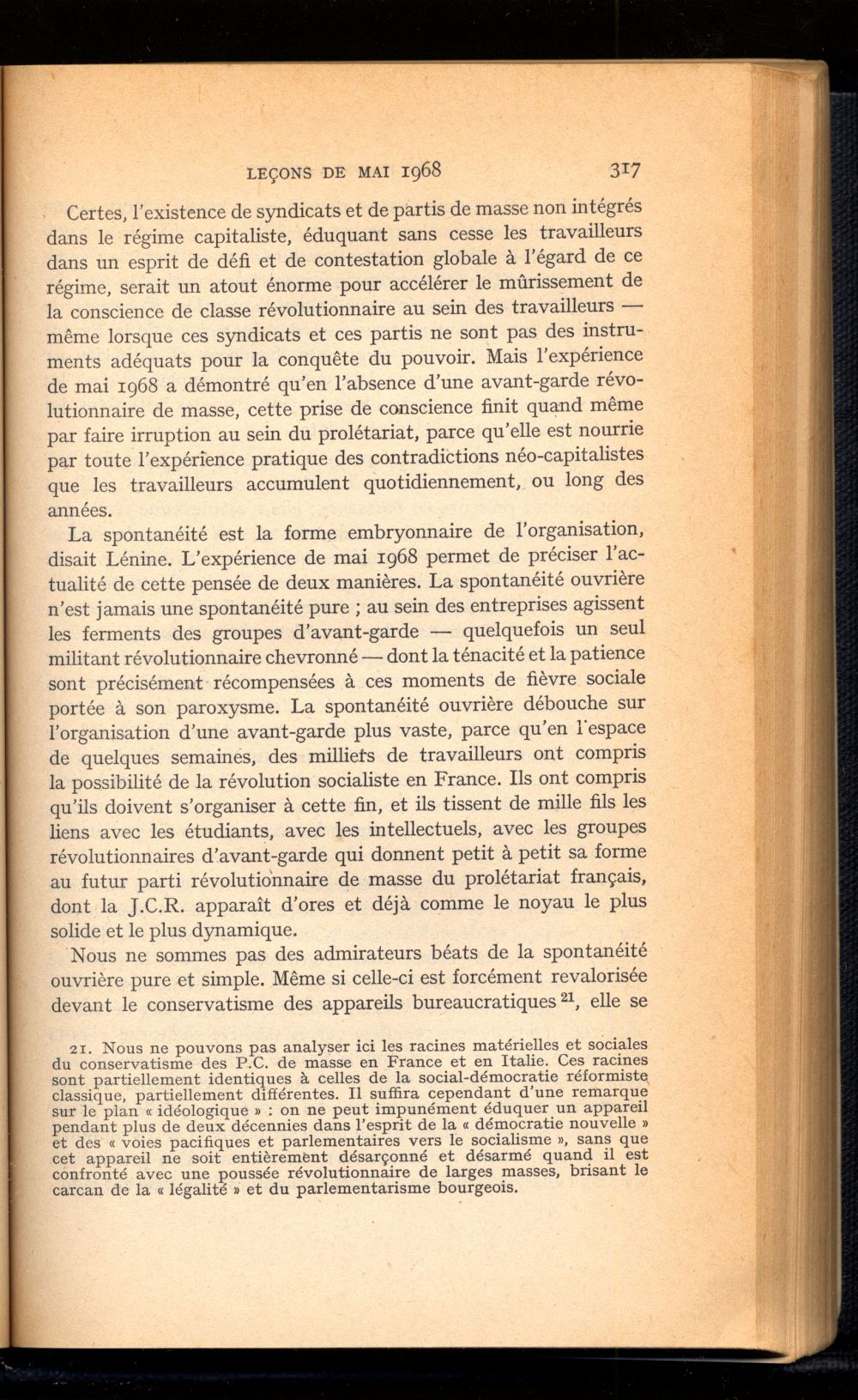

LEÇONS DE MAI 1968
317
Certes, l'existence de syndicats et de partis de masse non intégrés
dans le régime capitaliste, éduquant sans cesse les travailleurs
dans un esprit de défi et de contestation globale à l'égard de ce
régime, serait un atout énorme pour accélérer le mûrissement de
la conscience de classe révolutionnaire au sein des travailleurs —•
même lorsque ces syndicats et ces partis ne sont pas des instru-
ments adéquats pour la conquête du pouvoir. Mais l'expérience
de mai 1968 a démontré qu'en l'absence d'une avant-garde révo-
lutionnaire de masse, cette prise de conscience finit quand même
par faire irruption au sein du prolétariat, parce qu'elle est nourrie
par toute l'expérience pratique des contradictions néo-capitalistes
que les travailleurs accumulent quotidiennement, ou long des
années.
dans le régime capitaliste, éduquant sans cesse les travailleurs
dans un esprit de défi et de contestation globale à l'égard de ce
régime, serait un atout énorme pour accélérer le mûrissement de
la conscience de classe révolutionnaire au sein des travailleurs —•
même lorsque ces syndicats et ces partis ne sont pas des instru-
ments adéquats pour la conquête du pouvoir. Mais l'expérience
de mai 1968 a démontré qu'en l'absence d'une avant-garde révo-
lutionnaire de masse, cette prise de conscience finit quand même
par faire irruption au sein du prolétariat, parce qu'elle est nourrie
par toute l'expérience pratique des contradictions néo-capitalistes
que les travailleurs accumulent quotidiennement, ou long des
années.
La spontanéité est la forme embryonnaire de l'organisation,
disait Lénine. L'expérience de mai 1968 permet de préciser l'ac-
tualité de cette pensée de deux manières. La spontanéité ouvrière
n'est jamais une spontanéité pure ; au sein des entreprises agissent
les ferments des groupes d'avant-garde —- quelquefois un seul
militant révolutionnaire chevronné — dont la ténacité et la patience
sont précisément récompensées à ces moments de fièvre sociale
portée à son paroxysme. La spontanéité ouvrière débouche sur
l'organisation d'une avant-garde plus vaste, parce qu'en l'espace
de quelques semaines, des milliers de travailleurs ont compris
la possibilité de la révolution socialiste en France. Ils ont compris
qu'ils doivent s'organiser à cette fin, et ils tissent de mille fils les
liens avec les étudiants, avec les intellectuels, avec les groupes
révolutionnaires d'avant-garde qui donnent petit à petit sa forme
au futur parti révolutionnaire de masse du prolétariat français,
dont la J.C.R. apparaît d'ores et déjà comme le noyau le plus
solide et le plus dynamique.
disait Lénine. L'expérience de mai 1968 permet de préciser l'ac-
tualité de cette pensée de deux manières. La spontanéité ouvrière
n'est jamais une spontanéité pure ; au sein des entreprises agissent
les ferments des groupes d'avant-garde —- quelquefois un seul
militant révolutionnaire chevronné — dont la ténacité et la patience
sont précisément récompensées à ces moments de fièvre sociale
portée à son paroxysme. La spontanéité ouvrière débouche sur
l'organisation d'une avant-garde plus vaste, parce qu'en l'espace
de quelques semaines, des milliers de travailleurs ont compris
la possibilité de la révolution socialiste en France. Ils ont compris
qu'ils doivent s'organiser à cette fin, et ils tissent de mille fils les
liens avec les étudiants, avec les intellectuels, avec les groupes
révolutionnaires d'avant-garde qui donnent petit à petit sa forme
au futur parti révolutionnaire de masse du prolétariat français,
dont la J.C.R. apparaît d'ores et déjà comme le noyau le plus
solide et le plus dynamique.
Nous ne sommes pas des admirateurs béats de la spontanéité
ouvrière pure et simple. Même si celle-ci est forcément revalorisée
devant le conservatisme des appareils bureaucratiques21, elle se
ouvrière pure et simple. Même si celle-ci est forcément revalorisée
devant le conservatisme des appareils bureaucratiques21, elle se
21. Nous ne pouvons pas analyser ici les racines matérielles et sociales
du conservatisme des P.C. de masse en France et en Italie. Ces racines
sont partiellement identiques à celles de la social-démocratie réformiste
classique, partiellement différentes. Il suffira cependant d'une remarque
sur le plan « idéologique » : on ne peut impunément éduquer un appareil
pendant plus de deux décennies dans l'esprit de la « démocratie nouvelle »
et des « voies pacifiques et parlementaires vers le socialisme », sans que
cet appareil ne soit entièrement désarçonné et désarmé quand il est
confronté avec une poussée révolutionnaire de larges masses, brisant le
carcan de la « légalité » et du parlementarisme bourgeois.
du conservatisme des P.C. de masse en France et en Italie. Ces racines
sont partiellement identiques à celles de la social-démocratie réformiste
classique, partiellement différentes. Il suffira cependant d'une remarque
sur le plan « idéologique » : on ne peut impunément éduquer un appareil
pendant plus de deux décennies dans l'esprit de la « démocratie nouvelle »
et des « voies pacifiques et parlementaires vers le socialisme », sans que
cet appareil ne soit entièrement désarçonné et désarmé quand il est
confronté avec une poussée révolutionnaire de larges masses, brisant le
carcan de la « légalité » et du parlementarisme bourgeois.
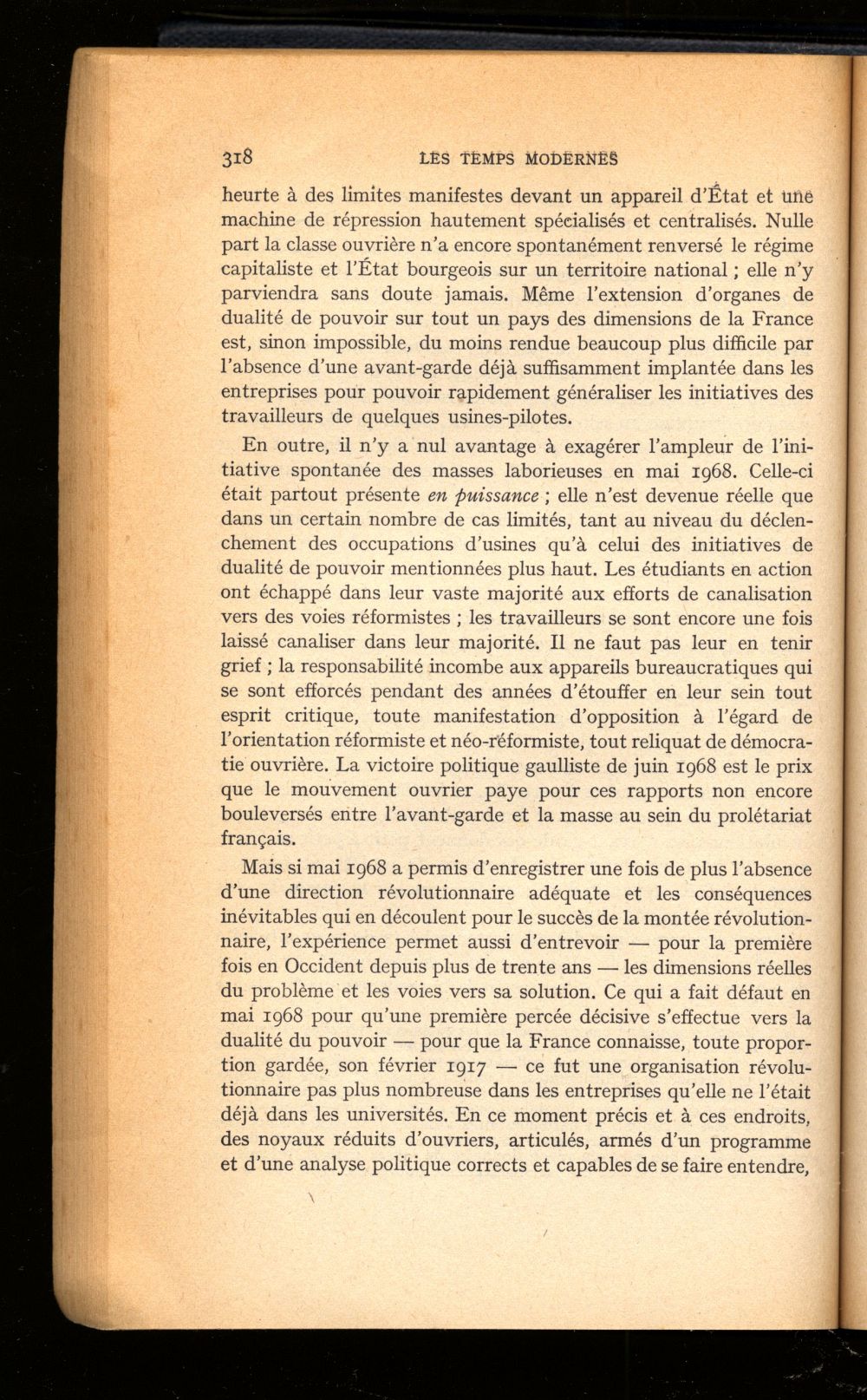

318 LES TEMPS MODERNES
heurte à des limites manifestes devant un appareil d'État et une
machine de répression hautement spécialisés et centralisés. Nulle
part la classe ouvrière n'a encore spontanément renversé le régime
capitaliste et l'État bourgeois sur un territoire national ; elle n'y
parviendra sans doute jamais. Même l'extension d'organes de
dualité de pouvoir sur tout un pays des dimensions de la France
est, sinon impossible, du moins rendue beaucoup plus difficile par
l'absence d'une avant-garde déjà suffisamment implantée dans les
entreprises pour pouvoir rapidement généraliser les initiatives des
travailleurs de quelques usines-pilotes.
machine de répression hautement spécialisés et centralisés. Nulle
part la classe ouvrière n'a encore spontanément renversé le régime
capitaliste et l'État bourgeois sur un territoire national ; elle n'y
parviendra sans doute jamais. Même l'extension d'organes de
dualité de pouvoir sur tout un pays des dimensions de la France
est, sinon impossible, du moins rendue beaucoup plus difficile par
l'absence d'une avant-garde déjà suffisamment implantée dans les
entreprises pour pouvoir rapidement généraliser les initiatives des
travailleurs de quelques usines-pilotes.
En outre, il n'y a nul avantage à exagérer l'ampleur de l'ini-
tiative spontanée des masses laborieuses en mai 1968. Celle-ci
était partout présente en -puissance ; elle n'est devenue réelle que
dans un certain nombre de cas limités, tant au niveau du déclen-
chement des occupations d'usines qu'à celui des initiatives de
dualité de pouvoir mentionnées plus haut. Les étudiants en action
ont échappé dans leur vaste majorité aux efforts de canalisation
vers des voies réformistes ; les travailleurs se sont encore une fois
laissé canaliser dans leur majorité. Il ne faut pas leur en tenir
grief ; la responsabilité incombe aux appareils bureaucratiques qui
se sont efforcés pendant des années d'étouffer en leur sein tout
esprit critique, toute manifestation d'opposition à l'égard de
l'orientation réformiste et néo-réformiste, tout reliquat de démocra-
tie ouvrière. La victoire politique gaulliste de juin 1968 est le prix
que le mouvement ouvrier paye pour ces rapports non encore
bouleversés entre l'avant-garde et la masse au sein du prolétariat
français.
tiative spontanée des masses laborieuses en mai 1968. Celle-ci
était partout présente en -puissance ; elle n'est devenue réelle que
dans un certain nombre de cas limités, tant au niveau du déclen-
chement des occupations d'usines qu'à celui des initiatives de
dualité de pouvoir mentionnées plus haut. Les étudiants en action
ont échappé dans leur vaste majorité aux efforts de canalisation
vers des voies réformistes ; les travailleurs se sont encore une fois
laissé canaliser dans leur majorité. Il ne faut pas leur en tenir
grief ; la responsabilité incombe aux appareils bureaucratiques qui
se sont efforcés pendant des années d'étouffer en leur sein tout
esprit critique, toute manifestation d'opposition à l'égard de
l'orientation réformiste et néo-réformiste, tout reliquat de démocra-
tie ouvrière. La victoire politique gaulliste de juin 1968 est le prix
que le mouvement ouvrier paye pour ces rapports non encore
bouleversés entre l'avant-garde et la masse au sein du prolétariat
français.
Mais si mai 1968 a permis d'enregistrer une fois de plus l'absence
d'une direction révolutionnaire adéquate et les conséquences
inévitables qui en découlent pour le succès de la montée révolution-
naire, l'expérience permet aussi d'entrevoir — pour la première
fois en Occident depuis plus de trente ans —• les dimensions réelles
du problème et les voies vers sa solution. Ce qui a fait défaut en
mai 1968 pour qu'une première percée décisive s'effectue vers la
dualité du pouvoir — pour que la France connaisse, toute propor-
tion gardée, son février 1917 — ce fut une organisation révolu-
tionnaire pas plus nombreuse dans les entreprises qu'elle ne l'était
déjà dans les universités. En ce moment précis et à ces endroits,
des noyaux réduits d'ouvriers, articulés, armés d'un programme
et d'une analyse politique corrects et capables de se faire entendre,
d'une direction révolutionnaire adéquate et les conséquences
inévitables qui en découlent pour le succès de la montée révolution-
naire, l'expérience permet aussi d'entrevoir — pour la première
fois en Occident depuis plus de trente ans —• les dimensions réelles
du problème et les voies vers sa solution. Ce qui a fait défaut en
mai 1968 pour qu'une première percée décisive s'effectue vers la
dualité du pouvoir — pour que la France connaisse, toute propor-
tion gardée, son février 1917 — ce fut une organisation révolu-
tionnaire pas plus nombreuse dans les entreprises qu'elle ne l'était
déjà dans les universités. En ce moment précis et à ces endroits,
des noyaux réduits d'ouvriers, articulés, armés d'un programme
et d'une analyse politique corrects et capables de se faire entendre,
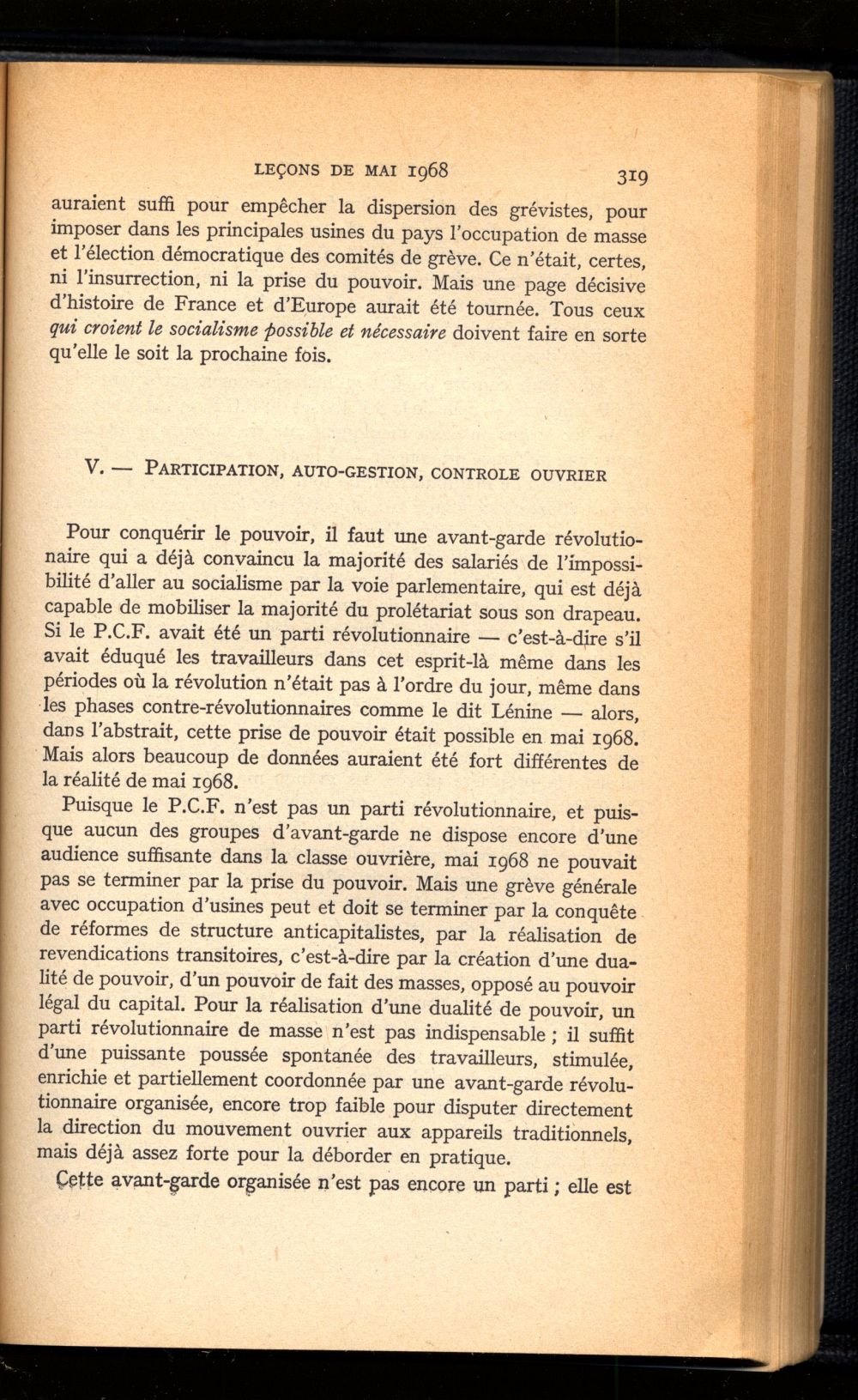

LEÇONS DE MAI 1968
319
auraient suffi pour empêcher la dispersion des grévistes, pour
imposer dans les principales usines du pays l'occupation de masse
et l'élection démocratique des comités de grève. Ce n'était, certes,
ni l'insurrection, ni la prise du pouvoir. Mais une page décisive
d'histoire de France et d'Europe aurait été tournée. Tous ceux
qui croient le socialisme possible et nécessaire doivent faire en sorte
qu'elle le soit la prochaine fois.
imposer dans les principales usines du pays l'occupation de masse
et l'élection démocratique des comités de grève. Ce n'était, certes,
ni l'insurrection, ni la prise du pouvoir. Mais une page décisive
d'histoire de France et d'Europe aurait été tournée. Tous ceux
qui croient le socialisme possible et nécessaire doivent faire en sorte
qu'elle le soit la prochaine fois.
V. — PARTICIPATION, AUTO-GESTION, CONTROLE OUVRIER
Pour conquérir le pouvoir, il faut une avant-garde révolutio-
naire qui a déjà convaincu la majorité des salariés de l'impossi-
bilité d'aller au socialisme par la voie parlementaire, qui est déjà
capable de mobiliser la majorité du prolétariat sous son drapeau.
Si le P.C.F. avait été un parti révolutionnaire — c'est-à-dire s'il
avait éduqué les travailleurs dans cet esprit-là même dans les
périodes où la révolution n'était pas à l'ordre du jour, même dans
les phases contre-révolutionnaires comme le dit Lénine — alors,
dans l'abstrait, cette prise de pouvoir était possible en mai 1968.
Mais alors beaucoup de données auraient été fort différentes de
la réalité de mai 1968.
naire qui a déjà convaincu la majorité des salariés de l'impossi-
bilité d'aller au socialisme par la voie parlementaire, qui est déjà
capable de mobiliser la majorité du prolétariat sous son drapeau.
Si le P.C.F. avait été un parti révolutionnaire — c'est-à-dire s'il
avait éduqué les travailleurs dans cet esprit-là même dans les
périodes où la révolution n'était pas à l'ordre du jour, même dans
les phases contre-révolutionnaires comme le dit Lénine — alors,
dans l'abstrait, cette prise de pouvoir était possible en mai 1968.
Mais alors beaucoup de données auraient été fort différentes de
la réalité de mai 1968.
Puisque le P.C.F. n'est pas un parti révolutionnaire, et puis-
que aucun des groupes d'avant-garde ne dispose encore d'une
audience suffisante dans la classe ouvrière, mai 1968 ne pouvait
pas se terminer par la prise du pouvoir. Mais une grève générale
avec occupation d'usines peut et doit se terminer par la conquête
de réformes de structure anticapitalistes, par la réalisation de
revendications transitoires, c'est-à-dire par la création d'une dua-
lité de pouvoir, d'un pouvoir de fait des masses, opposé au pouvoir
légal du capital. Pour la réalisation d'une dualité de pouvoir, un
parti révolutionnaire de masse n'est pas indispensable ; il suffit
d'une puissante poussée spontanée des travailleurs, stimulée,
enrichie et partiellement coordonnée par une avant-garde révolu-
tionnaire organisée, encore trop faible pour disputer directement
la direction du mouvement ouvrier aux appareils traditionnels,
mais déjà assez forte pour la déborder en pratique.
que aucun des groupes d'avant-garde ne dispose encore d'une
audience suffisante dans la classe ouvrière, mai 1968 ne pouvait
pas se terminer par la prise du pouvoir. Mais une grève générale
avec occupation d'usines peut et doit se terminer par la conquête
de réformes de structure anticapitalistes, par la réalisation de
revendications transitoires, c'est-à-dire par la création d'une dua-
lité de pouvoir, d'un pouvoir de fait des masses, opposé au pouvoir
légal du capital. Pour la réalisation d'une dualité de pouvoir, un
parti révolutionnaire de masse n'est pas indispensable ; il suffit
d'une puissante poussée spontanée des travailleurs, stimulée,
enrichie et partiellement coordonnée par une avant-garde révolu-
tionnaire organisée, encore trop faible pour disputer directement
la direction du mouvement ouvrier aux appareils traditionnels,
mais déjà assez forte pour la déborder en pratique.
Cette avant-garde organisée n'est pas encore un parti ; elle est
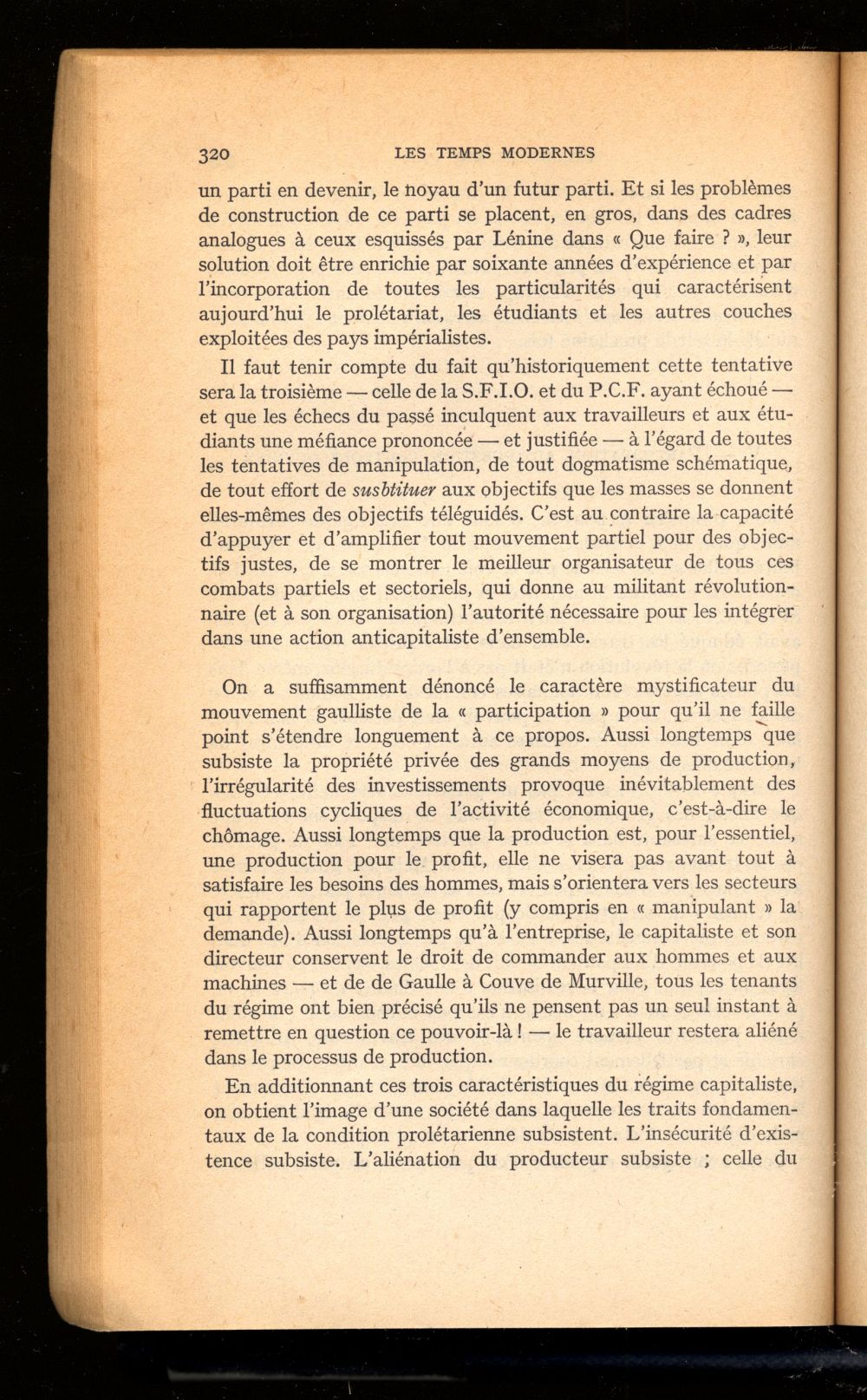

320
LES TEMPS MODERNES
un parti en devenir, le noyau d'un futur parti. Et si les problèmes
de construction de ce parti se placent, en gros, dans des cadres
analogues à ceux esquissés par Lénine dans « Que faire ? », leur
solution doit être enrichie par soixante années d'expérience et par
l'incorporation de toutes les particularités qui caractérisent
aujourd'hui le prolétariat, les étudiants et les autres couches
exploitées des pays impérialistes.
de construction de ce parti se placent, en gros, dans des cadres
analogues à ceux esquissés par Lénine dans « Que faire ? », leur
solution doit être enrichie par soixante années d'expérience et par
l'incorporation de toutes les particularités qui caractérisent
aujourd'hui le prolétariat, les étudiants et les autres couches
exploitées des pays impérialistes.
Il faut tenir compte du fait qu'historiquement cette tentative
sera la troisième — celle de la S.F.I.O. et du P.C.F. ayant échoué —•
et que les échecs du passé inculquent aux travailleurs et aux étu-
diants une méfiance prononcée —• et justifiée — à l'égard de toutes
les tentatives de manipulation, de tout dogmatisme schématique,
de tout effort de susbtituer aux objectifs que les masses se donnent
elles-mêmes des objectifs téléguidés. C'est au contraire la capacité
d'appuyer et d'amplifier tout mouvement partiel pour des objec-
tifs justes, de se montrer le meilleur organisateur de tous ces
combats partiels et sectoriels, qui donne au militant révolution-
naire (et à son organisation) l'autorité nécessaire pour les intégrer
dans une action anticapitaliste d'ensemble.
sera la troisième — celle de la S.F.I.O. et du P.C.F. ayant échoué —•
et que les échecs du passé inculquent aux travailleurs et aux étu-
diants une méfiance prononcée —• et justifiée — à l'égard de toutes
les tentatives de manipulation, de tout dogmatisme schématique,
de tout effort de susbtituer aux objectifs que les masses se donnent
elles-mêmes des objectifs téléguidés. C'est au contraire la capacité
d'appuyer et d'amplifier tout mouvement partiel pour des objec-
tifs justes, de se montrer le meilleur organisateur de tous ces
combats partiels et sectoriels, qui donne au militant révolution-
naire (et à son organisation) l'autorité nécessaire pour les intégrer
dans une action anticapitaliste d'ensemble.
On a suffisamment dénoncé le caractère mystificateur du
mouvement gaulliste de la « participation » pour qu'il ne faille
point s'étendre longuement à ce propos. Aussi longtemps que
subsiste la propriété privée des grands moyens de production,
l'irrégularité des investissements provoque inévitablement des
fluctuations cycliques de l'activité économique, c'est-à-dire le
chômage. Aussi longtemps que la production est, pour l'essentiel,
une production pour le profit, elle ne visera pas avant tout à
satisfaire les besoins des hommes, mais s'orientera vers les secteurs
qui rapportent le plus de profit (y compris en « manipulant » la
demande). Aussi longtemps qu'à l'entreprise, le capitaliste et son
directeur conservent le droit de commander aux hommes et aux
machines — et de de Gaulle à Couve de Murville, tous les tenants
du régime ont bien précisé qu'ils ne pensent pas un seul instant à
remettre en question ce pouvoir-là ! —• le travailleur restera aliéné
dans le processus de production.
mouvement gaulliste de la « participation » pour qu'il ne faille
point s'étendre longuement à ce propos. Aussi longtemps que
subsiste la propriété privée des grands moyens de production,
l'irrégularité des investissements provoque inévitablement des
fluctuations cycliques de l'activité économique, c'est-à-dire le
chômage. Aussi longtemps que la production est, pour l'essentiel,
une production pour le profit, elle ne visera pas avant tout à
satisfaire les besoins des hommes, mais s'orientera vers les secteurs
qui rapportent le plus de profit (y compris en « manipulant » la
demande). Aussi longtemps qu'à l'entreprise, le capitaliste et son
directeur conservent le droit de commander aux hommes et aux
machines — et de de Gaulle à Couve de Murville, tous les tenants
du régime ont bien précisé qu'ils ne pensent pas un seul instant à
remettre en question ce pouvoir-là ! —• le travailleur restera aliéné
dans le processus de production.
En additionnant ces trois caractéristiques du régime capitaliste,
on obtient l'image d'une société dans laquelle les traits fondamen-
taux de la condition prolétarienne subsistent. L'insécurité d'exis-
tence subsiste. L'aliénation du producteur subsiste ; celle du
on obtient l'image d'une société dans laquelle les traits fondamen-
taux de la condition prolétarienne subsistent. L'insécurité d'exis-
tence subsiste. L'aliénation du producteur subsiste ; celle du
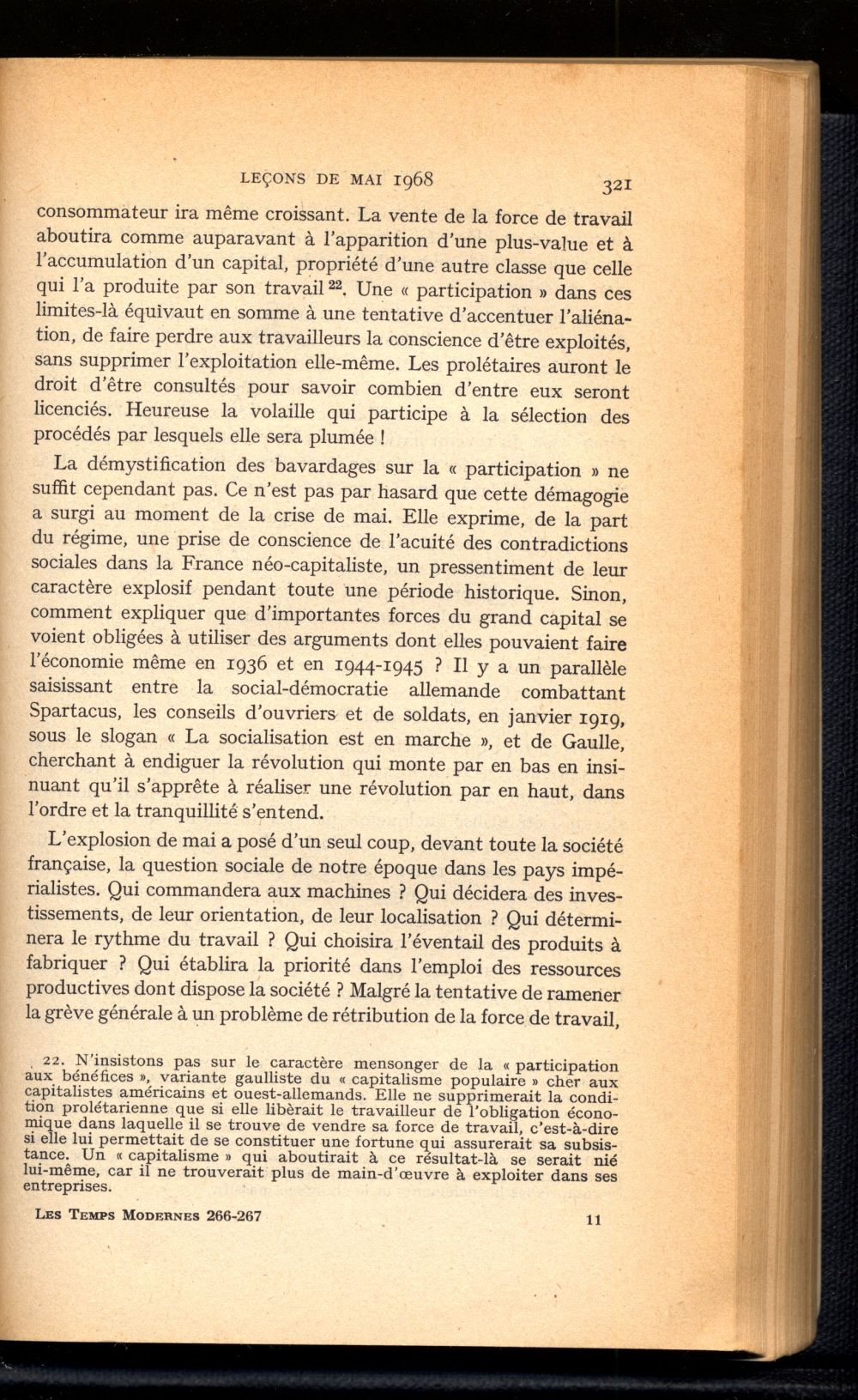

LEÇONS DE MAI Ig68
32I
consommateur ira même croissant. La vente de la force de travail
aboutira comme auparavant à l'apparition d'une plus-value et à
l'accumulation d'un capital, propriété d'une autre classe que celle
qui l'a produite par son travail22. Une « participation » dans ces
limites-là équivaut en somme à une tentative d'accentuer l'aliéna-
tion, de faire perdre aux travailleurs la conscience d'être exploités,
sans supprimer l'exploitation elle-même. Les prolétaires auront le
droit d'être consultés pour savoir combien d'entre eux seront
licenciés. Heureuse la volaille qui participe à la sélection des
procédés par lesquels elle sera plumée !
aboutira comme auparavant à l'apparition d'une plus-value et à
l'accumulation d'un capital, propriété d'une autre classe que celle
qui l'a produite par son travail22. Une « participation » dans ces
limites-là équivaut en somme à une tentative d'accentuer l'aliéna-
tion, de faire perdre aux travailleurs la conscience d'être exploités,
sans supprimer l'exploitation elle-même. Les prolétaires auront le
droit d'être consultés pour savoir combien d'entre eux seront
licenciés. Heureuse la volaille qui participe à la sélection des
procédés par lesquels elle sera plumée !
La démystification des bavardages sur la « participation » ne
suffit cependant pas. Ce n'est pas par hasard que cette démagogie
a surgi au moment de la crise de mai. Elle exprime, de la part
du régime, une prise de conscience de l'acuité des contradictions
sociales dans la France néo-capitaliste, un pressentiment de leur
caractère explosif pendant toute une période historique. Sinon,
comment expliquer que d'importantes forces du grand capital se
voient obligées à utiliser des arguments dont elles pouvaient faire
l'économie même en 1936 et en 1944-1945 ? Il y a un parallèle
saisissant entre la social-démocratie allemande combattant
Spartacus, les conseils d'ouvriers et de soldats, en janvier 1919,
sous le slogan « La socialisation est en marche », et de Gaulle,
cherchant à endiguer la révolution qui monte par en bas en insi-
nuant qu'il s'apprête à réaliser une révolution par en haut, dans
l'ordre et la tranquillité s'entend.
suffit cependant pas. Ce n'est pas par hasard que cette démagogie
a surgi au moment de la crise de mai. Elle exprime, de la part
du régime, une prise de conscience de l'acuité des contradictions
sociales dans la France néo-capitaliste, un pressentiment de leur
caractère explosif pendant toute une période historique. Sinon,
comment expliquer que d'importantes forces du grand capital se
voient obligées à utiliser des arguments dont elles pouvaient faire
l'économie même en 1936 et en 1944-1945 ? Il y a un parallèle
saisissant entre la social-démocratie allemande combattant
Spartacus, les conseils d'ouvriers et de soldats, en janvier 1919,
sous le slogan « La socialisation est en marche », et de Gaulle,
cherchant à endiguer la révolution qui monte par en bas en insi-
nuant qu'il s'apprête à réaliser une révolution par en haut, dans
l'ordre et la tranquillité s'entend.
L'explosion de mai a posé d'un seul coup, devant toute la société
française, la question sociale de notre époque dans les pays impé-
rialistes. Qui commandera aux machines ? Qui décidera des inves-
tissements, de leur orientation, de leur localisation ? Qui détermi-
nera le rythme du travail ? Qui choisira l'éventail des produits à
fabriquer ? Qui établira la priorité dans l'emploi des ressources
productives dont dispose la société ? Malgré la tentative de ramener
la grève générale à un problème de rétribution de la force de travail,
française, la question sociale de notre époque dans les pays impé-
rialistes. Qui commandera aux machines ? Qui décidera des inves-
tissements, de leur orientation, de leur localisation ? Qui détermi-
nera le rythme du travail ? Qui choisira l'éventail des produits à
fabriquer ? Qui établira la priorité dans l'emploi des ressources
productives dont dispose la société ? Malgré la tentative de ramener
la grève générale à un problème de rétribution de la force de travail,
22. N'insistons pas sur le caractère mensonger de la « participation
aux bénéfices », variante gaulliste du « capitalisme populaire » cher aux
capitalistes américains et ouest-allemands. Elle ne supprimerait la condi-
tion prolétarienne que si elle libérait le travailleur de l'obligation écono-
mique dans laquelle il se trouve de vendre sa force de travail, c'est-à-dire
si elle lui permettait de se constituer une fortune qui assurerait sa subsis-
tance. Un « capitalisme » qui aboutirait à ce résultat-là se serait nié
lui-même, car il ne trouverait plus de main-d'œuvre à exploiter dans ses
entreprises.
aux bénéfices », variante gaulliste du « capitalisme populaire » cher aux
capitalistes américains et ouest-allemands. Elle ne supprimerait la condi-
tion prolétarienne que si elle libérait le travailleur de l'obligation écono-
mique dans laquelle il se trouve de vendre sa force de travail, c'est-à-dire
si elle lui permettait de se constituer une fortune qui assurerait sa subsis-
tance. Un « capitalisme » qui aboutirait à ce résultat-là se serait nié
lui-même, car il ne trouverait plus de main-d'œuvre à exploiter dans ses
entreprises.
LES TEMPS MODERNES 266-267
11
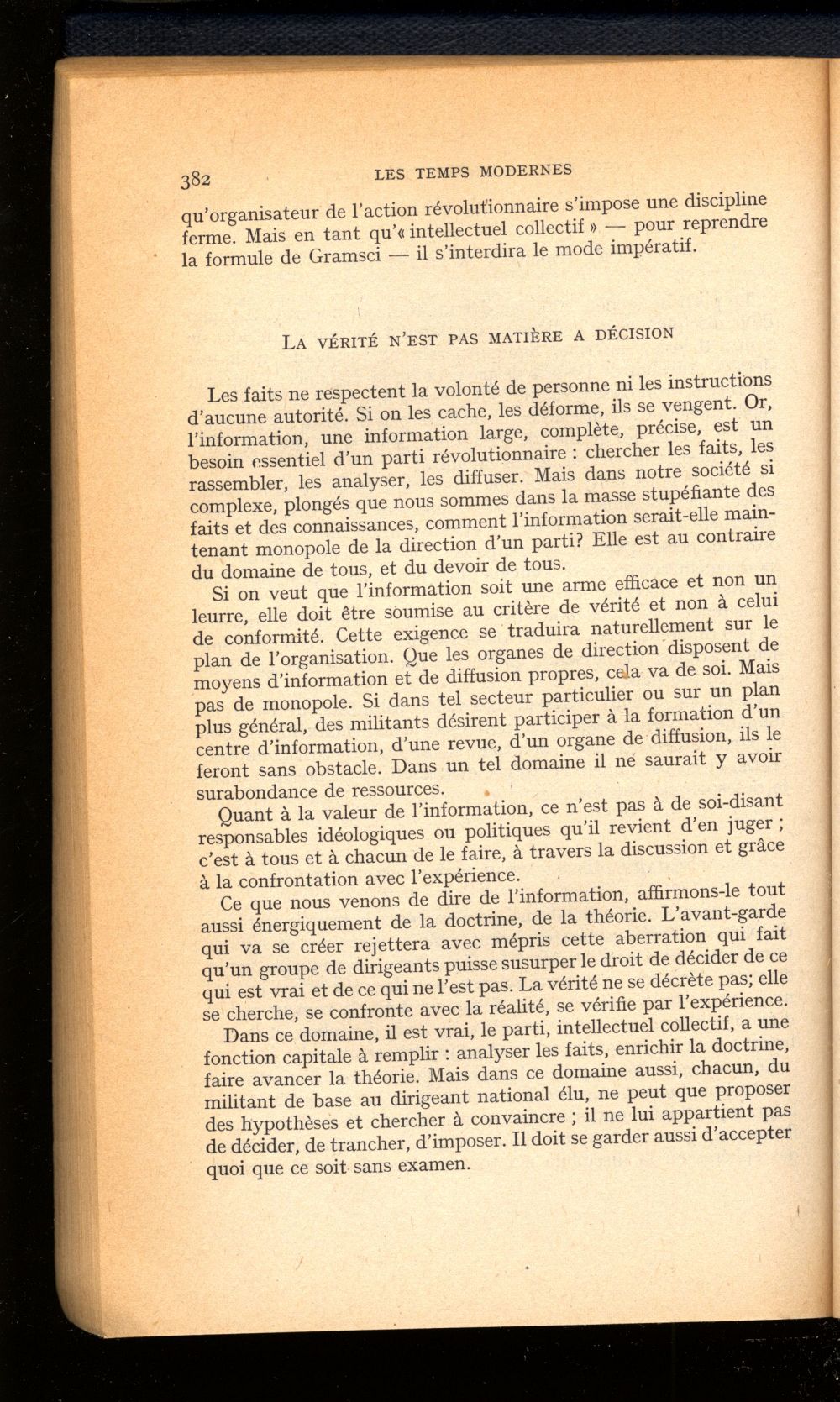

382 LES TEMPS MODERNES
qu'organisateur de l'action révolutionnaire s'impose une discipline
ferme. Mais en tant qu'« intellectuel collectif » — pour reprendre
la formule de Gramsci — il s'interdira le mode impératif.
ferme. Mais en tant qu'« intellectuel collectif » — pour reprendre
la formule de Gramsci — il s'interdira le mode impératif.
LA VÉRITÉ N'EST PAS MATIÈRE A DÉCISION
Les faits ne respectent la volonté de personne ni les instructions
d'aucune autorité. Si on les cache, les déforme, ils se vengent. Or,
l'information, une information large, complète, précise, est un
besoin essentiel d'un parti révolutionnaire : chercher les faits, les
rassembler, les analyser, les diffuser. Mais dans notre société si
complexe, plongés que nous sommes dans la masse stupéfiante des
faits et des connaissances, comment l'information serait-elle main-
tenant monopole de la direction d'un parti? Elle est au contraire
du domaine de tous, et du devoir de tous.
d'aucune autorité. Si on les cache, les déforme, ils se vengent. Or,
l'information, une information large, complète, précise, est un
besoin essentiel d'un parti révolutionnaire : chercher les faits, les
rassembler, les analyser, les diffuser. Mais dans notre société si
complexe, plongés que nous sommes dans la masse stupéfiante des
faits et des connaissances, comment l'information serait-elle main-
tenant monopole de la direction d'un parti? Elle est au contraire
du domaine de tous, et du devoir de tous.
Si on veut que l'information soit une arme efficace et non un
leurre, elle doit être soumise au critère de vérité et non à celui
de conformité. Cette exigence se traduira naturellement sur le
plan de l'organisation. Que les organes de direction disposent de
moyens d'information et de diffusion propres, cela va de soi. Mais
pas de monopole. Si dans tel secteur particulier ou sur un plan
plus général, des militants désirent participer à la formation d'un
centre d'information, d'une revue, d'un organe de diffusion, ils le
feront sans obstacle. Dans un tel domaine il ne saurait y avoir
surabondance de ressources.
leurre, elle doit être soumise au critère de vérité et non à celui
de conformité. Cette exigence se traduira naturellement sur le
plan de l'organisation. Que les organes de direction disposent de
moyens d'information et de diffusion propres, cela va de soi. Mais
pas de monopole. Si dans tel secteur particulier ou sur un plan
plus général, des militants désirent participer à la formation d'un
centre d'information, d'une revue, d'un organe de diffusion, ils le
feront sans obstacle. Dans un tel domaine il ne saurait y avoir
surabondance de ressources.
Quant à la valeur de l'information, ce n'est pas à de soi-disant
responsables idéologiques ou politiques qu'il revient d'en juger ;
c'est à tous et à chacun de le faire, à travers la discussion et grâce
à la confrontation avec l'expérience.
responsables idéologiques ou politiques qu'il revient d'en juger ;
c'est à tous et à chacun de le faire, à travers la discussion et grâce
à la confrontation avec l'expérience.
Ce que nous venons de dire de l'information, affirmons-le tout
aussi énergiquement de la doctrine, de la théorie. L'avant-garde
qui va se créer rejettera avec mépris cette aberration qui fait
qu'un groupe de dirigeants puisse susurper le droit de décider de ce
qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. La vérité ne se décrète pas; elle
se cherche, se confronte avec la réalité, se vérifie par l'expérience.
aussi énergiquement de la doctrine, de la théorie. L'avant-garde
qui va se créer rejettera avec mépris cette aberration qui fait
qu'un groupe de dirigeants puisse susurper le droit de décider de ce
qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. La vérité ne se décrète pas; elle
se cherche, se confronte avec la réalité, se vérifie par l'expérience.
Dans ce domaine, il est vrai, le parti, intellectuel collectif, a une
fonction capitale à remplir : analyser les faits, enrichir la doctrine,
faire avancer la théorie. Mais dans ce domaine aussi, chacun, du
militant de base au dirigeant national élu, ne peut que proposer
des hypothèses et chercher à convaincre ; il ne lui appartient pas
de décider, de trancher, d'imposer. Il doit se garder aussi d'accepter
quoi que ce soit sans examen.
fonction capitale à remplir : analyser les faits, enrichir la doctrine,
faire avancer la théorie. Mais dans ce domaine aussi, chacun, du
militant de base au dirigeant national élu, ne peut que proposer
des hypothèses et chercher à convaincre ; il ne lui appartient pas
de décider, de trancher, d'imposer. Il doit se garder aussi d'accepter
quoi que ce soit sans examen.
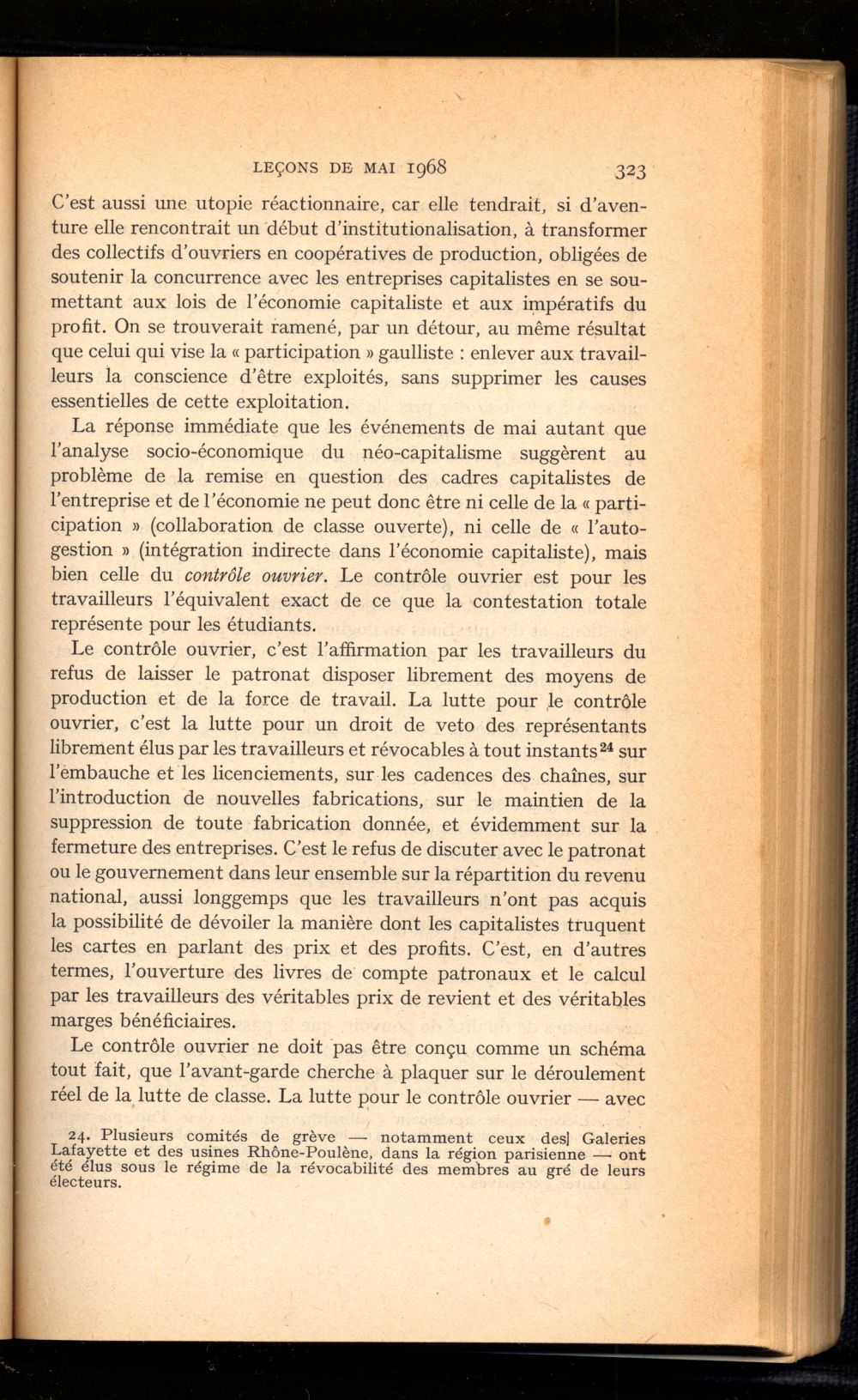

LEÇONS DE MAI IQÔ8
323
C'est aussi une utopie réactionnaire, car elle tendrait, si d'aven-
ture elle rencontrait un début d'institutionalisation, à transformer
des collectifs d'ouvriers en coopératives de production, obligées de
soutenir la concurrence avec les entreprises capitalistes en se sou-
mettant aux lois de l'économie capitaliste et aux impératifs du
profit. On se trouverait ramené, par un détour, au même résultat
que celui qui vise la « participation » gaulliste : enlever aux travail-
leurs la conscience d'être exploités, sans supprimer les causes
essentielles de cette exploitation.
ture elle rencontrait un début d'institutionalisation, à transformer
des collectifs d'ouvriers en coopératives de production, obligées de
soutenir la concurrence avec les entreprises capitalistes en se sou-
mettant aux lois de l'économie capitaliste et aux impératifs du
profit. On se trouverait ramené, par un détour, au même résultat
que celui qui vise la « participation » gaulliste : enlever aux travail-
leurs la conscience d'être exploités, sans supprimer les causes
essentielles de cette exploitation.
La réponse immédiate que les événements de mai autant que
l'analyse socio-économique du néo-capitalisme suggèrent au
problème de la remise en question des cadres capitalistes de
l'entreprise et de l'économie ne peut donc être ni celle de la « parti-
cipation » (collaboration de classe ouverte), ni celle de « l'auto-
gestion » (intégration indirecte dans l'économie capitaliste), mais
bien celle du contrôle ouvrier. Le contrôle ouvrier est pour les
travailleurs l'équivalent exact de ce que la contestation totale
représente pour les étudiants.
l'analyse socio-économique du néo-capitalisme suggèrent au
problème de la remise en question des cadres capitalistes de
l'entreprise et de l'économie ne peut donc être ni celle de la « parti-
cipation » (collaboration de classe ouverte), ni celle de « l'auto-
gestion » (intégration indirecte dans l'économie capitaliste), mais
bien celle du contrôle ouvrier. Le contrôle ouvrier est pour les
travailleurs l'équivalent exact de ce que la contestation totale
représente pour les étudiants.
Le contrôle ouvrier, c'est l'affirmation par les travailleurs du
refus de laisser le patronat disposer librement des moyens de
production et de la force de travail. La lutte pour le contrôle
ouvrier, c'est la lutte pour un droit de veto des représentants
librement élus par les travailleurs et révocables à tout instants24 sur
l'embauche et les licenciements, sur les cadences des chaînes, sur
l'introduction de nouvelles fabrications, sur le maintien de la
suppression de toute fabrication donnée, et évidemment sur la
fermeture des entreprises. C'est le refus de discuter avec le patronat
ou le gouvernement dans leur ensemble sur la répartition du revenu
national, aussi longgemps que les travailleurs n'ont pas acquis
la possibilité de dévoiler la manière dont les capitalistes truquent
les cartes en parlant des prix et des profits. C'est, en d'autres
termes, l'ouverture des livres de compte patronaux et le calcul
par les travailleurs des véritables prix de revient et des véritables
marges bénéficiaires.
refus de laisser le patronat disposer librement des moyens de
production et de la force de travail. La lutte pour le contrôle
ouvrier, c'est la lutte pour un droit de veto des représentants
librement élus par les travailleurs et révocables à tout instants24 sur
l'embauche et les licenciements, sur les cadences des chaînes, sur
l'introduction de nouvelles fabrications, sur le maintien de la
suppression de toute fabrication donnée, et évidemment sur la
fermeture des entreprises. C'est le refus de discuter avec le patronat
ou le gouvernement dans leur ensemble sur la répartition du revenu
national, aussi longgemps que les travailleurs n'ont pas acquis
la possibilité de dévoiler la manière dont les capitalistes truquent
les cartes en parlant des prix et des profits. C'est, en d'autres
termes, l'ouverture des livres de compte patronaux et le calcul
par les travailleurs des véritables prix de revient et des véritables
marges bénéficiaires.
Le contrôle ouvrier ne doit pas être conçu comme un schéma
tout fait, que l'avant-garde cherche à plaquer sur le déroulement
réel de la lutte de classe. La lutte pour le contrôle ouvrier — avec
tout fait, que l'avant-garde cherche à plaquer sur le déroulement
réel de la lutte de classe. La lutte pour le contrôle ouvrier — avec
24. Plusieurs comités de grève — notamment ceux des| Galeries
Lafayette et des usines Rhône-Poulène, dans la région parisienne —• ont
été élus sous le régime de la révocabilité des membres au gré de leurs
électeurs.
Lafayette et des usines Rhône-Poulène, dans la région parisienne —• ont
été élus sous le régime de la révocabilité des membres au gré de leurs
électeurs.
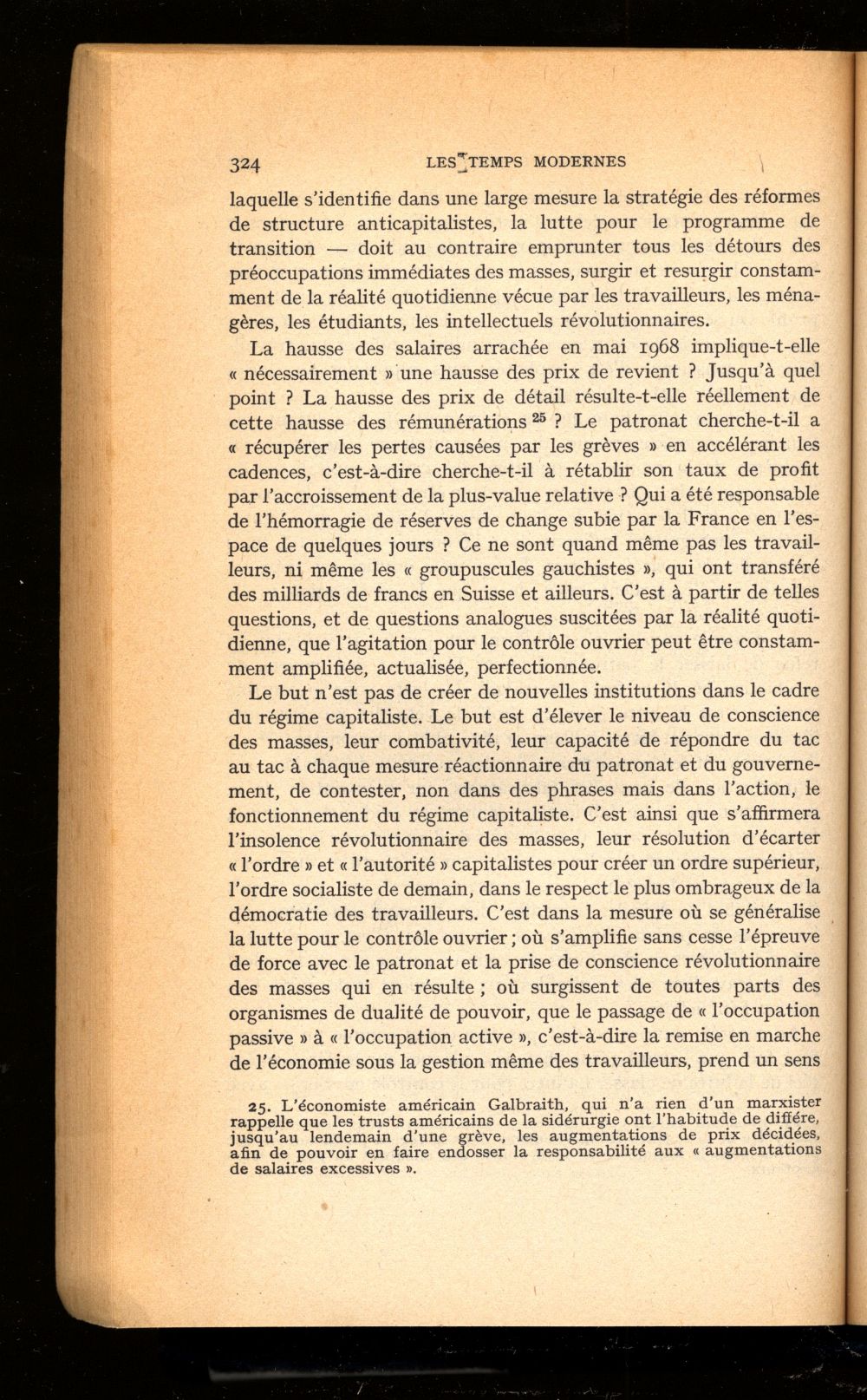

324
LES TEMPS MODERNES
laquelle s'identifie dans une large mesure la stratégie des réformes
de structure anticapitalistes, la lutte pour le programme de
transition —• doit au contraire emprunter tous les détours des
préoccupations immédiates des masses, surgir et resurgir constam-
ment de la réalité quotidienne vécue par les travailleurs, les ména-
gères, les étudiants, les intellectuels révolutionnaires.
de structure anticapitalistes, la lutte pour le programme de
transition —• doit au contraire emprunter tous les détours des
préoccupations immédiates des masses, surgir et resurgir constam-
ment de la réalité quotidienne vécue par les travailleurs, les ména-
gères, les étudiants, les intellectuels révolutionnaires.
La hausse des salaires arrachée en mai 1968 implique-t-elle
« nécessairement » une hausse des prix de revient ? Jusqu'à quel
point ? La hausse des prix de détail résulte-t-elle réellement de
cette hausse des rémunérations25 ? Le patronat cherche-t-il a
« récupérer les pertes causées par les grèves » en accélérant les
cadences, c'est-à-dire cherche-t-il à rétablir son taux de profit
par l'accroissement de la plus-value relative ? Qui a été responsable
de l'hémorragie de réserves de change subie par la France en l'es-
pace de quelques jours ? Ce ne sont quand même pas les travail-
leurs, ni même les « groupuscules gauchistes », qui ont transféré
des milliards de francs en Suisse et ailleurs. C'est à partir de telles
questions, et de questions analogues suscitées par la réalité quoti-
dienne, que l'agitation pour le contrôle ouvrier peut être constam-
ment amplifiée, actualisée, perfectionnée.
« nécessairement » une hausse des prix de revient ? Jusqu'à quel
point ? La hausse des prix de détail résulte-t-elle réellement de
cette hausse des rémunérations25 ? Le patronat cherche-t-il a
« récupérer les pertes causées par les grèves » en accélérant les
cadences, c'est-à-dire cherche-t-il à rétablir son taux de profit
par l'accroissement de la plus-value relative ? Qui a été responsable
de l'hémorragie de réserves de change subie par la France en l'es-
pace de quelques jours ? Ce ne sont quand même pas les travail-
leurs, ni même les « groupuscules gauchistes », qui ont transféré
des milliards de francs en Suisse et ailleurs. C'est à partir de telles
questions, et de questions analogues suscitées par la réalité quoti-
dienne, que l'agitation pour le contrôle ouvrier peut être constam-
ment amplifiée, actualisée, perfectionnée.
Le but n'est pas de créer de nouvelles institutions dans le cadre
du régime capitaliste. Le but est d'élever le niveau de conscience
des masses, leur combativité, leur capacité de répondre du tac
au tac à chaque mesure réactionnaire du patronat et du gouverne-
ment, de contester, non dans des phrases mais dans l'action, le
fonctionnement du régime capitaliste. C'est ainsi que s'affirmera
l'insolence révolutionnaire des masses, leur résolution d'écarter
« l'ordre » et « l'autorité » capitalistes pour créer un ordre supérieur,
l'ordre socialiste de demain, dans le respect le plus ombrageux de la
démocratie des travailleurs. C'est dans la mesure où se généralise
la lutte pour le contrôle ouvrier ; où s'amplifie sans cesse l'épreuve
de force avec le patronat et la prise de conscience révolutionnaire
des masses qui en résulte ; où surgissent de toutes parts des
organismes de dualité de pouvoir, que le passage de « l'occupation
passive » à « l'occupation active », c'est-à-dire la remise en marche
de l'économie sous la gestion même des travailleurs, prend un sens
du régime capitaliste. Le but est d'élever le niveau de conscience
des masses, leur combativité, leur capacité de répondre du tac
au tac à chaque mesure réactionnaire du patronat et du gouverne-
ment, de contester, non dans des phrases mais dans l'action, le
fonctionnement du régime capitaliste. C'est ainsi que s'affirmera
l'insolence révolutionnaire des masses, leur résolution d'écarter
« l'ordre » et « l'autorité » capitalistes pour créer un ordre supérieur,
l'ordre socialiste de demain, dans le respect le plus ombrageux de la
démocratie des travailleurs. C'est dans la mesure où se généralise
la lutte pour le contrôle ouvrier ; où s'amplifie sans cesse l'épreuve
de force avec le patronat et la prise de conscience révolutionnaire
des masses qui en résulte ; où surgissent de toutes parts des
organismes de dualité de pouvoir, que le passage de « l'occupation
passive » à « l'occupation active », c'est-à-dire la remise en marche
de l'économie sous la gestion même des travailleurs, prend un sens
25. L'économiste américain Galbraith, qui n'a rien d'un marxister
rappelle que les trusts américains de la sidérurgie ont l'habitude de diffère,
jusqu'au lendemain d'une grève, les augmentations de prix décidées,
afin de pouvoir en faire endosser la responsabilité aux « augmentations
de salaires excessives ».
rappelle que les trusts américains de la sidérurgie ont l'habitude de diffère,
jusqu'au lendemain d'une grève, les augmentations de prix décidées,
afin de pouvoir en faire endosser la responsabilité aux « augmentations
de salaires excessives ».
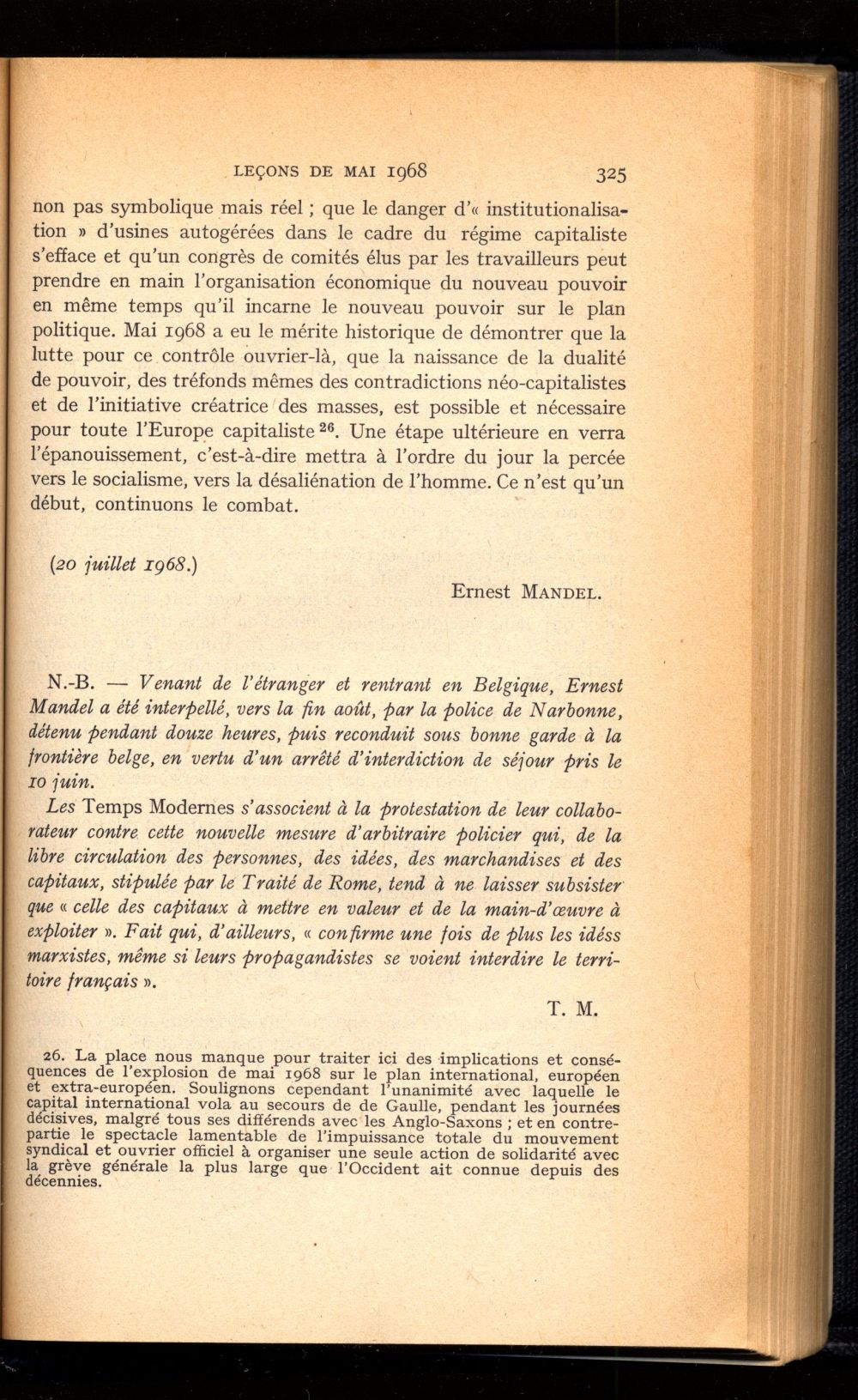

LEÇONS DE MAI Ig68
325
non pas symbolique mais réel ; que le danger d'« institutionalisa-
tion » d'usines autogérées dans le cadre du régime capitaliste
s'efface et qu'un congrès de comités élus par les travailleurs peut
prendre en main l'organisation économique du nouveau pouvoir
en même temps qu'il incarne le nouveau pouvoir sur le plan
politique. Mai 1968 a eu le mérite historique de démontrer que la
lutte pour ce contrôle ouvrier-là, que la naissance de la dualité
de pouvoir, des tréfonds mêmes des contradictions néo-capitalistes
et de l'initiative créatrice des masses, est possible et nécessaire
pour toute l'Europe capitaliste 26. Une étape ultérieure en verra
l'épanouissement, c'est-à-dire mettra à l'ordre du jour la percée
vers le socialisme, vers la désaliénation de l'homme. Ce n'est qu'un
début, continuons le combat.
tion » d'usines autogérées dans le cadre du régime capitaliste
s'efface et qu'un congrès de comités élus par les travailleurs peut
prendre en main l'organisation économique du nouveau pouvoir
en même temps qu'il incarne le nouveau pouvoir sur le plan
politique. Mai 1968 a eu le mérite historique de démontrer que la
lutte pour ce contrôle ouvrier-là, que la naissance de la dualité
de pouvoir, des tréfonds mêmes des contradictions néo-capitalistes
et de l'initiative créatrice des masses, est possible et nécessaire
pour toute l'Europe capitaliste 26. Une étape ultérieure en verra
l'épanouissement, c'est-à-dire mettra à l'ordre du jour la percée
vers le socialisme, vers la désaliénation de l'homme. Ce n'est qu'un
début, continuons le combat.
(20 juillet 1968.)
Ernest MANDEL.
N.-B. —• Venant de l'étranger et rentrant en Belgique, Ernest
Mandel a été interpellé, vers la fin août, par la police de Narbonne,
détenu pendant douze heures, puis reconduit sous bonne garde à la
frontière belge, en vertu d'un arrêté d'interdiction de séjour pris le
10 juin.
Mandel a été interpellé, vers la fin août, par la police de Narbonne,
détenu pendant douze heures, puis reconduit sous bonne garde à la
frontière belge, en vertu d'un arrêté d'interdiction de séjour pris le
10 juin.
Les Temps Modernes s'associent à la protestation de leur collabo-
rateur contre cette nouvelle mesure d'arbitraire policier qui, de la
libre circulation des personnes, des idées, des marchandises et des
capitaux, stipulée par le Traité de Rome, tend à ne laisser subsister
que « cette des capitaux à mettre en valeur et de la main-d'œuvre à
exploiter ». Fait qui, d'ailleurs, « confirme une fois de plus les idéss
marxistes, même si leurs propagandistes se voient interdire le terri-
toire français ».
rateur contre cette nouvelle mesure d'arbitraire policier qui, de la
libre circulation des personnes, des idées, des marchandises et des
capitaux, stipulée par le Traité de Rome, tend à ne laisser subsister
que « cette des capitaux à mettre en valeur et de la main-d'œuvre à
exploiter ». Fait qui, d'ailleurs, « confirme une fois de plus les idéss
marxistes, même si leurs propagandistes se voient interdire le terri-
toire français ».
T. M.
26. La place nous manque pour traiter ici des implications et consé-
quences de l'explosion de mai 1968 sur le plan international, européen
et extra-européen. Soulignons cependant l'unanimité avec laquelle le
capital international vola au secours de de Gaulle, pendant les journées
décisives, malgré tous ses différends avec les Anglo-Saxons ; et en contre-
partie le spectacle lamentable de l'impuissance totale du mouvement
syndical et ouvrier officiel à organiser une seule action de solidarité avec
la grève générale la plus large que l'Occident ait connue depuis des
décennies.
quences de l'explosion de mai 1968 sur le plan international, européen
et extra-européen. Soulignons cependant l'unanimité avec laquelle le
capital international vola au secours de de Gaulle, pendant les journées
décisives, malgré tous ses différends avec les Anglo-Saxons ; et en contre-
partie le spectacle lamentable de l'impuissance totale du mouvement
syndical et ouvrier officiel à organiser une seule action de solidarité avec
la grève générale la plus large que l'Occident ait connue depuis des
décennies.
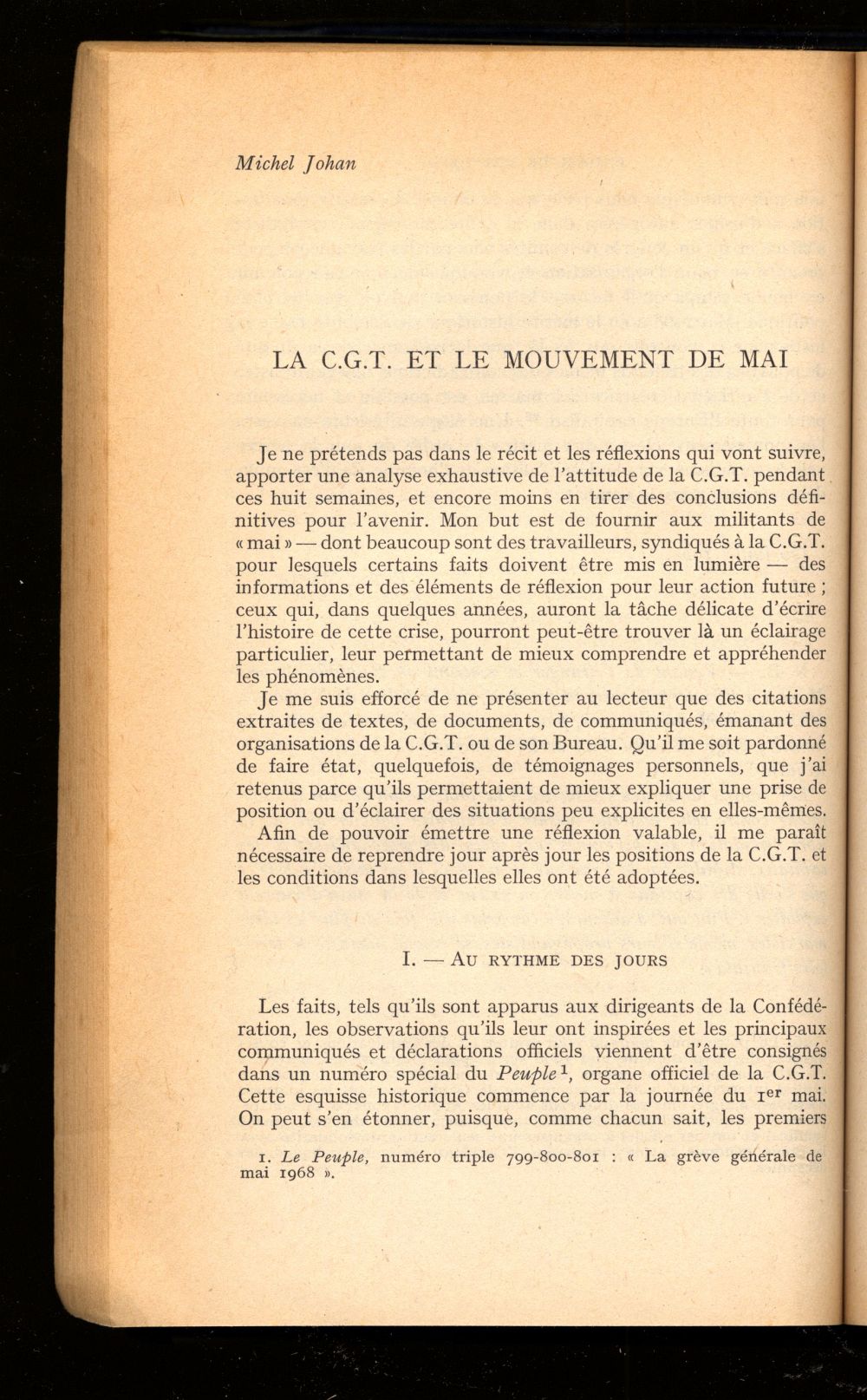

Michel Johan
LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
Je ne prétends pas dans le récit et les réflexions qui vont suivre,
apporter une analyse exhaustive de l'attitude de la C.G.T. pendant
ces huit semaines, et encore moins en tirer des conclusions défi-
nitives pour l'avenir. Mon but est de fournir aux militants de
« mai » — dont beaucoup sont des travailleurs, syndiqués à la C.G.T.
pour lesquels certains faits doivent être mis en lumière — des
informations et des éléments de réflexion pour leur action future ;
ceux qui, dans quelques années, auront la tâche délicate d'écrire
l'histoire de cette crise, pourront peut-être trouver là un éclairage
particulier, leur permettant de mieux comprendre et appréhender
les phénomènes.
apporter une analyse exhaustive de l'attitude de la C.G.T. pendant
ces huit semaines, et encore moins en tirer des conclusions défi-
nitives pour l'avenir. Mon but est de fournir aux militants de
« mai » — dont beaucoup sont des travailleurs, syndiqués à la C.G.T.
pour lesquels certains faits doivent être mis en lumière — des
informations et des éléments de réflexion pour leur action future ;
ceux qui, dans quelques années, auront la tâche délicate d'écrire
l'histoire de cette crise, pourront peut-être trouver là un éclairage
particulier, leur permettant de mieux comprendre et appréhender
les phénomènes.
Je me suis efforcé de ne présenter au lecteur que des citations
extraites de textes, de documents, de communiqués, émanant des
organisations de la C.G.T. ou de son Bureau. Qu'il me soit pardonné
de faire état, quelquefois, de témoignages personnels, que j'ai
retenus parce qu'ils permettaient de mieux expliquer une prise de
position ou d'éclairer des situations peu explicites en elles-mêmes.
extraites de textes, de documents, de communiqués, émanant des
organisations de la C.G.T. ou de son Bureau. Qu'il me soit pardonné
de faire état, quelquefois, de témoignages personnels, que j'ai
retenus parce qu'ils permettaient de mieux expliquer une prise de
position ou d'éclairer des situations peu explicites en elles-mêmes.
Afin de pouvoir émettre une réflexion valable, il me paraît
nécessaire de reprendre jour après jour les positions de la C.G.T. et
les conditions dans lesquelles elles ont été adoptées.
nécessaire de reprendre jour après jour les positions de la C.G.T. et
les conditions dans lesquelles elles ont été adoptées.
I. — Au RYTHME DES JOURS
Les faits, tels qu'ils sont apparus aux dirigeants de la Confédé-
ration, les observations qu'ils leur ont inspirées et les principaux
communiqués et déclarations officiels viennent d'être consignés
dans un numéro spécial du Peuple1, organe officiel de la C.G.T.
Cette esquisse historique commence par la journée du Ier mai.
On peut s'en étonner, puisque, comme chacun sait, les premiers
ration, les observations qu'ils leur ont inspirées et les principaux
communiqués et déclarations officiels viennent d'être consignés
dans un numéro spécial du Peuple1, organe officiel de la C.G.T.
Cette esquisse historique commence par la journée du Ier mai.
On peut s'en étonner, puisque, comme chacun sait, les premiers
i. Le Peuple, numéro triple 799-800-801
mai 1968 ».
mai 1968 ».
La grève générale de
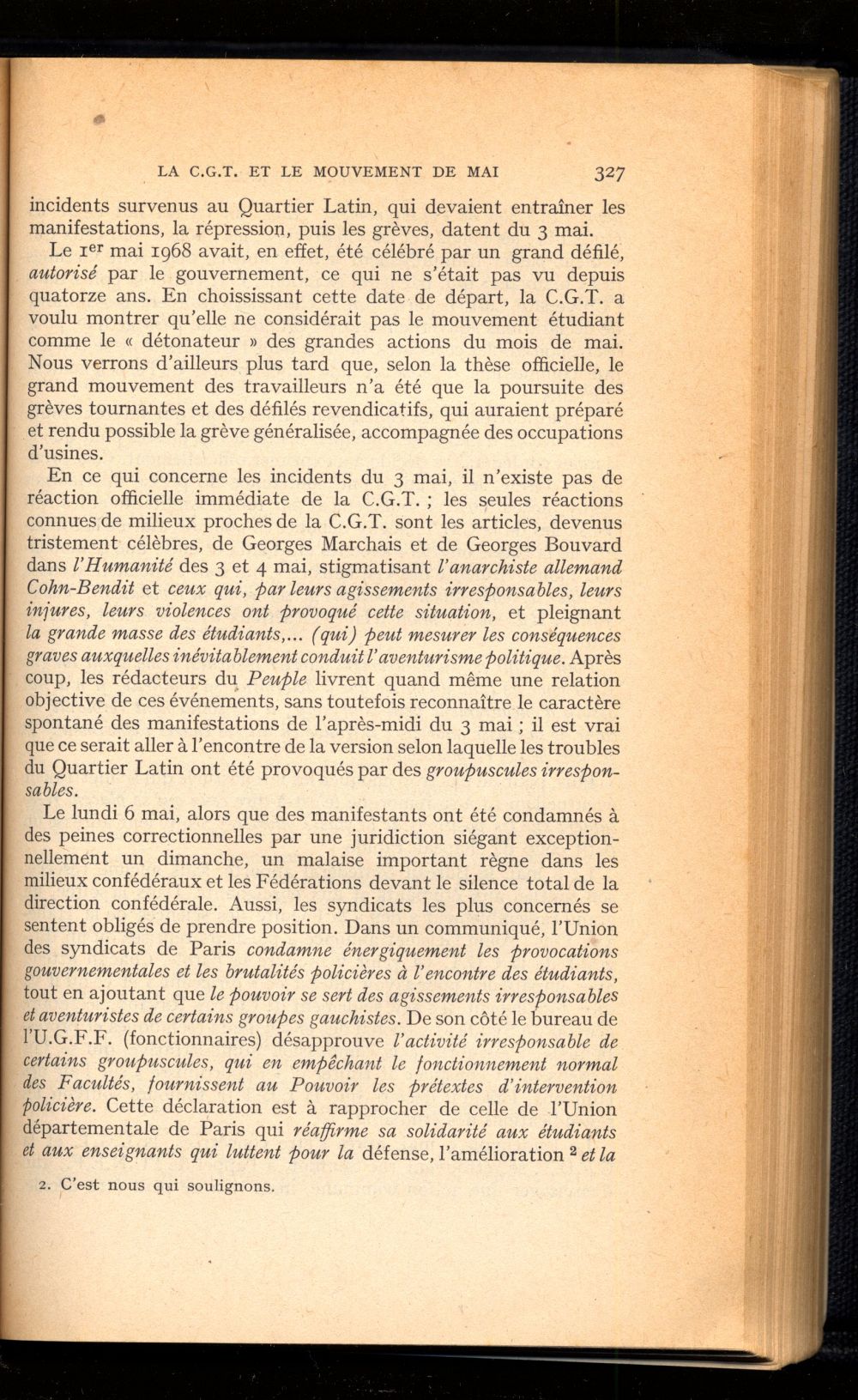

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
327
incidents survenus au Quartier Latin, qui devaient entraîner les
manifestations, la répression, puis les grèves, datent du 3 mai.
manifestations, la répression, puis les grèves, datent du 3 mai.
Le Ier mai 1968 avait, en effet, été célébré par un grand défilé,
autorisé par le gouvernement, ce qui ne s'était pas vu depuis
quatorze ans. En choississant cette date de départ, la C.G.T. a
voulu montrer qu'elle ne considérait pas le mouvement étudiant
comme le « détonateur » des grandes actions du mois de mai.
Nous verrons d'ailleurs plus tard que, selon la thèse officielle, le
grand mouvement des travailleurs n'a été que la poursuite des
grèves tournantes et des défilés revendicatifs, qui auraient préparé
et rendu possible la grève généralisée, accompagnée des occupations
d'usines.
autorisé par le gouvernement, ce qui ne s'était pas vu depuis
quatorze ans. En choississant cette date de départ, la C.G.T. a
voulu montrer qu'elle ne considérait pas le mouvement étudiant
comme le « détonateur » des grandes actions du mois de mai.
Nous verrons d'ailleurs plus tard que, selon la thèse officielle, le
grand mouvement des travailleurs n'a été que la poursuite des
grèves tournantes et des défilés revendicatifs, qui auraient préparé
et rendu possible la grève généralisée, accompagnée des occupations
d'usines.
En ce qui concerne les incidents du 3 mai, il n'existe pas de
réaction officielle immédiate de la C.G.T. ; les seules réactions
connues de milieux proches de la C.G.T. sont les articles, devenus
tristement célèbres, de Georges Marchais et de Georges Bouvard
dans l'Humanité des 3 et 4 mai, stigmatisant l'anarchiste allemand
Cohn-Bendit et ceux qui, par leurs agissements irresponsables, leurs
injures, leurs violences ont provoqué cette situation, et pleignant
la grande masse des étudiants,... (qui) peut mesurer les conséquences
graves auxquelles inévitablement conduit l'aventurisme politique. Après
coup, les rédacteurs du Peuple livrent quand même une relation
objective de ces événements, sans toutefois reconnaître le caractère
spontané des manifestations de l'après-midi du 3 mai ; il est vrai
que ce serait aller à l'encontre de la version selon laquelle les troubles
du Quartier Latin ont été provoqués par des groupuscules irrespon-
sables.
réaction officielle immédiate de la C.G.T. ; les seules réactions
connues de milieux proches de la C.G.T. sont les articles, devenus
tristement célèbres, de Georges Marchais et de Georges Bouvard
dans l'Humanité des 3 et 4 mai, stigmatisant l'anarchiste allemand
Cohn-Bendit et ceux qui, par leurs agissements irresponsables, leurs
injures, leurs violences ont provoqué cette situation, et pleignant
la grande masse des étudiants,... (qui) peut mesurer les conséquences
graves auxquelles inévitablement conduit l'aventurisme politique. Après
coup, les rédacteurs du Peuple livrent quand même une relation
objective de ces événements, sans toutefois reconnaître le caractère
spontané des manifestations de l'après-midi du 3 mai ; il est vrai
que ce serait aller à l'encontre de la version selon laquelle les troubles
du Quartier Latin ont été provoqués par des groupuscules irrespon-
sables.
Le lundi 6 mai, alors que des manifestants ont été condamnés à
des peines correctionnelles par une juridiction siégant exception-
nellement un dimanche, un malaise important règne dans les
milieux confédéraux et les Fédérations devant le silence total de la
direction confédérale. Aussi, les syndicats les plus concernés se
sentent obligés de prendre position. Dans un communiqué, l'Union
des syndicats de Paris condamne éner giquement les provocations
gouvernementales et les brutalités policières à l'encontre des étudiants,
tout en ajoutant que le pouvoir se sert des agissements irresponsables
et aventuristes de certains groupes gauchistes. De son côté le bureau de
l'U.G.F.F. (fonctionnaires) désapprouve l'activité irresponsable de
certains groupuscules, qui en empêchant le fonctionnement normal
des Facultés, fournissent au Pouvoir les prétextes d'intervention
policière. Cette déclaration est à rapprocher de celle de l'Union
départementale de Paris qui réaffirme sa solidarité aux étudiants
et aux enseignants qui luttent pour la défense, l'amélioration 2 et la
des peines correctionnelles par une juridiction siégant exception-
nellement un dimanche, un malaise important règne dans les
milieux confédéraux et les Fédérations devant le silence total de la
direction confédérale. Aussi, les syndicats les plus concernés se
sentent obligés de prendre position. Dans un communiqué, l'Union
des syndicats de Paris condamne éner giquement les provocations
gouvernementales et les brutalités policières à l'encontre des étudiants,
tout en ajoutant que le pouvoir se sert des agissements irresponsables
et aventuristes de certains groupes gauchistes. De son côté le bureau de
l'U.G.F.F. (fonctionnaires) désapprouve l'activité irresponsable de
certains groupuscules, qui en empêchant le fonctionnement normal
des Facultés, fournissent au Pouvoir les prétextes d'intervention
policière. Cette déclaration est à rapprocher de celle de l'Union
départementale de Paris qui réaffirme sa solidarité aux étudiants
et aux enseignants qui luttent pour la défense, l'amélioration 2 et la
2. C'est nous qui soulignons.
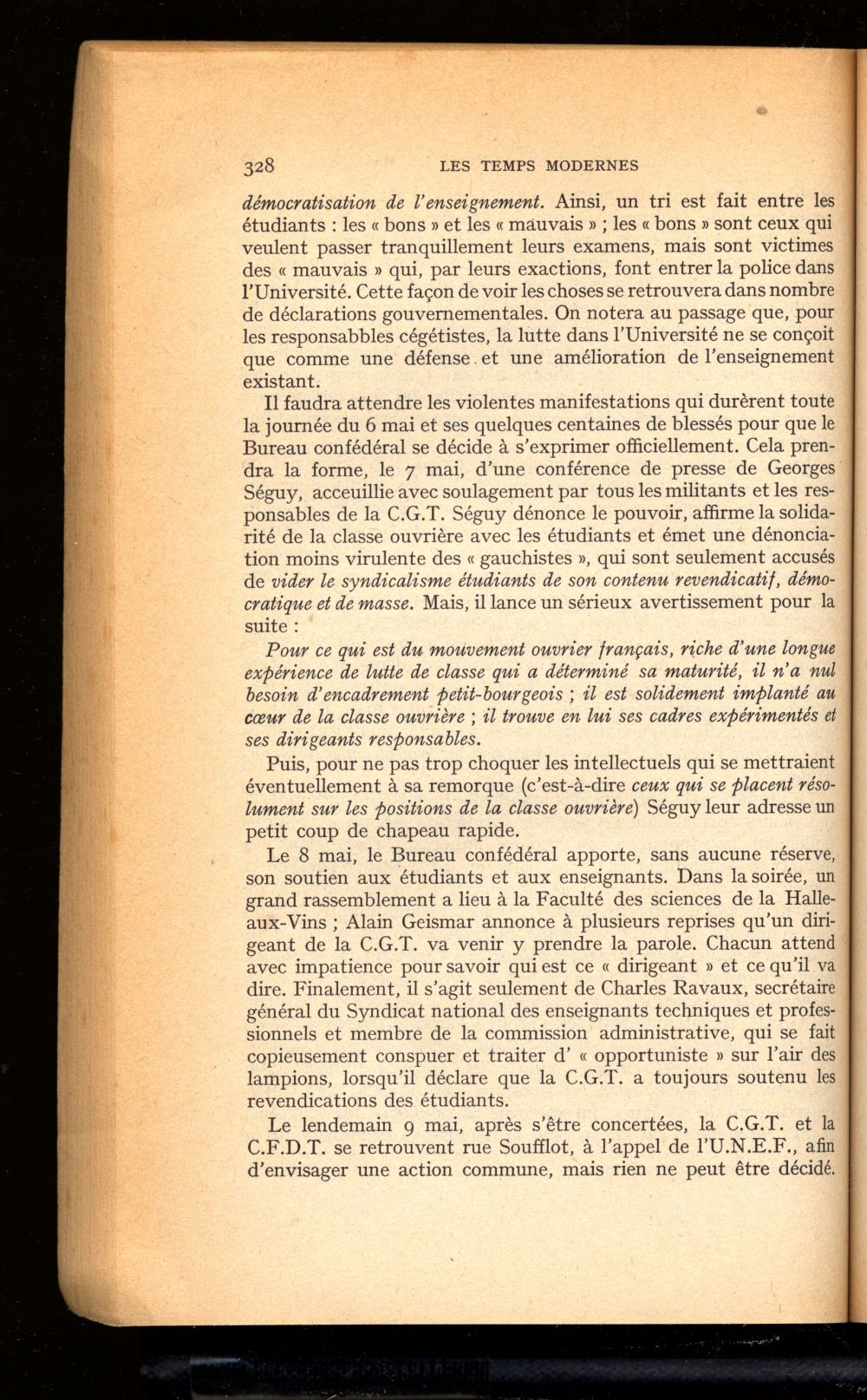

328
LES TEMPS MODERNES
démocratisation de l'enseignement. Ainsi, un tri est fait entre les
étudiants : les « bons » et les « mauvais » ; les « bons » sont ceux qui
veulent passer tranquillement leurs examens, mais sont victimes
des « mauvais » qui, par leurs exactions, font entrer la police dans
l'Université. Cette façon de voir les choses se retrouvera dans nombre
de déclarations gouvernementales. On notera au passage que, pour
les responsabbles cégétistes, la lutte dans l'Université ne se conçoit
que comme une défense et une amélioration de l'enseignement
existant.
étudiants : les « bons » et les « mauvais » ; les « bons » sont ceux qui
veulent passer tranquillement leurs examens, mais sont victimes
des « mauvais » qui, par leurs exactions, font entrer la police dans
l'Université. Cette façon de voir les choses se retrouvera dans nombre
de déclarations gouvernementales. On notera au passage que, pour
les responsabbles cégétistes, la lutte dans l'Université ne se conçoit
que comme une défense et une amélioration de l'enseignement
existant.
Il faudra attendre les violentes manifestations qui durèrent toute
la journée du 6 mai et ses quelques centaines de blessés pour que le
Bureau confédéral se décide à s'exprimer officiellement. Cela pren-
dra la forme, le 7 mai, d'une conférence de presse de Georges
Séguy, acceuillie avec soulagement par tous les militants et les res-
ponsables de la C.G.T. Séguy dénonce le pouvoir, affirme la solida-
rité de la classe ouvrière avec les étudiants et émet une dénoncia-
tion moins virulente des « gauchistes », qui sont seulement accusés
de vider le syndicalisme étudiants de son contenu revendicatif, démo-
cratique et de masse. Mais, il lance un sérieux avertissement pour la
suite :
la journée du 6 mai et ses quelques centaines de blessés pour que le
Bureau confédéral se décide à s'exprimer officiellement. Cela pren-
dra la forme, le 7 mai, d'une conférence de presse de Georges
Séguy, acceuillie avec soulagement par tous les militants et les res-
ponsables de la C.G.T. Séguy dénonce le pouvoir, affirme la solida-
rité de la classe ouvrière avec les étudiants et émet une dénoncia-
tion moins virulente des « gauchistes », qui sont seulement accusés
de vider le syndicalisme étudiants de son contenu revendicatif, démo-
cratique et de masse. Mais, il lance un sérieux avertissement pour la
suite :
Pour ce qui est du mouvement ouvrier français, riche d'une longue
expérience de lutte de classe qui a déterminé sa maturité, il n'a nul
besoin d'encadrement -petit-bourgeois ; il est solidement implanté au
cœur de la classe ouvrière ; il trouve en lui ses cadres expérimentés et
ses dirigeants responsables.
expérience de lutte de classe qui a déterminé sa maturité, il n'a nul
besoin d'encadrement -petit-bourgeois ; il est solidement implanté au
cœur de la classe ouvrière ; il trouve en lui ses cadres expérimentés et
ses dirigeants responsables.
Puis, pour ne pas trop choquer les intellectuels qui se mettraient
éventuellement à sa remorque (c'est-à-dire ceux qui se placent réso-
lument sur les positions de la classe ouvrière) Séguy leur adresse un
petit coup de chapeau rapide.
éventuellement à sa remorque (c'est-à-dire ceux qui se placent réso-
lument sur les positions de la classe ouvrière) Séguy leur adresse un
petit coup de chapeau rapide.
Le 8 mai, le Bureau confédéral apporte, sans aucune réserve,
son soutien aux étudiants et aux enseignants. Dans la soirée, un
grand rassemblement a lieu à la Faculté des sciences de la Halle-
aux-Vins ; Alain Geismar annonce à plusieurs reprises qu'un diri-
geant de la C.G.T. va venir y prendre la parole. Chacun attend
avec impatience pour savoir qui est ce « dirigeant » et ce qu'il va
dire. Finalement, il s'agit seulement de Charles Ravaux, secrétaire
général du Syndicat national des enseignants techniques et profes-
sionnels et membre de la commission administrative, qui se fait
copieusement conspuer et traiter d' « opportuniste » sur l'air des
lampions, lorsqu'il déclare que la C.G.T. a toujours soutenu les
revendications des étudiants.
son soutien aux étudiants et aux enseignants. Dans la soirée, un
grand rassemblement a lieu à la Faculté des sciences de la Halle-
aux-Vins ; Alain Geismar annonce à plusieurs reprises qu'un diri-
geant de la C.G.T. va venir y prendre la parole. Chacun attend
avec impatience pour savoir qui est ce « dirigeant » et ce qu'il va
dire. Finalement, il s'agit seulement de Charles Ravaux, secrétaire
général du Syndicat national des enseignants techniques et profes-
sionnels et membre de la commission administrative, qui se fait
copieusement conspuer et traiter d' « opportuniste » sur l'air des
lampions, lorsqu'il déclare que la C.G.T. a toujours soutenu les
revendications des étudiants.
Le lendemain 9 mai, après s'être concertées, la C.G.T. et la
C.F.D.T. se retrouvent rue Soufflot, à l'appel de l'U.N.E.F., afin
d'envisager une action commune, mais rien ne peut être décidé.
C.F.D.T. se retrouvent rue Soufflot, à l'appel de l'U.N.E.F., afin
d'envisager une action commune, mais rien ne peut être décidé.
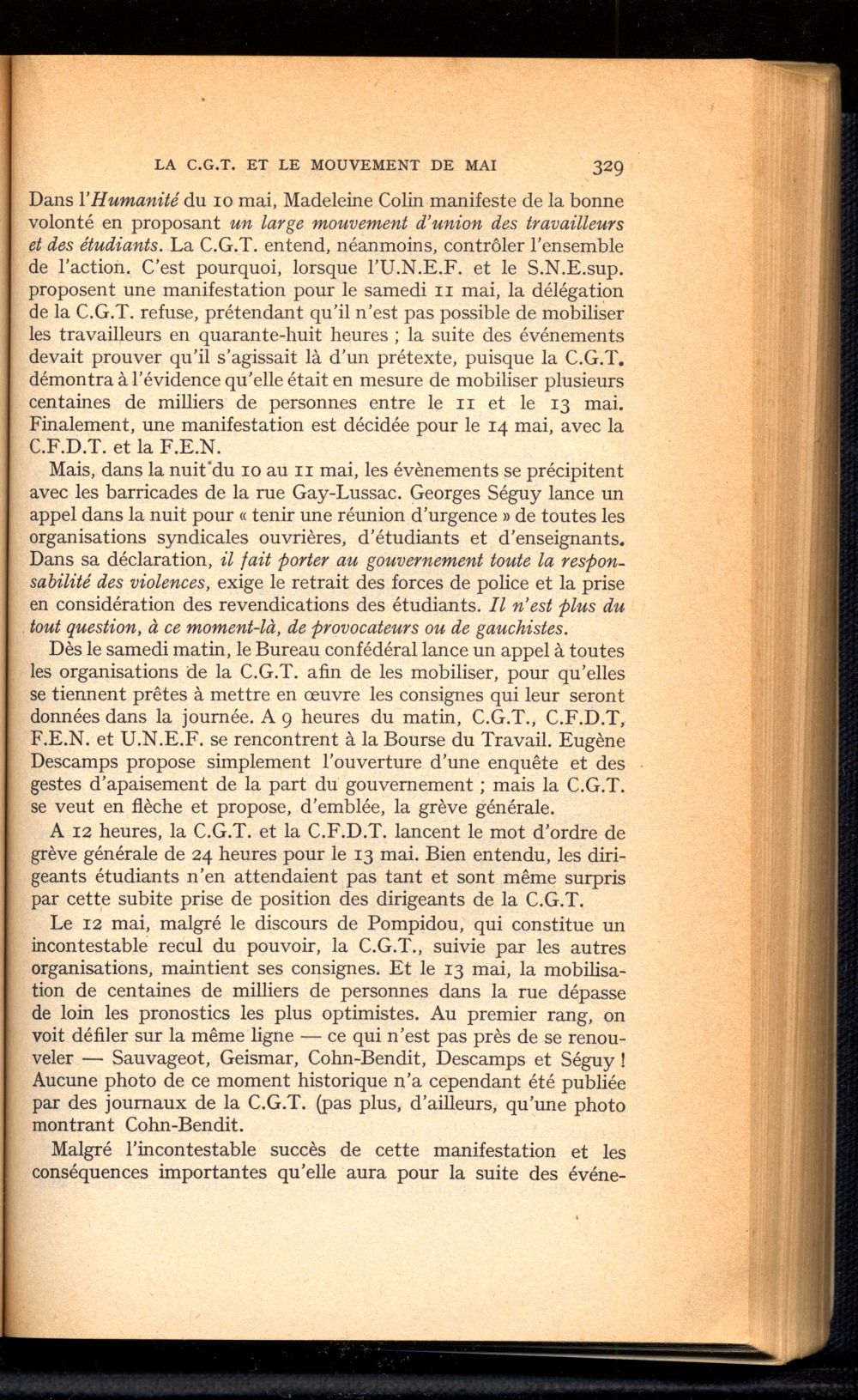

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
329
Dans l'Humanité du 10 mai, Madeleine Colin manifeste de la bonne
volonté en proposant un large mouvement d'union des travailleurs
et des étudiants. La C.G.T. entend, néanmoins, contrôler l'ensemble
de l'action. C'est pourquoi, lorsque l'U.N.E.F. et le S.N.E.sup.
proposent une manifestation pour le samedi n mai, la délégation
de la C.G.T. refuse, prétendant qu'il n'est pas possible de mobiliser
les travailleurs en quarante-huit heures ; la suite des événements
devait prouver qu'il s'agissait là d'un prétexte, puisque la C.G.T.
démontra à l'évidence qu'elle était en mesure de mobiliser plusieurs
centaines de milliers de personnes entre le n et le 13 mai.
Finalement, une manifestation est décidée pour le 14 mai, avec la
C.F.D.T. et la F.E.N.
volonté en proposant un large mouvement d'union des travailleurs
et des étudiants. La C.G.T. entend, néanmoins, contrôler l'ensemble
de l'action. C'est pourquoi, lorsque l'U.N.E.F. et le S.N.E.sup.
proposent une manifestation pour le samedi n mai, la délégation
de la C.G.T. refuse, prétendant qu'il n'est pas possible de mobiliser
les travailleurs en quarante-huit heures ; la suite des événements
devait prouver qu'il s'agissait là d'un prétexte, puisque la C.G.T.
démontra à l'évidence qu'elle était en mesure de mobiliser plusieurs
centaines de milliers de personnes entre le n et le 13 mai.
Finalement, une manifestation est décidée pour le 14 mai, avec la
C.F.D.T. et la F.E.N.
Mais, dans la nuit'du 10 au n mai, les événements se précipitent
avec les barricades de la rue Gay-Lussac. Georges Séguy lance un
appel dans la nuit pour « tenir une réunion d'urgence » de toutes les
organisations syndicales ouvrières, d'étudiants et d'enseignants.
Dans sa déclaration, il fait porter au gouvernement toute la respon-
sabilité des violences, exige le retrait des forces de police et la prise
en considération des revendications des étudiants. Il n'est plus du
tout question, à ce moment-là, de provocateurs ou de gauchistes.
avec les barricades de la rue Gay-Lussac. Georges Séguy lance un
appel dans la nuit pour « tenir une réunion d'urgence » de toutes les
organisations syndicales ouvrières, d'étudiants et d'enseignants.
Dans sa déclaration, il fait porter au gouvernement toute la respon-
sabilité des violences, exige le retrait des forces de police et la prise
en considération des revendications des étudiants. Il n'est plus du
tout question, à ce moment-là, de provocateurs ou de gauchistes.
Dès le samedi matin, le Bureau confédéral lance un appel à toutes
les organisations de la C.G.T. afin de les mobiliser, pour qu'elles
se tiennent prêtes à mettre en œuvre les consignes qui leur seront
données dans la journée. A g heures du matin, C.G.T., C.F.D.T,
F.E.N. et U.N.E.F. se rencontrent à la Bourse du Travail. Eugène
Descamps propose simplement l'ouverture d'une enquête et des
gestes d'apaisement de la part du gouvernement ; mais la C.G.T.
se veut en flèche et propose, d'emblée, la grève générale.
les organisations de la C.G.T. afin de les mobiliser, pour qu'elles
se tiennent prêtes à mettre en œuvre les consignes qui leur seront
données dans la journée. A g heures du matin, C.G.T., C.F.D.T,
F.E.N. et U.N.E.F. se rencontrent à la Bourse du Travail. Eugène
Descamps propose simplement l'ouverture d'une enquête et des
gestes d'apaisement de la part du gouvernement ; mais la C.G.T.
se veut en flèche et propose, d'emblée, la grève générale.
A 12 heures, la C.G.T. et la C.F.D.T. lancent le mot d'ordre de
grève générale de 24 heures pour le 13 mai. Bien entendu, les diri-
geants étudiants n'en attendaient pas tant et sont même surpris
par cette subite prise de position des dirigeants de la C.G.T.
grève générale de 24 heures pour le 13 mai. Bien entendu, les diri-
geants étudiants n'en attendaient pas tant et sont même surpris
par cette subite prise de position des dirigeants de la C.G.T.
Le 12 mai, malgré le discours de Pompidou, qui constitue un
incontestable recul du pouvoir, la C.G.T., suivie par les autres
organisations, maintient ses consignes. Et le 13 mai, la mobilisa-
tion de centaines de milliers de personnes dans la rue dépasse
de loin les pronostics les plus optimistes. Au premier rang, on
voit défiler sur la même ligne — ce qui n'est pas près de se renou-
veler — Sauvageot, Geismar, Cohn-Bendit, Descamps et Séguy !
Aucune photo de ce moment historique n'a cependant été publiée
par des journaux de la C.G.T. (pas plus, d'ailleurs, qu'une photo
montrant Cohn-Bendit.
incontestable recul du pouvoir, la C.G.T., suivie par les autres
organisations, maintient ses consignes. Et le 13 mai, la mobilisa-
tion de centaines de milliers de personnes dans la rue dépasse
de loin les pronostics les plus optimistes. Au premier rang, on
voit défiler sur la même ligne — ce qui n'est pas près de se renou-
veler — Sauvageot, Geismar, Cohn-Bendit, Descamps et Séguy !
Aucune photo de ce moment historique n'a cependant été publiée
par des journaux de la C.G.T. (pas plus, d'ailleurs, qu'une photo
montrant Cohn-Bendit.
Malgré l'incontestable succès de cette manifestation et les
conséquences importantes qu'elle aura pour la suite des événe-
conséquences importantes qu'elle aura pour la suite des événe-
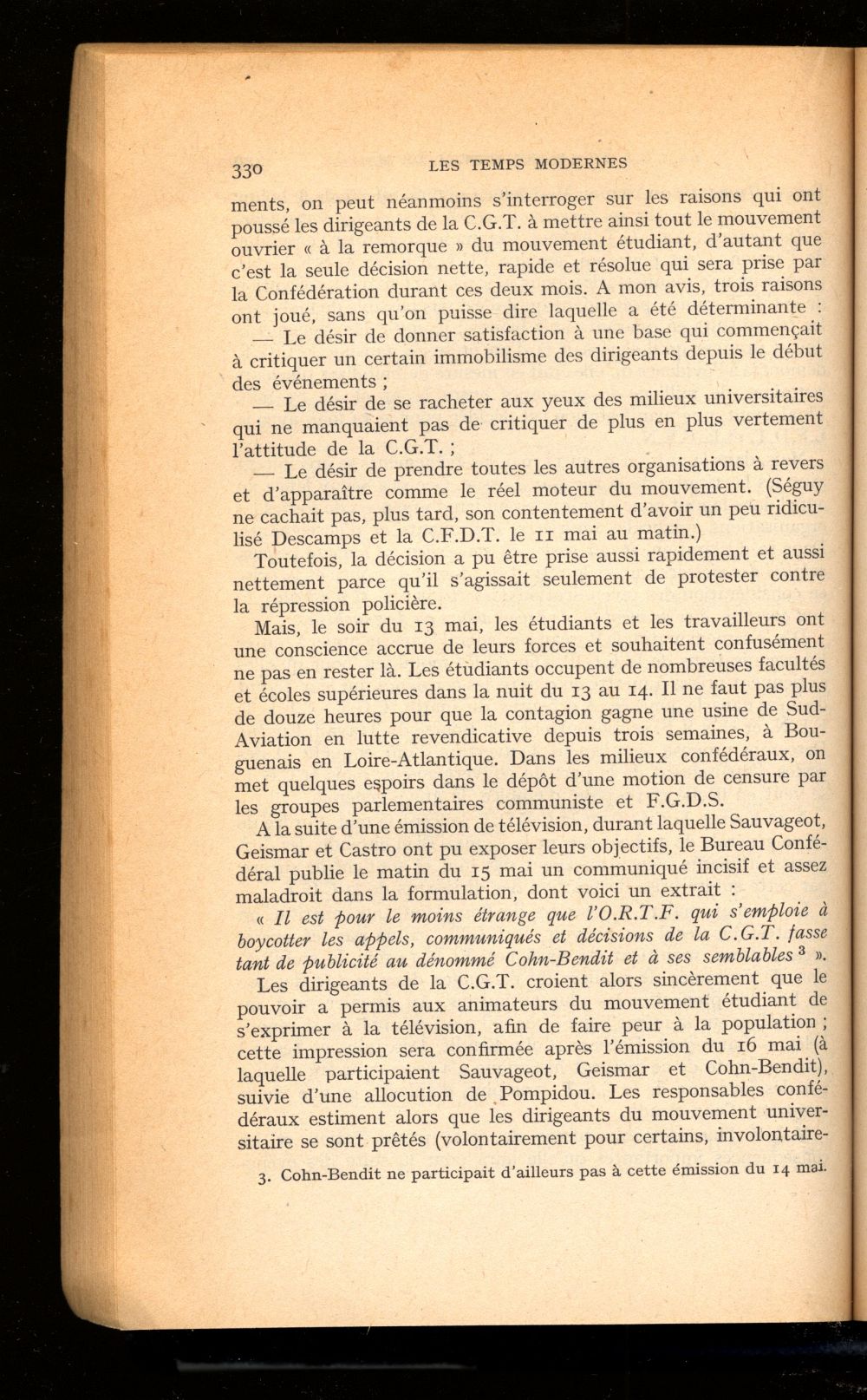

330
LES TEMPS MODERNES
ments, on peut néanmoins s'interroger sur les raisons qui ont
poussé les dirigeants de la C.G.T. à mettre ainsi tout le mouvement
ouvrier « à la remorque » du mouvement étudiant, d'autant que
c'est la seule décision nette, rapide et résolue qui sera prise par
la Confédération durant ces deux mois. A mon avis, trois raisons
ont joué, sans qu'on puisse dire laquelle, a été déterminante :
poussé les dirigeants de la C.G.T. à mettre ainsi tout le mouvement
ouvrier « à la remorque » du mouvement étudiant, d'autant que
c'est la seule décision nette, rapide et résolue qui sera prise par
la Confédération durant ces deux mois. A mon avis, trois raisons
ont joué, sans qu'on puisse dire laquelle, a été déterminante :
— Le désir de donner satisfaction à une base qui commençait
à critiquer un certain immobilisme, des dirigeants depuis le début
des événements ;
à critiquer un certain immobilisme, des dirigeants depuis le début
des événements ;
— Le désir de se racheter aux yeux des milieux universitaires
qui ne manquaient pas de critiquer de plus en plus vertement
l'attitude de la C.G.T. ;
qui ne manquaient pas de critiquer de plus en plus vertement
l'attitude de la C.G.T. ;
— Le désir de prendre toutes les autres organisations à revers
et d'apparaître comme le réel moteur du mouvement. (Séguy
ne cachait pas, plus tard, son contentement d'avoir un peu ridicu-
lisé Descamps et la C.F.D.T. le n mai au matin.)
et d'apparaître comme le réel moteur du mouvement. (Séguy
ne cachait pas, plus tard, son contentement d'avoir un peu ridicu-
lisé Descamps et la C.F.D.T. le n mai au matin.)
Toutefois, la décision a pu être prise aussi rapidement et aussi
nettement parce qu'il s'agissait seulement de protester contre
la répression policière.
nettement parce qu'il s'agissait seulement de protester contre
la répression policière.
Mais, le soir du 13 mai, les étudiants et les travailleurs ont
une conscience accrue de leurs forces et souhaitent confusément
ne pas en rester là. Les étudiants occupent de nombreuses facultés
et écoles supérieures dans la nuit du 13 au 14. Il ne faut pas plus
de douze heures pour que la contagion gagne une usine de Sud-
Aviation en lutte revendicative depuis trois semaines, à Bou-
guenais en Loire-Atlantique. Dans les milieux confédéraux, on
met quelques espoirs dans le dépôt d'une motion de censure par
les groupes parlementaires communiste et F.G.D.S.
une conscience accrue de leurs forces et souhaitent confusément
ne pas en rester là. Les étudiants occupent de nombreuses facultés
et écoles supérieures dans la nuit du 13 au 14. Il ne faut pas plus
de douze heures pour que la contagion gagne une usine de Sud-
Aviation en lutte revendicative depuis trois semaines, à Bou-
guenais en Loire-Atlantique. Dans les milieux confédéraux, on
met quelques espoirs dans le dépôt d'une motion de censure par
les groupes parlementaires communiste et F.G.D.S.
A la suite d'une émission de télévision, durant laquelle Sauvageot,
Geismar et Castro ont pu exposer leurs objectifs, le Bureau Confé-
déral publie le matin du 15 mai un communiqué incisif et assez
maladroit dans la formulation, dont voici un extrait :
Geismar et Castro ont pu exposer leurs objectifs, le Bureau Confé-
déral publie le matin du 15 mai un communiqué incisif et assez
maladroit dans la formulation, dont voici un extrait :
« II est pour le moins étrange que l'O.R.T.F. qui s'emploie à
boycotter les appels, communiqués et décisions de la C.G.T. fasse
tant de publicité au dénommé Cohn-Bendit et à ses semblables 3 ».
boycotter les appels, communiqués et décisions de la C.G.T. fasse
tant de publicité au dénommé Cohn-Bendit et à ses semblables 3 ».
Les dirigeants de la C.G.T. croient alors sincèrement que le
pouvoir a permis aux animateurs du mouvement étudiant de
s'exprimer à la télévision, afin de faire peur à la population ;
cette impression sera confirmée après l'émission du 16 mai (à
laquelle participaient Sauvageot, Geismar et Cohn-Bendit),
suivie d'une allocution de Pompidou. Les responsables confé-
déraux estiment alors que les dirigeants du mouvement univer-
sitaire se sont prêtés (volontairement pour certains, involontaire-
pouvoir a permis aux animateurs du mouvement étudiant de
s'exprimer à la télévision, afin de faire peur à la population ;
cette impression sera confirmée après l'émission du 16 mai (à
laquelle participaient Sauvageot, Geismar et Cohn-Bendit),
suivie d'une allocution de Pompidou. Les responsables confé-
déraux estiment alors que les dirigeants du mouvement univer-
sitaire se sont prêtés (volontairement pour certains, involontaire-
3. Cohn-Bendit ne participait d'ailleurs pas à cette émission du 14 mai.
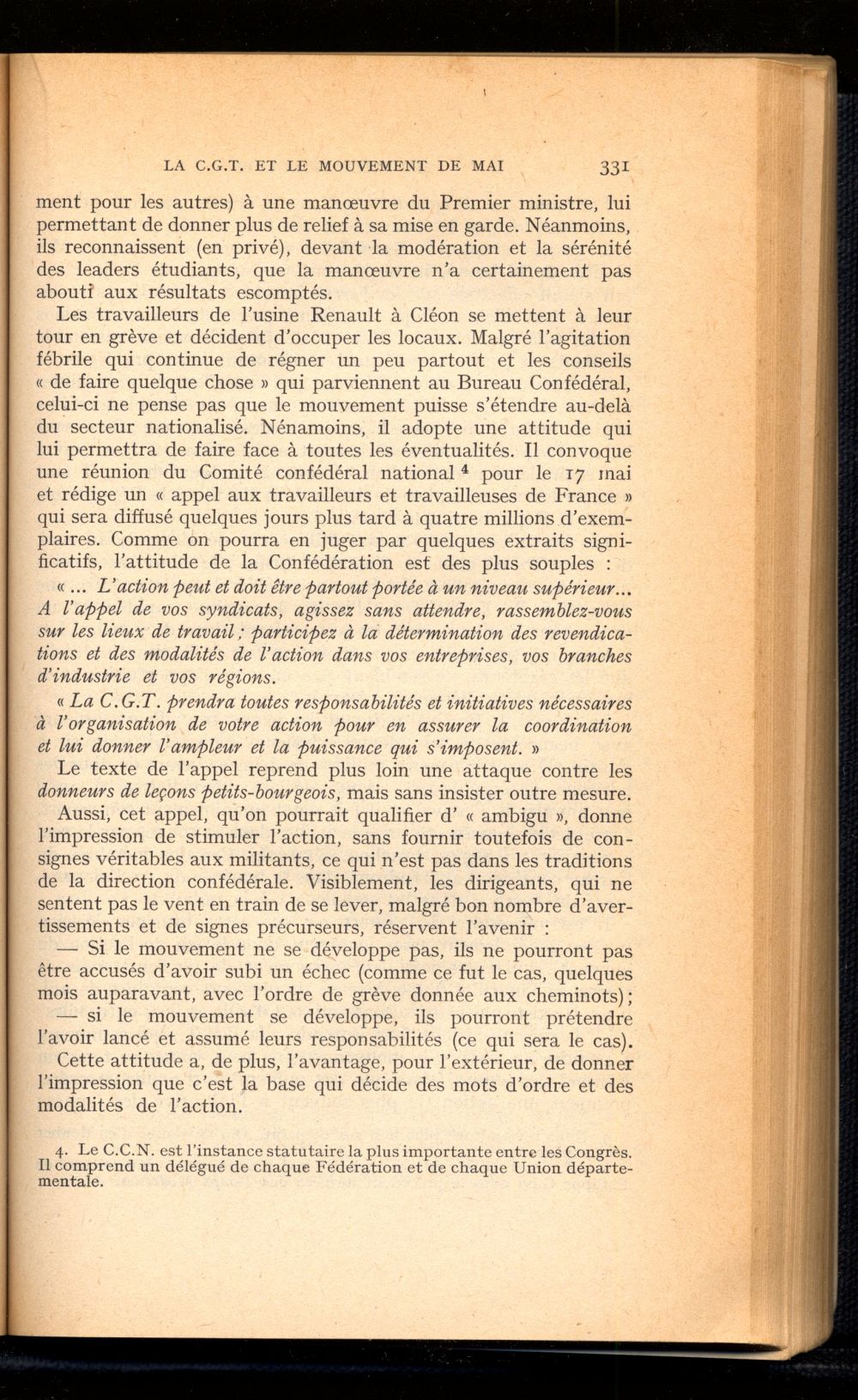

LA C.G.Ï. ET LE MOUVEMENT DE MAI
331
ment pour les autres) à une manœuvre du Premier ministre, lui
permettant de donner plus de relief à sa mise en garde. Néanmoins,
ils reconnaissent (en privé), devant la modération et la sérénité
des leaders étudiants, que la manœuvre n'a certainement pas
abouti aux résultats escomptés.
permettant de donner plus de relief à sa mise en garde. Néanmoins,
ils reconnaissent (en privé), devant la modération et la sérénité
des leaders étudiants, que la manœuvre n'a certainement pas
abouti aux résultats escomptés.
Les travailleurs de l'usine Renault à Cléon se mettent à leur
tour en grève et décident d'occuper les locaux. Malgré l'agitation
fébrile qui continue de régner un peu partout et les conseils
« de faire quelque chose » qui parviennent au Bureau Confédéral,
celui-ci ne pense pas que le mouvement puisse s'étendre au-delà
du secteur nationalisé. Nénamoins, il adopte une attitude qui
lui permettra de faire face à toutes les éventualités. Il convoque
une réunion du Comité confédéral national4 pour le 17 mai
et rédige un « appel aux travailleurs et travailleuses de France »
qui sera diffusé quelques jours plus tard à quatre millions d'exem-
plaires. Comme on pourra en juger par quelques extraits signi-
ficatifs, l'attitude de la Confédération est des plus souples :
tour en grève et décident d'occuper les locaux. Malgré l'agitation
fébrile qui continue de régner un peu partout et les conseils
« de faire quelque chose » qui parviennent au Bureau Confédéral,
celui-ci ne pense pas que le mouvement puisse s'étendre au-delà
du secteur nationalisé. Nénamoins, il adopte une attitude qui
lui permettra de faire face à toutes les éventualités. Il convoque
une réunion du Comité confédéral national4 pour le 17 mai
et rédige un « appel aux travailleurs et travailleuses de France »
qui sera diffusé quelques jours plus tard à quatre millions d'exem-
plaires. Comme on pourra en juger par quelques extraits signi-
ficatifs, l'attitude de la Confédération est des plus souples :
«... L'action peut et doit être partout portée à un niveau supérieur...
A l'appel de vos syndicats, agissez sans attendre, rassemblez-vous
sur les lieux de travail : participez à la détermination des revendica-
tions et des modalités de l'action dans vos entreprises, vos branches
d'industrie et vos régions.
A l'appel de vos syndicats, agissez sans attendre, rassemblez-vous
sur les lieux de travail : participez à la détermination des revendica-
tions et des modalités de l'action dans vos entreprises, vos branches
d'industrie et vos régions.
« La C.G.T. prendra toutes responsabilités et initiatives nécessaires
à l'organisation de votre action pour en assurer la coordination
et lui donner l'ampleur et la puissance qui s'imposent. »
à l'organisation de votre action pour en assurer la coordination
et lui donner l'ampleur et la puissance qui s'imposent. »
Le texte de l'appel reprend plus loin une attaque contre les
donneurs de leçons petits-bourgeois, mais sans insister outre mesure.
donneurs de leçons petits-bourgeois, mais sans insister outre mesure.
Aussi, cet appel, qu'on pourrait qualifier d' « ambigu », donne
l'impression de stimuler l'action, sans fournir toutefois de con-
signes véritables aux militants, ce qui n'est pas dans les traditions
de la direction confédérale. Visiblement, les dirigeants, qui ne
sentent pas le vent en train de se lever, malgré bon nombre d'aver-
tissements et de signes précurseurs, réservent l'avenir :
l'impression de stimuler l'action, sans fournir toutefois de con-
signes véritables aux militants, ce qui n'est pas dans les traditions
de la direction confédérale. Visiblement, les dirigeants, qui ne
sentent pas le vent en train de se lever, malgré bon nombre d'aver-
tissements et de signes précurseurs, réservent l'avenir :
— Si le mouvement ne se développe pas, ils ne pourront pas
être accusés d'avoir subi un échec (comme ce fut le cas, quelques
mois auparavant, avec l'ordre de grève donnée aux cheminots);
être accusés d'avoir subi un échec (comme ce fut le cas, quelques
mois auparavant, avec l'ordre de grève donnée aux cheminots);
— si le mouvement se développe, ils pourront prétendre
l'avoir lancé et assumé leurs responsabilités (ce qui sera le cas).
l'avoir lancé et assumé leurs responsabilités (ce qui sera le cas).
Cette attitude a, de plus, l'avantage, pour l'extérieur, de donner
l'impression que c'est la base qui décide des mots d'ordre et des
modalités de l'action.
l'impression que c'est la base qui décide des mots d'ordre et des
modalités de l'action.
4. Le C.C.N. est l'instance statutaire la plus importante entre les Congrès.
Il comprend un délégué de chaque Fédération et de chaque Union départe-
mentale.
Il comprend un délégué de chaque Fédération et de chaque Union départe-
mentale.
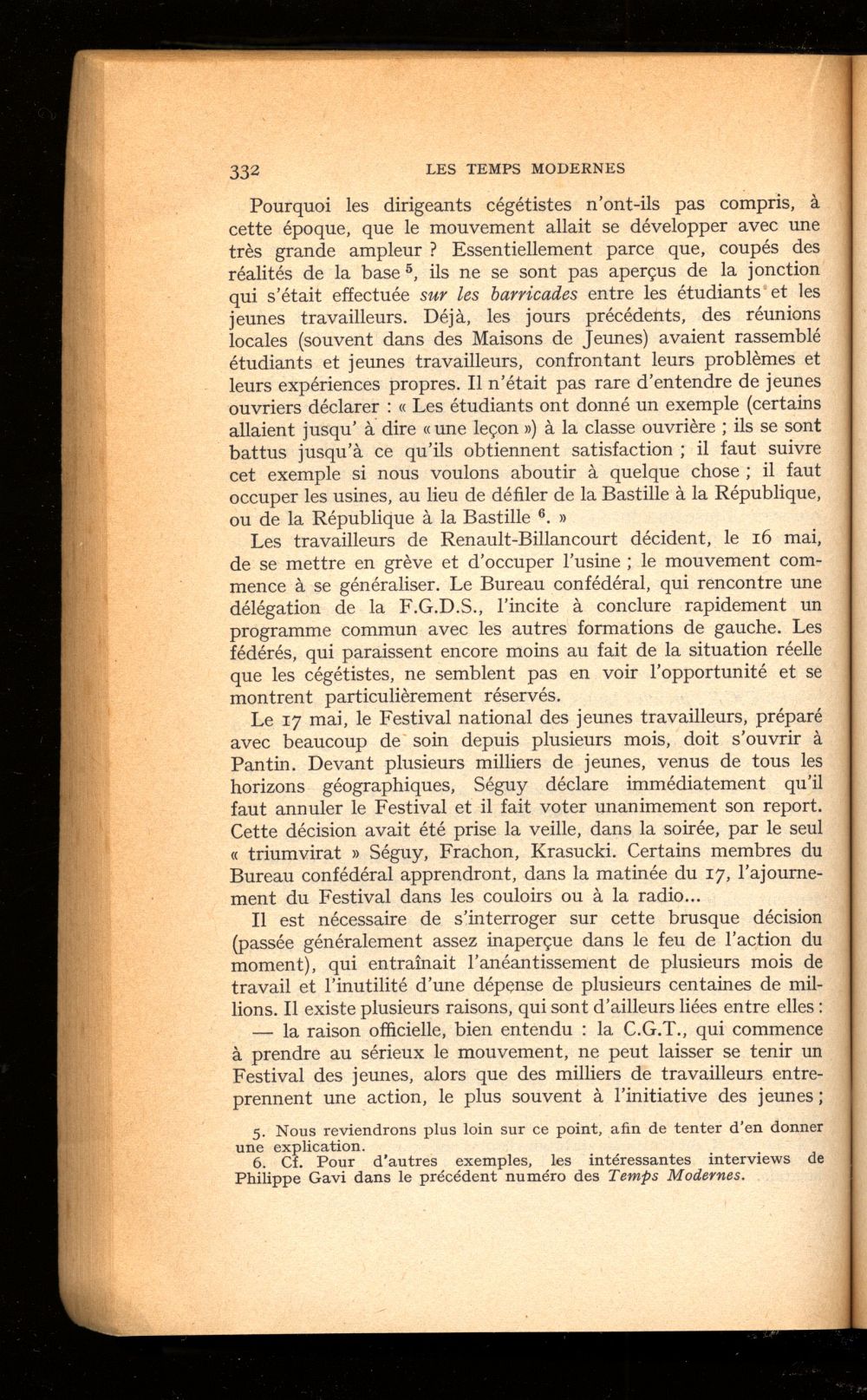

332
LES TEMPS MODERNES
Pourquoi les dirigeants cégétistes n'ont-ils pas compris, à
cette époque, que le mouvement allait se développer avec une
très grande ampleur ? Essentiellement parce que, coupés des
réalités de la base5, ils ne se sont pas aperçus de la jonction
qui s'était effectuée sur les barricades entre les étudiants et les
jeunes travailleurs. Déjà, les jours précédents, des réunions
locales (souvent dans des Maisons de Jeunes) avaient rassemblé
étudiants et jeunes travailleurs, confrontant leurs problèmes et
leurs expériences propres. Il n'était pas rare d'entendre de jeunes
ouvriers déclarer : « Les étudiants ont donné un exemple (certains
allaient jusqu' à dire « une leçon ») à la classe ouvrière ; ils se sont
battus jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction ; il faut suivre
cet exemple si nous voulons aboutir à quelque chose ; il faut
occuper les usines, au lieu de défiler de la Bastille à la République,
ou de la République à la Bastille 6. »
cette époque, que le mouvement allait se développer avec une
très grande ampleur ? Essentiellement parce que, coupés des
réalités de la base5, ils ne se sont pas aperçus de la jonction
qui s'était effectuée sur les barricades entre les étudiants et les
jeunes travailleurs. Déjà, les jours précédents, des réunions
locales (souvent dans des Maisons de Jeunes) avaient rassemblé
étudiants et jeunes travailleurs, confrontant leurs problèmes et
leurs expériences propres. Il n'était pas rare d'entendre de jeunes
ouvriers déclarer : « Les étudiants ont donné un exemple (certains
allaient jusqu' à dire « une leçon ») à la classe ouvrière ; ils se sont
battus jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction ; il faut suivre
cet exemple si nous voulons aboutir à quelque chose ; il faut
occuper les usines, au lieu de défiler de la Bastille à la République,
ou de la République à la Bastille 6. »
Les travailleurs de Renault-Billancourt décident, le 16 mai,
de se mettre en grève et d'occuper l'usine ; le mouvement com-
mence à se généraliser. Le Bureau confédéral, qui rencontre une
délégation de la F.G.D.S., l'incite à conclure rapidement un
programme commun avec les autres formations de gauche. Les
fédérés, qui paraissent encore moins au fait de la situation réelle
que les cégétistes, ne semblent pas en voir l'opportunité et se
montrent particulièrement réservés.
de se mettre en grève et d'occuper l'usine ; le mouvement com-
mence à se généraliser. Le Bureau confédéral, qui rencontre une
délégation de la F.G.D.S., l'incite à conclure rapidement un
programme commun avec les autres formations de gauche. Les
fédérés, qui paraissent encore moins au fait de la situation réelle
que les cégétistes, ne semblent pas en voir l'opportunité et se
montrent particulièrement réservés.
Le 17 mai, le Festival national des jeunes travailleurs, préparé
avec beaucoup de soin depuis plusieurs mois, doit s'ouvrir à
Pantin. Devant plusieurs milliers de jeunes, venus de tous les
horizons géographiques, Séguy déclare immédiatement qu'il
faut annuler le Festival et il fait voter unanimement son report.
Cette décision avait été prise la veille, dans la soirée, par le seul
« triumvirat » Séguy, Frachon, Krasucki. Certains membres du
Bureau confédéral apprendront, dans la matinée du 17, l'ajourne-
ment du Festival dans les couloirs ou à la radio...
avec beaucoup de soin depuis plusieurs mois, doit s'ouvrir à
Pantin. Devant plusieurs milliers de jeunes, venus de tous les
horizons géographiques, Séguy déclare immédiatement qu'il
faut annuler le Festival et il fait voter unanimement son report.
Cette décision avait été prise la veille, dans la soirée, par le seul
« triumvirat » Séguy, Frachon, Krasucki. Certains membres du
Bureau confédéral apprendront, dans la matinée du 17, l'ajourne-
ment du Festival dans les couloirs ou à la radio...
Il est nécessaire de s'interroger sur cette brusque décision
(passée généralement assez inaperçue dans le feu de l'action du
moment), qui entraînait l'anéantissement de plusieurs mois de
travail et l'inutilité d'une dépense de plusieurs centaines de mil-
lions. Il existe plusieurs raisons, qui sont d'ailleurs liées entre elles :
(passée généralement assez inaperçue dans le feu de l'action du
moment), qui entraînait l'anéantissement de plusieurs mois de
travail et l'inutilité d'une dépense de plusieurs centaines de mil-
lions. Il existe plusieurs raisons, qui sont d'ailleurs liées entre elles :
— la raison officielle, bien entendu : la C.G.T., qui commence
à prendre au sérieux le mouvement, ne peut laisser se tenir un
Festival des jeunes, alors que des milliers de travailleurs entre-
prennent une action, le plus souvent à l'initiative des jeunes ;
à prendre au sérieux le mouvement, ne peut laisser se tenir un
Festival des jeunes, alors que des milliers de travailleurs entre-
prennent une action, le plus souvent à l'initiative des jeunes ;
5. Nous reviendrons plus loin sur ce point, afin de tenter d'en donner
une explication.
une explication.
6. Cf. Pour d'autres exemples, les intéressantes interviews de
Philippe Gavi dans le précédent numéro des Temps Modernes.
Philippe Gavi dans le précédent numéro des Temps Modernes.
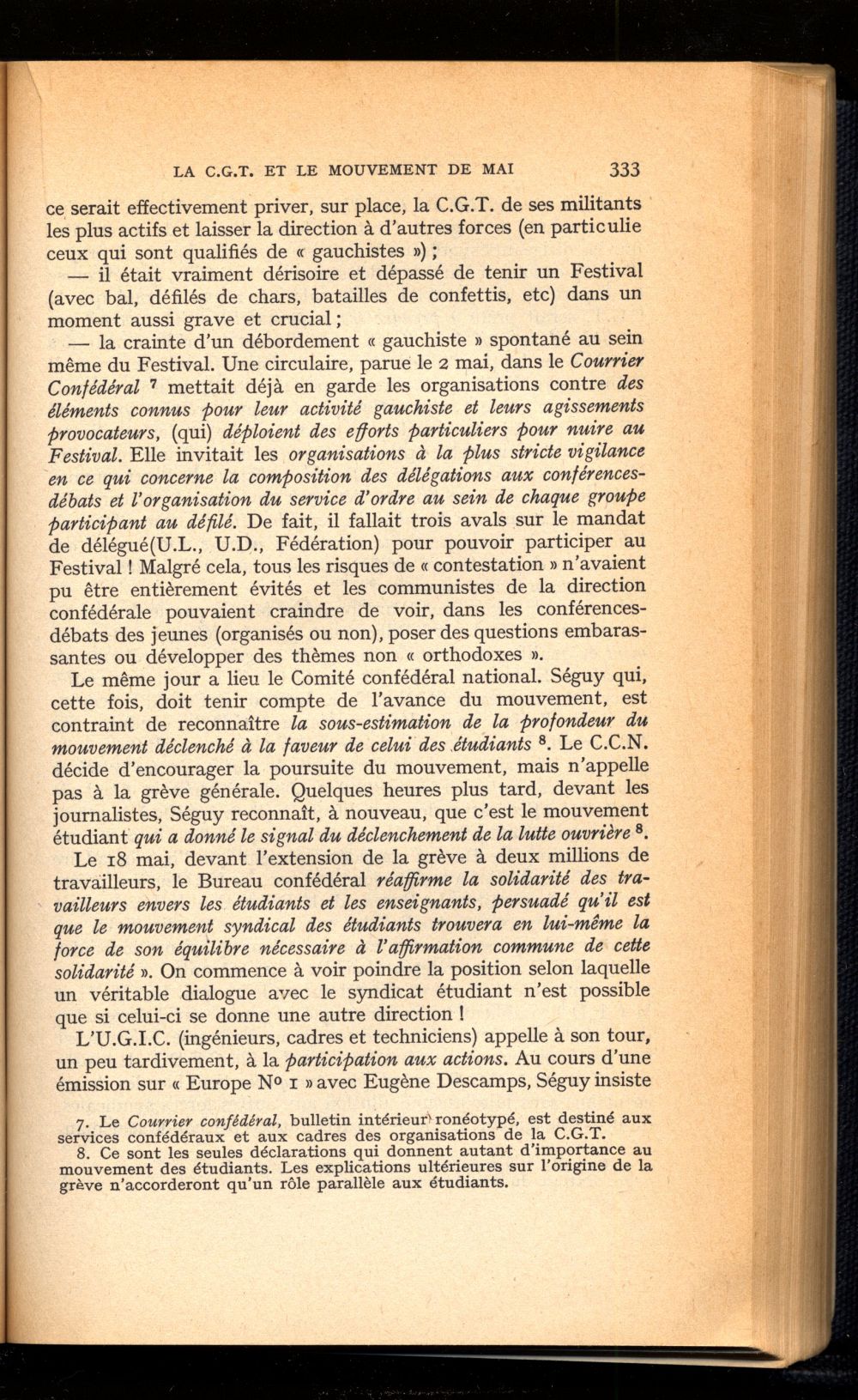

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI 333
ce serait effectivement priver, sur place, la C.G.T. de ses militants
les plus actifs et laisser la direction à d'autres forces (en particulie
ceux qui sont qualifiés de « gauchistes ») ;
les plus actifs et laisser la direction à d'autres forces (en particulie
ceux qui sont qualifiés de « gauchistes ») ;
—• il était vraiment dérisoire et dépassé de tenir un Festival
(avec bal, défilés de chars, batailles de confettis, etc) dans un
moment aussi grave et crucial ;
(avec bal, défilés de chars, batailles de confettis, etc) dans un
moment aussi grave et crucial ;
—- la crainte d'un débordement « gauchiste » spontané au sein
même du Festival. Une circulaire, parue le 2 mai, dans le Courrier
Confédéral 1 mettait déjà en garde les organisations contre des
éléments connus pour leur activité gauchiste et leurs agissements
provocateurs, (qui) déploient des efforts particuliers pour nuire au
Festival. Elle invitait les organisations à la plus stricte vigilance
en ce qui concerne la composition des délégations aux conférences-
débats et l'organisation du service d'ordre au sein de chaque groupe
participant au défilé. De fait, il fallait trois avals sur le mandat
de délégué(U.L., U.D., Fédération) pour pouvoir participer au
Festival ! Malgré cela, tous les risques de « contestation » n'avaient
pu être entièrement évités et les communistes de la direction
confédérale pouvaient craindre de voir, dans les conférences-
débats des jeunes (organisés ou non), poser des questions embaras-
santes ou développer des thèmes non « orthodoxes ».
même du Festival. Une circulaire, parue le 2 mai, dans le Courrier
Confédéral 1 mettait déjà en garde les organisations contre des
éléments connus pour leur activité gauchiste et leurs agissements
provocateurs, (qui) déploient des efforts particuliers pour nuire au
Festival. Elle invitait les organisations à la plus stricte vigilance
en ce qui concerne la composition des délégations aux conférences-
débats et l'organisation du service d'ordre au sein de chaque groupe
participant au défilé. De fait, il fallait trois avals sur le mandat
de délégué(U.L., U.D., Fédération) pour pouvoir participer au
Festival ! Malgré cela, tous les risques de « contestation » n'avaient
pu être entièrement évités et les communistes de la direction
confédérale pouvaient craindre de voir, dans les conférences-
débats des jeunes (organisés ou non), poser des questions embaras-
santes ou développer des thèmes non « orthodoxes ».
Le même jour a lieu le Comité confédéral national. Séguy qui,
cette fois, doit tenir compte de l'avance du mouvement, est
contraint de reconnaître la sous-estimation de la profondeur du
mouvement déclenché à la faveur de celui des étudiants 8. Le C.C.N.
décide d'encourager la poursuite du mouvement, mais n'appelle
pas à la grève générale. Quelques heures plus tard, devant les
journalistes, Séguy reconnaît, à nouveau, que c'est le mouvement
étudiant qui a donné le signal du déclenchement de la lutte ouvrière *.
cette fois, doit tenir compte de l'avance du mouvement, est
contraint de reconnaître la sous-estimation de la profondeur du
mouvement déclenché à la faveur de celui des étudiants 8. Le C.C.N.
décide d'encourager la poursuite du mouvement, mais n'appelle
pas à la grève générale. Quelques heures plus tard, devant les
journalistes, Séguy reconnaît, à nouveau, que c'est le mouvement
étudiant qui a donné le signal du déclenchement de la lutte ouvrière *.
Le 18 mai, devant l'extension de la grève à deux millions de
travailleurs, le Bureau confédéral réaffirme la solidarité des tra-
vailleurs envers les étudiants et les enseignants, persuadé qu'il est
que le mouvement syndical des étudiants trouvera en lui-même la
force de son équilibre nécessaire à l'affirmation commune de cette
solidarité ». On commence à voir poindre la position selon laquelle
un véritable dialogue avec le syndicat étudiant n'est possible
que si celui-ci se donne une autre direction !
travailleurs, le Bureau confédéral réaffirme la solidarité des tra-
vailleurs envers les étudiants et les enseignants, persuadé qu'il est
que le mouvement syndical des étudiants trouvera en lui-même la
force de son équilibre nécessaire à l'affirmation commune de cette
solidarité ». On commence à voir poindre la position selon laquelle
un véritable dialogue avec le syndicat étudiant n'est possible
que si celui-ci se donne une autre direction !
L'U.G.I.C. (ingénieurs, cadres et techniciens) appelle à son tour,
un peu tardivement, à la participation aux actions. Au cours d'une
émission sur « Europe N° i » avec Eugène Descamps, Séguy insiste
un peu tardivement, à la participation aux actions. Au cours d'une
émission sur « Europe N° i » avec Eugène Descamps, Séguy insiste
7. Le Courrier confédéral, bulletin intérieur! ronéotypé, est destiné aux
services confédéraux et aux cadres des organisations de la C.G.T.
services confédéraux et aux cadres des organisations de la C.G.T.
8. Ce sont les seules déclarations qui donnent autant d'importance au
mouvement des étudiants. Les explications ultérieures sur l'origine de la
grève n'accorderont qu'un rôle parallèle aux étudiants.
mouvement des étudiants. Les explications ultérieures sur l'origine de la
grève n'accorderont qu'un rôle parallèle aux étudiants.
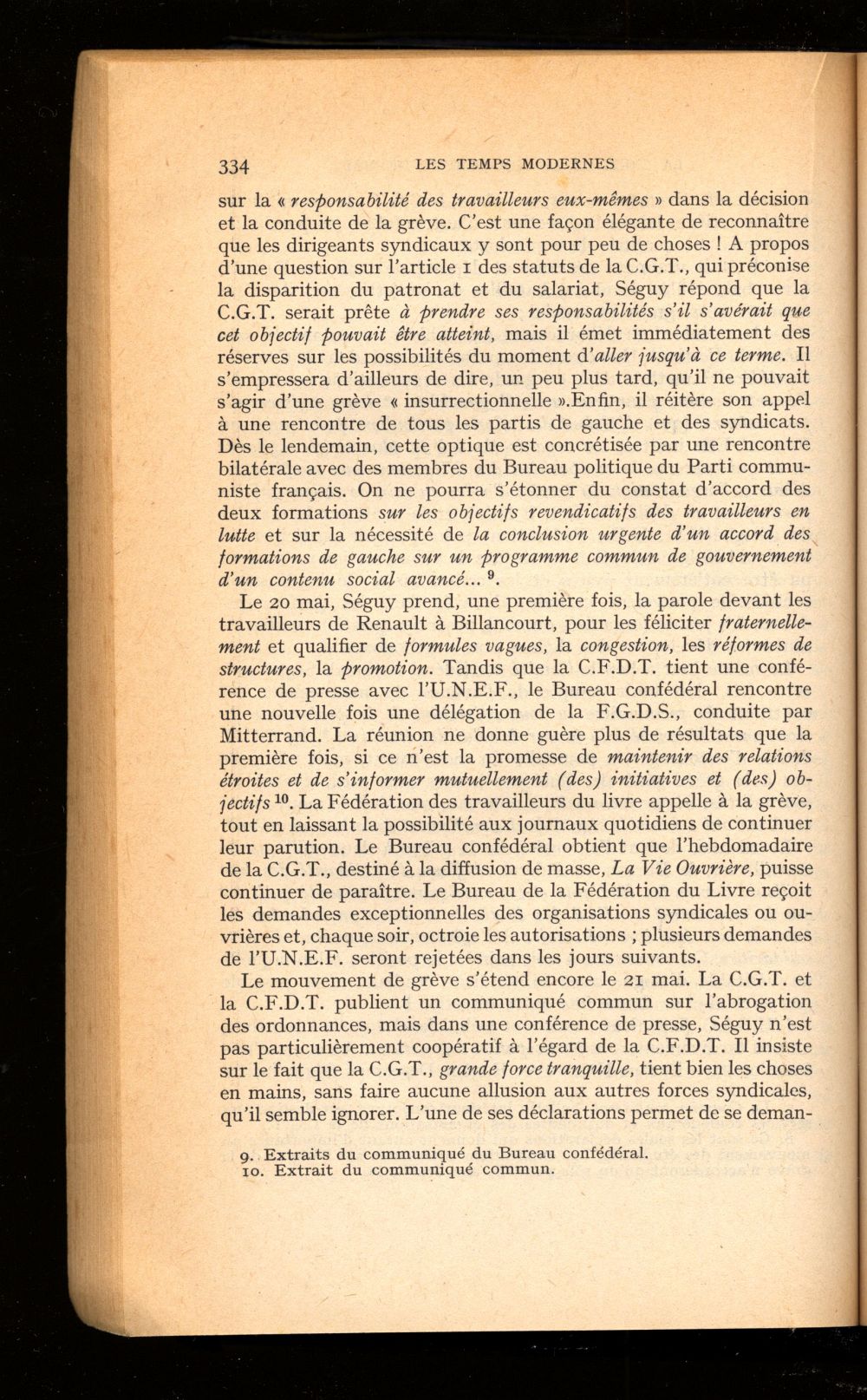

334 LES TEMPS MODERNES
sur la « responsabilité des travailleurs eux-mêmes » dans la décision
et la conduite de la grève. C'est une façon élégante de reconnaître
que les dirigeants syndicaux y sont pour peu de choses ! A propos
d'une question sur l'article i des statuts de laC.G.T., qui préconise
la disparition du patronat et du salariat, Séguy répond que la
C.G.T. serait prête à prendre ses responsabilités s'il s'avérait que
cet objectif pouvait être atteint, mais il émet immédiatement des
réserves sur les possibilités du moment d'aller jusqu'à ce terme. Il
s'empressera d'ailleurs de dire, un peu plus tard, qu'il ne pouvait
s'agir d'une grève « insurrectionnelle ».Enfin, il réitère son appel
à une rencontre de tous les partis de gauche et des syndicats.
Dès le lendemain, cette optique est concrétisée par une rencontre
bilatérale avec des membres du Bureau politique du Parti commu-
niste français. On ne pourra s'étonner du constat d'accord des
deux formations sur les objectifs revendicatifs des travailleurs en
lutte et sur la nécessité de la conclusion urgente d'un accord des
formations de gauche sur un programme commun de gouvernement
d'un contenu social avancé... 9.
et la conduite de la grève. C'est une façon élégante de reconnaître
que les dirigeants syndicaux y sont pour peu de choses ! A propos
d'une question sur l'article i des statuts de laC.G.T., qui préconise
la disparition du patronat et du salariat, Séguy répond que la
C.G.T. serait prête à prendre ses responsabilités s'il s'avérait que
cet objectif pouvait être atteint, mais il émet immédiatement des
réserves sur les possibilités du moment d'aller jusqu'à ce terme. Il
s'empressera d'ailleurs de dire, un peu plus tard, qu'il ne pouvait
s'agir d'une grève « insurrectionnelle ».Enfin, il réitère son appel
à une rencontre de tous les partis de gauche et des syndicats.
Dès le lendemain, cette optique est concrétisée par une rencontre
bilatérale avec des membres du Bureau politique du Parti commu-
niste français. On ne pourra s'étonner du constat d'accord des
deux formations sur les objectifs revendicatifs des travailleurs en
lutte et sur la nécessité de la conclusion urgente d'un accord des
formations de gauche sur un programme commun de gouvernement
d'un contenu social avancé... 9.
Le 20 mai, Séguy prend, une première fois, la parole devant les
travailleurs de Renault à Billancourt, pour les féliciter fraternelle-
ment et qualifier de formules vagues, la congestion, les réformes de
structures, la promotion. Tandis que la C.F.D.T. tient une confé-
rence de presse avec l'U.N.E.F., le Bureau confédéral rencontre
une nouvelle fois une délégation de la F.G.D.S., conduite par
Mitterrand. La réunion ne donne guère plus de résultats que la
première fois, si ce n'est la promesse de maintenir des relations
étroites et de s'informer mutuellement (des) initiatives et (des) ob-
jectifs 10. La Fédération des travailleurs du livre appelle à la grève,
tout en laissant la possibilité aux journaux quotidiens de continuer
leur parution. Le Bureau confédéral obtient que l'hebdomadaire
de la C.G.T., destiné à la diffusion de masse, La Vie Ouvrière, puisse
continuer de paraître. Le Bureau de la Fédération du Livre reçoit
les demandes exceptionnelles des organisations syndicales ou ou-
vrières et, chaque soir, octroie les autorisations ; plusieurs demandes
de l'U.N.E.F. seront rejetées dans les jours suivants.
travailleurs de Renault à Billancourt, pour les féliciter fraternelle-
ment et qualifier de formules vagues, la congestion, les réformes de
structures, la promotion. Tandis que la C.F.D.T. tient une confé-
rence de presse avec l'U.N.E.F., le Bureau confédéral rencontre
une nouvelle fois une délégation de la F.G.D.S., conduite par
Mitterrand. La réunion ne donne guère plus de résultats que la
première fois, si ce n'est la promesse de maintenir des relations
étroites et de s'informer mutuellement (des) initiatives et (des) ob-
jectifs 10. La Fédération des travailleurs du livre appelle à la grève,
tout en laissant la possibilité aux journaux quotidiens de continuer
leur parution. Le Bureau confédéral obtient que l'hebdomadaire
de la C.G.T., destiné à la diffusion de masse, La Vie Ouvrière, puisse
continuer de paraître. Le Bureau de la Fédération du Livre reçoit
les demandes exceptionnelles des organisations syndicales ou ou-
vrières et, chaque soir, octroie les autorisations ; plusieurs demandes
de l'U.N.E.F. seront rejetées dans les jours suivants.
Le mouvement de grève s'étend encore le 21 mai. La C.G.T. et
la C.F.D.T. publient un communiqué commun sur l'abrogation
des ordonnances, mais dans une conférence de presse, Séguy n'est
pas particulièrement coopératif à l'égard de la C.F.D.T. Il insiste
sur le fait que la C.G.T., grande force tranquille, tient bien les choses
en mains, sans faire aucune allusion aux autres forces syndicales,
qu'il semble ignorer. L'une de ses déclarations permet de se deman-
la C.F.D.T. publient un communiqué commun sur l'abrogation
des ordonnances, mais dans une conférence de presse, Séguy n'est
pas particulièrement coopératif à l'égard de la C.F.D.T. Il insiste
sur le fait que la C.G.T., grande force tranquille, tient bien les choses
en mains, sans faire aucune allusion aux autres forces syndicales,
qu'il semble ignorer. L'une de ses déclarations permet de se deman-
9. Extraits du communiqué du Bureau confédéral.
10. Extrait du communiqué commun.
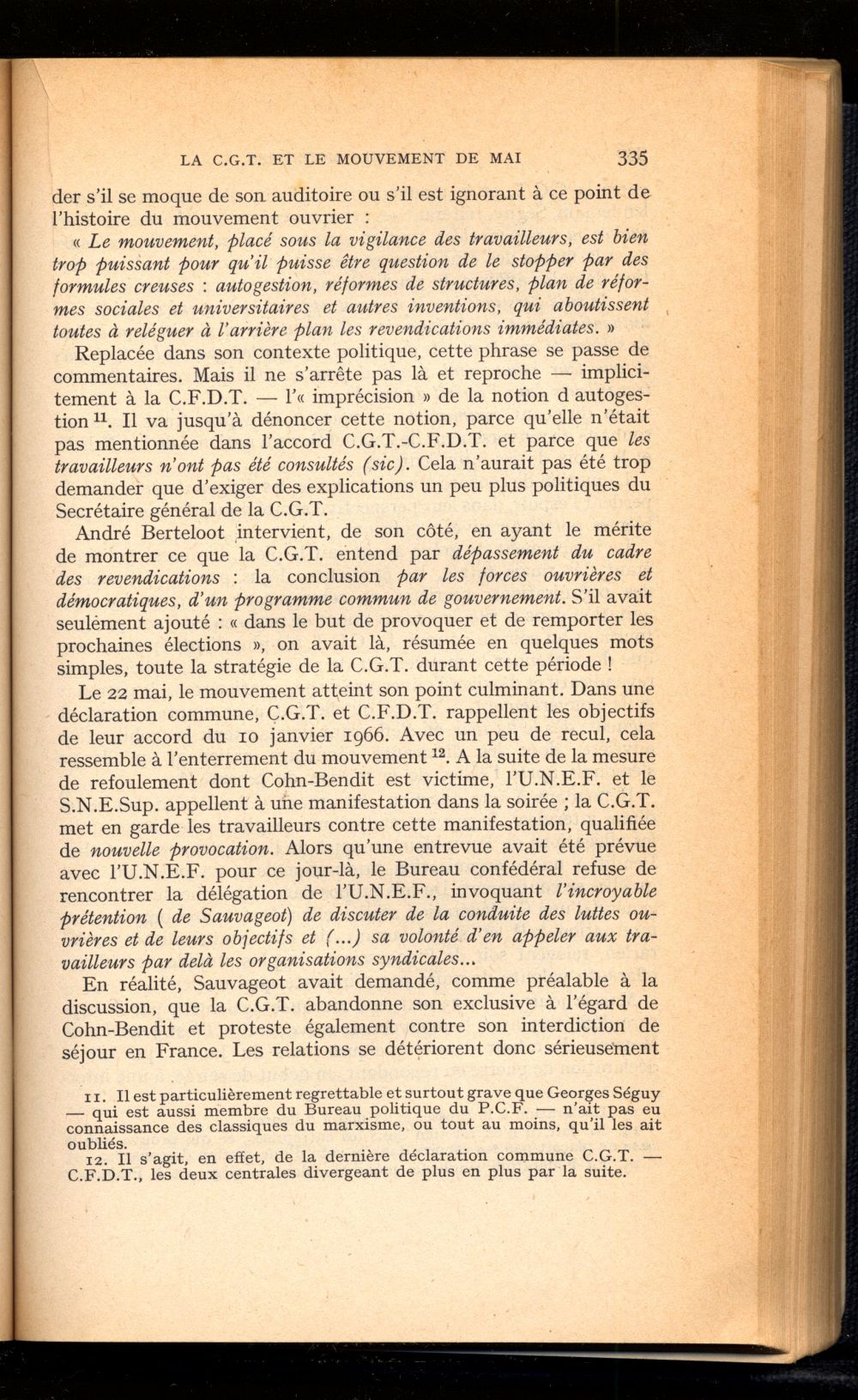

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
335
der s'il se moque de son auditoire ou s'il est ignorant à ce point de
l'histoire du mouvement ouvrier :
l'histoire du mouvement ouvrier :
« Le, mouvement, -placé sous la vigilance des travailleurs, est bien
trop puissant pour qu'il puisse être question de le stopper par des
formules creuses : autogestion, réformes de structures, plan de réfor-
mes sociales et universitaires et autres inventions, qui aboutissent
toutes à reléguer à l'arrière plan les revendications immédiates. »
trop puissant pour qu'il puisse être question de le stopper par des
formules creuses : autogestion, réformes de structures, plan de réfor-
mes sociales et universitaires et autres inventions, qui aboutissent
toutes à reléguer à l'arrière plan les revendications immédiates. »
Replacée dans son contexte politique, cette phrase se passe de
commentaires. Mais il ne s'arrête pas là et reproche — implici-
tement à la C.F.D.T. — l'« imprécision » de la notion d autoges-
tion u. Il va jusqu'à dénoncer cette notion, parce qu'elle n'était
pas mentionnée dans l'accord C.G.T.-C.F.D.T. et parce que les
travailleurs n'ont pas été consultés (sic). Cela n'aurait pas été trop
demander que d'exiger des explications un peu plus politiques du
Secrétaire général de la C.G.T.
commentaires. Mais il ne s'arrête pas là et reproche — implici-
tement à la C.F.D.T. — l'« imprécision » de la notion d autoges-
tion u. Il va jusqu'à dénoncer cette notion, parce qu'elle n'était
pas mentionnée dans l'accord C.G.T.-C.F.D.T. et parce que les
travailleurs n'ont pas été consultés (sic). Cela n'aurait pas été trop
demander que d'exiger des explications un peu plus politiques du
Secrétaire général de la C.G.T.
André Berteloot intervient, de son côté, en ayant le mérite
de montrer ce que la C.G.T. entend par dépassement du cadre
des revendications : la conclusion par les forces ouvrières et
démocratiques, d'un programme commun de gouvernement. S'il avait
seulement ajouté : « dans le but de provoquer et de remporter les
prochaines élections », on avait là, résumée en quelques mots
simples, toute la stratégie de la C.G.T. durant cette période !
de montrer ce que la C.G.T. entend par dépassement du cadre
des revendications : la conclusion par les forces ouvrières et
démocratiques, d'un programme commun de gouvernement. S'il avait
seulement ajouté : « dans le but de provoquer et de remporter les
prochaines élections », on avait là, résumée en quelques mots
simples, toute la stratégie de la C.G.T. durant cette période !
Le 22 mai, le mouvement atteint son point culminant. Dans une
déclaration commune, C.G.T. et C.F.D.T. rappellent les objectifs
de leur accord du 10 janvier 1966. Avec un peu de recul, cela
ressemble à l'enterrement du mouvement12. A la suite de la mesure
de refoulement dont Cohn-Bendit est victime, l'U.N.E.F. et le
S.N.E.Sup. appellent à une manifestation dans la soirée ; la C.G.T.
met en garde les travailleurs contre cette manifestation, qualifiée
de nouvelle provocation. Alors qu'une entrevue avait été prévue
avec l'U.N.E.F. pour ce jour-là, le Bureau confédéral refuse de
rencontrer la délégation de l'U.N.E.F., invoquant l'incroyable
prétention ( de Sauvageot) de discuter de la conduite des luttes ou-
vrières et de leurs objectifs et (...) sa volonté d'en appeler aux tra-
vailleurs par delà les organisations syndicales...
déclaration commune, C.G.T. et C.F.D.T. rappellent les objectifs
de leur accord du 10 janvier 1966. Avec un peu de recul, cela
ressemble à l'enterrement du mouvement12. A la suite de la mesure
de refoulement dont Cohn-Bendit est victime, l'U.N.E.F. et le
S.N.E.Sup. appellent à une manifestation dans la soirée ; la C.G.T.
met en garde les travailleurs contre cette manifestation, qualifiée
de nouvelle provocation. Alors qu'une entrevue avait été prévue
avec l'U.N.E.F. pour ce jour-là, le Bureau confédéral refuse de
rencontrer la délégation de l'U.N.E.F., invoquant l'incroyable
prétention ( de Sauvageot) de discuter de la conduite des luttes ou-
vrières et de leurs objectifs et (...) sa volonté d'en appeler aux tra-
vailleurs par delà les organisations syndicales...
En réalité, Sauvageot avait demandé, comme préalable à la
discussion, que la C.G.T. abandonne son exclusive à l'égard de
Cohn-Bendit et proteste également contre son interdiction de
séjour en France. Les relations se détériorent donc sérieusement
discussion, que la C.G.T. abandonne son exclusive à l'égard de
Cohn-Bendit et proteste également contre son interdiction de
séjour en France. Les relations se détériorent donc sérieusement
11. Il est particulièrement regrettable et surtout grave que Georges Séguy
— qui est aussi membre du Bureau politique du P.C.F. — n'ait pas eu
connaissance des classiques du marxisme, ou tout au moins, qu'il les ait
oubliés.
— qui est aussi membre du Bureau politique du P.C.F. — n'ait pas eu
connaissance des classiques du marxisme, ou tout au moins, qu'il les ait
oubliés.
12. Il s'agit, en effet, de la dernière déclaration commune C.G.T. —•
C.F.D.T., les deux centrales divergeant de plus en plus par la suite.
C.F.D.T., les deux centrales divergeant de plus en plus par la suite.
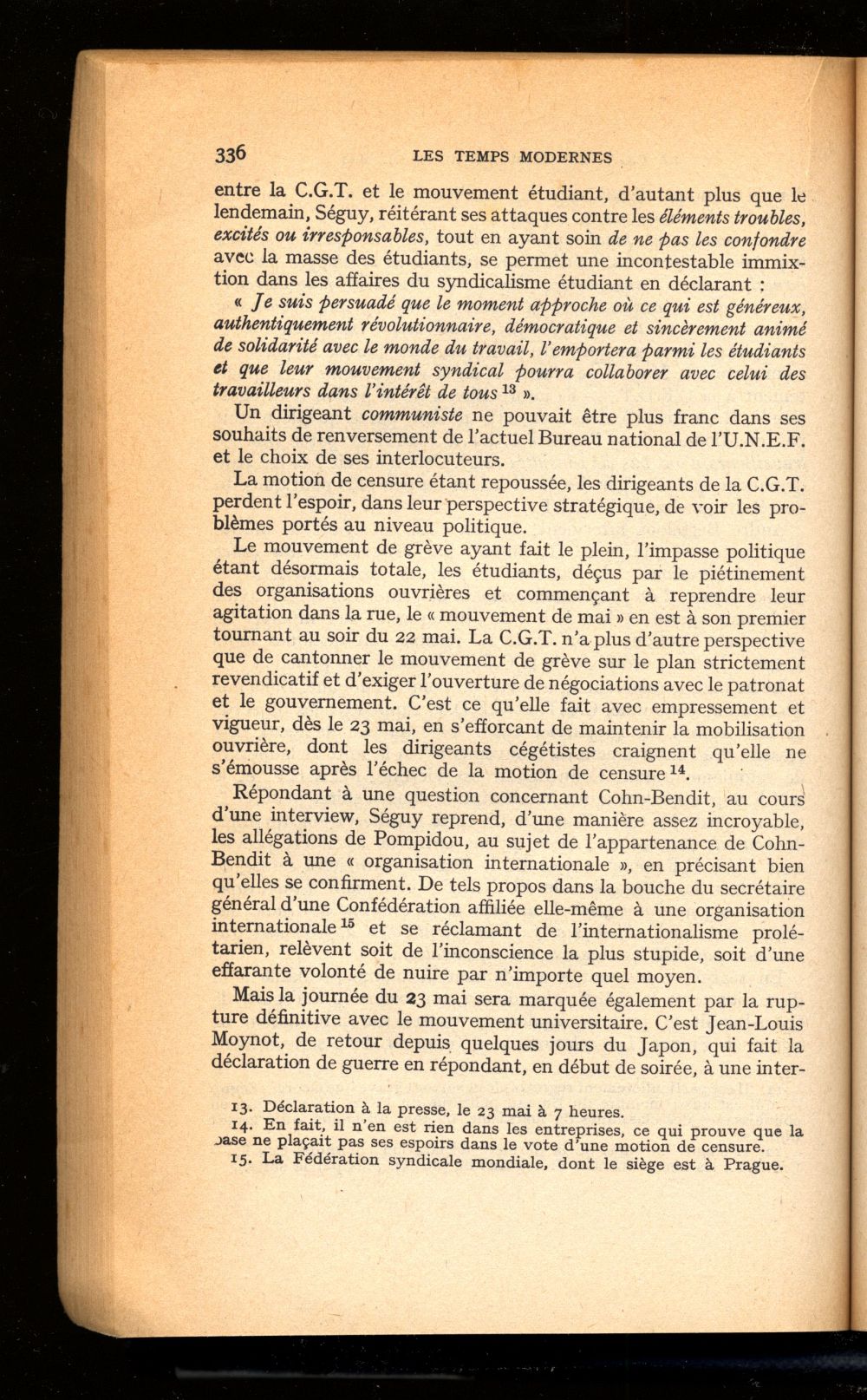

336 LES TEMPS MODERNES
entre la C.G.T. et le mouvement étudiant, d'autant plus que le
lendemain, Séguy, réitérant ses attaques contre les éléments troubles,
excités ou irresponsables, tout en ayant soin de ne pas les confondre
avec la masse des étudiants, se permet une incontestable immix-
tion dans les affaires du syndicalisme étudiant en déclarant :
lendemain, Séguy, réitérant ses attaques contre les éléments troubles,
excités ou irresponsables, tout en ayant soin de ne pas les confondre
avec la masse des étudiants, se permet une incontestable immix-
tion dans les affaires du syndicalisme étudiant en déclarant :
« Je suis persuadé que le moment approche où ce qui est généreux,
authentiquement révolutionnaire, démocratique et sincèrement animé
de solidarité avec le monde du travail, l'emportera parmi les étudiants
et que leur mouvement syndical pourra collaborer avec celui des
travailleurs dans l'intérêt de tous13 ».
authentiquement révolutionnaire, démocratique et sincèrement animé
de solidarité avec le monde du travail, l'emportera parmi les étudiants
et que leur mouvement syndical pourra collaborer avec celui des
travailleurs dans l'intérêt de tous13 ».
Un dirigeant communiste ne pouvait être plus franc dans ses
souhaits de renversement de l'actuel Bureau national de l'U.N.E.F.
et le choix de ses interlocuteurs.
souhaits de renversement de l'actuel Bureau national de l'U.N.E.F.
et le choix de ses interlocuteurs.
La motion de censure étant repoussée, les dirigeants de la C.G.T.
perdent l'espoir, dans leur perspective stratégique, de voir les pro-
blèmes portés au niveau politique.
perdent l'espoir, dans leur perspective stratégique, de voir les pro-
blèmes portés au niveau politique.
Le mouvement de grève ayant fait le plein, l'impasse politique
étant désormais totale, les étudiants, déçus par le piétinement
des organisations ouvrières et commençant à reprendre leur
agitation dans la rue, le « mouvement de mai » en est à son premier
tournant au soir du 22 mai. La C.G.T. n'a plus d'autre perspective
que de cantonner le mouvement de grève sur le plan strictement
revendicatif et d'exiger l'ouverture de négociations avec le patronat
et le gouvernement. C'est ce qu'elle fait avec empressement et
vigueur, dès le 23 mai, en s'efforçant de maintenir la mobilisation
ouvrière, dont les dirigeants cégétistes craignent qu'elle ne
s'émousse après l'échec de la motion de censure 14.
étant désormais totale, les étudiants, déçus par le piétinement
des organisations ouvrières et commençant à reprendre leur
agitation dans la rue, le « mouvement de mai » en est à son premier
tournant au soir du 22 mai. La C.G.T. n'a plus d'autre perspective
que de cantonner le mouvement de grève sur le plan strictement
revendicatif et d'exiger l'ouverture de négociations avec le patronat
et le gouvernement. C'est ce qu'elle fait avec empressement et
vigueur, dès le 23 mai, en s'efforçant de maintenir la mobilisation
ouvrière, dont les dirigeants cégétistes craignent qu'elle ne
s'émousse après l'échec de la motion de censure 14.
Répondant à une question concernant Cohn-Bendit, au cours
d'une interview, Séguy reprend, d'une manière assez incroyable,
les allégations de Pompidou, au sujet de l'appartenance de Cohn-
Bendit à une « organisation internationale », en précisant bien
qu'elles se confirment. De tels propos dans la bouche du secrétaire
général d'une Confédération affiliée elle-même à une organisation
internationale15 et se réclamant de l'internationalisme prolé-
tarien, relèvent soit de l'inconscience la plus stupide, soit d'une
effarante volonté de nuire par n'importe quel moyen.
d'une interview, Séguy reprend, d'une manière assez incroyable,
les allégations de Pompidou, au sujet de l'appartenance de Cohn-
Bendit à une « organisation internationale », en précisant bien
qu'elles se confirment. De tels propos dans la bouche du secrétaire
général d'une Confédération affiliée elle-même à une organisation
internationale15 et se réclamant de l'internationalisme prolé-
tarien, relèvent soit de l'inconscience la plus stupide, soit d'une
effarante volonté de nuire par n'importe quel moyen.
Mais la journée du 23 mai sera marquée également par la rup-
ture définitive avec le mouvement universitaire. C'est Jean-Louis
Moynot, de retour depuis quelques jours du Japon, qui fait la
déclaration de guerre en répondant, en début de soirée, à une inter-
ture définitive avec le mouvement universitaire. C'est Jean-Louis
Moynot, de retour depuis quelques jours du Japon, qui fait la
déclaration de guerre en répondant, en début de soirée, à une inter-
13. Déclaration à la presse, le 23 mai à 7 heures.
14. En fait, il n'en est rien dans les entreprises, ce qui prouve que la
jase ne plaçait pas ses espoirs dans le vote d'une motion de censure.
jase ne plaçait pas ses espoirs dans le vote d'une motion de censure.
15. La Fédération syndicale mondiale, dont le siège est à Prague.
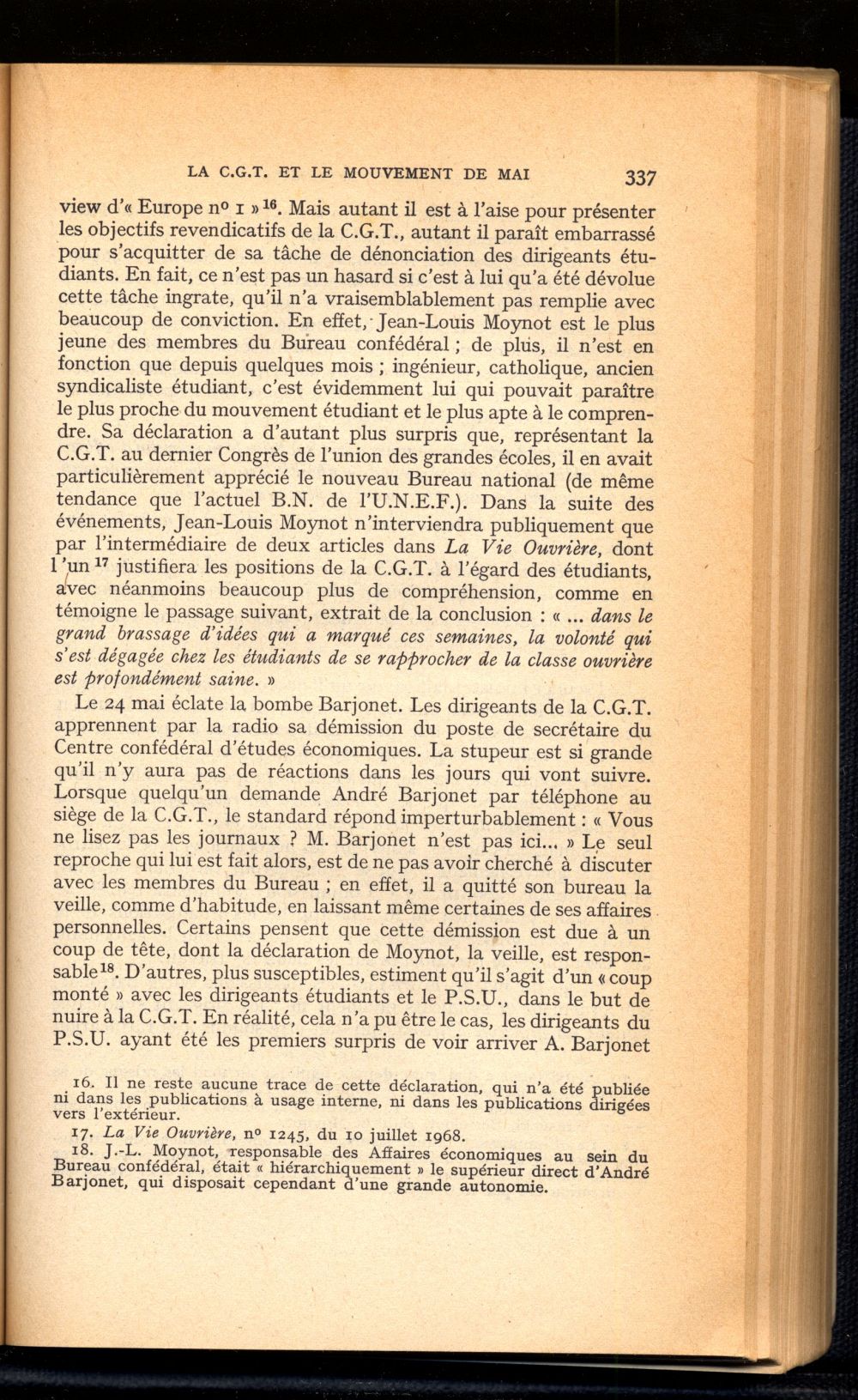

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
337
view d'« Europe n° i »16. Mais autant il est à l'aise pour présenter
les objectifs revendicatifs de la C.G.T., autant il paraît embarrassé
pour s'acquitter de sa tâche de dénonciation des dirigeants étu-
diants. En fait, ce n'est pas un hasard si c'est à lui qu'a été dévolue
cette tâche ingrate, qu'il n'a vraisemblablement pas remplie avec
beaucoup de conviction. En effet, • Jean-Louis Moynot est le plus
jeune des membres du Bureau confédéral ; de plus, il n'est en
fonction que depuis quelques mois ; ingénieur, catholique, ancien
syndicaliste étudiant, c'est évidemment lui qui pouvait paraître
le plus proche du mouvement étudiant et le plus apte à le compren-
dre. Sa déclaration a d'autant plus surpris que, représentant la
C.G.T. au dernier Congrès de l'union des grandes écoles, il en avait
particulièrement apprécié le nouveau Bureau national (de même
tendance que l'actuel B.N. de l'U.N.E.F.). Dans la suite des
événements, Jean-Louis Moynot n'interviendra publiquement que
par l'intermédiaire de deux articles dans La Vie Ouvrière, dont
l'un 17 justifiera les positions de la C.G.T. à l'égard des étudiants,
avec néanmoins beaucoup plus de compréhension, comme en
témoigne le passage suivant, extrait de la conclusion : « ... dans le
grand brassage d'idées qui a marqué ces semaines, la volonté qui
s'est dégagée chez les étudiants de se rapprocher de la classe ouvrière
est profondément saine. »
les objectifs revendicatifs de la C.G.T., autant il paraît embarrassé
pour s'acquitter de sa tâche de dénonciation des dirigeants étu-
diants. En fait, ce n'est pas un hasard si c'est à lui qu'a été dévolue
cette tâche ingrate, qu'il n'a vraisemblablement pas remplie avec
beaucoup de conviction. En effet, • Jean-Louis Moynot est le plus
jeune des membres du Bureau confédéral ; de plus, il n'est en
fonction que depuis quelques mois ; ingénieur, catholique, ancien
syndicaliste étudiant, c'est évidemment lui qui pouvait paraître
le plus proche du mouvement étudiant et le plus apte à le compren-
dre. Sa déclaration a d'autant plus surpris que, représentant la
C.G.T. au dernier Congrès de l'union des grandes écoles, il en avait
particulièrement apprécié le nouveau Bureau national (de même
tendance que l'actuel B.N. de l'U.N.E.F.). Dans la suite des
événements, Jean-Louis Moynot n'interviendra publiquement que
par l'intermédiaire de deux articles dans La Vie Ouvrière, dont
l'un 17 justifiera les positions de la C.G.T. à l'égard des étudiants,
avec néanmoins beaucoup plus de compréhension, comme en
témoigne le passage suivant, extrait de la conclusion : « ... dans le
grand brassage d'idées qui a marqué ces semaines, la volonté qui
s'est dégagée chez les étudiants de se rapprocher de la classe ouvrière
est profondément saine. »
Le 24 mai éclate la bombe Barjonet. Les dirigeants de la C.G.T.
apprennent par la radio sa démission du poste de secrétaire du
Centre confédéral d'études économiques. La stupeur est si grande
qu'il n'y aura pas de réactions dans les jours qui vont suivre.
Lorsque quelqu'un demande André Barjonet par téléphone au
siège de la C.G.T., le standard répond imperturbablement : « Vous
ne lisez pas les journaux ? M. Barjonet n'est pas ici.., » Le seul
reproche qui lui est fait alors, est de ne pas avoir cherché à discuter
avec les membres du Bureau ; en effet, il a quitté son bureau la
veille, comme d'habitude, en laissant même certaines de ses affaires
personnelles. Certains pensent que cette démission est due à un
coup de tête, dont la déclaration de Moynot, la veille, est respon-
sable18. D'autres, plus susceptibles, estiment qu'il s'agit d'un « coup
monté » avec les dirigeants étudiants et le P.S.U., dans le but de
nuire à la C.G.T. En réalité, cela n'a pu être le cas, les dirigeants du
P.S.U. ayant été les premiers surpris de voir arriver A. Barjonet
apprennent par la radio sa démission du poste de secrétaire du
Centre confédéral d'études économiques. La stupeur est si grande
qu'il n'y aura pas de réactions dans les jours qui vont suivre.
Lorsque quelqu'un demande André Barjonet par téléphone au
siège de la C.G.T., le standard répond imperturbablement : « Vous
ne lisez pas les journaux ? M. Barjonet n'est pas ici.., » Le seul
reproche qui lui est fait alors, est de ne pas avoir cherché à discuter
avec les membres du Bureau ; en effet, il a quitté son bureau la
veille, comme d'habitude, en laissant même certaines de ses affaires
personnelles. Certains pensent que cette démission est due à un
coup de tête, dont la déclaration de Moynot, la veille, est respon-
sable18. D'autres, plus susceptibles, estiment qu'il s'agit d'un « coup
monté » avec les dirigeants étudiants et le P.S.U., dans le but de
nuire à la C.G.T. En réalité, cela n'a pu être le cas, les dirigeants du
P.S.U. ayant été les premiers surpris de voir arriver A. Barjonet
16. Il ne reste aucune trace de cette déclaration, qui n'a été publiée
ni dans les publications à usage interne, ni dans les publications dirigées
vers l'extérieur.
ni dans les publications à usage interne, ni dans les publications dirigées
vers l'extérieur.
17. La Vie Ouvrière, n° 1245, du 10 juillet 1968.
18. J.-L. Moynot, responsable des Affaires économiques au sein du
Bureau confédéral, était « hiérarchiquement » le supérieur direct d'André
Barjonet, qui disposait cependant d'une grande autonomie.
Bureau confédéral, était « hiérarchiquement » le supérieur direct d'André
Barjonet, qui disposait cependant d'une grande autonomie.
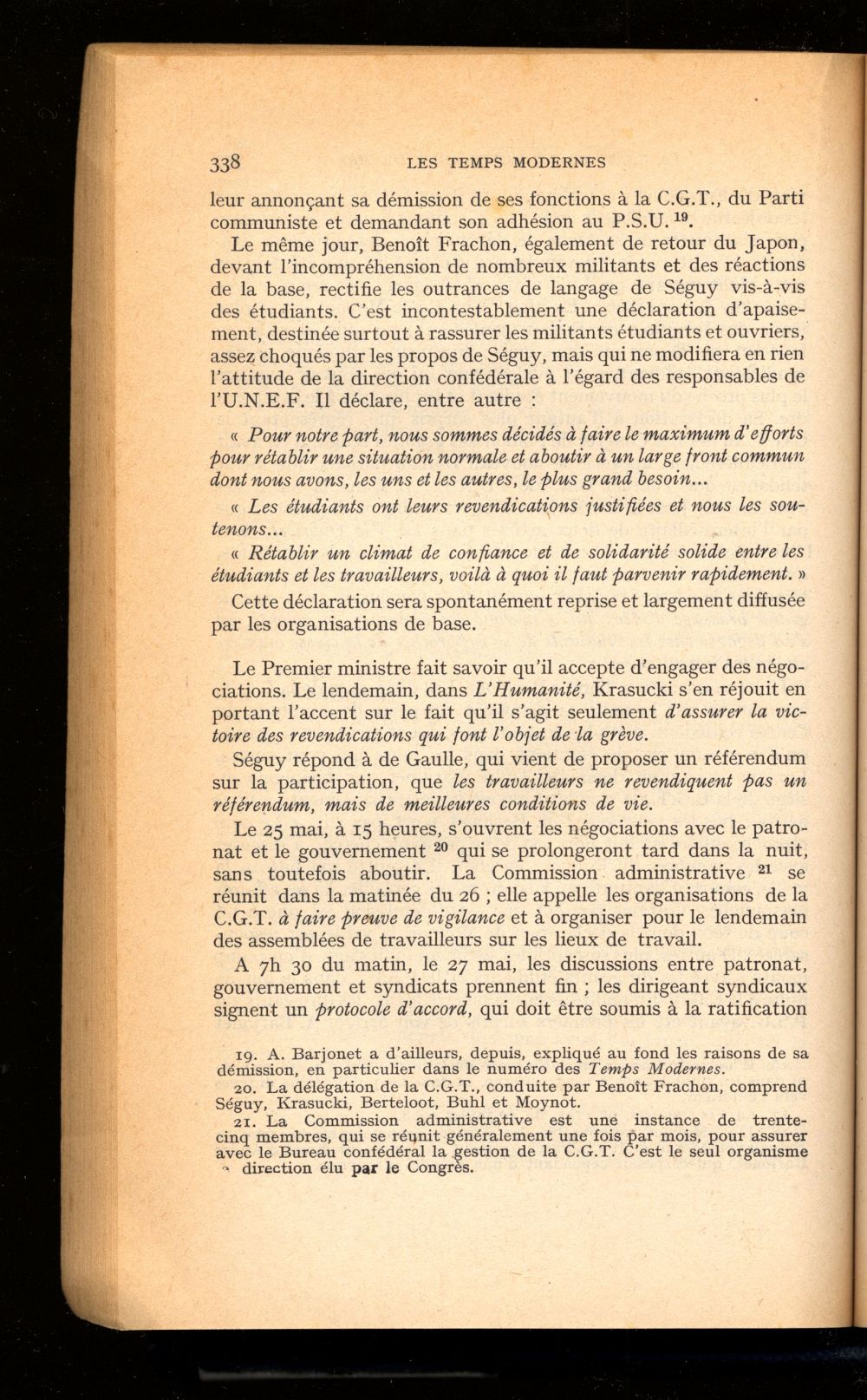

338
LES TEMPS MODERNES
leur annonçant sa démission de ses fonctions à la G.G.T., du Parti
communiste et demandant son adhésion au P.S.U.19.
communiste et demandant son adhésion au P.S.U.19.
Le même jour, Benoît Fraction, également de retour du Japon,
devant l'incompréhension de nombreux militants et des réactions
de la base, rectifie les outrances de langage de Séguy vis-à-vis
des étudiants. C'est incontestablement une déclaration d'apaise-
ment, destinée surtout à rassurer les militants étudiants et ouvriers,
assez choqués par les propos de Séguy, mais qui ne modifiera en rien
l'attitude de la direction confédérale à l'égard des responsables de
l'U.N.E.F. Il déclare, entre autre :
devant l'incompréhension de nombreux militants et des réactions
de la base, rectifie les outrances de langage de Séguy vis-à-vis
des étudiants. C'est incontestablement une déclaration d'apaise-
ment, destinée surtout à rassurer les militants étudiants et ouvriers,
assez choqués par les propos de Séguy, mais qui ne modifiera en rien
l'attitude de la direction confédérale à l'égard des responsables de
l'U.N.E.F. Il déclare, entre autre :
« Pour notre part, nous sommes décidés à faire le maximum d'efforts
pour rétablir une situation normale et aboutir à un large front commun
dont nous avons, les uns et les autres, le plus grand besoin...
pour rétablir une situation normale et aboutir à un large front commun
dont nous avons, les uns et les autres, le plus grand besoin...
« Les étudiants ont leurs revendications justifiées et nous les sou-
tenons...
tenons...
« Rétablir un climat de confiance et de solidarité solide entre les
étudiants et les travailleurs, voilà à quoi il faut parvenir rapidement. »
étudiants et les travailleurs, voilà à quoi il faut parvenir rapidement. »
Cette déclaration sera spontanément reprise et largement diffusée
par les organisations de base.
par les organisations de base.
Le Premier ministre fait savoir qu'il accepte d'engager des négo-
ciations. Le lendemain, dans L'Humanité, Krasucki s'en réjouit en
portant l'accent sur le fait qu'il s'agit seulement d'assurer la vic-
toire des revendications qui font l'objet de la grève.
ciations. Le lendemain, dans L'Humanité, Krasucki s'en réjouit en
portant l'accent sur le fait qu'il s'agit seulement d'assurer la vic-
toire des revendications qui font l'objet de la grève.
Séguy répond à de Gaulle, qui vient de proposer un référendum
sur la participation, que les travailleurs ne revendiquent pas un
référendum, mais de meilleures conditions de vie.
sur la participation, que les travailleurs ne revendiquent pas un
référendum, mais de meilleures conditions de vie.
Le 25 mai, à 15 heures, s'ouvrent les négociations avec le patro-
nat et le gouvernement 20 qui se prolongeront tard dans la nuit,
sans toutefois aboutir. La Commission administrative 21 se
réunit dans la matinée du 26 ; elle appelle les organisations de la
C.G.T. à faire preuve de vigilance et à organiser pour le lendemain
des assemblées de travailleurs sur les lieux de travail.
nat et le gouvernement 20 qui se prolongeront tard dans la nuit,
sans toutefois aboutir. La Commission administrative 21 se
réunit dans la matinée du 26 ; elle appelle les organisations de la
C.G.T. à faire preuve de vigilance et à organiser pour le lendemain
des assemblées de travailleurs sur les lieux de travail.
A yh 30 du matin, le 27 mai, les discussions entre patronat,
gouvernement et syndicats prennent fin ; les dirigeant syndicaux
signent un protocole d'accord, qui doit être soumis à la ratification
gouvernement et syndicats prennent fin ; les dirigeant syndicaux
signent un protocole d'accord, qui doit être soumis à la ratification
19. A. Barjonet a d'ailleurs, depuis, expliqué au fond les raisons de sa
démission, en particulier dans le numéro des Temps Modernes.
démission, en particulier dans le numéro des Temps Modernes.
20. La délégation de la C.G.T., conduite par Benoît Frachon, comprend
Séguy, Krasucki, Berteloot, Buhl et Moynot.
Séguy, Krasucki, Berteloot, Buhl et Moynot.
21. La Commission administrative est une instance de trente-
cinq membres, qui se réunit généralement une fois par mois, pour assurer
avec le Bureau confédéral la gestion de la C.G.T. C'est le seul organisme
cinq membres, qui se réunit généralement une fois par mois, pour assurer
avec le Bureau confédéral la gestion de la C.G.T. C'est le seul organisme
•> direction élu par le Congrès.
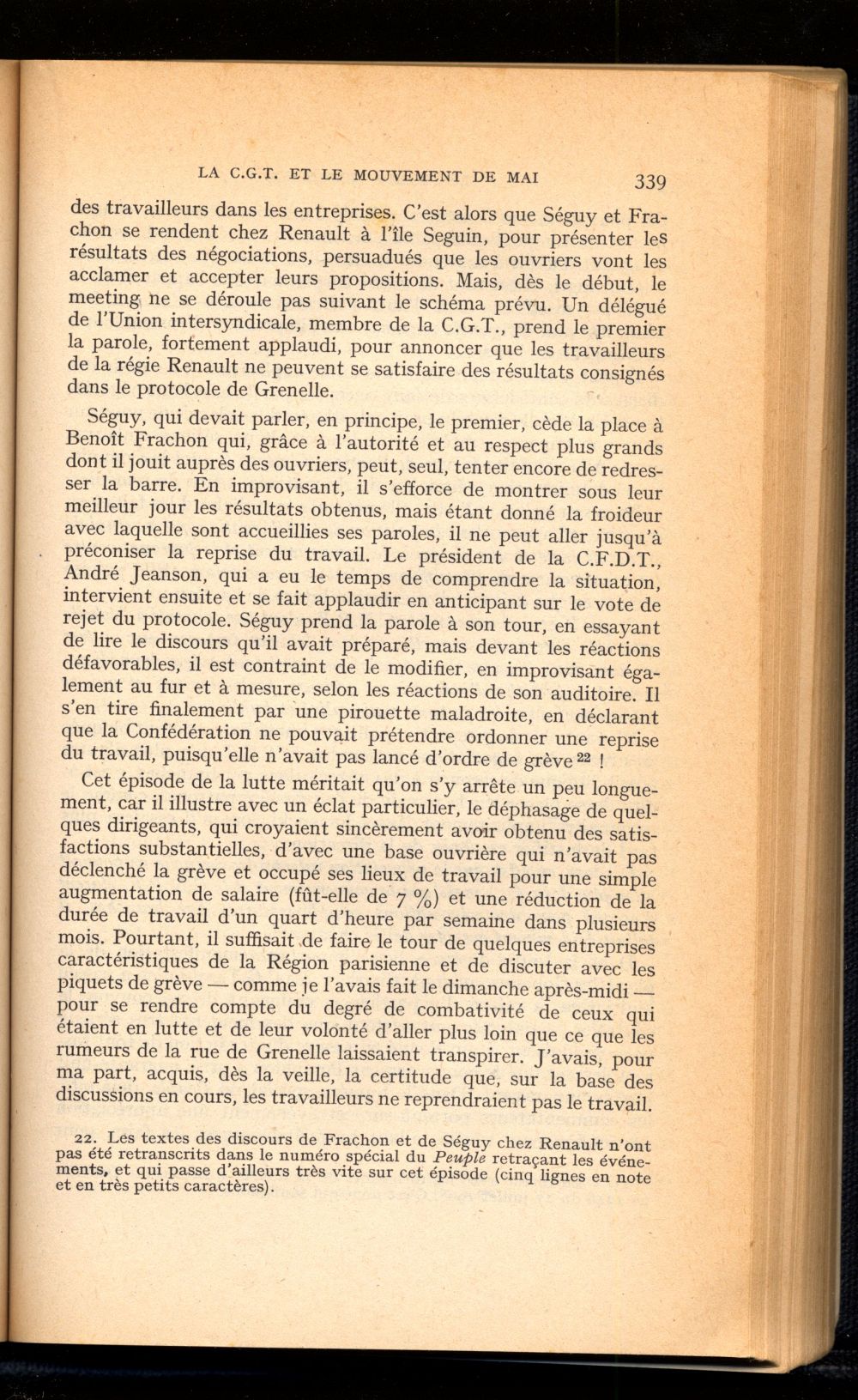

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
339
des travailleurs dans les entreprises. C'est alors que Séguy et Fra-
chon se rendent chez Renault à l'île Seguin, pour présenter les
résultats des négociations, persuadués que les ouvriers vont les
acclamer et accepter leurs propositions. Mais, dès le début, le
meeting ne se déroule pas suivant le schéma prévu. Un délégué
de l'Union intersyndicale, membre de la C.G.T., prend le premier
la parole, fortement applaudi, pour annoncer que les travailleurs
de la régie Renault ne peuvent se satisfaire des résultats consignés
dans le protocole de Grenelle.
chon se rendent chez Renault à l'île Seguin, pour présenter les
résultats des négociations, persuadués que les ouvriers vont les
acclamer et accepter leurs propositions. Mais, dès le début, le
meeting ne se déroule pas suivant le schéma prévu. Un délégué
de l'Union intersyndicale, membre de la C.G.T., prend le premier
la parole, fortement applaudi, pour annoncer que les travailleurs
de la régie Renault ne peuvent se satisfaire des résultats consignés
dans le protocole de Grenelle.
Séguy, qui devait parler, en principe, le premier, cède la place à
Benoît Frachon qui, grâce à l'autorité et au respect plus grands
dont il jouit auprès des ouvriers, peut, seul, tenter encore de redres-
ser la barre. En improvisant, il s'efforce de montrer sous leur
meilleur jour les résultats obtenus, mais étant donné la froideur
avec laquelle sont accueillies ses paroles, il ne peut aller jusqu'à
préconiser la reprise du travail. Le président de la C.F.D.T.,
André Jeanson, qui a eu le temps de comprendre la situation,
intervient ensuite et se fait applaudir en anticipant sur le vote de
rejet du protocole. Séguy prend la parole à son tour, en essayant
de lire le discours qu'il avait préparé, mais devant les réactions
défavorables, il est contraint de le modifier, en improvisant éga-
lement au fur et à mesure, selon les réactions de son auditoire. Il
s'en tire finalement par une pirouette maladroite, en déclarant
que la Confédération ne pouvait prétendre ordonner une reprise
du travail, puisqu'elle n'avait pas lancé d'ordre de grève22 !
Benoît Frachon qui, grâce à l'autorité et au respect plus grands
dont il jouit auprès des ouvriers, peut, seul, tenter encore de redres-
ser la barre. En improvisant, il s'efforce de montrer sous leur
meilleur jour les résultats obtenus, mais étant donné la froideur
avec laquelle sont accueillies ses paroles, il ne peut aller jusqu'à
préconiser la reprise du travail. Le président de la C.F.D.T.,
André Jeanson, qui a eu le temps de comprendre la situation,
intervient ensuite et se fait applaudir en anticipant sur le vote de
rejet du protocole. Séguy prend la parole à son tour, en essayant
de lire le discours qu'il avait préparé, mais devant les réactions
défavorables, il est contraint de le modifier, en improvisant éga-
lement au fur et à mesure, selon les réactions de son auditoire. Il
s'en tire finalement par une pirouette maladroite, en déclarant
que la Confédération ne pouvait prétendre ordonner une reprise
du travail, puisqu'elle n'avait pas lancé d'ordre de grève22 !
Cet épisode de la lutte méritait qu'on s'y arrête un peu longue-
ment, car il illustre avec un éclat particulier, le déphasage de quel-
ques dirigeants, qui croyaient sincèrement avoir obtenu des satis-
factions substantielles, d'avec une base ouvrière qui n'avait pas
déclenché la grève et occupé ses lieux de travail pour une simple
augmentation de salaire (fût-elle de 7 %) et une réduction de la
durée de travail d'un quart d'heure par semaine dans plusieurs
mois. Pourtant, il suffisait de faire le tour de quelques entreprises
caractéristiques de la Région parisienne et de discuter avec les
piquets de grève — comme je l'avais fait le dimanche après-midi —
pour se rendre compte du degré de combativité de ceux qui
étaient en lutte et de leur volonté d'aller plus loin que ce que les
rumeurs de la rue de Grenelle laissaient transpirer. J'avais, pour
ma part, acquis, dès la veille, la certitude que, sur la base des
discussions en cours, les travailleurs ne reprendraient pas le travail.
ment, car il illustre avec un éclat particulier, le déphasage de quel-
ques dirigeants, qui croyaient sincèrement avoir obtenu des satis-
factions substantielles, d'avec une base ouvrière qui n'avait pas
déclenché la grève et occupé ses lieux de travail pour une simple
augmentation de salaire (fût-elle de 7 %) et une réduction de la
durée de travail d'un quart d'heure par semaine dans plusieurs
mois. Pourtant, il suffisait de faire le tour de quelques entreprises
caractéristiques de la Région parisienne et de discuter avec les
piquets de grève — comme je l'avais fait le dimanche après-midi —
pour se rendre compte du degré de combativité de ceux qui
étaient en lutte et de leur volonté d'aller plus loin que ce que les
rumeurs de la rue de Grenelle laissaient transpirer. J'avais, pour
ma part, acquis, dès la veille, la certitude que, sur la base des
discussions en cours, les travailleurs ne reprendraient pas le travail.
22. Les textes des discours de Frachon et de Séguy chez Renault n'ont
pas été retranscrits dans le numéro spécial du Peuple retraçant les événe-
ments, et qui passe d'ailleurs très vite sur cet épisode (cinq lignes en note
et en très petits caractères).
pas été retranscrits dans le numéro spécial du Peuple retraçant les événe-
ments, et qui passe d'ailleurs très vite sur cet épisode (cinq lignes en note
et en très petits caractères).
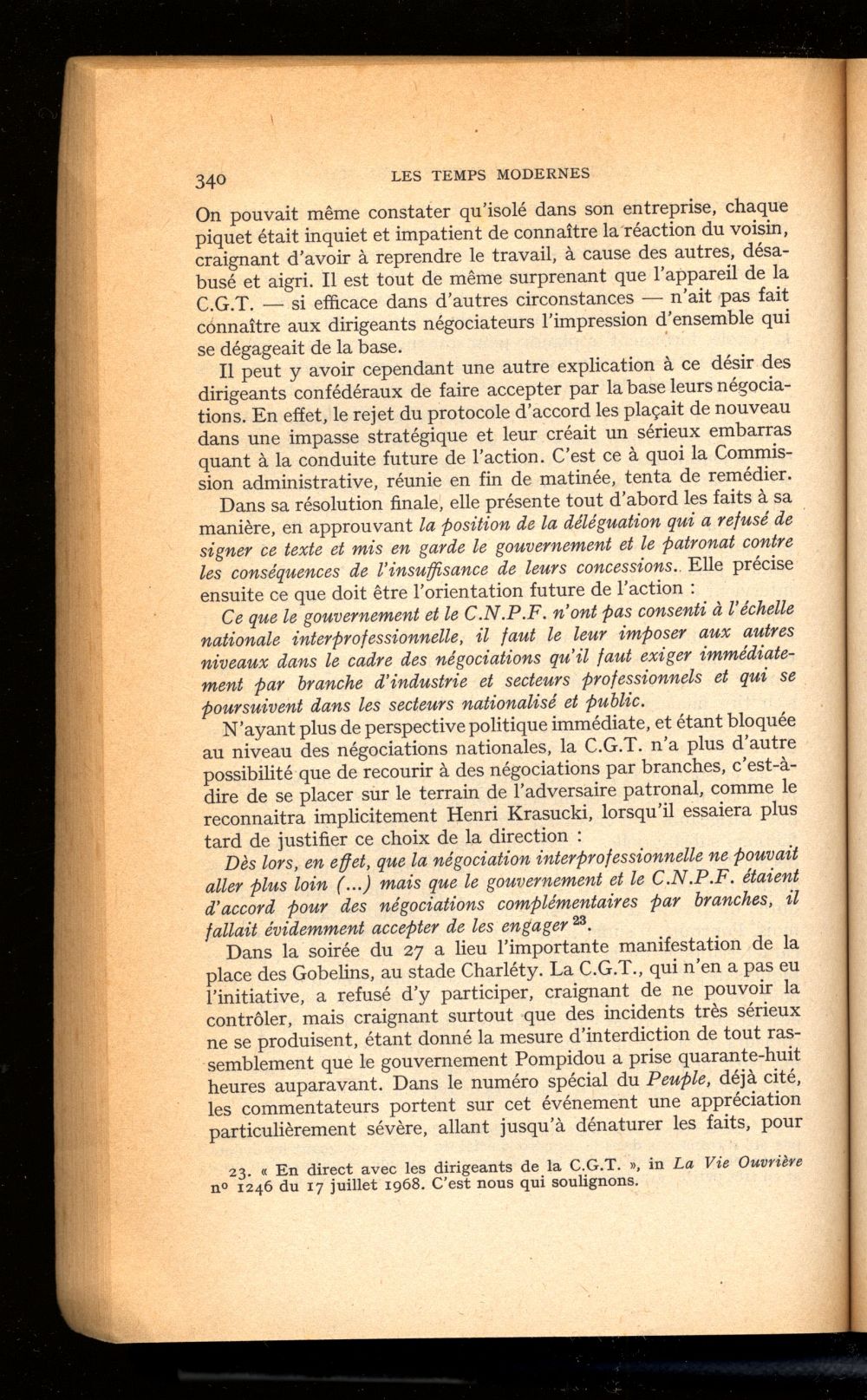

340 LES TEMPS MODERNES
On pouvait même constater qu'isolé dans son entreprise, chaque
piquet était inquiet et impatient de connaître la réaction du voisin,
craignant d'avoir à reprendre le travail, à cause des autres, désa-
busé et aigri. Il est tout de même surprenant que l'appareil de la
C.G.T. — si efficace dans d'autres circonstances — n'ait pas fait
connaître aux dirigeants négociateurs l'impression d'ensemble qui
se dégageait de la base.
piquet était inquiet et impatient de connaître la réaction du voisin,
craignant d'avoir à reprendre le travail, à cause des autres, désa-
busé et aigri. Il est tout de même surprenant que l'appareil de la
C.G.T. — si efficace dans d'autres circonstances — n'ait pas fait
connaître aux dirigeants négociateurs l'impression d'ensemble qui
se dégageait de la base.
Il peut y avoir cependant une autre explication à ce désir des
dirigeants confédéraux de faire accepter par la base leurs négocia-
tions. En effet, le rejet du protocole d'accord les plaçait de nouveau
dans une impasse stratégique et leur créait un sérieux embarras
quant à la conduite future de l'action. C'est ce à quoi la Commis-
sion administrative, réunie en fin de matinée, tenta de remédier.
dirigeants confédéraux de faire accepter par la base leurs négocia-
tions. En effet, le rejet du protocole d'accord les plaçait de nouveau
dans une impasse stratégique et leur créait un sérieux embarras
quant à la conduite future de l'action. C'est ce à quoi la Commis-
sion administrative, réunie en fin de matinée, tenta de remédier.
Dans sa résolution finale, elle présente tout d'abord les faits à sa
manière, en approuvant la position de la déléguation qui a refusé de
signer ce texte et mis en garde le gouvernement et le patronat contre
les conséquences de l'insuffisance de leurs concessions. Elle précise
ensuite ce que doit être l'orientation future de l'action :
manière, en approuvant la position de la déléguation qui a refusé de
signer ce texte et mis en garde le gouvernement et le patronat contre
les conséquences de l'insuffisance de leurs concessions. Elle précise
ensuite ce que doit être l'orientation future de l'action :
Ce que le gouvernement et le C.N.P.F. n'ont pas consenti à l'échelle
nationale interprofessionnelle, il faut le leur imposer aux autres
niveaux dans le cadre des négociations, qu'il faut exiger immédiate-
ment par branche d'industrie et secteurs professionnels et qui se
poursuivent dans les secteurs nationalisé et public.
nationale interprofessionnelle, il faut le leur imposer aux autres
niveaux dans le cadre des négociations, qu'il faut exiger immédiate-
ment par branche d'industrie et secteurs professionnels et qui se
poursuivent dans les secteurs nationalisé et public.
N'ayant plus de perspective politique immédiate, et étant bloquée
au niveau des négociations nationales, la C.G.T. n'a plus d'autre
possibilité que de recourir à des négociations par branches, c'est-à-
dire de se placer sur le terrain de l'adversaire patronal, comme le
reconnaîtra implicitement Henri Krasucki, lorsqu'il essaiera plus
tard de justifier ce choix de la direction :
au niveau des négociations nationales, la C.G.T. n'a plus d'autre
possibilité que de recourir à des négociations par branches, c'est-à-
dire de se placer sur le terrain de l'adversaire patronal, comme le
reconnaîtra implicitement Henri Krasucki, lorsqu'il essaiera plus
tard de justifier ce choix de la direction :
Dès lors, en effet, que la négociation interprofessionnelle ne pouvait
aller plus loin (...) mais que le gouvernement et le C.N.P.F. étaient
d'accord pour des négociations complémentaires par branches, il
fallait évidemment accepter de les engager 23.
aller plus loin (...) mais que le gouvernement et le C.N.P.F. étaient
d'accord pour des négociations complémentaires par branches, il
fallait évidemment accepter de les engager 23.
Dans la soirée du 27 a lieu l'importante manifestation de la
place des Gobelins, au stade Charléty. La C.G.T., qui n'en a pas eu
l'initiative, a refusé d'y participer, craignant de ne pouvoir la
contrôler, mais craignant surtout que des incidents très sérieux
ne se produisent, étant donné la mesure d'interdiction de tout ras-
semblement que le gouvernement Pompidou a prise quarante-huit
heures auparavant. Dans le numéro spécial du Peuple, déjà cité,
les commentateurs portent sur cet événement une appréciation
particulièrement sévère, allant jusqu'à dénaturer les faits, pour
place des Gobelins, au stade Charléty. La C.G.T., qui n'en a pas eu
l'initiative, a refusé d'y participer, craignant de ne pouvoir la
contrôler, mais craignant surtout que des incidents très sérieux
ne se produisent, étant donné la mesure d'interdiction de tout ras-
semblement que le gouvernement Pompidou a prise quarante-huit
heures auparavant. Dans le numéro spécial du Peuple, déjà cité,
les commentateurs portent sur cet événement une appréciation
particulièrement sévère, allant jusqu'à dénaturer les faits, pour
23. « En direct avec les dirigeants de la C.G.T. », in La Vie Ouvrière
n° 1246 du 17 juillet 1968. C'est nous qui soulignons.
n° 1246 du 17 juillet 1968. C'est nous qui soulignons.
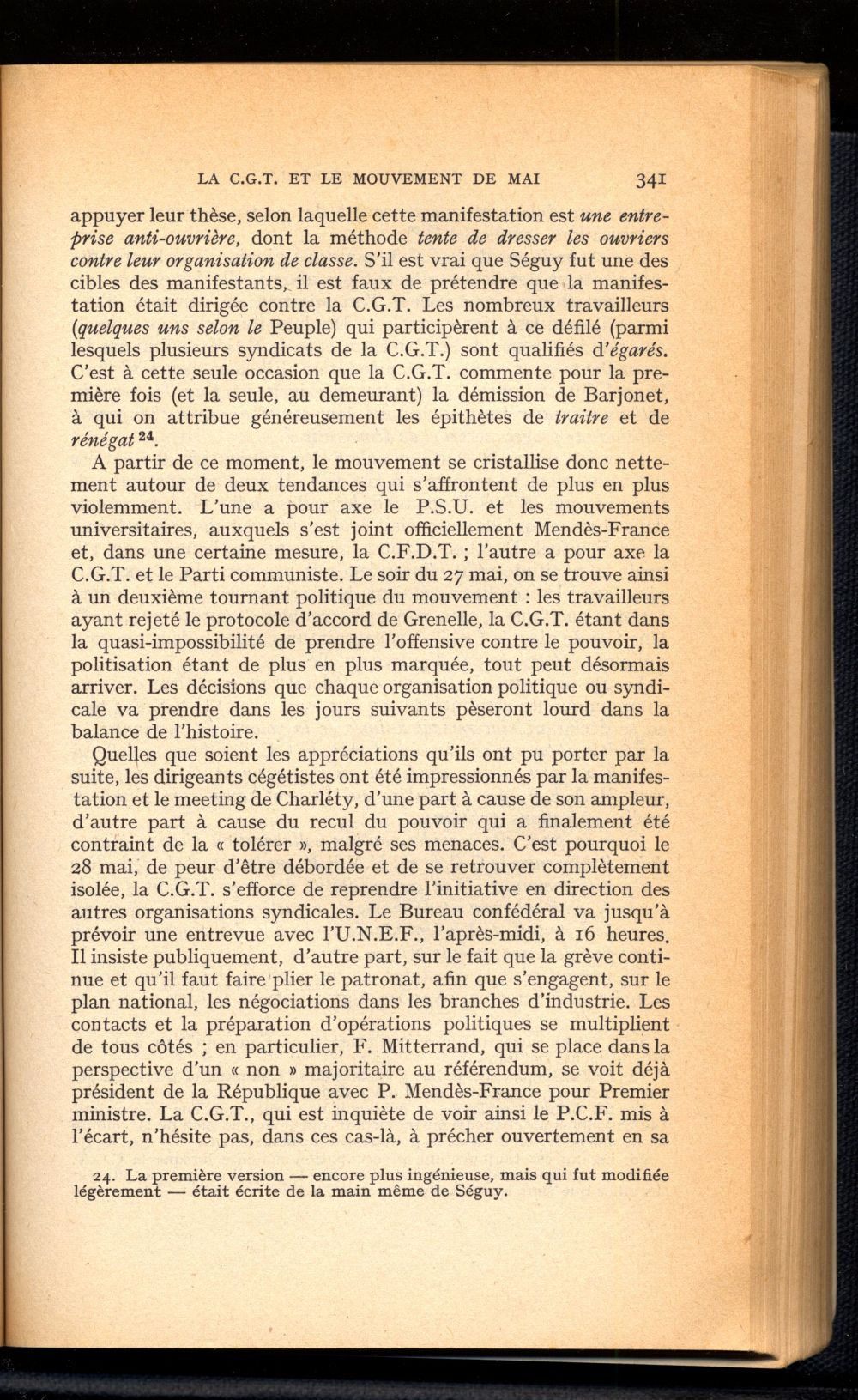

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
341
appuyer leur thèse, selon laquelle cette manifestation est une entre-
prise anti-ouvrière, dont la méthode tente de dresser les ouvriers
contre leur organisation de classe. S'il est vrai que Séguy fut une des
cibles des manifestants, il est faux de prétendre que la manifes-
tation était dirigée contre la C.G.T. Les nombreux travailleurs
(quelques uns selon le Peuple) qui participèrent à ce défilé (parmi
lesquels plusieurs syndicats de la C.G.T.) sont qualifiés d'égarés.
C'est à cette seule occasion que la C.G.T. commente pour la pre-
mière fois (et la seule, au demeurant) la démission de Barjonet,
à qui on attribue généreusement les épithètes de traître et de
renégat24.
prise anti-ouvrière, dont la méthode tente de dresser les ouvriers
contre leur organisation de classe. S'il est vrai que Séguy fut une des
cibles des manifestants, il est faux de prétendre que la manifes-
tation était dirigée contre la C.G.T. Les nombreux travailleurs
(quelques uns selon le Peuple) qui participèrent à ce défilé (parmi
lesquels plusieurs syndicats de la C.G.T.) sont qualifiés d'égarés.
C'est à cette seule occasion que la C.G.T. commente pour la pre-
mière fois (et la seule, au demeurant) la démission de Barjonet,
à qui on attribue généreusement les épithètes de traître et de
renégat24.
A partir de ce moment, le mouvement se cristallise donc nette-
ment autour de deux tendances qui s'affrontent de plus en plus
violemment. L'une a pour axe le P.S.U. et les mouvements
universitaires, auxquels s'est joint officiellement Mendès-France
et, dans une certaine mesure, la C.F.D.T. ; l'autre a pour axe la
C.G.T. et le Parti communiste. Le soir du 27 mai, on se trouve ainsi
à un deuxième tournant politique du mouvement : les travailleurs
ayant rejeté le protocole d'accord de Grenelle, la C.G.T. étant dans
la quasi-impossibilité de prendre l'offensive contre le pouvoir, la
politisation étant de plus en plus marquée, tout peut désormais
arriver. Les décisions que chaque organisation politique ou syndi-
cale va prendre dans les jours suivants pèseront lourd dans la
balance de l'histoire.
ment autour de deux tendances qui s'affrontent de plus en plus
violemment. L'une a pour axe le P.S.U. et les mouvements
universitaires, auxquels s'est joint officiellement Mendès-France
et, dans une certaine mesure, la C.F.D.T. ; l'autre a pour axe la
C.G.T. et le Parti communiste. Le soir du 27 mai, on se trouve ainsi
à un deuxième tournant politique du mouvement : les travailleurs
ayant rejeté le protocole d'accord de Grenelle, la C.G.T. étant dans
la quasi-impossibilité de prendre l'offensive contre le pouvoir, la
politisation étant de plus en plus marquée, tout peut désormais
arriver. Les décisions que chaque organisation politique ou syndi-
cale va prendre dans les jours suivants pèseront lourd dans la
balance de l'histoire.
Quelles que soient les appréciations qu'ils ont pu porter par la
suite, les dirigeants cégétistes ont été impressionnés par la manifes-
tation et le meeting de Charléty, d'une part à cause de son ampleur,
d'autre part à cause du recul du pouvoir qui a finalement été
contraint de la « tolérer », malgré ses menaces. C'est pourquoi le
28 mai, de peur d'être débordée et de se retrouver complètement
isolée, la C.G.T. s'efforce de reprendre l'initiative en direction des
autres organisations syndicales. Le Bureau confédéral va jusqu'à
prévoir une entrevue avec l'U.N.E.F., l'après-midi, à 16 heures.
Il insiste publiquement, d'autre part, sur le fait que la grève conti-
nue et qu'il faut faire plier le patronat, afin que s'engagent, sur le
plan national, les négociations dans les branches d'industrie. Les
contacts et la préparation d'opérations politiques se multiplient
de tous côtés ; en particulier, F. Mitterrand, qui se place dans la
perspective d'un « non » majoritaire au référendum, se voit déjà
président de la République avec P. Mendès-France pour Premier
ministre. La C.G.T., qui est inquiète de voir ainsi le P.C.F. mis à
l'écart, n'hésite pas, dans ces cas-là, à prêcher ouvertement en sa
suite, les dirigeants cégétistes ont été impressionnés par la manifes-
tation et le meeting de Charléty, d'une part à cause de son ampleur,
d'autre part à cause du recul du pouvoir qui a finalement été
contraint de la « tolérer », malgré ses menaces. C'est pourquoi le
28 mai, de peur d'être débordée et de se retrouver complètement
isolée, la C.G.T. s'efforce de reprendre l'initiative en direction des
autres organisations syndicales. Le Bureau confédéral va jusqu'à
prévoir une entrevue avec l'U.N.E.F., l'après-midi, à 16 heures.
Il insiste publiquement, d'autre part, sur le fait que la grève conti-
nue et qu'il faut faire plier le patronat, afin que s'engagent, sur le
plan national, les négociations dans les branches d'industrie. Les
contacts et la préparation d'opérations politiques se multiplient
de tous côtés ; en particulier, F. Mitterrand, qui se place dans la
perspective d'un « non » majoritaire au référendum, se voit déjà
président de la République avec P. Mendès-France pour Premier
ministre. La C.G.T., qui est inquiète de voir ainsi le P.C.F. mis à
l'écart, n'hésite pas, dans ces cas-là, à prêcher ouvertement en sa
24. La première version — encore plus ingénieuse, mais qui fut modifiée
légèrement — était écrite de la main même de Séguy.
légèrement — était écrite de la main même de Séguy.
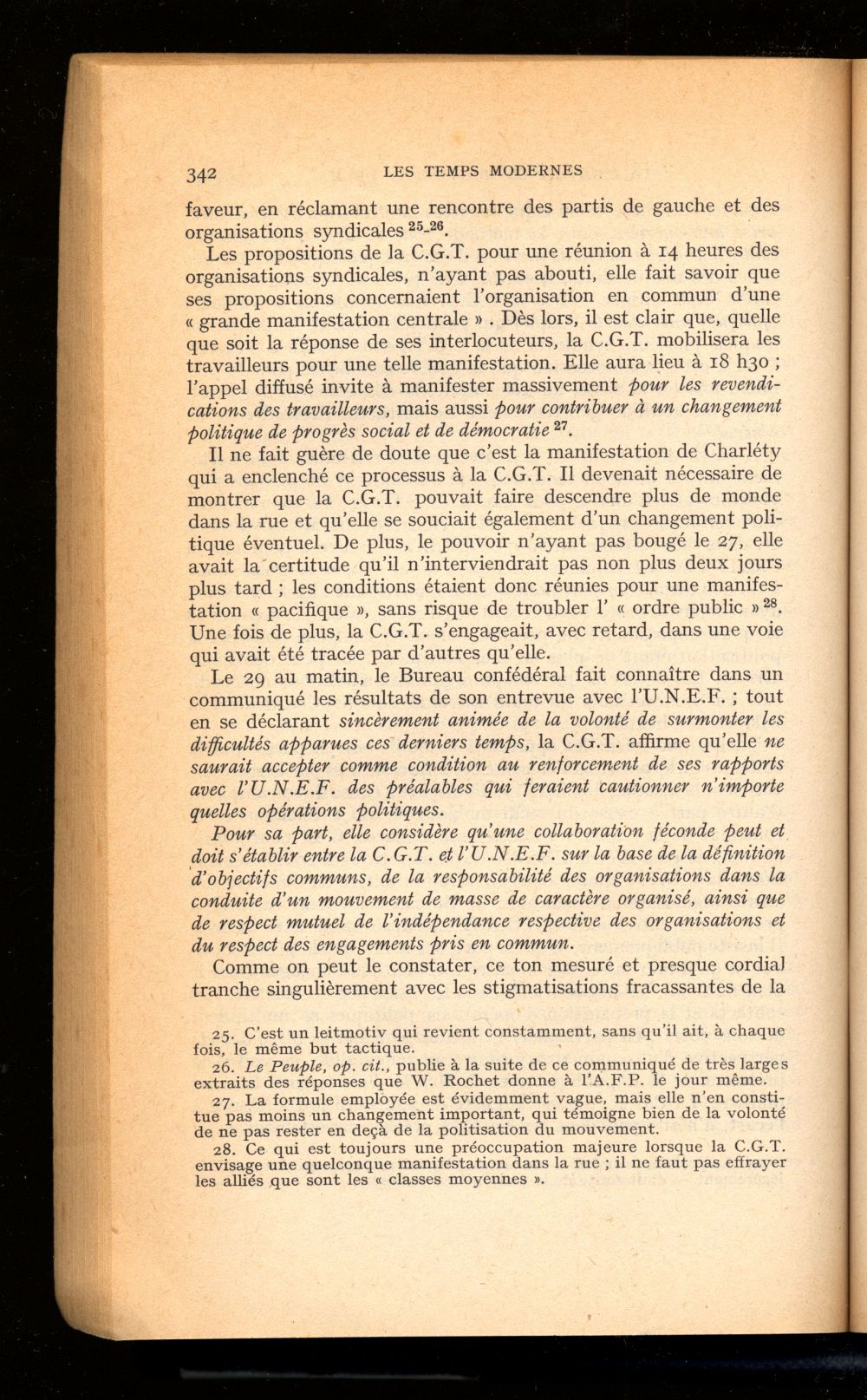

342
LES TEMPS MODERNES
faveur, en réclamant une rencontre des partis de gauche et des
organisations syndicales 25-26.
organisations syndicales 25-26.
Les propositions de la C.G.T. pour une réunion à 14 heures des
organisations syndicales, n'ayant pas abouti, elle fait savoir que
ses propositions concernaient l'organisation en commun d'une
« grande manifestation centrale » . Dès lors, il est clair que, quelle
que soit la réponse de ses interlocuteurs, la C.G.T. mobilisera les
travailleurs pour une telle manifestation. Elle aura lieu à 18 1130 ;
l'appel diffusé invite à manifester massivement pour les revendi-
cations des travailleurs, mais aussi pour contribuer à un changement
politique de progrès social et de démocratie 27.
organisations syndicales, n'ayant pas abouti, elle fait savoir que
ses propositions concernaient l'organisation en commun d'une
« grande manifestation centrale » . Dès lors, il est clair que, quelle
que soit la réponse de ses interlocuteurs, la C.G.T. mobilisera les
travailleurs pour une telle manifestation. Elle aura lieu à 18 1130 ;
l'appel diffusé invite à manifester massivement pour les revendi-
cations des travailleurs, mais aussi pour contribuer à un changement
politique de progrès social et de démocratie 27.
Il ne fait guère de doute que c'est la manifestation de Charléty
qui a enclenché ce processus à la C.G.T. Il devenait nécessaire de
montrer que la C.G.T. pouvait faire descendre plus de monde
dans la rue et qu'elle se souciait également d'un changement poli-
tique éventuel. De plus, le pouvoir n'ayant pas bougé le 27, elle
avait la certitude qu'il n'interviendrait pas non plus deux jours
plus tard ; les conditions étaient donc réunies pour une manifes-
tation « pacifique », sans risque de troubler 1' « ordre public »28.
Une fois de plus, la C.G.T. s'engageait, avec retard, dans une voie
qui avait été tracée par d'autres qu'elle.
qui a enclenché ce processus à la C.G.T. Il devenait nécessaire de
montrer que la C.G.T. pouvait faire descendre plus de monde
dans la rue et qu'elle se souciait également d'un changement poli-
tique éventuel. De plus, le pouvoir n'ayant pas bougé le 27, elle
avait la certitude qu'il n'interviendrait pas non plus deux jours
plus tard ; les conditions étaient donc réunies pour une manifes-
tation « pacifique », sans risque de troubler 1' « ordre public »28.
Une fois de plus, la C.G.T. s'engageait, avec retard, dans une voie
qui avait été tracée par d'autres qu'elle.
Le 29 au matin, le Bureau confédéral fait connaître dans un
communiqué les résultats de son entrevue avec l'U.N.E.F. ; tout
en se déclarant sincèrement animée de la volonté de surmonter les
difficultés apparues ces derniers temps, la C.G.T. affirme qu'elle ne
saurait accepter comme condition au renforcement de ses rapports
avec l'U.N.E.F. des préalables qui feraient cautionner n'importe
quelles opérations politiques.
communiqué les résultats de son entrevue avec l'U.N.E.F. ; tout
en se déclarant sincèrement animée de la volonté de surmonter les
difficultés apparues ces derniers temps, la C.G.T. affirme qu'elle ne
saurait accepter comme condition au renforcement de ses rapports
avec l'U.N.E.F. des préalables qui feraient cautionner n'importe
quelles opérations politiques.
Pour sa part, elle considère qu'une collaboration féconde peut et
doit s'établir entre la C.G.T. et l'U.N.E.F. sur la base de la définition
d'objectifs communs, de la responsabilité des organisations dans la
conduite d'un mouvement de masse de caractère organisé, ainsi que
de respect mutuel de l'indépendance respective des organisations et
du respect des engagements pris en commun.
doit s'établir entre la C.G.T. et l'U.N.E.F. sur la base de la définition
d'objectifs communs, de la responsabilité des organisations dans la
conduite d'un mouvement de masse de caractère organisé, ainsi que
de respect mutuel de l'indépendance respective des organisations et
du respect des engagements pris en commun.
Comme on peut le constater, ce ton mesuré et presque cordial
tranche singulièrement avec les stigmatisations fracassantes de la
tranche singulièrement avec les stigmatisations fracassantes de la
25. C'est un leitmotiv qui revient constamment, sans qu'il ait, à chaque
fois, le même but tactique.
fois, le même but tactique.
26. Le Peuple, op. cit., publie à la suite de ce communiqué de très larges
extraits des réponses que W. Rochet donne à l'A.F.P. le jour même.
extraits des réponses que W. Rochet donne à l'A.F.P. le jour même.
27. La formule employée est évidemment vague, mais elle n'en consti-
tue pas moins un changement important, qui témoigne bien de la volonté
de ne pas rester en deçà de la politisation du mouvement.
tue pas moins un changement important, qui témoigne bien de la volonté
de ne pas rester en deçà de la politisation du mouvement.
28. Ce qui est toujours une préoccupation majeure lorsque la C.G.T.
envisage une quelconque manifestation dans la rue ; il ne faut pas effrayer
les alliés que sont les « classes moyennes ».
envisage une quelconque manifestation dans la rue ; il ne faut pas effrayer
les alliés que sont les « classes moyennes ».
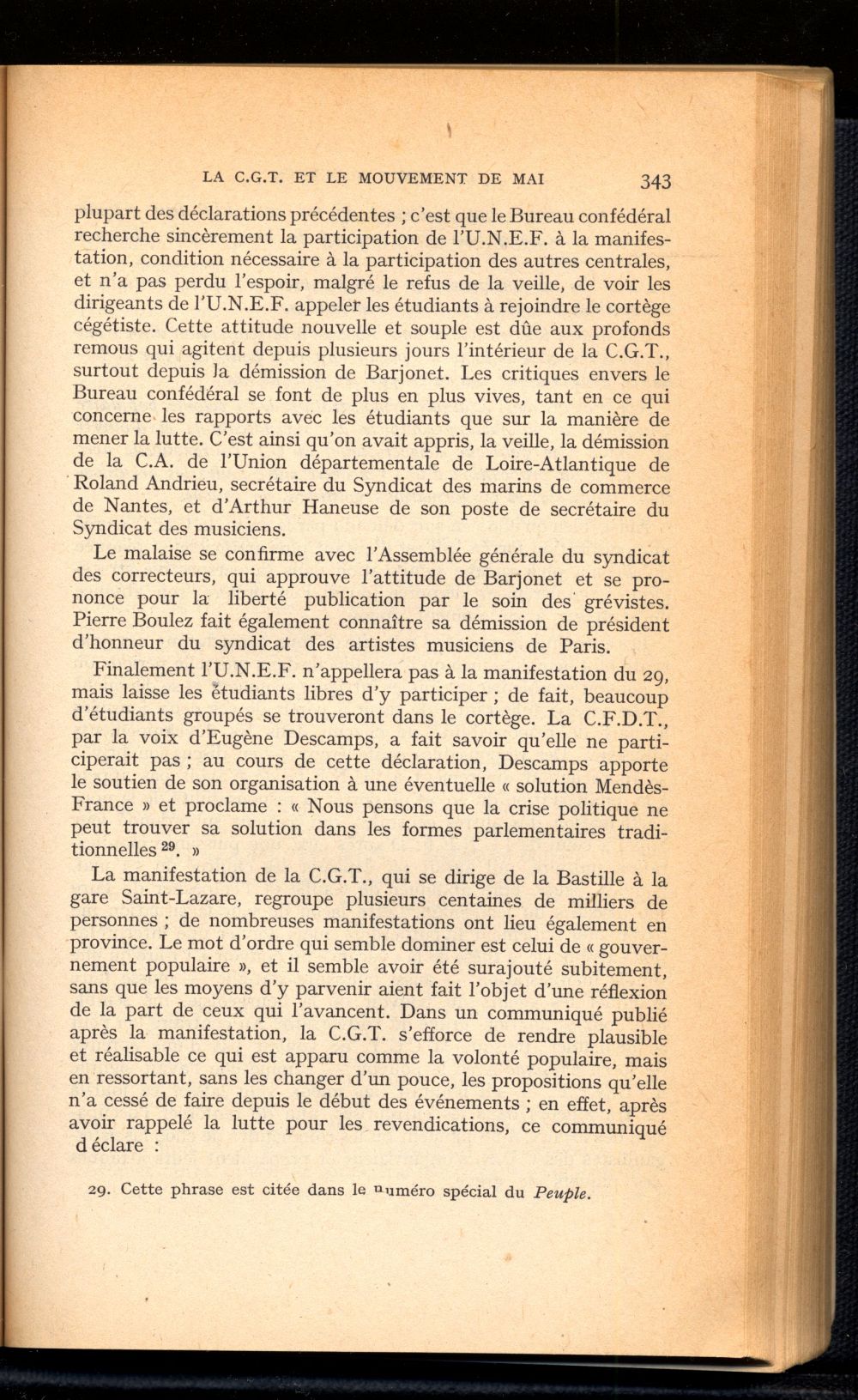

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
343
plupart des déclarations précédentes ; c'est que le Bureau confédéral
recherche sincèrement la participation de l'U.N.E.F. à la manifes-
tation, condition nécessaire à la participation des autres centrales,
et n'a pas perdu l'espoir, malgré le refus de la veille, de voir les
dirigeants de l'U.N.E.F. appeler les étudiants à rejoindre le cortège
cégétiste. Cette attitude nouvelle et souple est due aux profonds
remous qui agitent depuis plusieurs jours l'intérieur de la C.G.T.,
surtout depuis la démission de Barjonet. Les critiques envers le
Bureau confédéral se font de plus en plus vives, tant en ce qui
concerne les rapports avec les étudiants que sur la manière de
mener la lutte. C'est ainsi qu'on avait appris, la veille, la démission
de la C.A. de l'Union départementale de Loire-Atlantique de
Roland Andrieu, secrétaire du Syndicat des marins de commerce
de Nantes, et d'Arthur Haneuse de son poste de secrétaire du
Syndicat des musiciens.
recherche sincèrement la participation de l'U.N.E.F. à la manifes-
tation, condition nécessaire à la participation des autres centrales,
et n'a pas perdu l'espoir, malgré le refus de la veille, de voir les
dirigeants de l'U.N.E.F. appeler les étudiants à rejoindre le cortège
cégétiste. Cette attitude nouvelle et souple est due aux profonds
remous qui agitent depuis plusieurs jours l'intérieur de la C.G.T.,
surtout depuis la démission de Barjonet. Les critiques envers le
Bureau confédéral se font de plus en plus vives, tant en ce qui
concerne les rapports avec les étudiants que sur la manière de
mener la lutte. C'est ainsi qu'on avait appris, la veille, la démission
de la C.A. de l'Union départementale de Loire-Atlantique de
Roland Andrieu, secrétaire du Syndicat des marins de commerce
de Nantes, et d'Arthur Haneuse de son poste de secrétaire du
Syndicat des musiciens.
Le malaise se confirme avec l'Assemblée générale du syndicat
des correcteurs, qui approuve l'attitude de Barjonet et se pro-
nonce pour la liberté publication par le soin des grévistes.
Pierre Boulez fait également connaître sa démission de président
d'honneur du syndicat des artistes musiciens de Paris.
des correcteurs, qui approuve l'attitude de Barjonet et se pro-
nonce pour la liberté publication par le soin des grévistes.
Pierre Boulez fait également connaître sa démission de président
d'honneur du syndicat des artistes musiciens de Paris.
Finalement l'U.N.E.F. n'appellera pas à la manifestation du 29,
mais laisse les étudiants libres d'y participer ; de fait, beaucoup
d'étudiants groupés se trouveront dans le cortège. La C.F.D.T.,
par la voix d'Eugène Descamps, a fait savoir qu'elle ne parti-
ciperait pas ; au cours de cette déclaration, Descamps apporte
le soutien de son organisation à une éventuelle « solution Mendès-
France » et proclame : « Nous pensons que la crise politique ne
peut trouver sa solution dans les formes parlementaires tradi-
tionnelles w. »
mais laisse les étudiants libres d'y participer ; de fait, beaucoup
d'étudiants groupés se trouveront dans le cortège. La C.F.D.T.,
par la voix d'Eugène Descamps, a fait savoir qu'elle ne parti-
ciperait pas ; au cours de cette déclaration, Descamps apporte
le soutien de son organisation à une éventuelle « solution Mendès-
France » et proclame : « Nous pensons que la crise politique ne
peut trouver sa solution dans les formes parlementaires tradi-
tionnelles w. »
La manifestation de la C.G.T., qui se dirige de la Bastille à la
gare Saint-Lazare, regroupe plusieurs centaines de milliers de
personnes ; de nombreuses manifestations ont lieu également en
province. Le mot d'ordre qui semble dominer est celui de « gouver-
nement populaire », et il semble avoir été surajouté subitement,
sans que les moyens d'y parvenir aient fait l'objet d'une réflexion
de la part de ceux qui l'avancent. Dans un communiqué publié
après la manifestation, la C.G.T. s'efforce de rendre plausible
et réalisable ce qui est apparu comme la volonté populaire, mais
en ressortant, sans les changer d'un pouce, les propositions qu'elle
n'a cessé de faire depuis le début des événements ; en effet, après
avoir rappelé la lutte pour les revendications, ce communiqué
déclare :
gare Saint-Lazare, regroupe plusieurs centaines de milliers de
personnes ; de nombreuses manifestations ont lieu également en
province. Le mot d'ordre qui semble dominer est celui de « gouver-
nement populaire », et il semble avoir été surajouté subitement,
sans que les moyens d'y parvenir aient fait l'objet d'une réflexion
de la part de ceux qui l'avancent. Dans un communiqué publié
après la manifestation, la C.G.T. s'efforce de rendre plausible
et réalisable ce qui est apparu comme la volonté populaire, mais
en ressortant, sans les changer d'un pouce, les propositions qu'elle
n'a cessé de faire depuis le début des événements ; en effet, après
avoir rappelé la lutte pour les revendications, ce communiqué
déclare :
29. Cette phrase est citée dans le numéro spécial du Peuple.
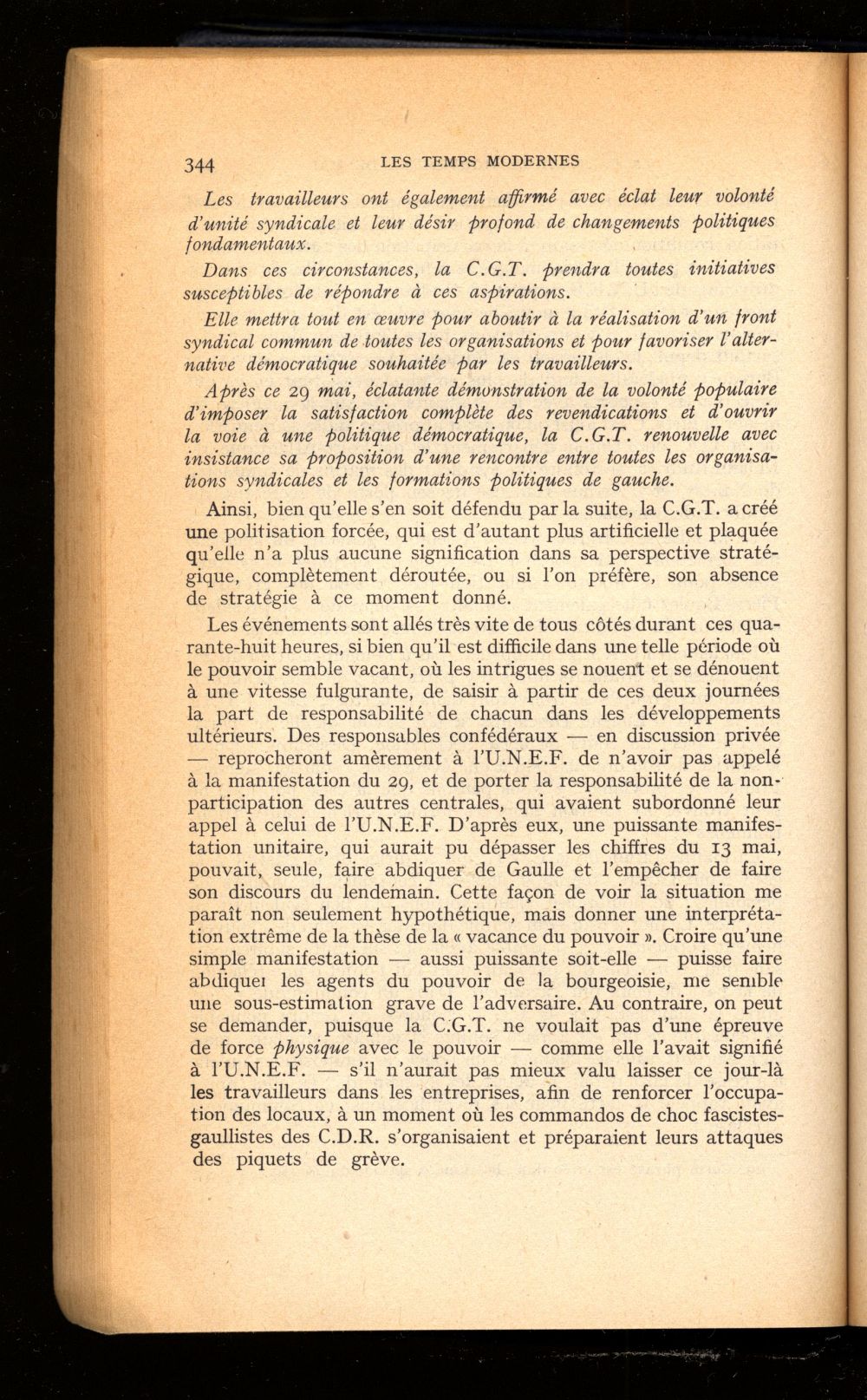

344
LES TEMPS MODERNES
Les travailleurs ont également affirmé avec éclat leur volonté
d'unité syndicale et leur désir •profond de changements -politiques
fondamentaux.
d'unité syndicale et leur désir •profond de changements -politiques
fondamentaux.
Dans ces circonstances, la C.G.T. prendra toutes initiatives
susceptibles de répondre à ces aspirations.
susceptibles de répondre à ces aspirations.
Elle mettra tout en œuvre pour aboutir à la réalisation d'un front
syndical commun de toutes les organisations et pour favoriser l'alter-
native démocratique souhaitée par les travailleurs.
syndical commun de toutes les organisations et pour favoriser l'alter-
native démocratique souhaitée par les travailleurs.
Après ce 29 mai, éclatante démonstration de la volonté populaire
d'imposer la satisfaction complète des revendications et d'ouvrir
la voie à une politique démocratique, la C.G.T. renouvelle avec
insistance sa proposition d'une rencontre entre toutes les organisa-
tions syndicales et les formations politiques de gauche.
d'imposer la satisfaction complète des revendications et d'ouvrir
la voie à une politique démocratique, la C.G.T. renouvelle avec
insistance sa proposition d'une rencontre entre toutes les organisa-
tions syndicales et les formations politiques de gauche.
Ainsi, bien qu'elle s'en soit défendu par la suite, la C.G.T. a créé
une politisation forcée, qui est d'autant plus artificielle et plaquée
qu'elle n'a plus aucune signification dans sa perspective straté-
gique, complètement déroutée, ou si l'on préfère, son absence
de stratégie à ce moment donné.
une politisation forcée, qui est d'autant plus artificielle et plaquée
qu'elle n'a plus aucune signification dans sa perspective straté-
gique, complètement déroutée, ou si l'on préfère, son absence
de stratégie à ce moment donné.
Les événements sont allés très vite de tous côtés durant ces qua-
rante-huit heures, si bien qu'il est difficile dans une telle période où
le pouvoir semble vacant, où les intrigues se nouent et se dénouent
à une vitesse fulgurante, de saisir à partir de ces deux journées
la part de responsabilité de chacun dans les développements
ultérieurs. Des responsables confédéraux — en discussion privée
— reprocheront amèrement à l'U.N.E.F. de n'avoir pas appelé
à la manifestation du 29, et de porter la responsabilité de la non-
participation des autres centrales, qui avaient subordonné leur
appel à celui de l'U.N.E.F. D'après eux, une puissante manifes-
tation unitaire, qui aurait pu dépasser les chiffres du 13 mai,
pouvait, seule, faire abdiquer de Gaulle et l'empêcher de faire
son discours du lendemain. Cette façon de voir la situation me
paraît non seulement hypothétique, mais donner une interpréta-
tion extrême de la thèse de la « vacance du pouvoir ». Croire qu'une
simple manifestation — aussi puissante soit-elle — puisse faire
abdiquei les agents du pouvoir de la bourgeoisie, nie semble
une sous-estimation grave de l'adversaire. Au contraire, on peut
se demander, puisque la C.G.T. ne voulait pas d'une épreuve
de force physique avec le pouvoir — comme elle l'avait signifié
à l'U.N.E.F. — s'il n'aurait pas mieux valu laisser ce jour-là
les travailleurs dans les entreprises, afin de renforcer l'occupa-
tion des locaux, à un moment où les commandos de choc fascistes-
gaullistes des C.D.R. s'organisaient et préparaient leurs attaques
des piquets de grève.
rante-huit heures, si bien qu'il est difficile dans une telle période où
le pouvoir semble vacant, où les intrigues se nouent et se dénouent
à une vitesse fulgurante, de saisir à partir de ces deux journées
la part de responsabilité de chacun dans les développements
ultérieurs. Des responsables confédéraux — en discussion privée
— reprocheront amèrement à l'U.N.E.F. de n'avoir pas appelé
à la manifestation du 29, et de porter la responsabilité de la non-
participation des autres centrales, qui avaient subordonné leur
appel à celui de l'U.N.E.F. D'après eux, une puissante manifes-
tation unitaire, qui aurait pu dépasser les chiffres du 13 mai,
pouvait, seule, faire abdiquer de Gaulle et l'empêcher de faire
son discours du lendemain. Cette façon de voir la situation me
paraît non seulement hypothétique, mais donner une interpréta-
tion extrême de la thèse de la « vacance du pouvoir ». Croire qu'une
simple manifestation — aussi puissante soit-elle — puisse faire
abdiquei les agents du pouvoir de la bourgeoisie, nie semble
une sous-estimation grave de l'adversaire. Au contraire, on peut
se demander, puisque la C.G.T. ne voulait pas d'une épreuve
de force physique avec le pouvoir — comme elle l'avait signifié
à l'U.N.E.F. — s'il n'aurait pas mieux valu laisser ce jour-là
les travailleurs dans les entreprises, afin de renforcer l'occupa-
tion des locaux, à un moment où les commandos de choc fascistes-
gaullistes des C.D.R. s'organisaient et préparaient leurs attaques
des piquets de grève.
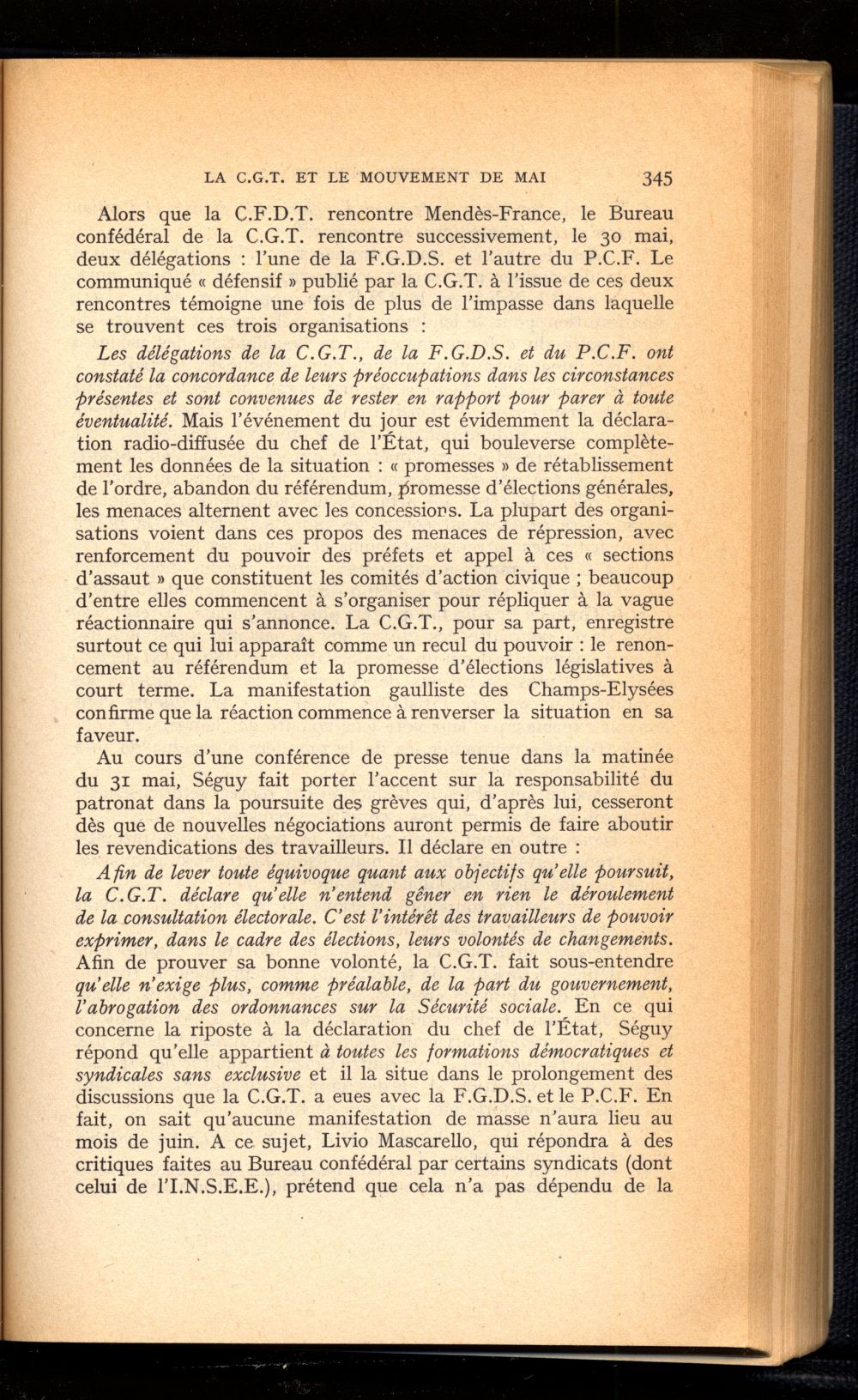

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
345
Alors que la C.F.D.T. rencontre Mendès-France, le Bureau
confédéral de la C.G.T. rencontre successivement, le 30 mai,
deux délégations : l'une de la F.G.D.S. et l'autre du P.C.F. Le
communiqué « défensif » publié par la C.G.T. à l'issue de ces deux
rencontres témoigne une fois de plus de l'impasse dans laquelle
se trouvent ces trois organisations :
confédéral de la C.G.T. rencontre successivement, le 30 mai,
deux délégations : l'une de la F.G.D.S. et l'autre du P.C.F. Le
communiqué « défensif » publié par la C.G.T. à l'issue de ces deux
rencontres témoigne une fois de plus de l'impasse dans laquelle
se trouvent ces trois organisations :
Les délégations de la C.G.T., de la F.G.D.S. et du P.C.F. ont
constaté la concordance de leurs préoccupations dans les circonstances
présentes et sont convenues de rester en rapport pour parer à toute
éventualité. Mais l'événement du jour est évidemment la déclara-
tion radio-diffusée du chef de l'État, qui bouleverse complète-
ment les données de la situation : « promesses » de rétablissement
de l'ordre, abandon du référendum, promesse d'élections générales,
les menaces alternent avec les concessions. La plupart des organi-
sations voient dans ces propos des menaces de répression, avec
renforcement du pouvoir des préfets et appel à ces « sections
d'assaut » que constituent les comités d'action civique ; beaucoup
d'entre elles commencent à s'organiser pour répliquer à la vague
réactionnaire qui s'annonce. La C.G.T., pour sa part, enregistre
surtout ce qui lui apparaît comme un recul du pouvoir : le renon-
cement au référendum et la promesse d'élections législatives à
court terme. La manifestation gaulliste des Champs-Elysées
confirme que la réaction commence à renverser la situation en sa
faveur.
constaté la concordance de leurs préoccupations dans les circonstances
présentes et sont convenues de rester en rapport pour parer à toute
éventualité. Mais l'événement du jour est évidemment la déclara-
tion radio-diffusée du chef de l'État, qui bouleverse complète-
ment les données de la situation : « promesses » de rétablissement
de l'ordre, abandon du référendum, promesse d'élections générales,
les menaces alternent avec les concessions. La plupart des organi-
sations voient dans ces propos des menaces de répression, avec
renforcement du pouvoir des préfets et appel à ces « sections
d'assaut » que constituent les comités d'action civique ; beaucoup
d'entre elles commencent à s'organiser pour répliquer à la vague
réactionnaire qui s'annonce. La C.G.T., pour sa part, enregistre
surtout ce qui lui apparaît comme un recul du pouvoir : le renon-
cement au référendum et la promesse d'élections législatives à
court terme. La manifestation gaulliste des Champs-Elysées
confirme que la réaction commence à renverser la situation en sa
faveur.
Au cours d'une conférence de presse tenue dans la matinée
du 31 mai, Séguy fait porter l'accent sur la responsabilité du
patronat dans la poursuite des grèves qui, d'après lui, cesseront
dès que de nouvelles négociations auront permis de faire aboutir
les revendications des travailleurs. Il déclare en outre :
du 31 mai, Séguy fait porter l'accent sur la responsabilité du
patronat dans la poursuite des grèves qui, d'après lui, cesseront
dès que de nouvelles négociations auront permis de faire aboutir
les revendications des travailleurs. Il déclare en outre :
Afin de lever toute équivoque quant aux objectifs qu'elle poursuit,
la C.G.T. déclare quelle n'entend gêner en rien le déroulement
de la consultation électorale. C'est l'intérêt des travailleurs de pouvoir
exprimer, dans le cadre des élections, leurs volontés de changements.
Afin de prouver sa bonne volonté, la C.G.T. fait sous-entendre
qu'elle n'exige plus, comme préalable, de la part du gouvernement,
l'abrogation des ordonnances sur la Sécurité sociale. En ce qui
concerne la riposte à la déclaration du chef de l'État, Séguy
répond qu'elle appartient à toutes les formations démocratiques et
syndicales sans exclusive et il la situe dans le prolongement des
discussions que la C.G.T. a eues avec la F.G.D.S. et le P.C.F. En
fait, on sait qu'aucune manifestation de masse n'aura lieu au
mois de juin. A ce sujet, Livio Mascarello, qui répondra à des
critiques faites au Bureau confédéral par certains syndicats (dont
celui de 1T.N.S.E.E.), prétend que cela n'a pas dépendu de la
la C.G.T. déclare quelle n'entend gêner en rien le déroulement
de la consultation électorale. C'est l'intérêt des travailleurs de pouvoir
exprimer, dans le cadre des élections, leurs volontés de changements.
Afin de prouver sa bonne volonté, la C.G.T. fait sous-entendre
qu'elle n'exige plus, comme préalable, de la part du gouvernement,
l'abrogation des ordonnances sur la Sécurité sociale. En ce qui
concerne la riposte à la déclaration du chef de l'État, Séguy
répond qu'elle appartient à toutes les formations démocratiques et
syndicales sans exclusive et il la situe dans le prolongement des
discussions que la C.G.T. a eues avec la F.G.D.S. et le P.C.F. En
fait, on sait qu'aucune manifestation de masse n'aura lieu au
mois de juin. A ce sujet, Livio Mascarello, qui répondra à des
critiques faites au Bureau confédéral par certains syndicats (dont
celui de 1T.N.S.E.E.), prétend que cela n'a pas dépendu de la
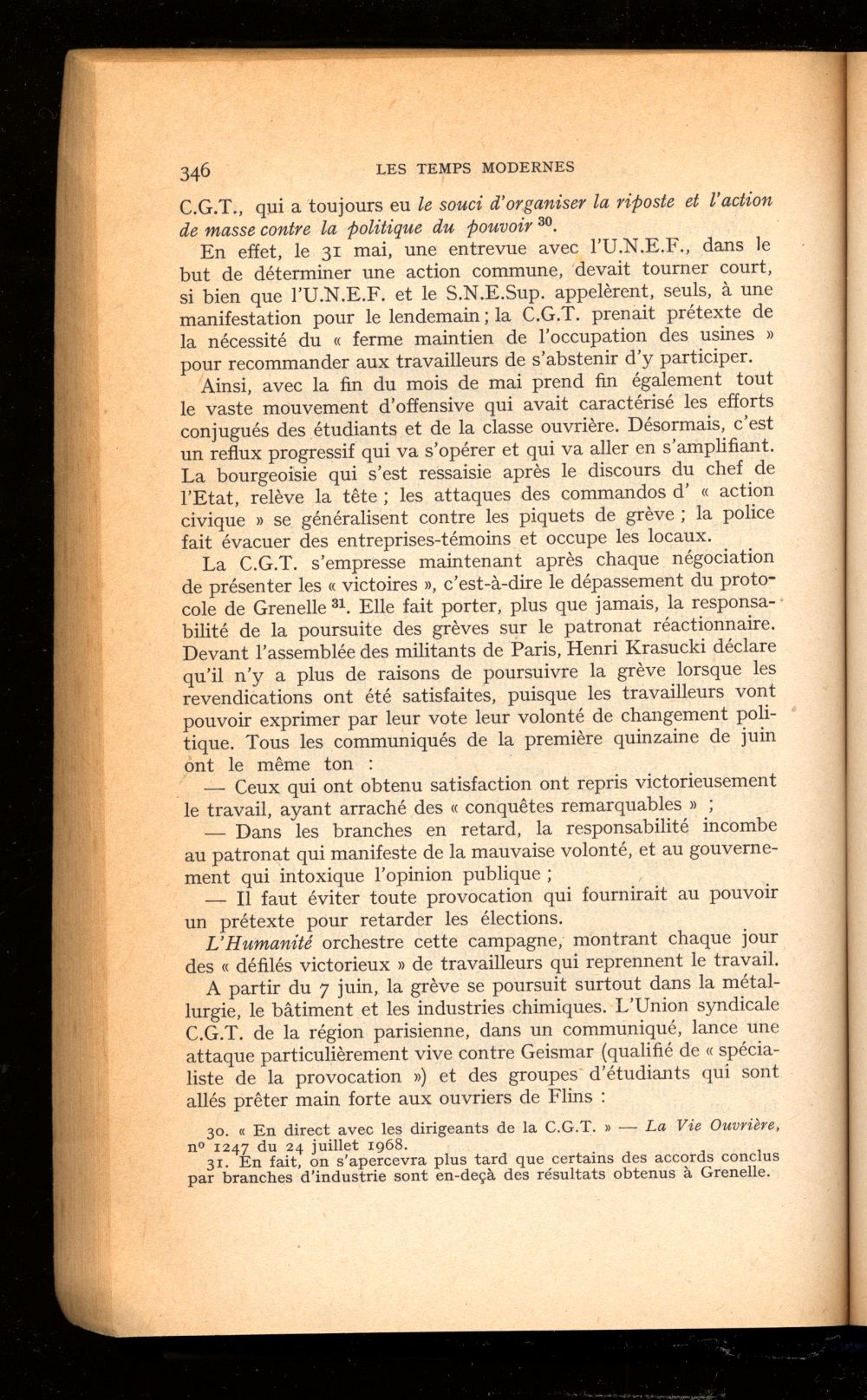

346
LES TEMPS MODERNES
C.G.T., qui a toujours eu le souci d'organiser la riposte et l'action
de masse contre la politique du pouvoir 30.
de masse contre la politique du pouvoir 30.
En effet, le 31 mai, une entrevue avec l'U.N.E.F., dans le
but de déterminer une action commune, devait tourner court,
si bien que l'U.N.E.F. et le S.N.E.Sup. appelèrent, seuls, à une
manifestation pour le lendemain ; la C.G.T. prenait prétexte de
la nécessité du « ferme maintien de l'occupation des usines »
pour recommander aux travailleurs de s'abstenir d'y participer.
but de déterminer une action commune, devait tourner court,
si bien que l'U.N.E.F. et le S.N.E.Sup. appelèrent, seuls, à une
manifestation pour le lendemain ; la C.G.T. prenait prétexte de
la nécessité du « ferme maintien de l'occupation des usines »
pour recommander aux travailleurs de s'abstenir d'y participer.
Ainsi, avec la fin du mois de mai prend fin également tout
le vaste mouvement d'offensive qui avait caractérisé les efforts
conjugués des étudiants et de la classe ouvrière. Désormais, c'est
un reflux progressif qui va s'opérer et qui va aller en s'amplifiant.
La bourgeoisie qui s'est ressaisie après le discours du chef de
l'Etat, relève la tête ; les attaques des commandos d' « action
civique » se généralisent contre les piquets de grève ; la police
fait évacuer des entreprises-témoins et occupe les locaux.
le vaste mouvement d'offensive qui avait caractérisé les efforts
conjugués des étudiants et de la classe ouvrière. Désormais, c'est
un reflux progressif qui va s'opérer et qui va aller en s'amplifiant.
La bourgeoisie qui s'est ressaisie après le discours du chef de
l'Etat, relève la tête ; les attaques des commandos d' « action
civique » se généralisent contre les piquets de grève ; la police
fait évacuer des entreprises-témoins et occupe les locaux.
La C.G.T. s'empresse maintenant après chaque négociation
de présenter les « victoires », c'est-à-dire le dépassement du proto-
cole de Grenelle 31. Elle fait porter, plus que jamais, la responsa-
bilité de la poursuite des grèves sur le patronat réactionnaire.
Devant l'assemblée des militants de Paris, Henri Krasucki déclare
qu'il n'y a plus de raisons de poursuivre la grève lorsque les
revendications ont été satisfaites, puisque les travailleurs vont
pouvoir exprimer par leur vote leur volonté de changement poli-
tique. Tous les communiqués de la première quinzaine de juin
ont le même ton :
de présenter les « victoires », c'est-à-dire le dépassement du proto-
cole de Grenelle 31. Elle fait porter, plus que jamais, la responsa-
bilité de la poursuite des grèves sur le patronat réactionnaire.
Devant l'assemblée des militants de Paris, Henri Krasucki déclare
qu'il n'y a plus de raisons de poursuivre la grève lorsque les
revendications ont été satisfaites, puisque les travailleurs vont
pouvoir exprimer par leur vote leur volonté de changement poli-
tique. Tous les communiqués de la première quinzaine de juin
ont le même ton :
— Ceux qui ont obtenu satisfaction ont repris victorieusement
le travail, ayant arraché des « conquêtes remarquables » ;
le travail, ayant arraché des « conquêtes remarquables » ;
— Dans les branches en retard, la responsabilité incombe
au patronat qui manifeste de la mauvaise volonté, et au gouverne-
ment qui intoxique l'opinion publique ;
au patronat qui manifeste de la mauvaise volonté, et au gouverne-
ment qui intoxique l'opinion publique ;
— Il faut éviter toute provocation qui fournirait au pouvoir
un prétexte pour retarder les élections.
un prétexte pour retarder les élections.
L'Humanité orchestre cette campagne, montrant chaque jour
des « défilés victorieux » de travailleurs qui reprennent le travail.
des « défilés victorieux » de travailleurs qui reprennent le travail.
A partir du 7 juin, la grève se poursuit surtout dans la métal-
lurgie, le bâtiment et les industries chimiques. L'Union syndicale
C.G.T. de la région parisienne, dans un communiqué, lance une
attaque particulièrement vive contre Geismar (qualifié de « spécia-
liste de la provocation ») et des groupes d'étudiants qui sont
allés prêter main forte aux ouvriers de Flins :
lurgie, le bâtiment et les industries chimiques. L'Union syndicale
C.G.T. de la région parisienne, dans un communiqué, lance une
attaque particulièrement vive contre Geismar (qualifié de « spécia-
liste de la provocation ») et des groupes d'étudiants qui sont
allés prêter main forte aux ouvriers de Flins :
30. « En direct avec les dirigeants de la C.G.T. » — La Vie Ouvrière,
n° 1247 du 24 juillet 1968.
n° 1247 du 24 juillet 1968.
31. En fait, on s'apercevra plus tard que certains des accords conclus
par branches d'industrie sont en-deçà des résultats obtenus à Grenelle.
par branches d'industrie sont en-deçà des résultats obtenus à Grenelle.
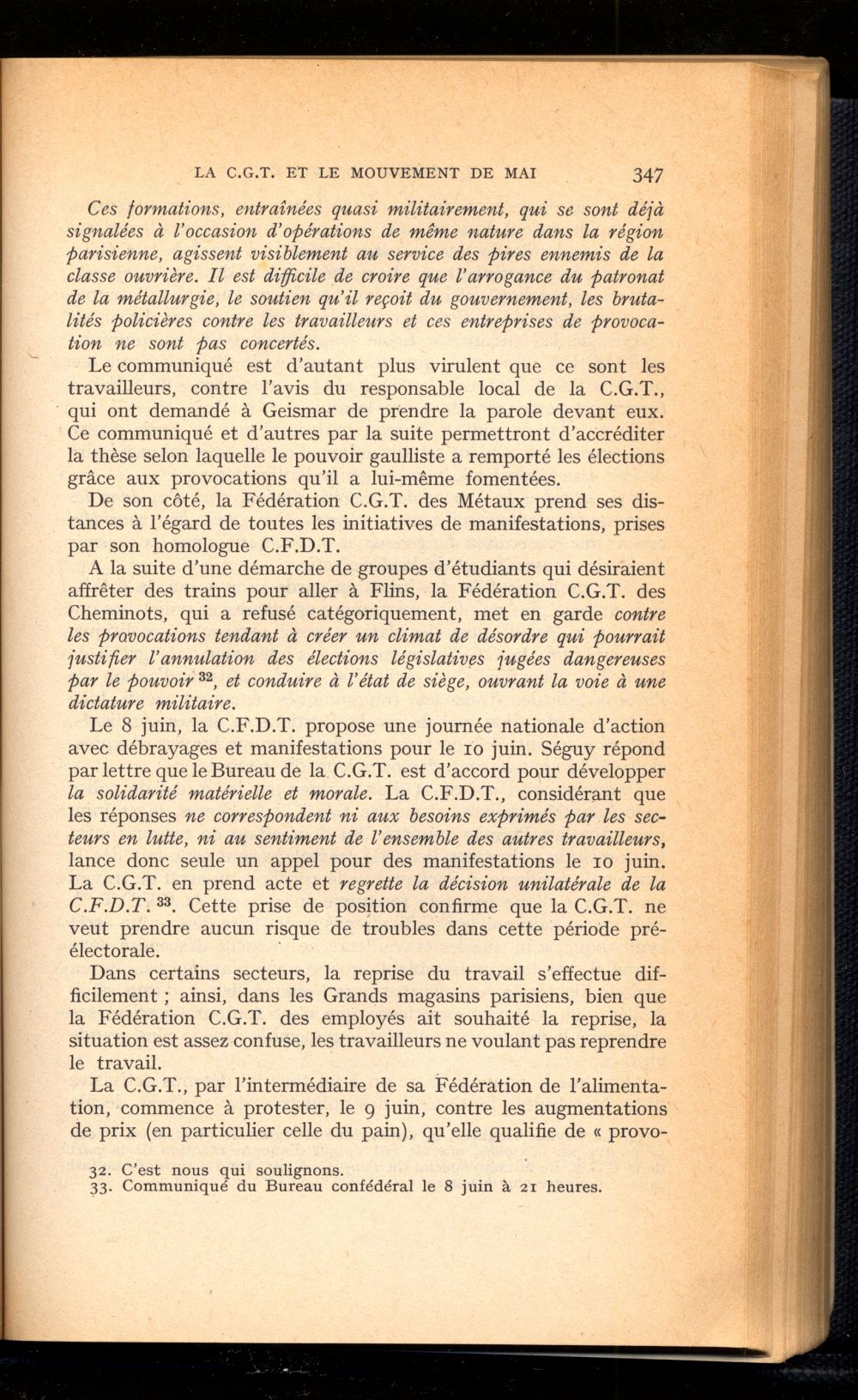

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
347
Ces formations, entraînées quasi militairement, qui se sont déjà
signalées à l'occasion d'opérations de même nature dans la région
parisienne, agissent visiblement au service des pires ennemis de la
classe ouvrière. Il est difficile de croire que l'arrogance du patronat
de la métallurgie, le soutien qu'il reçoit du gouvernement, les bruta-
lités policières contre les travailleurs et ces entreprises de provoca-
tion ne sont pas concertés.
signalées à l'occasion d'opérations de même nature dans la région
parisienne, agissent visiblement au service des pires ennemis de la
classe ouvrière. Il est difficile de croire que l'arrogance du patronat
de la métallurgie, le soutien qu'il reçoit du gouvernement, les bruta-
lités policières contre les travailleurs et ces entreprises de provoca-
tion ne sont pas concertés.
Le communiqué est d'autant plus virulent que ce sont les
travailleurs, contre l'avis du responsable local de la C.G.T.,
qui ont demandé à Geismar de prendre la parole devant eux.
Ce communiqué et d'autres par la suite permettront d'accréditer
la thèse selon laquelle le pouvoir gaulliste a remporté les élections
grâce aux provocations qu'il a lui-même fomentées.
travailleurs, contre l'avis du responsable local de la C.G.T.,
qui ont demandé à Geismar de prendre la parole devant eux.
Ce communiqué et d'autres par la suite permettront d'accréditer
la thèse selon laquelle le pouvoir gaulliste a remporté les élections
grâce aux provocations qu'il a lui-même fomentées.
De son côté, la Fédération C.G.T. des Métaux prend ses dis-
tances à l'égard de toutes les initiatives de manifestations, prises
par son homologue C.F.D.T.
tances à l'égard de toutes les initiatives de manifestations, prises
par son homologue C.F.D.T.
A la suite d'une démarche de groupes d'étudiants qui désiraient
affréter des trains pour aller à Flins, la Fédération C.G.T. des
Cheminots, qui a refusé catégoriquement, met en garde contre
les provocations tendant à créer un climat de désordre qui pourrait
justifier l'annulation des élections législatives jugées dangereuses
par le pouvoir 32, et conduire à l'état de siège, ouvrant la voie à une
dictature militaire.
affréter des trains pour aller à Flins, la Fédération C.G.T. des
Cheminots, qui a refusé catégoriquement, met en garde contre
les provocations tendant à créer un climat de désordre qui pourrait
justifier l'annulation des élections législatives jugées dangereuses
par le pouvoir 32, et conduire à l'état de siège, ouvrant la voie à une
dictature militaire.
Le 8 juin, la C.F.D.T. propose une journée nationale d'action
avec débrayages et manifestations pour le 10 juin. Séguy répond
par lettre que le Bureau de la C.G.T. est d'accord pour développer
la solidarité matérielle et morale. La C.F.D.T., considérant que
les réponses ne correspondent ni aux besoins exprimés par les sec-
teurs en lutte, ni au sentiment de l'ensemble des autres travailleurs,
lance donc seule un appel pour des manifestations le 10 juin.
La C.G.T. en prend acte et regrette la décision unilatérale de la
C.F.D.T. 33. Cette prise de position confirme que la C.G.T. ne
veut prendre aucun risque de troubles dans cette période pré-
électorale.
avec débrayages et manifestations pour le 10 juin. Séguy répond
par lettre que le Bureau de la C.G.T. est d'accord pour développer
la solidarité matérielle et morale. La C.F.D.T., considérant que
les réponses ne correspondent ni aux besoins exprimés par les sec-
teurs en lutte, ni au sentiment de l'ensemble des autres travailleurs,
lance donc seule un appel pour des manifestations le 10 juin.
La C.G.T. en prend acte et regrette la décision unilatérale de la
C.F.D.T. 33. Cette prise de position confirme que la C.G.T. ne
veut prendre aucun risque de troubles dans cette période pré-
électorale.
Dans certains secteurs, la reprise du travail s'effectue dif-
ficilement ; ainsi, dans les Grands magasins parisiens, bien que
la Fédération C.G.T. des employés ait souhaité la reprise, la
situation est assez confuse, les travailleurs ne voulant pas reprendre
le travail.
ficilement ; ainsi, dans les Grands magasins parisiens, bien que
la Fédération C.G.T. des employés ait souhaité la reprise, la
situation est assez confuse, les travailleurs ne voulant pas reprendre
le travail.
La C.G.T., par l'intermédiaire de sa Fédération de l'alimenta-
tion, commence à protester, le 9 juin, contre les augmentations
de prix (en particulier celle du pain), qu'elle qualifie de « provo-
tion, commence à protester, le 9 juin, contre les augmentations
de prix (en particulier celle du pain), qu'elle qualifie de « provo-
32. C'est nous qui soulignons.
33. Communiqué du Bureau confédéral le
juin à 2i heures.
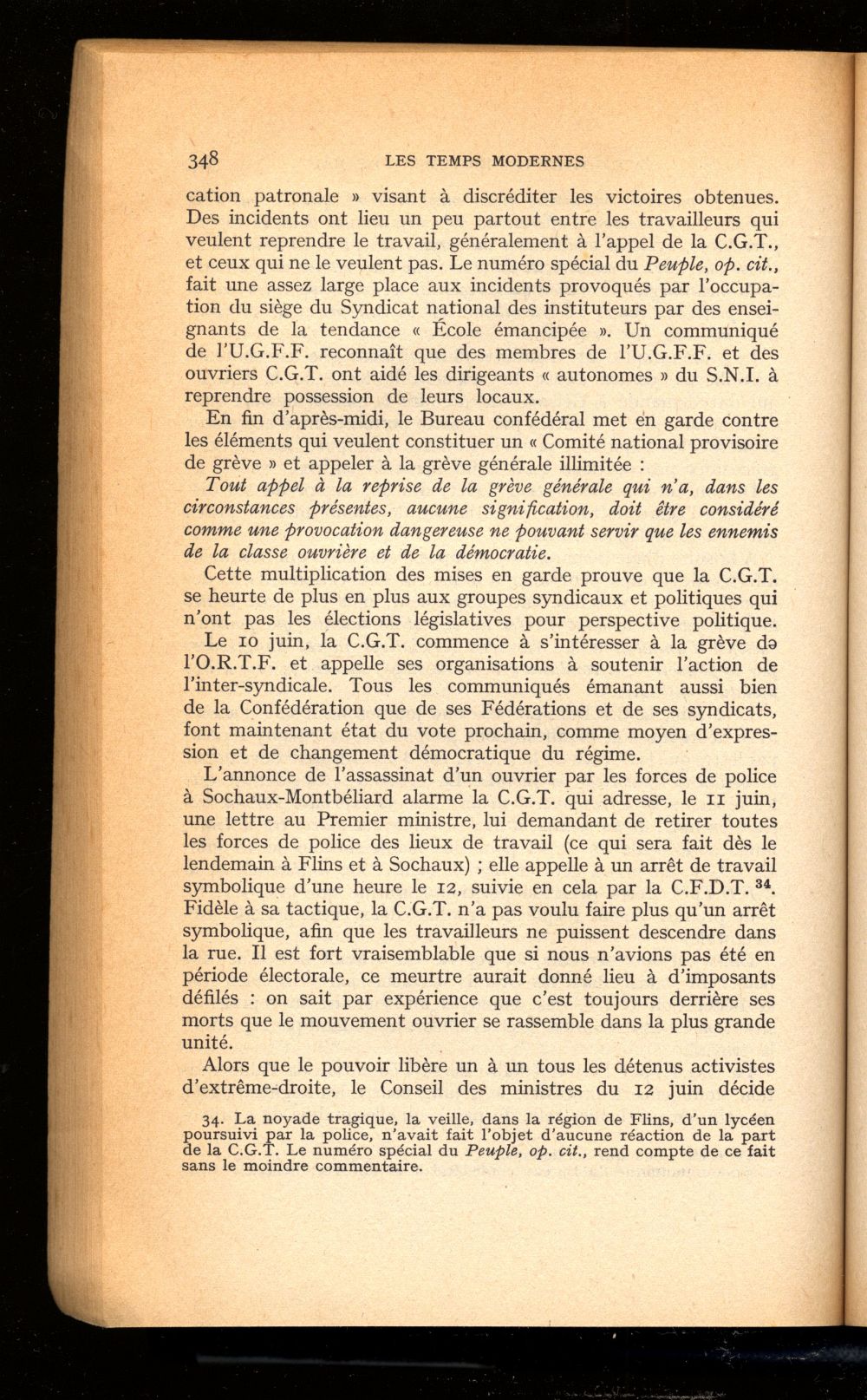

348
LES TEMPS MODERNES
cation patronale » visant à discréditer les victoires obtenues.
Des incidents ont lieu un peu partout entre les travailleurs qui
veulent reprendre le travail, généralement à l'appel de la C.G.T.,
et ceux qui ne le veulent pas. Le numéro spécial du Peuple, op. cit.,
fait une assez large place aux incidents provoqués par l'occupa-
tion du siège du Syndicat national des instituteurs par des ensei-
gnants de la tendance « Ecole émancipée ». Un communiqué
de l'U.C.F.F. reconnaît que des membres de l'U.G.F.F. et des
ouvriers C.G.T. ont aidé les dirigeants « autonomes » du S.N.I. à
reprendre possession de leurs locaux.
Des incidents ont lieu un peu partout entre les travailleurs qui
veulent reprendre le travail, généralement à l'appel de la C.G.T.,
et ceux qui ne le veulent pas. Le numéro spécial du Peuple, op. cit.,
fait une assez large place aux incidents provoqués par l'occupa-
tion du siège du Syndicat national des instituteurs par des ensei-
gnants de la tendance « Ecole émancipée ». Un communiqué
de l'U.C.F.F. reconnaît que des membres de l'U.G.F.F. et des
ouvriers C.G.T. ont aidé les dirigeants « autonomes » du S.N.I. à
reprendre possession de leurs locaux.
En fin d'après-midi, le Bureau confédéral met en garde contre
les éléments qui veulent constituer un « Comité national provisoire
de grève » et appeler à la grève générale illimitée :
les éléments qui veulent constituer un « Comité national provisoire
de grève » et appeler à la grève générale illimitée :
Tout appel à la reprise de la grève générale qui n'a, dans les
circonstances présentes, aucune signification, doit être considéré
comme une provocation dangereuse ne pouvant servir que les ennemis
de la classe ouvrière et de la démocratie.
circonstances présentes, aucune signification, doit être considéré
comme une provocation dangereuse ne pouvant servir que les ennemis
de la classe ouvrière et de la démocratie.
Cette multiplication des mises en garde prouve que la C.G.T.
se heurte de plus en plus aux groupes syndicaux et politiques qui
n'ont pas les élections législatives pour perspective politique.
se heurte de plus en plus aux groupes syndicaux et politiques qui
n'ont pas les élections législatives pour perspective politique.
Le 10 juin, la C.G.T. commence à s'intéresser à la grève da
l'O.R.T.F. et appelle ses organisations à soutenir l'action de
l'inter-syndicale. Tous les communiqués émanant aussi bien
de la Confédération que de ses Fédérations et de ses syndicats,
font maintenant état du vote prochain, comme moyen d'expres-
sion et de changement démocratique du régime.
l'O.R.T.F. et appelle ses organisations à soutenir l'action de
l'inter-syndicale. Tous les communiqués émanant aussi bien
de la Confédération que de ses Fédérations et de ses syndicats,
font maintenant état du vote prochain, comme moyen d'expres-
sion et de changement démocratique du régime.
L'annonce de l'assassinat d'un ouvrier par les forces de police
à Sochaux-Montbéliard alarme la C.G.T. qui adresse, le n juin,
une lettre au Premier ministre, lui demandant de retirer toutes
les forces de police des lieux de travail (ce qui sera fait dès le
lendemain à Flins et à Sochaux) ; elle appelle à un arrêt de travail
symbolique d'une heure le 12, suivie en cela par la C.F.D.T. 34.
Fidèle à sa tactique, la C.G.T. n'a pas voulu faire plus qu'un arrêt
symbolique, afin que les travailleurs ne puissent descendre dans
la rue. Il est fort vraisemblable que si nous n'avions pas été en
période électorale, ce meurtre aurait donné lieu à d'imposants
défilés : on sait par expérience que c'est toujours derrière ses
morts que le mouvement ouvrier se rassemble dans la plus grande
unité.
à Sochaux-Montbéliard alarme la C.G.T. qui adresse, le n juin,
une lettre au Premier ministre, lui demandant de retirer toutes
les forces de police des lieux de travail (ce qui sera fait dès le
lendemain à Flins et à Sochaux) ; elle appelle à un arrêt de travail
symbolique d'une heure le 12, suivie en cela par la C.F.D.T. 34.
Fidèle à sa tactique, la C.G.T. n'a pas voulu faire plus qu'un arrêt
symbolique, afin que les travailleurs ne puissent descendre dans
la rue. Il est fort vraisemblable que si nous n'avions pas été en
période électorale, ce meurtre aurait donné lieu à d'imposants
défilés : on sait par expérience que c'est toujours derrière ses
morts que le mouvement ouvrier se rassemble dans la plus grande
unité.
Alors que le pouvoir libère un à un tous les détenus activistes
d'extrême-droite, le Conseil des ministres du 12 juin décide
d'extrême-droite, le Conseil des ministres du 12 juin décide
34. La noyade tragique, la veille, dans la région de Flins, d'un lycé'
poursuivi par la police, n'avait fait l'objet d'aucune réaction de la pa
de la C.G.T. Le numéro spécial du Peuple, op. cit., rend compte de ce fait
sans le moindre commentaire.
poursuivi par la police, n'avait fait l'objet d'aucune réaction de la pa
de la C.G.T. Le numéro spécial du Peuple, op. cit., rend compte de ce fait
sans le moindre commentaire.
ceen
part
part
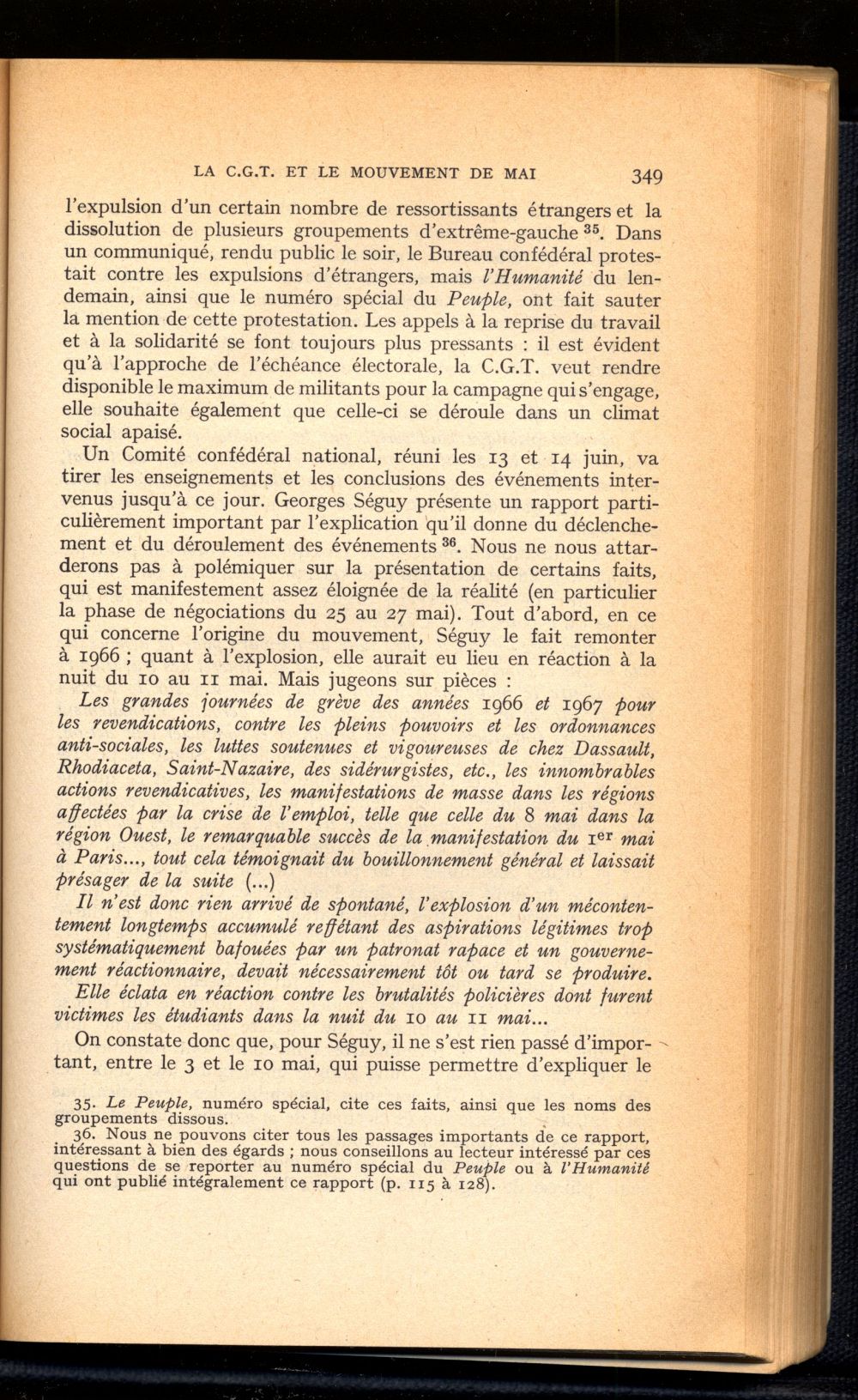

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
349
l'expulsion d'un certain nombre de ressortissants étrangers et la
dissolution de plusieurs groupements d'extrême-gauche 35. Dans
un communiqué, rendu public le soir, le Bureau confédéral protes-
tait contre les expulsions d'étrangers, mais l'Humanité du len-
demain, ainsi que le numéro spécial du Peuple, ont fait sauter
la mention de cette protestation. Les appels à la reprise du travail
et à la solidarité se font toujours plus pressants : il est évident
qu'à l'approche de l'échéance électorale, la C.G.T. veut rendre
disponible le maximum de militants pour la campagne qui s'engage,
elle souhaite également que celle-ci se déroule dans un climat
social apaisé.
dissolution de plusieurs groupements d'extrême-gauche 35. Dans
un communiqué, rendu public le soir, le Bureau confédéral protes-
tait contre les expulsions d'étrangers, mais l'Humanité du len-
demain, ainsi que le numéro spécial du Peuple, ont fait sauter
la mention de cette protestation. Les appels à la reprise du travail
et à la solidarité se font toujours plus pressants : il est évident
qu'à l'approche de l'échéance électorale, la C.G.T. veut rendre
disponible le maximum de militants pour la campagne qui s'engage,
elle souhaite également que celle-ci se déroule dans un climat
social apaisé.
Un Comité confédéral national, réuni les 13 et 14 juin, va
tirer les enseignements et les conclusions des événements inter-
venus jusqu'à ce jour. Georges Séguy présente un rapport parti-
culièrement important par l'explication qu'il donne du déclenche-
ment et du déroulement des événements 36. Nous ne nous attar-
derons pas à polémiquer sur la présentation de certains faits,
qui est manifestement assez éloignée de la réalité (en particulier
la phase de négociations du 25 au 27 mai). Tout d'abord, en ce
qui concerne l'origine du mouvement, Séguy le fait remonter
à 1966 ; quant à l'explosion, elle aurait eu lieu en réaction à la
nuit du 10 au u mai. Mais jugeons sur pièces :
tirer les enseignements et les conclusions des événements inter-
venus jusqu'à ce jour. Georges Séguy présente un rapport parti-
culièrement important par l'explication qu'il donne du déclenche-
ment et du déroulement des événements 36. Nous ne nous attar-
derons pas à polémiquer sur la présentation de certains faits,
qui est manifestement assez éloignée de la réalité (en particulier
la phase de négociations du 25 au 27 mai). Tout d'abord, en ce
qui concerne l'origine du mouvement, Séguy le fait remonter
à 1966 ; quant à l'explosion, elle aurait eu lieu en réaction à la
nuit du 10 au u mai. Mais jugeons sur pièces :
Les grandes journées de grève des années 1966 et 1967 -pour
les revendications, contre les pleins pouvoirs et les ordonnances
anti-sociales, les luttes soutenues et vigoureuses de chez Dassault,
Rhodiaceta, Saint-Nazaire, des sidérurgistes, etc., les innombrables
actions revendicatives, les manifestations de masse dans les régions
affectées par la crise de l'emploi, telle que celle du 8 mai dans la
région Ouest, le remarquable succès de la manifestation du Ier mai
à Paris..., tout cela témoignait du bouillonnement général et laissait
présager de la suite (...)
les revendications, contre les pleins pouvoirs et les ordonnances
anti-sociales, les luttes soutenues et vigoureuses de chez Dassault,
Rhodiaceta, Saint-Nazaire, des sidérurgistes, etc., les innombrables
actions revendicatives, les manifestations de masse dans les régions
affectées par la crise de l'emploi, telle que celle du 8 mai dans la
région Ouest, le remarquable succès de la manifestation du Ier mai
à Paris..., tout cela témoignait du bouillonnement général et laissait
présager de la suite (...)
77 n'est donc rien arrivé de spontané, l'explosion d'un méconten-
tement longtemps accumulé reffétant des aspirations légitimes trop
systématiquement bafouées par un patronat rapace et un gouverne-
ment réactionnaire, devait nécessairement tôt ou tard se produire.
tement longtemps accumulé reffétant des aspirations légitimes trop
systématiquement bafouées par un patronat rapace et un gouverne-
ment réactionnaire, devait nécessairement tôt ou tard se produire.
Elle éclata en réaction contre les brutalités policières dont furent
victimes les étudiants dans la nuit du 10 au il mai...
victimes les étudiants dans la nuit du 10 au il mai...
On constate donc que, pour Séguy, il ne s'est rien passé d'impor-
tant, entre le 3 et le 10 mai, qui puisse permettre d'expliquer le
tant, entre le 3 et le 10 mai, qui puisse permettre d'expliquer le
35. Le Peuple, numéro spécial, cite ces faits, ainsi que les noms des
groupements dissous.
groupements dissous.
36. Nous ne pouvons citer tous les passages importants de ce rapport,
intéressant à bien des égards ; nous conseillons au lecteur intéressé par ces
questions de se reporter au numéro spécial du Peuple ou à l'Humanité
qui ont publié intégralement ce rapport (p. 115 à 128).
intéressant à bien des égards ; nous conseillons au lecteur intéressé par ces
questions de se reporter au numéro spécial du Peuple ou à l'Humanité
qui ont publié intégralement ce rapport (p. 115 à 128).
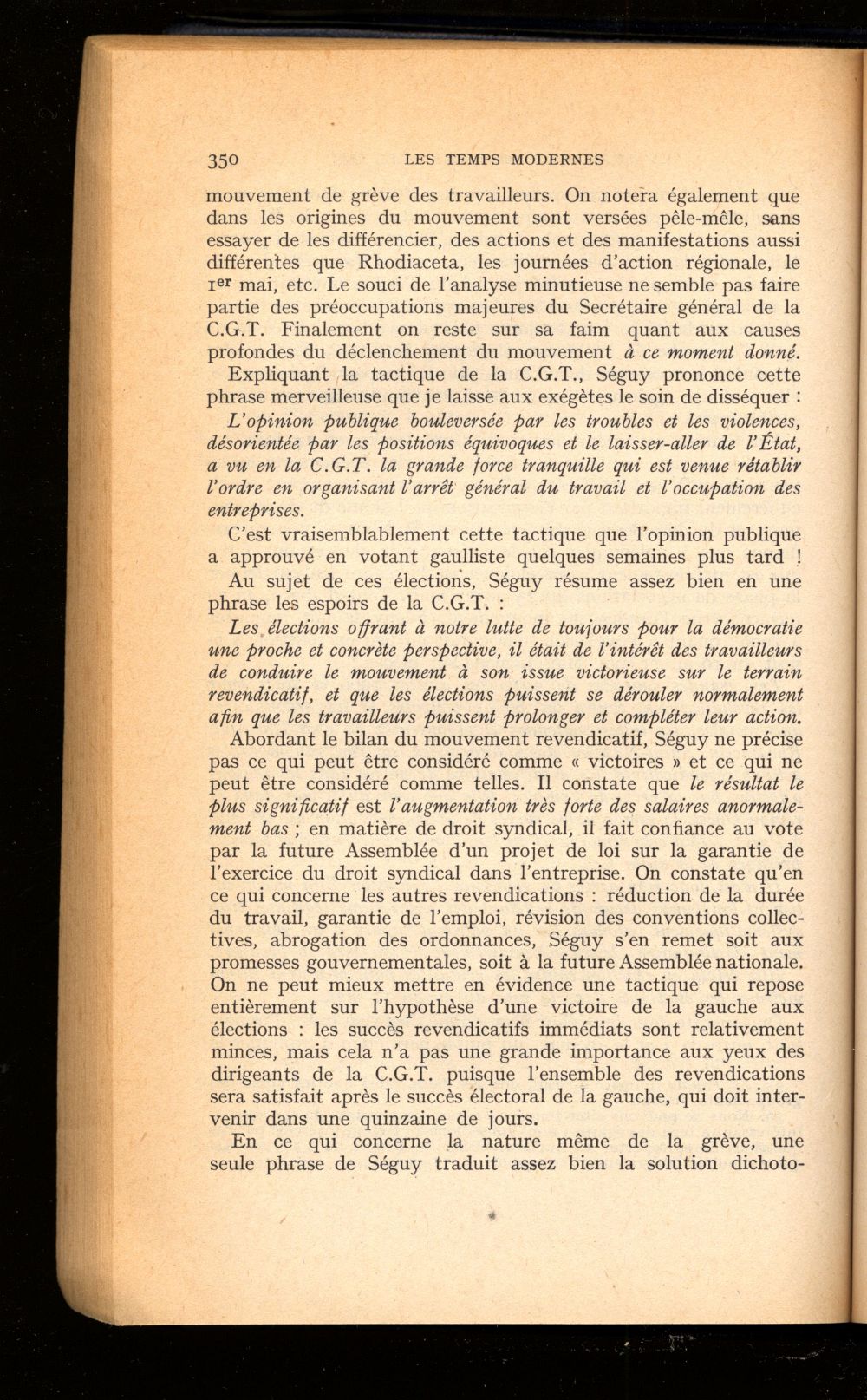

350
LES TEMPS MODERNES
mouvement de grève des travailleurs. On notera également que
dans les origines du mouvement sont versées pêle-mêle, sans
essayer de les différencier, des actions et des manifestations aussi
différentes que Rhodiaceta, les journées d'action régionale, le
Ier mai, etc. Le souci de l'analyse minutieuse ne semble pas faire
partie des préoccupations majeures du Secrétaire général de la
C.G.T. Finalement on reste sur sa faim quant aux causes
profondes du déclenchement du mouvement à ce moment donné.
dans les origines du mouvement sont versées pêle-mêle, sans
essayer de les différencier, des actions et des manifestations aussi
différentes que Rhodiaceta, les journées d'action régionale, le
Ier mai, etc. Le souci de l'analyse minutieuse ne semble pas faire
partie des préoccupations majeures du Secrétaire général de la
C.G.T. Finalement on reste sur sa faim quant aux causes
profondes du déclenchement du mouvement à ce moment donné.
Expliquant la tactique de la C.G.T., Séguy prononce cette
phrase merveilleuse que je laisse aux exégètes le soin de disséquer :
phrase merveilleuse que je laisse aux exégètes le soin de disséquer :
L'opinion publique bouleversée par les troubles et les violences,
désorientée par les positions équivoques et le laisser-aller de l'État,
a vu en la C.G.T. la grande force tranquille qui est venue rétablir
l'ordre en organisant l'arrêt général du travail et l'occupation des
entreprises.
désorientée par les positions équivoques et le laisser-aller de l'État,
a vu en la C.G.T. la grande force tranquille qui est venue rétablir
l'ordre en organisant l'arrêt général du travail et l'occupation des
entreprises.
C'est vraisemblablement cette tactique que l'opinion publique
a approuvé en votant gaulliste quelques semaines plus tard !
a approuvé en votant gaulliste quelques semaines plus tard !
Au sujet de ces élections, Séguy résume assez bien en une
phrase les espoirs de la C.G.T. :
phrase les espoirs de la C.G.T. :
Les élections offrant à notre lutte de toujours pour la démocratie
une proche et concrète perspective, il était de l'intérêt des travailleurs
de conduire le mouvement à son issue victorieuse sur le terrain
revendicatif, et que les élections puissent se dérouler normalement
afin que les travailleurs puissent prolonger et compléter leur action.
une proche et concrète perspective, il était de l'intérêt des travailleurs
de conduire le mouvement à son issue victorieuse sur le terrain
revendicatif, et que les élections puissent se dérouler normalement
afin que les travailleurs puissent prolonger et compléter leur action.
Abordant le bilan du mouvement revendicatif, Séguy ne précise
pas ce qui peut être considéré comme « victoires » et ce qui ne
peut être considéré comme telles. Il constate que le résultat le
plus significatif est l'augmentation très forte des salaires anormale-
ment bas ; en matière de droit syndical, il fait confiance au vote
par la future Assemblée d'un projet de loi sur la garantie de
l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. On constate qu'en
ce qui concerne les autres revendications : réduction de la durée
du travail, garantie de l'emploi, révision des conventions collec-
tives, abrogation des ordonnances, Séguy s'en remet soit aux
promesses gouvernementales, soit à la future Assemblée nationale.
On ne peut mieux mettre en évidence une tactique qui repose
entièrement sur l'hypothèse d'une victoire de la gauche aux
élections : les succès revendicatifs immédiats sont relativement
minces, mais cela n'a pas une grande importance aux yeux des
dirigeants de la C.G.T. puisque l'ensemble des revendications
sera satisfait après le succès électoral de la gauche, qui doit inter-
venir dans une quinzaine de jours.
pas ce qui peut être considéré comme « victoires » et ce qui ne
peut être considéré comme telles. Il constate que le résultat le
plus significatif est l'augmentation très forte des salaires anormale-
ment bas ; en matière de droit syndical, il fait confiance au vote
par la future Assemblée d'un projet de loi sur la garantie de
l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. On constate qu'en
ce qui concerne les autres revendications : réduction de la durée
du travail, garantie de l'emploi, révision des conventions collec-
tives, abrogation des ordonnances, Séguy s'en remet soit aux
promesses gouvernementales, soit à la future Assemblée nationale.
On ne peut mieux mettre en évidence une tactique qui repose
entièrement sur l'hypothèse d'une victoire de la gauche aux
élections : les succès revendicatifs immédiats sont relativement
minces, mais cela n'a pas une grande importance aux yeux des
dirigeants de la C.G.T. puisque l'ensemble des revendications
sera satisfait après le succès électoral de la gauche, qui doit inter-
venir dans une quinzaine de jours.
En ce qui concerne la nature même de la grève, une
seule phrase de Séguy traduit assez bien la solution dichoto-
seule phrase de Séguy traduit assez bien la solution dichoto-
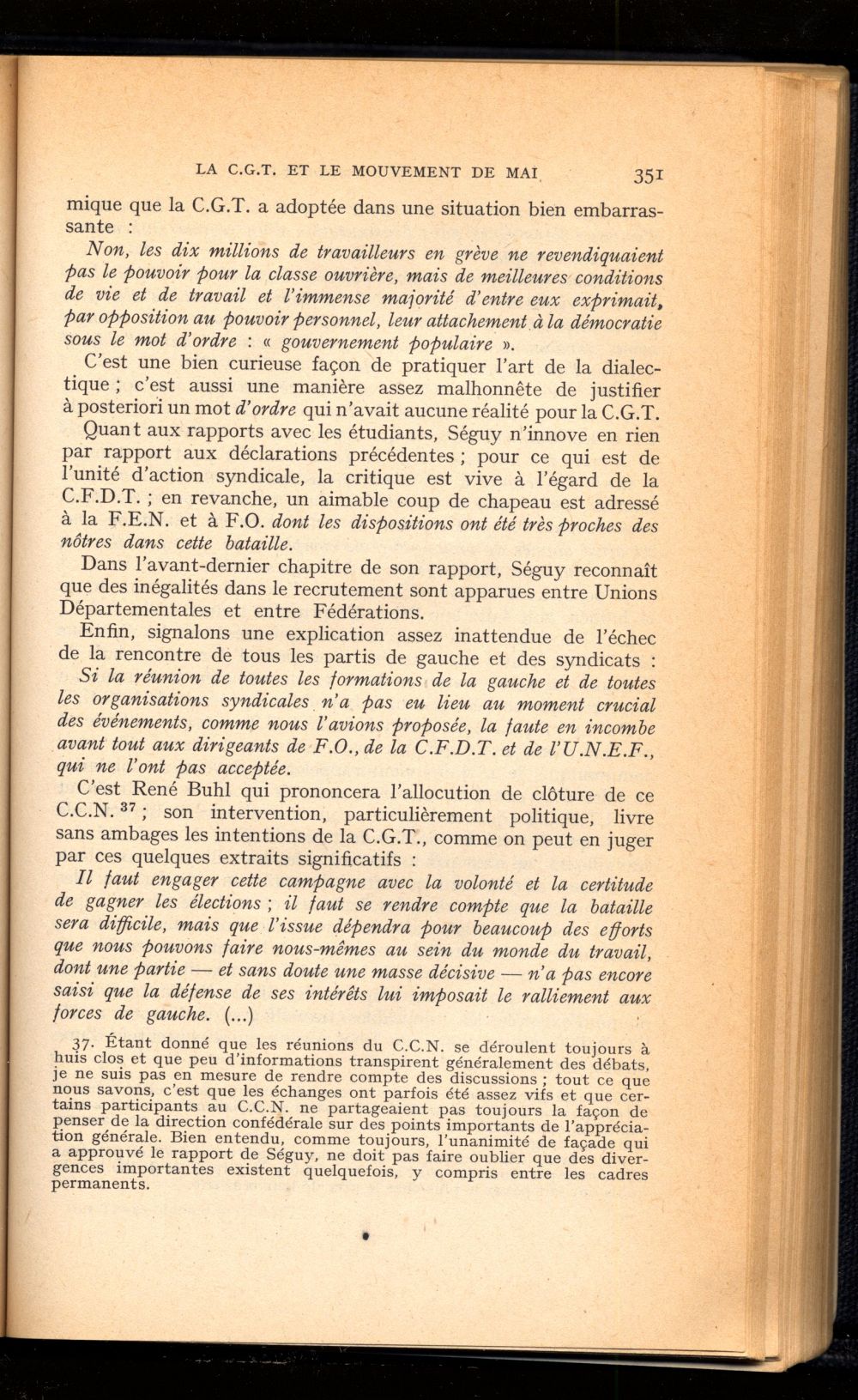

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
351
mique que la C.G.T. a adoptée dans une situation bien embarras-
sante :
sante :
Non, les dix millions de travailleurs en grève ne revendiquaient
pas le pouvoir pour la classe ouvrière, mais de meilleures conditions
de vie et de travail et l'immense majorité d'entre eux exprimait,
par opposition au pouvoir personnel, leur attachement .à la démocratie
sous le mot d'ordre : « gouvernement populaire ».
pas le pouvoir pour la classe ouvrière, mais de meilleures conditions
de vie et de travail et l'immense majorité d'entre eux exprimait,
par opposition au pouvoir personnel, leur attachement .à la démocratie
sous le mot d'ordre : « gouvernement populaire ».
C'est une bien curieuse façon de pratiquer l'art de la dialec-
tique ; c'est aussi une manière assez malhonnête de justifier
à posteriori un mot d'ordre qui n'avait aucune réalité pour la C.G.T.
tique ; c'est aussi une manière assez malhonnête de justifier
à posteriori un mot d'ordre qui n'avait aucune réalité pour la C.G.T.
Quant aux rapports avec les étudiants, Séguy n'innove en rien
par rapport aux déclarations précédentes ; pour ce qui est de
l'unité d'action syndicale, la critique est vive à l'égard de la
C.F.D.T. ; en revanche, un aimable coup de chapeau est adressé
à la F.E.N. et à F.O. dont les dispositions ont été très proches des
nôtres dans cette bataille.
par rapport aux déclarations précédentes ; pour ce qui est de
l'unité d'action syndicale, la critique est vive à l'égard de la
C.F.D.T. ; en revanche, un aimable coup de chapeau est adressé
à la F.E.N. et à F.O. dont les dispositions ont été très proches des
nôtres dans cette bataille.
Dans l'avant-dernier chapitre de son rapport, Séguy reconnaît
que des inégalités dans le recrutement sont apparues entre Unions
Départementales et entre Fédérations.
que des inégalités dans le recrutement sont apparues entre Unions
Départementales et entre Fédérations.
Enfin, signalons une explication assez inattendue de l'échec
de la rencontre de tous les partis de gauche et des syndicats :
de la rencontre de tous les partis de gauche et des syndicats :
Si la réunion de toutes les formations de la gauche et de toutes
les organisations syndicales n'a pas eu lieu au moment crucial
des événements, comme nous l'avions proposée, la faute en incombe
avant tout aux dirigeants de F.O., de la C.F.D.T. et de l'U.N.E.F.,
qui ne l'ont pas acceptée.
les organisations syndicales n'a pas eu lieu au moment crucial
des événements, comme nous l'avions proposée, la faute en incombe
avant tout aux dirigeants de F.O., de la C.F.D.T. et de l'U.N.E.F.,
qui ne l'ont pas acceptée.
C'est René Buhl qui prononcera l'allocution de clôture de ce
C.C.N.37 ; son intervention, particulièrement politique, livre
sans ambages les intentions de la C.G.T., comme on peut en juger
par ces quelques extraits significatifs :
C.C.N.37 ; son intervention, particulièrement politique, livre
sans ambages les intentions de la C.G.T., comme on peut en juger
par ces quelques extraits significatifs :
II faut engager cette campagne avec la volonté et la certitude
de gagner les élections ; il faut se rendre compte que la bataille
sera difficile, mais que l'issue dépendra pour beaucoup des efforts
que nous pouvons faire nous-mêmes au sein du monde du travail,
dont une partie — et sans doute une masse décisive — n'a pas encore
saisi que la défense de ses intérêts lui imposait le ralliement aux
forces de gauche. (...)
de gagner les élections ; il faut se rendre compte que la bataille
sera difficile, mais que l'issue dépendra pour beaucoup des efforts
que nous pouvons faire nous-mêmes au sein du monde du travail,
dont une partie — et sans doute une masse décisive — n'a pas encore
saisi que la défense de ses intérêts lui imposait le ralliement aux
forces de gauche. (...)
37. Étant donné que les réunions du C.C.N. se déroulent toujours à
huis clos et que peu d'informations transpirent généralement des débats,
je ne suis pas en mesure de rendre compte des discussions ; tout ce que
nous savons, c'est que les échanges ont parfois été assez vifs et que cer-
tains participants au C.C.N. ne partageaient pas toujours la façon de
penser de la direction confédérale sur des points importants de l'apprécia-
tion générale. Bien entendu, comme toujours, l'unanimité de façade qui
a approuvé le rapport de Séguy, ne doit pas faire oublier que des diver-
gences importantes existent quelquefois, y compris entre les cadres
permanents.
huis clos et que peu d'informations transpirent généralement des débats,
je ne suis pas en mesure de rendre compte des discussions ; tout ce que
nous savons, c'est que les échanges ont parfois été assez vifs et que cer-
tains participants au C.C.N. ne partageaient pas toujours la façon de
penser de la direction confédérale sur des points importants de l'apprécia-
tion générale. Bien entendu, comme toujours, l'unanimité de façade qui
a approuvé le rapport de Séguy, ne doit pas faire oublier que des diver-
gences importantes existent quelquefois, y compris entre les cadres
permanents.
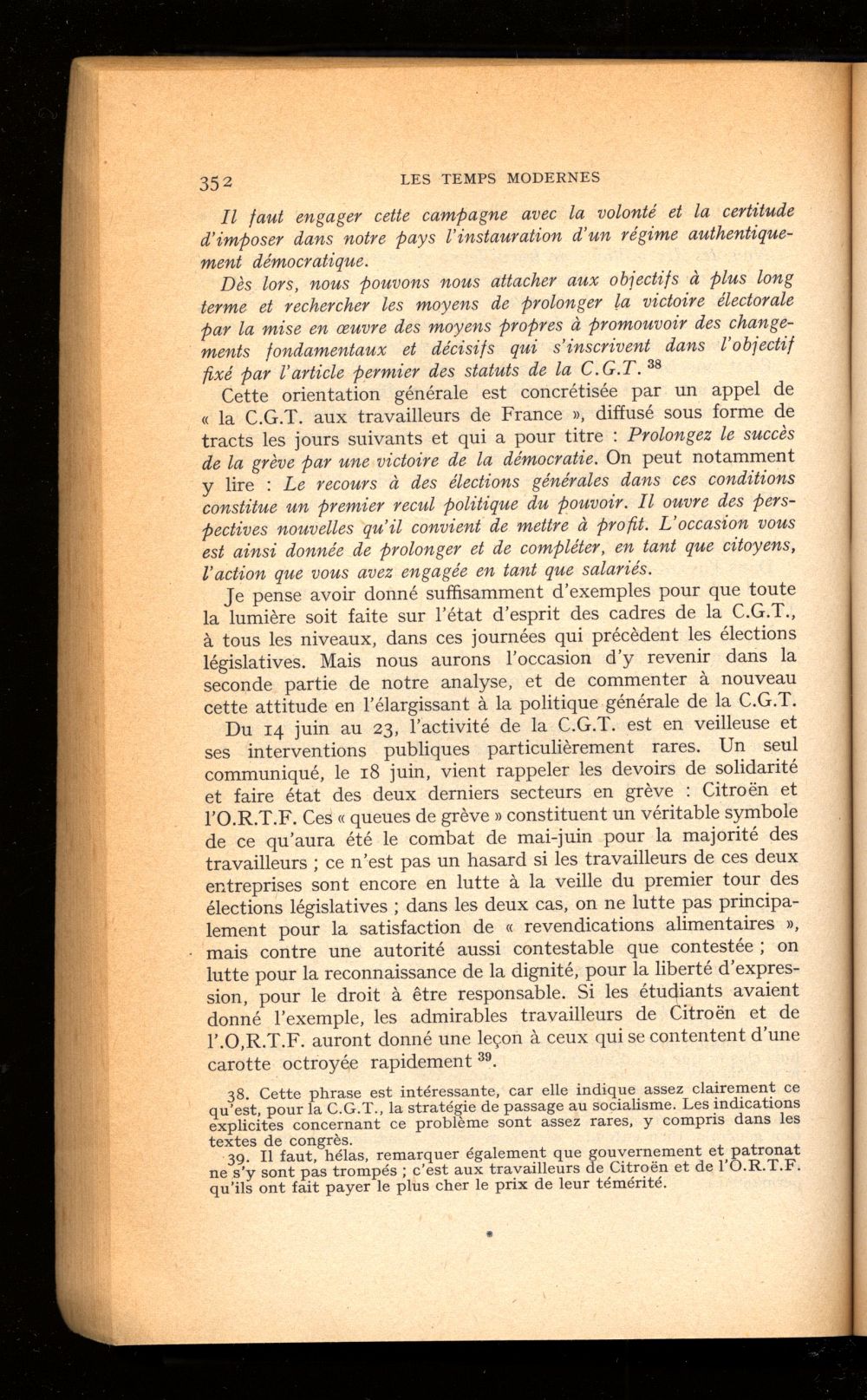

352
LES TEMPS MODERNES
II faut engager cette campagne avec la volonté et la certitude
d'imposer dans notre pays l'instauration d'un régime authentique-
ment démocratique.
d'imposer dans notre pays l'instauration d'un régime authentique-
ment démocratique.
Dès lors, nous pouvons nous attacher aux objectifs à plus long
terme et rechercher les moyens de prolonger la victoire électorale
par la mise en œuvre des moyens propres à promouvoir des change-
ments fondamentaux et décisifs qui s'inscrivent dans l'objectif
fixé par l'article permier des statuts de la C.G.T. 38
terme et rechercher les moyens de prolonger la victoire électorale
par la mise en œuvre des moyens propres à promouvoir des change-
ments fondamentaux et décisifs qui s'inscrivent dans l'objectif
fixé par l'article permier des statuts de la C.G.T. 38
Cette orientation générale est concrétisée par un appel de
« la C.G.T. aux travailleurs de France », diffusé sous forme de
tracts les jours suivants et qui a pour titre : Prolongez le succès
de la grève par une victoire de la démocratie. On peut notamment
y lire : Le recours à des élections générales dans ces conditions
constitue un premier recul politique du pouvoir. Il ouvre des pers-
pectives nouvelles qu'il convient de mettre à profit. L'occasion vous
est ainsi donnée de prolonger et de compléter, en tant que citoyens,
l'action que vous avez engagée en tant que salariés.
« la C.G.T. aux travailleurs de France », diffusé sous forme de
tracts les jours suivants et qui a pour titre : Prolongez le succès
de la grève par une victoire de la démocratie. On peut notamment
y lire : Le recours à des élections générales dans ces conditions
constitue un premier recul politique du pouvoir. Il ouvre des pers-
pectives nouvelles qu'il convient de mettre à profit. L'occasion vous
est ainsi donnée de prolonger et de compléter, en tant que citoyens,
l'action que vous avez engagée en tant que salariés.
Je pense avoir donné suffisamment d'exemples pour que toute
la lumière soit faite sur l'état d'esprit des cadres de la C.G.T.,
à tous les niveaux, dans ces journées qui précèdent les élections
législatives. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la
seconde partie de notre analyse, et de commenter à nouveau
cette attitude en l'élargissant à la politique générale de la C.G.T.
la lumière soit faite sur l'état d'esprit des cadres de la C.G.T.,
à tous les niveaux, dans ces journées qui précèdent les élections
législatives. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans la
seconde partie de notre analyse, et de commenter à nouveau
cette attitude en l'élargissant à la politique générale de la C.G.T.
Du 14 juin au 23, l'activité de la C.G.T. est en veilleuse et
ses interventions publiques particulièrement rares. Un seul
communiqué, le 18 juin, vient rappeler les devoirs de solidarité
et faire état des deux derniers secteurs en grève : Citroën et
l'O.R.T.F. Ces « queues de grève » constituent un véritable symbole
de ce qu'aura été le combat de mai-juin pour la majorité des
travailleurs ; ce n'est pas un hasard si les travailleurs de ces deux
entreprises sont encore en lutte à la veille du premier tour des
élections législatives ; dans les deux cas, on ne lutte pas principa-
lement pour la satisfaction de « revendications alimentaires »,
mais contre une autorité aussi contestable que contestée ; on
lutte pour la reconnaissance de la dignité, pour la liberté d'expres-
sion, pour le droit à être responsable. Si les étudiants avaient
donné l'exemple, les admirables travailleurs de Citroën et de
l'.O.R.T.F. auront donné une leçon à ceux qui se contentent d'une
carotte octroyée rapidement 39.
ses interventions publiques particulièrement rares. Un seul
communiqué, le 18 juin, vient rappeler les devoirs de solidarité
et faire état des deux derniers secteurs en grève : Citroën et
l'O.R.T.F. Ces « queues de grève » constituent un véritable symbole
de ce qu'aura été le combat de mai-juin pour la majorité des
travailleurs ; ce n'est pas un hasard si les travailleurs de ces deux
entreprises sont encore en lutte à la veille du premier tour des
élections législatives ; dans les deux cas, on ne lutte pas principa-
lement pour la satisfaction de « revendications alimentaires »,
mais contre une autorité aussi contestable que contestée ; on
lutte pour la reconnaissance de la dignité, pour la liberté d'expres-
sion, pour le droit à être responsable. Si les étudiants avaient
donné l'exemple, les admirables travailleurs de Citroën et de
l'.O.R.T.F. auront donné une leçon à ceux qui se contentent d'une
carotte octroyée rapidement 39.
38. Cette phrase est intéressante, car elle indique assez clairement ce
qu'est, pour la C.G.T., la stratégie de passage au socialisme. Les indications
explicites concernant ce problème sont assez rares, y compris dans les
textes de congrès.
qu'est, pour la C.G.T., la stratégie de passage au socialisme. Les indications
explicites concernant ce problème sont assez rares, y compris dans les
textes de congrès.
39. Il faut, hélas, remarquer également que gouvernement et patronat
ne s'y sont pas trompés ; c'est aux travailleurs de Citroën et de l'O.R.T.F.
qu'ils ont fait payer le plus cher le prix de leur témérité.
ne s'y sont pas trompés ; c'est aux travailleurs de Citroën et de l'O.R.T.F.
qu'ils ont fait payer le plus cher le prix de leur témérité.
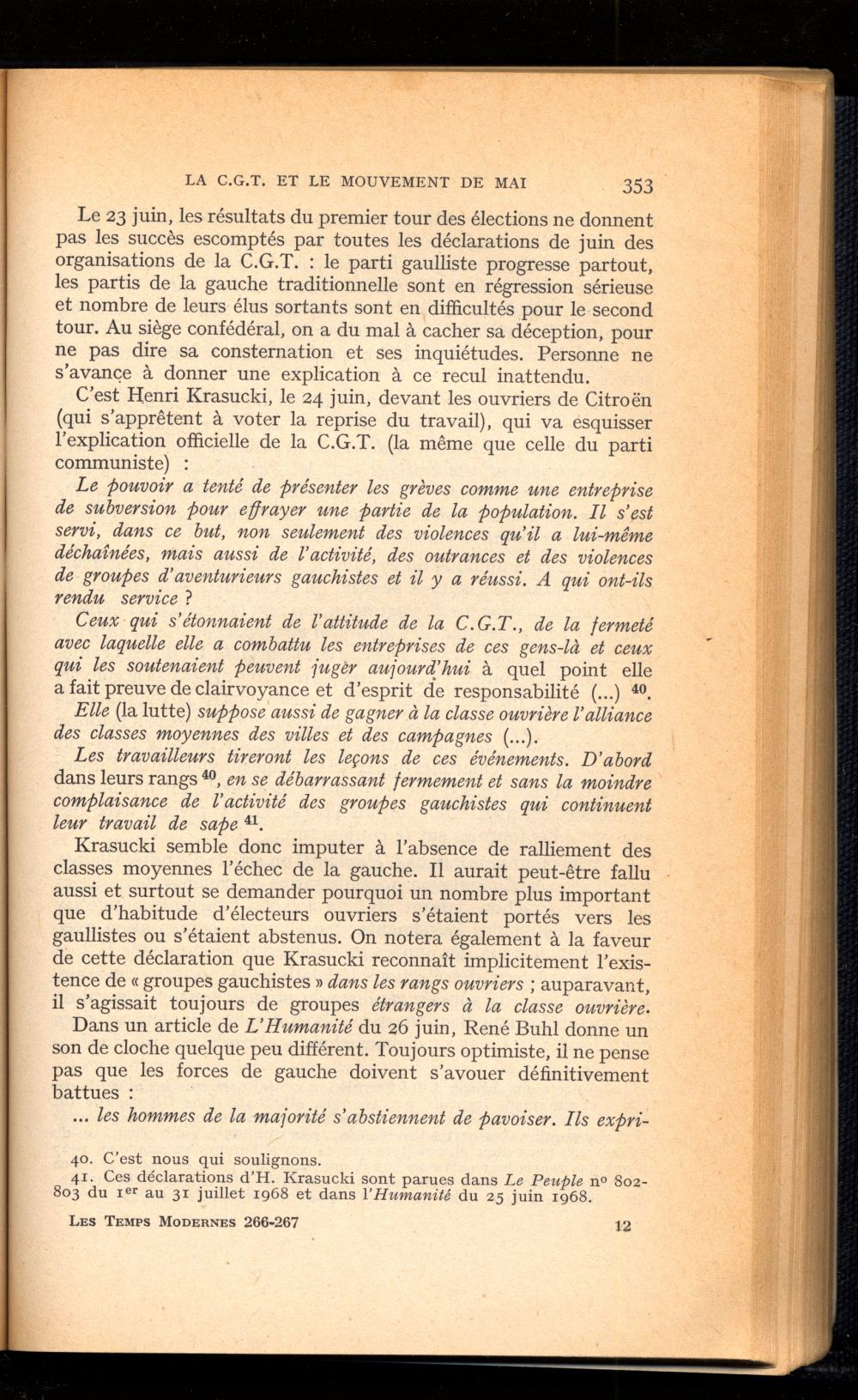

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
353
Le 23 juin, les résultats du premier tour des élections ne donnent
pas les succès escomptés par toutes les déclarations de juin des
organisations de la C.G.T. : le parti gaulliste progresse partout,
les partis de la gauche traditionnelle sont en régression sérieuse
et nombre de leurs élus sortants sont en difficultés pour le second
tour. Au siège confédéral, on a du mal à cacher sa déception, pour
ne pas dire sa consternation et ses inquiétudes. Personne ne
s'avance à donner une explication à ce recul inattendu.
pas les succès escomptés par toutes les déclarations de juin des
organisations de la C.G.T. : le parti gaulliste progresse partout,
les partis de la gauche traditionnelle sont en régression sérieuse
et nombre de leurs élus sortants sont en difficultés pour le second
tour. Au siège confédéral, on a du mal à cacher sa déception, pour
ne pas dire sa consternation et ses inquiétudes. Personne ne
s'avance à donner une explication à ce recul inattendu.
C'est Henri Krasucki, le 24 juin, devant les ouvriers de Citroën
(qui s'apprêtent à voter la reprise du travail), qui va esquisser
l'explication officielle de la C.G.T. (la même que celle du parti
communiste) :
(qui s'apprêtent à voter la reprise du travail), qui va esquisser
l'explication officielle de la C.G.T. (la même que celle du parti
communiste) :
Le •pouvoir a tenté de présenter les grèves comme une entreprise
de subversion pour effrayer une partie de la population. Il s'est
servi, dans ce but, non seulement des violences qu'il a lui-même
déchaînées, mais aussi de l'activité, des outrances et des violences
de groupes d'aventurieurs gauchistes et il y a réussi. A qui ont-ils
rendu service ?
de subversion pour effrayer une partie de la population. Il s'est
servi, dans ce but, non seulement des violences qu'il a lui-même
déchaînées, mais aussi de l'activité, des outrances et des violences
de groupes d'aventurieurs gauchistes et il y a réussi. A qui ont-ils
rendu service ?
Ceux qui s'étonnaient de l'attitude de la C.G.T., de la fermeté
avec laquelle elle a combattu les entreprises de ces gens-là et ceux
qui les soutenaient peuvent juger aujourd'hui à quel point elle
a fait preuve de clairvoyance et d'esprit de responsabilité (...) 40.
avec laquelle elle a combattu les entreprises de ces gens-là et ceux
qui les soutenaient peuvent juger aujourd'hui à quel point elle
a fait preuve de clairvoyance et d'esprit de responsabilité (...) 40.
Elle (la lutte) suppose aussi de gagner à la classe ouvrière l'alliance
des classes moyennes des villes et des campagnes (...).
des classes moyennes des villes et des campagnes (...).
Les travailleurs tireront les leçons de ces événements. D'abord
dans leurs rangs 40, en se débarrassant fermement et sans la moindre
complaisance de l'activité des groupes gauchistes qui continuent
leur travail de sape 41.
dans leurs rangs 40, en se débarrassant fermement et sans la moindre
complaisance de l'activité des groupes gauchistes qui continuent
leur travail de sape 41.
Krasucki semble donc imputer à l'absence de ralliement des
classes moyennes l'échec de la gauche. Il aurait peut-être fallu
aussi et surtout se demander pourquoi un nombre plus important
que d'habitude d'électeurs ouvriers s'étaient portés vers les
gaullistes ou s'étaient abstenus. On notera également à la faveur
de cette déclaration que Krasucki reconnaît implicitement l'exis-
tence de « groupes gauchistes » dans les rangs ouvriers ; auparavant,
il s'agissait toujours de groupes étrangers à la classe ouvrière.
classes moyennes l'échec de la gauche. Il aurait peut-être fallu
aussi et surtout se demander pourquoi un nombre plus important
que d'habitude d'électeurs ouvriers s'étaient portés vers les
gaullistes ou s'étaient abstenus. On notera également à la faveur
de cette déclaration que Krasucki reconnaît implicitement l'exis-
tence de « groupes gauchistes » dans les rangs ouvriers ; auparavant,
il s'agissait toujours de groupes étrangers à la classe ouvrière.
Dans un article de L'Humanité du 26 juin, René Buhl donne un
son de cloche quelque peu différent. Toujours optimiste, il ne pense
pas que les forces de gauche doivent s'avouer définitivement
battues :
son de cloche quelque peu différent. Toujours optimiste, il ne pense
pas que les forces de gauche doivent s'avouer définitivement
battues :
... les hommes de la majorité s'abstiennent de pavoiser. Ils expri-
40. C'est nous qui soulignons.
41. Ces déclarations d'H. Krasucki sont parues dans Le Peuple n° 802-
803 du Ier au 31 juillet 1968 et dans VHumanité du 25 juin 1968.
803 du Ier au 31 juillet 1968 et dans VHumanité du 25 juin 1968.
LES TEMPS MODERNES 266-267
12
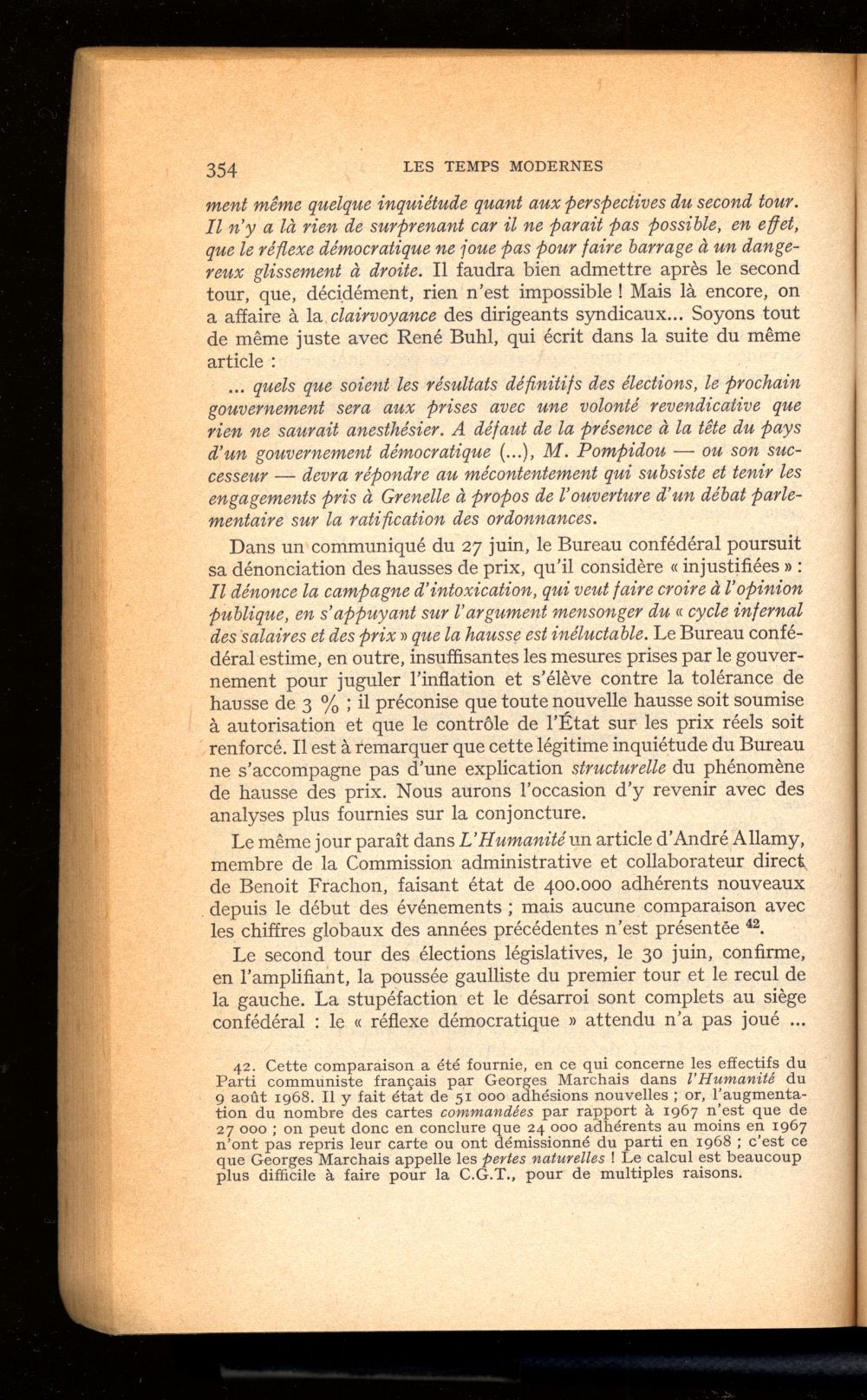

354
LES TEMPS MODERNES
ment même quelque inquiétude quant aux perspectives Au second, tour.
Il n'y a là rien de surprenant car il ne parait pas possible, en effet,
que le réflexe démocratique ne joue pas pour faire barrage à un dange-
reux glissement à droite. Il faudra bien admettre après le second
tour, que, décidément, rien n'est impossible ! Mais là encore, on
a affaire à la clairvoyance des dirigeants syndicaux... Soyons tout
de même juste avec René Buhl, qui écrit dans la suite du même
article :
Il n'y a là rien de surprenant car il ne parait pas possible, en effet,
que le réflexe démocratique ne joue pas pour faire barrage à un dange-
reux glissement à droite. Il faudra bien admettre après le second
tour, que, décidément, rien n'est impossible ! Mais là encore, on
a affaire à la clairvoyance des dirigeants syndicaux... Soyons tout
de même juste avec René Buhl, qui écrit dans la suite du même
article :
... quels que soient les résultats définitifs des élections, le prochain
gouvernement sera aux prises avec une volonté revendicative que
rien ne saurait anesthésier. A défaut de la présence à la tête du pays
d'un gouvernement démocratique (...), M. Pompidou — ou son suc-
cesseur — devra répondre au mécontentement qui subsiste et tenir les
engagements pris à Grenelle à propos de l'ouverture d'un débat parle-
mentaire sur la ratification des ordonnances.
gouvernement sera aux prises avec une volonté revendicative que
rien ne saurait anesthésier. A défaut de la présence à la tête du pays
d'un gouvernement démocratique (...), M. Pompidou — ou son suc-
cesseur — devra répondre au mécontentement qui subsiste et tenir les
engagements pris à Grenelle à propos de l'ouverture d'un débat parle-
mentaire sur la ratification des ordonnances.
Dans un communiqué du 27 juin, le Bureau confédéral poursuit
sa dénonciation des hausses de prix, qu'il considère « injustifiées » :
II dénonce la campagne d'intoxication, qui veut faire croire à l'opinion
publique, en s'appuyant sur l'argiiment mensonger du « cycle infernal
des salaires et des prix » que la hausse est inéluctable. Le Bureau confé-
déral estime, en outre, insuffisantes les mesures prises par le gouver-
nement pour juguler l'inflation et s'élève contre la tolérance de
hausse de 3 % ; il préconise que toute nouvelle hausse soit soumise
à autorisation et que le contrôle de l'État sur les prix réels soit
renforcé. Il est à remarquer que cette légitime inquiétude du Bureau
ne s'accompagne pas d'une explication structurelle du phénomène
de hausse des prix. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec des
analyses plus fournies sur la conjoncture.
sa dénonciation des hausses de prix, qu'il considère « injustifiées » :
II dénonce la campagne d'intoxication, qui veut faire croire à l'opinion
publique, en s'appuyant sur l'argiiment mensonger du « cycle infernal
des salaires et des prix » que la hausse est inéluctable. Le Bureau confé-
déral estime, en outre, insuffisantes les mesures prises par le gouver-
nement pour juguler l'inflation et s'élève contre la tolérance de
hausse de 3 % ; il préconise que toute nouvelle hausse soit soumise
à autorisation et que le contrôle de l'État sur les prix réels soit
renforcé. Il est à remarquer que cette légitime inquiétude du Bureau
ne s'accompagne pas d'une explication structurelle du phénomène
de hausse des prix. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec des
analyses plus fournies sur la conjoncture.
Le même jour paraît dans L'Hwnanitévn article d'André Allamy,
membre de la Commission administrative et collaborateur direct
de Benoit Frachon, faisant état de 400.000 adhérents nouveaux
depuis le début des événements ; mais aucune comparaison avec
les chiffres globaux des années précédentes n'est présentée 42.
membre de la Commission administrative et collaborateur direct
de Benoit Frachon, faisant état de 400.000 adhérents nouveaux
depuis le début des événements ; mais aucune comparaison avec
les chiffres globaux des années précédentes n'est présentée 42.
Le second tour des élections législatives, le 30 juin, confirme,
en l'amplifiant, la poussée gaulliste du premier tour et le recul de
la gauche. La stupéfaction et le désarroi sont complets au siège
confédéral : le « réflexe démocratique » attendu n'a pas joué ...
en l'amplifiant, la poussée gaulliste du premier tour et le recul de
la gauche. La stupéfaction et le désarroi sont complets au siège
confédéral : le « réflexe démocratique » attendu n'a pas joué ...
42. Cette comparaison a été fournie, en ce qui concerne les effectifs du
Parti communiste français par Georges Marchais dans l'Humanité du
9 août 1968. Il y fait état de 51 ooo adhésions nouvelles ; or, l'augmenta-
tion du nombre des cartes commandées par rapport à 1967 n'est que de
27 ooo ; on peut donc en conclure que 24 ooo adhérents au moins en 1967
n'ont pas repris leur carte ou ont démissionné du parti en 1968 ; c'est ce
que Georges Marchais appelle les pertes naturelles ! Le calcul est beaucoup
plus difficile à faire pour la C.G.T., pour de multiples raisons.
Parti communiste français par Georges Marchais dans l'Humanité du
9 août 1968. Il y fait état de 51 ooo adhésions nouvelles ; or, l'augmenta-
tion du nombre des cartes commandées par rapport à 1967 n'est que de
27 ooo ; on peut donc en conclure que 24 ooo adhérents au moins en 1967
n'ont pas repris leur carte ou ont démissionné du parti en 1968 ; c'est ce
que Georges Marchais appelle les pertes naturelles ! Le calcul est beaucoup
plus difficile à faire pour la C.G.T., pour de multiples raisons.
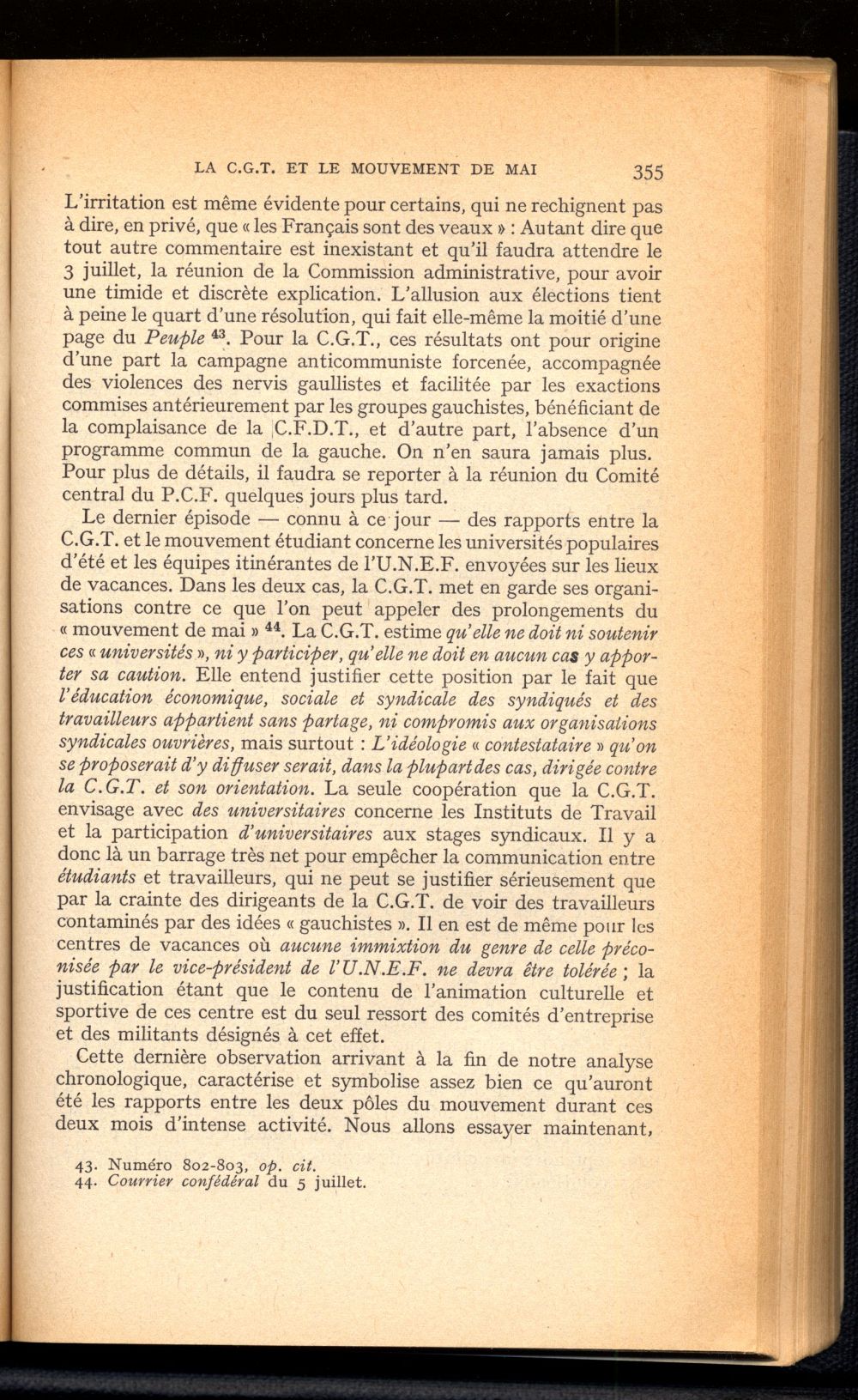

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
355
L'irritation est même évidente pour certains, qui ne rechignent pas
à dire, en privé, que « les Français sont des veaux » : Autant dire que
tout autre commentaire est inexistant et qu'il faudra attendre le
3 juillet, la réunion de la Commission administrative, pour avoir
une timide et discrète explication. L'allusion aux élections tient
à peine le quart d'une résolution, qui fait elle-même la moitié d'une
page du Peuple 43. Pour la C.G.T., ces résultats ont pour origine
d'une part la campagne anticommuniste forcenée, accompagnée
des violences des nervis gaullistes et facilitée par les exactions
commises antérieurement par les groupes gauchistes, bénéficiant de
la complaisance de la C.F.D.T., et d'autre part, l'absence d'un
programme commun de la gauche. On n'en saura jamais plus.
Pour plus de détails, il faudra se reporter à la réunion du Comité
central du P.C.F. quelques jours plus tard.
à dire, en privé, que « les Français sont des veaux » : Autant dire que
tout autre commentaire est inexistant et qu'il faudra attendre le
3 juillet, la réunion de la Commission administrative, pour avoir
une timide et discrète explication. L'allusion aux élections tient
à peine le quart d'une résolution, qui fait elle-même la moitié d'une
page du Peuple 43. Pour la C.G.T., ces résultats ont pour origine
d'une part la campagne anticommuniste forcenée, accompagnée
des violences des nervis gaullistes et facilitée par les exactions
commises antérieurement par les groupes gauchistes, bénéficiant de
la complaisance de la C.F.D.T., et d'autre part, l'absence d'un
programme commun de la gauche. On n'en saura jamais plus.
Pour plus de détails, il faudra se reporter à la réunion du Comité
central du P.C.F. quelques jours plus tard.
Le dernier épisode — connu à ce jour — des rapports entre la
C.G.T. et le mouvement étudiant concerne les universités populaires
d'été et les équipes itinérantes de l'U.N.E.F. envoyées sur les lieux
de vacances. Dans les deux cas, la C.G.T. met en garde ses organi-
sations contre ce que l'on peut appeler des prolongements du
« mouvement de mai » 44. La C.G.T. estime quelle ne doit ni soutenir
ces « universités », ni y participer, qu'elle ne doit en aucun cas y appor-
ter sa caution. Elle entend justifier cette position par le fait que
l'éducation économique, sociale et syndicale des syndiqués et des
travailleurs appartient sans partage, ni compromis aux organisations
syndicales ouvrières, mais surtout : L'idéologie « contestataire » qu'on
se proposerait d'y diffuser serait, dans la plupart des cas, dirigée contre
la C.G.T. et son orientation. La seule coopération que la C.G.T.
envisage avec des universitaires concerne les Instituts de Travail
et la participation d'universitaires aux stages syndicaux. Il y a
donc là un barrage très net pour empêcher la communication entre
étudiants et travailleurs, qui ne peut se justifier sérieusement que
par la crainte des dirigeants de la C.G.T. de voir des travailleurs
contaminés par des idées « gauchistes ». Il en est de même pour les
centres de vacances où aucune immixtion du genre de celle préco-
nisée par le vice-président de l'U.N.E.F. ne devra être tolérée ; la
justification étant que le contenu de l'animation culturelle et
sportive de ces centre est du seul ressort des comités d'entreprise
et des militants désignés à cet effet.
C.G.T. et le mouvement étudiant concerne les universités populaires
d'été et les équipes itinérantes de l'U.N.E.F. envoyées sur les lieux
de vacances. Dans les deux cas, la C.G.T. met en garde ses organi-
sations contre ce que l'on peut appeler des prolongements du
« mouvement de mai » 44. La C.G.T. estime quelle ne doit ni soutenir
ces « universités », ni y participer, qu'elle ne doit en aucun cas y appor-
ter sa caution. Elle entend justifier cette position par le fait que
l'éducation économique, sociale et syndicale des syndiqués et des
travailleurs appartient sans partage, ni compromis aux organisations
syndicales ouvrières, mais surtout : L'idéologie « contestataire » qu'on
se proposerait d'y diffuser serait, dans la plupart des cas, dirigée contre
la C.G.T. et son orientation. La seule coopération que la C.G.T.
envisage avec des universitaires concerne les Instituts de Travail
et la participation d'universitaires aux stages syndicaux. Il y a
donc là un barrage très net pour empêcher la communication entre
étudiants et travailleurs, qui ne peut se justifier sérieusement que
par la crainte des dirigeants de la C.G.T. de voir des travailleurs
contaminés par des idées « gauchistes ». Il en est de même pour les
centres de vacances où aucune immixtion du genre de celle préco-
nisée par le vice-président de l'U.N.E.F. ne devra être tolérée ; la
justification étant que le contenu de l'animation culturelle et
sportive de ces centre est du seul ressort des comités d'entreprise
et des militants désignés à cet effet.
Cette dernière observation arrivant à la fin de notre analyse
chronologique, caractérise et symbolise assez bien ce qu'auront
été les rapports entre les deux pôles du mouvement durant ces
deux mois d'intense activité. Nous allons essayer maintenant,
chronologique, caractérise et symbolise assez bien ce qu'auront
été les rapports entre les deux pôles du mouvement durant ces
deux mois d'intense activité. Nous allons essayer maintenant,
43. Numéro 802-803, op. cit.
44. Courrier confédéral du 5 juillet.
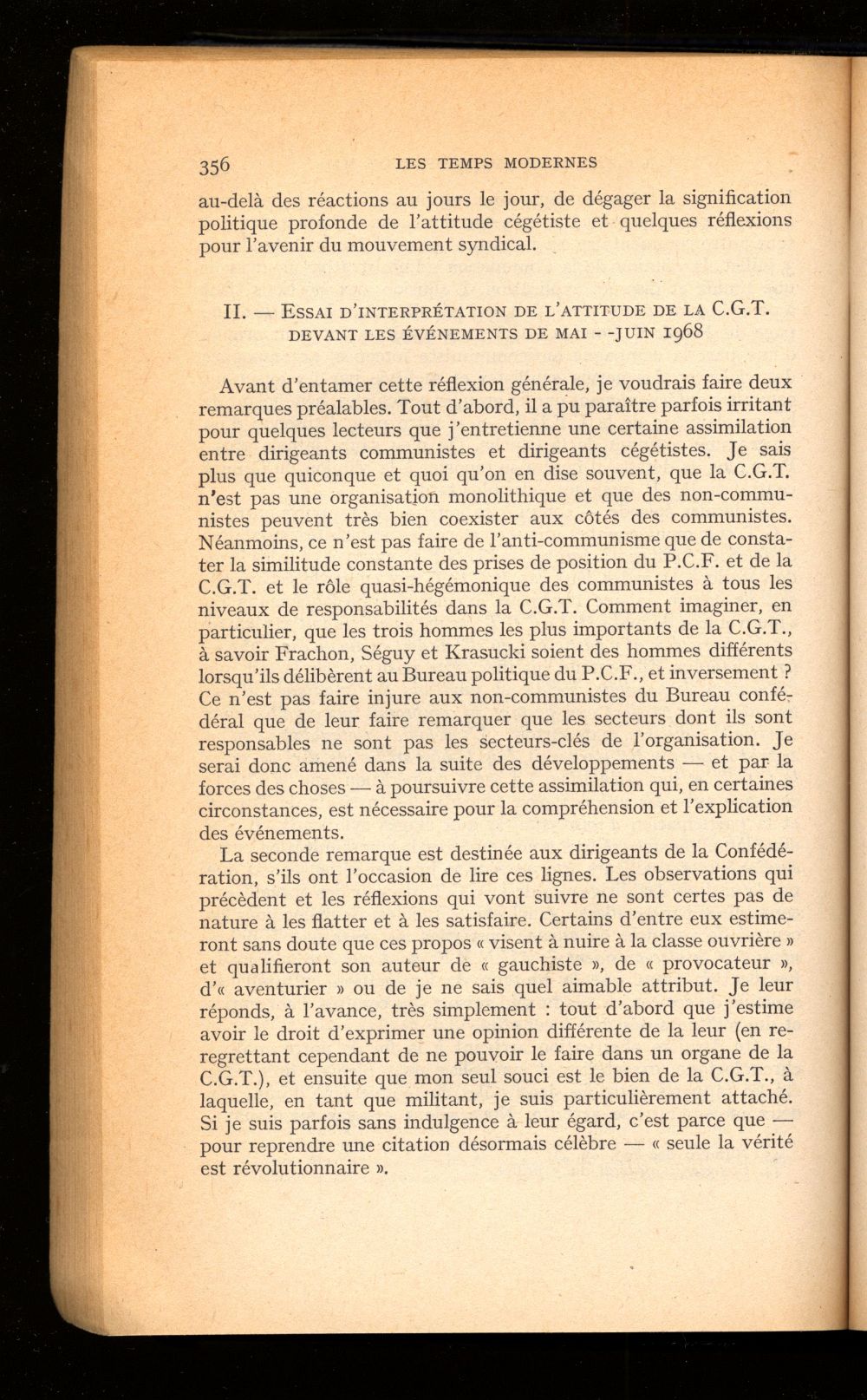

LES TEMPS MODERNES
356
au-delà des réactions au jours le jour, de dégager la signification
politique profonde de l'attitude cégétiste et quelques réflexions
pour l'avenir du mouvement syndical.
politique profonde de l'attitude cégétiste et quelques réflexions
pour l'avenir du mouvement syndical.
II. — ESSAI D'INTERPRÉTATION DE L'ATTITUDE DE LA C.G.T.
DEVANT LES ÉVÉNEMENTS DE MAI - -JUIN IQÔS
Avant d'entamer cette réflexion générale, je voudrais faire deux
remarques préalables. Tout d'abord, il a pu paraître parfois irritant
pour quelques lecteurs que j'entretienne une certaine assimilation
entre dirigeants communistes et dirigeants cégétistes. Je sais
plus que quiconque et quoi qu'on en dise souvent, que la C.G.T.
n'est pas une organisation monolithique et que des non-commu-
nistes peuvent très bien coexister aux côtés des communistes.
Néanmoins, ce n'est pas faire de l'anti-communisme que de consta-
ter la similitude constante des prises de position du P.C.F. et de la
C.G.T. et le rôle quasi-hégémonique des communistes à tous les
niveaux de responsabilités dans la C.G.T. Comment imaginer, en
particulier, que les trois hommes les plus importants de la C.G.T.,
à savoir Frachon, Séguy et Krasucki soient des hommes différents
lorsqu'ils délibèrent au Bureau politique du P.C.F., et inversement ?
Ce n'est pas faire injure aux non-communistes du Bureau confé-
déral que de leur faire remarquer que les secteurs dont ils sont
responsables ne sont pas les secteurs-clés de l'organisation. Je
serai donc amené dans la suite des développements — et par la
forces des choses — à poursuivre cette assimilation qui, en certaines
circonstances, est nécessaire pour la compréhension et l'explication
des événements.
remarques préalables. Tout d'abord, il a pu paraître parfois irritant
pour quelques lecteurs que j'entretienne une certaine assimilation
entre dirigeants communistes et dirigeants cégétistes. Je sais
plus que quiconque et quoi qu'on en dise souvent, que la C.G.T.
n'est pas une organisation monolithique et que des non-commu-
nistes peuvent très bien coexister aux côtés des communistes.
Néanmoins, ce n'est pas faire de l'anti-communisme que de consta-
ter la similitude constante des prises de position du P.C.F. et de la
C.G.T. et le rôle quasi-hégémonique des communistes à tous les
niveaux de responsabilités dans la C.G.T. Comment imaginer, en
particulier, que les trois hommes les plus importants de la C.G.T.,
à savoir Frachon, Séguy et Krasucki soient des hommes différents
lorsqu'ils délibèrent au Bureau politique du P.C.F., et inversement ?
Ce n'est pas faire injure aux non-communistes du Bureau confé-
déral que de leur faire remarquer que les secteurs dont ils sont
responsables ne sont pas les secteurs-clés de l'organisation. Je
serai donc amené dans la suite des développements — et par la
forces des choses — à poursuivre cette assimilation qui, en certaines
circonstances, est nécessaire pour la compréhension et l'explication
des événements.
La seconde remarque est destinée aux dirigeants de la Confédé-
ration, s'ils ont l'occasion de lire ces lignes. Les observations qui
précèdent et les réflexions qui vont suivre ne sont certes pas de
nature à les flatter et à les satisfaire. Certains d'entre eux estime-
ront sans doute que ces propos « visent à nuire à la classe ouvrière »
et qualifieront son auteur de « gauchiste », de « provocateur »,
d'« aventurier » ou de je ne sais quel aimable attribut. Je leur
réponds, à l'avance, très simplement : tout d'abord que j'estime
avoir le droit d'exprimer une opinion différente de la leur (en re-
regrettant cependant de ne pouvoir le faire dans un organe de la
C.G.T.), et ensuite que mon seul souci est le bien de la C.G.T., à
laquelle, en tant que militant, je suis particulièrement attaché.
Si je suis parfois sans indulgence à leur égard, c'est parce que —
pour reprendre une citation désormais célèbre — « seule la vérité
est révolutionnaire ».
ration, s'ils ont l'occasion de lire ces lignes. Les observations qui
précèdent et les réflexions qui vont suivre ne sont certes pas de
nature à les flatter et à les satisfaire. Certains d'entre eux estime-
ront sans doute que ces propos « visent à nuire à la classe ouvrière »
et qualifieront son auteur de « gauchiste », de « provocateur »,
d'« aventurier » ou de je ne sais quel aimable attribut. Je leur
réponds, à l'avance, très simplement : tout d'abord que j'estime
avoir le droit d'exprimer une opinion différente de la leur (en re-
regrettant cependant de ne pouvoir le faire dans un organe de la
C.G.T.), et ensuite que mon seul souci est le bien de la C.G.T., à
laquelle, en tant que militant, je suis particulièrement attaché.
Si je suis parfois sans indulgence à leur égard, c'est parce que —
pour reprendre une citation désormais célèbre — « seule la vérité
est révolutionnaire ».
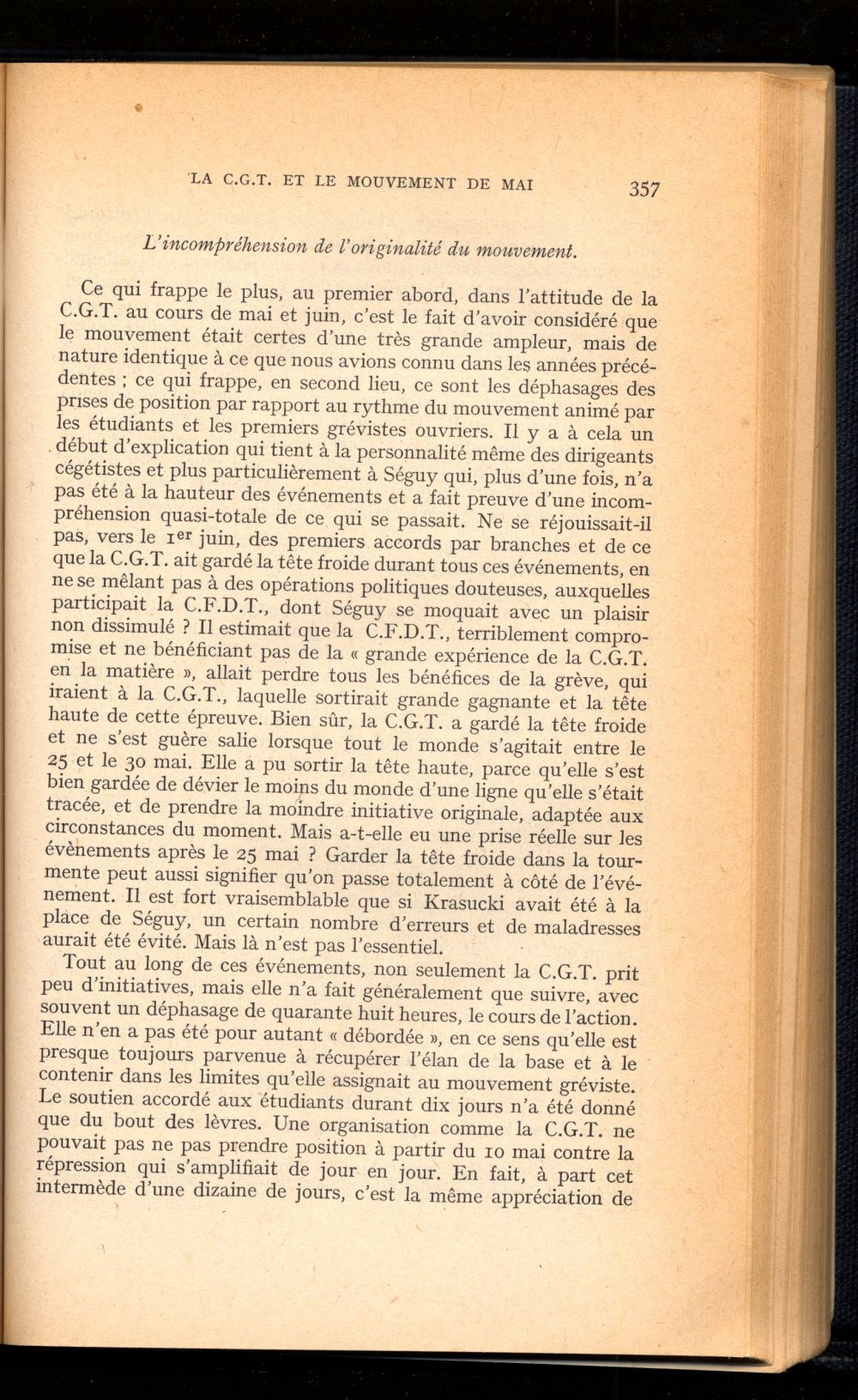

'LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
357
L'incompréhension de l'originalité du mouvement.
Ce qui frappe le plus, au premier abord, dans l'attitude de la
C.G.T. au cours de mai et juin, c'est le fait d'avoir considéré que
le mouvement était certes d'une très grande ampleur, mais de
nature identique à ce que nous avions connu dans les années précé-
dentes ; ce qui frappe, en second lieu, ce sont les déphasages des
prises de position par rapport au rythme du mouvement animé par
les étudiants et les premiers grévistes ouvriers. Il y a à cela un
, début d'explication qui tient à la personnalité même des dirigeants
cégétistes et plus particulièrement à Séguv qui, plus d'une fois, n'a
pas été à la hauteur des événements et a fait preuve d'une incom-
préhension quasi-totale de ce qui se passait. Ne se réjouissait-il
pas, vers le Ier juin, des premiers accords par branches et de ce
que la C.G.T. ait gardé la tête froide durant tous ces événements, en
ne se mêlant pas à des opérations politiques douteuses, auxquelles
participait la C.F.D.T., dont Séguy se moquait avec un plaisir
non dissimulé ? Il estimait que la C.F.D.T., terriblement compro-
mise et ne bénéficiant pas de la « grande expérience de la C.G.T.
en la matière », allait perdre tous les bénéfices de la grève, qui
iraient à la C.G.T., laquelle sortirait grande gagnante et la tête
haute de cette épreuve. Bien sûr, la C.G.T. a gardé la tête froide
et ne s'est guère salie lorsque tout le monde s'agitait entre le
25 et le 30 mai. Elle a pu sortir la tête haute, parce qu'elle s'est
bien gardée de dévier le moins du monde d'une ligne qu'elle s'était
tracée, et de prendre la moindre initiative originale, adaptée aux
circonstances du moment. Mais a-t-elle eu une prise réelle sur les
événements après le 25 mai ? Garder la tête froide dans la tour-
mente peut aussi signifier qu'on passe totalement à côté de l'évé-
nement. Il est fort vraisemblable que si Krasucki avait été à la
place de Séguy, un certain nombre d'erreurs et de maladresses
aurait été évité. Mais là n'est pas l'essentiel.
C.G.T. au cours de mai et juin, c'est le fait d'avoir considéré que
le mouvement était certes d'une très grande ampleur, mais de
nature identique à ce que nous avions connu dans les années précé-
dentes ; ce qui frappe, en second lieu, ce sont les déphasages des
prises de position par rapport au rythme du mouvement animé par
les étudiants et les premiers grévistes ouvriers. Il y a à cela un
, début d'explication qui tient à la personnalité même des dirigeants
cégétistes et plus particulièrement à Séguv qui, plus d'une fois, n'a
pas été à la hauteur des événements et a fait preuve d'une incom-
préhension quasi-totale de ce qui se passait. Ne se réjouissait-il
pas, vers le Ier juin, des premiers accords par branches et de ce
que la C.G.T. ait gardé la tête froide durant tous ces événements, en
ne se mêlant pas à des opérations politiques douteuses, auxquelles
participait la C.F.D.T., dont Séguy se moquait avec un plaisir
non dissimulé ? Il estimait que la C.F.D.T., terriblement compro-
mise et ne bénéficiant pas de la « grande expérience de la C.G.T.
en la matière », allait perdre tous les bénéfices de la grève, qui
iraient à la C.G.T., laquelle sortirait grande gagnante et la tête
haute de cette épreuve. Bien sûr, la C.G.T. a gardé la tête froide
et ne s'est guère salie lorsque tout le monde s'agitait entre le
25 et le 30 mai. Elle a pu sortir la tête haute, parce qu'elle s'est
bien gardée de dévier le moins du monde d'une ligne qu'elle s'était
tracée, et de prendre la moindre initiative originale, adaptée aux
circonstances du moment. Mais a-t-elle eu une prise réelle sur les
événements après le 25 mai ? Garder la tête froide dans la tour-
mente peut aussi signifier qu'on passe totalement à côté de l'évé-
nement. Il est fort vraisemblable que si Krasucki avait été à la
place de Séguy, un certain nombre d'erreurs et de maladresses
aurait été évité. Mais là n'est pas l'essentiel.
Tout au long de ces événements, non seulement la C.G.T. prit
peu d'initiatives, mais elle n'a fait généralement que suivre, avec
souvent un déphasage de quarante huit heures, le cours de l'action.
Elle n'en a pas été pour autant « débordée », en ce sens qu'elle est
presque toujours parvenue à récupérer l'élan de la base et à le
contenir dans les limites qu'elle assignait au mouvement gréviste.
Le soutien accordé aux étudiants durant dix jours n'a été donné
que du bout des lèvres. Une organisation comme la C.G.T. ne
pouvait pas ne pas prendre position à partir du 10 mai contre la
répression qui s'amplifiait de jour en jour. En fait, à part cet
intermède d'une dizaine de jours, c'est la même appréciation de
peu d'initiatives, mais elle n'a fait généralement que suivre, avec
souvent un déphasage de quarante huit heures, le cours de l'action.
Elle n'en a pas été pour autant « débordée », en ce sens qu'elle est
presque toujours parvenue à récupérer l'élan de la base et à le
contenir dans les limites qu'elle assignait au mouvement gréviste.
Le soutien accordé aux étudiants durant dix jours n'a été donné
que du bout des lèvres. Une organisation comme la C.G.T. ne
pouvait pas ne pas prendre position à partir du 10 mai contre la
répression qui s'amplifiait de jour en jour. En fait, à part cet
intermède d'une dizaine de jours, c'est la même appréciation de
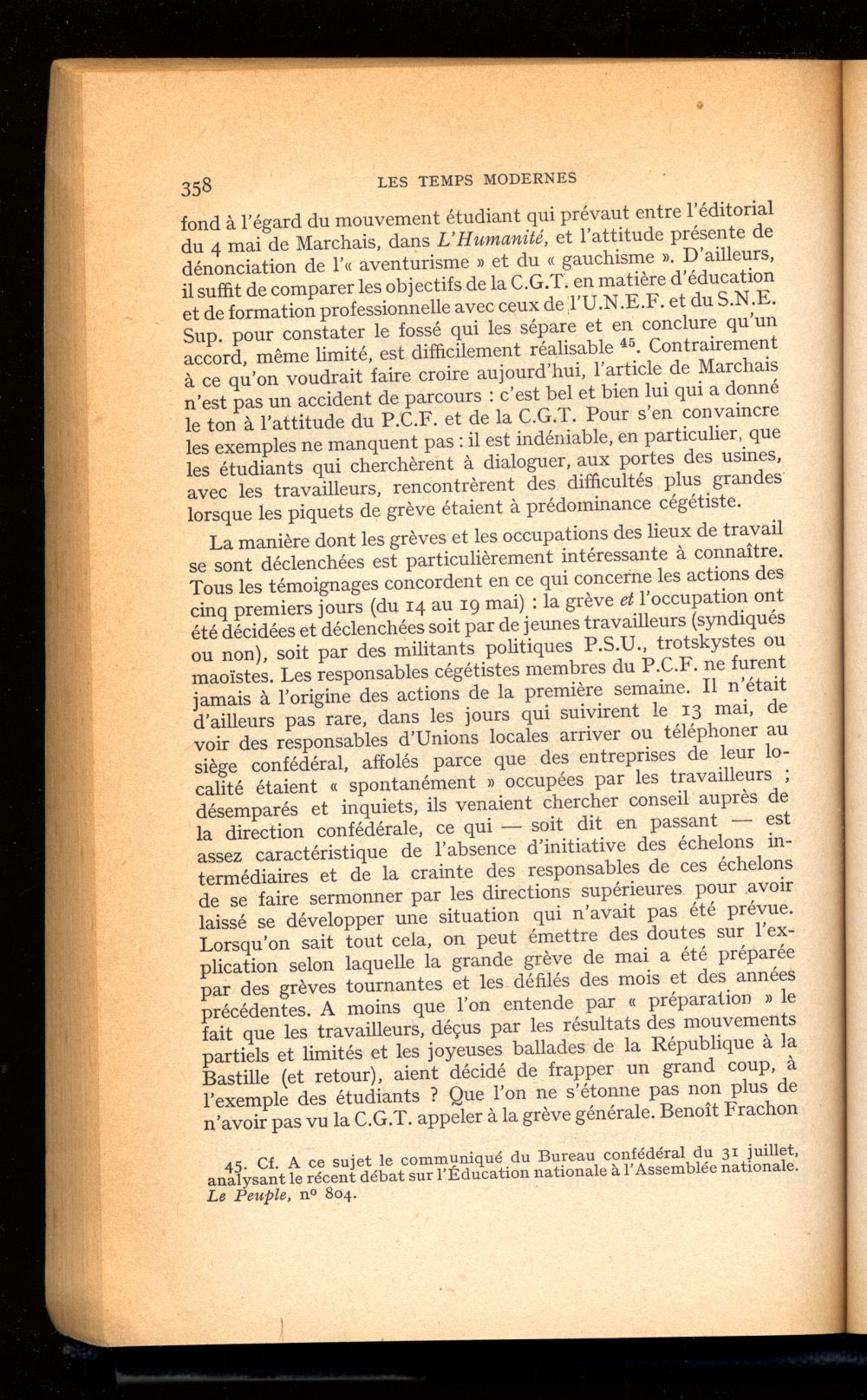

358
LES TEMPS MODERNES
fond à l'égard du mouvement étudiant qui prévaut entre l'éditorial
du 4 mai de Marchais, dans L'Humanité, et l'attitude présente de
dénonciation de l'« aventurisme » et du « gauchisme ». D'ailleurs,
il surfit de comparer les objectifs de la C.G.T. en matière d'éducation
et de formation professionnelle avec ceux de l'U.N.E.F. et du S.N.E.
Sup. pour constater le fossé qui les sépare et en conclure qu'un
accord, même limité, est difficilement réalisable *5. Contrairement
à ce qu'on voudrait faire croire aujourd'hui, l'article de Marchais
n'est pas un accident de parcours : c'est bel et bien lui qui a donné
le ton à l'attitude du P.C.F. et de la C.G.T. Pour s'en convaincre
les exemples ne manquent pas : il est indéniable, en particulier, que
les étudiants qui cherchèrent à dialoguer, aux portes des usines,
avec les travailleurs, rencontrèrent des difficultés plus grandes
lorsque les piquets de grève étaient à prédominance cégétiste.
du 4 mai de Marchais, dans L'Humanité, et l'attitude présente de
dénonciation de l'« aventurisme » et du « gauchisme ». D'ailleurs,
il surfit de comparer les objectifs de la C.G.T. en matière d'éducation
et de formation professionnelle avec ceux de l'U.N.E.F. et du S.N.E.
Sup. pour constater le fossé qui les sépare et en conclure qu'un
accord, même limité, est difficilement réalisable *5. Contrairement
à ce qu'on voudrait faire croire aujourd'hui, l'article de Marchais
n'est pas un accident de parcours : c'est bel et bien lui qui a donné
le ton à l'attitude du P.C.F. et de la C.G.T. Pour s'en convaincre
les exemples ne manquent pas : il est indéniable, en particulier, que
les étudiants qui cherchèrent à dialoguer, aux portes des usines,
avec les travailleurs, rencontrèrent des difficultés plus grandes
lorsque les piquets de grève étaient à prédominance cégétiste.
La manière dont les grèves et les occupations des lieux de travail
se sont déclenchées est particulièrement intéressante à connaître.
Tous les témoignages concordent en ce qui concerne les actions des
cinq premiers jours (du 14 au 19 mai) : la grève et l'occupation ont
été décidées et déclenchées soit par de jeunes travailleurs (syndiqués
ou non), soit par des militants politiques P.S.U., trotskystes ou
maoïstes. Les responsables cégétistes membres du P.C.F. ne furent
jamais à l'origine des actions de la première semaine. Il n'était
d'ailleurs pas rare, dans les jours qui suivirent le 13 mai, de
voir des responsables d'Unions locales arriver ou téléphoner au
siège confédéral, affolés parce que des entreprises de leur lo-
calité étaient « spontanément » occupées par les travailleurs ;
désemparés et inquiets, ils venaient chercher conseil auprès de
la direction confédérale, ce qui —• soit dit en passant — est
assez caractéristique de l'absence d'initiative des échelons in-
termédiaires et de la crainte des responsables de ces échelons
de se faire sermonner par les directions supérieures pour avoir
laissé se développer une situation qui n'avait pas été prévue.
Lorsqu'on sait tout cela, on peut émettre des doutes sur l'ex-
plication selon laquelle la grande grève de mai a été préparée
par des grèves tournantes et les défilés des mois et des années
précédentes. A moins que l'on entende par « préparation » le
fait que les travailleurs, déçus par les résultats des mouvements
partiels et limités et les joyeuses ballades de la République à la
Bastille (et retour), aient décidé de frapper un grand coup, à
l'exemple des étudiants ? Que l'on ne s'étonne pas non plus de
n'avoir pas vu la C.G.T. appeler à la grève générale. Benoît Frachon
se sont déclenchées est particulièrement intéressante à connaître.
Tous les témoignages concordent en ce qui concerne les actions des
cinq premiers jours (du 14 au 19 mai) : la grève et l'occupation ont
été décidées et déclenchées soit par de jeunes travailleurs (syndiqués
ou non), soit par des militants politiques P.S.U., trotskystes ou
maoïstes. Les responsables cégétistes membres du P.C.F. ne furent
jamais à l'origine des actions de la première semaine. Il n'était
d'ailleurs pas rare, dans les jours qui suivirent le 13 mai, de
voir des responsables d'Unions locales arriver ou téléphoner au
siège confédéral, affolés parce que des entreprises de leur lo-
calité étaient « spontanément » occupées par les travailleurs ;
désemparés et inquiets, ils venaient chercher conseil auprès de
la direction confédérale, ce qui —• soit dit en passant — est
assez caractéristique de l'absence d'initiative des échelons in-
termédiaires et de la crainte des responsables de ces échelons
de se faire sermonner par les directions supérieures pour avoir
laissé se développer une situation qui n'avait pas été prévue.
Lorsqu'on sait tout cela, on peut émettre des doutes sur l'ex-
plication selon laquelle la grande grève de mai a été préparée
par des grèves tournantes et les défilés des mois et des années
précédentes. A moins que l'on entende par « préparation » le
fait que les travailleurs, déçus par les résultats des mouvements
partiels et limités et les joyeuses ballades de la République à la
Bastille (et retour), aient décidé de frapper un grand coup, à
l'exemple des étudiants ? Que l'on ne s'étonne pas non plus de
n'avoir pas vu la C.G.T. appeler à la grève générale. Benoît Frachon
45. Cf. A ce sujet le communiqué du Bureau confédéral du 31 juillet,
analysant le récent débat sur l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale.
Le Peuple, n° 804.
analysant le récent débat sur l'Éducation nationale à l'Assemblée nationale.
Le Peuple, n° 804.
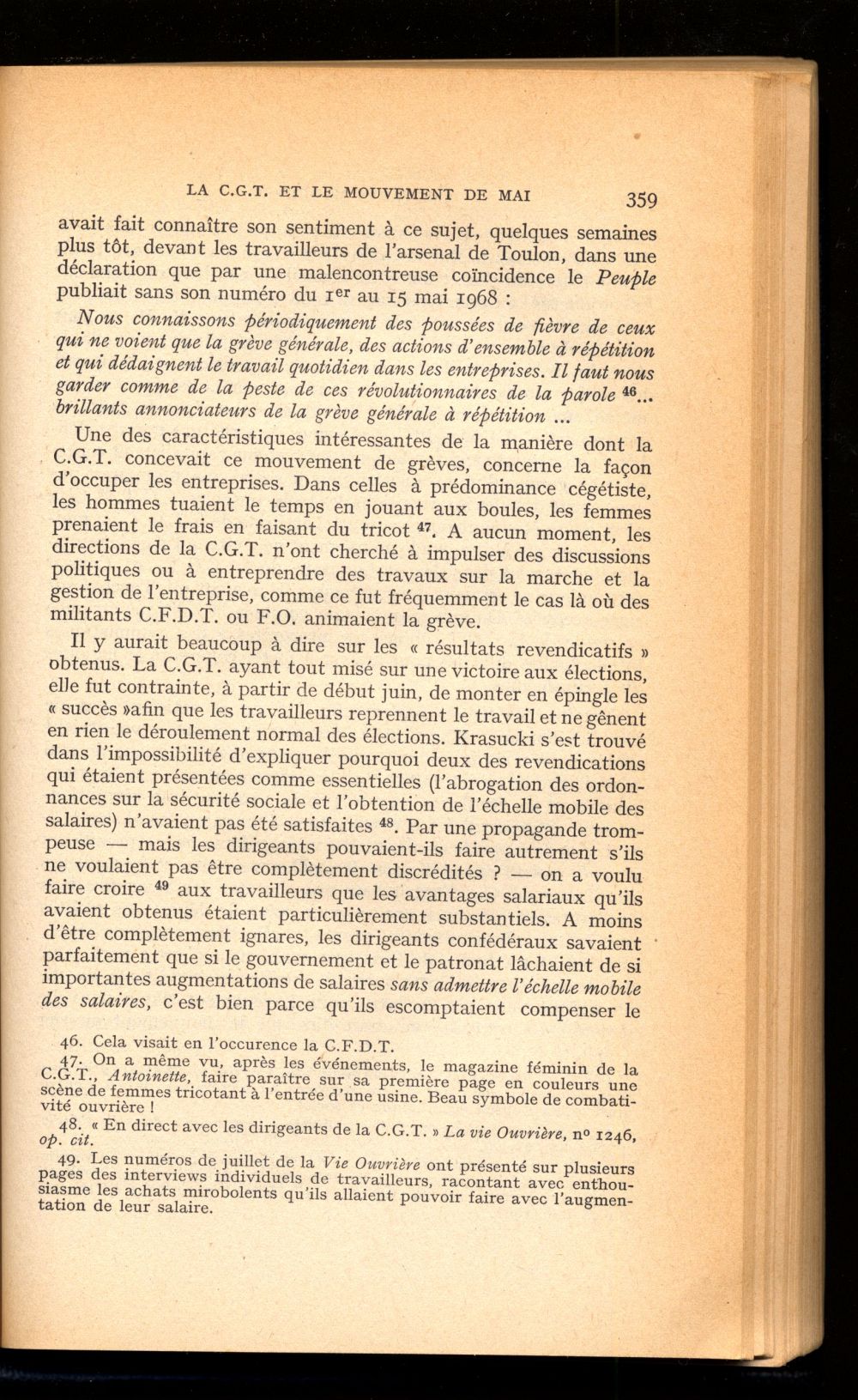

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
359
avait fait connaître son sentiment à ce sujet, quelques semaines
plus tôt, devant les travailleurs de l'arsenal de Toulon, dans une
déclaration que par une malencontreuse coïncidence le Peuple
publiait sans son numéro du Ier au 15 mai 1968 :
plus tôt, devant les travailleurs de l'arsenal de Toulon, dans une
déclaration que par une malencontreuse coïncidence le Peuple
publiait sans son numéro du Ier au 15 mai 1968 :
Nous connaissons périodiquement des poussées de fièvre de ceux
qui ne voient que la grève générale, des actions d'ensemble à répétition
et qui dédaignent le travail quotidien dans les entreprises. Il faut nous
garder comme de la peste de ces révolutionnaires de la parole 48...
brillants annonciateurs àe la grève générale à répétition ...
qui ne voient que la grève générale, des actions d'ensemble à répétition
et qui dédaignent le travail quotidien dans les entreprises. Il faut nous
garder comme de la peste de ces révolutionnaires de la parole 48...
brillants annonciateurs àe la grève générale à répétition ...
Une des caractéristiques intéressantes de la manière dont la
C.G.T. concevait ce mouvement de grèves, concerne la façon
d'occuper les entreprises. Dans celles à prédominance cégétiste,
les hommes tuaient le temps en jouant aux boules, les femmes
prenaient le frais en faisant du tricot 47. A aucun moment, les
directions de la C.G.T. n'ont cherché à impulser des discussions
politiques ou à entreprendre des travaux sur la marche et la
gestion de l'entreprise, comme ce fut fréquemment le cas là où des
militants C.F.D.T. ou F.O. animaient la grève.
C.G.T. concevait ce mouvement de grèves, concerne la façon
d'occuper les entreprises. Dans celles à prédominance cégétiste,
les hommes tuaient le temps en jouant aux boules, les femmes
prenaient le frais en faisant du tricot 47. A aucun moment, les
directions de la C.G.T. n'ont cherché à impulser des discussions
politiques ou à entreprendre des travaux sur la marche et la
gestion de l'entreprise, comme ce fut fréquemment le cas là où des
militants C.F.D.T. ou F.O. animaient la grève.
Il y aurait beaucoup à dire sur les « résultats revendicatifs »
obtenus. La C.G.T. ayant tout misé sur une victoire aux élections,
elle fut contrainte, à partir de début juin, de monter en épingle les
« succès »afin que les travailleurs reprennent le travail et ne gênent
en rien le déroulement normal des élections. Krasucki s'est trouvé
dans l'impossibilité d'expliquer pourquoi deux des revendications
qui étaient présentées comme essentielles (l'abrogation des ordon-
nances sur la sécurité sociale et l'obtention de l'échelle mobile des
salaires) n'avaient pas été satisfaites 48. Par une propagande trom-
peuse — mais les dirigeants pouvaient-ils faire autrement s'ils
ne voulaient pas être complètement discrédités ? — on a voulu
faire croire 49 aux travailleurs que les avantages salariaux qu'ils
avaient obtenus étaient particulièrement substantiels. A moins
d'être complètement ignares, les dirigeants confédéraux savaient
parfaitement que si le gouvernement et le patronat lâchaient de si
importantes augmentations de salaires sans admettre l'échelle mobile
des salaires, c'est bien parce qu'ils escomptaient compenser le
obtenus. La C.G.T. ayant tout misé sur une victoire aux élections,
elle fut contrainte, à partir de début juin, de monter en épingle les
« succès »afin que les travailleurs reprennent le travail et ne gênent
en rien le déroulement normal des élections. Krasucki s'est trouvé
dans l'impossibilité d'expliquer pourquoi deux des revendications
qui étaient présentées comme essentielles (l'abrogation des ordon-
nances sur la sécurité sociale et l'obtention de l'échelle mobile des
salaires) n'avaient pas été satisfaites 48. Par une propagande trom-
peuse — mais les dirigeants pouvaient-ils faire autrement s'ils
ne voulaient pas être complètement discrédités ? — on a voulu
faire croire 49 aux travailleurs que les avantages salariaux qu'ils
avaient obtenus étaient particulièrement substantiels. A moins
d'être complètement ignares, les dirigeants confédéraux savaient
parfaitement que si le gouvernement et le patronat lâchaient de si
importantes augmentations de salaires sans admettre l'échelle mobile
des salaires, c'est bien parce qu'ils escomptaient compenser le
46. Cela visait en l'occurence la C.F.D.T.
47. On a même vu, après les événements, le magazine féminin de la
C.G.T., Antoinette, faire paraître sur sa première page en couleurs une
scène de femmes tricotant à l'entrée d'une usine. Beau symbole de combati-
vité ouvrière !
C.G.T., Antoinette, faire paraître sur sa première page en couleurs une
scène de femmes tricotant à l'entrée d'une usine. Beau symbole de combati-
vité ouvrière !
48. « En direct avec les dirigeants de la C.G.T. » La vie Ouvrière, n° 1246,
op. cit.
op. cit.
49. Les numéros de juillet de la Vie Ouvrière ont présenté sur plusieurs
pages des interviews individuels de travailleurs, racontant avec enthou-
siasme les achats mirobolents qu'ils allaient pouvoir faire avec l'augmen-
tation de leur salaire.
pages des interviews individuels de travailleurs, racontant avec enthou-
siasme les achats mirobolents qu'ils allaient pouvoir faire avec l'augmen-
tation de leur salaire.
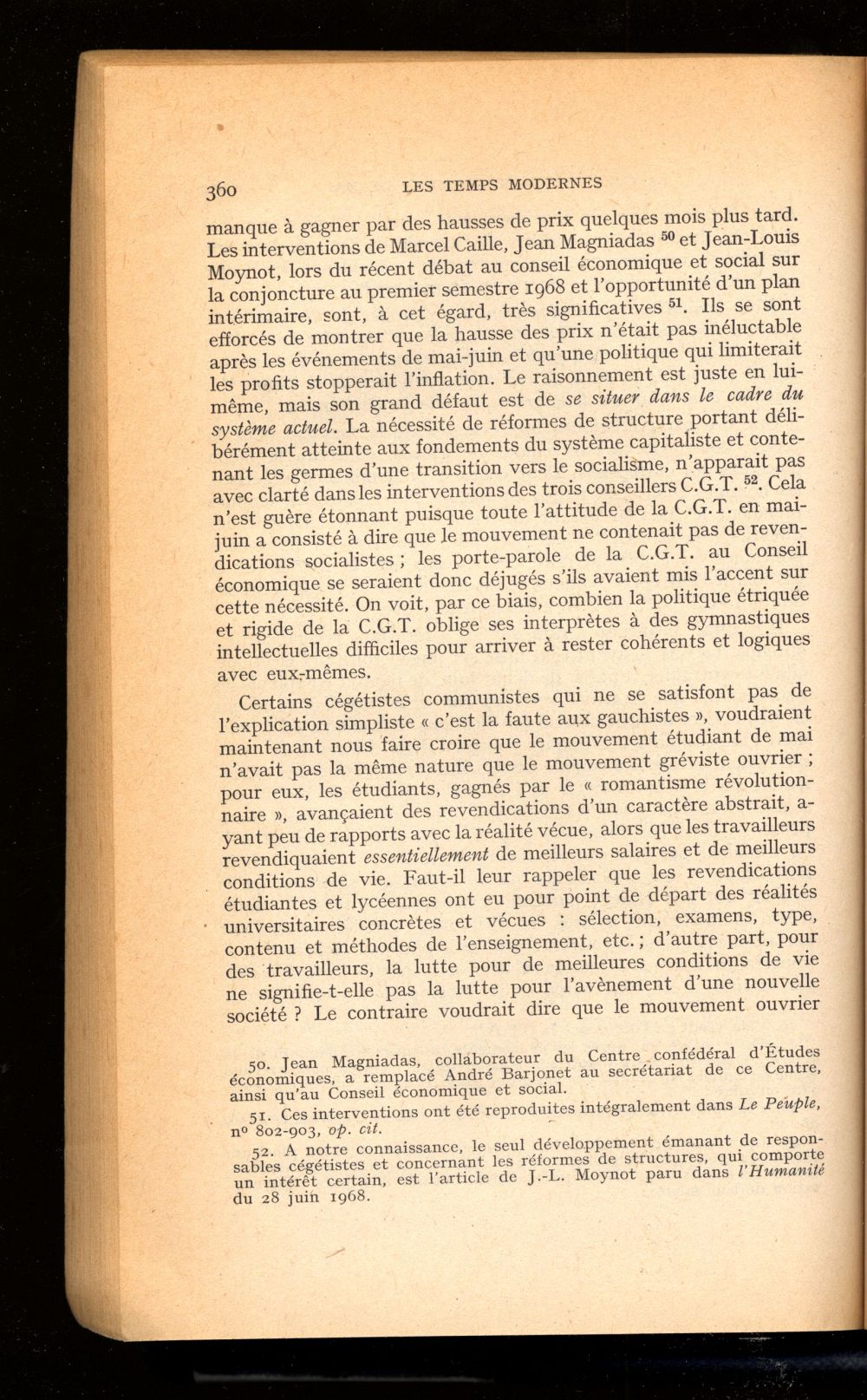

360
LES TEMPS MODERNES
manque à gagner par des hausses clé prix quelques mois plus tard.
Les interventions de Marcel Caille, Jean Magniadas 50 et Jean-Louis
Moynot, lors du récent débat au conseil économique et social sur
la conjoncture au premier semestre 1968 et l'opportunité d'un plan
intérimaire, sont, à cet égard, très significatives 51. Ils se sont
efforcés de montrer que la hausse des prix n'était pas inéluctable
après les événements de mai-juin et qu'une politique qui limiterait
les profits stopperait l'inflation. Le raisonnement est juste en lui-
même, mais son grand défaut est de se situer dans le cadre du
système actuel. La nécessité de réformes de structure portant déli-
bérément atteinte aux fondements du système capitaliste et conte-
nant les germes d'une transition vers le socialisme, n'apparait pas
avec clarté dans les interventions des trois conseillers C.G.T. 52. Cela
n'est guère étonnant puisque toute l'attitude de la C.G.T. en mai-
juin a consisté à dire que le mouvement ne contenait pas de reven-
dications socialistes ; les porte-parole de la C.G.T. au Conseil
économique se seraient donc déjugés s'ils avaient mis l'accent sur
cette nécessité. On voit, par ce biais, combien la politique étriquée
et rigide de la C.G.T. oblige ses interprètes à des gymnastiques
intellectuelles difficiles pour arriver à rester cohérents et logiques
avec euxrmêmes.
Les interventions de Marcel Caille, Jean Magniadas 50 et Jean-Louis
Moynot, lors du récent débat au conseil économique et social sur
la conjoncture au premier semestre 1968 et l'opportunité d'un plan
intérimaire, sont, à cet égard, très significatives 51. Ils se sont
efforcés de montrer que la hausse des prix n'était pas inéluctable
après les événements de mai-juin et qu'une politique qui limiterait
les profits stopperait l'inflation. Le raisonnement est juste en lui-
même, mais son grand défaut est de se situer dans le cadre du
système actuel. La nécessité de réformes de structure portant déli-
bérément atteinte aux fondements du système capitaliste et conte-
nant les germes d'une transition vers le socialisme, n'apparait pas
avec clarté dans les interventions des trois conseillers C.G.T. 52. Cela
n'est guère étonnant puisque toute l'attitude de la C.G.T. en mai-
juin a consisté à dire que le mouvement ne contenait pas de reven-
dications socialistes ; les porte-parole de la C.G.T. au Conseil
économique se seraient donc déjugés s'ils avaient mis l'accent sur
cette nécessité. On voit, par ce biais, combien la politique étriquée
et rigide de la C.G.T. oblige ses interprètes à des gymnastiques
intellectuelles difficiles pour arriver à rester cohérents et logiques
avec euxrmêmes.
Certains cégétistcs communistes qui ne se satisfont pas de
l'explication simpliste « c'est la faute aux gauchistes », voudraient
maintenant nous faire croire que le mouvement étudiant de mai
n'avait pas la même nature que le mouvement gréviste ouvrier ;
pour eux, les étudiants, gagnés par le « romantisme révolution-
naire », avançaient des revendications d'un caractère abstrait, a-
yant peu de rapports avec la réalité vécue, alors que les travailleurs
revendiquaient essentiellement de meilleurs salaires et de meilleurs
conditions de vie. Faut-il leur rappeler que les revendications
étudiantes et lycéennes ont eu pour point de départ des réalités
universitaires concrètes et vécues : sélection, examens, type,
contemi et méthodes de l'enseignement, etc. ; d'autre part, pour
des travailleurs, la lutte pour de meilleures conditions de vie
ne signifie-t-elle pas la lutte pour l'avènement d'une nouvelle
société ? Le contraire voudrait dire que le mouvement ouvrier
l'explication simpliste « c'est la faute aux gauchistes », voudraient
maintenant nous faire croire que le mouvement étudiant de mai
n'avait pas la même nature que le mouvement gréviste ouvrier ;
pour eux, les étudiants, gagnés par le « romantisme révolution-
naire », avançaient des revendications d'un caractère abstrait, a-
yant peu de rapports avec la réalité vécue, alors que les travailleurs
revendiquaient essentiellement de meilleurs salaires et de meilleurs
conditions de vie. Faut-il leur rappeler que les revendications
étudiantes et lycéennes ont eu pour point de départ des réalités
universitaires concrètes et vécues : sélection, examens, type,
contemi et méthodes de l'enseignement, etc. ; d'autre part, pour
des travailleurs, la lutte pour de meilleures conditions de vie
ne signifie-t-elle pas la lutte pour l'avènement d'une nouvelle
société ? Le contraire voudrait dire que le mouvement ouvrier
50. Jean Magniadas, collaborateur du Centre confédéral d'Études
économiques, a remplacé André Barjonet au secrétariat de ce Centre,
ainsi qu'au Conseil économique et social.
économiques, a remplacé André Barjonet au secrétariat de ce Centre,
ainsi qu'au Conseil économique et social.
51. Ces interventions ont été reproduites intégralement dans Le Peuple,
n° 802-903, op. cit.
n° 802-903, op. cit.
52. A notre connaissance, le seul développement émanant de respon-
sables cégétistcs et concernant les réformes de structures, qui comporte
un intérêt certain, est l'article de J.-J-. Moynot paru dans l'Humanité
du 28 juin 1968.
sables cégétistcs et concernant les réformes de structures, qui comporte
un intérêt certain, est l'article de J.-J-. Moynot paru dans l'Humanité
du 28 juin 1968.
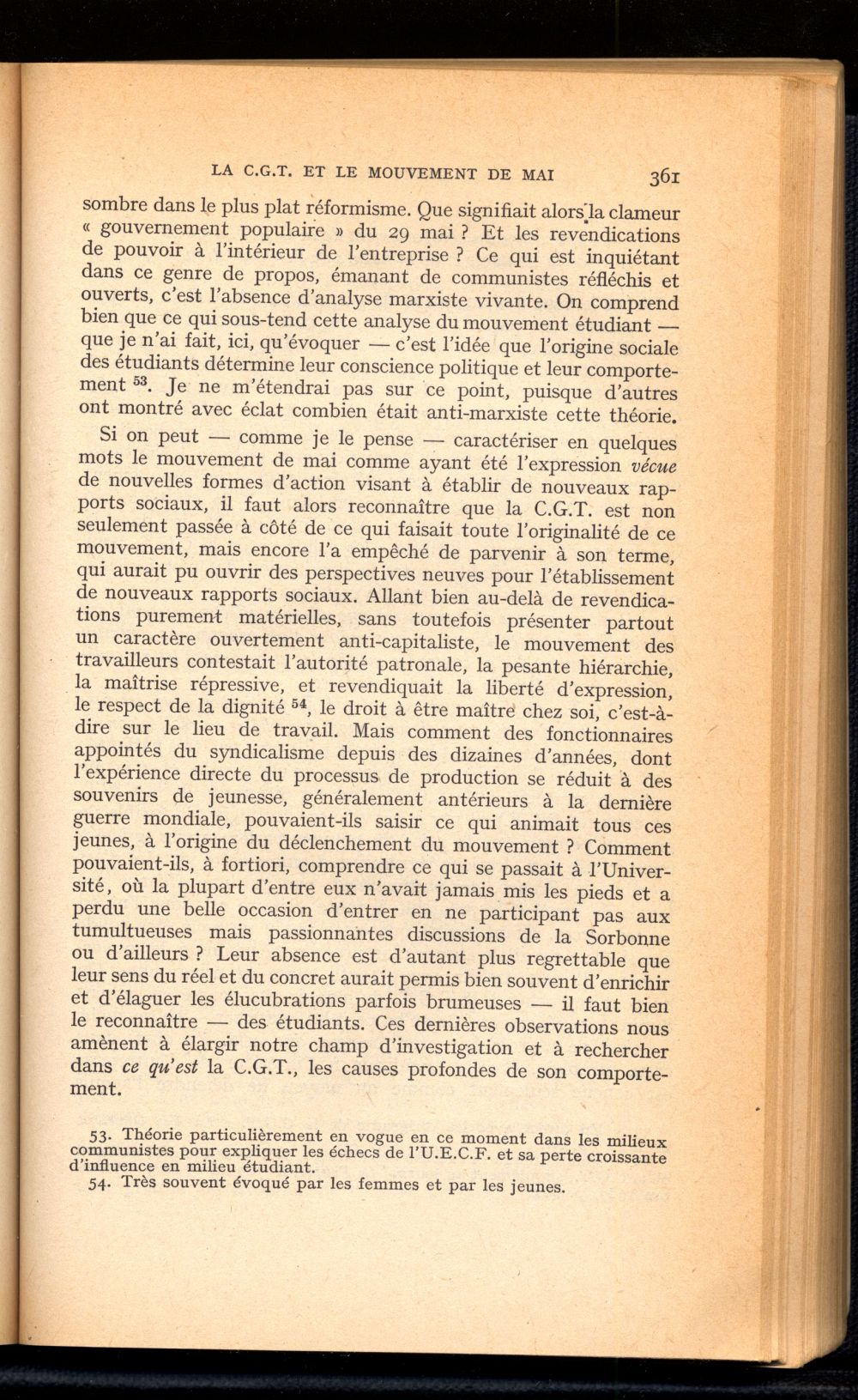

ïàïr-
LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI 361
sombre dans le plus plat réformisme. Que signifiait alorsla clameur
« gouvernement populaire » du 29 mai ? Et les revendications
de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise ? Ce qui est inquiétant
dans ce genre de propos, émanant de communistes réfléchis et
ouverts, c'est l'absence d'analyse marxiste vivante. On comprend
bien que ce qui sous-tend cette analyse du mouvement étudiant —
que je n'ai fait, ici, qu'évoquer — c'est l'idée que l'origine sociale
des étudiants détermine leur conscience politique et leur comporte-
ment 53. Je ne m'étendrai pas sur ce point, puisque d'autres
ont montré avec éclat combien était anti-marxiste cette théorie.
Si on peut — comme je le pense — caractériser en quelques
mots le mouvement de mai comme ayant été l'expression vécue
de nouvelles formes d'action visant à établir de nouveaux rap-
ports sociaux, il faut alors reconnaître que la C.G.T. est non
seulement passée à côté de ce qui faisait toute l'originalité de ce
mouvement, mais encore l'a empêché de parvenir à son terme,
qui aurait pu ouvrir des perspectives neuves pour l'établissement
de nouveaux rapports sociaux. Allant bien au-delà de revendica-
tions purement matérielles, sans toutefois présenter partout
un caractère ouvertement anti-capitaliste, le mouvement des
travailleurs contestait l'autorité patronale, la pesante hiérarchie,
la maîtrise répressive, et revendiquait la liberté d'expression,
le respect de la dignité 54, le droit à être maître chez soi, c'est-à-
dire sur le lieu de travail. Mais comment des fonctionnaires
appointés du syndicalisme depuis des dizaines d'années, dont
l'expérience directe du processus de production se réduit à des
souvenirs de jeunesse, généralement antérieurs à la dernière
guerre mondiale, pouvaient-ils saisir ce qui animait tous ces
jeunes, à l'origine du déclenchement du mouvement ? Comment
pouvaient-ils, à fortiori, comprendre ce qui se passait à l'Univer-
sité, où la plupart d'entre eux n'avait jamais mis les pieds et a
perdu une belle occasion d'entrer en ne participant pas aux
tumultueuses mais passionnantes discussions de la Sorbonne
ou d'ailleurs ? Leur absence est d'autant plus regrettable que
leur sens du réel et du concret aurait permis bien souvent d'enrichir
et d'élaguer les élucubrations parfois brumeuses •— il faut bien
le reconnaître — des étudiants. Ces dernières observations nous
amènent à élargir notre champ d'investigation et à rechercher
dans ce qu'est la C.G.T., les causes profondes de son comporte-
ment.
« gouvernement populaire » du 29 mai ? Et les revendications
de pouvoir à l'intérieur de l'entreprise ? Ce qui est inquiétant
dans ce genre de propos, émanant de communistes réfléchis et
ouverts, c'est l'absence d'analyse marxiste vivante. On comprend
bien que ce qui sous-tend cette analyse du mouvement étudiant —
que je n'ai fait, ici, qu'évoquer — c'est l'idée que l'origine sociale
des étudiants détermine leur conscience politique et leur comporte-
ment 53. Je ne m'étendrai pas sur ce point, puisque d'autres
ont montré avec éclat combien était anti-marxiste cette théorie.
Si on peut — comme je le pense — caractériser en quelques
mots le mouvement de mai comme ayant été l'expression vécue
de nouvelles formes d'action visant à établir de nouveaux rap-
ports sociaux, il faut alors reconnaître que la C.G.T. est non
seulement passée à côté de ce qui faisait toute l'originalité de ce
mouvement, mais encore l'a empêché de parvenir à son terme,
qui aurait pu ouvrir des perspectives neuves pour l'établissement
de nouveaux rapports sociaux. Allant bien au-delà de revendica-
tions purement matérielles, sans toutefois présenter partout
un caractère ouvertement anti-capitaliste, le mouvement des
travailleurs contestait l'autorité patronale, la pesante hiérarchie,
la maîtrise répressive, et revendiquait la liberté d'expression,
le respect de la dignité 54, le droit à être maître chez soi, c'est-à-
dire sur le lieu de travail. Mais comment des fonctionnaires
appointés du syndicalisme depuis des dizaines d'années, dont
l'expérience directe du processus de production se réduit à des
souvenirs de jeunesse, généralement antérieurs à la dernière
guerre mondiale, pouvaient-ils saisir ce qui animait tous ces
jeunes, à l'origine du déclenchement du mouvement ? Comment
pouvaient-ils, à fortiori, comprendre ce qui se passait à l'Univer-
sité, où la plupart d'entre eux n'avait jamais mis les pieds et a
perdu une belle occasion d'entrer en ne participant pas aux
tumultueuses mais passionnantes discussions de la Sorbonne
ou d'ailleurs ? Leur absence est d'autant plus regrettable que
leur sens du réel et du concret aurait permis bien souvent d'enrichir
et d'élaguer les élucubrations parfois brumeuses •— il faut bien
le reconnaître — des étudiants. Ces dernières observations nous
amènent à élargir notre champ d'investigation et à rechercher
dans ce qu'est la C.G.T., les causes profondes de son comporte-
ment.
53. Théorie particulièrement en vogue en ce moment dans les milieux
communistes pour expliquer les échecs de l'U.E.C.F. et sa perte croissante
d'influence en milieu étudiant.
communistes pour expliquer les échecs de l'U.E.C.F. et sa perte croissante
d'influence en milieu étudiant.
54. Très souvent évoqué par les femmes et par les jeunes.
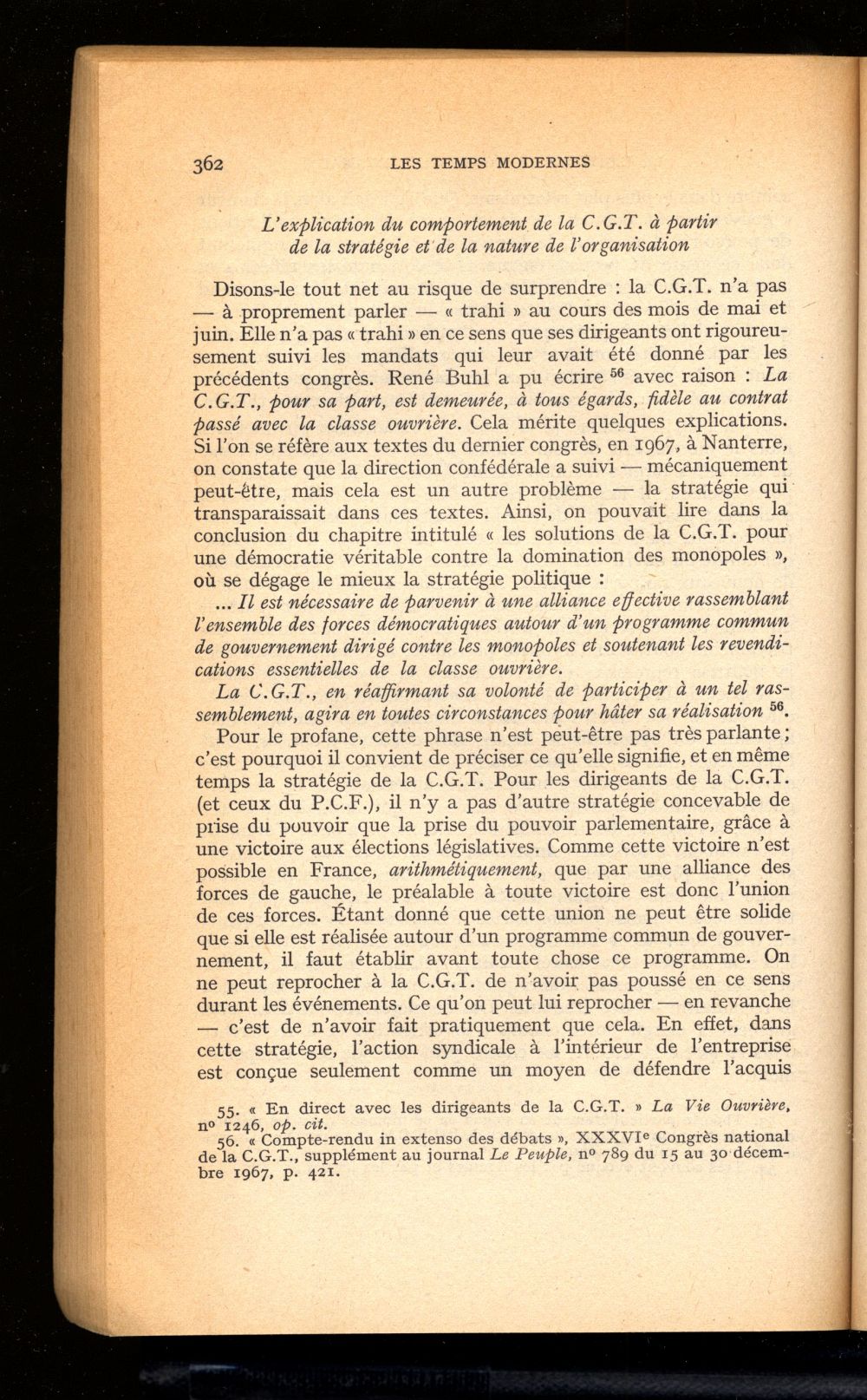

302
LES TEMPS MODERNES
L'explication du comportement de la C.G.T. à partir
de la stratégie et de la nature de l'organisation
de la stratégie et de la nature de l'organisation
Disons-le tout net au risque de surprendre : la C.G.T. n'a pas
— à proprement parler — « trahi » au cours des mois de mai et
juin. Elle n'a pas « trahi » en ce sens que ses dirigeants ont rigoureu-
sement suivi les mandats qui leur avait été donné par les
précédents congrès. René Buhl a pu écrire 56 avec raison : La
C.G.T., pour sa part, est demeurée, à tous égards, fidèle au contrat
passé avec la classe ouvrière. Cela mérite quelques explications.
Si l'on se réfère aux textes du dernier congrès, en 1967, à Nanterre,
on constate que la direction confédérale a suivi — mécaniquement
peut-être, mais cela est un autre problème — la stratégie qui
transparaissait dans ces textes. Ainsi, on pouvait lire dans la
conclusion du chapitre intitulé « les solutions de la C.G.T. pour
une démocratie véritable contre la domination des monopoles »,
où se dégage le mieux la stratégie politique :
juin. Elle n'a pas « trahi » en ce sens que ses dirigeants ont rigoureu-
sement suivi les mandats qui leur avait été donné par les
précédents congrès. René Buhl a pu écrire 56 avec raison : La
C.G.T., pour sa part, est demeurée, à tous égards, fidèle au contrat
passé avec la classe ouvrière. Cela mérite quelques explications.
Si l'on se réfère aux textes du dernier congrès, en 1967, à Nanterre,
on constate que la direction confédérale a suivi — mécaniquement
peut-être, mais cela est un autre problème — la stratégie qui
transparaissait dans ces textes. Ainsi, on pouvait lire dans la
conclusion du chapitre intitulé « les solutions de la C.G.T. pour
une démocratie véritable contre la domination des monopoles »,
où se dégage le mieux la stratégie politique :
...II est nécessaire de parvenir à une alliance effective rassemblant
l'ensemble des forces démocratiques autour d'un programme commun
de gouvernement dirigé contre les monopoles et soutenant les revendi-
cations essentielles de la classe ouvrière.
l'ensemble des forces démocratiques autour d'un programme commun
de gouvernement dirigé contre les monopoles et soutenant les revendi-
cations essentielles de la classe ouvrière.
La C.G.T., en réaffirmant sa volonté de participer à un tel ras-
semblement, agira en toutes circonstances pour hâter sa réalisation 56.
semblement, agira en toutes circonstances pour hâter sa réalisation 56.
Pour le profane, cette phrase n'est peut-être pas très parlante ;
c'est pourquoi il convient de préciser ce qu'elle signifie, et en même
temps la stratégie de la C.G.T. Pour les dirigeants de la C.G.T.
(et ceux du P.C.F.), il n'y a pas d'autre stratégie concevable de
prise du pouvoir que la prise du pouvoir parlementaire, grâce à
une victoire aux élections législatives. Comme cette victoire n'est
possible en France, arithmétiquement, que par une alliance des
forces de gauche, le préalable à toute victoire est donc l'union
de ces forces. Étant donné que cette union ne peut être solide
que si elle est réalisée autour d'un programme commun de gouver-
nement, il faut établir avant toute chose ce programme. On
ne peut reprocher à la C.G.T. de n'avoir pas poussé en ce sens
durant les événements. Ce qu'on peut lui reprocher — en revanche
c'est pourquoi il convient de préciser ce qu'elle signifie, et en même
temps la stratégie de la C.G.T. Pour les dirigeants de la C.G.T.
(et ceux du P.C.F.), il n'y a pas d'autre stratégie concevable de
prise du pouvoir que la prise du pouvoir parlementaire, grâce à
une victoire aux élections législatives. Comme cette victoire n'est
possible en France, arithmétiquement, que par une alliance des
forces de gauche, le préalable à toute victoire est donc l'union
de ces forces. Étant donné que cette union ne peut être solide
que si elle est réalisée autour d'un programme commun de gouver-
nement, il faut établir avant toute chose ce programme. On
ne peut reprocher à la C.G.T. de n'avoir pas poussé en ce sens
durant les événements. Ce qu'on peut lui reprocher — en revanche
— c'est de n'avoir fait pratiquement que cela. En effet, dans
cette stratégie, l'action syndicale à l'intérieur de l'entreprise
est conçue seulement comme un moyen de défendre l'acquis
cette stratégie, l'action syndicale à l'intérieur de l'entreprise
est conçue seulement comme un moyen de défendre l'acquis
55. « En direct avec les dirigeants de la C.G.T. » La Vie Ouvrière,
n° 1246, op. cit.
n° 1246, op. cit.
56. « Compte-rendu in extenso des débats », XXXVIe Congrès national
de la C.G.T., supplément au journal Le Peuple, n° 789 du 15 au 30 décem-
bre 1967, p. 421.
de la C.G.T., supplément au journal Le Peuple, n° 789 du 15 au 30 décem-
bre 1967, p. 421.
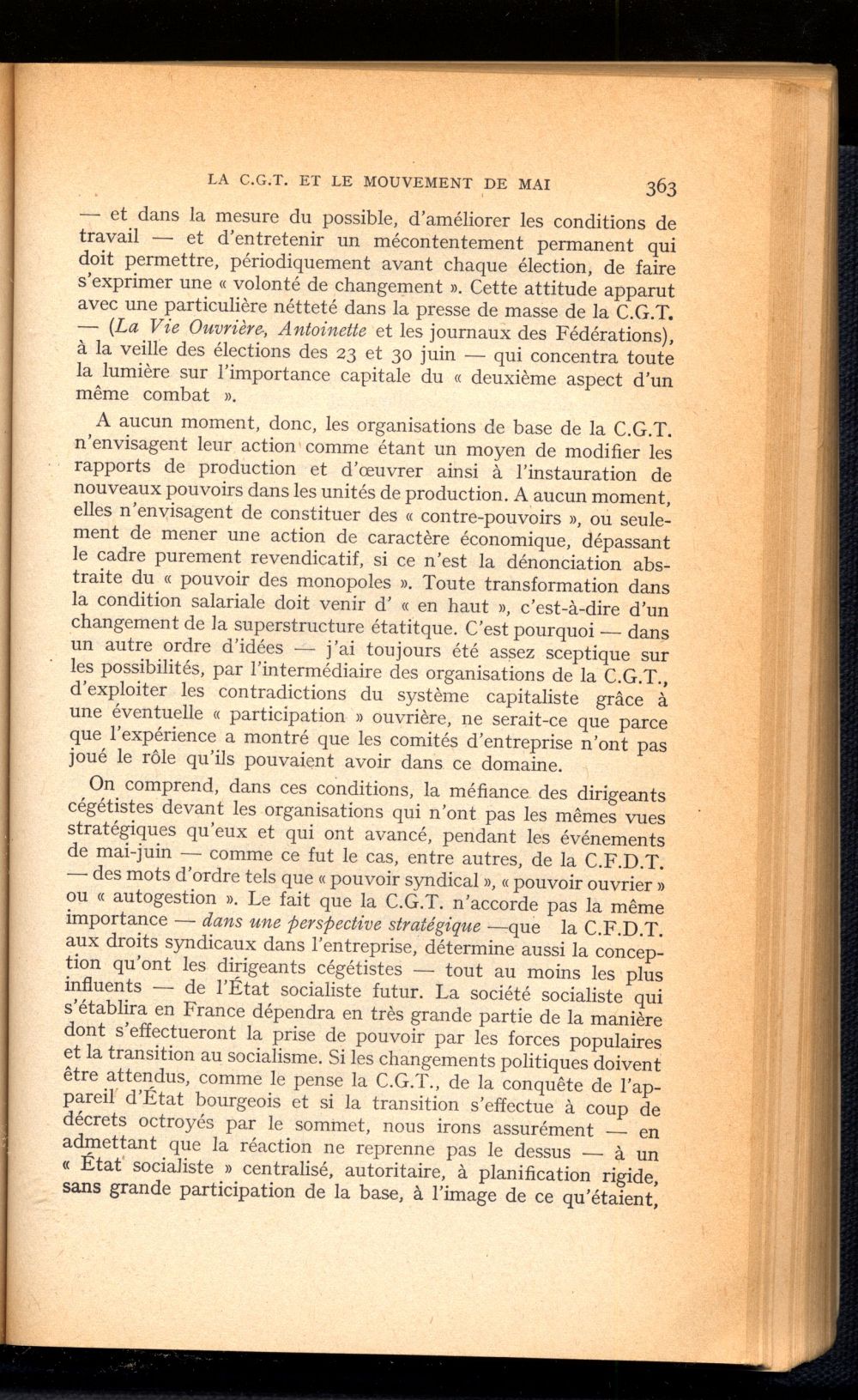

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
363
— et dans la mesure du possible, d'améliorer les conditions de
travail — et d'entretenir un mécontentement permanent qui
doit permettre, périodiquement avant chaque élection, de faire
s'exprimer une « volonté de changement ». Cette attitude apparut
avec une particulière netteté dans la presse de masse de la C.G.T.
travail — et d'entretenir un mécontentement permanent qui
doit permettre, périodiquement avant chaque élection, de faire
s'exprimer une « volonté de changement ». Cette attitude apparut
avec une particulière netteté dans la presse de masse de la C.G.T.
— (La Vie Ouvrière, Antoinette et les journaux des Fédérations),
à la veille des élections des 23 et 30 juin — qui concentra toute
la lumière sur l'importance capitale du « deuxième aspect d'un
même combat ».
à la veille des élections des 23 et 30 juin — qui concentra toute
la lumière sur l'importance capitale du « deuxième aspect d'un
même combat ».
A aucun moment, donc, les organisations de base de la C.G.T.
n'envisagent leur action comme étant un moyen de modifier les
rapports de production et d'œuvrer ainsi à l'instauration de
nouveaux pouvoirs dans les unités de production. A aucun moment,
elles n'envisagent de constituer des « contre-pouvoirs », ou seule-
ment de mener une action de caractère économique, dépassant
le cadre purement revendicatif, si ce n'est la dénonciation abs-
traite du « pouvoir des monopoles ». Toute transformation dans
la condition salariale doit venir d' « en haut », c'est-à-dire d'un
changement de la superstructure étatitque. C'est pourquoi — dans
un autre ordre d'idées — j'ai toujours été assez sceptique sur
les possibilités, par l'intermédiaire des organisations de la C.G.T.,
d'exploiter les contradictions du système capitaliste grâce à
une éventuelle « participation » ouvrière, ne serait-ce que parce
que l'expérience a montré que les comités d'entreprise n'ont pas
joué le rôle qu'ils pouvaient avoir dans ce domaine.
n'envisagent leur action comme étant un moyen de modifier les
rapports de production et d'œuvrer ainsi à l'instauration de
nouveaux pouvoirs dans les unités de production. A aucun moment,
elles n'envisagent de constituer des « contre-pouvoirs », ou seule-
ment de mener une action de caractère économique, dépassant
le cadre purement revendicatif, si ce n'est la dénonciation abs-
traite du « pouvoir des monopoles ». Toute transformation dans
la condition salariale doit venir d' « en haut », c'est-à-dire d'un
changement de la superstructure étatitque. C'est pourquoi — dans
un autre ordre d'idées — j'ai toujours été assez sceptique sur
les possibilités, par l'intermédiaire des organisations de la C.G.T.,
d'exploiter les contradictions du système capitaliste grâce à
une éventuelle « participation » ouvrière, ne serait-ce que parce
que l'expérience a montré que les comités d'entreprise n'ont pas
joué le rôle qu'ils pouvaient avoir dans ce domaine.
On comprend, dans ces conditions, la méfiance des dirigeants
cégétistes devant les organisations qui n'ont pas les mêmes vues
stratégiques qu'eux et qui ont avancé, pendant les événements
de mai-juin — comme ce fut le cas, entre autres, de la C.F.D.T.
cégétistes devant les organisations qui n'ont pas les mêmes vues
stratégiques qu'eux et qui ont avancé, pendant les événements
de mai-juin — comme ce fut le cas, entre autres, de la C.F.D.T.
— des mots d'ordre tels que « pouvoir syndical », « pouvoir ouvrier »
ou « autogestion ». Le fait que la C.G.T. n'accorde pas la même
importance — dans une perspective stratégique —que la C.F.D.T.
aux droits syndicaux dans l'entreprise, détermine aussi la concep-
tion qu'ont les dirigeants cégétistes — tout au moins les plus
influents — de l'État socialiste futur. La société socialiste qui
s'établira en France dépendra en très grande partie de la manière
dont s'effectueront la prise de pouvoir par les forces populaires
et la transition au socialisme. Si les changements politiques doivent
être attendus, comme le pense la C.G.T., de la conquête clé l'ap-
pareil d'Etat bourgeois et si la transition s'effectue à coup de
décrets octroyés par le sommet, nous irons assurément — en
admettant que la réaction ne reprenne pas le dessus — à un
« État socialiste » centralisé, autoritaire, à planification rigide,
sans grande participation de la base, à l'image de ce qu'étaient,
ou « autogestion ». Le fait que la C.G.T. n'accorde pas la même
importance — dans une perspective stratégique —que la C.F.D.T.
aux droits syndicaux dans l'entreprise, détermine aussi la concep-
tion qu'ont les dirigeants cégétistes — tout au moins les plus
influents — de l'État socialiste futur. La société socialiste qui
s'établira en France dépendra en très grande partie de la manière
dont s'effectueront la prise de pouvoir par les forces populaires
et la transition au socialisme. Si les changements politiques doivent
être attendus, comme le pense la C.G.T., de la conquête clé l'ap-
pareil d'Etat bourgeois et si la transition s'effectue à coup de
décrets octroyés par le sommet, nous irons assurément — en
admettant que la réaction ne reprenne pas le dessus — à un
« État socialiste » centralisé, autoritaire, à planification rigide,
sans grande participation de la base, à l'image de ce qu'étaient,
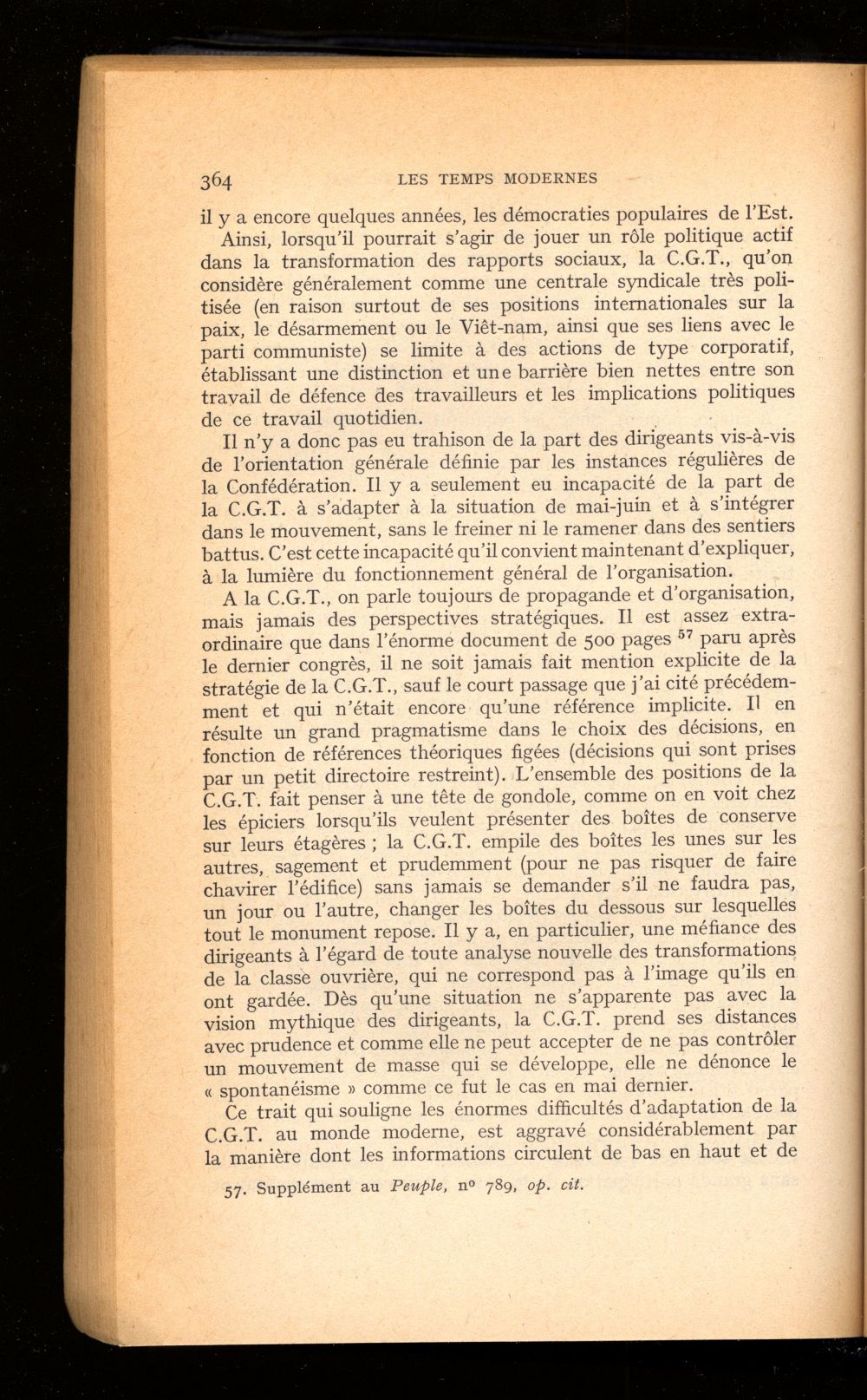

364
LES TEMPS MODERNES
il y a encore quelques années, les démocraties populaires de l'Est.
Ainsi, lorsqu'il pourrait s'agir de jouer un rôle politique actif
dans la transformation des rapports sociaux, la C.G.T., qu'on
considère généralement comme une centrale syndicale très poli-
tisée (en raison surtout de ses positions internationales sur la
paix, le désarmement ou le Viêt-nam, ainsi que ses liens avec le
parti communiste) se limite à des actions de type corporatif,
établissant une distinction et une barrière bien nettes entre son
travail de défence des travailleurs et les implications politiques
de ce travail quotidien.
dans la transformation des rapports sociaux, la C.G.T., qu'on
considère généralement comme une centrale syndicale très poli-
tisée (en raison surtout de ses positions internationales sur la
paix, le désarmement ou le Viêt-nam, ainsi que ses liens avec le
parti communiste) se limite à des actions de type corporatif,
établissant une distinction et une barrière bien nettes entre son
travail de défence des travailleurs et les implications politiques
de ce travail quotidien.
Il n'y a donc pas eu trahison de la part des dirigeants vis-à-vis
de l'orientation générale définie par les instances régulières de
la Confédération. Il y a seulement eu incapacité de la part de
la C.G.T. à s'adapter à la situation de mai-juin et à s'intégrer
dans le mouvement, sans le freiner ni le ramener dans des sentiers
battus. C'est cette incapacité qu'il convient maintenant d'expliquer,
à la lumière du fonctionnement général de l'organisation.
de l'orientation générale définie par les instances régulières de
la Confédération. Il y a seulement eu incapacité de la part de
la C.G.T. à s'adapter à la situation de mai-juin et à s'intégrer
dans le mouvement, sans le freiner ni le ramener dans des sentiers
battus. C'est cette incapacité qu'il convient maintenant d'expliquer,
à la lumière du fonctionnement général de l'organisation.
A la C.G.T., on parle toujours de propagande et d'organisation,
mais jamais des perspectives stratégiques. Il est assez extra-
ordinaire que dans l'énorme document de 500 pages 57 paru après
le dernier congrès, il ne soit jamais fait mention explicite de la
stratégie de la C.G.T., sauf le court passage que j'ai cité précédem-
ment et qui n'était encore qu'une référence implicite. Il en
résulte un grand pragmatisme dans le choix des décisions, en
fonction de références théoriques figées (décisions qui sont prises
par un petit directoire restreint). L'ensemble des positions de la
C.G.T. fait penser à une tête de gondole, comme on en voit chez
les épiciers lorsqu'ils veulent présenter des boîtes de conserve
sur leurs étagères ; la C.G.T. empile des boîtes les unes sur les
autres, sagement et prudemment (pour ne pas risquer de faire
chavirer l'édifice) sans jamais se demander s'il ne faudra pas,
un jour ou l'autre, changer les boîtes du dessous sur lesquelles
tout le monument repose. Il y a, en particulier, une méfiance des
dirigeants à l'égard de toute analyse nouvelle des transformations
de la classe ouvrière, qui ne correspond pas à l'image qu'ils en
ont gardée. Dès qu'une situation ne s'apparente pas avec la
vision mythique des dirigeants, la C.G.T. prend ses distances
avec prudence et comme elle ne peut accepter de ne pas contrôler
un mouvement de masse qui se développe, elle ne dénonce le
« spontanéisme » comme ce fut le cas en niai dernier.
mais jamais des perspectives stratégiques. Il est assez extra-
ordinaire que dans l'énorme document de 500 pages 57 paru après
le dernier congrès, il ne soit jamais fait mention explicite de la
stratégie de la C.G.T., sauf le court passage que j'ai cité précédem-
ment et qui n'était encore qu'une référence implicite. Il en
résulte un grand pragmatisme dans le choix des décisions, en
fonction de références théoriques figées (décisions qui sont prises
par un petit directoire restreint). L'ensemble des positions de la
C.G.T. fait penser à une tête de gondole, comme on en voit chez
les épiciers lorsqu'ils veulent présenter des boîtes de conserve
sur leurs étagères ; la C.G.T. empile des boîtes les unes sur les
autres, sagement et prudemment (pour ne pas risquer de faire
chavirer l'édifice) sans jamais se demander s'il ne faudra pas,
un jour ou l'autre, changer les boîtes du dessous sur lesquelles
tout le monument repose. Il y a, en particulier, une méfiance des
dirigeants à l'égard de toute analyse nouvelle des transformations
de la classe ouvrière, qui ne correspond pas à l'image qu'ils en
ont gardée. Dès qu'une situation ne s'apparente pas avec la
vision mythique des dirigeants, la C.G.T. prend ses distances
avec prudence et comme elle ne peut accepter de ne pas contrôler
un mouvement de masse qui se développe, elle ne dénonce le
« spontanéisme » comme ce fut le cas en niai dernier.
Ce trait qui souligne les énormes difficultés d'adaptation de la
C.G.T. au monde moderne, est aggravé considérablement par
la manière dont les informations circulent de bas en haut et de
C.G.T. au monde moderne, est aggravé considérablement par
la manière dont les informations circulent de bas en haut et de
57. Supplément au Peuple, n° 789, op. cit.
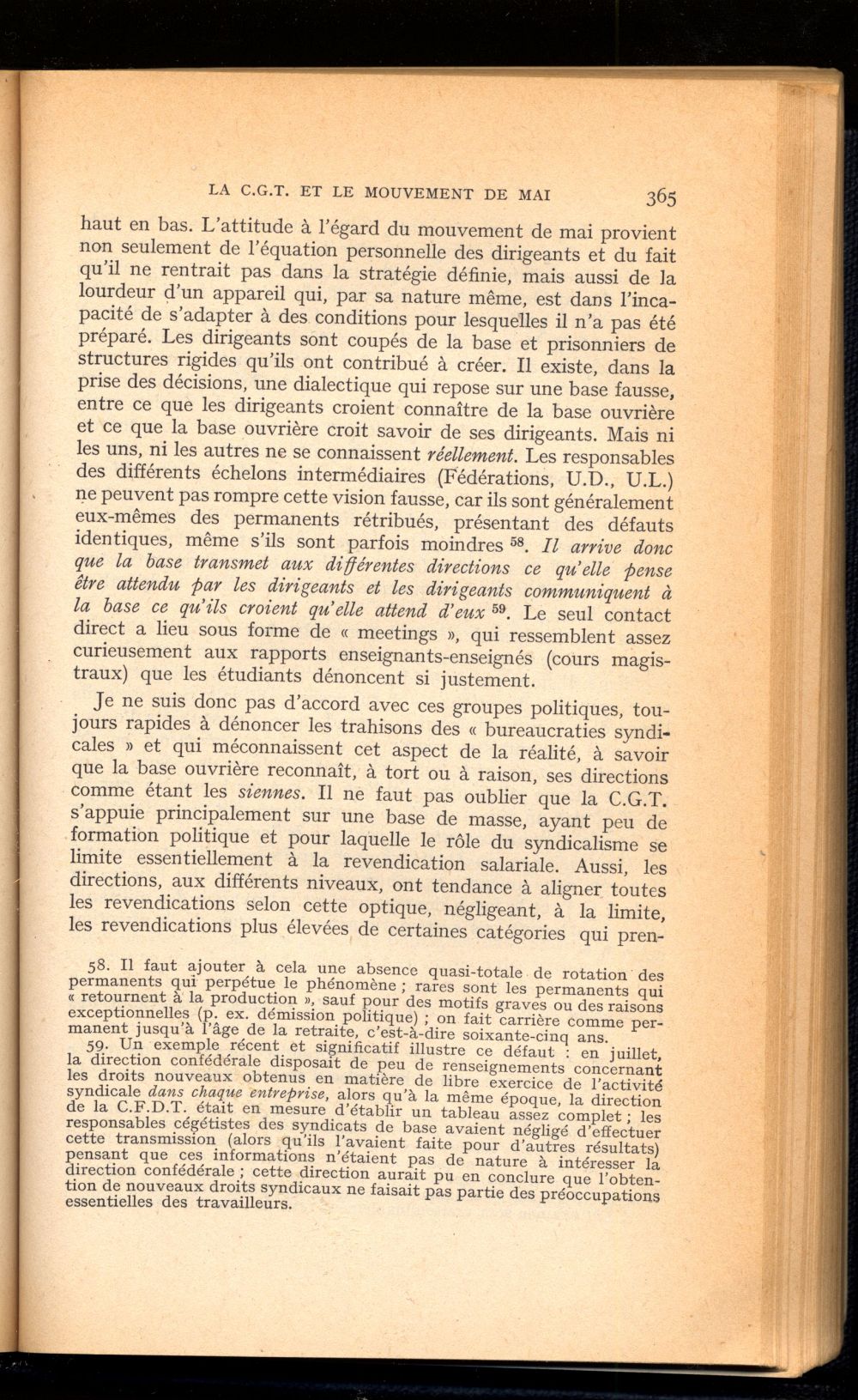

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
365
haut en bas. L'attitude à l'égard du mouvement de mai provient
non seulement de l'équation personnelle des dirigeants et du fait
qu'il ne rentrait pas dans la stratégie définie, mais aussi de la
lourdeur d'un appareil qui, par sa nature même, est dans l'inca-
pacité de s'adapter à des conditions pour lesquelles il n'a pas été
préparé. Les dirigeants sont coupés de la base et prisonniers de
structures rigides qu'ils ont contribué à créer. Il existe, dans la
prise des décisions, une dialectique qui repose sur une base fausse,
entre ce que les dirigeants croient connaître de la base ouvrière
et ce que la base ouvrière croit savoir de ses dirigeants. Mais ni
les uns, ni les autres ne se connaissent réellement. Les responsables
des différents échelons intermédiaires (Fédérations, U.D., U.L.)
ne peuvent pas rompre cette vision fausse, car ils sont généralement
eux-mêmes des permanents rétribués, présentant des défauts
identiques, même s'ils sont parfois moindres 38. // arrive donc
que la base transmet aux différentes directions ce quelle pense
être attendu par les dirigeants et les dirigeants communiquent à
la base ce qu'ils croient qu'elle attend d'eux 59. Le seul contact
direct a lieu sous forme de « meetings », qui ressemblent assez
curieusement aux rapports enseignants-enseignes (cours magis-
traux) que les étudiants dénoncent si justement.
non seulement de l'équation personnelle des dirigeants et du fait
qu'il ne rentrait pas dans la stratégie définie, mais aussi de la
lourdeur d'un appareil qui, par sa nature même, est dans l'inca-
pacité de s'adapter à des conditions pour lesquelles il n'a pas été
préparé. Les dirigeants sont coupés de la base et prisonniers de
structures rigides qu'ils ont contribué à créer. Il existe, dans la
prise des décisions, une dialectique qui repose sur une base fausse,
entre ce que les dirigeants croient connaître de la base ouvrière
et ce que la base ouvrière croit savoir de ses dirigeants. Mais ni
les uns, ni les autres ne se connaissent réellement. Les responsables
des différents échelons intermédiaires (Fédérations, U.D., U.L.)
ne peuvent pas rompre cette vision fausse, car ils sont généralement
eux-mêmes des permanents rétribués, présentant des défauts
identiques, même s'ils sont parfois moindres 38. // arrive donc
que la base transmet aux différentes directions ce quelle pense
être attendu par les dirigeants et les dirigeants communiquent à
la base ce qu'ils croient qu'elle attend d'eux 59. Le seul contact
direct a lieu sous forme de « meetings », qui ressemblent assez
curieusement aux rapports enseignants-enseignes (cours magis-
traux) que les étudiants dénoncent si justement.
Je ne suis donc pas d'accord avec ces groupes politiques, tou-
jours rapides à dénoncer les trahisons des « bureaucraties syndi-
cales » et qui méconnaissent cet aspect de la réalité, à savoir
que la base ouvrière reconnaît, à tort ou à raison, ses directions
comme étant les siennes. Il ne faut pas oublier que la C.G.T.
s'appuie principalement sur une base de masse, ayant peu de
formation politique et pour laquelle le rôle du syndicalisme se
limite essentiellement à la revendication salariale. Aussi, les
directions, aux différents niveaux, ont tendance à aligner toutes
les revendications selon cette optique, négligeant, à la limite,
les revendications plus élevées de certaines catégories qui pren-
jours rapides à dénoncer les trahisons des « bureaucraties syndi-
cales » et qui méconnaissent cet aspect de la réalité, à savoir
que la base ouvrière reconnaît, à tort ou à raison, ses directions
comme étant les siennes. Il ne faut pas oublier que la C.G.T.
s'appuie principalement sur une base de masse, ayant peu de
formation politique et pour laquelle le rôle du syndicalisme se
limite essentiellement à la revendication salariale. Aussi, les
directions, aux différents niveaux, ont tendance à aligner toutes
les revendications selon cette optique, négligeant, à la limite,
les revendications plus élevées de certaines catégories qui pren-
58. Il faut ajouter à cela une absence quasi-totale de rotation des
permanents qui perpétue le phénomène ; rares sont les permanents qui
permanents qui perpétue le phénomène ; rares sont les permanents qui
jusqu'à 1 âge cie la retraite, c'est-à-dire soixante-cinq
59. Un exemple récent et significatif illustre ce défaut : en juillet,
la direction confédérale disposait de peu de renseignements concernant
les droits nouveaux obtenus en matière de libre exercice de l'activité
syndicale dans chaque entreprise, alors qu'à la même époque, la direction
59. Un exemple récent et significatif illustre ce défaut : en juillet,
la direction confédérale disposait de peu de renseignements concernant
les droits nouveaux obtenus en matière de libre exercice de l'activité
syndicale dans chaque entreprise, alors qu'à la même époque, la direction
(alors qu'ils l'avaient faite pour d'autres résultats)
pensant que ces informations n'étaient pas de nature à intéresser la
direction confédérale ; cette direction aurait pu en conclure que l'obten-
tion de nouveaux droits syndicaux ne faisait pas partie des préoccupations
essentielles des travailleurs.
pensant que ces informations n'étaient pas de nature à intéresser la
direction confédérale ; cette direction aurait pu en conclure que l'obten-
tion de nouveaux droits syndicaux ne faisait pas partie des préoccupations
essentielles des travailleurs.
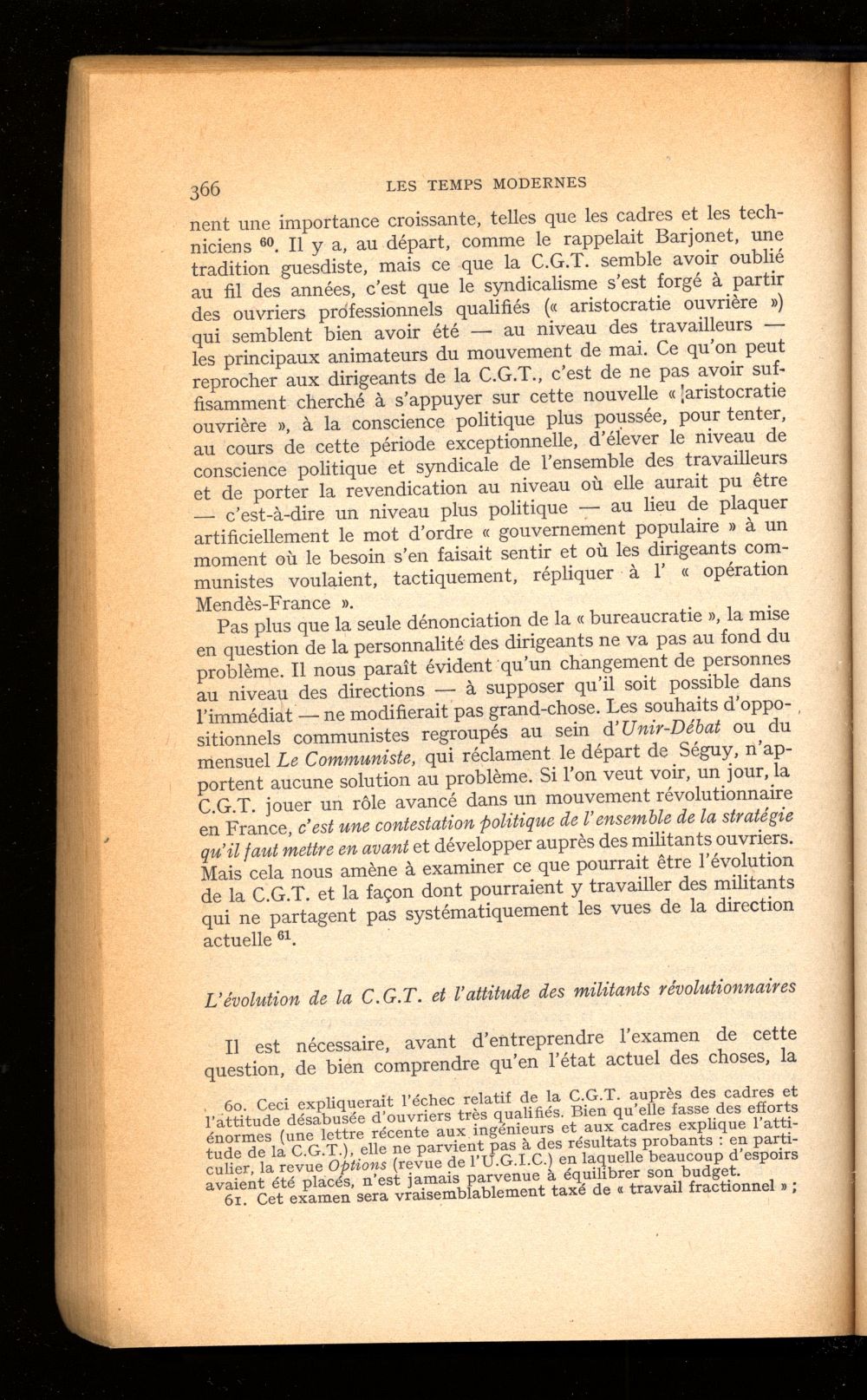

366 LES TEMPS MODERNES
nent une importance croissante, telles que les cadres et les tech-
niciens 60. Il y a, au départ, comme le rappelait Barjonet, une
tradition guesdiste, mais ce que la C.G.T. semble avoir oublié
au fil des années, c'est que le syndicalisme s'est forgé à partir
des ouvriers professionnels qualifiés (« aristocratie ouvrière »)
qui semblent bien avoir été — au niveau des travailleurs —
les principaux animateurs du mouvement de mai. Ce qu'on peut
reprocher aux dirigeants de la C.G.T., c'est de ne pas avoir suf~
fisamment cherché à s'appuyer sur cette nouvelle « ^aristocratie
ouvrière », à la conscience politique plus poussée, pour tenter,
au cours de cette période exceptionnelle, d'élever le niveau de
conscience politique et syndicale de l'ensemble des travailleurs
et de porter la revendication au niveau où elle aurait pu être
—• c'est-à-dire un niveau plus politique — au lieu de plaquer
artificiellement le mot d'ordre « gouvernement populaire » à un
moment où le besoin s'en faisait sentir et où les dirigeants com-
munistes voulaient, tactiquement, répliquer à 1' « opération
Mendès-France ».
niciens 60. Il y a, au départ, comme le rappelait Barjonet, une
tradition guesdiste, mais ce que la C.G.T. semble avoir oublié
au fil des années, c'est que le syndicalisme s'est forgé à partir
des ouvriers professionnels qualifiés (« aristocratie ouvrière »)
qui semblent bien avoir été — au niveau des travailleurs —
les principaux animateurs du mouvement de mai. Ce qu'on peut
reprocher aux dirigeants de la C.G.T., c'est de ne pas avoir suf~
fisamment cherché à s'appuyer sur cette nouvelle « ^aristocratie
ouvrière », à la conscience politique plus poussée, pour tenter,
au cours de cette période exceptionnelle, d'élever le niveau de
conscience politique et syndicale de l'ensemble des travailleurs
et de porter la revendication au niveau où elle aurait pu être
—• c'est-à-dire un niveau plus politique — au lieu de plaquer
artificiellement le mot d'ordre « gouvernement populaire » à un
moment où le besoin s'en faisait sentir et où les dirigeants com-
munistes voulaient, tactiquement, répliquer à 1' « opération
Mendès-France ».
Pas plus que la seule dénonciation de la « bureaucratie », la mise
en question de la personnalité des dirigeants ne va pas au fond du
problème. Il nous paraît évident qu'un changement de personnes
au niveau des directions —• à supposer qu'il soit possible dans
l'immédiat — ne modifierait pas grand-chose. Les souhaits d'oppo-
sitionnels communistes regroupés au sein d'Unir-Débat ou du
mensuel Le Communiste, qui réclament le départ de Séguy, n'ap-
portent aucune solution au problème. Si l'on veut voir, un jour, la
C.G.T. jouer un rôle avancé dans un mouvement révolutionnaire
en France, c'est une contestation politique de l'ensemble de la stratégie
qu'il faut mettre en avant et développer auprès des militants ouvriers.
Mais cela nous amène à examiner ce que pourrait être l'évolution
de la C.G.T. et la façon dont pourraient y travailler des militants
qui ne partagent pas systématiquement les vues de la direction
actuelle 01.
en question de la personnalité des dirigeants ne va pas au fond du
problème. Il nous paraît évident qu'un changement de personnes
au niveau des directions —• à supposer qu'il soit possible dans
l'immédiat — ne modifierait pas grand-chose. Les souhaits d'oppo-
sitionnels communistes regroupés au sein d'Unir-Débat ou du
mensuel Le Communiste, qui réclament le départ de Séguy, n'ap-
portent aucune solution au problème. Si l'on veut voir, un jour, la
C.G.T. jouer un rôle avancé dans un mouvement révolutionnaire
en France, c'est une contestation politique de l'ensemble de la stratégie
qu'il faut mettre en avant et développer auprès des militants ouvriers.
Mais cela nous amène à examiner ce que pourrait être l'évolution
de la C.G.T. et la façon dont pourraient y travailler des militants
qui ne partagent pas systématiquement les vues de la direction
actuelle 01.
L'évolution de la C.G.T. et l'attitude des militants révolutionnai'!'es
II est nécessaire, avant d'entreprendre l'examen de cette
question, de bien comprendre qu'en l'état actuel des choses, la
question, de bien comprendre qu'en l'état actuel des choses, la
60. Ceci expliquerait l'échec relatif de la C.G.T. auprès des cadres et
l'attitude désabusée d'ouvriers très qualifiés. Bien qu'elle fasse des efforts
énormes (une lettre récente aux ingénieurs et aux cadres explique l'atti-
tude de la C.G.T.), elle ne parvient pas à des résultats probants : en parti-
culier, la revue Options (revue de 1'U.G.I.C.) eu laquelle beaucoup d'espoirs
avaient été placés, n'est jamais parvenue à équilibrer son budget.
l'attitude désabusée d'ouvriers très qualifiés. Bien qu'elle fasse des efforts
énormes (une lettre récente aux ingénieurs et aux cadres explique l'atti-
tude de la C.G.T.), elle ne parvient pas à des résultats probants : en parti-
culier, la revue Options (revue de 1'U.G.I.C.) eu laquelle beaucoup d'espoirs
avaient été placés, n'est jamais parvenue à équilibrer son budget.
61. Cet examen sera vraisemblablement taxé de « travail fractionnel » ;
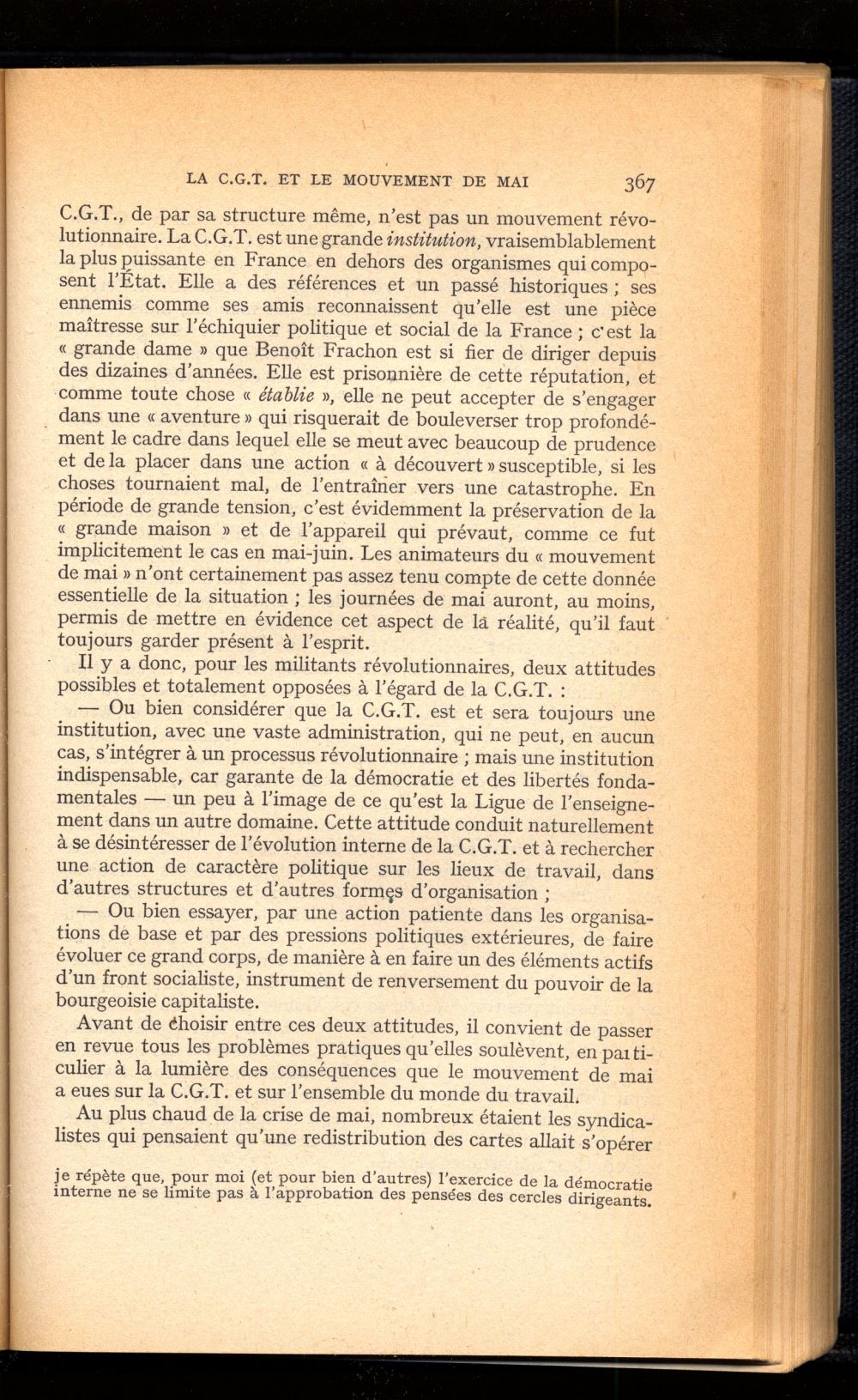

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
367
C.G.T., de par sa structure même, n'est pas un mouvement révo-
lutionnaire. La C.G.T. est une grande institution, vraisemblablement
la plus puissante en France en dehors des organismes qui compo-
sent l'Etat. Elle a des références et un passé historiques ; ses
ennemis comme ses amis reconnaissent qu'elle est une pièce
maîtresse sur l'échiquier politique et social de la France ; c1 est la
« grande dame » que Benoît Frachon est si fier de diriger depuis
des dizaines d'années. Elle est prisonnière de cette réputation, et
comme toute chose « établie », elle ne peut accepter de s'engager
dans une « aventure » qui risquerait de bouleverser trop profondé-
ment le cadre dans lequel elle se meut avec beaucoup de prudence
et de la placer dans une action « à découvert » susceptible, si les
choses tournaient mal, de l'entraîner vers une catastrophe. En
période de grande tension, c'est évidemment la préservation de la
« grande maison » et de l'appareil qui prévaut, comme ce fut
implicitement le cas en mai-juin. Les animateurs du « mouvement
de mai » n'ont certainement pas assez tenu compte de cette donnée
essentielle de la situation ; les journées de mai auront, au moins,
permis de mettre en évidence cet aspect de la réalité, qu'il faut
toujours garder présent à l'esprit.
lutionnaire. La C.G.T. est une grande institution, vraisemblablement
la plus puissante en France en dehors des organismes qui compo-
sent l'Etat. Elle a des références et un passé historiques ; ses
ennemis comme ses amis reconnaissent qu'elle est une pièce
maîtresse sur l'échiquier politique et social de la France ; c1 est la
« grande dame » que Benoît Frachon est si fier de diriger depuis
des dizaines d'années. Elle est prisonnière de cette réputation, et
comme toute chose « établie », elle ne peut accepter de s'engager
dans une « aventure » qui risquerait de bouleverser trop profondé-
ment le cadre dans lequel elle se meut avec beaucoup de prudence
et de la placer dans une action « à découvert » susceptible, si les
choses tournaient mal, de l'entraîner vers une catastrophe. En
période de grande tension, c'est évidemment la préservation de la
« grande maison » et de l'appareil qui prévaut, comme ce fut
implicitement le cas en mai-juin. Les animateurs du « mouvement
de mai » n'ont certainement pas assez tenu compte de cette donnée
essentielle de la situation ; les journées de mai auront, au moins,
permis de mettre en évidence cet aspect de la réalité, qu'il faut
toujours garder présent à l'esprit.
Il y a donc, pour les militants révolutionnaires, deux attitudes
possibles et totalement opposées à l'égard de la C.G.T. :
possibles et totalement opposées à l'égard de la C.G.T. :
•— Ou bien considérer que la C.G.T. est et sera toujours une
institution, avec une vaste administration, qui ne peut, en aucun
cas, s'intégrer à un processus révolutionnaire ; mais une institution
indispensable, car garante de la démocratie et des libertés fonda-
mentales — un peu à l'image de ce qu'est la Ligue de l'enseigne-
ment dans un autre domaine. Cette attitude conduit naturellement
à se désintéresser de l'évolution interne de la C.G.T. et à rechercher
une action de caractère politique sur les lieux de travail, dans
d'autres structures et d'autres formas d'organisation ;
institution, avec une vaste administration, qui ne peut, en aucun
cas, s'intégrer à un processus révolutionnaire ; mais une institution
indispensable, car garante de la démocratie et des libertés fonda-
mentales — un peu à l'image de ce qu'est la Ligue de l'enseigne-
ment dans un autre domaine. Cette attitude conduit naturellement
à se désintéresser de l'évolution interne de la C.G.T. et à rechercher
une action de caractère politique sur les lieux de travail, dans
d'autres structures et d'autres formas d'organisation ;
— Ou bien essayer, par une action patiente dans les organisa-
tions de base et par des pressions politiques extérieures, de faire
évoluer ce grand corps, de manière à en faire un des éléments actifs
d'un front socialiste, instrument de renversement du pouvoir de la
bourgeoisie capitaliste.
tions de base et par des pressions politiques extérieures, de faire
évoluer ce grand corps, de manière à en faire un des éléments actifs
d'un front socialiste, instrument de renversement du pouvoir de la
bourgeoisie capitaliste.
Avant de Choisir entre ces deux attitudes, il convient de passer
en revue tous les problèmes pratiques qu'elles soulèvent, enpaiti-
culier à la lumière des conséquences que le mouvement de mai
a eues sur la C.G.T. et sur l'ensemble du monde du travail.
en revue tous les problèmes pratiques qu'elles soulèvent, enpaiti-
culier à la lumière des conséquences que le mouvement de mai
a eues sur la C.G.T. et sur l'ensemble du monde du travail.
Au plus chaud de la crise de mai, nombreux étaient les syndica-
listes qui pensaient qu'une redistribution des cartes allait s'opérer
listes qui pensaient qu'une redistribution des cartes allait s'opérer
je répète que, pour moi (et pour bien d'autres) l'exercice de la démocratie
interne ne se limite pas à l'approbation des pensées des cercles dirigeants.
interne ne se limite pas à l'approbation des pensées des cercles dirigeants.
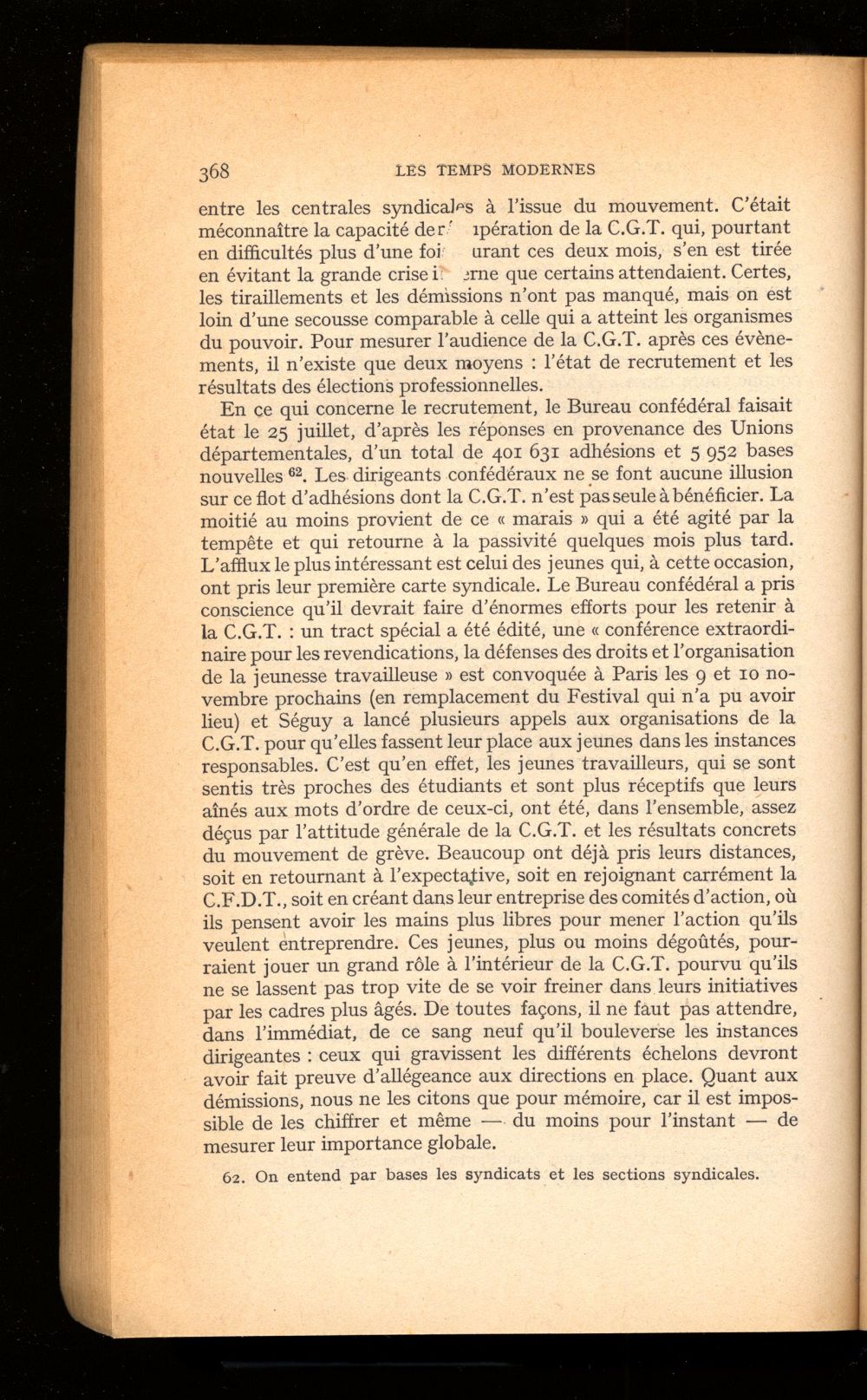

368
LES TEMPS MODERNES
entre les centrales syndicales à l'issue du mouvement. C'était
méconnaître la capacité der' ipération de la C.G.T. qui, pourtant
en difficultés plus d'une foi urant ces deux mois, s'en est tirée
en évitant la grande crise i: ;rne que certains attendaient. Certes,
les tiraillements et les démissions n'ont pas manqué, mais on est
loin d'une secousse comparable à celle qui a atteint les organismes
du pouvoir. Pour mesurer l'audience de la C.G.T. après ces événe-
ments, il n'existe que deux moyens : l'état de recrutement et les
résultats des élections professionnelles.
méconnaître la capacité der' ipération de la C.G.T. qui, pourtant
en difficultés plus d'une foi urant ces deux mois, s'en est tirée
en évitant la grande crise i: ;rne que certains attendaient. Certes,
les tiraillements et les démissions n'ont pas manqué, mais on est
loin d'une secousse comparable à celle qui a atteint les organismes
du pouvoir. Pour mesurer l'audience de la C.G.T. après ces événe-
ments, il n'existe que deux moyens : l'état de recrutement et les
résultats des élections professionnelles.
En ce qui concerne le recrutement, le Bureau confédéral faisait
état le 25 juillet, d'après les réponses en provenance des Unions
départementales, d'un total de 401 631 adhésions et 5 952 bases
nouvelles 62. Les dirigeants confédéraux ne se font aucune illusion
sur ce flot d'adhésions dont la C.G.T. n'est pas seule à bénéficier. La
moitié au moins provient de ce « marais » qui a été agité par la
tempête et qui retourne à la passivité quelques mois plus tard.
L'afflux le plus intéressant est celui des jeunes qui, à cette occasion,
ont pris leur première carte syndicale. Le Bureau confédéral a pris
conscience qu'il devrait faire d'énormes efforts pour les retenir à
la C.G.T. : un tract spécial a été édité, une « conférence extraordi-
naire pour les revendications, la défenses des droits et l'organisation
de la jeunesse travailleuse » est convoquée à Paris les 9 et 10 no-
vembre prochains (en remplacement du Festival qui n'a pu avoir
lieu) et Séguy a lancé plusieurs appels aux organisations de la
C.G.T. pour qu'elles fassent leur place aux jeunes dans les instances
responsables. C'est qu'en effet, les jeunes travailleurs, qui se sont
sentis très proches des étudiants et sont plus réceptifs que leurs
aînés aux mots d'ordre de ceux-ci, ont été, dans l'ensemble, assez
déçus par l'attitude générale de la C.G.T. et les résultats concrets
du mouvement de grève. Beaucoup ont déjà pris leurs distances,
soit en retournant à l'expectative, soit en rejoignant carrément la
C.F.D.T., soit en créant dans leur entreprise des comités d'action, où
ils pensent avoir les mains plus libres pour mener l'action qu'ils
veulent entreprendre. Ces jeunes, plus ou moins dégoûtés, pour-
raient jouer un grand rôle à l'intérieur de la C.G.T. pourvu qu'ils
ne se lassent pas trop vite de se voir freiner dans leurs initiatives
par les cadres plus âgés. De toutes façons, il ne faut pas attendre,
dans l'immédiat, de ce sang neuf qu'il bouleverse les instances
dirigeantes : ceux qui gravissent les différents échelons devront
avoir fait preuve d'allégeance aux directions en place. Quant aux
démissions, nous ne les citons que pour mémoire, car il est impos-
sible de les chiffrer et même — du moins pour l'instant — de
mesurer leur importance globale.
état le 25 juillet, d'après les réponses en provenance des Unions
départementales, d'un total de 401 631 adhésions et 5 952 bases
nouvelles 62. Les dirigeants confédéraux ne se font aucune illusion
sur ce flot d'adhésions dont la C.G.T. n'est pas seule à bénéficier. La
moitié au moins provient de ce « marais » qui a été agité par la
tempête et qui retourne à la passivité quelques mois plus tard.
L'afflux le plus intéressant est celui des jeunes qui, à cette occasion,
ont pris leur première carte syndicale. Le Bureau confédéral a pris
conscience qu'il devrait faire d'énormes efforts pour les retenir à
la C.G.T. : un tract spécial a été édité, une « conférence extraordi-
naire pour les revendications, la défenses des droits et l'organisation
de la jeunesse travailleuse » est convoquée à Paris les 9 et 10 no-
vembre prochains (en remplacement du Festival qui n'a pu avoir
lieu) et Séguy a lancé plusieurs appels aux organisations de la
C.G.T. pour qu'elles fassent leur place aux jeunes dans les instances
responsables. C'est qu'en effet, les jeunes travailleurs, qui se sont
sentis très proches des étudiants et sont plus réceptifs que leurs
aînés aux mots d'ordre de ceux-ci, ont été, dans l'ensemble, assez
déçus par l'attitude générale de la C.G.T. et les résultats concrets
du mouvement de grève. Beaucoup ont déjà pris leurs distances,
soit en retournant à l'expectative, soit en rejoignant carrément la
C.F.D.T., soit en créant dans leur entreprise des comités d'action, où
ils pensent avoir les mains plus libres pour mener l'action qu'ils
veulent entreprendre. Ces jeunes, plus ou moins dégoûtés, pour-
raient jouer un grand rôle à l'intérieur de la C.G.T. pourvu qu'ils
ne se lassent pas trop vite de se voir freiner dans leurs initiatives
par les cadres plus âgés. De toutes façons, il ne faut pas attendre,
dans l'immédiat, de ce sang neuf qu'il bouleverse les instances
dirigeantes : ceux qui gravissent les différents échelons devront
avoir fait preuve d'allégeance aux directions en place. Quant aux
démissions, nous ne les citons que pour mémoire, car il est impos-
sible de les chiffrer et même — du moins pour l'instant — de
mesurer leur importance globale.
62. On entend par bases les syndicats et les sections syndicales.
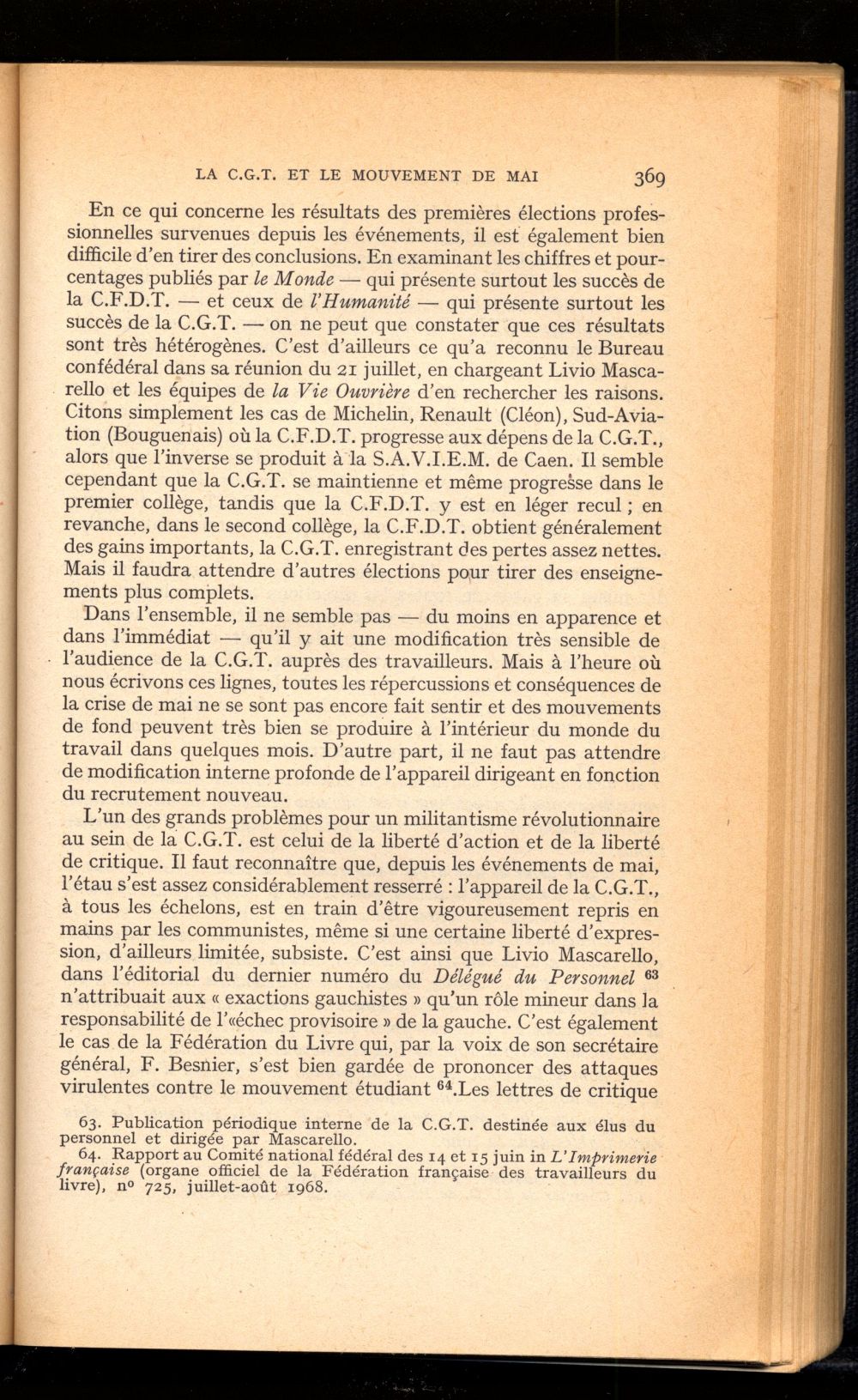

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
369
En ce qui concerne les résultats des premières élections profes-
sionnelles survenues depuis les événements, il est également bien
difficile d'en tirer des conclusions. En examinant les chiffres et pour-
centages publiés par le Monde — qui présente surtout les succès de
la C.F.D.T. — et ceux de l'Humanité — qui présente surtout les
succès de la C.G.T. — on ne peut que constater que ces résultats
sont très hétérogènes. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu le Bureau
confédéral dans sa réunion du 21 juillet, en chargeant Livio Masca-
rello et les équipes de la Vie Ouvrière d'en rechercher les raisons.
Citons simplement les cas de Michelin, Renault (Cléon), Sud-Avia-
tion (Bouguenais) où la C.F.D.T. progresse aux dépens de la C.G.T.,
alors que l'inverse se produit à la S.A.V.I.E.M. de Caen. Il semble
cependant que la C.G.T. se maintienne et même progresse dans le
premier collège, tandis que la C.F.D.T. y est en léger recul ; en
revanche, dans le second collège, la C.F.D.T. obtient généralement
des gains importants, la C.G.T. enregistrant des pertes assez nettes.
Mais il faudra attendre d'autres élections pour tirer des enseigne-
ments plus complets.
sionnelles survenues depuis les événements, il est également bien
difficile d'en tirer des conclusions. En examinant les chiffres et pour-
centages publiés par le Monde — qui présente surtout les succès de
la C.F.D.T. — et ceux de l'Humanité — qui présente surtout les
succès de la C.G.T. — on ne peut que constater que ces résultats
sont très hétérogènes. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu le Bureau
confédéral dans sa réunion du 21 juillet, en chargeant Livio Masca-
rello et les équipes de la Vie Ouvrière d'en rechercher les raisons.
Citons simplement les cas de Michelin, Renault (Cléon), Sud-Avia-
tion (Bouguenais) où la C.F.D.T. progresse aux dépens de la C.G.T.,
alors que l'inverse se produit à la S.A.V.I.E.M. de Caen. Il semble
cependant que la C.G.T. se maintienne et même progresse dans le
premier collège, tandis que la C.F.D.T. y est en léger recul ; en
revanche, dans le second collège, la C.F.D.T. obtient généralement
des gains importants, la C.G.T. enregistrant des pertes assez nettes.
Mais il faudra attendre d'autres élections pour tirer des enseigne-
ments plus complets.
Dans l'ensemble, il ne semble pas — du moins en apparence et
dans l'immédiat — qu'il y ait une modification très sensible de
l'audience de la C.G.T. auprès des travailleurs. Mais à l'heure où
nous écrivons ces lignes, toutes les répercussions et conséquences de
la crise de mai ne se sont pas encore fait sentir et des mouvements
de fond peuvent très bien se produire à l'intérieur du monde du
travail dans quelques mois. D'autre part, il ne faut pas attendre
de modification interne profonde de l'appareil dirigeant en fonction
du recrutement nouveau.
dans l'immédiat — qu'il y ait une modification très sensible de
l'audience de la C.G.T. auprès des travailleurs. Mais à l'heure où
nous écrivons ces lignes, toutes les répercussions et conséquences de
la crise de mai ne se sont pas encore fait sentir et des mouvements
de fond peuvent très bien se produire à l'intérieur du monde du
travail dans quelques mois. D'autre part, il ne faut pas attendre
de modification interne profonde de l'appareil dirigeant en fonction
du recrutement nouveau.
L'un des grands problèmes pour un militantisme révolutionnaire
au sein de la C.G.T. est celui de la liberté d'action et de la liberté
de critique. Il faut reconnaître que, depuis les événements de mai,
l'étau s'est assez considérablement resserré : l'appareil de la C.G.T.,
à tous les échelons, est en train d'être vigoureusement repris en
mains par les communistes, même si une certaine liberté d'expres-
sion, d'ailleurs limitée, subsiste. C'est ainsi que Livio Mascarello,
dans l'éditorial du dernier numéro du Délégué du Personnel 63
n'attribuait aux « exactions gauchistes » qu'un rôle mineur dans la
responsabilité de l'«échec provisoire » de la gauche. C'est également
le cas de la Fédération du Livre qui, par la voix de son secrétaire
général, F. Besnier, s'est bien gardée de prononcer des attaques
virulentes contre le mouvement étudiant 64.Les lettres de critique
au sein de la C.G.T. est celui de la liberté d'action et de la liberté
de critique. Il faut reconnaître que, depuis les événements de mai,
l'étau s'est assez considérablement resserré : l'appareil de la C.G.T.,
à tous les échelons, est en train d'être vigoureusement repris en
mains par les communistes, même si une certaine liberté d'expres-
sion, d'ailleurs limitée, subsiste. C'est ainsi que Livio Mascarello,
dans l'éditorial du dernier numéro du Délégué du Personnel 63
n'attribuait aux « exactions gauchistes » qu'un rôle mineur dans la
responsabilité de l'«échec provisoire » de la gauche. C'est également
le cas de la Fédération du Livre qui, par la voix de son secrétaire
général, F. Besnier, s'est bien gardée de prononcer des attaques
virulentes contre le mouvement étudiant 64.Les lettres de critique
63. Publication périodique interne de la C.G.T. destinée aux élus du
personnel et dirigée par Mascarello.
personnel et dirigée par Mascarello.
64. Rapport au Comité national fédéral des 14 et 15 juin in L'Imprimerie
française (organe officiel de la Fédération française des travailleurs du
livre), n° 725, juillet-août 1968.
française (organe officiel de la Fédération française des travailleurs du
livre), n° 725, juillet-août 1968.
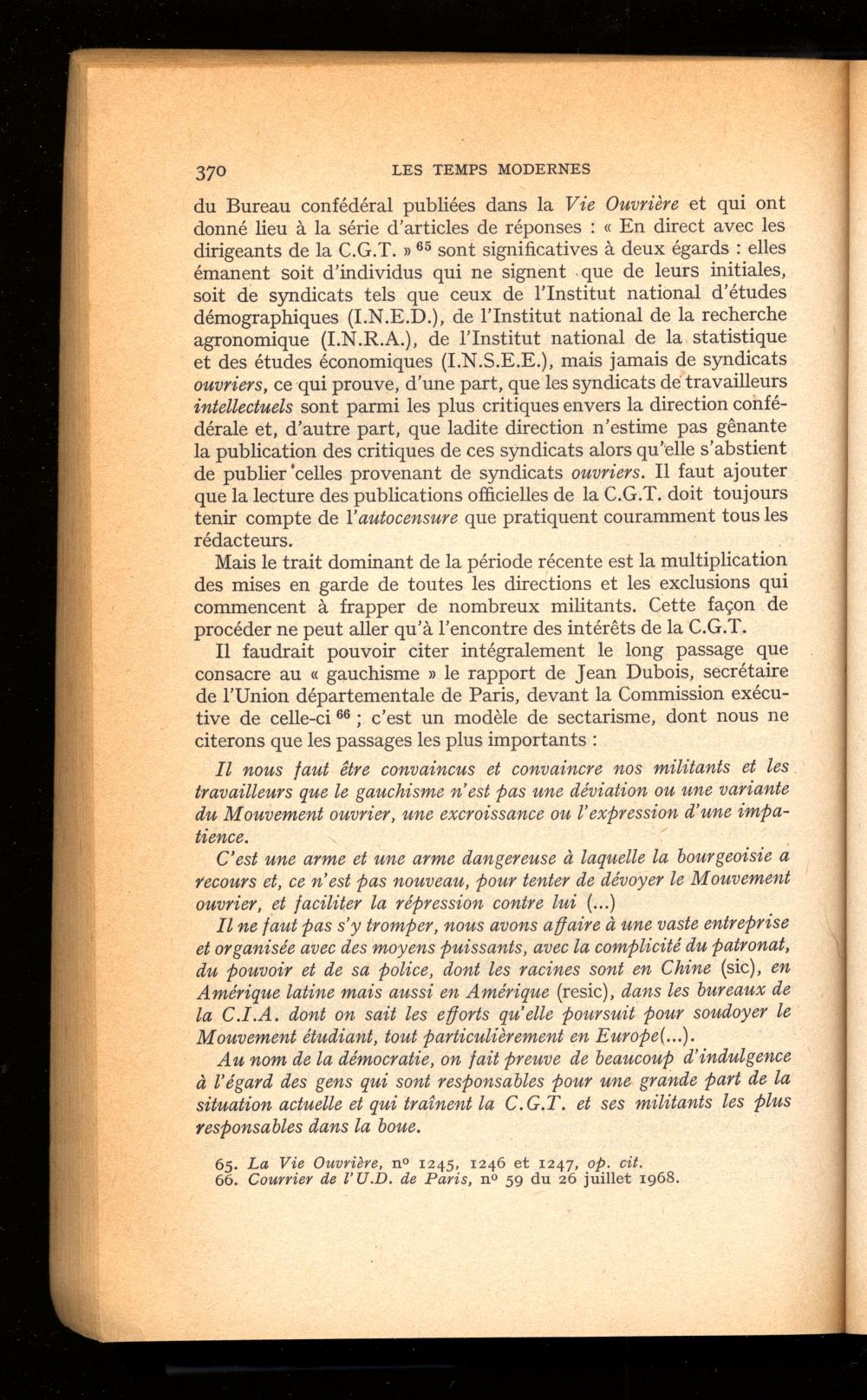

37°
LES TEMPS MODERNES
du Bureau confédéral publiées dans la Vie Ouvrière et qui ont
donné lieu à la série d'articles de réponses : « En direct avec les
dirigeants de la C.G.T. » 65 sont significatives à deux égards : elles
émanent soit d'individus qui ne signent que de leurs initiales,
soit de syndicats tels que ceux de l'Institut national d'études
démographiques (I.N.E.D.), de l'Institut national de la recherche
agronomique (I.N.R.A.), de l'Institut national de la statistique
et des études économiques (I.N.S.E.E.), mais jamais de syndicats
ouvriers, ce qui prouve, d'une part, que les syndicats dé travailleurs
intellectuels sont parmi les plus critiques envers la direction confé-
dérale et, d'autre part, que ladite direction n'estime pas gênante
la publication des critiques de ces syndicats alors qu'elle s'abstient
de publier'celles provenant de syndicats ouvriers. Il faut ajouter
que la lecture des publications officielles de la C.G.T. doit toujours
tenir compte de l'autocensure que pratiquent couramment tous les
rédacteurs.
donné lieu à la série d'articles de réponses : « En direct avec les
dirigeants de la C.G.T. » 65 sont significatives à deux égards : elles
émanent soit d'individus qui ne signent que de leurs initiales,
soit de syndicats tels que ceux de l'Institut national d'études
démographiques (I.N.E.D.), de l'Institut national de la recherche
agronomique (I.N.R.A.), de l'Institut national de la statistique
et des études économiques (I.N.S.E.E.), mais jamais de syndicats
ouvriers, ce qui prouve, d'une part, que les syndicats dé travailleurs
intellectuels sont parmi les plus critiques envers la direction confé-
dérale et, d'autre part, que ladite direction n'estime pas gênante
la publication des critiques de ces syndicats alors qu'elle s'abstient
de publier'celles provenant de syndicats ouvriers. Il faut ajouter
que la lecture des publications officielles de la C.G.T. doit toujours
tenir compte de l'autocensure que pratiquent couramment tous les
rédacteurs.
Mais le trait dominant de la période récente est la multiplication
des mises en garde de toutes les directions et les exclusions qui
commencent à frapper de nombreux militants. Cette façon de
procéder ne peut aller qu'à rencontre des intérêts de la C.G.T.
des mises en garde de toutes les directions et les exclusions qui
commencent à frapper de nombreux militants. Cette façon de
procéder ne peut aller qu'à rencontre des intérêts de la C.G.T.
Il faudrait pouvoir citer intégralement le long passage que
consacre au « gauchisme » le rapport de Jean Dubois, secrétaire
de l'Union départementale de Paris, devant la Commission execu-
tive de celle-ci 66 ; c'est un modèle de sectarisme, dont nous ne
citerons que les passages les plus importants :
consacre au « gauchisme » le rapport de Jean Dubois, secrétaire
de l'Union départementale de Paris, devant la Commission execu-
tive de celle-ci 66 ; c'est un modèle de sectarisme, dont nous ne
citerons que les passages les plus importants :
II nous faut être convaincus et convaincre nos militants et les
travailleurs que le gauchisme n'est pas une déviation ou une variante
du Mouvement ouvrier, une excroissance ou l'expression d'une impa-
tience.
travailleurs que le gauchisme n'est pas une déviation ou une variante
du Mouvement ouvrier, une excroissance ou l'expression d'une impa-
tience.
C'est une arme et une arme dangereuse à laquelle la bourgeoisie a
recours et, ce n'est pas nouveau, pour tenter de dévoyer le Mouvement
ouvrier, et faciliter la répression contre lui (...)
recours et, ce n'est pas nouveau, pour tenter de dévoyer le Mouvement
ouvrier, et faciliter la répression contre lui (...)
Il ne faut pas s'y tromper, nous avons affaire à une vaste entreprise
et organisée avec des moyens puissants, avec la complicité du patronat,
du pouvoir et de sa police, dont les racines sont en Chine (sic), en
Amérique latine mais aussi en Amérique (resic), dans les bureaux de
la C.I.A. dont on sait les efforts quelle poursuit pour soudoyer le
Mouvement étudiant, tout particulièrement en Europe(...).
et organisée avec des moyens puissants, avec la complicité du patronat,
du pouvoir et de sa police, dont les racines sont en Chine (sic), en
Amérique latine mais aussi en Amérique (resic), dans les bureaux de
la C.I.A. dont on sait les efforts quelle poursuit pour soudoyer le
Mouvement étudiant, tout particulièrement en Europe(...).
Au nom de la démocratie, on fait preuve de beaucoup d'indulgence
à l'égard des gens qui sont responsables pour une grande part de la
situation actuelle et qui traînent la C.G.T. et ses militants les plus
responsables dans la boue.
à l'égard des gens qui sont responsables pour une grande part de la
situation actuelle et qui traînent la C.G.T. et ses militants les plus
responsables dans la boue.
65. La Vie Ouvrière, n° 1245, 1246 et 1247, op. cit.
66. Courrier de l'U.D. de Paris, n° 59 du 26 juillet 1968.
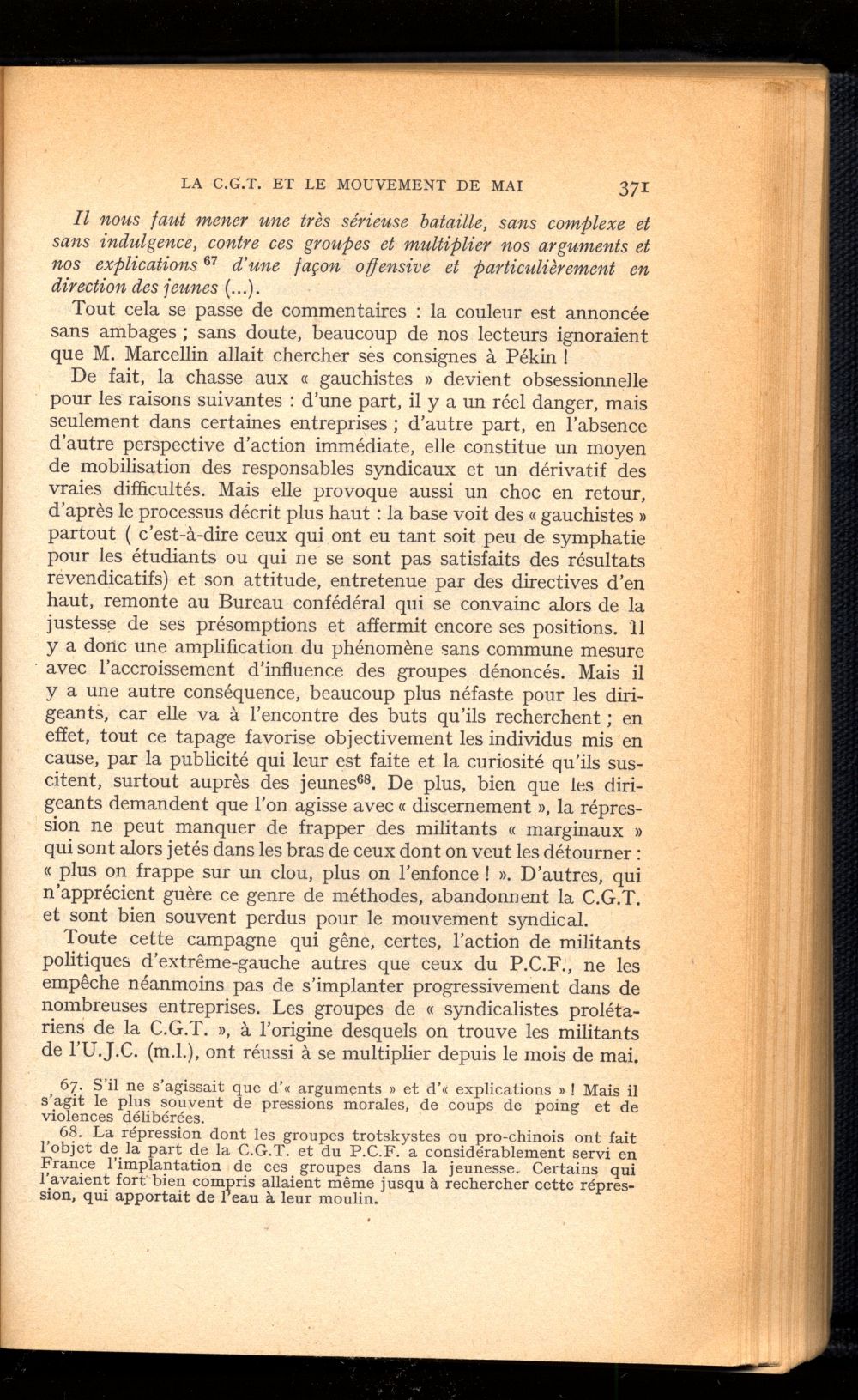

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
371
II nous faut mener une très sérieuse bataille, sans complexe et
sans indulgence, contre ces groupes et multiplier nos arguments et
nos explications67 d'une façon offensive et particulièrement en
direction des jeunes (...).
sans indulgence, contre ces groupes et multiplier nos arguments et
nos explications67 d'une façon offensive et particulièrement en
direction des jeunes (...).
Tout cela se passe de commentaires : la couleur est annoncée
sans ambages ; sans doute, beaucoup de nos lecteurs ignoraient
que M. Marcellin allait chercher ses consignes à Pékin !
sans ambages ; sans doute, beaucoup de nos lecteurs ignoraient
que M. Marcellin allait chercher ses consignes à Pékin !
De fait, la chasse aux « gauchistes » devient obsessionnelle
pour les raisons suivantes : d'une part, il y a un réel danger, mais
seulement dans certaines entreprises ; d'autre part, en l'absence
d'autre perspective d'action immédiate, elle constitue un moyen
de mobilisation des responsables syndicaux et un dérivatif des
vraies difficultés. Mais elle provoque aussi un choc en retour,
d'après le processus décrit plus haut : la base voit des « gauchistes »
partout ( c'est-à-dire ceux qui ont eu tant soit peu de symphatie
pour les étudiants ou qui ne se sont pas satisfaits des résultats
revendicatifs) et son attitude, entretenue par des directives d'en
haut, remonte au Bureau confédéral qui se convainc alors de la
justesse de ses présomptions et affermit encore ses positions. 11
y a donc une amplification du phénomène sans commune mesure
avec l'accroissement d'influence des groupes dénoncés. Mais il
y a une autre conséquence, beaucoup plus néfaste pour les diri-
geants, car elle va à l'encontre des buts qu'ils recherchent ; en
effet, tout ce tapage favorise objectivement les individus mis en
cause, par la publicité qui leur est faite et la curiosité qu'ils sus-
citent, surtout auprès des jeunes68. De plus, bien que les diri-
geants demandent que l'on agisse avec « discernement », la répres-
sion ne peut manquer de frapper des militants « marginaux »
qui sont alors jetés dans les bras de ceux dont on veut les détourner :
« plus on frappe sur un clou, plus on l'enfonce ! ». D'autres, qui
n'apprécient guère ce genre de méthodes, abandonnent la C.G.T.
et sont bien souvent perdus pour le mouvement syndical.
pour les raisons suivantes : d'une part, il y a un réel danger, mais
seulement dans certaines entreprises ; d'autre part, en l'absence
d'autre perspective d'action immédiate, elle constitue un moyen
de mobilisation des responsables syndicaux et un dérivatif des
vraies difficultés. Mais elle provoque aussi un choc en retour,
d'après le processus décrit plus haut : la base voit des « gauchistes »
partout ( c'est-à-dire ceux qui ont eu tant soit peu de symphatie
pour les étudiants ou qui ne se sont pas satisfaits des résultats
revendicatifs) et son attitude, entretenue par des directives d'en
haut, remonte au Bureau confédéral qui se convainc alors de la
justesse de ses présomptions et affermit encore ses positions. 11
y a donc une amplification du phénomène sans commune mesure
avec l'accroissement d'influence des groupes dénoncés. Mais il
y a une autre conséquence, beaucoup plus néfaste pour les diri-
geants, car elle va à l'encontre des buts qu'ils recherchent ; en
effet, tout ce tapage favorise objectivement les individus mis en
cause, par la publicité qui leur est faite et la curiosité qu'ils sus-
citent, surtout auprès des jeunes68. De plus, bien que les diri-
geants demandent que l'on agisse avec « discernement », la répres-
sion ne peut manquer de frapper des militants « marginaux »
qui sont alors jetés dans les bras de ceux dont on veut les détourner :
« plus on frappe sur un clou, plus on l'enfonce ! ». D'autres, qui
n'apprécient guère ce genre de méthodes, abandonnent la C.G.T.
et sont bien souvent perdus pour le mouvement syndical.
Toute cette campagne qui gêne, certes, l'action de militants
politiques d'extrême-gauche autres que ceux du P.C.F., ne les
empêche néanmoins pas de s'implanter progressivement dans de
nombreuses entreprises. Les groupes de « syndicalistes proléta-
riens de la C.G.T. », à l'origine desquels on trouve les militants
de l'U.J.C. (m.L), ont réussi à se multiplier depuis le mois de mai.
politiques d'extrême-gauche autres que ceux du P.C.F., ne les
empêche néanmoins pas de s'implanter progressivement dans de
nombreuses entreprises. Les groupes de « syndicalistes proléta-
riens de la C.G.T. », à l'origine desquels on trouve les militants
de l'U.J.C. (m.L), ont réussi à se multiplier depuis le mois de mai.
67. S'il ne s'agissait que d'« arguments » et d'« explications » ! Mais il
s'agit le plus souvent de pressions morales, de coups de poing et de
violences délibérées.
s'agit le plus souvent de pressions morales, de coups de poing et de
violences délibérées.
68. La répression dont les groupes trotskystes ou çro-chinois ont fait
l'objet de la part de la C.G.T. et du P.C.F. a considérablement servi en
France l'implantation de ces groupes dans la jeunesse. Certains qui
l'avaient fort bien compris allaient même jusqu à rechercher cette répres-
sion, qui apportait de l'eau à leur moulin.
l'objet de la part de la C.G.T. et du P.C.F. a considérablement servi en
France l'implantation de ces groupes dans la jeunesse. Certains qui
l'avaient fort bien compris allaient même jusqu à rechercher cette répres-
sion, qui apportait de l'eau à leur moulin.
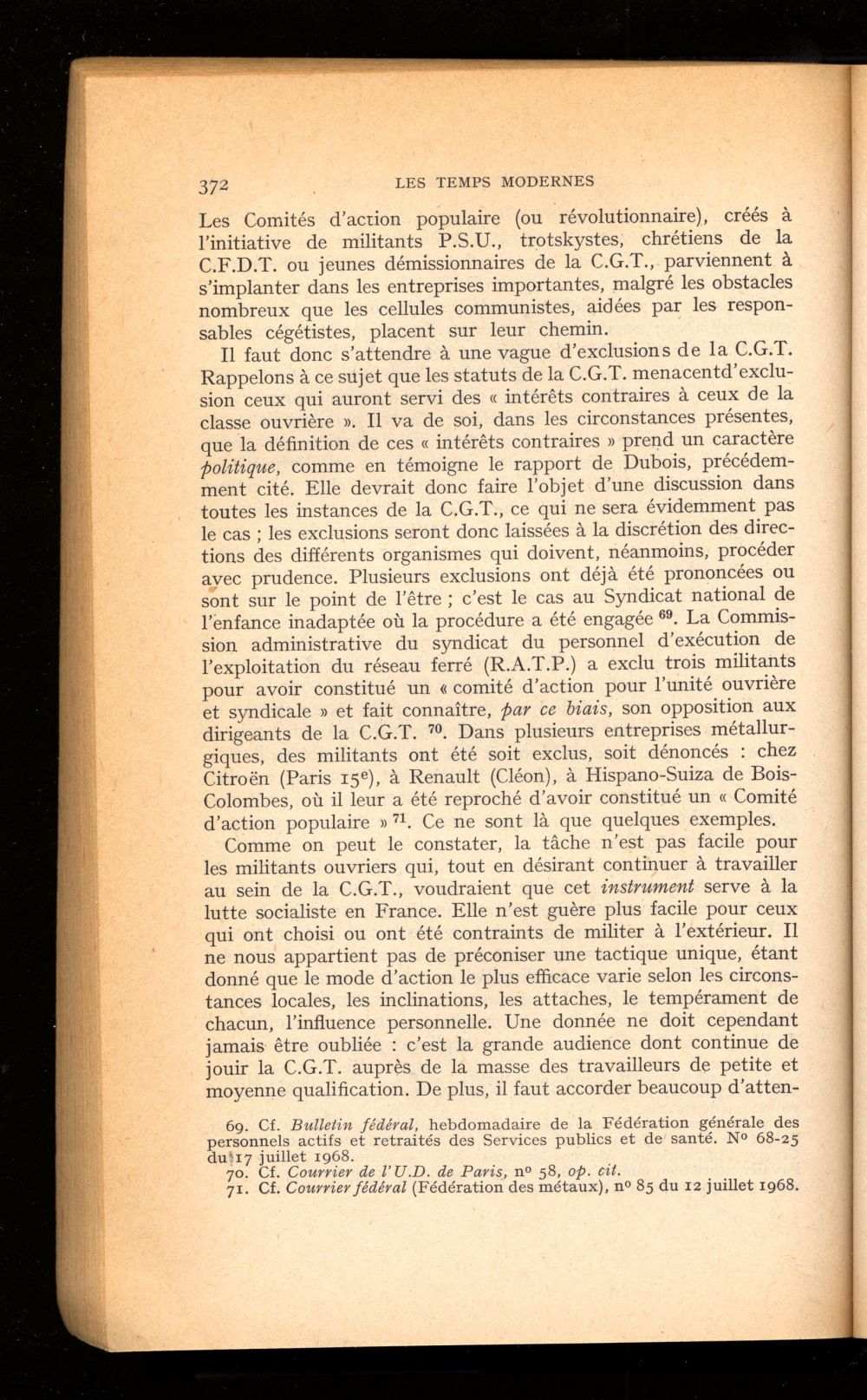

372 LES TEMPS MODERNES
Les Comités d'action populaire (ou révolutionnaire), créés à
l'initiative de militants P.S.U., trotskystes, chrétiens de la
C.F.D.T. ou jeunes démissionnaires de la C.G.T., parviennent à
s'implanter dans les entreprises importantes, malgré les obstacles
nombreux que les cellules communistes, aidées par les respon-
sables cégétistes, placent sur leur chemin.
l'initiative de militants P.S.U., trotskystes, chrétiens de la
C.F.D.T. ou jeunes démissionnaires de la C.G.T., parviennent à
s'implanter dans les entreprises importantes, malgré les obstacles
nombreux que les cellules communistes, aidées par les respon-
sables cégétistes, placent sur leur chemin.
Il faut donc s'attendre à une vague d'exclusions delà C.G.T.
Rappelons à ce sujet que les statuts de la C.G.T. menacentd'exclu-
sion ceux qui auront servi des « intérêts contraires à ceux de la
classe ouvrière ». Il va de soi, dans les circonstances présentes,
que la définition de ces « intérêts contraires » prend un caractère
politique, comme en témoigne le rapport de Dubois, précédem-
ment cité. Elle devrait donc faire l'objet d'une discussion dans
toutes les instances de la C.G.T., ce qui ne sera évidemment pas
le cas ; les exclusions seront donc laissées à la discrétion des direc-
tions des différents organismes qui doivent, néanmoins, procéder
avec prudence. Plusieurs exclusions ont déjà été prononcées ou
sont sur le point de l'être ; c'est le cas au Syndicat national de
l'enfance inadaptée où la procédure a été engagée 69. La Commis-
sion administrative du syndicat du personnel d'exécution de
l'exploitation du réseau ferré (R.A.T.P.) a exclu trois militants
pour avoir constitué un « comité d'action pour l'unité ouvrière
et syndicale » et fait connaître, par ce biais, son opposition aux
dirigeants de la C.G.T. 70. Dans plusieurs entreprises métallur-
giques, des militants ont été soit exclus, soit dénoncés : chez
Citroën (Paris 15e), à Renault (Cléon), à Hispano-Suiza de Bois-
Colombes, où il leur a été reproché d'avoir constitué un « Comité
d'action populaire » 71. Ce ne sont là que quelques exemples.
Rappelons à ce sujet que les statuts de la C.G.T. menacentd'exclu-
sion ceux qui auront servi des « intérêts contraires à ceux de la
classe ouvrière ». Il va de soi, dans les circonstances présentes,
que la définition de ces « intérêts contraires » prend un caractère
politique, comme en témoigne le rapport de Dubois, précédem-
ment cité. Elle devrait donc faire l'objet d'une discussion dans
toutes les instances de la C.G.T., ce qui ne sera évidemment pas
le cas ; les exclusions seront donc laissées à la discrétion des direc-
tions des différents organismes qui doivent, néanmoins, procéder
avec prudence. Plusieurs exclusions ont déjà été prononcées ou
sont sur le point de l'être ; c'est le cas au Syndicat national de
l'enfance inadaptée où la procédure a été engagée 69. La Commis-
sion administrative du syndicat du personnel d'exécution de
l'exploitation du réseau ferré (R.A.T.P.) a exclu trois militants
pour avoir constitué un « comité d'action pour l'unité ouvrière
et syndicale » et fait connaître, par ce biais, son opposition aux
dirigeants de la C.G.T. 70. Dans plusieurs entreprises métallur-
giques, des militants ont été soit exclus, soit dénoncés : chez
Citroën (Paris 15e), à Renault (Cléon), à Hispano-Suiza de Bois-
Colombes, où il leur a été reproché d'avoir constitué un « Comité
d'action populaire » 71. Ce ne sont là que quelques exemples.
Comme on peut le constater, la tâche n'est pas facile pour
les militants ouvriers qui, tout en désirant continuer à travailler
au sein de la C.G.T., voudraient que cet instrument serve à la
lutte socialiste en France. Elle n'est guère plus facile pour ceux
qui ont choisi ou ont été contraints de militer à l'extérieur. Il
ne nous appartient pas de préconiser une tactique unique, étant
donné que le mode d'action le plus efficace varie selon les circons-
tances locales, les inclinations, les attaches, le tempérament de
chacun, l'influence personnelle. Une donnée ne doit cependant
jamais être oubliée : c'est la grande audience dont continue de
jouir la C.G.T. auprès de la masse des travailleurs de petite et
moyenne qualification. De plus, il faut accorder beaucoup d'atten-
les militants ouvriers qui, tout en désirant continuer à travailler
au sein de la C.G.T., voudraient que cet instrument serve à la
lutte socialiste en France. Elle n'est guère plus facile pour ceux
qui ont choisi ou ont été contraints de militer à l'extérieur. Il
ne nous appartient pas de préconiser une tactique unique, étant
donné que le mode d'action le plus efficace varie selon les circons-
tances locales, les inclinations, les attaches, le tempérament de
chacun, l'influence personnelle. Une donnée ne doit cependant
jamais être oubliée : c'est la grande audience dont continue de
jouir la C.G.T. auprès de la masse des travailleurs de petite et
moyenne qualification. De plus, il faut accorder beaucoup d'atten-
6g. Cf. Bulletin fédéral, hebdomadaire de la Fédération générale des
personnels actifs et retraités des Services publics et de santé. N° 68-25
du'i? juillet 1968.
personnels actifs et retraités des Services publics et de santé. N° 68-25
du'i? juillet 1968.
70. Cf. Courrier de l'U.D. de Paris, n° 58, op. cit.
71. Cf. Courrier fédéral (Fédération des métaux), n° 85 du 12 juillet 1968.
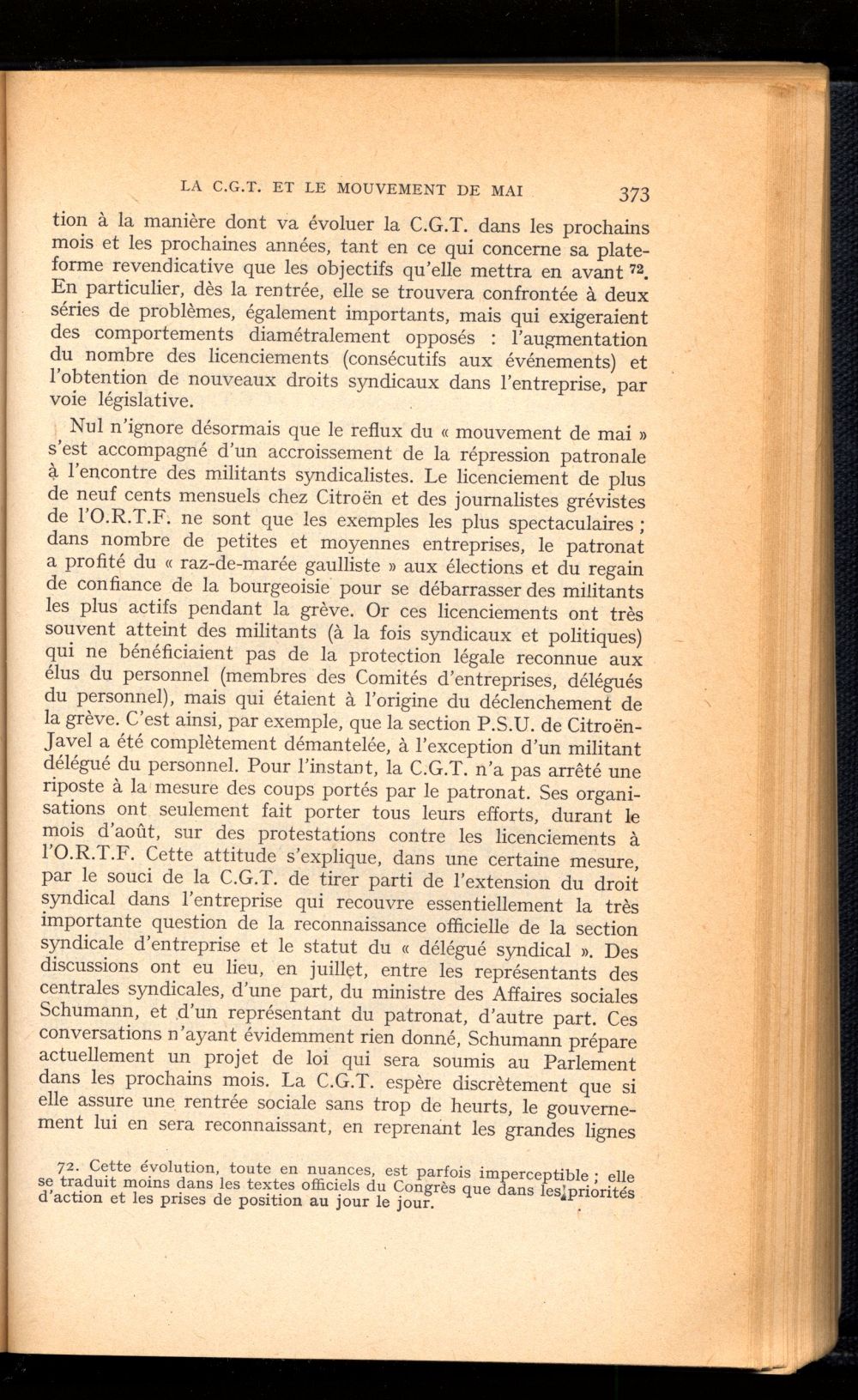

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI 373
tion à la manière dont va évoluer la C.G.T. dans les prochains
mois et les prochaines années, tant en ce qui concerne sa plate-
forme revendicative que les objectifs qu'elle mettra en avant72.
En particulier, dès la rentrée, elle se trouvera confrontée à deux
séries de problèmes, également importants, mais qui exigeraient
des comportements diamétralement opposés : l'augmentation
du nombre des licenciements (consécutifs aux événements) et
l'obtention de nouveaux droits syndicaux dans l'entreprise, par
voie législative.
mois et les prochaines années, tant en ce qui concerne sa plate-
forme revendicative que les objectifs qu'elle mettra en avant72.
En particulier, dès la rentrée, elle se trouvera confrontée à deux
séries de problèmes, également importants, mais qui exigeraient
des comportements diamétralement opposés : l'augmentation
du nombre des licenciements (consécutifs aux événements) et
l'obtention de nouveaux droits syndicaux dans l'entreprise, par
voie législative.
Nul n'ignore désormais que le reflux du « mouvement de mai »
s'est accompagné d'un accroissement de la répression patronale
à l'encontre des militants syndicalistes. Le licenciement de plus
de neuf cents mensuels chez Citroën et des journalistes grévistes
de l'O.R.T.F. ne sont que les exemples les plus spectaculaires ;
dans nombre de petites et moyennes entreprises, le patronat
a profité du « raz-de-marée gaulliste » aux élections et du regain
de confiance de la bourgeoisie pour se débarrasser des militants
les plus actifs pendant la grève. Or ces licenciements ont très
souvent atteint des militants (à la fois syndicaux et politiques)
qui ne bénéficiaient pas de la protection légale reconnue aux
élus du personnel (membres des Comités d'entreprises, délégués
du personnel), mais qui étaient à l'origine du déclenchement de
la grève. C'est ainsi, par exemple, que la section P.S.U. de Citroën-
Javel a été complètement démantelée, à l'exception d'un militant
délégué du personnel. Pour l'instant, la C.G.T. n'a pas arrêté une
riposte à la mesure des coups portés par le patronat. Ses organi-
sations ont seulement fait porter tous leurs efforts, durant le
mois d'août, sur des protestations contre les licenciements à
l'O.R.T.F. Cette attitude s'explique, dans une certaine mesure,
par le souci de la C.G.T. de tirer parti de l'extension du droit
syndical dans l'entreprise qui recouvre essentiellement la très
importante question de la reconnaissance officielle de la section
syndicale d'entreprise et le statut du « délégué syndical ». Des
discussions ont eu lieu, en juillet, entre les représentants des
centrales syndicales, d'une part, du ministre des Affaires sociales
Schumann, et d'un représentant du patronat, d'autre part. Ces
conversations n 'ayant évidemment rien donné, Schumann prépare
actuellement un projet de loi qui sera soumis au Parlement
dans les prochains mois. La C.G.T. espère discrètement que si
elle assure une rentrée sociale sans trop de heurts, le gouverne-
ment lui en sera reconnaissant, en reprenant les grandes lignes
s'est accompagné d'un accroissement de la répression patronale
à l'encontre des militants syndicalistes. Le licenciement de plus
de neuf cents mensuels chez Citroën et des journalistes grévistes
de l'O.R.T.F. ne sont que les exemples les plus spectaculaires ;
dans nombre de petites et moyennes entreprises, le patronat
a profité du « raz-de-marée gaulliste » aux élections et du regain
de confiance de la bourgeoisie pour se débarrasser des militants
les plus actifs pendant la grève. Or ces licenciements ont très
souvent atteint des militants (à la fois syndicaux et politiques)
qui ne bénéficiaient pas de la protection légale reconnue aux
élus du personnel (membres des Comités d'entreprises, délégués
du personnel), mais qui étaient à l'origine du déclenchement de
la grève. C'est ainsi, par exemple, que la section P.S.U. de Citroën-
Javel a été complètement démantelée, à l'exception d'un militant
délégué du personnel. Pour l'instant, la C.G.T. n'a pas arrêté une
riposte à la mesure des coups portés par le patronat. Ses organi-
sations ont seulement fait porter tous leurs efforts, durant le
mois d'août, sur des protestations contre les licenciements à
l'O.R.T.F. Cette attitude s'explique, dans une certaine mesure,
par le souci de la C.G.T. de tirer parti de l'extension du droit
syndical dans l'entreprise qui recouvre essentiellement la très
importante question de la reconnaissance officielle de la section
syndicale d'entreprise et le statut du « délégué syndical ». Des
discussions ont eu lieu, en juillet, entre les représentants des
centrales syndicales, d'une part, du ministre des Affaires sociales
Schumann, et d'un représentant du patronat, d'autre part. Ces
conversations n 'ayant évidemment rien donné, Schumann prépare
actuellement un projet de loi qui sera soumis au Parlement
dans les prochains mois. La C.G.T. espère discrètement que si
elle assure une rentrée sociale sans trop de heurts, le gouverne-
ment lui en sera reconnaissant, en reprenant les grandes lignes
72. Cette évolution, toute en nuances, est parfois imperceptible ; elle
se traduit moins dans les textes officiels du Congrès que dans les^priorités
d'action et les prises de position au jour le jour.
se traduit moins dans les textes officiels du Congrès que dans les^priorités
d'action et les prises de position au jour le jour.
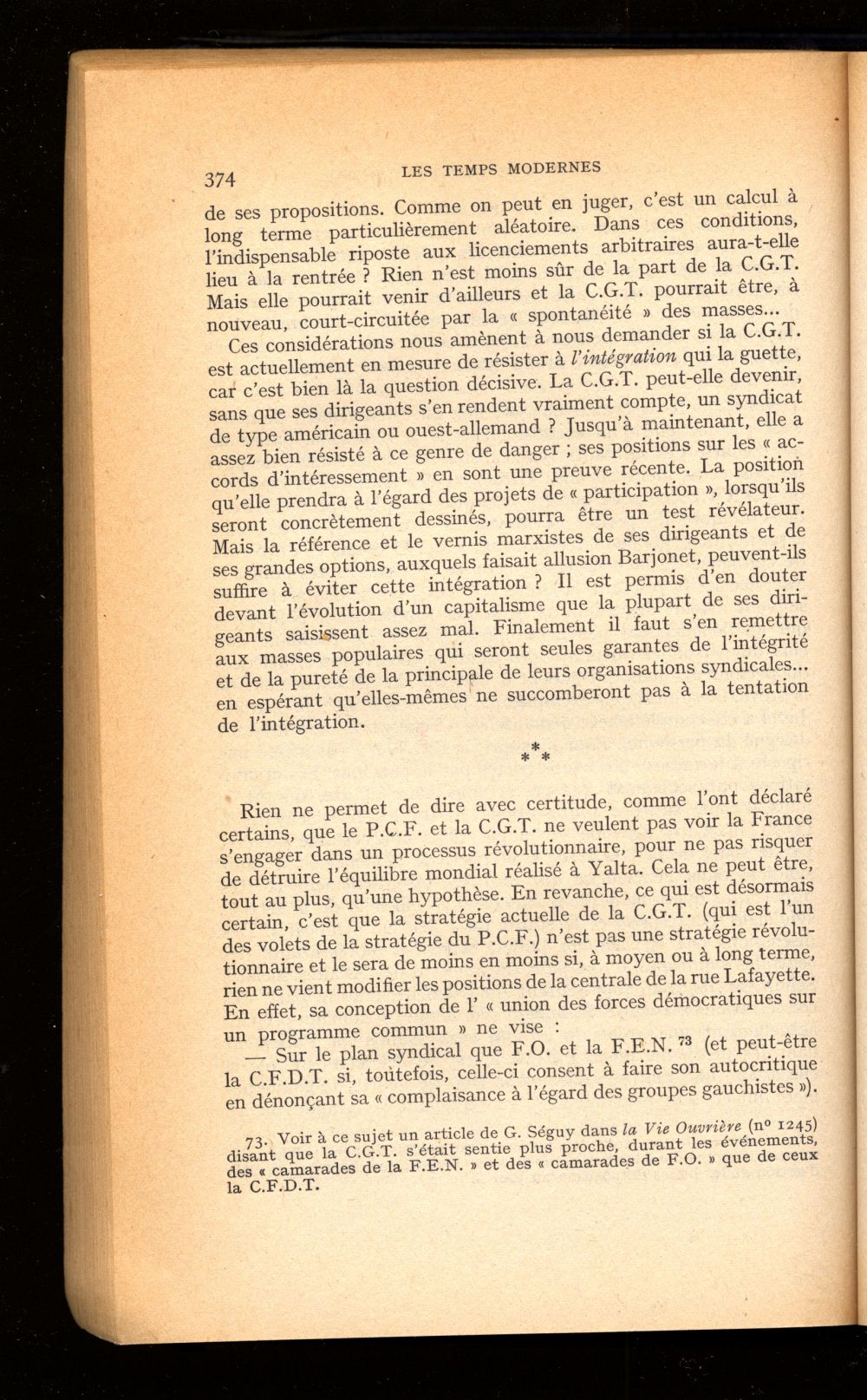

374
LES TEMPS MODERNES
de ses propositions. Comme on peut en juger, c'est un calcul à
long terme particulièrement aléatoire. Dans ces conditions,
l'indispensable riposte aux licenciements arbitraires aura-t-elle
lieu à la rentrée ? Rien n'est moins sûr de la part de la C.G.T.
Mais elle pourrait venir d'ailleurs et la C.G.T. pourrait être, à
nouveau, court-circuitée par la « spontanéité » des masses...
long terme particulièrement aléatoire. Dans ces conditions,
l'indispensable riposte aux licenciements arbitraires aura-t-elle
lieu à la rentrée ? Rien n'est moins sûr de la part de la C.G.T.
Mais elle pourrait venir d'ailleurs et la C.G.T. pourrait être, à
nouveau, court-circuitée par la « spontanéité » des masses...
Ces considérations nous amènent à nous demander si la C.G.T.
est actuellement en mesure de résister à l'intégration qui la guette,
car c'est bien là la question décisive. La C.G.T. peut-elle devenir,
sans que ses dirigeants s'en rendent vraiment compte, un syndicat
de type américain ou ouest-allemand ? Jusqu'à maintenant, elle a
assez bien résisté à ce genre de danger ; ses positions sur les « ac-
cords d'intéressement » en sont une preuve récente. La position
qu'elle prendra à l'égard des projets de « participation », lorsqu'ils
seront concrètement dessinés, pourra être un test révélateur.
Mais la référence et le vernis marxistes de ses dirigeants et de
ses grandes options, auxquels faisait allusion Barjonet, peuvent-ils
suffire à éviter cette intégration ? Il est permis d'en douter
devant l'évolution d'un capitalisme que la plupart de ses diri-
geants saisissent assez mal. Finalement il faut s'en remettre
aux masses populaires qui seront seules garantes de l'intégrité
et de la pureté de la principale de leurs organisations syndicales...
en espérant qu'elles-mêmes ne succomberont pas à la tentation
de l'intégration.
est actuellement en mesure de résister à l'intégration qui la guette,
car c'est bien là la question décisive. La C.G.T. peut-elle devenir,
sans que ses dirigeants s'en rendent vraiment compte, un syndicat
de type américain ou ouest-allemand ? Jusqu'à maintenant, elle a
assez bien résisté à ce genre de danger ; ses positions sur les « ac-
cords d'intéressement » en sont une preuve récente. La position
qu'elle prendra à l'égard des projets de « participation », lorsqu'ils
seront concrètement dessinés, pourra être un test révélateur.
Mais la référence et le vernis marxistes de ses dirigeants et de
ses grandes options, auxquels faisait allusion Barjonet, peuvent-ils
suffire à éviter cette intégration ? Il est permis d'en douter
devant l'évolution d'un capitalisme que la plupart de ses diri-
geants saisissent assez mal. Finalement il faut s'en remettre
aux masses populaires qui seront seules garantes de l'intégrité
et de la pureté de la principale de leurs organisations syndicales...
en espérant qu'elles-mêmes ne succomberont pas à la tentation
de l'intégration.
*
* *
Rien ne permet de dire avec certitude, comme l'ont déclaré
certains, que le P.C.F. et la C.G.T. ne veulent pas voir la France
s'engager dans un processus révolutionnaire, pour ne pas risquer
de détruire l'équilibre mondial réalisé à Yalta. Cela ne peut être,
tout au plus, qu'une hypothèse. En revanche, ce qui est désormais
certain, c'est que la stratégie actuelle de la C.G.T. (qui est l'un
des volets de la stratégie du P.C.F.) n'est pas une stratégie révolu-
tionnaire et le sera de moins en moins si, à moyen ou à long terme,
rien ne vient modifier les positions de la centrale de la rue Lafayette.
En effet, sa conception de 1' « union des forces démocratiques sur
un programme commun » ne vise :
certains, que le P.C.F. et la C.G.T. ne veulent pas voir la France
s'engager dans un processus révolutionnaire, pour ne pas risquer
de détruire l'équilibre mondial réalisé à Yalta. Cela ne peut être,
tout au plus, qu'une hypothèse. En revanche, ce qui est désormais
certain, c'est que la stratégie actuelle de la C.G.T. (qui est l'un
des volets de la stratégie du P.C.F.) n'est pas une stratégie révolu-
tionnaire et le sera de moins en moins si, à moyen ou à long terme,
rien ne vient modifier les positions de la centrale de la rue Lafayette.
En effet, sa conception de 1' « union des forces démocratiques sur
un programme commun » ne vise :
— Sur le plan syndical que F.O. et la F.E.N.73 (et peut-être
la C.F.D.T. si, totitefois, celle-ci consent à faire son autocritique
en dénonçant sa « complaisance à l'égard des groupes gauchistes »).
la C.F.D.T. si, totitefois, celle-ci consent à faire son autocritique
en dénonçant sa « complaisance à l'égard des groupes gauchistes »).
73. Voir à ce sujet un article de G. Séguy dans la Vie Ouvrière (n° 1245)
disant que la C.G.T. s'était sentie plus proche, durant les événements,
des « camarades de la F.E.N. » et des « camarades de F.O. » que de ceux
la C.F.D.T.
disant que la C.G.T. s'était sentie plus proche, durant les événements,
des « camarades de la F.E.N. » et des « camarades de F.O. » que de ceux
la C.F.D.T.
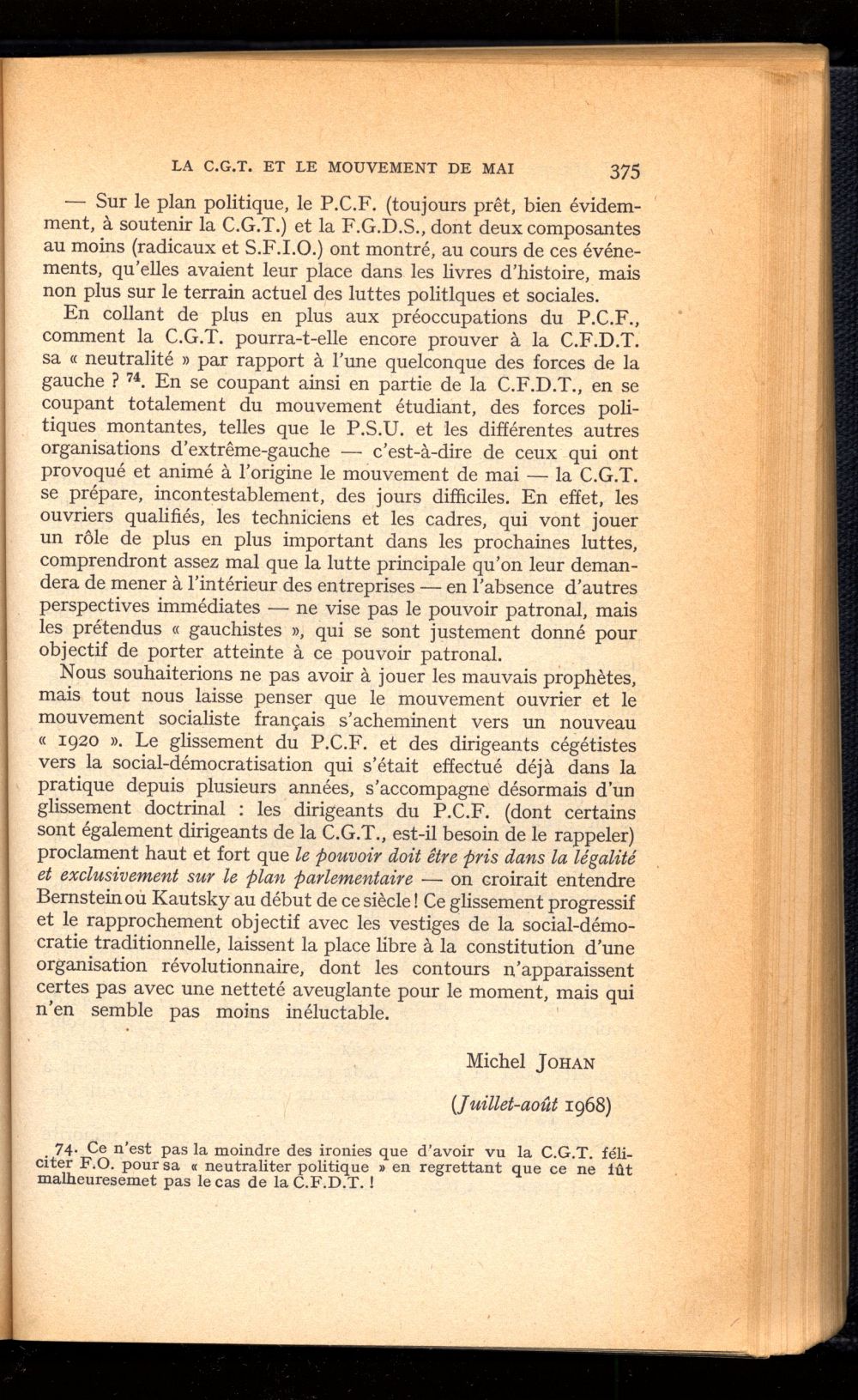

LA C.G.T. ET LE MOUVEMENT DE MAI
375
— Sur le plan politique, le P.C.F. (toujours prêt, bien évidem-
ment, à soutenir la C.G.T.) et la F.G.D.S., dont deux composantes
au moins (radicaux et S.F.I.O.) ont montré, au cours de ces événe-
ments, qu'elles avaient leur place dans les livres d'histoire, mais
non plus sur le terrain actuel des luttes politiques et sociales.
ment, à soutenir la C.G.T.) et la F.G.D.S., dont deux composantes
au moins (radicaux et S.F.I.O.) ont montré, au cours de ces événe-
ments, qu'elles avaient leur place dans les livres d'histoire, mais
non plus sur le terrain actuel des luttes politiques et sociales.
En collant de plus en plus aux préoccupations du P.C.F.,
comment la C.G.T. pourra-t-elle encore prouver à la C.F.D.T.
sa « neutralité » par rapport à l'une quelconque des forces de la
gauche ? 74. En se coupant ainsi en partie de la C.F.D.T., en se
coupant totalement du mouvement étudiant, des forces poli-
tiques montantes, telles que le P.S.U. et les différentes autres
organisations d'extrême-gauche — c'est-à-dire de ceux qui ont
provoqué et animé à l'origine le mouvement de mai — la C.G.T.
se prépare, incontestablement, des jours difficiles. En effet, les
ouvriers qualifiés, les techniciens et les cadres, qui vont jouer
un rôle de plus en plus important dans les prochaines luttes,
comprendront assez mal que la lutte principale qu'on leur deman-
dera de mener à l'intérieur des entreprises — en l'absence d'autres
perspectives immédiates — ne vise pas le pouvoir patronal, mais
les prétendus « gauchistes », qui se sont justement donné pour
objectif de porter atteinte à ce pouvoir patronal.
comment la C.G.T. pourra-t-elle encore prouver à la C.F.D.T.
sa « neutralité » par rapport à l'une quelconque des forces de la
gauche ? 74. En se coupant ainsi en partie de la C.F.D.T., en se
coupant totalement du mouvement étudiant, des forces poli-
tiques montantes, telles que le P.S.U. et les différentes autres
organisations d'extrême-gauche — c'est-à-dire de ceux qui ont
provoqué et animé à l'origine le mouvement de mai — la C.G.T.
se prépare, incontestablement, des jours difficiles. En effet, les
ouvriers qualifiés, les techniciens et les cadres, qui vont jouer
un rôle de plus en plus important dans les prochaines luttes,
comprendront assez mal que la lutte principale qu'on leur deman-
dera de mener à l'intérieur des entreprises — en l'absence d'autres
perspectives immédiates — ne vise pas le pouvoir patronal, mais
les prétendus « gauchistes », qui se sont justement donné pour
objectif de porter atteinte à ce pouvoir patronal.
Nous souhaiterions ne pas avoir à jouer les mauvais prophètes,
mais tout nous laisse penser que le mouvement ouvrier et le
mouvement socialiste français s'acheminent vers un nouveau
« 1920 ». Le glissement du P.C.F. et des dirigeants cégétistes
vers la social-démocratisation qui s'était effectué déjà dans la
pratique depuis plusieurs années, s'accompagne désormais d'un
glissement doctrinal : les dirigeants du P.C.F. (dont certains
sont également dirigeants de la C.G.T., est-il besoin de le rappeler)
proclament haut et fort que le pouvoir doit être pris dans la légalité
et exclusivement sur le plan parlementaire —• on croirait entendre
Bernstein ou Kautsky au début de ce siècle ! Ce glissement progressif
et le rapprochement objectif avec les vestiges de la social-démo-
cratie traditionnelle, laissent la place libre à la constitution d'une
organisation révolutionnaire, dont les contours n'apparaissent
certes pas avec une netteté aveuglante pour le moment, mais qui
n'en semble pas moins inéluctable.
mais tout nous laisse penser que le mouvement ouvrier et le
mouvement socialiste français s'acheminent vers un nouveau
« 1920 ». Le glissement du P.C.F. et des dirigeants cégétistes
vers la social-démocratisation qui s'était effectué déjà dans la
pratique depuis plusieurs années, s'accompagne désormais d'un
glissement doctrinal : les dirigeants du P.C.F. (dont certains
sont également dirigeants de la C.G.T., est-il besoin de le rappeler)
proclament haut et fort que le pouvoir doit être pris dans la légalité
et exclusivement sur le plan parlementaire —• on croirait entendre
Bernstein ou Kautsky au début de ce siècle ! Ce glissement progressif
et le rapprochement objectif avec les vestiges de la social-démo-
cratie traditionnelle, laissent la place libre à la constitution d'une
organisation révolutionnaire, dont les contours n'apparaissent
certes pas avec une netteté aveuglante pour le moment, mais qui
n'en semble pas moins inéluctable.
Michel JOHAN
(Juillet-août 1968)
(Juillet-août 1968)
74. Ce n'est pas la moindre des ironies que d'avoir vu la C.G.T. féli-
citer F.O. pour sa « neutraliter politique » en regrettant que ce ne lût
malheuresemet pas le cas de la C.F.D.T. !
citer F.O. pour sa « neutraliter politique » en regrettant que ce ne lût
malheuresemet pas le cas de la C.F.D.T. !
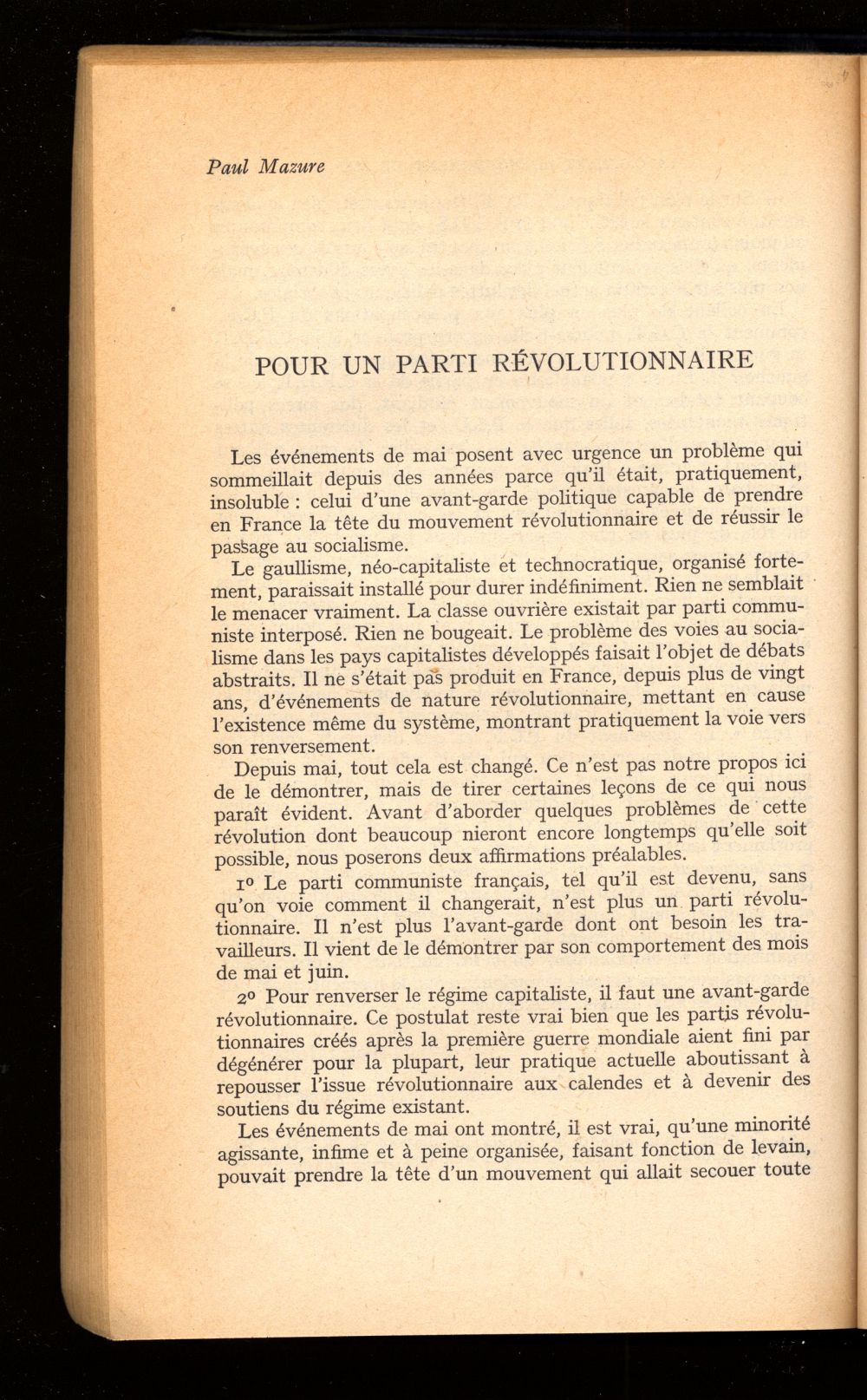

Paul Mazure
POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE
Les événements de mai posent avec urgence un problème qui
sommeillait depuis des années parce qu'il était, pratiquement,
insoluble : celui d'une avant-garde politique capable de prendre
en France la tête du mouvement révolutionnaire et de réussir le
passage au socialisme.
sommeillait depuis des années parce qu'il était, pratiquement,
insoluble : celui d'une avant-garde politique capable de prendre
en France la tête du mouvement révolutionnaire et de réussir le
passage au socialisme.
Le gaullisme, néo-capitaliste et technocratique, organisé forte-
ment, paraissait installé pour durer indéfiniment. Rien ne semblait
le menacer vraiment. La classe ouvrière existait par parti commu-
niste interposé. Rien ne bougeait. Le problème des voies au socia-
lisme dans les pays capitalistes développés faisait l'objet de débats
abstraits. Il ne s'était pas produit en France, depuis plus de vingt
ans, d'événements de nature révolutionnaire, mettant en cause
l'existence même du système, montrant pratiquement la voie vers
son renversement.
ment, paraissait installé pour durer indéfiniment. Rien ne semblait
le menacer vraiment. La classe ouvrière existait par parti commu-
niste interposé. Rien ne bougeait. Le problème des voies au socia-
lisme dans les pays capitalistes développés faisait l'objet de débats
abstraits. Il ne s'était pas produit en France, depuis plus de vingt
ans, d'événements de nature révolutionnaire, mettant en cause
l'existence même du système, montrant pratiquement la voie vers
son renversement.
Depuis mai, tout cela est changé. Ce n'est pas notre propos ici
de le démontrer, mais de tirer certaines leçons de ce qui nous
paraît évident. Avant d'aborder quelques problèmes de cette
révolution dont beaucoup nieront encore longtemps qu'elle soit
possible, nous poserons deux affirmations préalables.
de le démontrer, mais de tirer certaines leçons de ce qui nous
paraît évident. Avant d'aborder quelques problèmes de cette
révolution dont beaucoup nieront encore longtemps qu'elle soit
possible, nous poserons deux affirmations préalables.
i° Le parti communiste français, tel qu'il est devenu, sans
qu'on voie comment il changerait, n'est plus un parti révolu-
tionnaire. Il n'est plus l'avant-garde dont ont besoin les tra-
vailleurs. Il vient de le démontrer par son comportement des mois
de mai et juin.
qu'on voie comment il changerait, n'est plus un parti révolu-
tionnaire. Il n'est plus l'avant-garde dont ont besoin les tra-
vailleurs. Il vient de le démontrer par son comportement des mois
de mai et juin.
2° Pour renverser le régime capitaliste, il faut une avant-garde
révolutionnaire. Ce postulat reste vrai bien que les partis révolu-
tionnaires créés après la première guerre mondiale aient fini par
dégénérer pour la plupart, leur pratique actuelle aboutissant à
repousser l'issue révolutionnaire aux calendes et à devenir des
soutiens du régime existant.
révolutionnaire. Ce postulat reste vrai bien que les partis révolu-
tionnaires créés après la première guerre mondiale aient fini par
dégénérer pour la plupart, leur pratique actuelle aboutissant à
repousser l'issue révolutionnaire aux calendes et à devenir des
soutiens du régime existant.
Les événements de mai ont montré, il est vrai, qu'une minorité
agissante, infime et à peine organisée, faisant fonction de levain,
pouvait prendre la tête d'un mouvement qui allait secouer toute
agissante, infime et à peine organisée, faisant fonction de levain,
pouvait prendre la tête d'un mouvement qui allait secouer toute
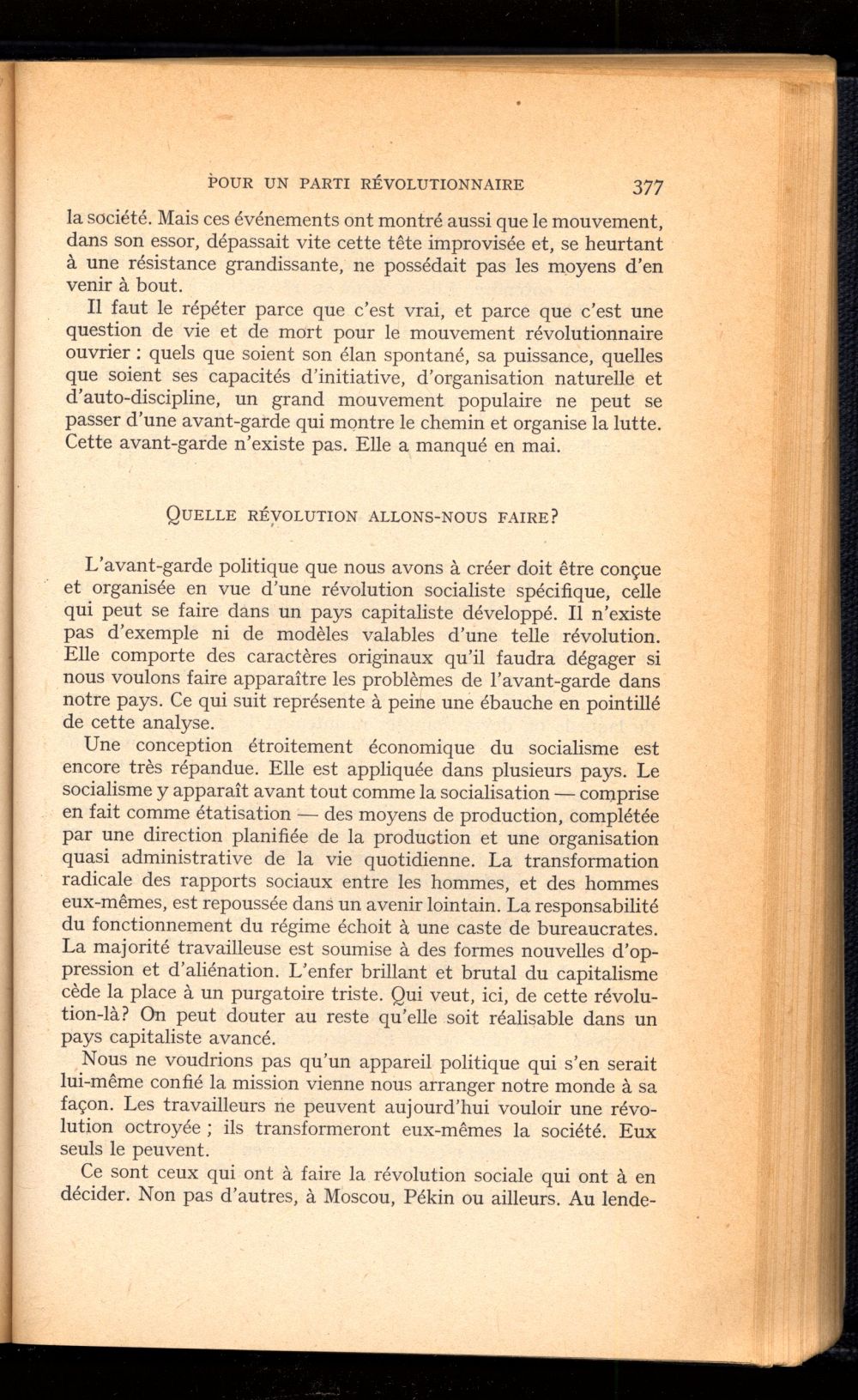

POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE
377
la société. Mais ces événements ont montré aussi que le mouvement,
dans son essor, dépassait vite cette tête improvisée et, se heurtant
à une résistance grandissante, ne possédait pas les moyens d'en
venir à bout.
dans son essor, dépassait vite cette tête improvisée et, se heurtant
à une résistance grandissante, ne possédait pas les moyens d'en
venir à bout.
Il faut le répéter parce que c'est vrai, et parce que c'est une
question de vie et de mort pour le mouvement révolutionnaire
ouvrier : quels que soient son clan spontané, sa puissance, quelles
que soient ses capacités d'initiative, d'organisation naturelle et
d'auto-discipline, un grand mouvement populaire ne peut se
passer d'une avant-garde qui montre le chemin et organise la lutte.
Cette avant-garde n'existe pas. Elle a manqué en mai.
question de vie et de mort pour le mouvement révolutionnaire
ouvrier : quels que soient son clan spontané, sa puissance, quelles
que soient ses capacités d'initiative, d'organisation naturelle et
d'auto-discipline, un grand mouvement populaire ne peut se
passer d'une avant-garde qui montre le chemin et organise la lutte.
Cette avant-garde n'existe pas. Elle a manqué en mai.
QUELLE RÉVOLUTION ALLONS-NOUS FAIRE?
L'avant-garde politique que nous avons à créer doit être conçue
et organisée en vue d'une révolution socialiste spécifique, celle
qui peut se faire dans un pays capitaliste développé. Il n'existe
pas d'exemple ni de modèles valables d'une telle révolution.
Elle comporte des caractères originaux qu'il faudra dégager si
nous voulons faire apparaître les problèmes de l'avant-garde dans
notre pays. Ce qui suit représente à peine une ébauche en pointillé
de cette analyse.
et organisée en vue d'une révolution socialiste spécifique, celle
qui peut se faire dans un pays capitaliste développé. Il n'existe
pas d'exemple ni de modèles valables d'une telle révolution.
Elle comporte des caractères originaux qu'il faudra dégager si
nous voulons faire apparaître les problèmes de l'avant-garde dans
notre pays. Ce qui suit représente à peine une ébauche en pointillé
de cette analyse.
Une conception étroitement économique du socialisme est
encore très répandue. Elle est appliquée dans plusieurs pays. Le
socialisme y apparaît avant tout comme la socialisation — comprise
en fait comme étatisation — des moyens de production, complétée
par une direction planifiée de la production et une organisation
quasi administrative de la vie quotidienne. La transformation
radicale des rapports sociaux entre les hommes, et des hommes
eux-mêmes, est repoussée dans un avenir lointain. La responsabilité
du fonctionnement du régime échoit à une caste de bureaucrates.
La majorité travailleuse est soumise à des formes nouvelles d'op-
pression et d'aliénation. L'enfer brillant et brutal du capitalisme
cède la place à un purgatoire triste. Qui veut, ici, de cette révolu-
tion-là? On peut douter au reste qu'elle soit réalisable dans un
pays capitaliste avancé.
encore très répandue. Elle est appliquée dans plusieurs pays. Le
socialisme y apparaît avant tout comme la socialisation — comprise
en fait comme étatisation — des moyens de production, complétée
par une direction planifiée de la production et une organisation
quasi administrative de la vie quotidienne. La transformation
radicale des rapports sociaux entre les hommes, et des hommes
eux-mêmes, est repoussée dans un avenir lointain. La responsabilité
du fonctionnement du régime échoit à une caste de bureaucrates.
La majorité travailleuse est soumise à des formes nouvelles d'op-
pression et d'aliénation. L'enfer brillant et brutal du capitalisme
cède la place à un purgatoire triste. Qui veut, ici, de cette révolu-
tion-là? On peut douter au reste qu'elle soit réalisable dans un
pays capitaliste avancé.
Nous ne voudrions pas qu'un appareil politique qui s'en serait
lui-même confié la mission vienne nous arranger notre monde à sa
façon. Les travailleurs ne peuvent aujourd'hui vouloir une révo-
lution octroyée ; ils transformeront eux-mêmes la société. Eux
seuls le peuvent.
lui-même confié la mission vienne nous arranger notre monde à sa
façon. Les travailleurs ne peuvent aujourd'hui vouloir une révo-
lution octroyée ; ils transformeront eux-mêmes la société. Eux
seuls le peuvent.
Ce sont ceux qui ont à faire la révolution sociale qui ont à en
décider. Non pas d'autres, à Moscou, Pékin ou ailleurs. Au lende-
décider. Non pas d'autres, à Moscou, Pékin ou ailleurs. Au lende-
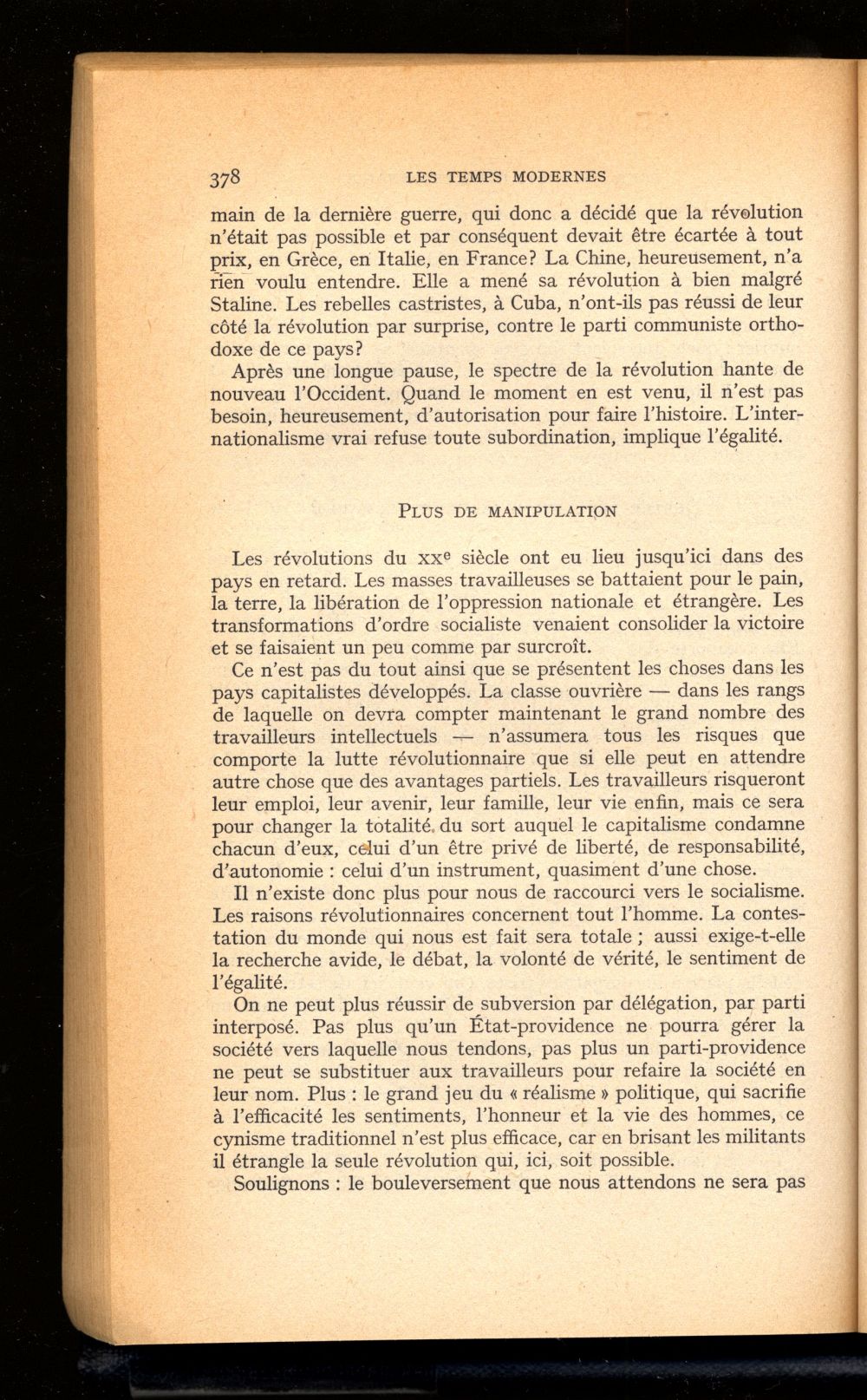

378
LES TEMPS MODERNES
main de la dernière guerre, qui donc a décidé que la révolution
n'était pas possible et par conséquent devait être écartée à tout
prix, en Grèce, en Italie, en France? La Chine, heureusement, n'a
rien voulu entendre. Elle a mené sa révolution à bien malgré
Staline. Les rebelles castristes, à Cuba, n'ont-ils pas réussi de leur
côté la révolution par surprise, contre le parti communiste ortho-
doxe de ce pays?
n'était pas possible et par conséquent devait être écartée à tout
prix, en Grèce, en Italie, en France? La Chine, heureusement, n'a
rien voulu entendre. Elle a mené sa révolution à bien malgré
Staline. Les rebelles castristes, à Cuba, n'ont-ils pas réussi de leur
côté la révolution par surprise, contre le parti communiste ortho-
doxe de ce pays?
Après une longue pause, le spectre de la révolution hante de
nouveau l'Occident. Quand le moment en est venu, il n'est pas
besoin, heureusement, d'autorisation pour faire l'histoire. L'inter-
nationalisme vrai refuse toute subordination, implique l'égalité.
nouveau l'Occident. Quand le moment en est venu, il n'est pas
besoin, heureusement, d'autorisation pour faire l'histoire. L'inter-
nationalisme vrai refuse toute subordination, implique l'égalité.
PLUS DE MANIPULATION
Les révolutions du xx° siècle ont eu lieu jusqu'ici dans des
pays en retard. Les masses travailleuses se battaient pour le pain,
la terre, la libération de l'oppression nationale et étrangère. Les
transformations d'ordre socialiste venaient consolider la victoire
et se faisaient un peu comme par surcroît.
pays en retard. Les masses travailleuses se battaient pour le pain,
la terre, la libération de l'oppression nationale et étrangère. Les
transformations d'ordre socialiste venaient consolider la victoire
et se faisaient un peu comme par surcroît.
Ce n'est pas du tout ainsi que se présentent les choses dans les
pays capitalistes développés. La classe ouvrière — dans les rangs
de laquelle on devra compter maintenant le grand nombre des
travailleurs intellectuels — n'assumera tous les risques que
comporte la lutte révolutionnaire que si elle peut en attendre
autre chose que des avantages partiels. Les travailleurs risqueront
leur emploi, leur avenir, leur famille, leur vie enfin, mais ce sera
pour changer la totalité du sort auquel le capitalisme condamne
chacun d'eux, celui d'un être privé de liberté, de responsabilité,
d'autonomie : celui d'un instrument, quasiment d'une chose.
pays capitalistes développés. La classe ouvrière — dans les rangs
de laquelle on devra compter maintenant le grand nombre des
travailleurs intellectuels — n'assumera tous les risques que
comporte la lutte révolutionnaire que si elle peut en attendre
autre chose que des avantages partiels. Les travailleurs risqueront
leur emploi, leur avenir, leur famille, leur vie enfin, mais ce sera
pour changer la totalité du sort auquel le capitalisme condamne
chacun d'eux, celui d'un être privé de liberté, de responsabilité,
d'autonomie : celui d'un instrument, quasiment d'une chose.
Il n'existe donc plus pour nous de raccourci vers le socialisme.
Les raisons révolutionnaires concernent tout l'homme. La contes-
tation du monde qui nous est fait sera totale ; aussi exige-t-elle
la recherche avide, le débat, la volonté de vérité, le sentiment de
l'égalité.
Les raisons révolutionnaires concernent tout l'homme. La contes-
tation du monde qui nous est fait sera totale ; aussi exige-t-elle
la recherche avide, le débat, la volonté de vérité, le sentiment de
l'égalité.
On ne peut plus réussir de subversion par délégation, par parti
interposé. Pas plus qu'un État-providence ne pourra gérer la
société vers laquelle nous tendons, pas plus un parti-providence
ne peut se substituer aux travailleurs pour refaire la société en
leur nom. Plus : le grand jeu du « réalisme » politique, qui sacrifie
à l'efficacité les sentiments, l'honneur et la vie des hommes, ce
cynisme traditionnel n'est plus efficace, car en brisant les militants
il étrangle la seule révolution qui, ici, soit possible.
interposé. Pas plus qu'un État-providence ne pourra gérer la
société vers laquelle nous tendons, pas plus un parti-providence
ne peut se substituer aux travailleurs pour refaire la société en
leur nom. Plus : le grand jeu du « réalisme » politique, qui sacrifie
à l'efficacité les sentiments, l'honneur et la vie des hommes, ce
cynisme traditionnel n'est plus efficace, car en brisant les militants
il étrangle la seule révolution qui, ici, soit possible.
Soulignons : le bouleversement que nous attendons ne sera pas
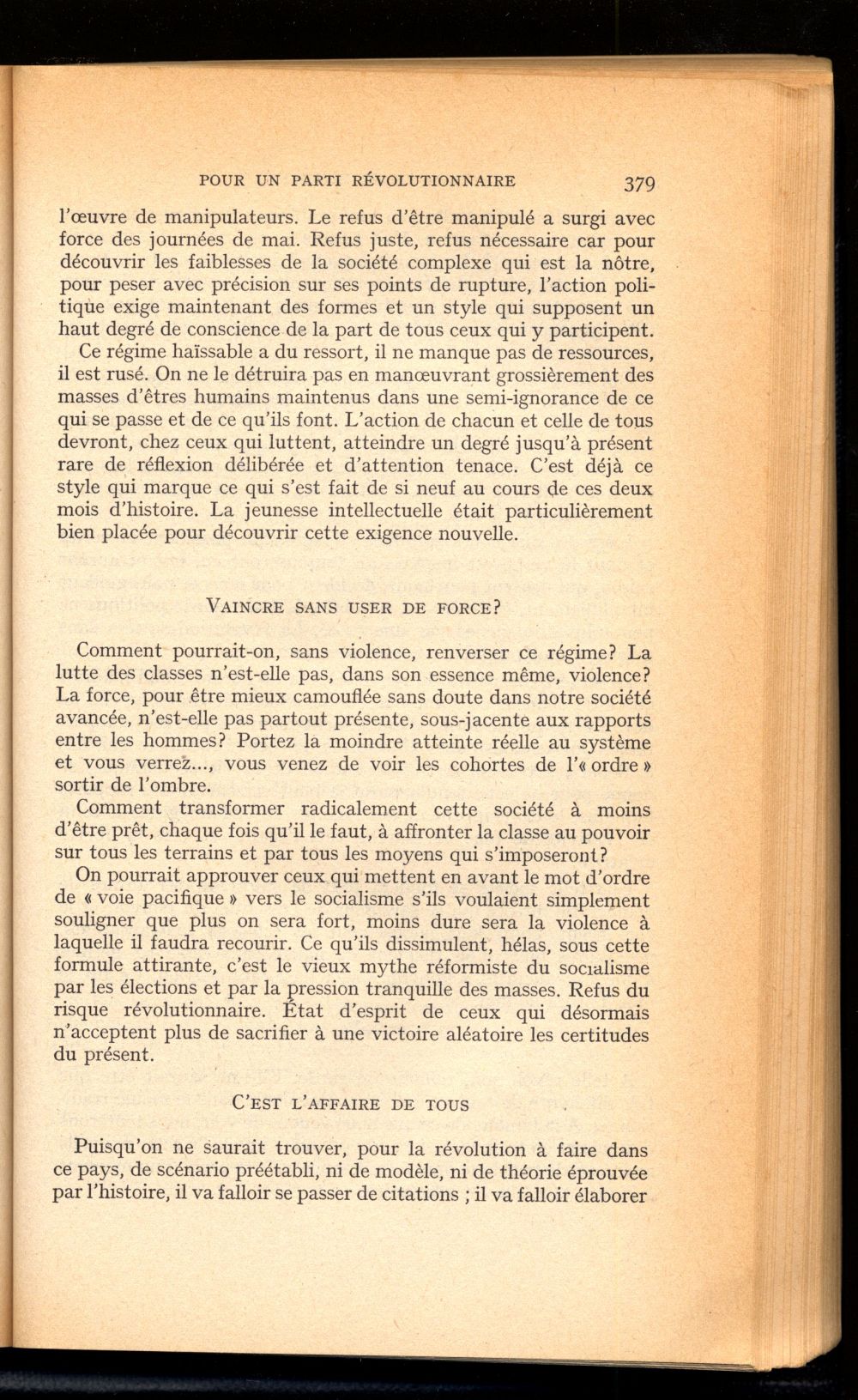

POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE
379
l'œuvre de manipulateurs. Le refus d'être manipulé a surgi avec
force des journées de mai. Refus juste, refus nécessaire car pour
découvrir les faiblesses de la société complexe qui est la nôtre,
pour peser avec précision sur ses points de rupture, l'action poli-
tique exige maintenant des formes et un style qui supposent un
haut degré de conscience de la part de tous ceux qui y participent.
Ce régime haïssable a du ressort, il ne manque pas de ressources,
il est rusé. On ne le détruira pas en manœuvrant grossièrement des
masses d'êtres humains maintenus dans une semi-ignorance de ce
qui se passe et de ce qu'ils font. L'action de chacun et celle de tous
devront, chez ceux qui luttent, atteindre un degré jusqu'à présent
rare de réflexion délibérée et d'attention tenace. C'est déjà ce
style qui marque ce qui s'est fait de si neuf au cours de ces deux
mois d'histoire. La jeunesse intellectuelle était particulièrement
bien placée pour découvrir cette exigence nouvelle.
force des journées de mai. Refus juste, refus nécessaire car pour
découvrir les faiblesses de la société complexe qui est la nôtre,
pour peser avec précision sur ses points de rupture, l'action poli-
tique exige maintenant des formes et un style qui supposent un
haut degré de conscience de la part de tous ceux qui y participent.
Ce régime haïssable a du ressort, il ne manque pas de ressources,
il est rusé. On ne le détruira pas en manœuvrant grossièrement des
masses d'êtres humains maintenus dans une semi-ignorance de ce
qui se passe et de ce qu'ils font. L'action de chacun et celle de tous
devront, chez ceux qui luttent, atteindre un degré jusqu'à présent
rare de réflexion délibérée et d'attention tenace. C'est déjà ce
style qui marque ce qui s'est fait de si neuf au cours de ces deux
mois d'histoire. La jeunesse intellectuelle était particulièrement
bien placée pour découvrir cette exigence nouvelle.
VAINCRE SANS USER DE FORCE?
Comment pourrait-on, sans violence, renverser ce régime? La
lutte des classes n'est-elle pas, dans son essence même, violence?
La force, pour être mieux camouflée sans doute dans notre société
avancée, n'est-elle pas partout présente, sous-jacente aux rapports
entre les hommes? Portez la moindre atteinte réelle au système
et vous verrez..., vous venez de voir les cohortes de l'« ordre »
sortir de l'ombre.
lutte des classes n'est-elle pas, dans son essence même, violence?
La force, pour être mieux camouflée sans doute dans notre société
avancée, n'est-elle pas partout présente, sous-jacente aux rapports
entre les hommes? Portez la moindre atteinte réelle au système
et vous verrez..., vous venez de voir les cohortes de l'« ordre »
sortir de l'ombre.
Comment transformer radicalement cette société à moins
d'être prêt, chaque fois qu'il le faut, à affronter la classe au pouvoir
sur tous les terrains et par tous les moyens qui s'imposeront?
d'être prêt, chaque fois qu'il le faut, à affronter la classe au pouvoir
sur tous les terrains et par tous les moyens qui s'imposeront?
On pourrait approuver ceux qui mettent en avant le mot d'ordre
de « voie pacifique » vers le socialisme s'ils voulaient simplement
souligner que plus on sera fort, moins dure sera la violence à
laquelle il faudra recourir. Ce qu'ils dissimulent, hélas, sous cette
formule attirante, c'est le vieux mythe réformiste du socialisme
par les élections et par la pression tranquille des masses. Refus du
risque révolutionnaire. État d'esprit de ceux qui désormais
n'acceptent plus de sacrifier à une victoire aléatoire les certitudes
du présent.
de « voie pacifique » vers le socialisme s'ils voulaient simplement
souligner que plus on sera fort, moins dure sera la violence à
laquelle il faudra recourir. Ce qu'ils dissimulent, hélas, sous cette
formule attirante, c'est le vieux mythe réformiste du socialisme
par les élections et par la pression tranquille des masses. Refus du
risque révolutionnaire. État d'esprit de ceux qui désormais
n'acceptent plus de sacrifier à une victoire aléatoire les certitudes
du présent.
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS
Puisqu'on ne saurait trouver, pour la révolution à faire dans
ce pays, de scénario préétabli, ni de modèle, ni de théorie éprouvée
par l'histoire, il va falloir se passer de citations ; il va falloir élaborer
ce pays, de scénario préétabli, ni de modèle, ni de théorie éprouvée
par l'histoire, il va falloir se passer de citations ; il va falloir élaborer
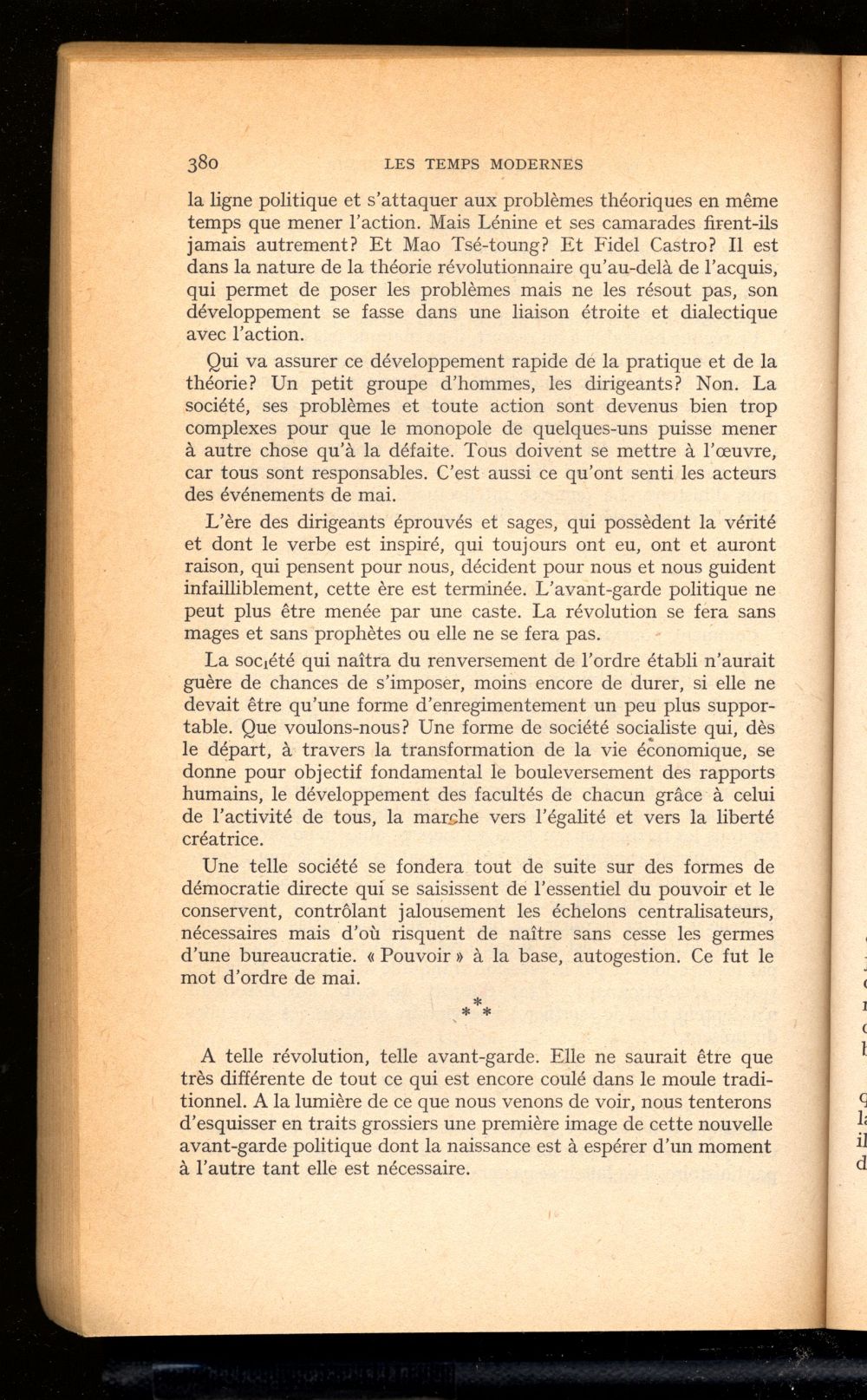

38o
LES TEMPS MODERNES
la ligne politique et s'attaquer aux problèmes théoriques en même
temps que mener l'action. Mais Lénine et ses camarades firent-ils
jamais autrement? Et Mao Tsé-toung? Et Eidel Castro? Il est
dans la nature de la théorie révolutionnaire qu'au-delà de l'acquis,
qui permet de poser les problèmes mais ne les résout pas, son
développement se fasse dans une liaison étroite et dialectique
avec l'action.
temps que mener l'action. Mais Lénine et ses camarades firent-ils
jamais autrement? Et Mao Tsé-toung? Et Eidel Castro? Il est
dans la nature de la théorie révolutionnaire qu'au-delà de l'acquis,
qui permet de poser les problèmes mais ne les résout pas, son
développement se fasse dans une liaison étroite et dialectique
avec l'action.
Qui va assurer ce développement rapide de la pratique et de la
théorie? Un petit groupe d'hommes, les dirigeants? Non. La
société, ses problèmes et toute action sont devenus bien trop
complexes pour que le monopole de quelques-uns puisse mener
à autre chose qu'à la défaite. Tous doivent se mettre à l'œuvre,
car tous sont responsables. C'est aussi ce qu'ont senti les acteurs
des événements de mai.
théorie? Un petit groupe d'hommes, les dirigeants? Non. La
société, ses problèmes et toute action sont devenus bien trop
complexes pour que le monopole de quelques-uns puisse mener
à autre chose qu'à la défaite. Tous doivent se mettre à l'œuvre,
car tous sont responsables. C'est aussi ce qu'ont senti les acteurs
des événements de mai.
L'ère des dirigeants éprouvés et sages, qui possèdent la vérité
et dont le verbe est inspiré, qui toujours ont eu, ont et auront
raison, qui pensent pour nous, décident pour nous et nous guident
infailliblement, cette ère est terminée. L'avant-garde politique ne
peut plus être menée par une caste. La révolution se fera sans
mages et sans prophètes ou elle ne se fera pas.
et dont le verbe est inspiré, qui toujours ont eu, ont et auront
raison, qui pensent pour nous, décident pour nous et nous guident
infailliblement, cette ère est terminée. L'avant-garde politique ne
peut plus être menée par une caste. La révolution se fera sans
mages et sans prophètes ou elle ne se fera pas.
La société qui naîtra du renversement de l'ordre établi n'aurait
guère de chances de s'imposer, moins encore de durer, si elle ne
devait être qu'une forme d'enregimentement un peu plus suppor-
table. Que voulons-nous? Une forme de société socialiste qui, dès
le départ, à travers la transformation de la vie économique, se
donne pour objectif fondamental le bouleversement des rapports
humains, le développement des facultés de chacun grâce à celui
de l'activité de tous, la marche vers l'égalité et vers la liberté
créatrice.
guère de chances de s'imposer, moins encore de durer, si elle ne
devait être qu'une forme d'enregimentement un peu plus suppor-
table. Que voulons-nous? Une forme de société socialiste qui, dès
le départ, à travers la transformation de la vie économique, se
donne pour objectif fondamental le bouleversement des rapports
humains, le développement des facultés de chacun grâce à celui
de l'activité de tous, la marche vers l'égalité et vers la liberté
créatrice.
Une telle société se fondera tout de suite sur des formes de
démocratie directe qui se saisissent de l'essentiel du pouvoir et le
conservent, contrôlant jalousement les échelons centralisateurs,
nécessaires mais d'où risquent de naître sans cesse les germes
d'une bureaucratie. « Pouvoir » à la base, autogestion. Ce fut le
mot d'ordre de mai.
démocratie directe qui se saisissent de l'essentiel du pouvoir et le
conservent, contrôlant jalousement les échelons centralisateurs,
nécessaires mais d'où risquent de naître sans cesse les germes
d'une bureaucratie. « Pouvoir » à la base, autogestion. Ce fut le
mot d'ordre de mai.
*
* *
* *
A telle révolution, telle avant-garde. Elle ne saurait être que
très différente de tout ce qui est encore coulé dans le moule tradi-
tionnel. A la lumière de ce que nous venons de voir, nous tenterons
d'esquisser en traits grossiers une première image de cette nouvelle
avant-garde politique dont la naissance est à espérer d'un moment
à l'autre tant elle est nécessaire.
très différente de tout ce qui est encore coulé dans le moule tradi-
tionnel. A la lumière de ce que nous venons de voir, nous tenterons
d'esquisser en traits grossiers une première image de cette nouvelle
avant-garde politique dont la naissance est à espérer d'un moment
à l'autre tant elle est nécessaire.
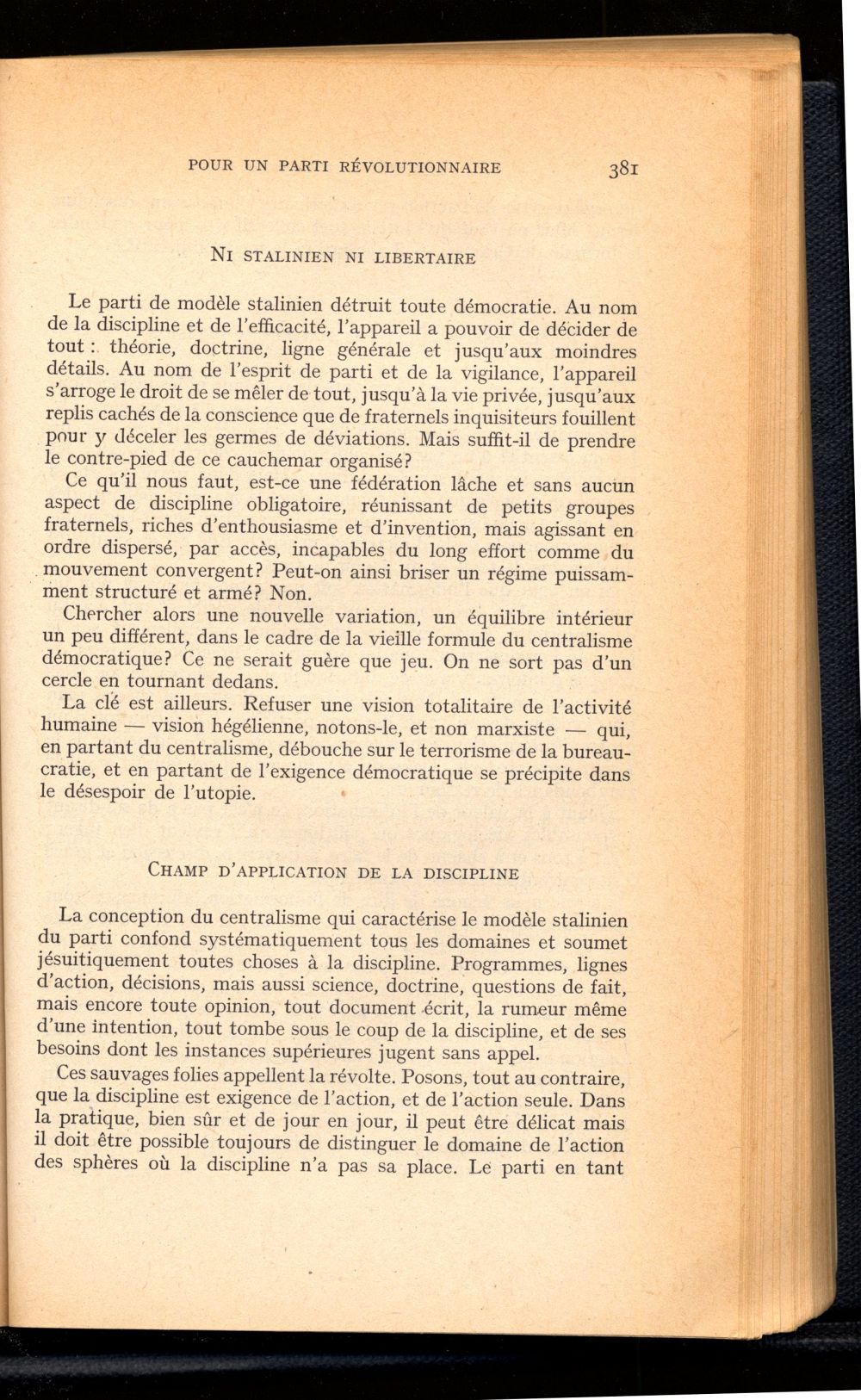

POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE
38i
Ni STALINIEN NI LIBERTAIRE
Le parti de modèle stalinien détruit toute démocratie. Au nom
de la discipline et de l'efficacité, l'appareil a pouvoir de décider de
tout : théorie, doctrine, ligne générale et jusqu'aux moindres
détails. Au nom de l'esprit de parti et de la vigilance, l'appareil
s'arroge le droit de se mêler de tout, jusqu'à la vie privée, jusqu'aux
replis cachés de la conscience que de fraternels inquisiteurs fouillent
pour y déceler les germes de déviations. Mais suffit-il de prendre
le contre-pied de ce cauchemar organisé?
de la discipline et de l'efficacité, l'appareil a pouvoir de décider de
tout : théorie, doctrine, ligne générale et jusqu'aux moindres
détails. Au nom de l'esprit de parti et de la vigilance, l'appareil
s'arroge le droit de se mêler de tout, jusqu'à la vie privée, jusqu'aux
replis cachés de la conscience que de fraternels inquisiteurs fouillent
pour y déceler les germes de déviations. Mais suffit-il de prendre
le contre-pied de ce cauchemar organisé?
Ce qu'il nous faut, est-ce une fédération lâche et sans aucun
aspect de discipline obligatoire, réunissant de petits groupes
fraternels, riches d'enthousiasme et d'invention, mais agissant en
ordre dispersé, par accès, incapables du long effort comme du
.mouvement convergent? Peut-on ainsi briser un régime puissam-
ment structuré et armé? Non.
aspect de discipline obligatoire, réunissant de petits groupes
fraternels, riches d'enthousiasme et d'invention, mais agissant en
ordre dispersé, par accès, incapables du long effort comme du
.mouvement convergent? Peut-on ainsi briser un régime puissam-
ment structuré et armé? Non.
Chercher alors une nouvelle variation, un équilibre intérieur
un peu différent, dans le cadre de la vieille formule du centralisme
démocratique? Ce ne serait guère que jeu. On ne sort pas d'un
cercle en tournant dedans.
un peu différent, dans le cadre de la vieille formule du centralisme
démocratique? Ce ne serait guère que jeu. On ne sort pas d'un
cercle en tournant dedans.
La clé est ailleurs. Refuser une vision totalitaire de l'activité
humaine — vision hégélienne, notons-le, et non marxiste — qui,
en partant du centralisme, débouche sur le terrorisme de la bureau-
cratie, et en partant de l'exigence démocratique se précipite dans
le désespoir de l'utopie.
humaine — vision hégélienne, notons-le, et non marxiste — qui,
en partant du centralisme, débouche sur le terrorisme de la bureau-
cratie, et en partant de l'exigence démocratique se précipite dans
le désespoir de l'utopie.
CHAMP D'APPLICATION DE LA DISCIPLINE
La conception du centralisme qui caractérise le modèle stalinien
du parti confond systématiquement tous les domaines et soumet
jésuitiquement toutes choses à la discipline. Programmes, lignes
d'action, décisions, mais aussi science, doctrine, questions de fait,
mais encore toute opinion, tout document écrit, la rumeur même
d'une intention, tout tombe sous le coup de la discipline, et de ses
besoins dont les instances supérieures jugent sans appel.
du parti confond systématiquement tous les domaines et soumet
jésuitiquement toutes choses à la discipline. Programmes, lignes
d'action, décisions, mais aussi science, doctrine, questions de fait,
mais encore toute opinion, tout document écrit, la rumeur même
d'une intention, tout tombe sous le coup de la discipline, et de ses
besoins dont les instances supérieures jugent sans appel.
Ces sauvages folies appellent la révolte. Posons, tout au contraire,
que la discipline est exigence de l'action, et de l'action seule. Dans
la pratique, bien sûr et de jour en jour, il peut être délicat mais
il doit être possible toujours de distinguer le domaine de l'action
des sphères où la discipline n'a pas sa place. Le parti en tant
que la discipline est exigence de l'action, et de l'action seule. Dans
la pratique, bien sûr et de jour en jour, il peut être délicat mais
il doit être possible toujours de distinguer le domaine de l'action
des sphères où la discipline n'a pas sa place. Le parti en tant
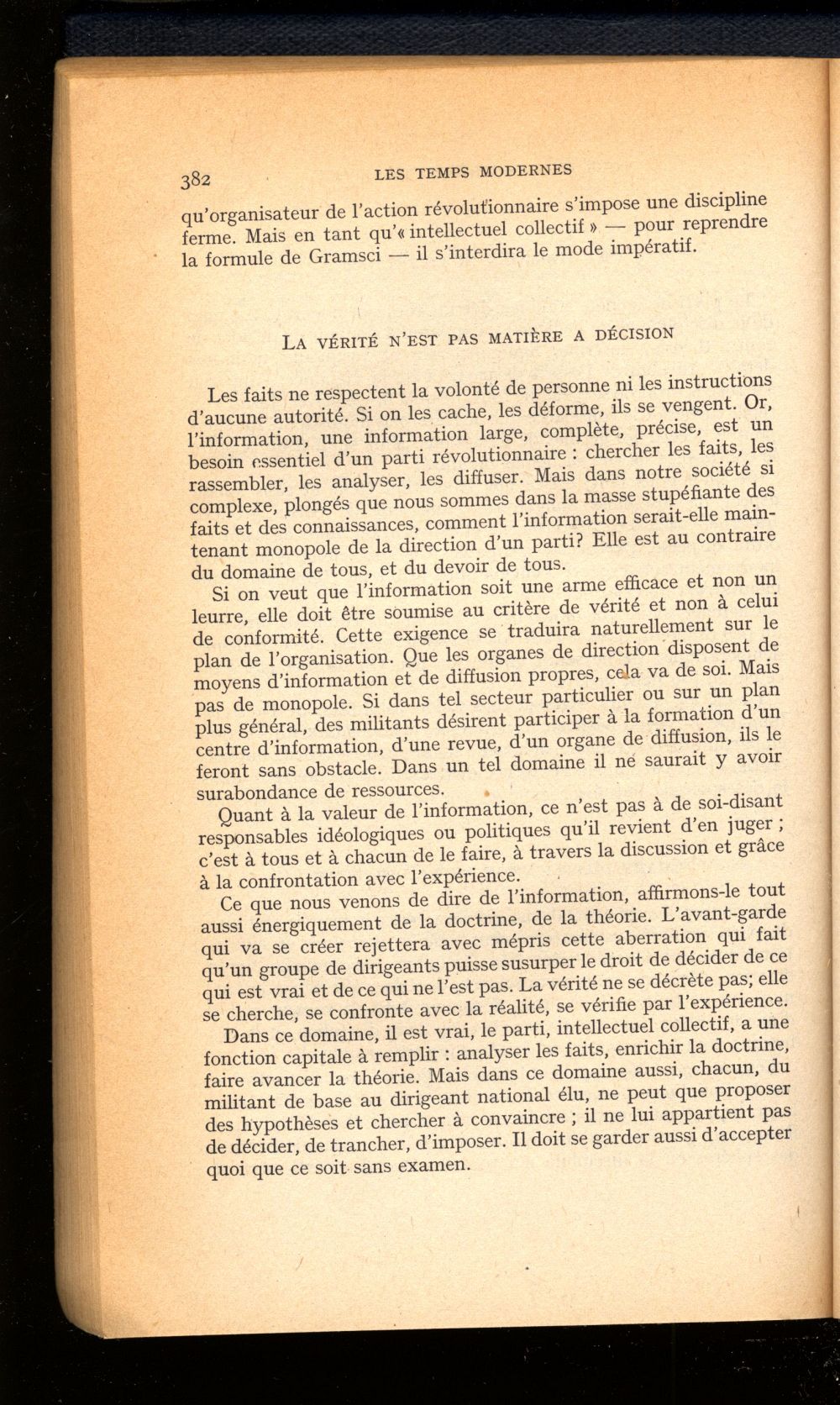

382 LES TEMPS MODERNES
qu'organisateur de l'action révolutionnaire s'impose une discipline
ferme. Mais en tant qu'« intellectuel collectif » — pour reprendre
la formule de Gramsci — il s'interdira le mode impératif.
ferme. Mais en tant qu'« intellectuel collectif » — pour reprendre
la formule de Gramsci — il s'interdira le mode impératif.
LA VÉRITÉ N'EST PAS MATIÈRE A DÉCISION
Les faits ne respectent la volonté de personne ni les instructions
d'aucune autorité. Si on les cache, les déforme, ils se vengent. Or,
l'information, une information large, complète, précise, est un
besoin essentiel d'un parti révolutionnaire : chercher les faits, les
rassembler, les analyser, les diffuser. Mais dans notre société si
complexe, plongés que nous sommes dans la masse stupéfiante des
faits et des connaissances, comment l'information serait-elle main-
tenant monopole de la direction d'un parti? Elle est au contraire
du domaine de tous, et du devoir de tous.
d'aucune autorité. Si on les cache, les déforme, ils se vengent. Or,
l'information, une information large, complète, précise, est un
besoin essentiel d'un parti révolutionnaire : chercher les faits, les
rassembler, les analyser, les diffuser. Mais dans notre société si
complexe, plongés que nous sommes dans la masse stupéfiante des
faits et des connaissances, comment l'information serait-elle main-
tenant monopole de la direction d'un parti? Elle est au contraire
du domaine de tous, et du devoir de tous.
Si on veut que l'information soit une arme efficace et non un
leurre, elle doit être soumise au critère de vérité et non à celui
de conformité. Cette exigence se traduira naturellement sur le
plan de l'organisation. Que les organes de direction disposent de
moyens d'information et de diffusion propres, cela va de soi. Mais
pas de monopole. Si dans tel secteur particulier ou sur un plan
plus général, des militants désirent participer à la formation d'un
centre d'information, d'une revue, d'un organe de diffusion, ils le
feront sans obstacle. Dans un tel domaine il ne saurait y avoir
surabondance de ressources.
leurre, elle doit être soumise au critère de vérité et non à celui
de conformité. Cette exigence se traduira naturellement sur le
plan de l'organisation. Que les organes de direction disposent de
moyens d'information et de diffusion propres, cela va de soi. Mais
pas de monopole. Si dans tel secteur particulier ou sur un plan
plus général, des militants désirent participer à la formation d'un
centre d'information, d'une revue, d'un organe de diffusion, ils le
feront sans obstacle. Dans un tel domaine il ne saurait y avoir
surabondance de ressources.
Quant à la valeur de l'information, ce n'est pas à de soi-disant
responsables idéologiques ou politiques qu'il revient d'en juger ;
c'est à tous et à chacun de le faire, à travers la discussion et grâce
à la confrontation avec l'expérience.
responsables idéologiques ou politiques qu'il revient d'en juger ;
c'est à tous et à chacun de le faire, à travers la discussion et grâce
à la confrontation avec l'expérience.
Ce que nous venons de dire de l'information, affirmons-le tout
aussi énergiquement de la doctrine, de la théorie. L'avant-garde
qui va se créer rejettera avec mépris cette aberration qui fait
qu'un groupe de dirigeants puisse susurper le droit de décider de ce
qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. La vérité ne se décrète pas; elle
se cherche, se confronte avec la réalité, se vérifie par l'expérience.
aussi énergiquement de la doctrine, de la théorie. L'avant-garde
qui va se créer rejettera avec mépris cette aberration qui fait
qu'un groupe de dirigeants puisse susurper le droit de décider de ce
qui est vrai et de ce qui ne l'est pas. La vérité ne se décrète pas; elle
se cherche, se confronte avec la réalité, se vérifie par l'expérience.
Dans ce domaine, il est vrai, le parti, intellectuel collectif, a une
fonction capitale à remplir : analyser les faits, enrichir la doctrine,
faire avancer la théorie. Mais dans ce domaine aussi, chacun, du
militant de base au dirigeant national élu, ne peut que proposer
des hypothèses et chercher à convaincre ; il ne lui appartient pas
de décider, de trancher, d'imposer. Il doit se garder aussi d'accepter
quoi que ce soit sans examen.
fonction capitale à remplir : analyser les faits, enrichir la doctrine,
faire avancer la théorie. Mais dans ce domaine aussi, chacun, du
militant de base au dirigeant national élu, ne peut que proposer
des hypothèses et chercher à convaincre ; il ne lui appartient pas
de décider, de trancher, d'imposer. Il doit se garder aussi d'accepter
quoi que ce soit sans examen.
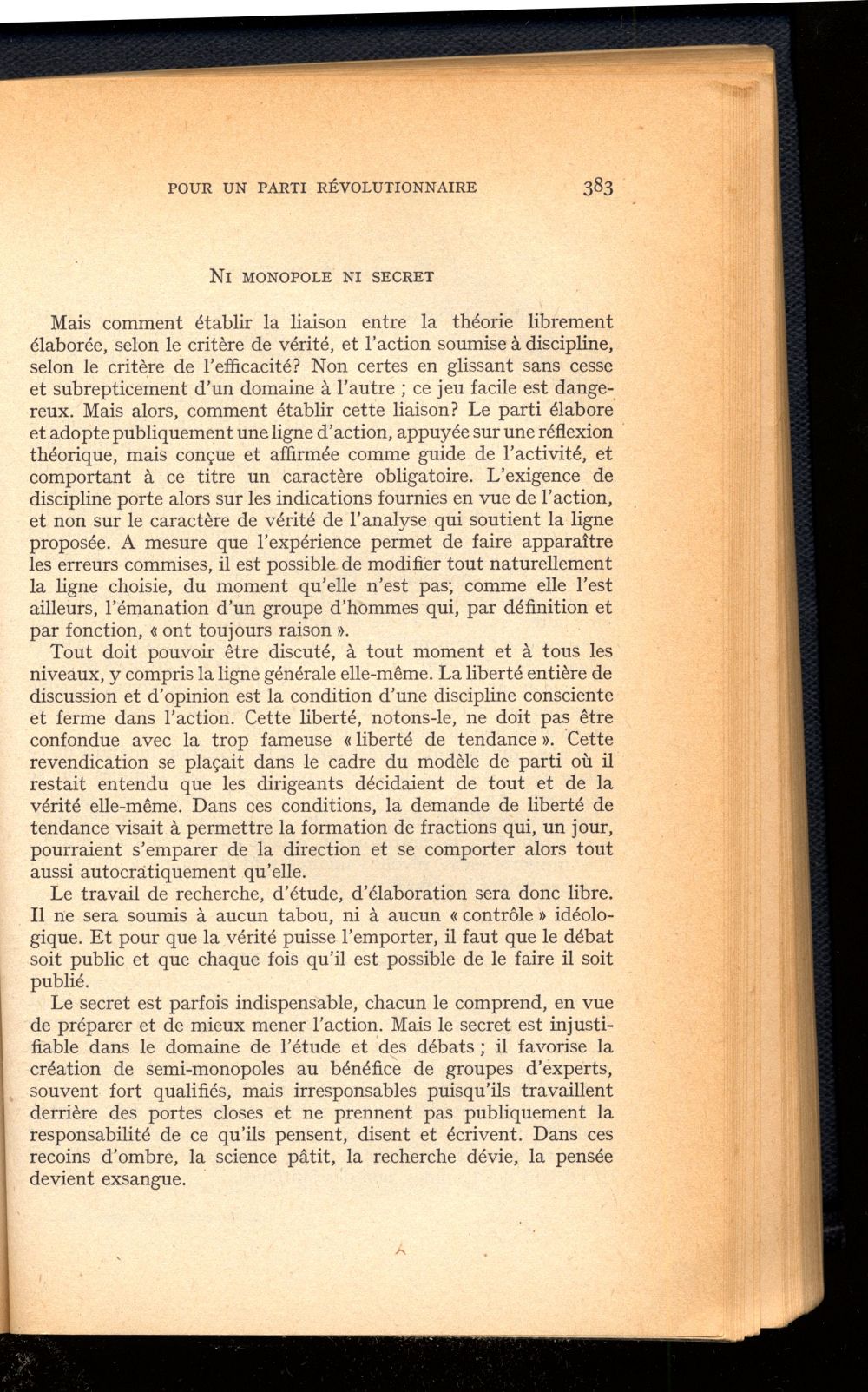

POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE
383
Ni MONOPOLE NI SECRET
Mais comment établir la liaison entre la théorie librement
élaborée, selon le critère de vérité, et l'action soumise à discipline,
selon le critère de l'efficacité? Non certes en glissant sans cesse
et subrepticement d'un domaine à l'autre ; ce jeu facile est dange-
reux. Mais alors, comment établir cette liaison? Le parti élabore
et adopte publiquement une ligne d'action, appuyée sur une réflexion
théorique, mais conçue et affirmée comme guide de l'activité, et
comportant à ce titre un caractère obligatoire. L'exigence de
discipline porte alors sur les indications fournies en vue de l'action,
et non sur le caractère de vérité de l'analyse qui soutient la ligne
proposée. A mesure que l'expérience permet de faire apparaître
les erreurs commises, il est possible de modifier tout naturellement
la ligne choisie, du moment qu'elle n'est pas; comme elle l'est
ailleurs, l'émanation d'un groupe d'hommes qui, par définition et
par fonction, « ont toujours raison ».
élaborée, selon le critère de vérité, et l'action soumise à discipline,
selon le critère de l'efficacité? Non certes en glissant sans cesse
et subrepticement d'un domaine à l'autre ; ce jeu facile est dange-
reux. Mais alors, comment établir cette liaison? Le parti élabore
et adopte publiquement une ligne d'action, appuyée sur une réflexion
théorique, mais conçue et affirmée comme guide de l'activité, et
comportant à ce titre un caractère obligatoire. L'exigence de
discipline porte alors sur les indications fournies en vue de l'action,
et non sur le caractère de vérité de l'analyse qui soutient la ligne
proposée. A mesure que l'expérience permet de faire apparaître
les erreurs commises, il est possible de modifier tout naturellement
la ligne choisie, du moment qu'elle n'est pas; comme elle l'est
ailleurs, l'émanation d'un groupe d'hommes qui, par définition et
par fonction, « ont toujours raison ».
Tout doit pouvoir être discuté, à tout moment et à tous les
niveaux, y compris la ligne générale elle-même. La liberté entière de
discussion et d'opinion est la condition d'une discipline consciente
et ferme dans l'action. Cette liberté, notons-le, ne doit pas être
confondue avec la trop fameuse « liberté de tendance ». Cette
revendication se plaçait dans le cadre du modèle de parti où il
restait entendu que les dirigeants décidaient de tout et de la
vérité elle-même. Dans ces conditions, la demande de liberté de
tendance visait à permettre la formation de fractions qui, un jour,
pourraient s'emparer de la direction et se comporter alors tout
aussi autocratiquement qu'elle.
niveaux, y compris la ligne générale elle-même. La liberté entière de
discussion et d'opinion est la condition d'une discipline consciente
et ferme dans l'action. Cette liberté, notons-le, ne doit pas être
confondue avec la trop fameuse « liberté de tendance ». Cette
revendication se plaçait dans le cadre du modèle de parti où il
restait entendu que les dirigeants décidaient de tout et de la
vérité elle-même. Dans ces conditions, la demande de liberté de
tendance visait à permettre la formation de fractions qui, un jour,
pourraient s'emparer de la direction et se comporter alors tout
aussi autocratiquement qu'elle.
Le travail de recherche, d'étude, d'élaboration sera donc libre.
Il ne sera soumis à aucun tabou, ni à aucun « contrôle » idéolo-
gique. Et pour que la vérité puisse l'emporter, il faut que le débat
soit public et que chaque fois qu'il est possible de le faire il soit
publié.
Il ne sera soumis à aucun tabou, ni à aucun « contrôle » idéolo-
gique. Et pour que la vérité puisse l'emporter, il faut que le débat
soit public et que chaque fois qu'il est possible de le faire il soit
publié.
Le secret est parfois indispensable, chacun le comprend, en vue
de préparer et de mieux mener l'action. Mais le secret est injusti-
fiable dans le domaine de l'étude et des débats ; il favorise la
création de semi-monopoles au bénéfice de groupes d'experts,
souvent fort qualifiés, mais irresponsables puisqu'ils travaillent
derrière des portes closes et ne prennent pas publiquement la
responsabilité de ce qu'ils pensent, disent et écrivent. Dans ces
recoins d'ombre, la science pâtit, la recherche dévie, la pensée
devient exsangue.
de préparer et de mieux mener l'action. Mais le secret est injusti-
fiable dans le domaine de l'étude et des débats ; il favorise la
création de semi-monopoles au bénéfice de groupes d'experts,
souvent fort qualifiés, mais irresponsables puisqu'ils travaillent
derrière des portes closes et ne prennent pas publiquement la
responsabilité de ce qu'ils pensent, disent et écrivent. Dans ces
recoins d'ombre, la science pâtit, la recherche dévie, la pensée
devient exsangue.
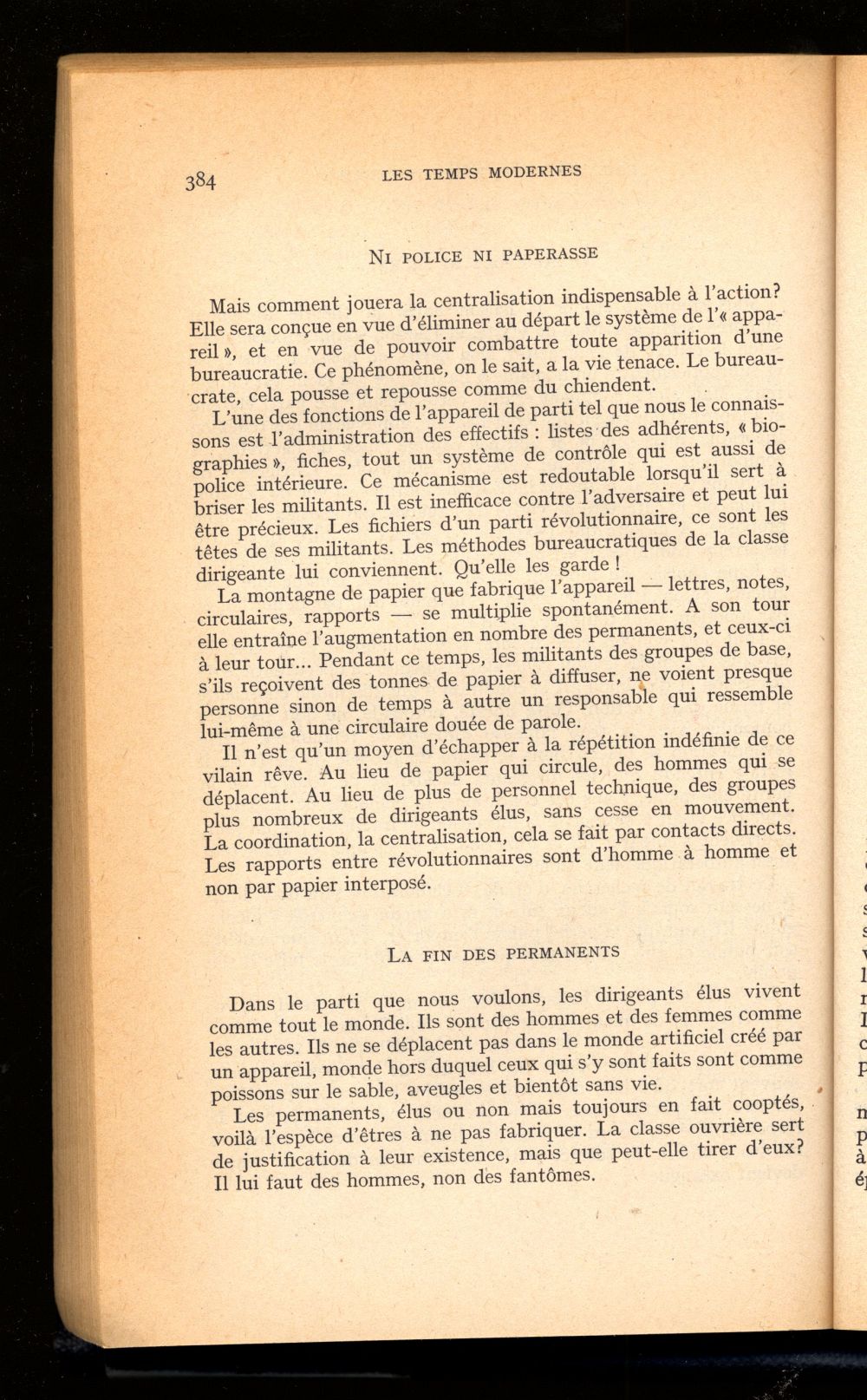

LES TEMPS MODERNES
Ni POLICE NI PAPERASSE
Mais comment jouera la centralisation indispensable à l'action?
Elle sera conçue en vue d'éliminer au départ le système de l'« appa-
reil », et en vue de pouvoir combattre toute apparition d'une
bureaucratie. Ce phénomène, on le sait, a la vie tenace. Le bureau-
crate, cela pousse et repousse comme du chiendent.
Elle sera conçue en vue d'éliminer au départ le système de l'« appa-
reil », et en vue de pouvoir combattre toute apparition d'une
bureaucratie. Ce phénomène, on le sait, a la vie tenace. Le bureau-
crate, cela pousse et repousse comme du chiendent.
L'une des fonctions de l'appareil de parti tel que nous le connais-
sons est l'administration des effectifs : listes des adhérents, «bio-
graphies », fiches, tout un système de contrôle qui est axissi de
police intérieure. Ce mécanisme est redoutable lorsqu'il sert à
briser les militants. Il est inefficace contre l'adversaire et peut lui
être précieux. Les fichiers d'un parti révolutionnaire, ce sont les
têtes de ses militants. Les méthodes bureaucratiques de la classe
dirigeante lui conviennent. Qu'elle les garde !
sons est l'administration des effectifs : listes des adhérents, «bio-
graphies », fiches, tout un système de contrôle qui est axissi de
police intérieure. Ce mécanisme est redoutable lorsqu'il sert à
briser les militants. Il est inefficace contre l'adversaire et peut lui
être précieux. Les fichiers d'un parti révolutionnaire, ce sont les
têtes de ses militants. Les méthodes bureaucratiques de la classe
dirigeante lui conviennent. Qu'elle les garde !
La montagne de papier que fabrique l'appareil — lettres, notes,
circulaires, rapports — se multiplie spontanément. A son tour
elle entraîne l'augmentation en nombre des permanents, et ceux-ci
à leur tour... Pendant ce temps, les militants des groupes de base,
s'ils reçoivent des tonnes de papier à diffuser, ne voient presque
personne sinon de temps à autre un responsable qui ressemble
lui-même à une circulaire douée de parole.
circulaires, rapports — se multiplie spontanément. A son tour
elle entraîne l'augmentation en nombre des permanents, et ceux-ci
à leur tour... Pendant ce temps, les militants des groupes de base,
s'ils reçoivent des tonnes de papier à diffuser, ne voient presque
personne sinon de temps à autre un responsable qui ressemble
lui-même à une circulaire douée de parole.
Il n'est qu'un moyen d'échapper à la répétition indéfinie de ce
vilain rêve. Au lieu de papier qui circule, des hommes qui se
déplacent. Au lieu de plus de personnel technique, des groupes
plus nombreux de dirigeants élus, sans cesse en mouvement.
La coordination, la centralisation, cela se fait par contacts directs.
Les rapports entre révolutionnaires sont d'homme à homme et
non par papier interposé.
vilain rêve. Au lieu de papier qui circule, des hommes qui se
déplacent. Au lieu de plus de personnel technique, des groupes
plus nombreux de dirigeants élus, sans cesse en mouvement.
La coordination, la centralisation, cela se fait par contacts directs.
Les rapports entre révolutionnaires sont d'homme à homme et
non par papier interposé.
LA FIN DES PERMANENTS
Dans le parti que nous voulons, les dirigeants élus vivent
comme tout le monde. Ils sont des hommes et des femmes comme
les autres. Ils ne se déplacent pas dans le monde artificiel créé par
un appareil, monde hors duquel ceux qui s'y sont faits sont comme
poissons sur le sable, aveugles et bientôt sans vie.
comme tout le monde. Ils sont des hommes et des femmes comme
les autres. Ils ne se déplacent pas dans le monde artificiel créé par
un appareil, monde hors duquel ceux qui s'y sont faits sont comme
poissons sur le sable, aveugles et bientôt sans vie.
Les permanents, élus ou non mais toujours en fait cooptés,
voilà l'espèce d'êtres à ne pas fabriquer. La classe ouvrière sert
de justification à leur existence, mais que peut-elle tirer d'eux?
Il lui faut des hommes, non des fantômes.
voilà l'espèce d'êtres à ne pas fabriquer. La classe ouvrière sert
de justification à leur existence, mais que peut-elle tirer d'eux?
Il lui faut des hommes, non des fantômes.
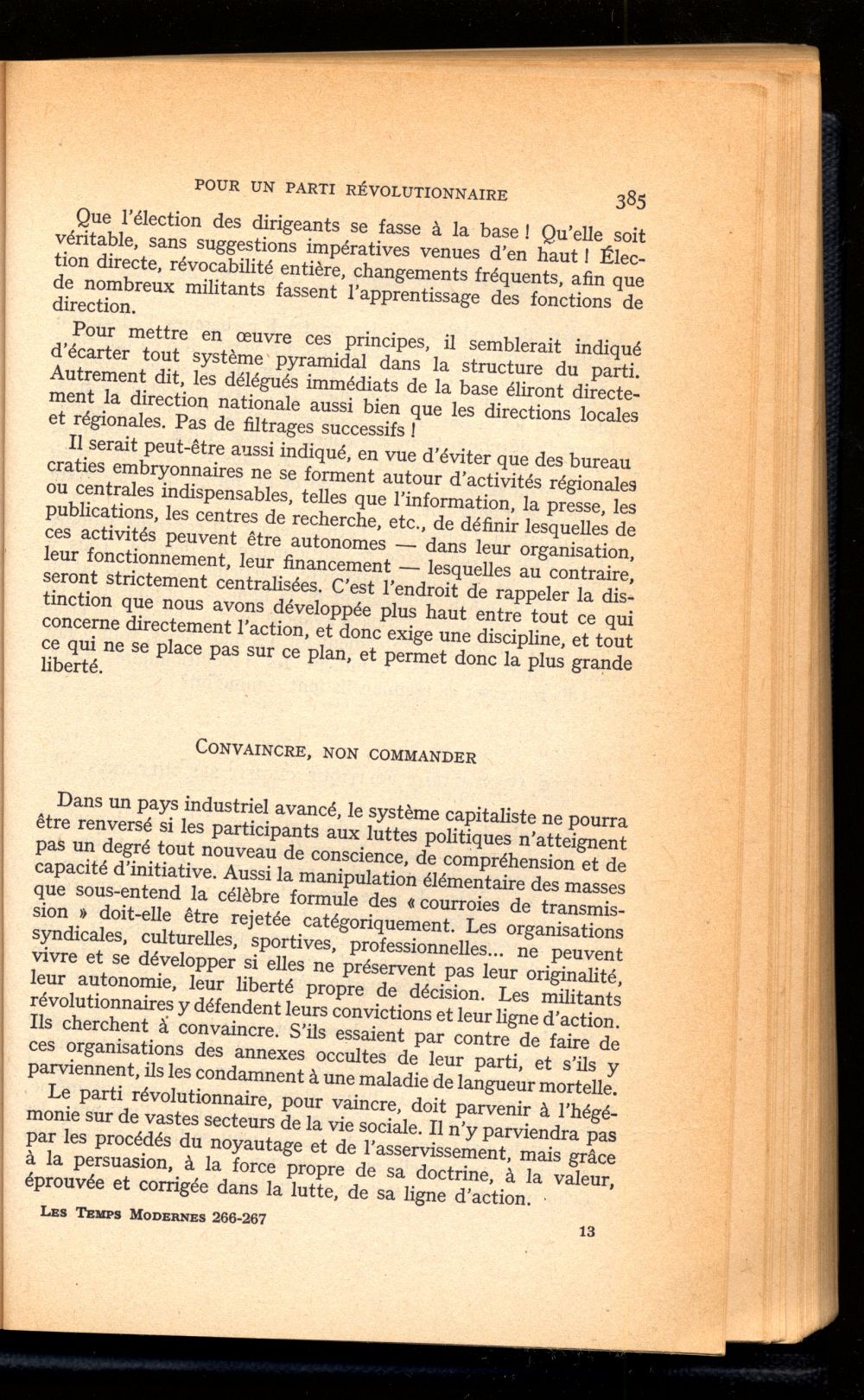

POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE
Que l'élection des dirigeants se fasse à la base ! Qu'elle soit
véritable, sans suggestions impératives venues d'en haut ! Élec-
tion directe, révocabilité entière, changements fréquents, afin que
de nombreux militants fassent l'apprentissage des fonctions de
direction.
véritable, sans suggestions impératives venues d'en haut ! Élec-
tion directe, révocabilité entière, changements fréquents, afin que
de nombreux militants fassent l'apprentissage des fonctions de
direction.
Pour mettre en œuvre ces principes, il semblerait indiqué
d'écarter tout système pyramidal dans la structure du parti.
Autrement dit, les délégués immédiats de la base éliront directe-
ment la direction nationale aussi bien que les directions locales
et régionales. Pas de filtrages successifs !
d'écarter tout système pyramidal dans la structure du parti.
Autrement dit, les délégués immédiats de la base éliront directe-
ment la direction nationale aussi bien que les directions locales
et régionales. Pas de filtrages successifs !
Il serait peut-être aussi indiqué, en vue d'éviter que des bureau
craties embryonnaires ne se forment autour d'activités régionales
ou centrales indispensables, telles que l'information, la presse, les
publications, les centres de recherche, etc., de définir lesquelles de
ces activités peuvent être autonomes — dans leur organisation,
leur fonctionnement, leur financement — lesquelles au contraire,
seront strictement centralisées. C'est l'endroit de rappeler la dis-
tinction que nous avons développée plus haut entre tout ce qui
concerne directement l'action, et donc exige une discipline, et tout
ce qui ne se place pas sur ce plan, et permet donc la plus grande
liberté.
craties embryonnaires ne se forment autour d'activités régionales
ou centrales indispensables, telles que l'information, la presse, les
publications, les centres de recherche, etc., de définir lesquelles de
ces activités peuvent être autonomes — dans leur organisation,
leur fonctionnement, leur financement — lesquelles au contraire,
seront strictement centralisées. C'est l'endroit de rappeler la dis-
tinction que nous avons développée plus haut entre tout ce qui
concerne directement l'action, et donc exige une discipline, et tout
ce qui ne se place pas sur ce plan, et permet donc la plus grande
liberté.
CONVAINCRE, NON COMMANDER
Dans un pays industriel avancé, le système capitaliste ne pourra
être renversé si les participants aux luttes politiques n'atteignent
pas un degré tout nouveau de conscience, de compréhension et de
capacité d'initiative. Aussi la manipulation élémentaire des masses
que sous-entend la célèbre formule des « courroies de transmis-
sion » doit-elle être rejetée catégoriquement. Les organisations
syndicales, culturelles, sportives, professionnelles... ne peuvent
vivre et se développer si elles ne préservent pas leur originalité,
leur autonomie, leur liberté propre de décision. Les militants
révolutionnaires y défendent leurs convictions et leur ligne d'action.
Ils cherchent à convaincre. S'ils essaient par contre de faire de
ces organisations des annexes occultes de leur parti, et s'ils y
parviennent, ils les condamnent à une maladie de langueur mortelle.
être renversé si les participants aux luttes politiques n'atteignent
pas un degré tout nouveau de conscience, de compréhension et de
capacité d'initiative. Aussi la manipulation élémentaire des masses
que sous-entend la célèbre formule des « courroies de transmis-
sion » doit-elle être rejetée catégoriquement. Les organisations
syndicales, culturelles, sportives, professionnelles... ne peuvent
vivre et se développer si elles ne préservent pas leur originalité,
leur autonomie, leur liberté propre de décision. Les militants
révolutionnaires y défendent leurs convictions et leur ligne d'action.
Ils cherchent à convaincre. S'ils essaient par contre de faire de
ces organisations des annexes occultes de leur parti, et s'ils y
parviennent, ils les condamnent à une maladie de langueur mortelle.
Le parti révolutionnaire, pour vaincre, doit parvenir à l'hégé-
monie sur de vastes secteurs de la vie sociale. Il n'y parviendra pas
par les procédés du noyautage et de l'asservissement, mais grâce
à la persuasion, à la force propre de sa doctrine, à la valeur,
éprouvée et corrigée dans la lutte, de sa ligne d'action.
monie sur de vastes secteurs de la vie sociale. Il n'y parviendra pas
par les procédés du noyautage et de l'asservissement, mais grâce
à la persuasion, à la force propre de sa doctrine, à la valeur,
éprouvée et corrigée dans la lutte, de sa ligne d'action.
LES TEMPS MODERNES 266-267
13
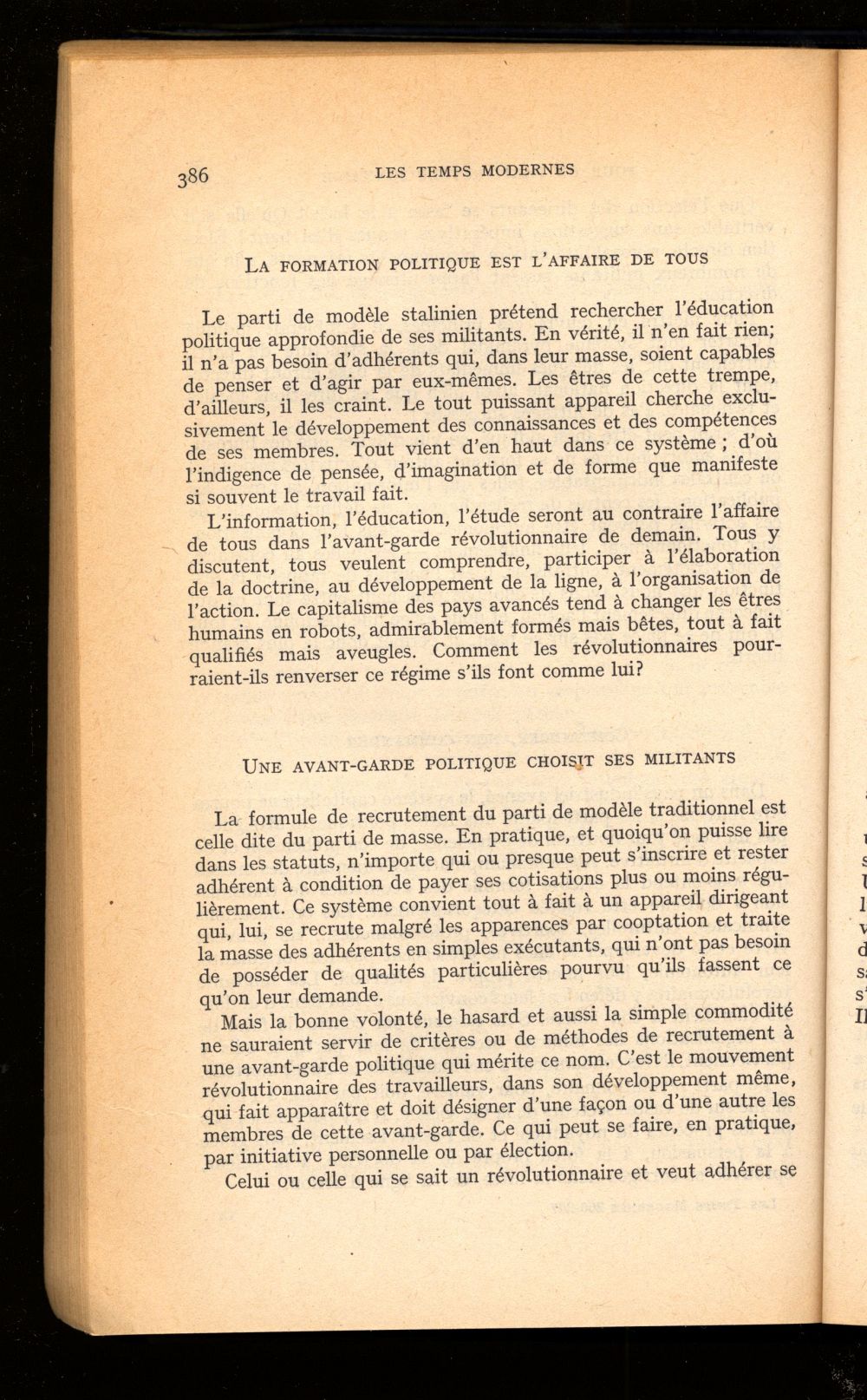

386
LES TEMPS MODERNES
LA FORMATION POLITIQUE EST L'AFFAIRE DE TOUS
Le parti de modèle stalinien prétend rechercher l'éducation
politique approfondie de ses militants. En vérité, il n'en fait rien;
il n'a pas besoin d'adhérents qui, dans leur masse, soient capables
de penser et d'agir par eux-mêmes. Les êtres de cette trempe,
d'ailleurs, il les craint. Le tout puissant appareil cherche exclu-
sivement le développement des connaissances et des compétences
de ses membres. Tout vient d'en haut dans ce système ; d'où
l'indigence de pensée, d'imagination et de forme que manifeste
si souvent le travail fait.
politique approfondie de ses militants. En vérité, il n'en fait rien;
il n'a pas besoin d'adhérents qui, dans leur masse, soient capables
de penser et d'agir par eux-mêmes. Les êtres de cette trempe,
d'ailleurs, il les craint. Le tout puissant appareil cherche exclu-
sivement le développement des connaissances et des compétences
de ses membres. Tout vient d'en haut dans ce système ; d'où
l'indigence de pensée, d'imagination et de forme que manifeste
si souvent le travail fait.
L'information, l'éducation, l'étude seront au contraire l'affaire
de tous dans l'avant-garde révolutionnaire de demain. Tous y
discutent, tous veulent comprendre, participer à l'élaboration
de la doctrine, au développement de la ligne, à l'organisation de
l'action. Le capitalisme des pays avancés tend à changer les êtres
humains en robots, admirablement formés mais bêtes, tout à fait
qualifiés mais aveugles. Comment les révolutionnaires pour-
raient-ils renverser ce régime s'ils font comme lui?
de tous dans l'avant-garde révolutionnaire de demain. Tous y
discutent, tous veulent comprendre, participer à l'élaboration
de la doctrine, au développement de la ligne, à l'organisation de
l'action. Le capitalisme des pays avancés tend à changer les êtres
humains en robots, admirablement formés mais bêtes, tout à fait
qualifiés mais aveugles. Comment les révolutionnaires pour-
raient-ils renverser ce régime s'ils font comme lui?
UNE AVANT-GARDE POLITIQUE CHOISÎT SES MILITANTS
La formule de recrutement du parti de modèle traditionnel est
celle dite du parti de masse. En pratique, et quoiqu'on puisse lire
dans les statuts, n'importe qui ou presque peut s'inscrire et rester
adhérent à condition de payer ses cotisations plus ou moins régu-
lièrement. Ce système convient tout à fait à un appareil dirigeant
qui, lui, se recrute malgré les apparences par cooptation et traite
la masse des adhérents en simples exécutants, qui n'ont pas besoin
de posséder de qualités particulières pourvu qu'ils fassent ce
qu'on leur demande.
celle dite du parti de masse. En pratique, et quoiqu'on puisse lire
dans les statuts, n'importe qui ou presque peut s'inscrire et rester
adhérent à condition de payer ses cotisations plus ou moins régu-
lièrement. Ce système convient tout à fait à un appareil dirigeant
qui, lui, se recrute malgré les apparences par cooptation et traite
la masse des adhérents en simples exécutants, qui n'ont pas besoin
de posséder de qualités particulières pourvu qu'ils fassent ce
qu'on leur demande.
Mais la bonne volonté, le hasard et aussi la simple commodité
ne sauraient servir de critères ou de méthodes de recrutement à
une avant-garde politique qui mérite ce nom. C'est le mouvement
révolutionnaire des travailleurs, dans son développement même,
qui fait apparaître et doit désigner d'une façon ou d'une autre les
membres de cette avant-garde. Ce qui peut se faire, en pratique,
par initiative personnelle ou par élection.
ne sauraient servir de critères ou de méthodes de recrutement à
une avant-garde politique qui mérite ce nom. C'est le mouvement
révolutionnaire des travailleurs, dans son développement même,
qui fait apparaître et doit désigner d'une façon ou d'une autre les
membres de cette avant-garde. Ce qui peut se faire, en pratique,
par initiative personnelle ou par élection.
Celui ou celle qui se sait un révolutionnaire et veut adhérer se
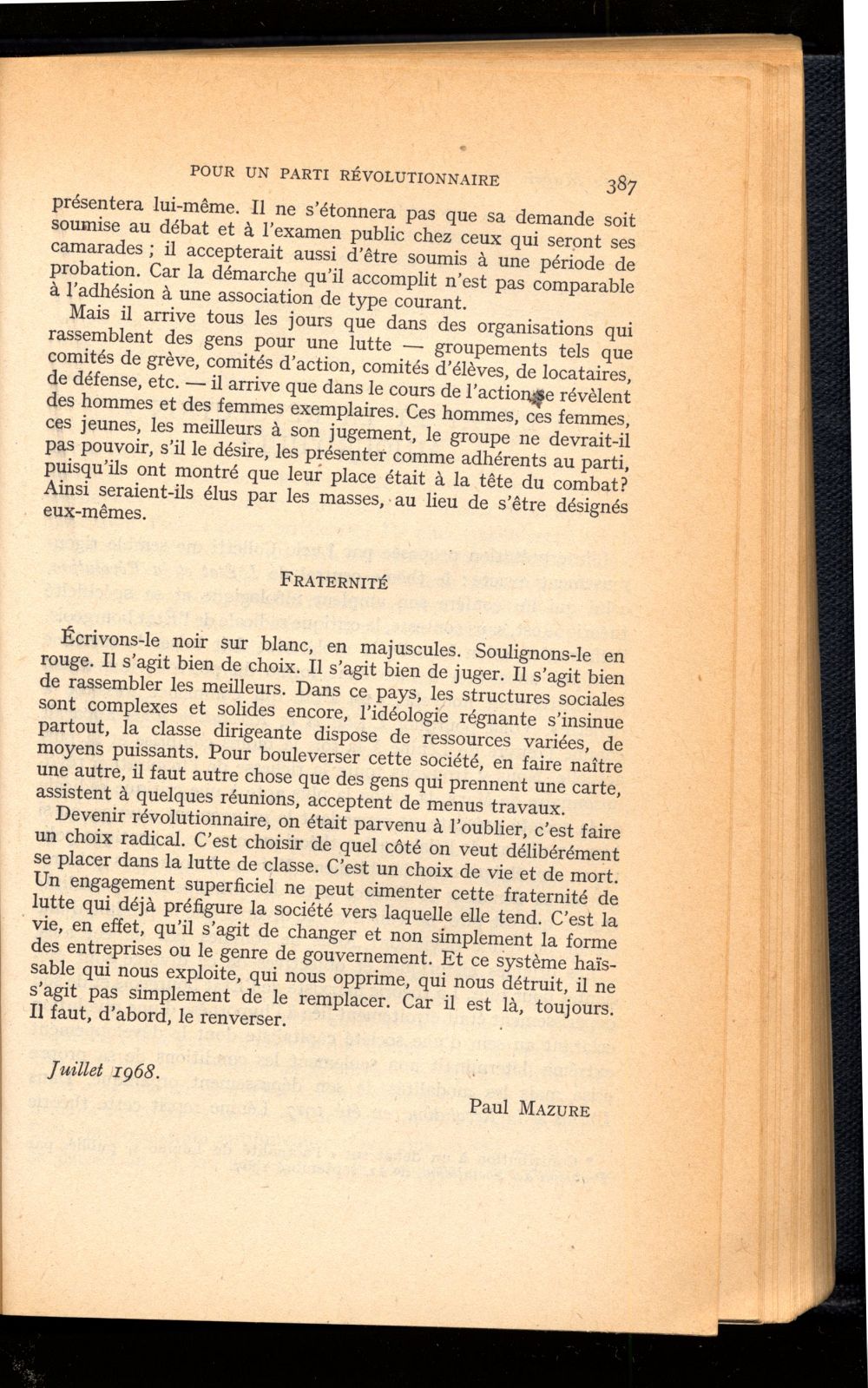

POUR UN PARTI RÉVOLUTIONNAIRE 387
présentera lui-même. Il ne s'étonnera pas que sa demande soit
soumise au débat et à l'examen public chez ceux qui seront ses
camarades ; il accepterait aussi d'être soumis à une période de
probation. Car la démarche qu'il accomplit n'est pas comparable
à l'adhésion à une association de type courant.
soumise au débat et à l'examen public chez ceux qui seront ses
camarades ; il accepterait aussi d'être soumis à une période de
probation. Car la démarche qu'il accomplit n'est pas comparable
à l'adhésion à une association de type courant.
Mais il arrive tous les jours que dans des organisations qui
rassemblent des gens pour une lutte —• groupements tels que
comités de grève, comités d'action, comités d'élèves, de locataires,
de défense, etc. — il arrive que dans le cours de l'actionne révèlent
des hommes et des femmes exemplaires. Ces hommes, ces femmes,
ces jeunes, les meilleurs à son jugement, le groupe ne devrait-il
pas pouvoir, s'il le désire, les présenter comme adhérents au parti,
puisqu'ils ont montré que leur place était à la tête du combat?
Ainsi seraient-ils élus par les masses, au lieu de s'être désignés
eux-mêmes.
rassemblent des gens pour une lutte —• groupements tels que
comités de grève, comités d'action, comités d'élèves, de locataires,
de défense, etc. — il arrive que dans le cours de l'actionne révèlent
des hommes et des femmes exemplaires. Ces hommes, ces femmes,
ces jeunes, les meilleurs à son jugement, le groupe ne devrait-il
pas pouvoir, s'il le désire, les présenter comme adhérents au parti,
puisqu'ils ont montré que leur place était à la tête du combat?
Ainsi seraient-ils élus par les masses, au lieu de s'être désignés
eux-mêmes.
FRATERNITÉ
Écrivons-le noir sur blanc, en majuscules. Soulignons-le en
rouge. Il s'agit bien de choix. Il s'agit bien de juger. Il s'agit bien
de rassembler les meilleurs. Dans ce pays, les structures sociales
sont complexes et solides encore, l'idéologie régnante s'insinue
partout, la classe dirigeante dispose de ressources variées, de
moyens puissants. Pour bouleverser cette société, en faire naître
une autre, il faut autre chose que des gens qui prennent une carte,
assistent à quelques réunions, acceptent de menus travaux.
rouge. Il s'agit bien de choix. Il s'agit bien de juger. Il s'agit bien
de rassembler les meilleurs. Dans ce pays, les structures sociales
sont complexes et solides encore, l'idéologie régnante s'insinue
partout, la classe dirigeante dispose de ressources variées, de
moyens puissants. Pour bouleverser cette société, en faire naître
une autre, il faut autre chose que des gens qui prennent une carte,
assistent à quelques réunions, acceptent de menus travaux.
Devenir révolutionnaire, on était parvenu à l'oublier, c'est faire
un choix radical. C'est choisir de quel côté on veut délibérément
se placer dans la lutte de classe. C'est un choix de vie et de mort.
Un engagement superficiel ne peut cimenter cette fraternité de
lutte qui déjà préfigure la société vers laquelle elle tend. C'est la
vie, en effet, qu'il s'agit de changer et non simplement la forme
des entreprises ou le genre de gouvernement. Et ce système haïs-
sable qui nous exploite, qui nous opprime, qui nous détruit, il ne
s'agit pas simplement de le remplacer. Car il est là, toujours.
Il faut, d'abord, le renverser.
un choix radical. C'est choisir de quel côté on veut délibérément
se placer dans la lutte de classe. C'est un choix de vie et de mort.
Un engagement superficiel ne peut cimenter cette fraternité de
lutte qui déjà préfigure la société vers laquelle elle tend. C'est la
vie, en effet, qu'il s'agit de changer et non simplement la forme
des entreprises ou le genre de gouvernement. Et ce système haïs-
sable qui nous exploite, qui nous opprime, qui nous détruit, il ne
s'agit pas simplement de le remplacer. Car il est là, toujours.
Il faut, d'abord, le renverser.
Juillet 1968.
Paul MAZURE
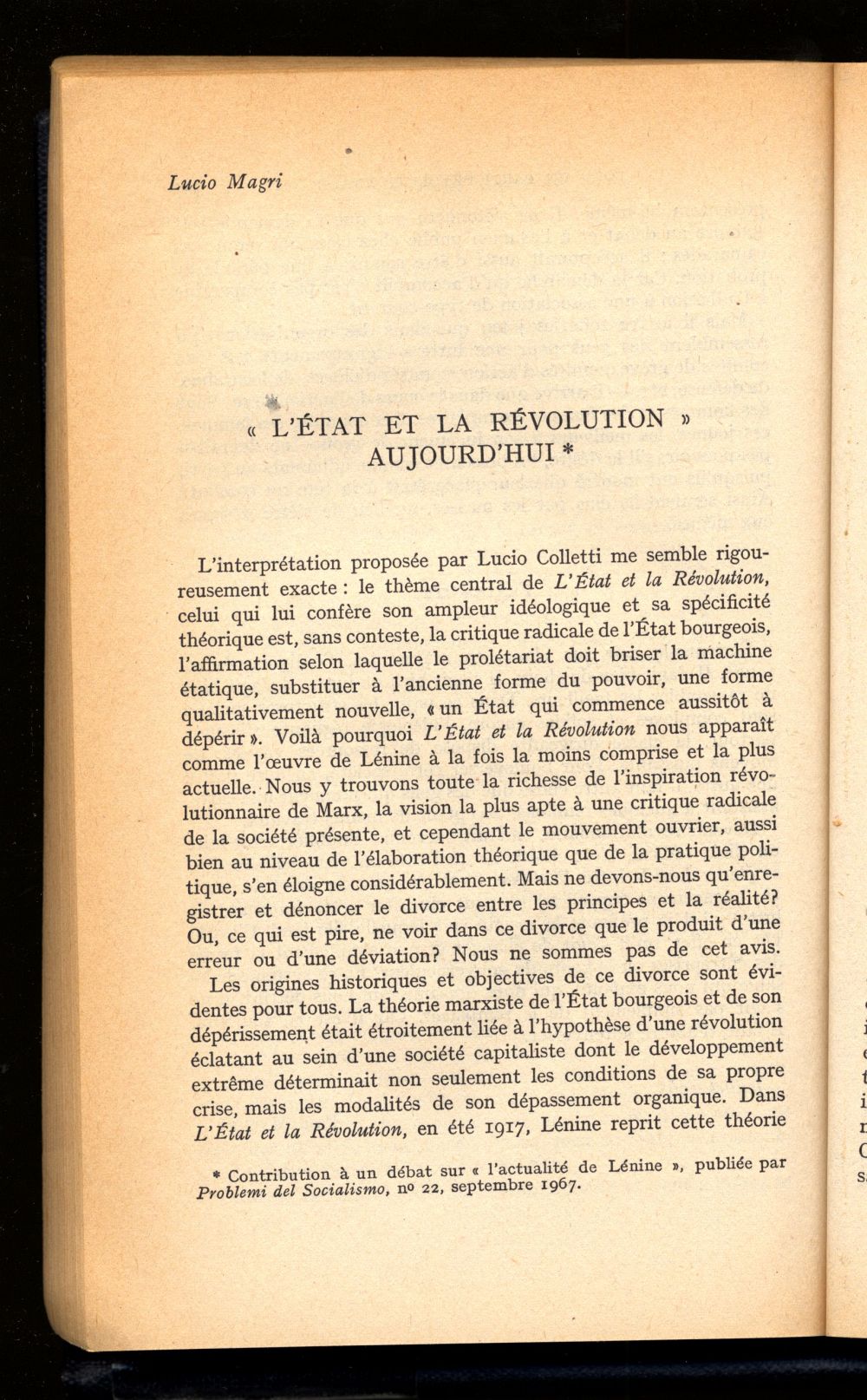

Lucio Magri
« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION »
AUJOURD'HUI *
AUJOURD'HUI *
L'interprétation proposée par Lucio Colletti me semble rigou-
reusement exacte : le thème central de L'État et la Révolution,
celui qui lui confère son ampleur idéologique et sa spécificité
théorique est, sans conteste, la critique radicale de l'État bourgeois,
l'affirmation selon laquelle le prolétariat doit briser la machine
étatique, substituer à l'ancienne forme du pouvoir, une forme
qualitativement nouvelle, « un État qui commence aussitôt à
dépérir ». Voilà pourquoi L'État et la Révolution nous apparaît
comme l'œuvre de Lénine à la fois la moins comprise et la plus
actuelle. Nous y trouvons toute la richesse de l'inspiration révo-
lutionnaire de Marx, la vision la plus apte à une critique radicale
de la société présente, et cependant le mouvement ouvrier, aussi
bien au niveau de l'élaboration théorique que de la pratique poli-
tique, s'en éloigne considérablement. Mais ne devons-nous qu'enre-
gistrer et dénoncer le divorce entre les principes et la réalité?
Ou, ce qui est pire, ne voir dans ce divorce que le produit d'une
erreur ou d'une déviation? Nous ne sommes pas de cet avis.
reusement exacte : le thème central de L'État et la Révolution,
celui qui lui confère son ampleur idéologique et sa spécificité
théorique est, sans conteste, la critique radicale de l'État bourgeois,
l'affirmation selon laquelle le prolétariat doit briser la machine
étatique, substituer à l'ancienne forme du pouvoir, une forme
qualitativement nouvelle, « un État qui commence aussitôt à
dépérir ». Voilà pourquoi L'État et la Révolution nous apparaît
comme l'œuvre de Lénine à la fois la moins comprise et la plus
actuelle. Nous y trouvons toute la richesse de l'inspiration révo-
lutionnaire de Marx, la vision la plus apte à une critique radicale
de la société présente, et cependant le mouvement ouvrier, aussi
bien au niveau de l'élaboration théorique que de la pratique poli-
tique, s'en éloigne considérablement. Mais ne devons-nous qu'enre-
gistrer et dénoncer le divorce entre les principes et la réalité?
Ou, ce qui est pire, ne voir dans ce divorce que le produit d'une
erreur ou d'une déviation? Nous ne sommes pas de cet avis.
Les origines historiques et objectives de ce divorce sont évi-
dentes pour tous. La théorie marxiste de l'État bourgeois et de son
dépérissement était étroitement liée à l'hypothèse d'une révolution
éclatant au sein d'une société capitaliste dont le développement
extrême déterminait non seulement les conditions de sa propre
crise, mais les modalités de son dépassement organique. Dans
L'État et la Révolution, en été 1917, Lénine reprit cette théorie
dentes pour tous. La théorie marxiste de l'État bourgeois et de son
dépérissement était étroitement liée à l'hypothèse d'une révolution
éclatant au sein d'une société capitaliste dont le développement
extrême déterminait non seulement les conditions de sa propre
crise, mais les modalités de son dépassement organique. Dans
L'État et la Révolution, en été 1917, Lénine reprit cette théorie
* Contribution à un débat sur « l'actualité de Lénine », publiée par
Problemi del Socialisme, n° 22, septembre 1967.
Problemi del Socialisme, n° 22, septembre 1967.
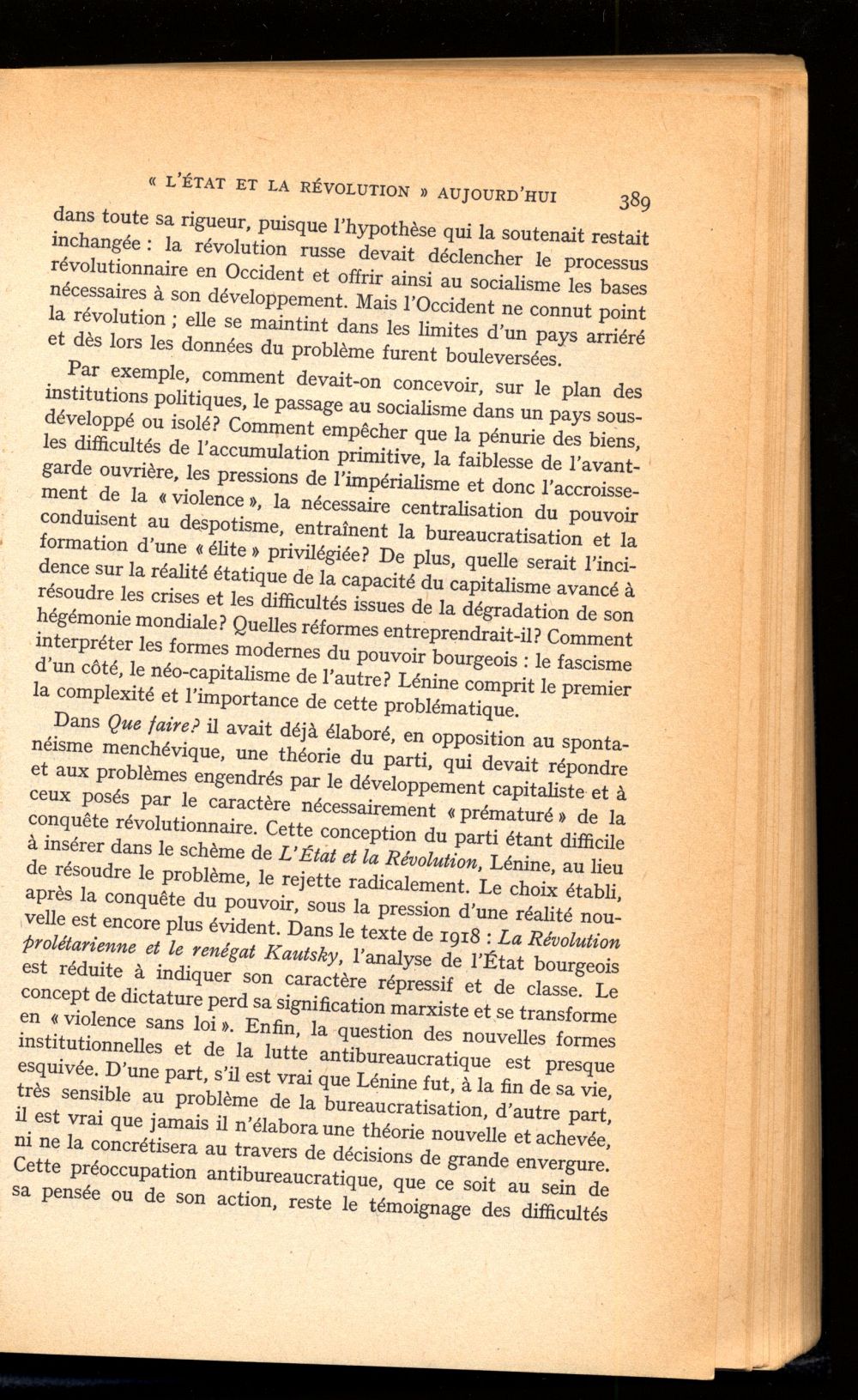

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
389
dans toute sa rigueur, puisque l'hypothèse qui la soutenait restait
inchangée : la révolution russe devait déclencher le processus
révolutionnaire en Occident et offrir ainsi au socialisme les bases
nécessaires à son développement. Mais l'Occident ne connut point
la révolution ; elle se maintint dans les limites d'un pays arriéré
et dès lors les données du problème furent bouleversées.
inchangée : la révolution russe devait déclencher le processus
révolutionnaire en Occident et offrir ainsi au socialisme les bases
nécessaires à son développement. Mais l'Occident ne connut point
la révolution ; elle se maintint dans les limites d'un pays arriéré
et dès lors les données du problème furent bouleversées.
Par exemple, comment devait-on concevoir, sur le plan des
institutions politiques, le passage au socialisme dans un pays sous-
dé veloppé ou isolé? Comment empêcher que la pénurie des biens,
les difficultés de l'accumulation primitive, la faiblesse de l'avant-
garde ouvrière, les pressions de l'impérialisme et donc l'accroisse-
ment de la « violence », la nécessaire centralisation du pouvoir
conduisent au despotisme, entraînent la bureaucratisation et la
formation d'une «élite» privilégiée? De plus, quelle serait l'inci-
dence sur la réalité étatique de la capacité du capitalisme avancé à
résoudre les crises et les difficultés issues de la dégradation de son
hégémonie mondiale? Quelles réformes entreprendrait-il? Comment
interpréter les formes modernes du pouvoir bourgeois : le fascisme
d'un côté, le néo-capitalisme de l'autre? Lénine comprit le premier
la complexité et l'importance de cette problématique.
institutions politiques, le passage au socialisme dans un pays sous-
dé veloppé ou isolé? Comment empêcher que la pénurie des biens,
les difficultés de l'accumulation primitive, la faiblesse de l'avant-
garde ouvrière, les pressions de l'impérialisme et donc l'accroisse-
ment de la « violence », la nécessaire centralisation du pouvoir
conduisent au despotisme, entraînent la bureaucratisation et la
formation d'une «élite» privilégiée? De plus, quelle serait l'inci-
dence sur la réalité étatique de la capacité du capitalisme avancé à
résoudre les crises et les difficultés issues de la dégradation de son
hégémonie mondiale? Quelles réformes entreprendrait-il? Comment
interpréter les formes modernes du pouvoir bourgeois : le fascisme
d'un côté, le néo-capitalisme de l'autre? Lénine comprit le premier
la complexité et l'importance de cette problématique.
Dans Que faire? il avait déjà élaboré, en opposition au sponta-
néisme menchévique, une théorie du parti, qui devait répondre
et aux problèmes engendrés par le développement capitaliste et à
ceux posés par le caractère nécessairement « prématuré » de la
conquête révolutionnaire. Cette conception du parti étant difficile
à insérer dans le schème de L'État et la Révolution, Lénine, au lieu
de résoudre le problème, le rejette radicalement. Le choix établi,
après la conquête du pouvoir, sous la pression d'une réalité nou-
velle est encore plus évident. Dans le texte de 1918 : La Révolution
prolétarienne et le renégat Kautsky, l'analyse de l'État bourgeois
est réduite à indiquer son caractère répressif et de classe. Le
concept de dictature perd sa signification marxiste et se transforme
en « violence sans loi ». Enfin, la question des nouvelles formes
institutionnelles et de la lutte antibureaucratique est presque
esquivée. D'une part, s'il est vrai que Lénine fut, à la fin de sa vie,
très sensible au problème de la bureaucratisation, d'autre part,
il est vrai que jamais il n'élabora une théorie nouvelle et achevée,
ni ne la concrétisera au travers de décisions de grande envergure.
Cette préoccupation antibureaucratique, que ce soit au sein de
sa pensée ou de son action, reste le témoignage des difficultés
néisme menchévique, une théorie du parti, qui devait répondre
et aux problèmes engendrés par le développement capitaliste et à
ceux posés par le caractère nécessairement « prématuré » de la
conquête révolutionnaire. Cette conception du parti étant difficile
à insérer dans le schème de L'État et la Révolution, Lénine, au lieu
de résoudre le problème, le rejette radicalement. Le choix établi,
après la conquête du pouvoir, sous la pression d'une réalité nou-
velle est encore plus évident. Dans le texte de 1918 : La Révolution
prolétarienne et le renégat Kautsky, l'analyse de l'État bourgeois
est réduite à indiquer son caractère répressif et de classe. Le
concept de dictature perd sa signification marxiste et se transforme
en « violence sans loi ». Enfin, la question des nouvelles formes
institutionnelles et de la lutte antibureaucratique est presque
esquivée. D'une part, s'il est vrai que Lénine fut, à la fin de sa vie,
très sensible au problème de la bureaucratisation, d'autre part,
il est vrai que jamais il n'élabora une théorie nouvelle et achevée,
ni ne la concrétisera au travers de décisions de grande envergure.
Cette préoccupation antibureaucratique, que ce soit au sein de
sa pensée ou de son action, reste le témoignage des difficultés
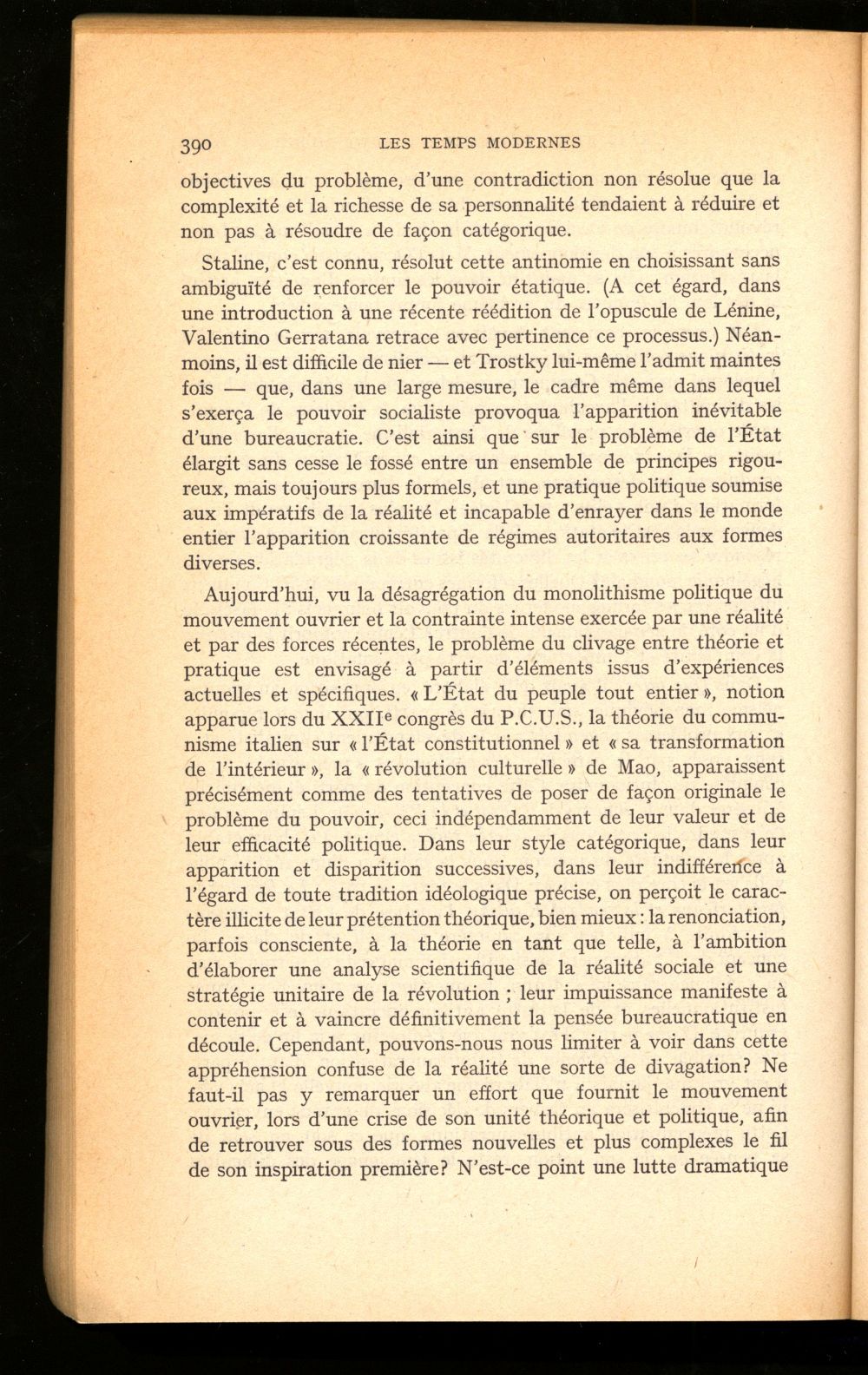

390
LES TEMPS MODERNES
objectives du problème, d'une contradiction non résolue que la
complexité et la richesse de sa personnalité tendaient à réduire et
non pas à résoudre de façon catégorique.
complexité et la richesse de sa personnalité tendaient à réduire et
non pas à résoudre de façon catégorique.
Staline, c'est connu, résolut cette antinomie en choisissant sans
ambiguïté de renforcer le pouvoir étatique. (A cet égard, dans
une introduction à une récente réédition de l'opuscule de Lénine,
Valentino Gerratana retrace avec pertinence ce processus.) Néan-
moins, il est difficile de nier — et Trostky lui-même l'admit maintes
fois •— que, dans une large mesure, le cadre même dans lequel
s'exerça le pouvoir socialiste provoqua l'apparition inévitable
d'une bureaucratie. C'est ainsi que sur le problème de l'État
élargit sans cesse le fossé entre un ensemble de principes rigou-
reux, mais toujours plus formels, et une pratique politique soumise
aux impératifs de la réalité et incapable d'enrayer dans le monde
entier l'apparition croissante de régimes autoritaires aux formes
diverses.
ambiguïté de renforcer le pouvoir étatique. (A cet égard, dans
une introduction à une récente réédition de l'opuscule de Lénine,
Valentino Gerratana retrace avec pertinence ce processus.) Néan-
moins, il est difficile de nier — et Trostky lui-même l'admit maintes
fois •— que, dans une large mesure, le cadre même dans lequel
s'exerça le pouvoir socialiste provoqua l'apparition inévitable
d'une bureaucratie. C'est ainsi que sur le problème de l'État
élargit sans cesse le fossé entre un ensemble de principes rigou-
reux, mais toujours plus formels, et une pratique politique soumise
aux impératifs de la réalité et incapable d'enrayer dans le monde
entier l'apparition croissante de régimes autoritaires aux formes
diverses.
Aujourd'hui, vu la désagrégation du monolithisme politique du
mouvement ouvrier et la contrainte intense exercée par une réalité
et par des forces récentes, le problème du clivage entre théorie et
pratique est envisagé à partir d'éléments issus d'expériences
actuelles et spécifiques. « L'État du peuple tout entier », notion
apparue lors du XXIIe congrès du P.C.U.S., la théorie du commu-
nisme italien sur « l'État constitutionnel » et « sa transformation
de l'intérieur », la « révolution culturelle » de Mao, apparaissent
précisément comme des tentatives de poser de façon originale le
problème du pouvoir, ceci indépendamment de leur valeur et de
leur efficacité politique. Dans leur style catégorique, dans leur
apparition et disparition successives, dans leur indifférence à
l'égard de toute tradition idéologique précise, on perçoit le carac-
tère illicite de leur prétention théorique, bien mieux : la renonciation,
parfois consciente, à la théorie en tant que telle, à l'ambition
d'élaborer une analyse scientifique de la réalité sociale et une
stratégie unitaire de la révolution ; leur impuissance manifeste à
contenir et à vaincre définitivement la pensée bureaucratique en
découle. Cependant, pouvons-nous nous limiter à voir dans cette
appréhension confuse de la réalité une sorte de divagation? Ne
faut-il pas y remarquer un effort que fournit le mouvement
ouvrier, lors d'une crise de son unité théorique et politique, afin
de retrouver sous des formes nouvelles et plus complexes le fil
de son inspiration première? N'est-ce point une lutte dramatique
mouvement ouvrier et la contrainte intense exercée par une réalité
et par des forces récentes, le problème du clivage entre théorie et
pratique est envisagé à partir d'éléments issus d'expériences
actuelles et spécifiques. « L'État du peuple tout entier », notion
apparue lors du XXIIe congrès du P.C.U.S., la théorie du commu-
nisme italien sur « l'État constitutionnel » et « sa transformation
de l'intérieur », la « révolution culturelle » de Mao, apparaissent
précisément comme des tentatives de poser de façon originale le
problème du pouvoir, ceci indépendamment de leur valeur et de
leur efficacité politique. Dans leur style catégorique, dans leur
apparition et disparition successives, dans leur indifférence à
l'égard de toute tradition idéologique précise, on perçoit le carac-
tère illicite de leur prétention théorique, bien mieux : la renonciation,
parfois consciente, à la théorie en tant que telle, à l'ambition
d'élaborer une analyse scientifique de la réalité sociale et une
stratégie unitaire de la révolution ; leur impuissance manifeste à
contenir et à vaincre définitivement la pensée bureaucratique en
découle. Cependant, pouvons-nous nous limiter à voir dans cette
appréhension confuse de la réalité une sorte de divagation? Ne
faut-il pas y remarquer un effort que fournit le mouvement
ouvrier, lors d'une crise de son unité théorique et politique, afin
de retrouver sous des formes nouvelles et plus complexes le fil
de son inspiration première? N'est-ce point une lutte dramatique
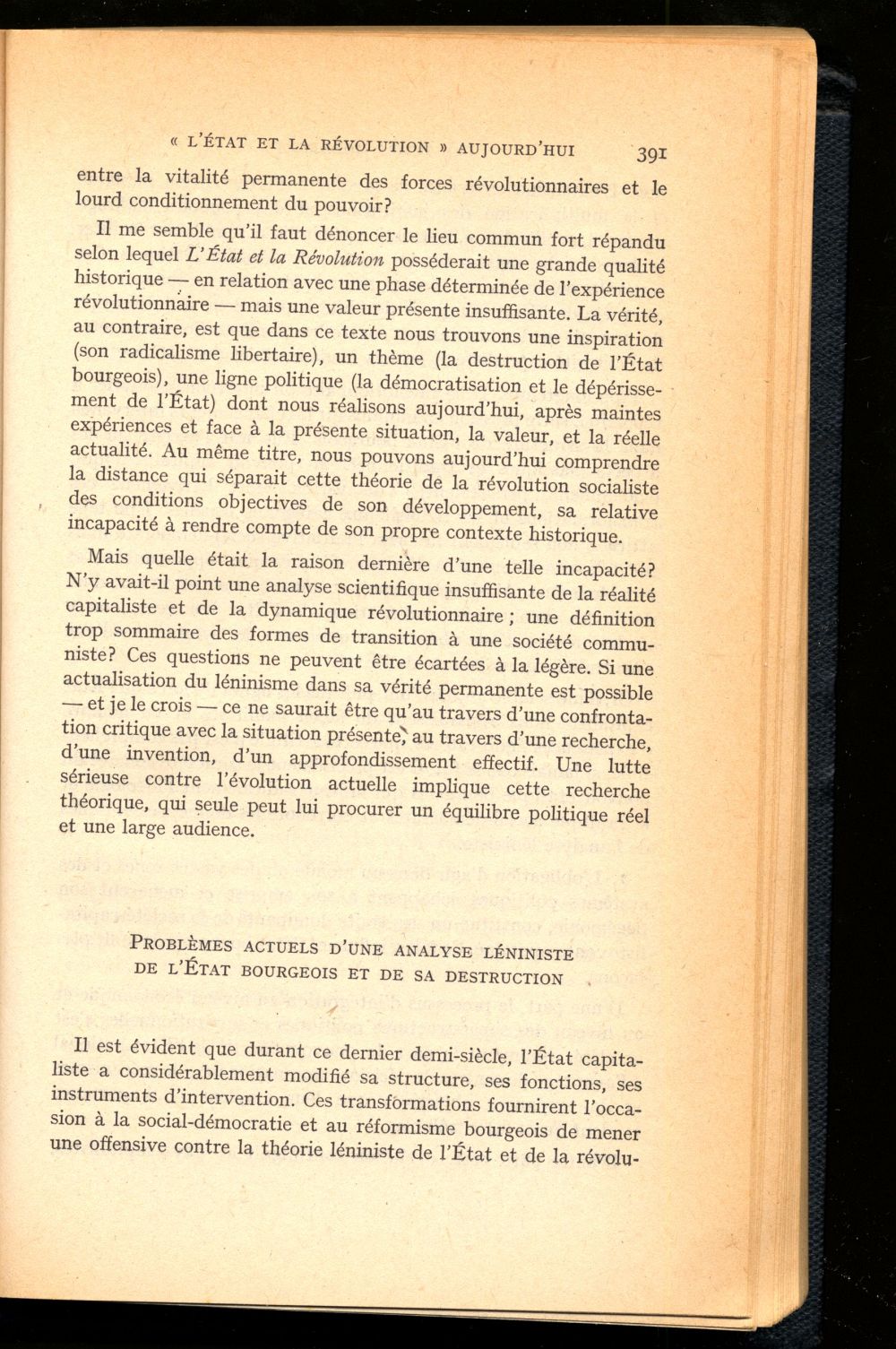

« L ETAT ET LA REVOLUTION » AUJOURD HUI
391
entre la vitalité permanente des forces révolutionnaires et le
lourd conditionnement du pouvoir?
lourd conditionnement du pouvoir?
Il me semble qu'il faut dénoncer le lieu commun fort répandu
selon lequel L'État et la Révolution posséderait une grande qualité
historique — en relation avec une phase déterminée de l'expérience
révolutionnaire — mais une valeur présente insuffisante. La vérité,
au contraire, est que dans ce texte nous trouvons une inspiration
(son radicalisme libertaire), un thème (la destruction de l'État
bourgeois), une ligne politique (la démocratisation et le dépérisse-
ment de l'État) dont nous réalisons aujourd'hui, après maintes
expériences et face à la présente situation, la valeur, et la réelle
actualité. Au même titre, nous pouvons aujourd'hui comprendre
la distance qui séparait cette théorie de la révolution socialiste
des conditions objectives de son développement, sa relative
incapacité à rendre compte de son propre contexte historique.
selon lequel L'État et la Révolution posséderait une grande qualité
historique — en relation avec une phase déterminée de l'expérience
révolutionnaire — mais une valeur présente insuffisante. La vérité,
au contraire, est que dans ce texte nous trouvons une inspiration
(son radicalisme libertaire), un thème (la destruction de l'État
bourgeois), une ligne politique (la démocratisation et le dépérisse-
ment de l'État) dont nous réalisons aujourd'hui, après maintes
expériences et face à la présente situation, la valeur, et la réelle
actualité. Au même titre, nous pouvons aujourd'hui comprendre
la distance qui séparait cette théorie de la révolution socialiste
des conditions objectives de son développement, sa relative
incapacité à rendre compte de son propre contexte historique.
Mais quelle était la raison dernière d'une telle incapacité?
N'y avait-il point une analyse scientifique insuffisante de la réalité
capitaliste et de la dynamique révolutionnaire ; une définition
trop sommaire des formes de transition à une société commu-
niste? Ces questions ne peuvent être écartées à la légère. Si une
actualisation du léninisme dans sa vérité permanente est possible
—- et je le crois — ce ne saurait être qu'au travers d'une confronta-
tion critique avec la situation présente^ au travers d'une recherche,
d'une invention, d'un approfondissement effectif. Une lutte
sérieuse contre l'évolution actuelle implique cette recherche
théorique, qui seule peut lui procurer un équilibre politique réel
et une large audience.
N'y avait-il point une analyse scientifique insuffisante de la réalité
capitaliste et de la dynamique révolutionnaire ; une définition
trop sommaire des formes de transition à une société commu-
niste? Ces questions ne peuvent être écartées à la légère. Si une
actualisation du léninisme dans sa vérité permanente est possible
—- et je le crois — ce ne saurait être qu'au travers d'une confronta-
tion critique avec la situation présente^ au travers d'une recherche,
d'une invention, d'un approfondissement effectif. Une lutte
sérieuse contre l'évolution actuelle implique cette recherche
théorique, qui seule peut lui procurer un équilibre politique réel
et une large audience.
PROBLÈMES ACTUELS D'UNE ANALYSE LÉNINISTE
DE L'ÉTAT BOURGEOIS ET DE SA DESTRUCTION
DE L'ÉTAT BOURGEOIS ET DE SA DESTRUCTION
II est évident que durant ce dernier demi-siècle, l'État capita-
liste a considérablement modifié sa structure, ses fonctions, ses
instruments d'intervention. Ces transformations fournirent l'occa-
sion à la social-démocratie et au réformisme bourgeois de mener
une offensive contre la théorie léniniste de l'État et de la révolu-
liste a considérablement modifié sa structure, ses fonctions, ses
instruments d'intervention. Ces transformations fournirent l'occa-
sion à la social-démocratie et au réformisme bourgeois de mener
une offensive contre la théorie léniniste de l'État et de la révolu-
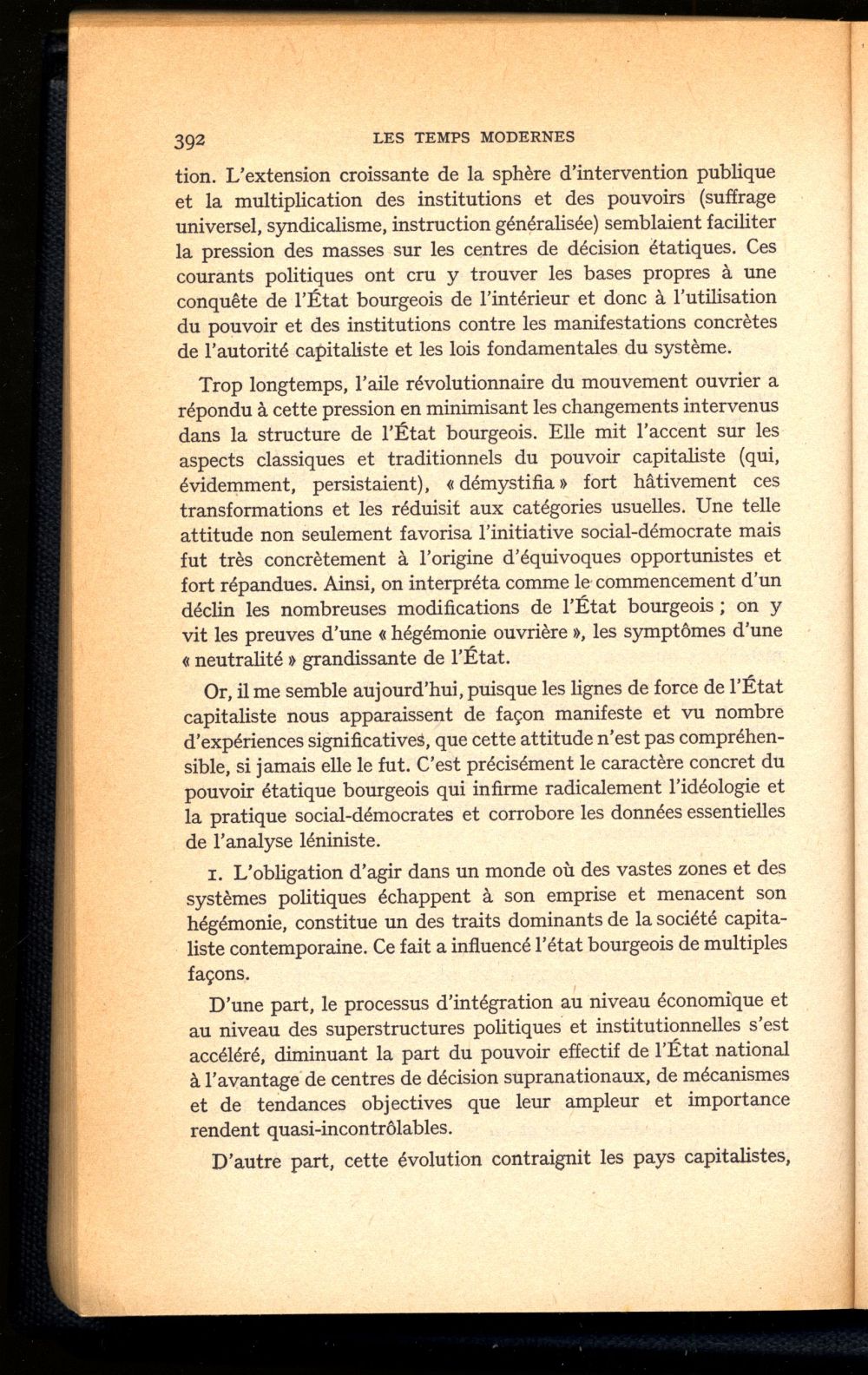

392
LES TEMPS MODERNES
tion. L'extension croissante de la sphère d'intervention publique
et la multiplication des institutions et des pouvoirs (suffrage
universel, syndicalisme, instruction généralisée) semblaient faciliter
la pression des masses sur les centres de décision étatiques. Ces
courants politiques ont cru y trouver les bases propres à une
conquête de l'État bourgeois de l'intérieur et donc à l'utilisation
du pouvoir et des institutions contre les manifestations concrètes
de l'autorité capitaliste et les lois fondamentales du système.
et la multiplication des institutions et des pouvoirs (suffrage
universel, syndicalisme, instruction généralisée) semblaient faciliter
la pression des masses sur les centres de décision étatiques. Ces
courants politiques ont cru y trouver les bases propres à une
conquête de l'État bourgeois de l'intérieur et donc à l'utilisation
du pouvoir et des institutions contre les manifestations concrètes
de l'autorité capitaliste et les lois fondamentales du système.
Trop longtemps, l'aile révolutionnaire du mouvement ouvrier a
répondu à cette pression en minimisant les changements intervenus
dans la structure de l'État bourgeois. Elle mit l'accent sur les
aspects classiques et traditionnels du pouvoir capitaliste (qui,
évidemment, persistaient), « démystifia » fort hâtivement ces
transformations et les réduisit aux catégories usuelles. Une telle
attitude non seulement favorisa l'initiative social-démocrate mais
fut très concrètement à l'origine d'équivoques opportunistes et
fort répandues. Ainsi, on interpréta comme le commencement d'un
déclin les nombreuses modifications de l'État bourgeois ; on y
vit les preuves d'une « hégémonie ouvrière », les symptômes d'une
« neutralité » grandissante de l'État.
répondu à cette pression en minimisant les changements intervenus
dans la structure de l'État bourgeois. Elle mit l'accent sur les
aspects classiques et traditionnels du pouvoir capitaliste (qui,
évidemment, persistaient), « démystifia » fort hâtivement ces
transformations et les réduisit aux catégories usuelles. Une telle
attitude non seulement favorisa l'initiative social-démocrate mais
fut très concrètement à l'origine d'équivoques opportunistes et
fort répandues. Ainsi, on interpréta comme le commencement d'un
déclin les nombreuses modifications de l'État bourgeois ; on y
vit les preuves d'une « hégémonie ouvrière », les symptômes d'une
« neutralité » grandissante de l'État.
Or, il me semble aujourd'hui, puisque les lignes de force de l'État
capitaliste nous apparaissent de façon manifeste et vu nombre
d'expériences significatives, que cette attitude n'est pas compréhen-
sible, si jamais elle le fut. C'est précisément le caractère concret du
pouvoir étatique bourgeois qui infirme radicalement l'idéologie et
la pratique social-démocrates et corrobore les données essentielles
de l'analyse léniniste.
capitaliste nous apparaissent de façon manifeste et vu nombre
d'expériences significatives, que cette attitude n'est pas compréhen-
sible, si jamais elle le fut. C'est précisément le caractère concret du
pouvoir étatique bourgeois qui infirme radicalement l'idéologie et
la pratique social-démocrates et corrobore les données essentielles
de l'analyse léniniste.
i. L'obligation d'agir dans un monde où des vastes zones et des
systèmes politiques échappent à son emprise et menacent son
hégémonie, constitue un des traits dominants de la société capita-
liste contemporaine. Ce fait a influencé l'état bourgeois de multiples
façons.
systèmes politiques échappent à son emprise et menacent son
hégémonie, constitue un des traits dominants de la société capita-
liste contemporaine. Ce fait a influencé l'état bourgeois de multiples
façons.
D'une part, le processus d'intégration au niveau économique et
au niveau des superstructures politiques et institutionnelles s'est
accéléré, diminuant la part du pouvoir effectif de l'État national
à l'avantage de centres de décision supranationaux, de mécanismes
et de tendances objectives que leur ampleur et importance
rendent quasi-incontrôlables.
au niveau des superstructures politiques et institutionnelles s'est
accéléré, diminuant la part du pouvoir effectif de l'État national
à l'avantage de centres de décision supranationaux, de mécanismes
et de tendances objectives que leur ampleur et importance
rendent quasi-incontrôlables.
D'autre part, cette évolution contraignit les pays capitalistes,


L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
393
et surtout les principales puissances, à engager une lutte contre
les États socialistes et les mouvements de libération des pays
sous-développés. Cette lutte — liée à la nécessité croissante de
trouver des débouchés pour le capital excédentaire et des secteurs
de dépenses improductives nécessaires à une politique anti-
cyclique — provoqua une militarisation accentuée des États et des
économies, différente quant à ses aspects et ses causes de celle
analysée par Lénine, mais non moins importante et considérable.
les États socialistes et les mouvements de libération des pays
sous-développés. Cette lutte — liée à la nécessité croissante de
trouver des débouchés pour le capital excédentaire et des secteurs
de dépenses improductives nécessaires à une politique anti-
cyclique — provoqua une militarisation accentuée des États et des
économies, différente quant à ses aspects et ses causes de celle
analysée par Lénine, mais non moins importante et considérable.
Aujourd'hui, disserter sur l'État bourgeois sans considérer ces
deux macro-phénomènes signifie, dès le départ, déformer les
traits les plus actuels de la réalité. Mais ces mêmes phénomènes
tendent déjà à invalider deux des postulats fondamentaux du
réformisme : la possibilité d'une lutte pour la transformation
sociale d'un pays qui ne participe pas activement à l'opposition
impérialisme - anti-impérialisme et dont il subit pourtant le
chantage et la violence ; la possibilité corrélative de soustraire, ne
serait-ce qu'imparfaitement, un seul pays capitaliste à l'ensemble
du système, ceci sans provoquer un bouleversement économique
profond et rapide et sans précipiter une crise radicale de sa stabilité
politique.
deux macro-phénomènes signifie, dès le départ, déformer les
traits les plus actuels de la réalité. Mais ces mêmes phénomènes
tendent déjà à invalider deux des postulats fondamentaux du
réformisme : la possibilité d'une lutte pour la transformation
sociale d'un pays qui ne participe pas activement à l'opposition
impérialisme - anti-impérialisme et dont il subit pourtant le
chantage et la violence ; la possibilité corrélative de soustraire, ne
serait-ce qu'imparfaitement, un seul pays capitaliste à l'ensemble
du système, ceci sans provoquer un bouleversement économique
profond et rapide et sans précipiter une crise radicale de sa stabilité
politique.
De plus, au sein des pays sous-développés ou en voie de déve-
loppement intégrés à l'ensemble capitaliste, s'affirme et se multiplie
un type d'État « sui generis » : un État devenu l'instrument, le
satellite de la métropole impérialiste qui lui offre les moyens de
constituer un moderne appareil de répression et de corruption.
Partant, il ne peut être ni transformé par une pression réformiste,
ni valablement combattu avec les méthodes traditionnelles de la
lutte politique et des mouvements de masse.
loppement intégrés à l'ensemble capitaliste, s'affirme et se multiplie
un type d'État « sui generis » : un État devenu l'instrument, le
satellite de la métropole impérialiste qui lui offre les moyens de
constituer un moderne appareil de répression et de corruption.
Partant, il ne peut être ni transformé par une pression réformiste,
ni valablement combattu avec les méthodes traditionnelles de la
lutte politique et des mouvements de masse.
2. Les institutions démocratiques et représentatives sont le
propre, sur le plan mondial, d'une part restreinte des pays capita-
listes. Or, dans ces pays, bien que solidement implantées elles sont
sujettes à des processus objectifs qui en affaiblissent le contenu
et en déforment la signification.
propre, sur le plan mondial, d'une part restreinte des pays capita-
listes. Or, dans ces pays, bien que solidement implantées elles sont
sujettes à des processus objectifs qui en affaiblissent le contenu
et en déforment la signification.
En fait, les fonctions mêmes de l'État capitaliste engendrent la
crise du système de la démocratie à tous les niveaux : parlement,
partis, assemblées régionales. Les choix qui traduisent véritable-
ment la réalité du nouveau pouvoir public (décisions d'investis-
sement, interventions anti-cycliques, gestion des services,
politique étrangère, politique des revenus) échappent à la discus-
crise du système de la démocratie à tous les niveaux : parlement,
partis, assemblées régionales. Les choix qui traduisent véritable-
ment la réalité du nouveau pouvoir public (décisions d'investis-
sement, interventions anti-cycliques, gestion des services,
politique étrangère, politique des revenus) échappent à la discus-
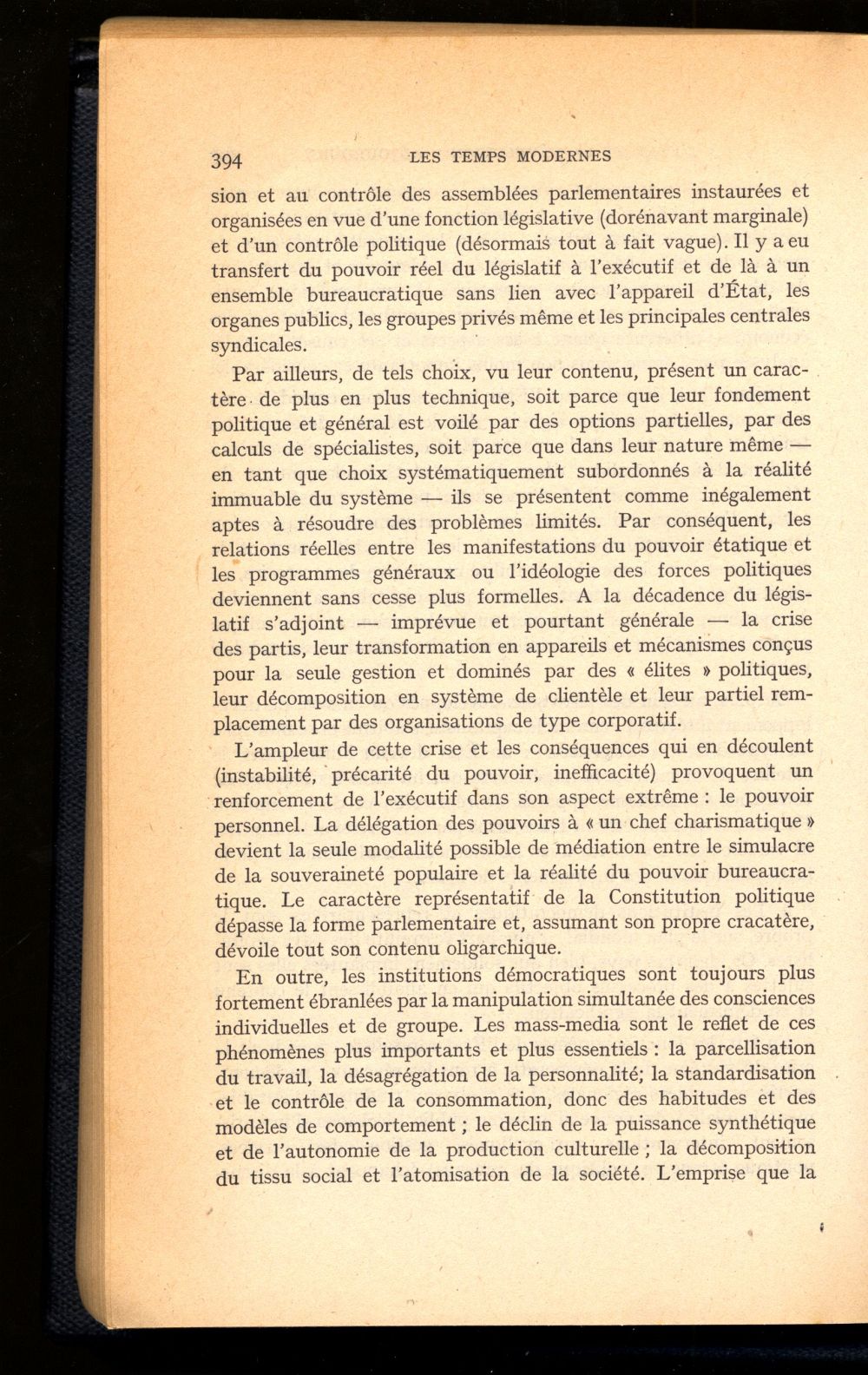

394
LES TEMPS MODERNES
sion et au contrôle des assemblées parlementaires instaurées et
organisées en vue d'une fonction législative (dorénavant marginale)
et d'un contrôle politique (désormais tout à fait vague). Il y a eu
transfert du pouvoir réel du législatif à l'exécutif et de là à un
ensemble bureaucratique sans lien avec l'appareil d'État, les
organes publics, les groupes privés même et les principales centrales
syndicales.
organisées en vue d'une fonction législative (dorénavant marginale)
et d'un contrôle politique (désormais tout à fait vague). Il y a eu
transfert du pouvoir réel du législatif à l'exécutif et de là à un
ensemble bureaucratique sans lien avec l'appareil d'État, les
organes publics, les groupes privés même et les principales centrales
syndicales.
Par ailleurs, de tels choix, vu leur contenu, présent un carac-
tère de plus en plus technique, soit parce que leur fondement
politique et général est voilé par des options partielles, par des
calculs de spécialistes, soit parce que dans leur nature même —
en tant que choix systématiquement subordonnés à la réalité
immuable du système — ils se présentent comme inégalement
aptes à résoudre des problèmes limités. Par conséquent, les
relations réelles entre les manifestations du pouvoir étatique et
les programmes généraux ou l'idéologie des forces politiques
deviennent sans cesse plus formelles. A la décadence du légis-
latif s'adjoint — imprévue et pourtant générale — la crise
des partis, leur transformation en appareils et mécanismes conçus
pour la seule gestion et dominés par des « élites » politiques,
leur décomposition en système de clientèle et leur partiel rem-
placement par des organisations de type corporatif.
tère de plus en plus technique, soit parce que leur fondement
politique et général est voilé par des options partielles, par des
calculs de spécialistes, soit parce que dans leur nature même —
en tant que choix systématiquement subordonnés à la réalité
immuable du système — ils se présentent comme inégalement
aptes à résoudre des problèmes limités. Par conséquent, les
relations réelles entre les manifestations du pouvoir étatique et
les programmes généraux ou l'idéologie des forces politiques
deviennent sans cesse plus formelles. A la décadence du légis-
latif s'adjoint — imprévue et pourtant générale — la crise
des partis, leur transformation en appareils et mécanismes conçus
pour la seule gestion et dominés par des « élites » politiques,
leur décomposition en système de clientèle et leur partiel rem-
placement par des organisations de type corporatif.
L'ampleur de cette crise et les conséquences qui en découlent
(instabilité, précarité du pouvoir, inefficacité) provoquent un
renforcement de l'exécutif dans son aspect extrême : le pouvoir
personnel. La délégation des pouvoirs à « un chef charismatique »
devient la seule modalité possible de médiation entre le simulacre
de la souveraineté populaire et la réalité du pouvoir bureaucra-
tique. Le caractère représentatif de la Constitution politique
dépasse la forme parlementaire et, assumant son propre cracatère,
dévoile tout son contenu oligarchique.
(instabilité, précarité du pouvoir, inefficacité) provoquent un
renforcement de l'exécutif dans son aspect extrême : le pouvoir
personnel. La délégation des pouvoirs à « un chef charismatique »
devient la seule modalité possible de médiation entre le simulacre
de la souveraineté populaire et la réalité du pouvoir bureaucra-
tique. Le caractère représentatif de la Constitution politique
dépasse la forme parlementaire et, assumant son propre cracatère,
dévoile tout son contenu oligarchique.
En outre, les institutions démocratiques sont toujours plus
fortement ébranlées par la manipulation simultanée des consciences
individuelles et de groupe. Les mass-media sont le reflet de ces
phénomènes plus importants et plus essentiels : la parcellisation
du travail, la désagrégation de la personnalité; la standardisation
et le contrôle de la consommation, donc des habitudes et des
modèles de comportement ; le déclin de la puissance synthétique
et de l'autonomie de la production culturelle ; la décomposition
du tissu social et l'atomisation de la société. L'emprise que la
fortement ébranlées par la manipulation simultanée des consciences
individuelles et de groupe. Les mass-media sont le reflet de ces
phénomènes plus importants et plus essentiels : la parcellisation
du travail, la désagrégation de la personnalité; la standardisation
et le contrôle de la consommation, donc des habitudes et des
modèles de comportement ; le déclin de la puissance synthétique
et de l'autonomie de la production culturelle ; la décomposition
du tissu social et l'atomisation de la société. L'emprise que la
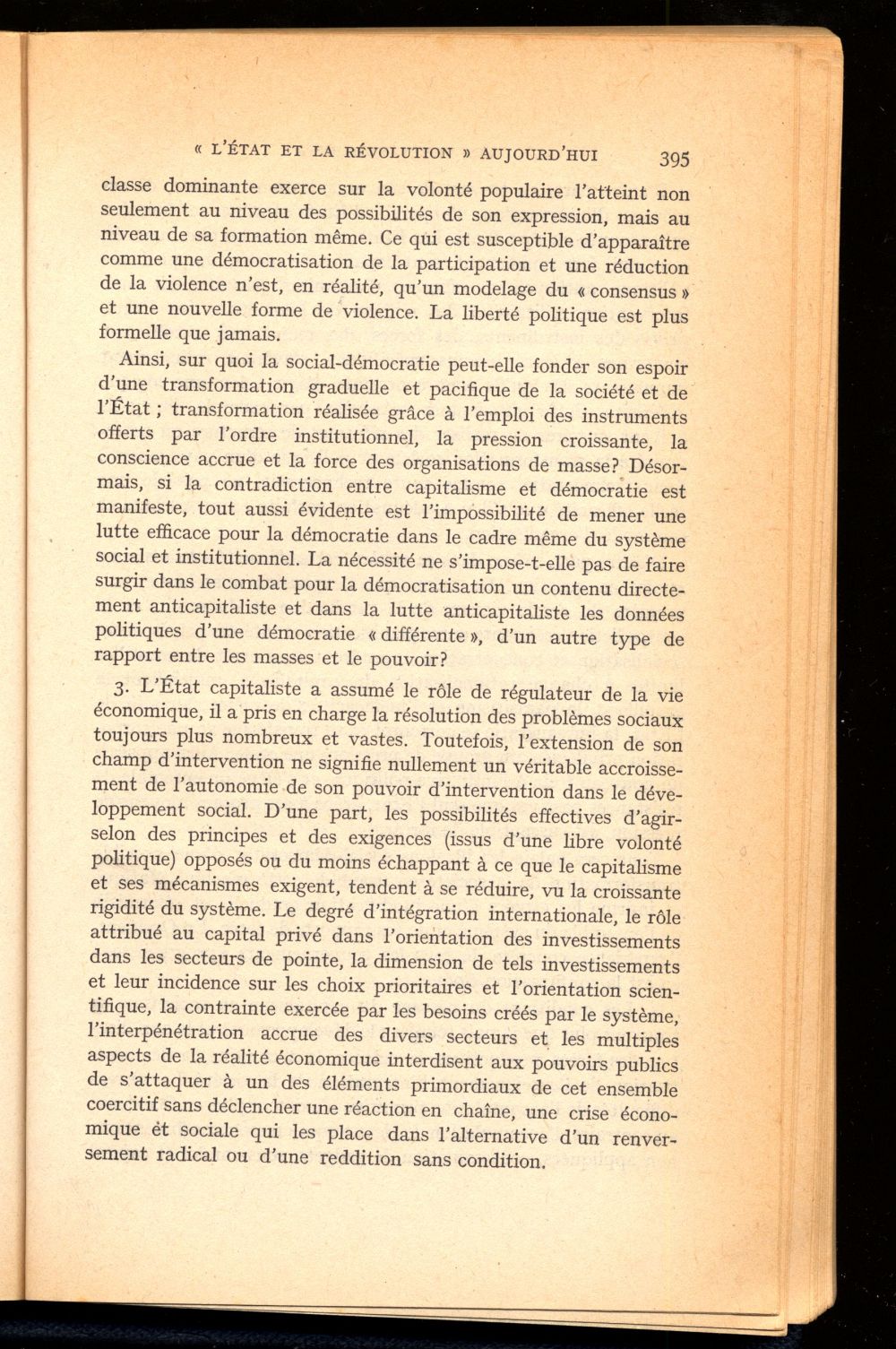

« L ETAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD HUI
395
classe dominante exerce sur la volonté populaire l'atteint non
seulement au niveau des possibilités de son expression, mais au
niveau de sa formation même. Ce qui est susceptible d'apparaître
comme une démocratisation de la participation et une réduction
de la violence n'est, en réalité, qu'un modelage du « consensus »
et une nouvelle forme de violence. La liberté politique est plus
formelle que jamais.
seulement au niveau des possibilités de son expression, mais au
niveau de sa formation même. Ce qui est susceptible d'apparaître
comme une démocratisation de la participation et une réduction
de la violence n'est, en réalité, qu'un modelage du « consensus »
et une nouvelle forme de violence. La liberté politique est plus
formelle que jamais.
Ainsi, sur quoi la social-démocratie peut-elle fonder son espoir
d'une transformation graduelle et pacifique de la société et de
l'État ; transformation réalisée grâce à l'emploi des instruments
offerts par l'ordre institutionnel, la pression croissante, la
conscience accrue et la force des organisations de masse? Désor-
mais, si la contradiction entre capitalisme et démocratie est
manifeste, tout aussi évidente est l'impossibilité de mener une
lutte efficace pour la démocratie dans le cadre même du système
social et institutionnel. La nécessité ne s'impose-t-elle pas de faire
surgir dans le combat pour la démocratisation un contenu directe-
ment anticapitaliste et dans la lutte anticapitaliste les données
politiques d'une démocratie « différente », d'un autre type de
rapport entre les masses et le pouvoir?
d'une transformation graduelle et pacifique de la société et de
l'État ; transformation réalisée grâce à l'emploi des instruments
offerts par l'ordre institutionnel, la pression croissante, la
conscience accrue et la force des organisations de masse? Désor-
mais, si la contradiction entre capitalisme et démocratie est
manifeste, tout aussi évidente est l'impossibilité de mener une
lutte efficace pour la démocratie dans le cadre même du système
social et institutionnel. La nécessité ne s'impose-t-elle pas de faire
surgir dans le combat pour la démocratisation un contenu directe-
ment anticapitaliste et dans la lutte anticapitaliste les données
politiques d'une démocratie « différente », d'un autre type de
rapport entre les masses et le pouvoir?
3. L'État capitaliste a assumé le rôle de régulateur de la vie
économique, il a pris en charge la résolution des problèmes sociaux
toujours plus nombreux et vastes. Toutefois, l'extension de son
champ d'intervention ne signifie nullement un véritable accroisse-
ment de l'autonomie de son pouvoir d'intervention dans le déve-
loppement social. D'une part, les possibilités effectives d'agir-
selon des principes et des exigences (issus d'une libre volonté
politique) opposés ou du moins échappant à ce que le capitalisme
et ses mécanismes exigent, tendent à se réduire, vu la croissante
rigidité du système. Le degré d'intégration internationale, le rôle
attribué au capital privé dans l'orientation des investissements
dans les secteurs de pointe, la dimension de tels investissements
et leur incidence sur les choix prioritaires et l'orientation scien-
tifique, la contrainte exercée par les besoins créés par le système,
l'interpénétration accrue des divers secteurs et les multiples
aspects de la réalité économique interdisent aux pouvoirs publics
de s'attaquer à un des éléments primordiaux de cet ensemble
coercitif sans déclencher une réaction en chaîne, une crise écono-
mique et sociale qui les place dans l'alternative d'un renver-
sement radical ou d'une reddition sans condition.
économique, il a pris en charge la résolution des problèmes sociaux
toujours plus nombreux et vastes. Toutefois, l'extension de son
champ d'intervention ne signifie nullement un véritable accroisse-
ment de l'autonomie de son pouvoir d'intervention dans le déve-
loppement social. D'une part, les possibilités effectives d'agir-
selon des principes et des exigences (issus d'une libre volonté
politique) opposés ou du moins échappant à ce que le capitalisme
et ses mécanismes exigent, tendent à se réduire, vu la croissante
rigidité du système. Le degré d'intégration internationale, le rôle
attribué au capital privé dans l'orientation des investissements
dans les secteurs de pointe, la dimension de tels investissements
et leur incidence sur les choix prioritaires et l'orientation scien-
tifique, la contrainte exercée par les besoins créés par le système,
l'interpénétration accrue des divers secteurs et les multiples
aspects de la réalité économique interdisent aux pouvoirs publics
de s'attaquer à un des éléments primordiaux de cet ensemble
coercitif sans déclencher une réaction en chaîne, une crise écono-
mique et sociale qui les place dans l'alternative d'un renver-
sement radical ou d'une reddition sans condition.
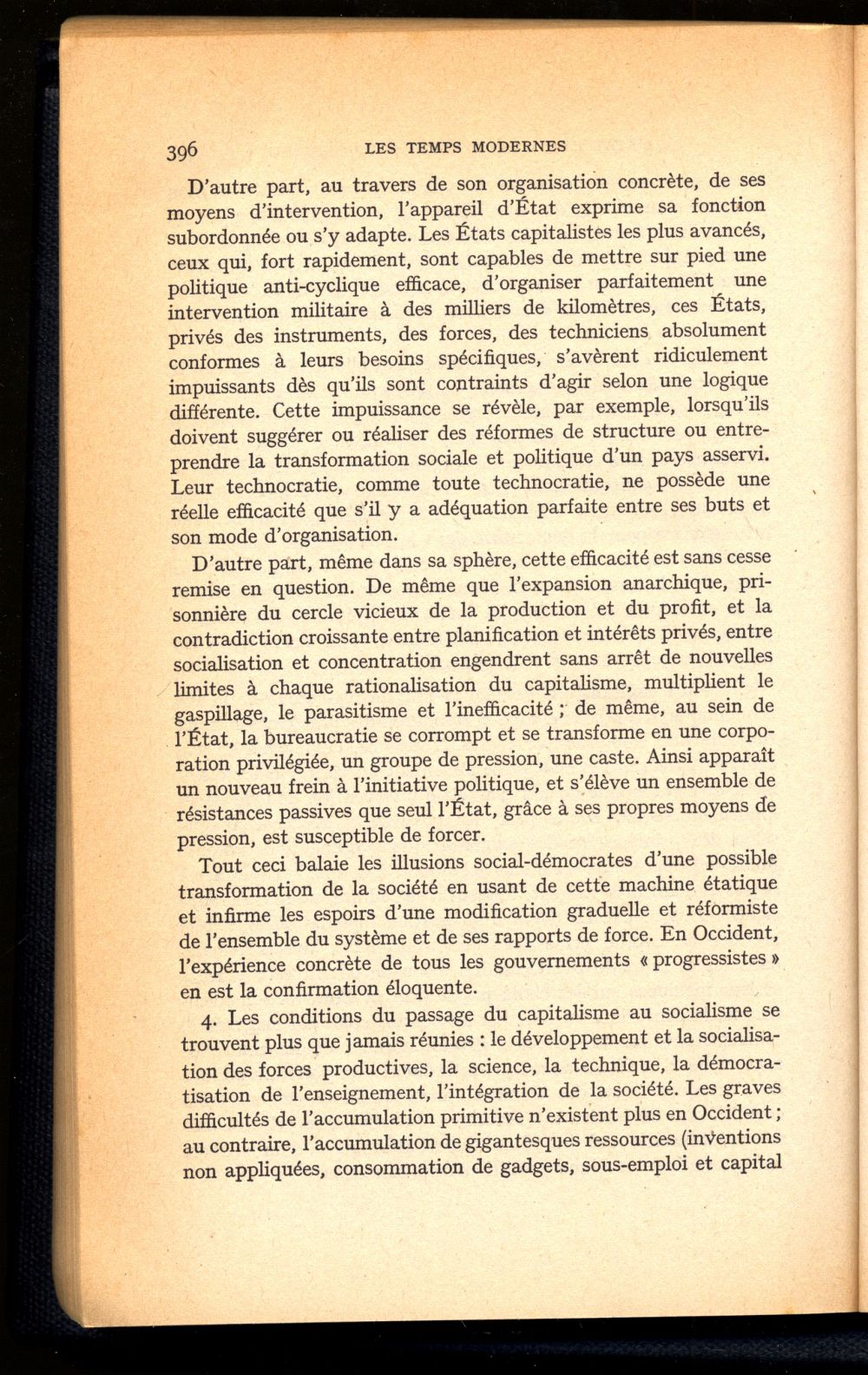

LES TEMPS MODERNES
D'autre part, au travers de son organisation concrète, de ses
moyens d'intervention, l'appareil d'État exprime sa fonction
subordonnée ou s'y adapte. Les États capitalistes les plus avancés,
ceux qui, fort rapidement, sont capables de mettre sur pied une
politique anti-cyclique efficace, d'organiser parfaitement une
intervention militaire à des milliers de kilomètres, ces États,
privés des instruments, des forces, des techniciens absolument
conformes à leurs besoins spécifiques, s'avèrent ridiculement
impuissants dès qu'ils sont contraints d'agir selon une logique
différente. Cette impuissance se révèle, par exemple, lorsqu'ils
doivent suggérer ou réaliser des réformes de structure ou entre-
prendre la transformation sociale et politique d'un pays asservi.
Leur technocratie, comme toute technocratie, ne possède une
réelle efficacité que s'il y a adéquation parfaite entre ses buts et
son mode d'organisation.
moyens d'intervention, l'appareil d'État exprime sa fonction
subordonnée ou s'y adapte. Les États capitalistes les plus avancés,
ceux qui, fort rapidement, sont capables de mettre sur pied une
politique anti-cyclique efficace, d'organiser parfaitement une
intervention militaire à des milliers de kilomètres, ces États,
privés des instruments, des forces, des techniciens absolument
conformes à leurs besoins spécifiques, s'avèrent ridiculement
impuissants dès qu'ils sont contraints d'agir selon une logique
différente. Cette impuissance se révèle, par exemple, lorsqu'ils
doivent suggérer ou réaliser des réformes de structure ou entre-
prendre la transformation sociale et politique d'un pays asservi.
Leur technocratie, comme toute technocratie, ne possède une
réelle efficacité que s'il y a adéquation parfaite entre ses buts et
son mode d'organisation.
D'autre part, même dans sa sphère, cette efficacité est sans cesse
remise en question. De même que l'expansion anarchique, pri-
sonnière du cercle vicieux de la production et du profit, et la
contradiction croissante entre planification et intérêts privés, entre
socialisation et concentration engendrent sans arrêt de nouvelles
limites à chaque rationalisation du capitalisme, multiplient le
gaspillage, le parasitisme et l'inefficacité ; de même, au sein de
l'État, la bureaucratie se corrompt et se transforme en une corpo-
ration privilégiée, un groupe de pression, une caste. Ainsi apparaît
un nouveau frein à l'initiative politique, et s'élève un ensemble de
résistances passives que seul l'État, grâce à ses propres moyens de
pression, est susceptible de forcer.
remise en question. De même que l'expansion anarchique, pri-
sonnière du cercle vicieux de la production et du profit, et la
contradiction croissante entre planification et intérêts privés, entre
socialisation et concentration engendrent sans arrêt de nouvelles
limites à chaque rationalisation du capitalisme, multiplient le
gaspillage, le parasitisme et l'inefficacité ; de même, au sein de
l'État, la bureaucratie se corrompt et se transforme en une corpo-
ration privilégiée, un groupe de pression, une caste. Ainsi apparaît
un nouveau frein à l'initiative politique, et s'élève un ensemble de
résistances passives que seul l'État, grâce à ses propres moyens de
pression, est susceptible de forcer.
Tout ceci balaie les illusions social-démocrates d'une possible
transformation de la société en usant de cette machine étatique
et infirme les espoirs d'une modification graduelle et réformiste
de l'ensemble du système et de ses rapports de force. En Occident,
l'expérience concrète de tous les gouvernements « progressistes »
en est la confirmation éloquente.
transformation de la société en usant de cette machine étatique
et infirme les espoirs d'une modification graduelle et réformiste
de l'ensemble du système et de ses rapports de force. En Occident,
l'expérience concrète de tous les gouvernements « progressistes »
en est la confirmation éloquente.
4. Les conditions du passage du capitalisme au socialisme se
trouvent plus que jamais réunies : le développement et la socialisa-
tion des forces productives, la science, la technique, la démocra-
tisation de l'enseignement, l'intégration de la société. Les graves
difficultés de l'accumulation primitive n'existent plus en Occident ;
au contraire, l'accumulation de gigantesques ressources (inventions
non appliquées, consommation de gadgets, sous-emploi et capital
trouvent plus que jamais réunies : le développement et la socialisa-
tion des forces productives, la science, la technique, la démocra-
tisation de l'enseignement, l'intégration de la société. Les graves
difficultés de l'accumulation primitive n'existent plus en Occident ;
au contraire, l'accumulation de gigantesques ressources (inventions
non appliquées, consommation de gadgets, sous-emploi et capital
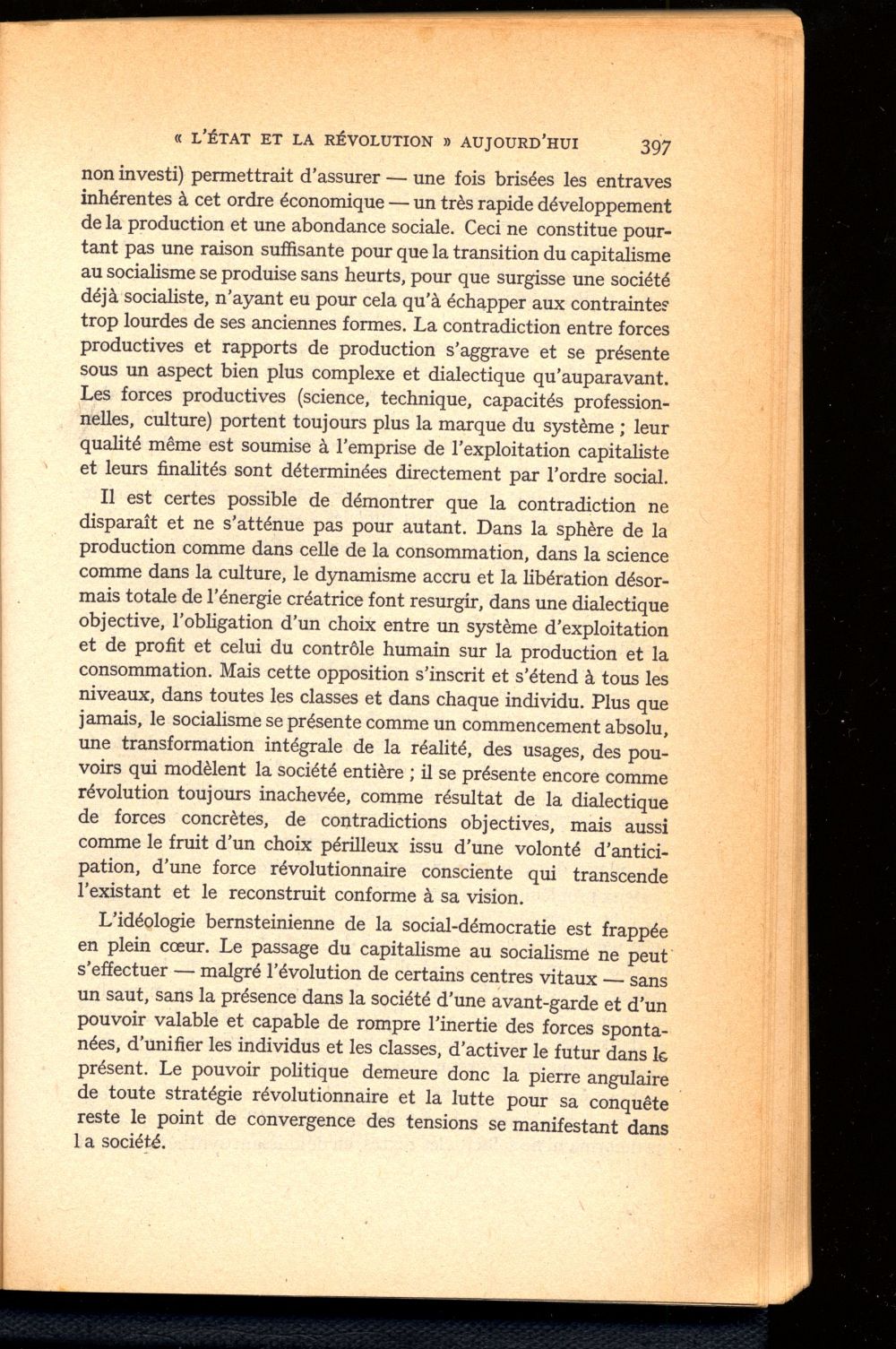

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
397
non investi) permettrait d'assurer — une fois brisées les entraves
inhérentes à cet ordre économique — un très rapide développement
de la production et une abondance sociale. Ceci ne constitue pour-
tant pas une raison suffisante pour que la transition du capitalisme
au socialisme se produise sans heurts, pour que surgisse une société
déjà socialiste, n'ayant eu pour cela qu'à échapper aux contrainte?
trop lourdes de ses anciennes formes. La contradiction entre forces
productives et rapports de production s'aggrave et se présente
sous un aspect bien plus complexe et dialectique qu'auparavant.
Les forces productives (science, technique, capacités profession-
nelles, culture) portent toujours plus la marque du système ; leur
qualité même est soumise à l'emprise de l'exploitation capitaliste
et leurs finalités sont déterminées directement par l'ordre social.
inhérentes à cet ordre économique — un très rapide développement
de la production et une abondance sociale. Ceci ne constitue pour-
tant pas une raison suffisante pour que la transition du capitalisme
au socialisme se produise sans heurts, pour que surgisse une société
déjà socialiste, n'ayant eu pour cela qu'à échapper aux contrainte?
trop lourdes de ses anciennes formes. La contradiction entre forces
productives et rapports de production s'aggrave et se présente
sous un aspect bien plus complexe et dialectique qu'auparavant.
Les forces productives (science, technique, capacités profession-
nelles, culture) portent toujours plus la marque du système ; leur
qualité même est soumise à l'emprise de l'exploitation capitaliste
et leurs finalités sont déterminées directement par l'ordre social.
Il est certes possible de démontrer que la contradiction ne
disparaît et ne s'atténue pas pour autant. Dans la sphère de la
production comme dans celle de la consommation, dans la science
comme dans la culture, le dynamisme accru et la libération désor-
mais totale de l'énergie créatrice font resurgir, dans une dialectique
objective, l'obligation d'un choix entre un système d'exploitation
et de profit et celui du contrôle humain sur la production et la
consommation. Mais cette opposition s'inscrit et s'étend à tous les
niveaux, dans toutes les classes et dans chaque individu. Plus que
jamais, le socialisme se présente comme un commencement absolu,
une transformation intégrale de la réalité, des usages, des pou-
voirs qui modèlent la société entière ; il se présente encore comme
révolution toujours inachevée, comme résultat de la dialectique
de forces concrètes, de contradictions objectives, mais aussi
comme le fruit d'un choix périlleux issu d'une volonté d'antici-
pation, d'une force révolutionnaire consciente qui transcende
l'existant et le reconstruit conforme à sa vision.
disparaît et ne s'atténue pas pour autant. Dans la sphère de la
production comme dans celle de la consommation, dans la science
comme dans la culture, le dynamisme accru et la libération désor-
mais totale de l'énergie créatrice font resurgir, dans une dialectique
objective, l'obligation d'un choix entre un système d'exploitation
et de profit et celui du contrôle humain sur la production et la
consommation. Mais cette opposition s'inscrit et s'étend à tous les
niveaux, dans toutes les classes et dans chaque individu. Plus que
jamais, le socialisme se présente comme un commencement absolu,
une transformation intégrale de la réalité, des usages, des pou-
voirs qui modèlent la société entière ; il se présente encore comme
révolution toujours inachevée, comme résultat de la dialectique
de forces concrètes, de contradictions objectives, mais aussi
comme le fruit d'un choix périlleux issu d'une volonté d'antici-
pation, d'une force révolutionnaire consciente qui transcende
l'existant et le reconstruit conforme à sa vision.
L'idéologie bernsteinienne de la social-démocratie est frappée
en plein cœur. Le passage du capitalisme au socialisme ne peut
s'effectuer — malgré l'évolution de certains centres vitaux — sans
un saut, sans la présence dans la société d'une avant-garde et d'un
pouvoir valable et capable de rompre l'inertie des forces sponta-
nées, d'unifier les individus et les classes, d'activer le futur dans k
présent. Le pouvoir politique demeure donc la pierre angulaire
de toute stratégie révolutionnaire et la lutte pour sa conquête
reste le point de convergence des tensions se manifestant dans
1 a société.
en plein cœur. Le passage du capitalisme au socialisme ne peut
s'effectuer — malgré l'évolution de certains centres vitaux — sans
un saut, sans la présence dans la société d'une avant-garde et d'un
pouvoir valable et capable de rompre l'inertie des forces sponta-
nées, d'unifier les individus et les classes, d'activer le futur dans k
présent. Le pouvoir politique demeure donc la pierre angulaire
de toute stratégie révolutionnaire et la lutte pour sa conquête
reste le point de convergence des tensions se manifestant dans
1 a société.
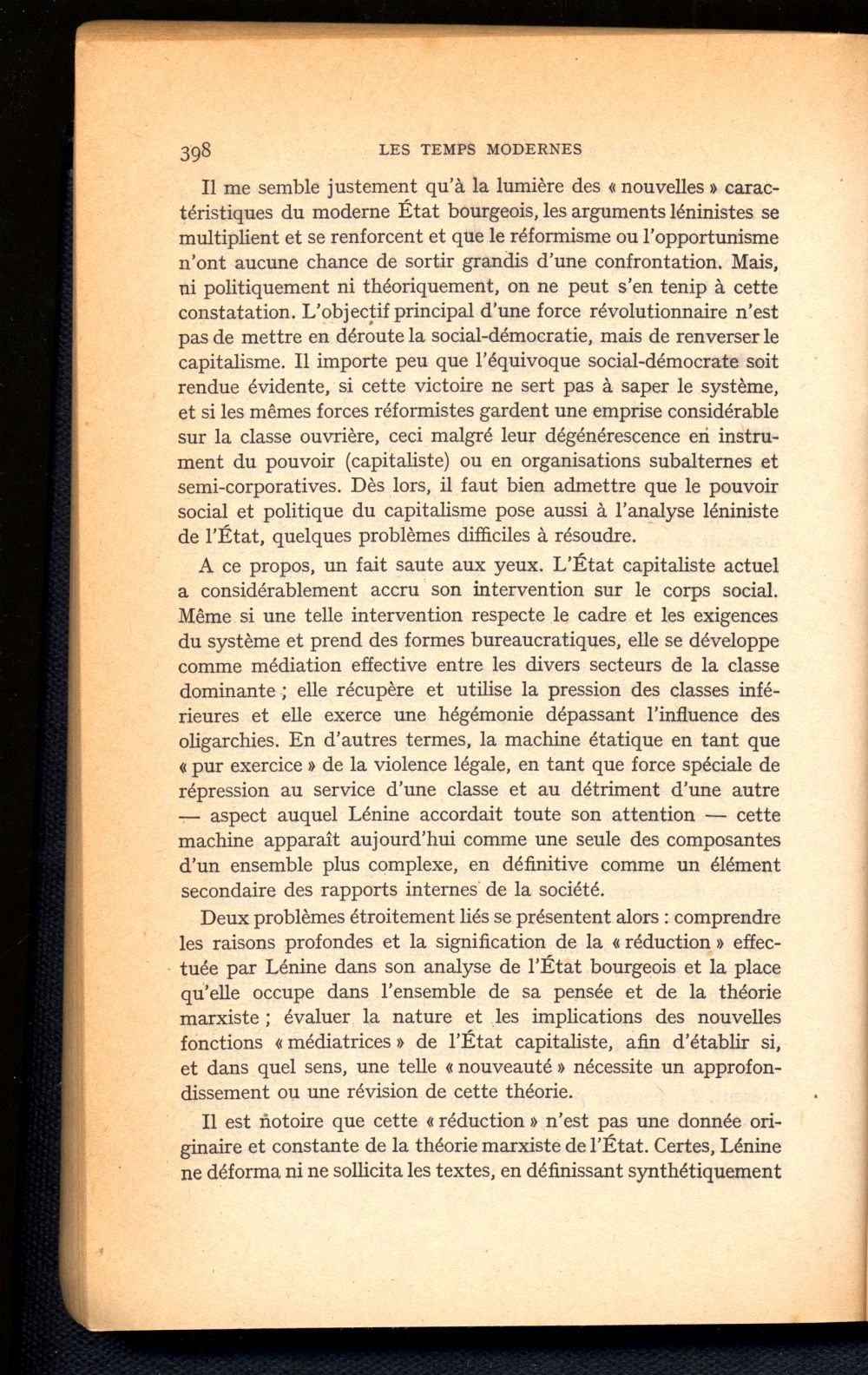

398 LES TEMPS MODERNES
II me semble justement qu'à la lumière des « nouvelles » carac-
téristiques du moderne État bourgeois, les arguments léninistes se
multiplient et se renforcent et que le réformisme ou l'opportunisme
n'ont aucune chance de sortir grandis d'une confrontation. Mais,
ni politiquement ni théoriquement, on ne peut s'en tenip à cette
constatation. L'objectif principal d'une force révolutionnaire n'est
pas de mettre en déroute la social-démocratie, mais de renverser le
capitalisme. Il importe peu que l'équivoque social-démocrate soit
rendue évidente, si cette victoire ne sert pas à saper le système,
et si les mêmes forces réformistes gardent une emprise considérable
sur la classe ouvrière, ceci malgré leur dégénérescence en instru-
ment du pouvoir (capitaliste) ou en organisations subalternes et
semi-corporatives. Dès lors, il faut bien admettre que le pouvoir
social et politique du capitalisme pose aussi à l'analyse léniniste
de l'État, quelques problèmes difficiles à résoudre.
téristiques du moderne État bourgeois, les arguments léninistes se
multiplient et se renforcent et que le réformisme ou l'opportunisme
n'ont aucune chance de sortir grandis d'une confrontation. Mais,
ni politiquement ni théoriquement, on ne peut s'en tenip à cette
constatation. L'objectif principal d'une force révolutionnaire n'est
pas de mettre en déroute la social-démocratie, mais de renverser le
capitalisme. Il importe peu que l'équivoque social-démocrate soit
rendue évidente, si cette victoire ne sert pas à saper le système,
et si les mêmes forces réformistes gardent une emprise considérable
sur la classe ouvrière, ceci malgré leur dégénérescence en instru-
ment du pouvoir (capitaliste) ou en organisations subalternes et
semi-corporatives. Dès lors, il faut bien admettre que le pouvoir
social et politique du capitalisme pose aussi à l'analyse léniniste
de l'État, quelques problèmes difficiles à résoudre.
A ce propos, un fait saute aux yeux. L'État capitaliste actuel
a considérablement accru son intervention sur le corps social.
Même si une telle intervention respecte le cadre et les exigences
du système et prend des formes bureaucratiques, elle se développe
comme médiation effective entre les divers secteurs de la classe
dominante ; elle récupère et utilise la pression des classes infé-
rieures et elle exerce une hégémonie dépassant l'influence des
oligarchies. En d'autres termes, la machine étatique en tant que
« pur exercice » de la violence légale, en tant que force spéciale de
répression au service d'une classe et au détriment d'une autre
— aspect auquel Lénine accordait toute son attention — cette
machine apparaît aujourd'hui comme une seule des composantes
d'un ensemble plus complexe, en définitive comme un élément
secondaire des rapports internes de la société.
a considérablement accru son intervention sur le corps social.
Même si une telle intervention respecte le cadre et les exigences
du système et prend des formes bureaucratiques, elle se développe
comme médiation effective entre les divers secteurs de la classe
dominante ; elle récupère et utilise la pression des classes infé-
rieures et elle exerce une hégémonie dépassant l'influence des
oligarchies. En d'autres termes, la machine étatique en tant que
« pur exercice » de la violence légale, en tant que force spéciale de
répression au service d'une classe et au détriment d'une autre
— aspect auquel Lénine accordait toute son attention — cette
machine apparaît aujourd'hui comme une seule des composantes
d'un ensemble plus complexe, en définitive comme un élément
secondaire des rapports internes de la société.
Deux problèmes étroitement liés se présentent alors : comprendre
les raisons profondes et la signification de la « réduction » effec-
tuée par Lénine dans son analyse de l'État bourgeois et la place
qu'elle occupe dans l'ensemble de sa pensée et de la théorie
marxiste ; évaluer la nature et les implications des nouvelles
fonctions « médiatrices » de l'État capitaliste, afin d'établir si,
et dans quel sens, une telle « nouveauté » nécessite un approfon-
dissement ou une révision de cette théorie.
les raisons profondes et la signification de la « réduction » effec-
tuée par Lénine dans son analyse de l'État bourgeois et la place
qu'elle occupe dans l'ensemble de sa pensée et de la théorie
marxiste ; évaluer la nature et les implications des nouvelles
fonctions « médiatrices » de l'État capitaliste, afin d'établir si,
et dans quel sens, une telle « nouveauté » nécessite un approfon-
dissement ou une révision de cette théorie.
Il est notoire que cette « réduction » n'est pas une donnée ori-
ginaire et constante de la théorie marxiste de l'État. Certes, Lénine
ne déforma ni ne sollicita les textes, en définissant synthétiquement
ginaire et constante de la théorie marxiste de l'État. Certes, Lénine
ne déforma ni ne sollicita les textes, en définissant synthétiquement
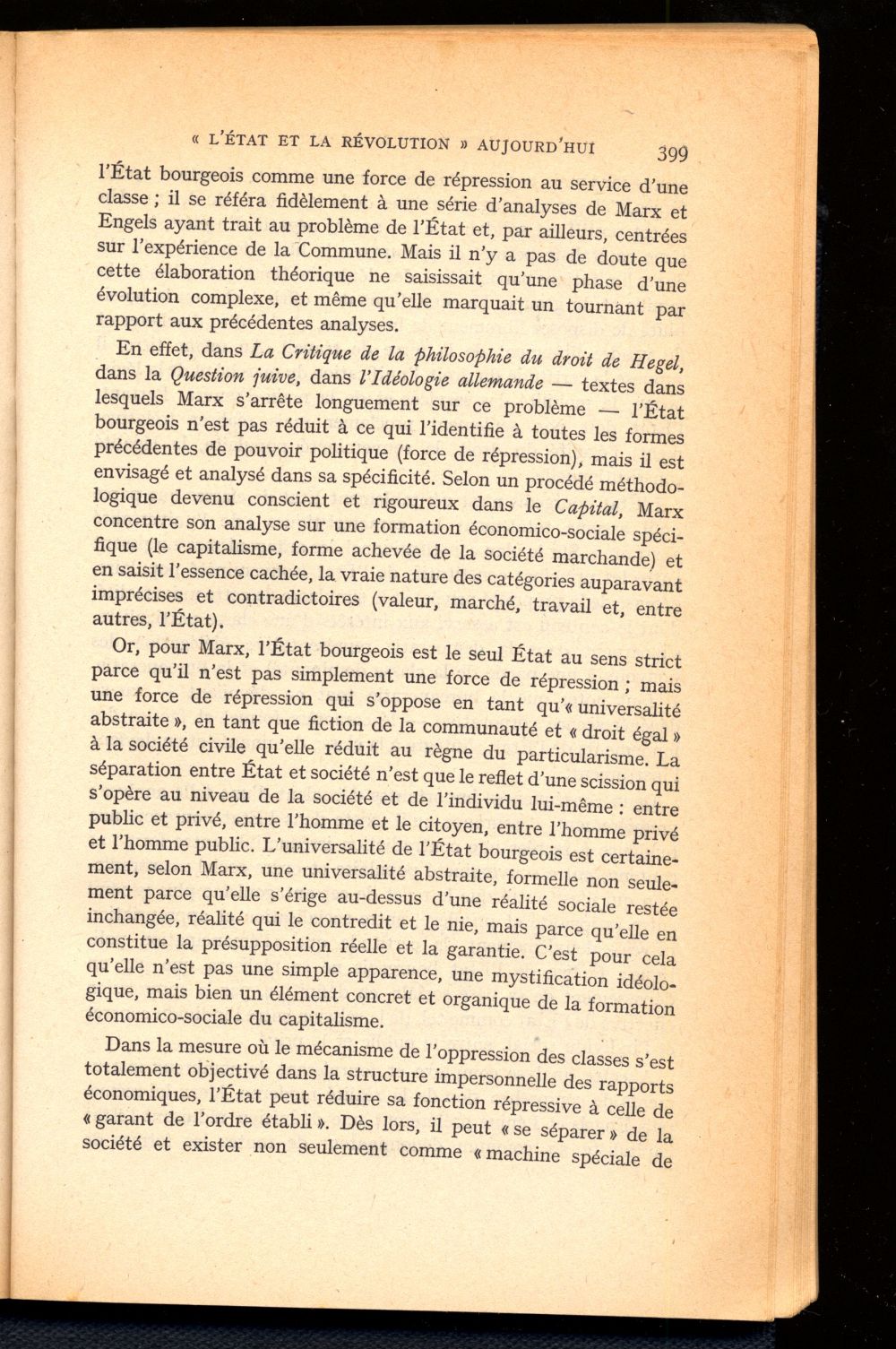

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
l'État bourgeois comme une force de répression au service d'une
classe ; il se référa fidèlement à une série d'analyses de Marx et
Engels ayant trait au problème de l'État et, par ailleurs centrées
sur l'expérience de la Commune. Mais il n'y a pas de doute
cette élaboration théorique ne saisissait qu'une phase d'une
évolution complexe, et même qu'elle marquait un tournant par
rapport aux précédentes analyses.
classe ; il se référa fidèlement à une série d'analyses de Marx et
Engels ayant trait au problème de l'État et, par ailleurs centrées
sur l'expérience de la Commune. Mais il n'y a pas de doute
cette élaboration théorique ne saisissait qu'une phase d'une
évolution complexe, et même qu'elle marquait un tournant par
rapport aux précédentes analyses.
En effet, dans La Critique de la philosophie du droit de Hegel
dans la Question juive, dans l'Idéologie allemande — textes dans
lesquels Marx s'arrête longuement sur ce problème — l'État
bourgeois n'est pas réduit à ce qui l'identifie à toutes les formes
précédentes de pouvoir politique (force de répression) mais il est
envisagé et analysé dans sa spécificité. Selon un procédé méthodo
logique devenu conscient et rigoureux dans le Capital Marx
concentre son analyse sur une formation économico-sociale spéci
fique (le capitalisme, forme achevée de la société marchande) et
en saisit l'essence cachée, la vraie nature des catégories auparavant
imprécises et contradictoires (valeur, marché, travail et enrre
autres, l'Etat). '
dans la Question juive, dans l'Idéologie allemande — textes dans
lesquels Marx s'arrête longuement sur ce problème — l'État
bourgeois n'est pas réduit à ce qui l'identifie à toutes les formes
précédentes de pouvoir politique (force de répression) mais il est
envisagé et analysé dans sa spécificité. Selon un procédé méthodo
logique devenu conscient et rigoureux dans le Capital Marx
concentre son analyse sur une formation économico-sociale spéci
fique (le capitalisme, forme achevée de la société marchande) et
en saisit l'essence cachée, la vraie nature des catégories auparavant
imprécises et contradictoires (valeur, marché, travail et enrre
autres, l'Etat). '
Or, pour Marx, l'État bourgeois est le seul État au sens strict
parce qu'il n'est pas simplement une force de répression • mais
une force de répression qui s'oppose en tant qu'« universalité
abstraite », en tant que fiction de la communauté et « droit éeal »
à la société civile^qu'elle réduit au règne du particularisme La
séparation entre Etat et société n'est que le reflet d'une scission qui
s opère au niveau de la société et de l'individu lui-même • entre
public et privé entre l'homme et le citoyen, entre l'homme privé
et 1 homme public. L'universalité de l'État bourgeois est certaine
ment, selon Marx, une universalité abstraite, formelle non seule
ment parce qu'elle s'érige au-dessus d'une réalité sociale restée
inchangée réalité qui le contredit et le nie, mais parce qu'elle en
constitue la présupposition réelle et la garantie. C'est pour cda
quelle n est pas une simple apparence, une mystification idéolo-
gique, mais bien un élément concret et organique de la formation
économico-sociale du capitalisme. "«ion
parce qu'il n'est pas simplement une force de répression • mais
une force de répression qui s'oppose en tant qu'« universalité
abstraite », en tant que fiction de la communauté et « droit éeal »
à la société civile^qu'elle réduit au règne du particularisme La
séparation entre Etat et société n'est que le reflet d'une scission qui
s opère au niveau de la société et de l'individu lui-même • entre
public et privé entre l'homme et le citoyen, entre l'homme privé
et 1 homme public. L'universalité de l'État bourgeois est certaine
ment, selon Marx, une universalité abstraite, formelle non seule
ment parce qu'elle s'érige au-dessus d'une réalité sociale restée
inchangée réalité qui le contredit et le nie, mais parce qu'elle en
constitue la présupposition réelle et la garantie. C'est pour cda
quelle n est pas une simple apparence, une mystification idéolo-
gique, mais bien un élément concret et organique de la formation
économico-sociale du capitalisme. "«ion
Dans la mesure où le mécanisme de l'oppression des classes s'est
totalement objective dans la structure impersonnelle des rapports
économiques, 1 Etat peut réduire sa fonction répressive à cSTde
«garant de l'ordre établi». Dès lors, il peut «se séparer» de î
société et exister non seulement comme «machine spéciale de
totalement objective dans la structure impersonnelle des rapports
économiques, 1 Etat peut réduire sa fonction répressive à cSTde
«garant de l'ordre établi». Dès lors, il peut «se séparer» de î
société et exister non seulement comme «machine spéciale de
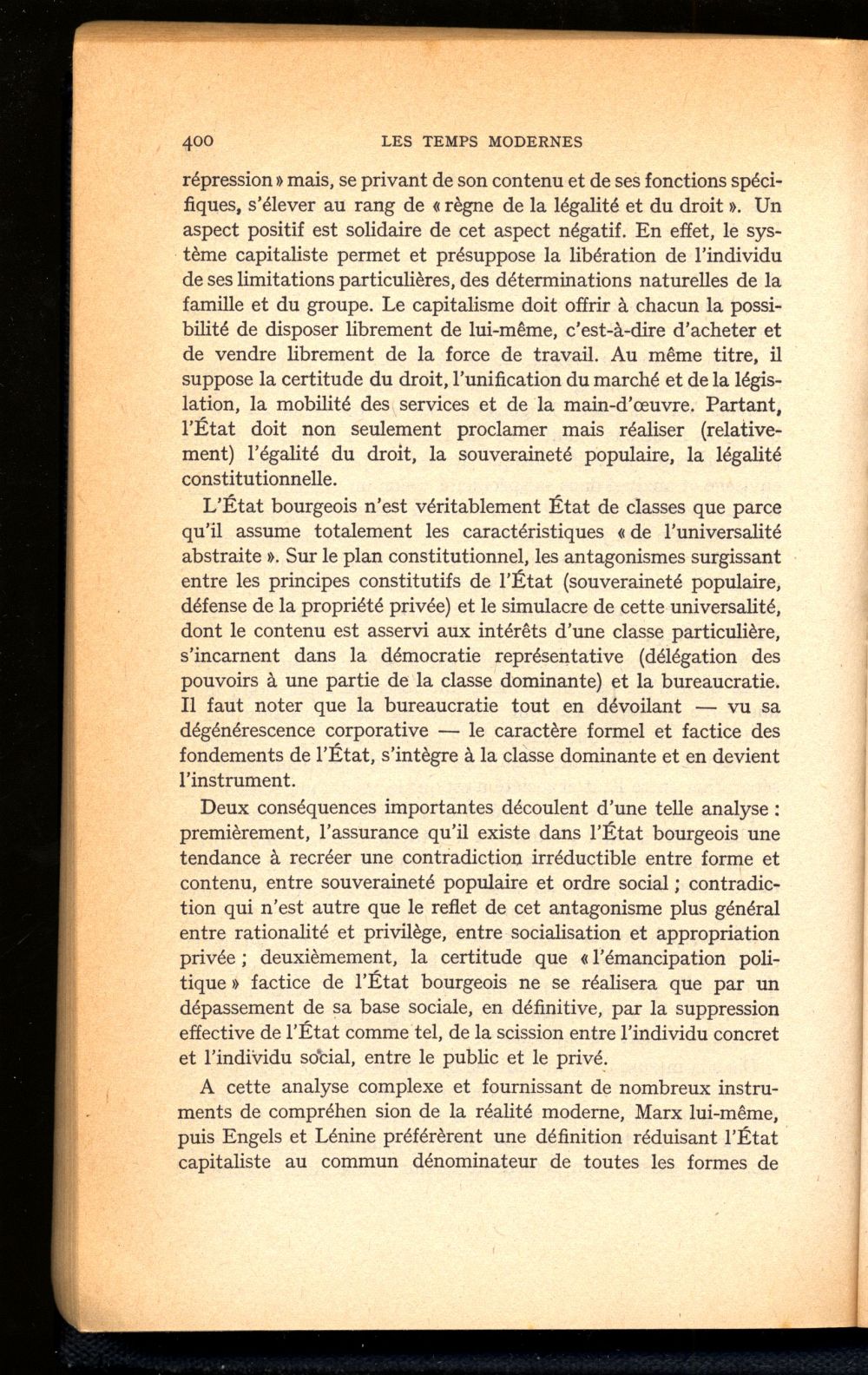

400
LES TEMPS MODERNES
répression » mais, se privant de son contenu et de ses fonctions spéci-
fiques, s'élever au rang de « règne de la légalité et du droit ». Un
aspect positif est solidaire de cet aspect négatif. En effet, le sys-
tème capitaliste permet et présuppose la libération de l'individu
de ses limitations particulières, des déterminations naturelles de la
famille et du groupe. Le capitalisme doit offrir à chacun la possi-
bilité de disposer librement de lui-même, c'est-à-dire d'acheter et
de vendre librement de la force de travail. Au même titre, il
suppose la certitude du droit, l'unification du marché et de la légis-
lation, la mobilité des services et de la main-d'œuvre. Partant,
l'État doit non seulement proclamer mais réaliser (relative-
ment) l'égalité du droit, la souveraineté populaire, la légalité
constitutionnelle.
fiques, s'élever au rang de « règne de la légalité et du droit ». Un
aspect positif est solidaire de cet aspect négatif. En effet, le sys-
tème capitaliste permet et présuppose la libération de l'individu
de ses limitations particulières, des déterminations naturelles de la
famille et du groupe. Le capitalisme doit offrir à chacun la possi-
bilité de disposer librement de lui-même, c'est-à-dire d'acheter et
de vendre librement de la force de travail. Au même titre, il
suppose la certitude du droit, l'unification du marché et de la légis-
lation, la mobilité des services et de la main-d'œuvre. Partant,
l'État doit non seulement proclamer mais réaliser (relative-
ment) l'égalité du droit, la souveraineté populaire, la légalité
constitutionnelle.
L'État bourgeois n'est véritablement État de classes que parce
qu'il assume totalement les caractéristiques « de l'universalité
abstraite ». Sur le plan constitutionnel, les antagonismes surgissant
entre les principes constitutifs de l'État (souveraineté populaire,
défense de la propriété privée) et le simulacre de cette universalité,
dont le contenu est asservi aux intérêts d'une classe particulière,
s'incarnent dans la démocratie représentative (délégation des
pouvoirs à une partie de la classe dominante) et la bureaucratie.
Il faut noter que la bureaucratie tout en dévoilant — vu sa
dégénérescence corporative — le caractère formel et factice des
fondements de l'État, s'intègre à la classe dominante et en devient
l'instrument.
qu'il assume totalement les caractéristiques « de l'universalité
abstraite ». Sur le plan constitutionnel, les antagonismes surgissant
entre les principes constitutifs de l'État (souveraineté populaire,
défense de la propriété privée) et le simulacre de cette universalité,
dont le contenu est asservi aux intérêts d'une classe particulière,
s'incarnent dans la démocratie représentative (délégation des
pouvoirs à une partie de la classe dominante) et la bureaucratie.
Il faut noter que la bureaucratie tout en dévoilant — vu sa
dégénérescence corporative — le caractère formel et factice des
fondements de l'État, s'intègre à la classe dominante et en devient
l'instrument.
Deux conséquences importantes découlent d'une telle analyse :
premièrement, l'assurance qu'il existe dans l'État bourgeois une
tendance à recréer une contradiction irréductible entre forme et
contenu, entre souveraineté populaire et ordre social ; contradic-
tion qui n'est autre que le reflet de cet antagonisme plus général
entre rationalité et privilège, entre socialisation et appropriation
privée ; deuxièmement, la certitude que « l'émancipation poli-
tique » factice de l'État bourgeois ne se réalisera que par un
dépassement de sa base sociale, en définitive, par la suppression
effective de l'État comme tel, de la scission entre l'individu concret
et l'individu social, entre le public et le privé.
premièrement, l'assurance qu'il existe dans l'État bourgeois une
tendance à recréer une contradiction irréductible entre forme et
contenu, entre souveraineté populaire et ordre social ; contradic-
tion qui n'est autre que le reflet de cet antagonisme plus général
entre rationalité et privilège, entre socialisation et appropriation
privée ; deuxièmement, la certitude que « l'émancipation poli-
tique » factice de l'État bourgeois ne se réalisera que par un
dépassement de sa base sociale, en définitive, par la suppression
effective de l'État comme tel, de la scission entre l'individu concret
et l'individu social, entre le public et le privé.
A cette analyse complexe et fournissant de nombreux instru-
ments de compréhen sion de la réalité moderne, Marx lui-même,
puis Engels et Lénine préférèrent une définition réduisant l'État
capitaliste au commun dénominateur de toutes les formes de
ments de compréhen sion de la réalité moderne, Marx lui-même,
puis Engels et Lénine préférèrent une définition réduisant l'État
capitaliste au commun dénominateur de toutes les formes de
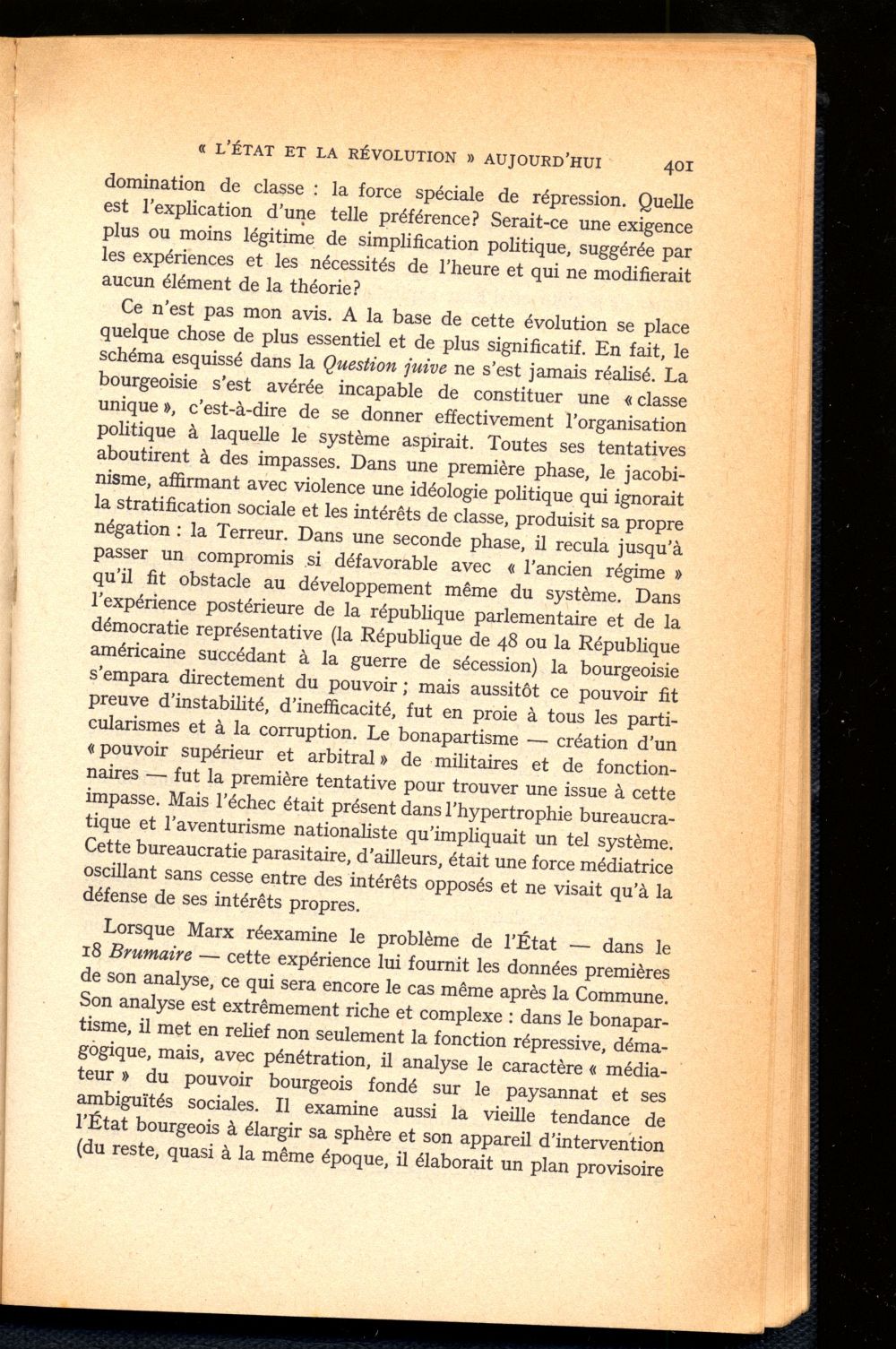

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
401
domination de classe : la force spéciale de répression. Quelle
est l'explication d'une telle préférence? Serait-ce une exigence
plus ou moins légitime de simplification politique, suggérée par
les expériences et les nécessités de l'heure et qui ne modifierait
aucun élément de la théorie?
est l'explication d'une telle préférence? Serait-ce une exigence
plus ou moins légitime de simplification politique, suggérée par
les expériences et les nécessités de l'heure et qui ne modifierait
aucun élément de la théorie?
Ce n'est pas mon avis. A la base de cette évolution se place
quelque chose de plus essentiel et de plus significatif. En fait, le
schéma esquissé dans la Question juive ne s'est jamais réalisé. La
bourgeoisie s'est avérée incapable de constituer une « classe
unique », c'est-à-dire de se donner effectivement l'organisation
politique à laquelle le système aspirait. Toutes ses tentatives
aboutirent à des impasses. Dans une première phase, le jacobi-
nisme, affirmant avec violence une idéologie politique qui ignorait
la stratification sociale et les intérêts de classe, produisit sa propre
négation : la Terreur. Dans une seconde phase, il recula jusqu'à
passer un compromis si défavorable avec « l'ancien régime »
qu'il fit obstacle au développement même du système. Dans
l'expérience postérieure de la république parlementaire et de la
démocratie représentative (la République de 48 ou la République
américaine succédant à la guerre de sécession) la bourgeoisie
s'empara directement du pouvoir ; mais aussitôt ce pouvoir fit
preuve d'instabilité, d'inefficacité, fut en proie à tous les parti-
cularismes et à la corruption. Le bonapartisme — création d'un
« pouvoir supérieur et arbitral » de militaires et de fonction-
naires — fut la première tentative pour trouver une issue à cette
impasse. Mais l'échec était présent dans l'hypertrophie bureaucra-
tique et l'aventurisme nationaliste qu'impliquait un tel système.
Cette bureaucratie parasitaire, d'ailleurs, était une force médiatrice
oscillant sans cesse entre des intérêts opposés et ne visait qu'à la
défense de ses intérêts propres.
quelque chose de plus essentiel et de plus significatif. En fait, le
schéma esquissé dans la Question juive ne s'est jamais réalisé. La
bourgeoisie s'est avérée incapable de constituer une « classe
unique », c'est-à-dire de se donner effectivement l'organisation
politique à laquelle le système aspirait. Toutes ses tentatives
aboutirent à des impasses. Dans une première phase, le jacobi-
nisme, affirmant avec violence une idéologie politique qui ignorait
la stratification sociale et les intérêts de classe, produisit sa propre
négation : la Terreur. Dans une seconde phase, il recula jusqu'à
passer un compromis si défavorable avec « l'ancien régime »
qu'il fit obstacle au développement même du système. Dans
l'expérience postérieure de la république parlementaire et de la
démocratie représentative (la République de 48 ou la République
américaine succédant à la guerre de sécession) la bourgeoisie
s'empara directement du pouvoir ; mais aussitôt ce pouvoir fit
preuve d'instabilité, d'inefficacité, fut en proie à tous les parti-
cularismes et à la corruption. Le bonapartisme — création d'un
« pouvoir supérieur et arbitral » de militaires et de fonction-
naires — fut la première tentative pour trouver une issue à cette
impasse. Mais l'échec était présent dans l'hypertrophie bureaucra-
tique et l'aventurisme nationaliste qu'impliquait un tel système.
Cette bureaucratie parasitaire, d'ailleurs, était une force médiatrice
oscillant sans cesse entre des intérêts opposés et ne visait qu'à la
défense de ses intérêts propres.
Lorsque Marx réexamine le problème de l'État — dans le
18 Brumaire — cette expérience lui fournit les données premières
de son analyse, ce qui sera encore le cas même après la Commune.
Son analyse est extrêmement riche et complexe : dans le bonapar-
tisme, il met en relief non seulement la fonction répressive, déma-
gogique, mais, avec pénétration, il analyse le caractère « média-
teur » du pouvoir bourgeois fondé sur le paysannat et ses
ambiguïtés sociales. Il examine aussi la vieille tendance de
l'État bourgeois à élargir sa sphère et son appareil d'intervention
(du reste, quasi à la même époque, il élaborait un plan provisoire
18 Brumaire — cette expérience lui fournit les données premières
de son analyse, ce qui sera encore le cas même après la Commune.
Son analyse est extrêmement riche et complexe : dans le bonapar-
tisme, il met en relief non seulement la fonction répressive, déma-
gogique, mais, avec pénétration, il analyse le caractère « média-
teur » du pouvoir bourgeois fondé sur le paysannat et ses
ambiguïtés sociales. Il examine aussi la vieille tendance de
l'État bourgeois à élargir sa sphère et son appareil d'intervention
(du reste, quasi à la même époque, il élaborait un plan provisoire
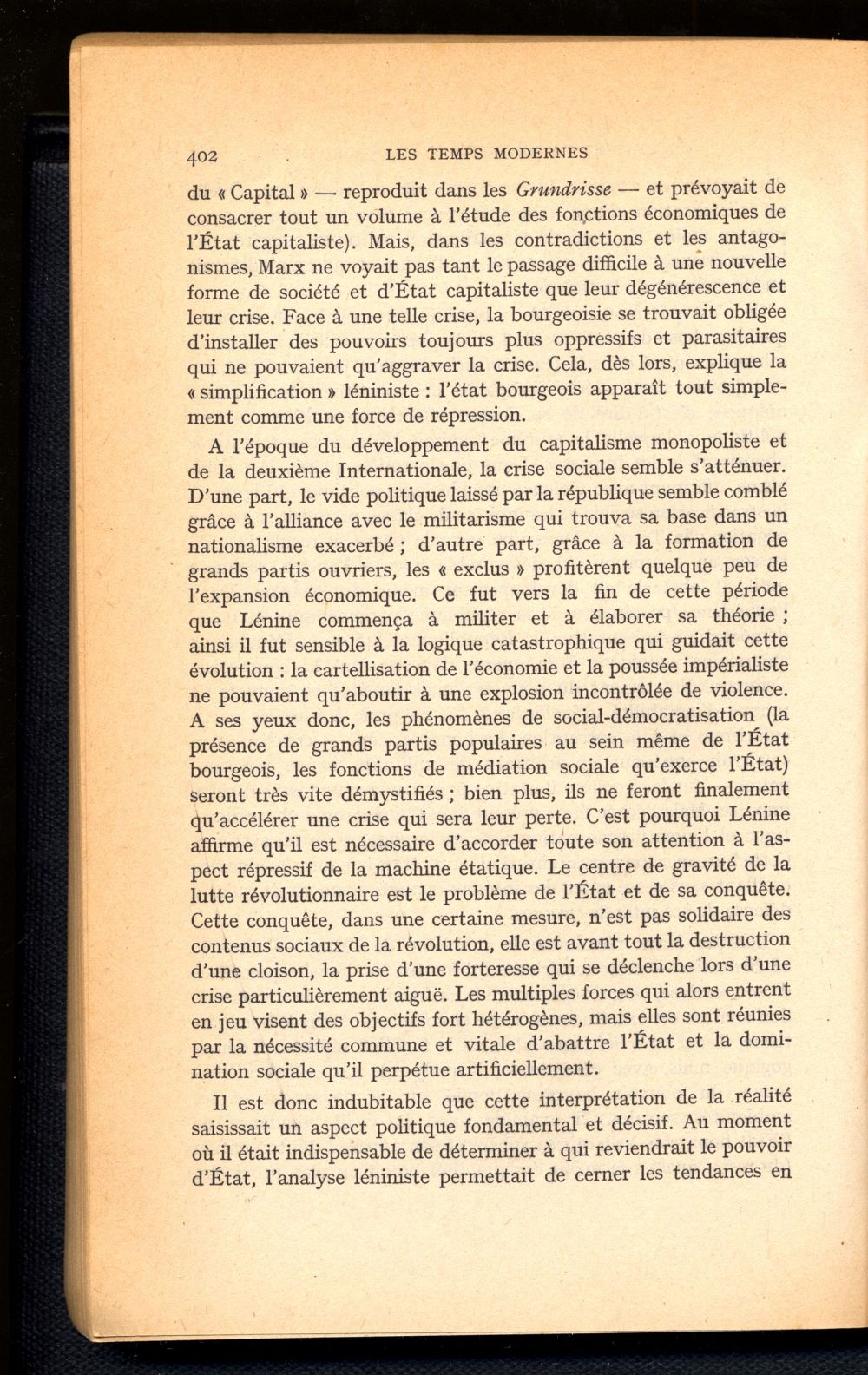

402
LES TEMPS MODERNES
du « Capital » — reproduit dans les Grundrisse — et prévoyait de
consacrer tout un volume à l'étude des fonctions économiques de
l'État capitaliste). Mais, dans les contradictions et les antago-
nismes, Marx ne voyait pas tant le passage difficile à une nouvelle
forme de société et d'État capitaliste que leur dégénérescence et
leur crise. Face à une telle crise, la bourgeoisie se trouvait obligée
d'installer des pouvoirs toujours plus oppressifs et parasitaires
qui ne pouvaient qu'aggraver la crise. Cela, dès lors, explique la
« simplification » léniniste : l'état bourgeois apparaît tout simple-
ment comme une force de répression.
consacrer tout un volume à l'étude des fonctions économiques de
l'État capitaliste). Mais, dans les contradictions et les antago-
nismes, Marx ne voyait pas tant le passage difficile à une nouvelle
forme de société et d'État capitaliste que leur dégénérescence et
leur crise. Face à une telle crise, la bourgeoisie se trouvait obligée
d'installer des pouvoirs toujours plus oppressifs et parasitaires
qui ne pouvaient qu'aggraver la crise. Cela, dès lors, explique la
« simplification » léniniste : l'état bourgeois apparaît tout simple-
ment comme une force de répression.
A l'époque du développement du capitalisme monopoliste et
de la deuxième Internationale, la crise sociale semble s'atténuer.
D'une part, le vide politique laissé par la république semble comblé
grâce à l'alliance avec le militarisme qui trouva sa base dans un
nationalisme exacerbé ; d'autre part, grâce à la formation de
grands partis ouvriers, les « exclus » profitèrent quelque peu de
l'expansion économique. Ce fut vers la fin de cette période
que Lénine commença à militer et à élaborer sa théorie ;
ainsi il fut sensible à la logique catastrophique qui guidait cette
évolution : la cartellisation de l'économie et la poussée impérialiste
ne pouvaient qu'aboutir à une explosion incontrôlée de violence.
A ses yeux donc, les phénomènes de social-démocratisation (la
présence de grands partis populaires au sein même de l'État
bourgeois, les fonctions de médiation sociale qu'exercé l'État)
seront très vite démystifiés ; bien plus, ils ne feront finalement
qu'accélérer une crise qui sera leur perte. C'est pourquoi Lénine
affirme qu'il est nécessaire d'accorder toute son attention à l'as-
pect répressif de la machine étatique. Le centre de gravité de la
lutte révolutionnaire est le problème de l'État et de sa conquête.
Cette conquête, dans une certaine mesure, n'est pas solidaire des
contenus sociaux de la révolution, elle est avant tout la destruction
d'une cloison, la prise d'une forteresse qui se déclenche lors d'une
crise particulièrement aiguë. Les multiples forces qui alors entrent
en jeu visent des objectifs fort hétérogènes, mais elles sont réunies
par la nécessité commune et vitale d'abattre l'État et la domi-
nation sociale qu'il perpétue artificiellement.
de la deuxième Internationale, la crise sociale semble s'atténuer.
D'une part, le vide politique laissé par la république semble comblé
grâce à l'alliance avec le militarisme qui trouva sa base dans un
nationalisme exacerbé ; d'autre part, grâce à la formation de
grands partis ouvriers, les « exclus » profitèrent quelque peu de
l'expansion économique. Ce fut vers la fin de cette période
que Lénine commença à militer et à élaborer sa théorie ;
ainsi il fut sensible à la logique catastrophique qui guidait cette
évolution : la cartellisation de l'économie et la poussée impérialiste
ne pouvaient qu'aboutir à une explosion incontrôlée de violence.
A ses yeux donc, les phénomènes de social-démocratisation (la
présence de grands partis populaires au sein même de l'État
bourgeois, les fonctions de médiation sociale qu'exercé l'État)
seront très vite démystifiés ; bien plus, ils ne feront finalement
qu'accélérer une crise qui sera leur perte. C'est pourquoi Lénine
affirme qu'il est nécessaire d'accorder toute son attention à l'as-
pect répressif de la machine étatique. Le centre de gravité de la
lutte révolutionnaire est le problème de l'État et de sa conquête.
Cette conquête, dans une certaine mesure, n'est pas solidaire des
contenus sociaux de la révolution, elle est avant tout la destruction
d'une cloison, la prise d'une forteresse qui se déclenche lors d'une
crise particulièrement aiguë. Les multiples forces qui alors entrent
en jeu visent des objectifs fort hétérogènes, mais elles sont réunies
par la nécessité commune et vitale d'abattre l'État et la domi-
nation sociale qu'il perpétue artificiellement.
Il est donc indubitable que cette interprétation de la réalité
saisissait un aspect politique fondamental et décisif. Au moment
où il était indispensable de déterminer à qui reviendrait le pouvoir
d'État, l'analyse léniniste permettait de cerner les tendances en
saisissait un aspect politique fondamental et décisif. Au moment
où il était indispensable de déterminer à qui reviendrait le pouvoir
d'État, l'analyse léniniste permettait de cerner les tendances en
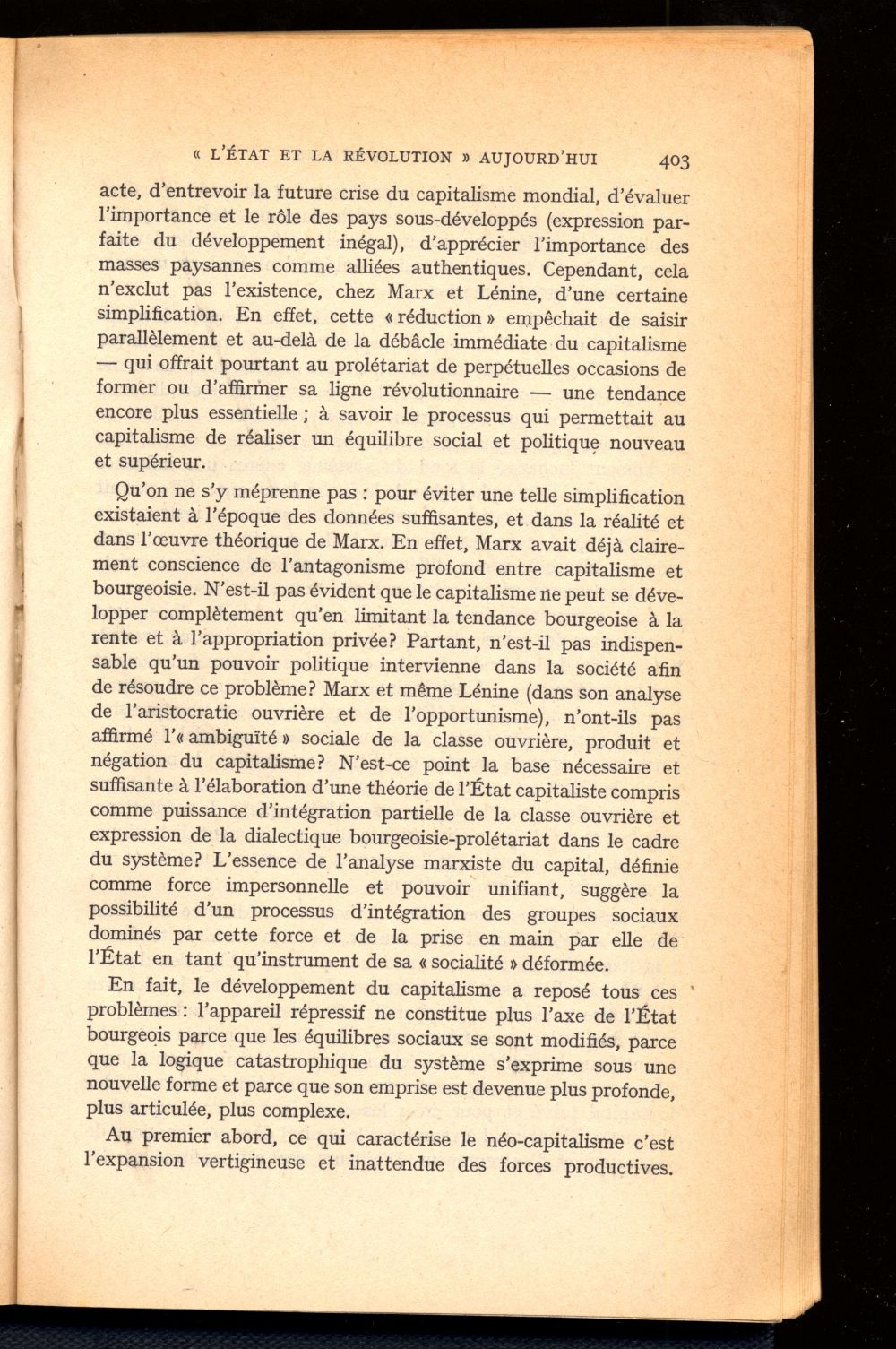

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
4°3
acte, d'entrevoir la future crise du capitalisme mondial, d'évaluer
l'importance et le rôle des pays sous-développés (expression par-
faite du développement inégal), d'apprécier l'importance des
masses paysannes comme alliées authentiques. Cependant, cela
n'exclut pas l'existence, chez Marx et Lénine, d'une certaine
simplification. En effet, cette « réduction » empêchait de saisir
parallèlement et au-delà de la débâcle immédiate du capitalisme
— qui offrait pourtant au prolétariat de perpétuelles occasions de
former ou d'affirmer sa ligne révolutionnaire •—• une tendance
encore plus essentielle ; à savoir le processus qui permettait au
capitalisme de réaliser un équilibre social et politique nouveau
et supérieur.
l'importance et le rôle des pays sous-développés (expression par-
faite du développement inégal), d'apprécier l'importance des
masses paysannes comme alliées authentiques. Cependant, cela
n'exclut pas l'existence, chez Marx et Lénine, d'une certaine
simplification. En effet, cette « réduction » empêchait de saisir
parallèlement et au-delà de la débâcle immédiate du capitalisme
— qui offrait pourtant au prolétariat de perpétuelles occasions de
former ou d'affirmer sa ligne révolutionnaire •—• une tendance
encore plus essentielle ; à savoir le processus qui permettait au
capitalisme de réaliser un équilibre social et politique nouveau
et supérieur.
Qu'on ne s'y méprenne pas : pour éviter une telle simplification
existaient à l'époque des données suffisantes, et dans la réalité et
dans l'œuvre théorique de Marx. En effet, Marx avait déjà claire-
ment conscience de l'antagonisme profond entre capitalisme et
bourgeoisie. N'est-il pas évident que le capitalisme ne peut se déve-
lopper complètement qu'en limitant la tendance bourgeoise à la
rente et à l'appropriation privée? Partant, n'est-il pas indispen-
sable qu'un pouvoir politique intervienne dans la société afin
de résoudre ce problème? Marx et même Lénine (dans son analyse
de l'aristocratie ouvrière et de l'opportunisme), n'ont-ils pas
affirmé l'« ambiguïté » sociale de la classe ouvrière, produit et
négation du capitalisme? N'est-ce point la base nécessaire et
suffisante à l'élaboration d'une théorie de l'État capitaliste compris
comme puissance d'intégration partielle de la classe ouvrière et
expression de la dialectique bourgeoisie-prolétariat dans le cadre
du système? L'essence de l'analyse marxiste du capital, définie
comme force impersonnelle et pouvoir unifiant, suggère la
possibilité d'un processus d'intégration des groupes sociaux
dominés par cette force et de la prise en main par elle de
l'État en tant qu'instrument de sa « socialité » déformée.
existaient à l'époque des données suffisantes, et dans la réalité et
dans l'œuvre théorique de Marx. En effet, Marx avait déjà claire-
ment conscience de l'antagonisme profond entre capitalisme et
bourgeoisie. N'est-il pas évident que le capitalisme ne peut se déve-
lopper complètement qu'en limitant la tendance bourgeoise à la
rente et à l'appropriation privée? Partant, n'est-il pas indispen-
sable qu'un pouvoir politique intervienne dans la société afin
de résoudre ce problème? Marx et même Lénine (dans son analyse
de l'aristocratie ouvrière et de l'opportunisme), n'ont-ils pas
affirmé l'« ambiguïté » sociale de la classe ouvrière, produit et
négation du capitalisme? N'est-ce point la base nécessaire et
suffisante à l'élaboration d'une théorie de l'État capitaliste compris
comme puissance d'intégration partielle de la classe ouvrière et
expression de la dialectique bourgeoisie-prolétariat dans le cadre
du système? L'essence de l'analyse marxiste du capital, définie
comme force impersonnelle et pouvoir unifiant, suggère la
possibilité d'un processus d'intégration des groupes sociaux
dominés par cette force et de la prise en main par elle de
l'État en tant qu'instrument de sa « socialité » déformée.
En fait, le développement du capitalisme a reposé tous ces
problèmes : l'appareil répressif ne constitue plus l'axe de l'État
bourgeois parce que les équilibres sociaux se sont modifiés, parce
que la logique catastrophique du système s'exprime sous une
nouvelle forme et parce que son emprise est devenue plus profonde,
plus articulée, plus complexe.
problèmes : l'appareil répressif ne constitue plus l'axe de l'État
bourgeois parce que les équilibres sociaux se sont modifiés, parce
que la logique catastrophique du système s'exprime sous une
nouvelle forme et parce que son emprise est devenue plus profonde,
plus articulée, plus complexe.
Au premier abord, ce qui caractérise le néo-capitalisme c'est
l'expansion vertigineuse et inattendue des forces productives.
l'expansion vertigineuse et inattendue des forces productives.
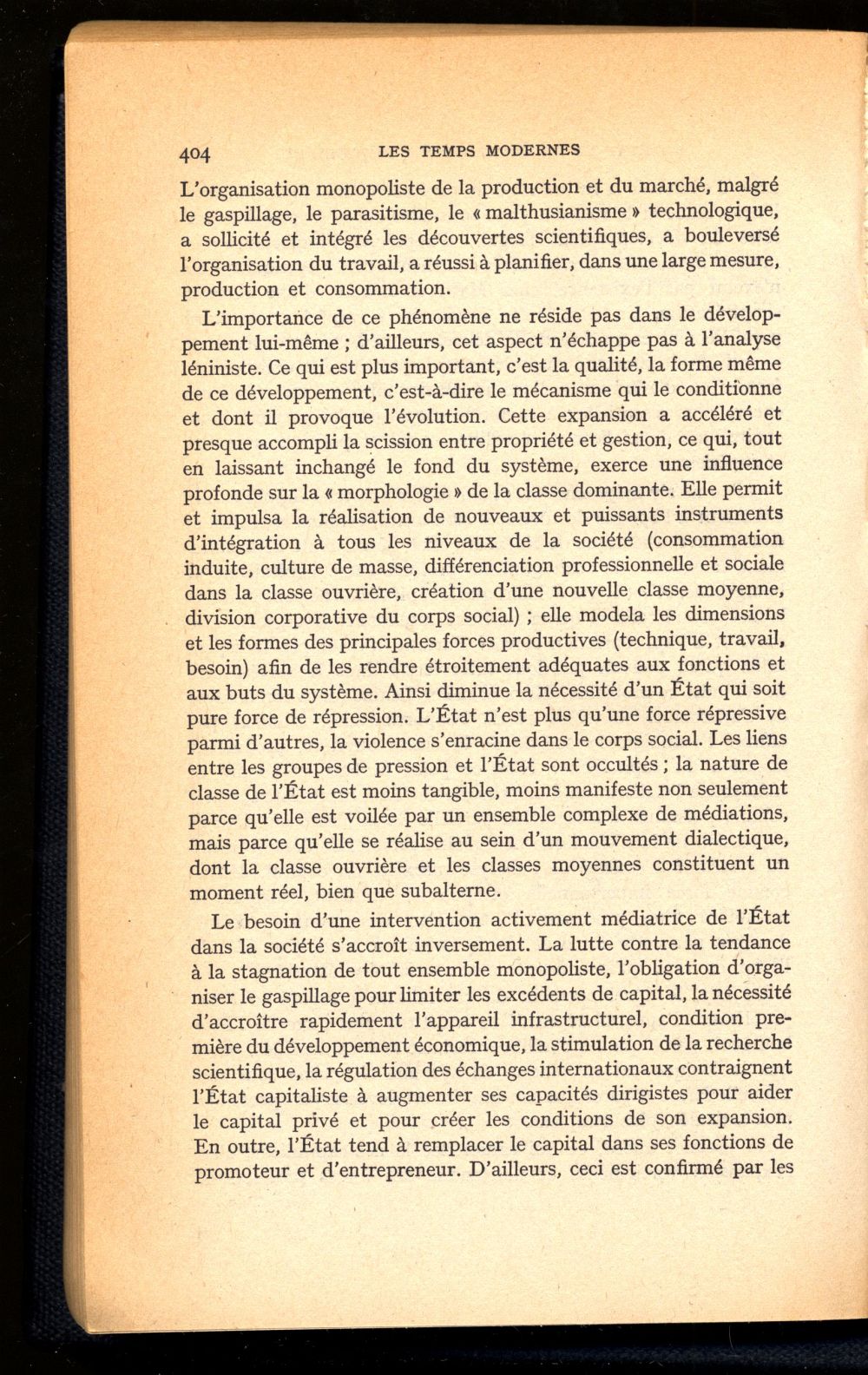

404
LES TEMPS MODERNES
L'organisation monopoliste de la production et du marché, malgré
le gaspillage, le parasitisme, le « malthusianisme » technologique,
a sollicité et intégré les découvertes scientifiques, a bouleversé
l'organisation du travail, a réussi à planifier, dans une large mesure,
production et consommation.
le gaspillage, le parasitisme, le « malthusianisme » technologique,
a sollicité et intégré les découvertes scientifiques, a bouleversé
l'organisation du travail, a réussi à planifier, dans une large mesure,
production et consommation.
L'importance de ce phénomène ne réside pas dans le dévelop-
pement lui-même ; d'ailleurs, cet aspect n'échappe pas à l'analyse
léniniste. Ce qui est plus important, c'est la qualité, la forme même
de ce développement, c'est-à-dire le mécanisme qui le conditionne
et dont il provoque l'évolution. Cette expansion a accéléré et
presque accompli la scission entre propriété et gestion, ce qui, tout
en laissant inchangé le fond du système, exerce une influence
profonde sur la « morphologie » de la classe dominante. Elle permit
et impulsa la réalisation de nouveaux et puissants instruments
d'intégration à tous les niveaux de la société (consommation
induite, culture de masse, différenciation professionnelle et sociale
dans la classe ouvrière, création d'une nouvelle classe moyenne,
division corporative du corps social) ; elle modela les dimensions
et les formes des principales forces productives (technique, travail,
besoin) afin de les rendre étroitement adéquates aux fonctions et
aux buts du système. Ainsi diminue la nécessité d'un État qui soit
pure force de répression. L'État n'est plus qu'une force répressive
parmi d'autres, la violence s'enracine dans le corps social. Les liens
entre les groupes de pression et l'État sont occultés ; la nature de
classe de l'État est moins tangible, moins manifeste non seulement
parce qu'elle est voilée par un ensemble complexe de médiations,
mais parce qu'elle se réalise au sein d'un mouvement dialectique,
dont la classe ouvrière et les classes moyennes constituent un
moment réel, bien que subalterne.
pement lui-même ; d'ailleurs, cet aspect n'échappe pas à l'analyse
léniniste. Ce qui est plus important, c'est la qualité, la forme même
de ce développement, c'est-à-dire le mécanisme qui le conditionne
et dont il provoque l'évolution. Cette expansion a accéléré et
presque accompli la scission entre propriété et gestion, ce qui, tout
en laissant inchangé le fond du système, exerce une influence
profonde sur la « morphologie » de la classe dominante. Elle permit
et impulsa la réalisation de nouveaux et puissants instruments
d'intégration à tous les niveaux de la société (consommation
induite, culture de masse, différenciation professionnelle et sociale
dans la classe ouvrière, création d'une nouvelle classe moyenne,
division corporative du corps social) ; elle modela les dimensions
et les formes des principales forces productives (technique, travail,
besoin) afin de les rendre étroitement adéquates aux fonctions et
aux buts du système. Ainsi diminue la nécessité d'un État qui soit
pure force de répression. L'État n'est plus qu'une force répressive
parmi d'autres, la violence s'enracine dans le corps social. Les liens
entre les groupes de pression et l'État sont occultés ; la nature de
classe de l'État est moins tangible, moins manifeste non seulement
parce qu'elle est voilée par un ensemble complexe de médiations,
mais parce qu'elle se réalise au sein d'un mouvement dialectique,
dont la classe ouvrière et les classes moyennes constituent un
moment réel, bien que subalterne.
Le besoin d'une intervention activement médiatrice de l'État
dans la société s'accroît inversement. La lutte contre la tendance
à la stagnation de tout ensemble monopoliste, l'obligation d'orga-
niser le gaspillage pour limiter les excédents de capital, la nécessité
d'accroître rapidement l'appareil infrastructurel, condition pre-
mière du développement économique, la stimulation de la recherche
scientifique, la régulation des échanges internationaux contraignent
l'État capitaliste à augmenter ses capacités dirigistes pour aider
le capital privé et pour créer les conditions de son expansion.
En outre, l'État tend à remplacer le capital dans ses fonctions de
promoteur et d'entrepreneur. D'ailleurs, ceci est confirmé par les
dans la société s'accroît inversement. La lutte contre la tendance
à la stagnation de tout ensemble monopoliste, l'obligation d'orga-
niser le gaspillage pour limiter les excédents de capital, la nécessité
d'accroître rapidement l'appareil infrastructurel, condition pre-
mière du développement économique, la stimulation de la recherche
scientifique, la régulation des échanges internationaux contraignent
l'État capitaliste à augmenter ses capacités dirigistes pour aider
le capital privé et pour créer les conditions de son expansion.
En outre, l'État tend à remplacer le capital dans ses fonctions de
promoteur et d'entrepreneur. D'ailleurs, ceci est confirmé par les
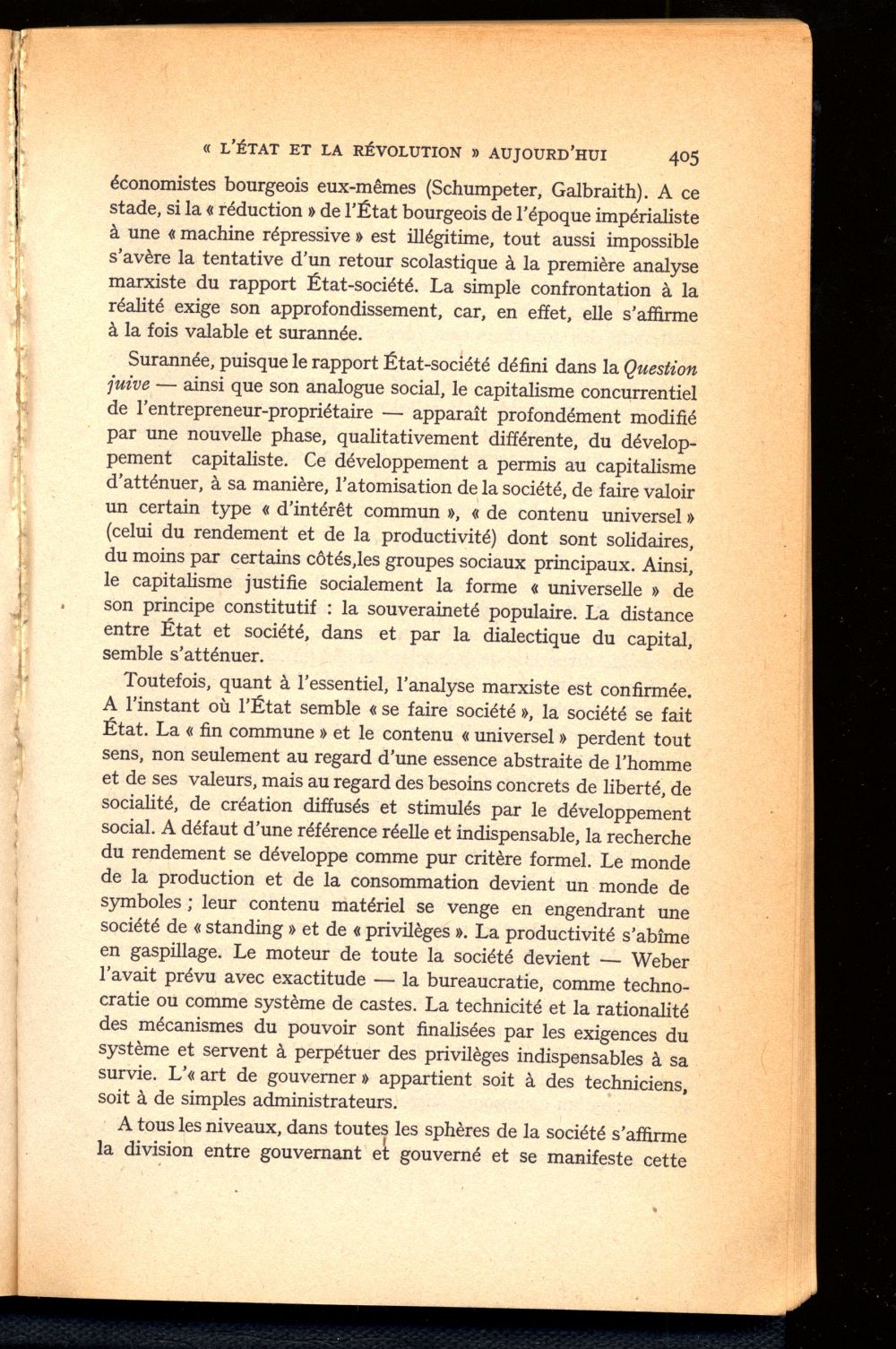

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
405
économistes bourgeois eux-mêmes (Schumpeter, Galbraith). A ce
stade, si la « réduction » de l'État bourgeois de l'époque impérialiste
à une « machine répressive » est illégitime, tout aussi impossible
s'avère la tentative d'un retour scolastique à la première analyse
marxiste du rapport État-société. La simple confrontation à la
réalité exige son approfondissement, car, en effet, elle s'affirme
à la fois valable et surannée.
stade, si la « réduction » de l'État bourgeois de l'époque impérialiste
à une « machine répressive » est illégitime, tout aussi impossible
s'avère la tentative d'un retour scolastique à la première analyse
marxiste du rapport État-société. La simple confrontation à la
réalité exige son approfondissement, car, en effet, elle s'affirme
à la fois valable et surannée.
Surannée, puisque le rapport État-société défini dans la Question
juive — ainsi que son analogue social, le capitalisme concurrentiel
de l'entrepreneur-propriétaire — apparaît profondément modifié
par une nouvelle phase, qualitativement différente, du dévelop-
pement capitaliste. Ce développement a permis au capitalisme
d'atténuer, à sa manière, l'atomisation de la société, de faire valoir
un certain type « d'intérêt commun », « de contenu universel »
(celui du rendement et de la productivité) dont sont solidaires,
du moins par certains côtés,les groupes sociaux principaux. Ainsi,
le capitalisme justifie socialement la forme « universelle » de
son principe constitutif : la souveraineté populaire. La distance
entre État et société, dans et par la dialectique du capital,
semble s'atténuer.
juive — ainsi que son analogue social, le capitalisme concurrentiel
de l'entrepreneur-propriétaire — apparaît profondément modifié
par une nouvelle phase, qualitativement différente, du dévelop-
pement capitaliste. Ce développement a permis au capitalisme
d'atténuer, à sa manière, l'atomisation de la société, de faire valoir
un certain type « d'intérêt commun », « de contenu universel »
(celui du rendement et de la productivité) dont sont solidaires,
du moins par certains côtés,les groupes sociaux principaux. Ainsi,
le capitalisme justifie socialement la forme « universelle » de
son principe constitutif : la souveraineté populaire. La distance
entre État et société, dans et par la dialectique du capital,
semble s'atténuer.
Toutefois, quant à l'essentiel, l'analyse marxiste est confirmée.
A l'instant où l'État semble « se faire société », la société se fait
État. La « fin commune » et le contenu « universel » perdent tout
sens, non seulement au regard d'une essence abstraite de l'homme
et de ses valeurs, mais au regard des besoins concrets de liberté, de
socialité, de création diffusés et stimulés par le développement
social. A défaut d'une référence réelle et indispensable, la recherche
du rendement se développe comme pur critère formel. Le monde
de la production et de la consommation devient un monde de
symboles ; leur contenu matériel se venge en engendrant une
société de « standing » et de « privilèges ». La productivité s'abîme
en gaspillage. Le moteur de toute la société devient — Weber
l'avait prévu avec exactitude — la bureaucratie, comme techno-
cratie ou comme système de castes. La technicité et la rationalité
des mécanismes du pouvoir sont finalisées par les exigences du
système et servent à perpétuer des privilèges indispensables à sa
survie. L'« art de gouverner » appartient soit à des techniciens,
soit à de simples administrateurs.
A l'instant où l'État semble « se faire société », la société se fait
État. La « fin commune » et le contenu « universel » perdent tout
sens, non seulement au regard d'une essence abstraite de l'homme
et de ses valeurs, mais au regard des besoins concrets de liberté, de
socialité, de création diffusés et stimulés par le développement
social. A défaut d'une référence réelle et indispensable, la recherche
du rendement se développe comme pur critère formel. Le monde
de la production et de la consommation devient un monde de
symboles ; leur contenu matériel se venge en engendrant une
société de « standing » et de « privilèges ». La productivité s'abîme
en gaspillage. Le moteur de toute la société devient — Weber
l'avait prévu avec exactitude — la bureaucratie, comme techno-
cratie ou comme système de castes. La technicité et la rationalité
des mécanismes du pouvoir sont finalisées par les exigences du
système et servent à perpétuer des privilèges indispensables à sa
survie. L'« art de gouverner » appartient soit à des techniciens,
soit à de simples administrateurs.
A tous les niveaux, dans toutes les sphères de la société s'affirme
la division entre gouvernant et gouverné et se manifeste cette
la division entre gouvernant et gouverné et se manifeste cette
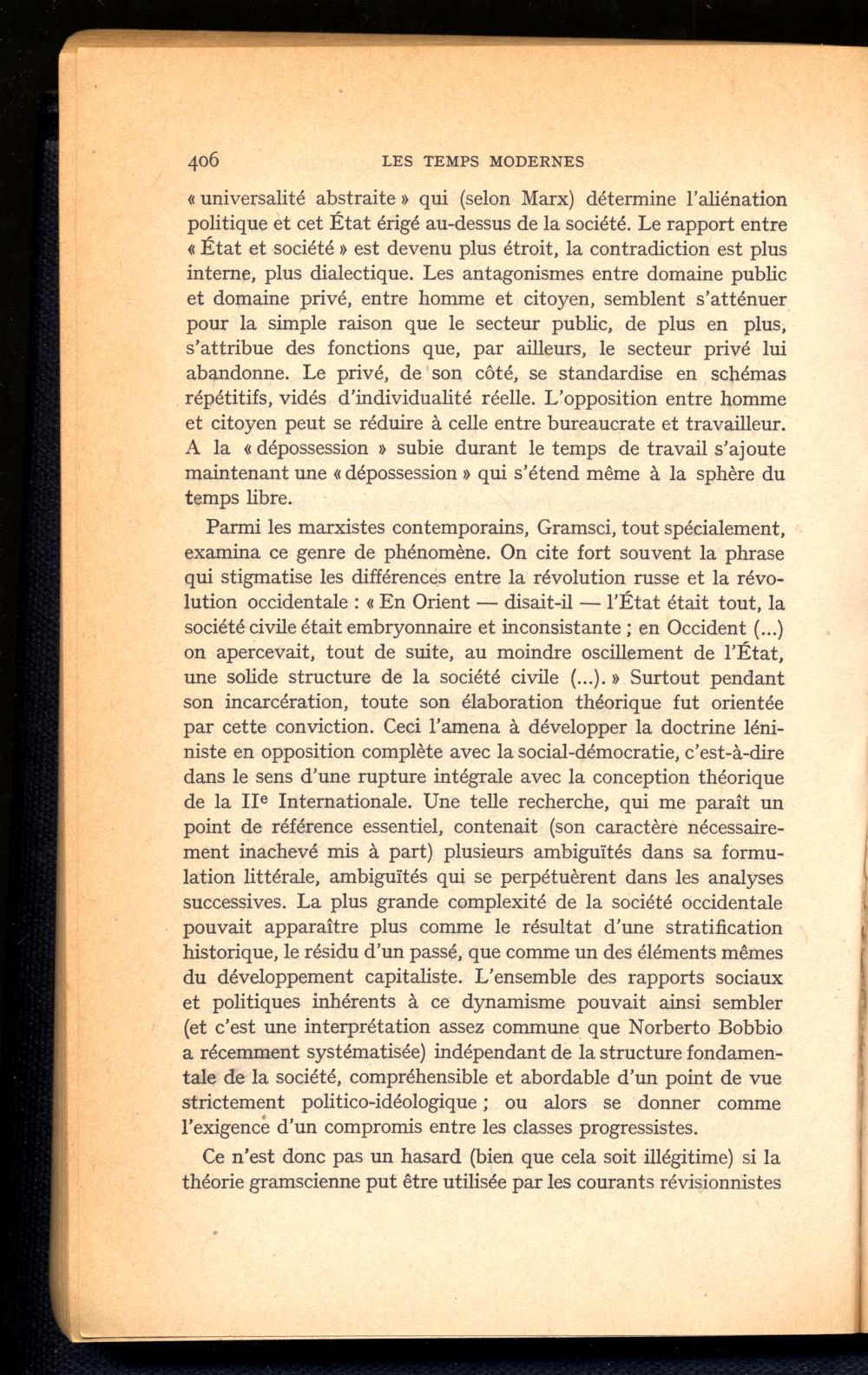

400 LES TEMPS MODERNES
« universalité abstraite » qui (selon Marx) détermine l'aliénation
politique et cet État érigé au-dessus de la société. Le rapport entre
« État et société » est devenu plus étroit, la contradiction est plus
interne, plus dialectique. Les antagonismes entre domaine public
et domaine privé, entre homme et citoyen, semblent s'atténuer
pour la simple raison que le secteur public, de plus en plus,
s'attribue des fonctions que, par ailleurs, le secteur privé lui
abandonne. Le privé, de son côté, se standardise en schémas
répétitifs, vidés d'individualité réelle. L'opposition entre homme
et citoyen peut se réduire à celle entre bureaucrate et travailleur.
A la « dépossession » subie durant le temps de travail s'ajoute
maintenant une « dépossession » qui s'étend même à la sphère du
temps libre.
politique et cet État érigé au-dessus de la société. Le rapport entre
« État et société » est devenu plus étroit, la contradiction est plus
interne, plus dialectique. Les antagonismes entre domaine public
et domaine privé, entre homme et citoyen, semblent s'atténuer
pour la simple raison que le secteur public, de plus en plus,
s'attribue des fonctions que, par ailleurs, le secteur privé lui
abandonne. Le privé, de son côté, se standardise en schémas
répétitifs, vidés d'individualité réelle. L'opposition entre homme
et citoyen peut se réduire à celle entre bureaucrate et travailleur.
A la « dépossession » subie durant le temps de travail s'ajoute
maintenant une « dépossession » qui s'étend même à la sphère du
temps libre.
Parmi les marxistes contemporains, Gramsci, tout spécialement,
examina ce genre de phénomène. On cite fort souvent la phrase
qui stigmatise les différences entre la révolution russe et la révo-
lution occidentale : « En Orient — disait-il — l'État était tout, la
société civile était embryonnaire et inconsistante ; en Occident (...)
on apercevait, tout de suite, au moindre oscillement de l'État,
une solide structure de la société civile (...). » Surtout pendant
son incarcération, toute son élaboration théorique fut orientée
par cette conviction. Ceci l'amena à développer la doctrine léni-
niste en opposition complète avec la social-démocratie, c'est-à-dire
dans le sens d'une rupture intégrale avec la conception théorique
de la IIe Internationale. Une telle recherche, qui me paraît un
point de référence essentiel, contenait (son caractère nécessaire-
ment inachevé mis à part) plusieurs ambiguïtés dans sa formu-
lation littérale, ambiguïtés qui se perpétuèrent dans les analyses
successives. La plus grande complexité de la société occidentale
pouvait apparaître plus comme le résultat d'une stratification
historique, le résidu d'un passé, que comme un des éléments mêmes
du développement capitaliste. L'ensemble des rapports sociaux
et politiques inhérents à ce dynamisme pouvait ainsi sembler
(et c'est une interprétation assez commune que Norberto Bobbio
a récemment systématisée) indépendant de la structure fondamen-
tale de la société, compréhensible et abordable d'un point de vue
strictement politico-idéologique ; ou alors se donner comme
l'exigence d'un compromis entre les classes progressistes.
examina ce genre de phénomène. On cite fort souvent la phrase
qui stigmatise les différences entre la révolution russe et la révo-
lution occidentale : « En Orient — disait-il — l'État était tout, la
société civile était embryonnaire et inconsistante ; en Occident (...)
on apercevait, tout de suite, au moindre oscillement de l'État,
une solide structure de la société civile (...). » Surtout pendant
son incarcération, toute son élaboration théorique fut orientée
par cette conviction. Ceci l'amena à développer la doctrine léni-
niste en opposition complète avec la social-démocratie, c'est-à-dire
dans le sens d'une rupture intégrale avec la conception théorique
de la IIe Internationale. Une telle recherche, qui me paraît un
point de référence essentiel, contenait (son caractère nécessaire-
ment inachevé mis à part) plusieurs ambiguïtés dans sa formu-
lation littérale, ambiguïtés qui se perpétuèrent dans les analyses
successives. La plus grande complexité de la société occidentale
pouvait apparaître plus comme le résultat d'une stratification
historique, le résidu d'un passé, que comme un des éléments mêmes
du développement capitaliste. L'ensemble des rapports sociaux
et politiques inhérents à ce dynamisme pouvait ainsi sembler
(et c'est une interprétation assez commune que Norberto Bobbio
a récemment systématisée) indépendant de la structure fondamen-
tale de la société, compréhensible et abordable d'un point de vue
strictement politico-idéologique ; ou alors se donner comme
l'exigence d'un compromis entre les classes progressistes.
Ce n'est donc pas un hasard (bien que cela soit illégitime) si la
théorie gramscienne put être utilisée par les courants révisionnistes
théorie gramscienne put être utilisée par les courants révisionnistes
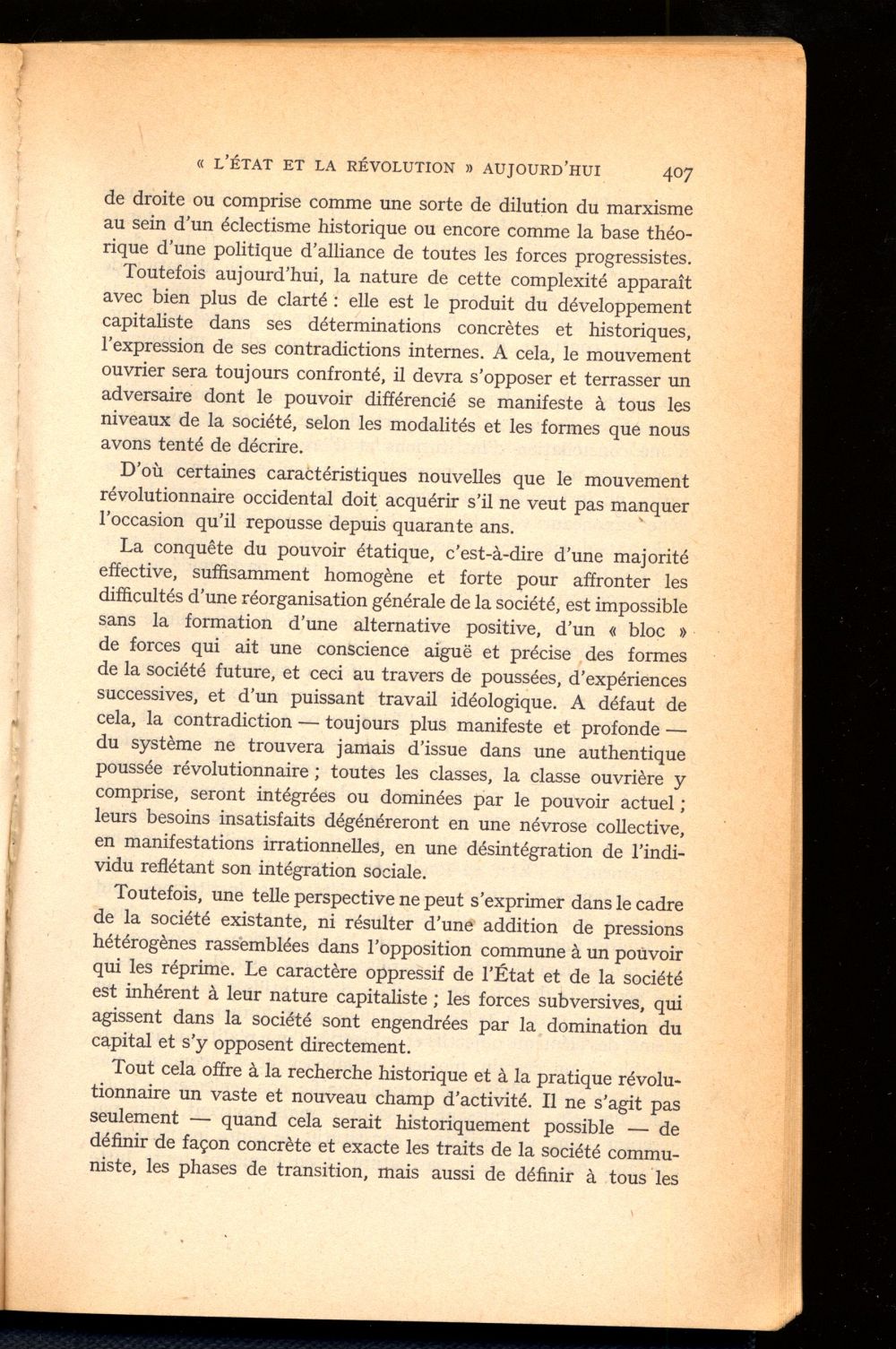

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
407
de droite ou comprise comme une sorte de dilution du marxisme
au sein d'un éclectisme historique ou encore comme la base théo-
rique d'une politique d'alliance de toutes les forces progressistes.
au sein d'un éclectisme historique ou encore comme la base théo-
rique d'une politique d'alliance de toutes les forces progressistes.
Toutefois aujourd'hui, la nature de cette complexité apparaît
avec bien plus de clarté : elle est le produit du développement
capitaliste dans ses déterminations concrètes et historiques,
l'expression de ses contradictions internes. A cela, le mouvement
ouvrier sera toujours confronté, il devra s'opposer et terrasser un
adversaire dont le pouvoir différencié se manifeste à tous les
niveaux de la société, selon les modalités et les formes que nous
avons tenté de décrire.
avec bien plus de clarté : elle est le produit du développement
capitaliste dans ses déterminations concrètes et historiques,
l'expression de ses contradictions internes. A cela, le mouvement
ouvrier sera toujours confronté, il devra s'opposer et terrasser un
adversaire dont le pouvoir différencié se manifeste à tous les
niveaux de la société, selon les modalités et les formes que nous
avons tenté de décrire.
D'où certaines caractéristiques nouvelles que le mouvement
révolutionnaire occidental doit acquérir s'il ne veut pas manquer
l'occasion qu'il repousse depuis quarante ans.
révolutionnaire occidental doit acquérir s'il ne veut pas manquer
l'occasion qu'il repousse depuis quarante ans.
La conquête du pouvoir étatique, c'est-à-dire d'une majorité
effective, suffisamment homogène et forte pour affronter les
difficultés d'une réorganisation générale de la société, est impossible
sans la formation d'une alternative positive, d'un « bloc »
de forces qui ait une conscience aiguë et précise des formes
de la société future, et ceci au travers de poussées, d'expériences
successives, et d'un puissant travail idéologique. A défaut de
cela, la contradiction — toujours plus manifeste et profonde —
du système ne trouvera jamais d'issue dans une authentique
poussée révolutionnaire ; toutes les classes, la classe ouvrière y
comprise, seront intégrées ou dominées par le pouvoir actuel ;
leurs besoins insatisfaits dégénéreront en une névrose collective,
en manifestations irrationnelles, en une désintégration de l'indi-
vidu reflétant son intégration sociale.
effective, suffisamment homogène et forte pour affronter les
difficultés d'une réorganisation générale de la société, est impossible
sans la formation d'une alternative positive, d'un « bloc »
de forces qui ait une conscience aiguë et précise des formes
de la société future, et ceci au travers de poussées, d'expériences
successives, et d'un puissant travail idéologique. A défaut de
cela, la contradiction — toujours plus manifeste et profonde —
du système ne trouvera jamais d'issue dans une authentique
poussée révolutionnaire ; toutes les classes, la classe ouvrière y
comprise, seront intégrées ou dominées par le pouvoir actuel ;
leurs besoins insatisfaits dégénéreront en une névrose collective,
en manifestations irrationnelles, en une désintégration de l'indi-
vidu reflétant son intégration sociale.
Toutefois, une telle perspective ne peut s'exprimer dans le cadre
de la société existante, ni résulter d'une addition de pressions
hétérogènes rassemblées dans l'opposition commune à un pouvoir
qui les réprime. Le caractère oppressif de l'État et de la société
est inhérent à leur nature capitaliste ; les forces subversives, qui
agissent dans la société sont engendrées par la domination du
capital et s'y opposent directement.
de la société existante, ni résulter d'une addition de pressions
hétérogènes rassemblées dans l'opposition commune à un pouvoir
qui les réprime. Le caractère oppressif de l'État et de la société
est inhérent à leur nature capitaliste ; les forces subversives, qui
agissent dans la société sont engendrées par la domination du
capital et s'y opposent directement.
Tout cela offre à la recherche historique et à la pratique révolu-
tionnaire un vaste et nouveau champ d'activité. Il ne s'agit pas
seulement — quand cela serait historiquement possible — de
définir de façon concrète et exacte les traits de la société commu-
niste, les phases de transition, mais aussi de définir à tous les
tionnaire un vaste et nouveau champ d'activité. Il ne s'agit pas
seulement — quand cela serait historiquement possible — de
définir de façon concrète et exacte les traits de la société commu-
niste, les phases de transition, mais aussi de définir à tous les
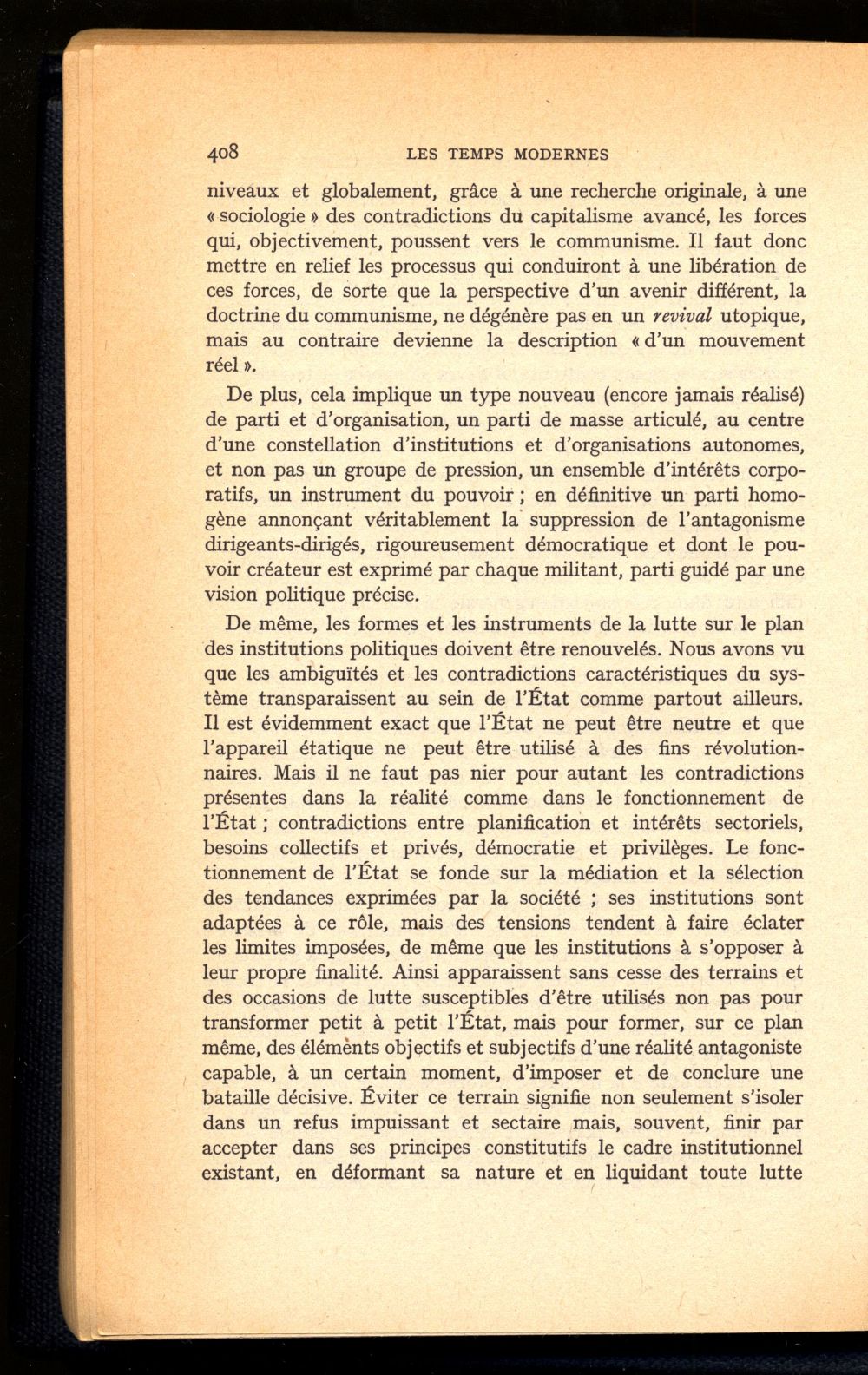

408
LES TEMPS MODERNES
niveaux et globalement, grâce à une recherche originale, à une
« sociologie » des contradictions du capitalisme avancé, les forces
qui, objectivement, poussent vers le communisme. Il faut donc
mettre en relief les processus qui conduiront à une libération de
ces forces, de sorte que la perspective d'un avenir différent, la
doctrine du communisme, ne dégénère pas en un revival utopique,
mais au contraire devienne la description « d'un mouvement
réel ».
« sociologie » des contradictions du capitalisme avancé, les forces
qui, objectivement, poussent vers le communisme. Il faut donc
mettre en relief les processus qui conduiront à une libération de
ces forces, de sorte que la perspective d'un avenir différent, la
doctrine du communisme, ne dégénère pas en un revival utopique,
mais au contraire devienne la description « d'un mouvement
réel ».
De plus, cela implique un type nouveau (encore jamais réalisé)
de parti et d'organisation, un parti de masse articulé, au centre
d'une constellation d'institutions et d'organisations autonomes,
et non pas un groupe de pression, un ensemble d'intérêts corpo-
ratifs, un instrument du pouvoir ; en définitive un parti homo-
gène annonçant véritablement la suppression de l'antagonisme
dirigeants-dirigés, rigoureusement démocratique et dont le pou-
voir créateur est exprimé par chaque militant, parti guidé par une
vision politique précise.
de parti et d'organisation, un parti de masse articulé, au centre
d'une constellation d'institutions et d'organisations autonomes,
et non pas un groupe de pression, un ensemble d'intérêts corpo-
ratifs, un instrument du pouvoir ; en définitive un parti homo-
gène annonçant véritablement la suppression de l'antagonisme
dirigeants-dirigés, rigoureusement démocratique et dont le pou-
voir créateur est exprimé par chaque militant, parti guidé par une
vision politique précise.
De même, les formes et les instruments de la lutte sur le plan
des institutions politiques doivent être renouvelés. Nous avons vu
que les ambiguïtés et les contradictions caractéristiques du sys-
tème transparaissent au sein de l'État comme partout ailleurs.
Il est évidemment exact que l'État ne peut être neutre et que
l'appareil étatique ne peut être utilisé à des fins révolution-
naires. Mais il ne faut pas nier pour autant les contradictions
présentes dans la réalité comme dans le fonctionnement de
l'État ; contradictions entre planification et intérêts sectoriels,
besoins collectifs et privés, démocratie et privilèges. Le fonc-
tionnement de l'État se fonde sur la médiation et la sélection
des tendances exprimées par la société ; ses institutions sont
adaptées à ce rôle, mais des tensions tendent à faire éclater
les limites imposées, de même que les institutions à s'opposer à
leur propre finalité. Ainsi apparaissent sans cesse des terrains et
des occasions de lutte susceptibles d'être utilisés non pas pour
transformer petit à petit l'État, mais pour former, sur ce plan
même, des éléments objectifs et subjectifs d'une réalité antagoniste
capable, à un certain moment, d'imposer et de conclure une
bataille décisive. Éviter ce terrain signifie non seulement s'isoler
dans un refus impuissant et sectaire mais, souvent, finir par
accepter dans ses principes constitutifs le cadre institutionnel
existant, en déformant sa nature et en liquidant toute lutte
des institutions politiques doivent être renouvelés. Nous avons vu
que les ambiguïtés et les contradictions caractéristiques du sys-
tème transparaissent au sein de l'État comme partout ailleurs.
Il est évidemment exact que l'État ne peut être neutre et que
l'appareil étatique ne peut être utilisé à des fins révolution-
naires. Mais il ne faut pas nier pour autant les contradictions
présentes dans la réalité comme dans le fonctionnement de
l'État ; contradictions entre planification et intérêts sectoriels,
besoins collectifs et privés, démocratie et privilèges. Le fonc-
tionnement de l'État se fonde sur la médiation et la sélection
des tendances exprimées par la société ; ses institutions sont
adaptées à ce rôle, mais des tensions tendent à faire éclater
les limites imposées, de même que les institutions à s'opposer à
leur propre finalité. Ainsi apparaissent sans cesse des terrains et
des occasions de lutte susceptibles d'être utilisés non pas pour
transformer petit à petit l'État, mais pour former, sur ce plan
même, des éléments objectifs et subjectifs d'une réalité antagoniste
capable, à un certain moment, d'imposer et de conclure une
bataille décisive. Éviter ce terrain signifie non seulement s'isoler
dans un refus impuissant et sectaire mais, souvent, finir par
accepter dans ses principes constitutifs le cadre institutionnel
existant, en déformant sa nature et en liquidant toute lutte
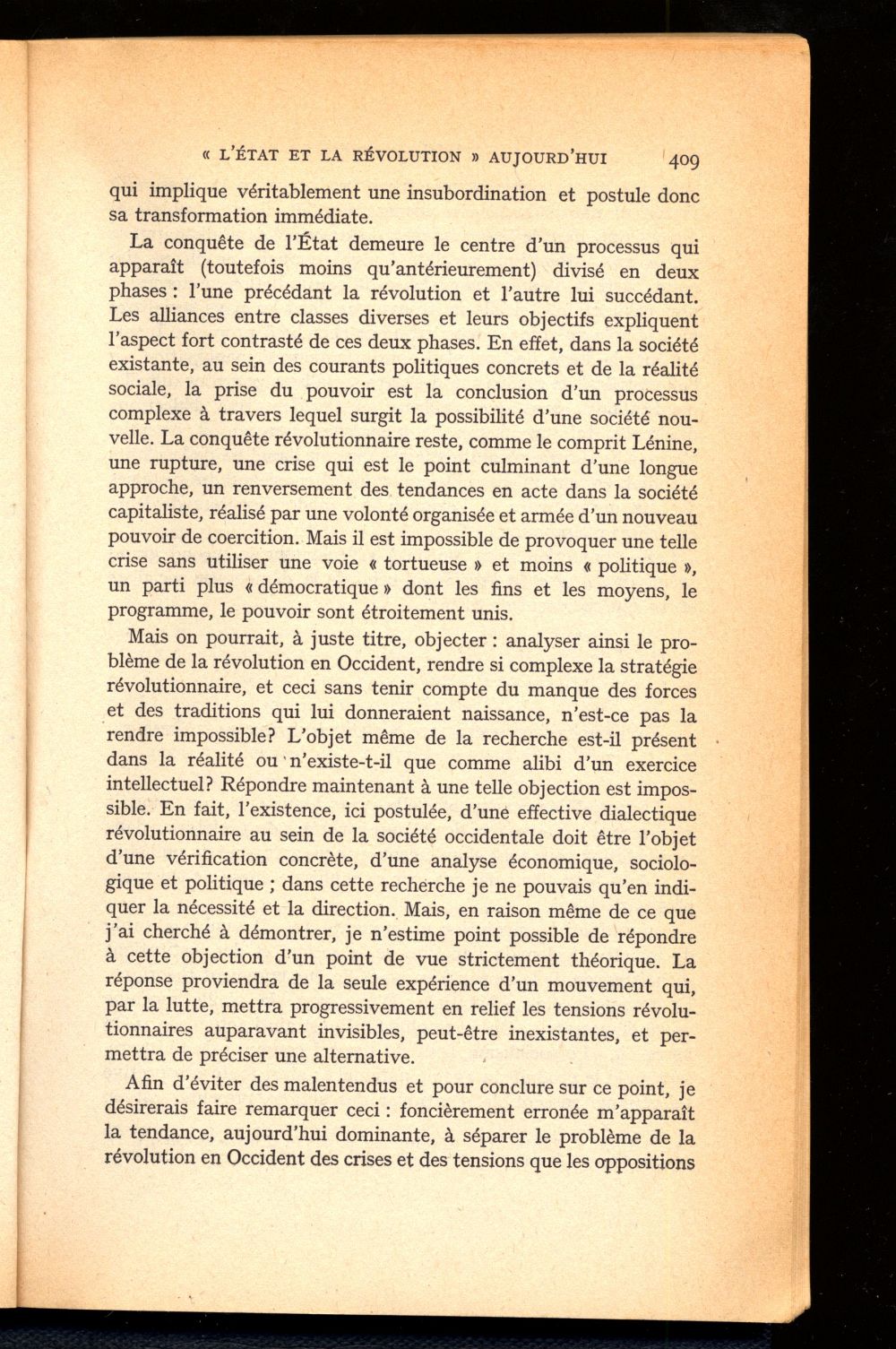

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
409
qui implique véritablement une insubordination et postule donc
sa transformation immédiate.
sa transformation immédiate.
La conquête de l'État demeure le centre d'un processus qui
apparaît (toutefois moins qu'antérieurement) divisé en deux
phases : l'une précédant la révolution et l'autre lui succédant.
Les alliances entre classes diverses et leurs objectifs expliquent
l'aspect fort contrasté de ces deux phases. En effet, dans la société
existante, au sein des courants politiques concrets et de la réalité
sociale, la prise du pouvoir est la conclusion d'un processus
complexe à travers lequel surgit la possibilité d'une société nou-
velle. La conquête révolutionnaire reste, comme le comprit Lénine,
une rupture, une crise qui est le point culminant d'une longue
approche, un renversement des tendances en acte dans la société
capitaliste, réalisé par une volonté organisée et armée d'un nouveau
pouvoir de coercition. Mais il est impossible de provoquer une telle
crise sans utiliser une voie « tortueuse » et moins « politique »,
un parti plus « démocratique » dont les fins et les moyens, le
programme, le pouvoir sont étroitement unis.
apparaît (toutefois moins qu'antérieurement) divisé en deux
phases : l'une précédant la révolution et l'autre lui succédant.
Les alliances entre classes diverses et leurs objectifs expliquent
l'aspect fort contrasté de ces deux phases. En effet, dans la société
existante, au sein des courants politiques concrets et de la réalité
sociale, la prise du pouvoir est la conclusion d'un processus
complexe à travers lequel surgit la possibilité d'une société nou-
velle. La conquête révolutionnaire reste, comme le comprit Lénine,
une rupture, une crise qui est le point culminant d'une longue
approche, un renversement des tendances en acte dans la société
capitaliste, réalisé par une volonté organisée et armée d'un nouveau
pouvoir de coercition. Mais il est impossible de provoquer une telle
crise sans utiliser une voie « tortueuse » et moins « politique »,
un parti plus « démocratique » dont les fins et les moyens, le
programme, le pouvoir sont étroitement unis.
Mais on pourrait, à juste titre, objecter : analyser ainsi le pro-
blème de la révolution en Occident, rendre si complexe la stratégie
révolutionnaire, et ceci sans tenir compte du manque des forces
et des traditions qui lui donneraient naissance, n'est-ce pas la
rendre impossible? L'objet même de la recherche est-il présent
dans la réalité ou ' n'existe-t-il que comme alibi d'un exercice
intellectuel? Répondre maintenant à une telle objection est impos-
sible. En fait, l'existence, ici postulée, d'une effective dialectique
révolutionnaire au sein de la société occidentale doit être l'objet
d'une vérification concrète, d'une analyse économique, sociolo-
gique et politique ; dans cette recherche je ne pouvais qu'en indi-
quer la nécessité et la direction. Mais, en raison même de ce que
j'ai cherché à démontrer, je n'estime point possible de répondre
à cette objection d'un point de vue strictement théorique. La
réponse proviendra de la seule expérience d'un mouvement qui,
par la lutte, mettra progressivement en relief les tensions révolu-
tionnaires auparavant invisibles, peut-être inexistantes, et per-
mettra de préciser une alternative.
blème de la révolution en Occident, rendre si complexe la stratégie
révolutionnaire, et ceci sans tenir compte du manque des forces
et des traditions qui lui donneraient naissance, n'est-ce pas la
rendre impossible? L'objet même de la recherche est-il présent
dans la réalité ou ' n'existe-t-il que comme alibi d'un exercice
intellectuel? Répondre maintenant à une telle objection est impos-
sible. En fait, l'existence, ici postulée, d'une effective dialectique
révolutionnaire au sein de la société occidentale doit être l'objet
d'une vérification concrète, d'une analyse économique, sociolo-
gique et politique ; dans cette recherche je ne pouvais qu'en indi-
quer la nécessité et la direction. Mais, en raison même de ce que
j'ai cherché à démontrer, je n'estime point possible de répondre
à cette objection d'un point de vue strictement théorique. La
réponse proviendra de la seule expérience d'un mouvement qui,
par la lutte, mettra progressivement en relief les tensions révolu-
tionnaires auparavant invisibles, peut-être inexistantes, et per-
mettra de préciser une alternative.
Afin d'éviter des malentendus et pour conclure sur ce point, je
désirerais faire remarquer ceci : foncièrement erronée m'apparaît
la tendance, aujourd'hui dominante, à séparer le problème de la
révolution en Occident des crises et des tensions que les oppositions
désirerais faire remarquer ceci : foncièrement erronée m'apparaît
la tendance, aujourd'hui dominante, à séparer le problème de la
révolution en Occident des crises et des tensions que les oppositions
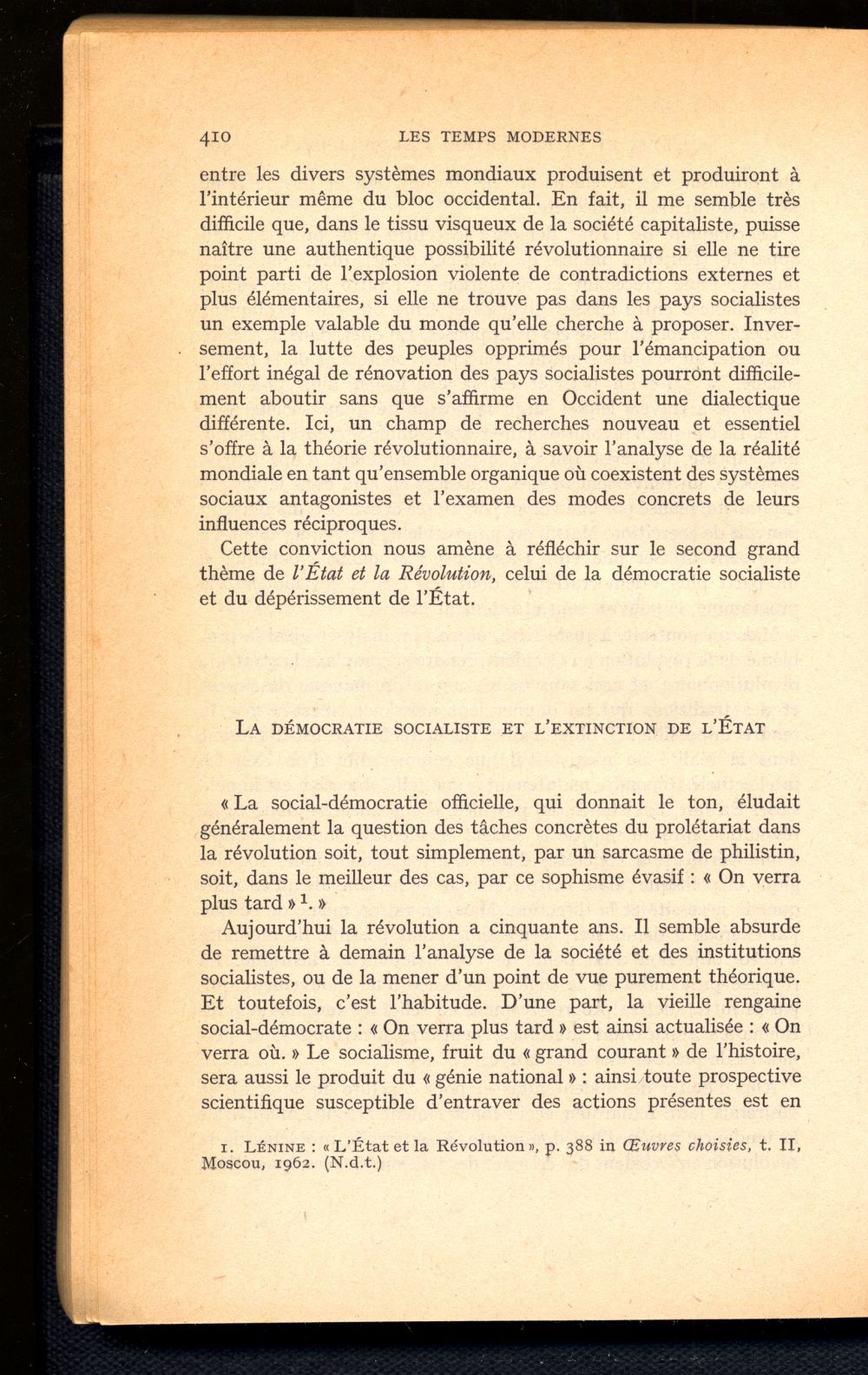

410
LES TEMPS MODERNES
entre les divers systèmes mondiaux produisent et produiront à
l'intérieur même du bloc occidental. En fait, il me semble très
difficile que, dans le tissu visqueux de la société capitaliste, puisse
naître une authentique possibilité révolutionnaire si elle ne tire
point parti de l'explosion violente de contradictions externes et
plus élémentaires, si elle ne trouve pas dans les pays socialistes
un exemple valable du monde qu'elle cherche à proposer. Inver-
sement, la lutte des peuples opprimés pour l'émancipation ou
l'effort inégal de rénovation des pays socialistes pourront difficile-
ment aboutir sans que s'affirme en Occident une dialectique
différente. Ici, un champ de recherches nouveau et essentiel
s'offre à la théorie révolutionnaire, à savoir l'analyse de la réalité
mondiale en tant qu'ensemble organique où coexistent des systèmes
sociaux antagonistes et l'examen des modes concrets de leurs
influences réciproques.
l'intérieur même du bloc occidental. En fait, il me semble très
difficile que, dans le tissu visqueux de la société capitaliste, puisse
naître une authentique possibilité révolutionnaire si elle ne tire
point parti de l'explosion violente de contradictions externes et
plus élémentaires, si elle ne trouve pas dans les pays socialistes
un exemple valable du monde qu'elle cherche à proposer. Inver-
sement, la lutte des peuples opprimés pour l'émancipation ou
l'effort inégal de rénovation des pays socialistes pourront difficile-
ment aboutir sans que s'affirme en Occident une dialectique
différente. Ici, un champ de recherches nouveau et essentiel
s'offre à la théorie révolutionnaire, à savoir l'analyse de la réalité
mondiale en tant qu'ensemble organique où coexistent des systèmes
sociaux antagonistes et l'examen des modes concrets de leurs
influences réciproques.
Cette conviction nous amène à réfléchir sur le second grand
thème de l'État et la Révolution, celui de la démocratie socialiste
et du dépérissement de l'État.
thème de l'État et la Révolution, celui de la démocratie socialiste
et du dépérissement de l'État.
LA DÉMOCRATIE SOCIALISTE ET L'EXTINCTION DE L'ÉTAT
« La social-démocratie officielle, qui donnait le ton, éludait
généralement la question des tâches concrètes du prolétariat dans
la révolution soit, tout simplement, par un sarcasme de philistin,
soit, dans le meilleur des cas, par ce sophisme évasif : « On verra
plus tard »1. »
généralement la question des tâches concrètes du prolétariat dans
la révolution soit, tout simplement, par un sarcasme de philistin,
soit, dans le meilleur des cas, par ce sophisme évasif : « On verra
plus tard »1. »
Aujourd'hui la révolution a cinquante ans. Il semble absurde
de remettre à demain l'analyse de la société et des institutions
socialistes, ou de la mener d'un point de vue purement théorique.
Et toutefois, c'est l'habitude. D'une part, la vieille rengaine
social-démocrate : « On verra plus tard » est ainsi actualisée : « On
verra où. » Le socialisme, fruit du « grand courant » de l'histoire,
sera aussi le produit du « génie national » : ainsi toute prospective
scientifique susceptible d'entraver des actions présentes est en
de remettre à demain l'analyse de la société et des institutions
socialistes, ou de la mener d'un point de vue purement théorique.
Et toutefois, c'est l'habitude. D'une part, la vieille rengaine
social-démocrate : « On verra plus tard » est ainsi actualisée : « On
verra où. » Le socialisme, fruit du « grand courant » de l'histoire,
sera aussi le produit du « génie national » : ainsi toute prospective
scientifique susceptible d'entraver des actions présentes est en
i. LÉNINE : « L'État et la Révolution», p. 388 in Œuvres choisies, t. II,
Moscou, 1962. (N.d.t.)
Moscou, 1962. (N.d.t.)
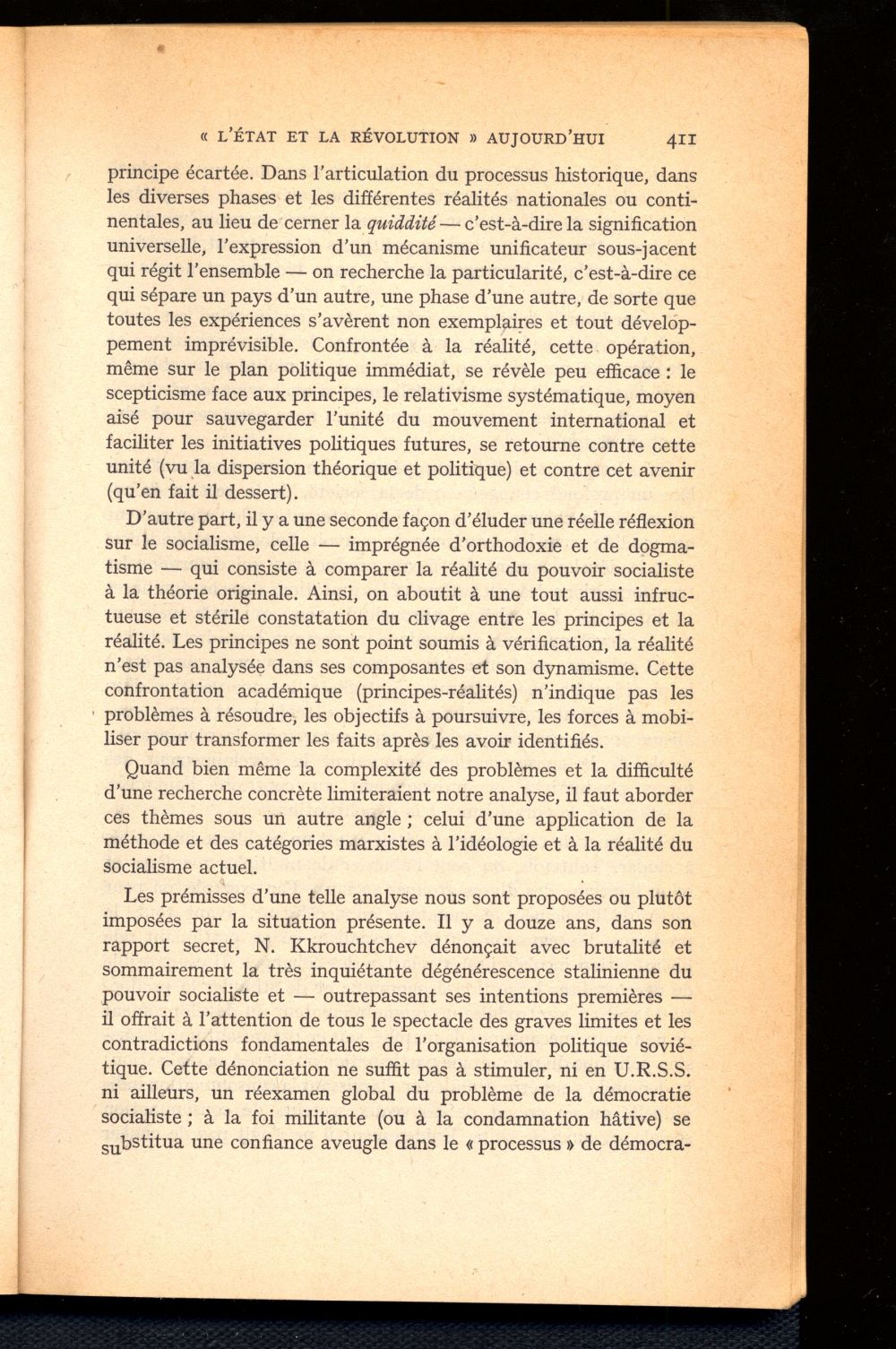

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
411
principe écartée. Dans l'articulation du processus historique, dans
les diverses phases et les différentes réalités nationales ou conti-
nentales, au lieu de cerner la quiddité—c'est-à-dire la signification
universelle, l'expression d'un mécanisme unificateur sous-jacent
qui régit l'ensemble — on recherche la particularité, c'est-à-dire ce
qui sépare un pays d'un autre, une phase d'une autre, de sorte que
toutes les expériences s'avèrent non exemplaires et tout dévelop-
pement imprévisible. Confrontée à la réalité, cette opération,
même sur le plan politique immédiat, se révèle peu efficace : le
scepticisme face aux principes, le relativisme systématique, moyen
aisé pour sauvegarder l'unité du mouvement international et
faciliter les initiatives politiques futures, se retourne contre cette
unité (vu la dispersion théorique et politique) et contre cet avenir
(qu'en fait il dessert).
les diverses phases et les différentes réalités nationales ou conti-
nentales, au lieu de cerner la quiddité—c'est-à-dire la signification
universelle, l'expression d'un mécanisme unificateur sous-jacent
qui régit l'ensemble — on recherche la particularité, c'est-à-dire ce
qui sépare un pays d'un autre, une phase d'une autre, de sorte que
toutes les expériences s'avèrent non exemplaires et tout dévelop-
pement imprévisible. Confrontée à la réalité, cette opération,
même sur le plan politique immédiat, se révèle peu efficace : le
scepticisme face aux principes, le relativisme systématique, moyen
aisé pour sauvegarder l'unité du mouvement international et
faciliter les initiatives politiques futures, se retourne contre cette
unité (vu la dispersion théorique et politique) et contre cet avenir
(qu'en fait il dessert).
D'autre part, il y a une seconde façon d'éluder une réelle réflexion
sur le socialisme, celle — imprégnée d'orthodoxie et de dogma-
tisme — qui consiste à comparer la réalité du pouvoir socialiste
à la théorie originale. Ainsi, on aboutit à une tout aussi infruc-
tueuse et stérile constatation du clivage entre les principes et la
réalité. Les principes ne sont point soumis à vérification, la réalité
n'est pas analysée dans ses composantes et son dynamisme. Cette
confrontation académique (principes-réalités) n'indique pas les
problèmes à résoudre, les objectifs à poursuivre, les forces à mobi-
liser pour transformer les faits après les avoir identifiés.
sur le socialisme, celle — imprégnée d'orthodoxie et de dogma-
tisme — qui consiste à comparer la réalité du pouvoir socialiste
à la théorie originale. Ainsi, on aboutit à une tout aussi infruc-
tueuse et stérile constatation du clivage entre les principes et la
réalité. Les principes ne sont point soumis à vérification, la réalité
n'est pas analysée dans ses composantes et son dynamisme. Cette
confrontation académique (principes-réalités) n'indique pas les
problèmes à résoudre, les objectifs à poursuivre, les forces à mobi-
liser pour transformer les faits après les avoir identifiés.
Quand bien même la complexité des problèmes et la difficulté
d'une recherche concrète limiteraient notre analyse, il faut aborder
ces thèmes sous un autre angle ; celui d'une application de la
méthode et des catégories marxistes à l'idéologie et à la réalité du
socialisme actuel.
d'une recherche concrète limiteraient notre analyse, il faut aborder
ces thèmes sous un autre angle ; celui d'une application de la
méthode et des catégories marxistes à l'idéologie et à la réalité du
socialisme actuel.
Les prémisses d'une telle analyse nous sont proposées ou plutôt
imposées par la situation présente. Il y a douze ans, dans son
rapport secret, N. Kkrouchtchev dénonçait avec brutalité et
sommairement la très inquiétante dégénérescence stalinienne du
pouvoir socialiste et — outrepassant ses intentions premières —
il offrait à l'attention de tous le spectacle des graves limites et les
contradictions fondamentales de l'organisation politique sovié-
tique. Cette dénonciation ne suffit pas à stimuler, ni en U.R.S.S.
ni ailleurs, un réexamen global du problème de la démocratie
socialiste ; à la foi militante (ou à la condamnation hâtive) se
substitua une confiance aveugle dans le « processus » de démocra-
imposées par la situation présente. Il y a douze ans, dans son
rapport secret, N. Kkrouchtchev dénonçait avec brutalité et
sommairement la très inquiétante dégénérescence stalinienne du
pouvoir socialiste et — outrepassant ses intentions premières —
il offrait à l'attention de tous le spectacle des graves limites et les
contradictions fondamentales de l'organisation politique sovié-
tique. Cette dénonciation ne suffit pas à stimuler, ni en U.R.S.S.
ni ailleurs, un réexamen global du problème de la démocratie
socialiste ; à la foi militante (ou à la condamnation hâtive) se
substitua une confiance aveugle dans le « processus » de démocra-
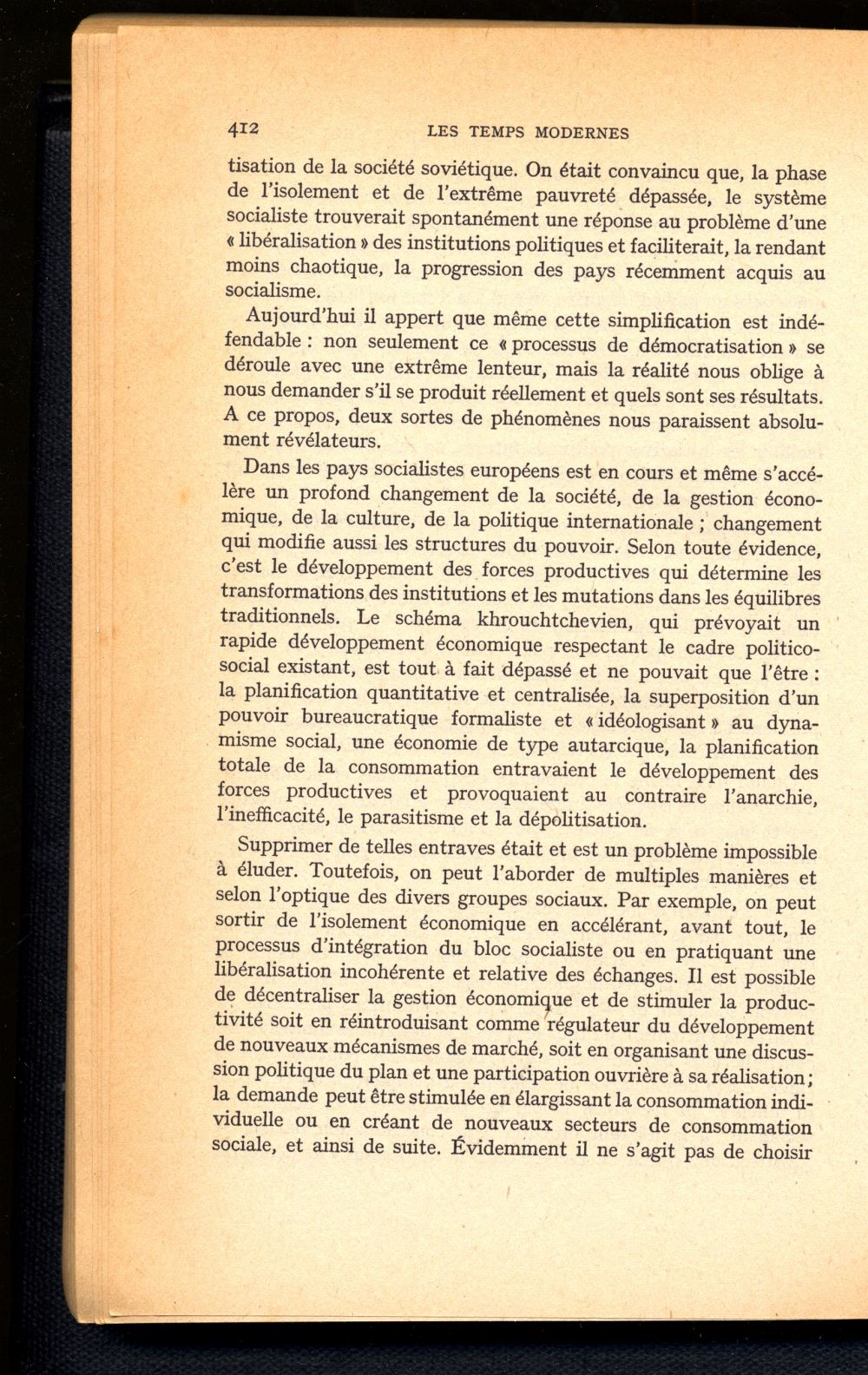

412
LES TEMPS MODERNES
tisation de la société soviétique. On était convaincu que, la phase
de l'isolement et de l'extrême pauvreté dépassée, le système
socialiste trouverait spontanément une réponse au problème d'une
« libéralisation » des institutions politiques et faciliterait, la rendant
moins chaotique, la progression des pays récemment acquis au
socialisme.
de l'isolement et de l'extrême pauvreté dépassée, le système
socialiste trouverait spontanément une réponse au problème d'une
« libéralisation » des institutions politiques et faciliterait, la rendant
moins chaotique, la progression des pays récemment acquis au
socialisme.
Aujourd'hui il appert que même cette simplification est indé-
fendable : non seulement ce « processus de démocratisation » se
déroule avec une extrême lenteur, mais la réalité nous oblige à
nous demander s'il se produit réellement et quels sont ses résultats.
A ce propos, deux sortes de phénomènes nous paraissent absolu-
ment révélateurs.
fendable : non seulement ce « processus de démocratisation » se
déroule avec une extrême lenteur, mais la réalité nous oblige à
nous demander s'il se produit réellement et quels sont ses résultats.
A ce propos, deux sortes de phénomènes nous paraissent absolu-
ment révélateurs.
Dans les pays socialistes européens est en cours et même s'accé-
lère un profond changement de la société, de la gestion écono-
mique, de la culture, de la politique internationale ; changement
qui modifie aussi les structures du pouvoir. Selon toute évidence,
c'est le développement des forces productives qui détermine les
transformations des institutions et les mutations dans les équilibres
traditionnels. Le schéma khrouchtchevien, qui prévoyait un
rapide développement économique respectant le cadre politico-
social existant, est tout à fait dépassé et ne pouvait que l'être :
la planification quantitative et centralisée, la superposition d'un
pouvoir bureaucratique formaliste et « idéologisant » au dyna-
misme social, une économie de type autarcique, la planification
totale de la consommation entravaient le développement des
forces productives et provoquaient au contraire l'anarchie,
l'inefficacité, le parasitisme et la dépolitisation.
lère un profond changement de la société, de la gestion écono-
mique, de la culture, de la politique internationale ; changement
qui modifie aussi les structures du pouvoir. Selon toute évidence,
c'est le développement des forces productives qui détermine les
transformations des institutions et les mutations dans les équilibres
traditionnels. Le schéma khrouchtchevien, qui prévoyait un
rapide développement économique respectant le cadre politico-
social existant, est tout à fait dépassé et ne pouvait que l'être :
la planification quantitative et centralisée, la superposition d'un
pouvoir bureaucratique formaliste et « idéologisant » au dyna-
misme social, une économie de type autarcique, la planification
totale de la consommation entravaient le développement des
forces productives et provoquaient au contraire l'anarchie,
l'inefficacité, le parasitisme et la dépolitisation.
Supprimer de telles entraves était et est un problème impossible
à éluder. Toutefois, on peut l'aborder de multiples manières et
selon l'optique des divers groupes sociaux. Par exemple, on peut
sortir de l'isolement économique en accélérant, avant tout, le
processus d'intégration du bloc socialiste ou en pratiquant une
libéralisation incohérente et relative des échanges. Il est possible
de décentraliser la gestion économique et de stimuler la produc-
tivité soit en réintroduisant comme régulateur du développement
de nouveaux mécanismes de marché, soit en organisant une discus-
sion politique du plan et une participation ouvrière à sa réalisation ;
la demande peut être stimulée en élargissant la consommation indi-
viduelle ou en créant de nouveaux secteurs de consommation
sociale, et ainsi de suite. Évidemment il ne s'agit pas de choisir
à éluder. Toutefois, on peut l'aborder de multiples manières et
selon l'optique des divers groupes sociaux. Par exemple, on peut
sortir de l'isolement économique en accélérant, avant tout, le
processus d'intégration du bloc socialiste ou en pratiquant une
libéralisation incohérente et relative des échanges. Il est possible
de décentraliser la gestion économique et de stimuler la produc-
tivité soit en réintroduisant comme régulateur du développement
de nouveaux mécanismes de marché, soit en organisant une discus-
sion politique du plan et une participation ouvrière à sa réalisation ;
la demande peut être stimulée en élargissant la consommation indi-
viduelle ou en créant de nouveaux secteurs de consommation
sociale, et ainsi de suite. Évidemment il ne s'agit pas de choisir
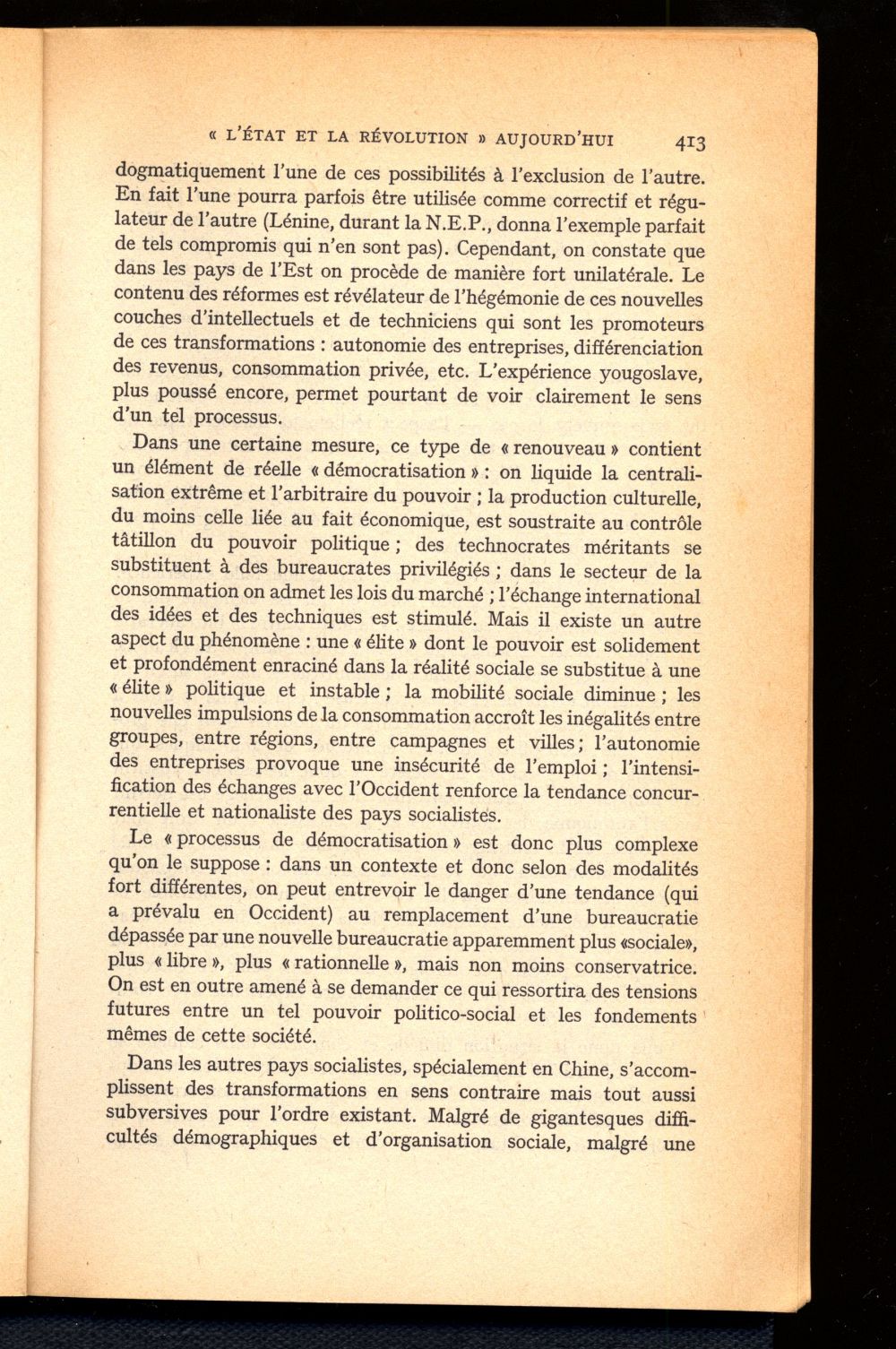

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
dogmatiquement l'une de ces possibilités à l'exclusion de l'autre.
En fait l'une pourra parfois être utilisée comme correctif et régu-
lateur de l'autre (Lénine, durant la N.E.P., donna l'exemple parfait
de tels compromis qui n'en sont pas). Cependant, on constate que
dans les pays de l'Est on procède de manière fort unilatérale. Le
contenu des réformes est révélateur de l'hégémonie de ces nouvelles
couches d'intellectuels et de techniciens qui sont les promoteurs
de ces transformations : autonomie des entreprises, différenciation
des revenus, consommation privée, etc. L'expérience yougoslave,
plus poussé encore, permet pourtant de voir clairement le sens
d'un tel processus.
En fait l'une pourra parfois être utilisée comme correctif et régu-
lateur de l'autre (Lénine, durant la N.E.P., donna l'exemple parfait
de tels compromis qui n'en sont pas). Cependant, on constate que
dans les pays de l'Est on procède de manière fort unilatérale. Le
contenu des réformes est révélateur de l'hégémonie de ces nouvelles
couches d'intellectuels et de techniciens qui sont les promoteurs
de ces transformations : autonomie des entreprises, différenciation
des revenus, consommation privée, etc. L'expérience yougoslave,
plus poussé encore, permet pourtant de voir clairement le sens
d'un tel processus.
Dans une certaine mesure, ce type de « renouveau » contient
un élément de réelle « démocratisation » : on liquide la centrali-
sation extrême et l'arbitraire du pouvoir ; la production culturelle,
du moins celle liée au fait économique, est soustraite au contrôle
tatillon du pouvoir politique ; des technocrates méritants se
substituent à des bureaucrates privilégiés ; dans le secteur de la
consommation on admet les lois du marché ; l'échange international
des idées et des techniques est stimulé. Mais il existe un autre
aspect du phénomène : une « élite » dont le pouvoir est solidement
et profondément enraciné dans la réalité sociale se substitue à une
« élite » politique et instable ; la mobilité sociale diminue ; les
nouvelles impulsions de la consommation accroît les inégalités entre
groupes, entre régions, entre campagnes et villes; l'autonomie
des entreprises provoque une insécurité de l'emploi ; l'intensi-
fication des échanges avec l'Occident renforce la tendance concur-
rentielle et nationaliste des pays socialistes.
un élément de réelle « démocratisation » : on liquide la centrali-
sation extrême et l'arbitraire du pouvoir ; la production culturelle,
du moins celle liée au fait économique, est soustraite au contrôle
tatillon du pouvoir politique ; des technocrates méritants se
substituent à des bureaucrates privilégiés ; dans le secteur de la
consommation on admet les lois du marché ; l'échange international
des idées et des techniques est stimulé. Mais il existe un autre
aspect du phénomène : une « élite » dont le pouvoir est solidement
et profondément enraciné dans la réalité sociale se substitue à une
« élite » politique et instable ; la mobilité sociale diminue ; les
nouvelles impulsions de la consommation accroît les inégalités entre
groupes, entre régions, entre campagnes et villes; l'autonomie
des entreprises provoque une insécurité de l'emploi ; l'intensi-
fication des échanges avec l'Occident renforce la tendance concur-
rentielle et nationaliste des pays socialistes.
Le « processus de démocratisation » est donc plus complexe
qu'on le suppose : dans un contexte et donc selon des modalités
fort différentes, on peut entrevoir le danger d'une tendance (qui
a prévalu en Occident) au remplacement d'une bureaucratie
dépassée par une nouvelle bureaucratie apparemment plus «sociale»,
plus « libre », plus « rationnelle », mais non moins conservatrice.
On est en outre amené à se demander ce qui ressortira des tensions
futures entre un tel pouvoir politico-social et les fondements
mêmes de cette société.
qu'on le suppose : dans un contexte et donc selon des modalités
fort différentes, on peut entrevoir le danger d'une tendance (qui
a prévalu en Occident) au remplacement d'une bureaucratie
dépassée par une nouvelle bureaucratie apparemment plus «sociale»,
plus « libre », plus « rationnelle », mais non moins conservatrice.
On est en outre amené à se demander ce qui ressortira des tensions
futures entre un tel pouvoir politico-social et les fondements
mêmes de cette société.
Dans les autres pays socialistes, spécialement en Chine, s'accom-
plissent des transformations en sens contraire mais tout aussi
subversives pour l'ordre existant. Malgré de gigantesques diffi-
cultés démographiques et d'organisation sociale, malgré une
plissent des transformations en sens contraire mais tout aussi
subversives pour l'ordre existant. Malgré de gigantesques diffi-
cultés démographiques et d'organisation sociale, malgré une
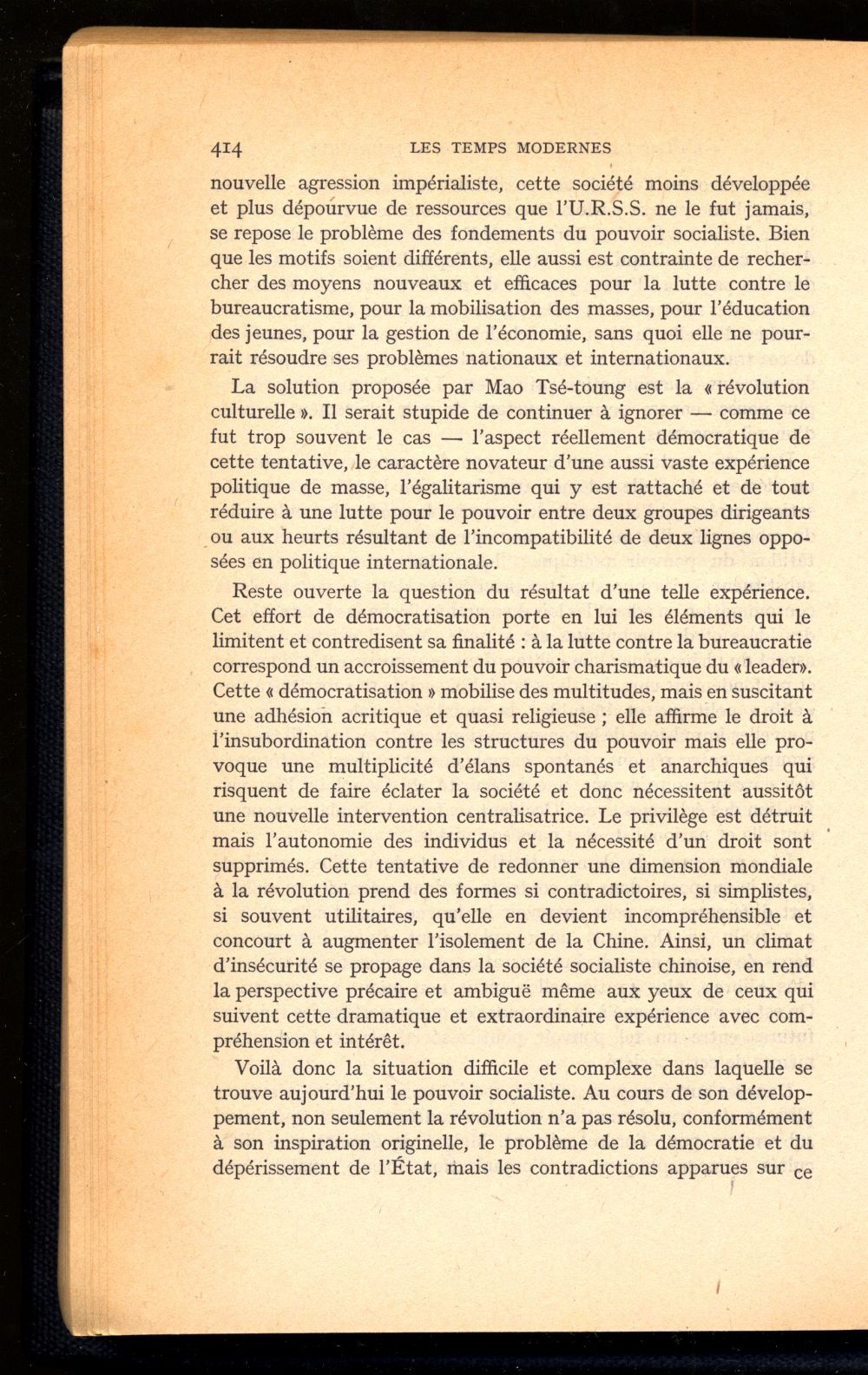

414
LES TEMPS MODERNES
nouvelle agression impérialiste, cette société moins développée
et plus dépourvue de ressources que l'U.R.S.S. ne le fut jamais,
se repose le problème des fondements du pouvoir socialiste. Bien
que les motifs soient différents, elle aussi est contrainte de recher-
cher des moyens nouveaux et efficaces pour la lutte contre le
bureaucratisme, pour la mobilisation des masses, pour l'éducation
des jeunes, pour la gestion de l'économie, sans quoi elle ne pour-
rait résoudre ses problèmes nationaux et internationaux.
et plus dépourvue de ressources que l'U.R.S.S. ne le fut jamais,
se repose le problème des fondements du pouvoir socialiste. Bien
que les motifs soient différents, elle aussi est contrainte de recher-
cher des moyens nouveaux et efficaces pour la lutte contre le
bureaucratisme, pour la mobilisation des masses, pour l'éducation
des jeunes, pour la gestion de l'économie, sans quoi elle ne pour-
rait résoudre ses problèmes nationaux et internationaux.
La solution proposée par Mao Tsé-toung est la « révolution
culturelle ». Il serait stupide de continuer à ignorer —• comme ce
fut trop souvent le cas — l'aspect réellement démocratique de
cette tentative, le caractère novateur d'une aussi vaste expérience
politique de masse, l'égalitarisme qui y est rattaché et de tout
réduire à une lutte pour le pouvoir entre deux groupes dirigeants
ou aux heurts résultant de l'incompatibilité de deux lignes oppo-
sées en politique internationale.
culturelle ». Il serait stupide de continuer à ignorer —• comme ce
fut trop souvent le cas — l'aspect réellement démocratique de
cette tentative, le caractère novateur d'une aussi vaste expérience
politique de masse, l'égalitarisme qui y est rattaché et de tout
réduire à une lutte pour le pouvoir entre deux groupes dirigeants
ou aux heurts résultant de l'incompatibilité de deux lignes oppo-
sées en politique internationale.
Reste ouverte la question du résultat d'une telle expérience.
Cet effort de démocratisation porte en lui les éléments qui le
limitent et contredisent sa finalité : à la lutte contre la bureaucratie
correspond un accroissement du pouvoir charismatique du « leader».
Cette « démocratisation » mobilise des multitudes, mais en suscitant
une adhésion acritique et quasi religieuse ; elle affirme le droit à
l'insubordination contre les structures du pouvoir mais elle pro-
voque une multiplicité d'élans spontanés et anarchiques qui
risquent de faire éclater la société et donc nécessitent aussitôt
une nouvelle intervention centralisatrice. Le privilège est détruit
mais l'autonomie des individus et la nécessité d'un droit sont
supprimés. Cette tentative de redonner une dimension mondiale
à la révolution prend des formes si contradictoires, si simplistes,
si souvent utilitaires, qu'elle en devient incompréhensible et
concourt à augmenter l'isolement de la Chine. Ainsi, un climat
d'insécurité se propage dans la société socialiste chinoise, en rend
la perspective précaire et ambiguë même aux yeux de ceux qui
suivent cette dramatique et extraordinaire expérience avec com-
préhension et intérêt.
Cet effort de démocratisation porte en lui les éléments qui le
limitent et contredisent sa finalité : à la lutte contre la bureaucratie
correspond un accroissement du pouvoir charismatique du « leader».
Cette « démocratisation » mobilise des multitudes, mais en suscitant
une adhésion acritique et quasi religieuse ; elle affirme le droit à
l'insubordination contre les structures du pouvoir mais elle pro-
voque une multiplicité d'élans spontanés et anarchiques qui
risquent de faire éclater la société et donc nécessitent aussitôt
une nouvelle intervention centralisatrice. Le privilège est détruit
mais l'autonomie des individus et la nécessité d'un droit sont
supprimés. Cette tentative de redonner une dimension mondiale
à la révolution prend des formes si contradictoires, si simplistes,
si souvent utilitaires, qu'elle en devient incompréhensible et
concourt à augmenter l'isolement de la Chine. Ainsi, un climat
d'insécurité se propage dans la société socialiste chinoise, en rend
la perspective précaire et ambiguë même aux yeux de ceux qui
suivent cette dramatique et extraordinaire expérience avec com-
préhension et intérêt.
Voilà donc la situation difficile et complexe dans laquelle se
trouve aujourd'hui le pouvoir socialiste. Au cours de son dévelop-
pement, non seulement la révolution n'a pas résolu, conformément
à son inspiration originelle, le problème de la démocratie et du
dépérissement de l'État, mais les contradictions apparues sur ce
trouve aujourd'hui le pouvoir socialiste. Au cours de son dévelop-
pement, non seulement la révolution n'a pas résolu, conformément
à son inspiration originelle, le problème de la démocratie et du
dépérissement de l'État, mais les contradictions apparues sur ce
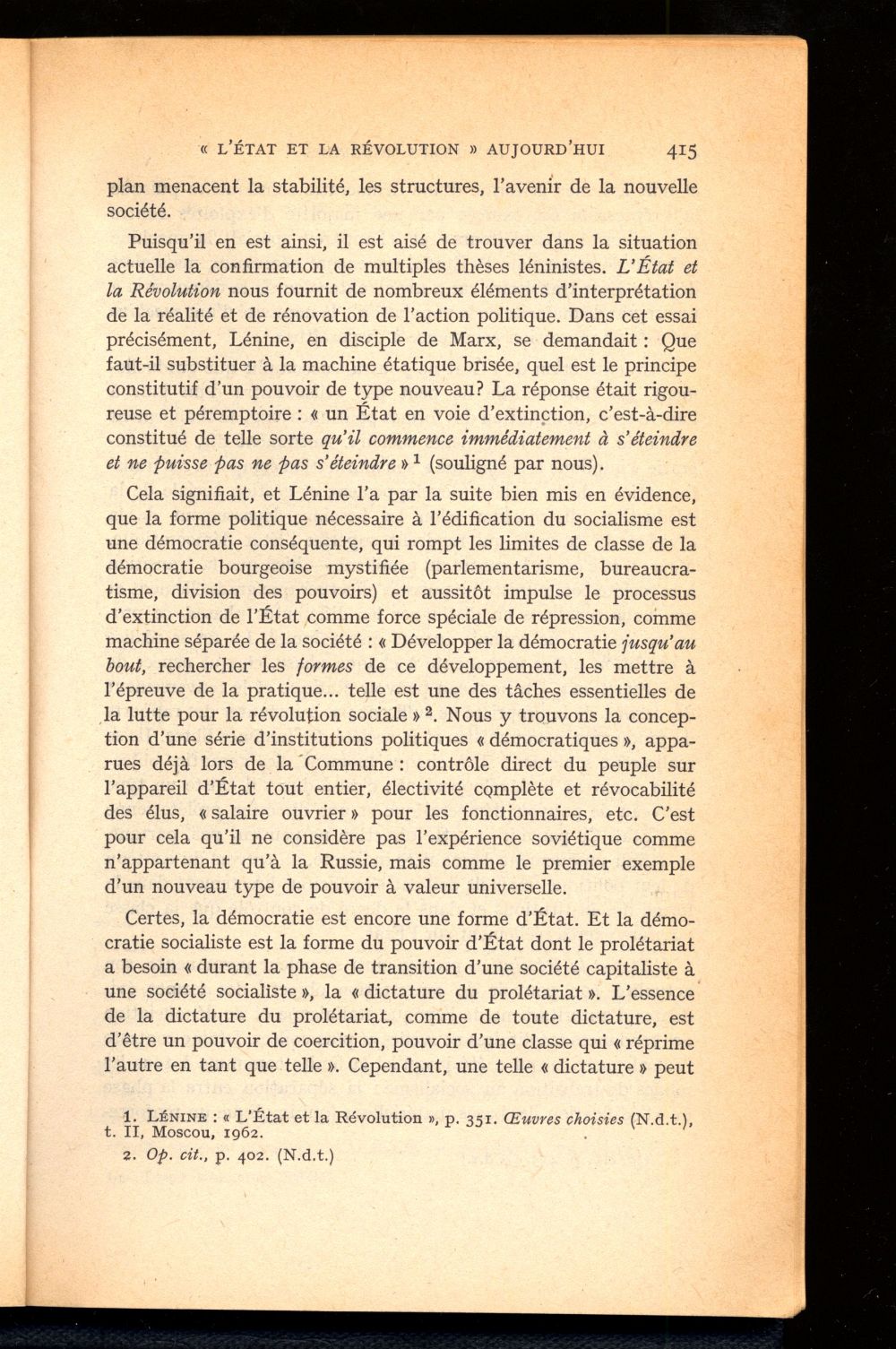

« L ETAT ET LA REVOLUTION » AUJOURD HUI
415
plan menacent la stabilité, les structures, l'avenir de la nouvelle
société.
société.
Puisqu'il en est ainsi, il est aisé de trouver dans la situation
actuelle la confirmation de multiples thèses léninistes. L'État et
la Révolution nous fournit de nombreux éléments d'interprétation
de la réalité et de rénovation de l'action politique. Dans cet essai
précisément, Lénine, en disciple de Marx, se demandait : Que
faut-il substituer à la machine étatique brisée, quel est le principe
constitutif d'un pouvoir de type nouveau? La réponse était rigou-
reuse et péremptoire : « un État en voie d'extinction, c'est-à-dire
constitué de telle sorte qu'il commence immédiatement à s'éteindre
et ne puisse pas ne pas s'éteindre » 1 (souligné par nous).
actuelle la confirmation de multiples thèses léninistes. L'État et
la Révolution nous fournit de nombreux éléments d'interprétation
de la réalité et de rénovation de l'action politique. Dans cet essai
précisément, Lénine, en disciple de Marx, se demandait : Que
faut-il substituer à la machine étatique brisée, quel est le principe
constitutif d'un pouvoir de type nouveau? La réponse était rigou-
reuse et péremptoire : « un État en voie d'extinction, c'est-à-dire
constitué de telle sorte qu'il commence immédiatement à s'éteindre
et ne puisse pas ne pas s'éteindre » 1 (souligné par nous).
Cela signifiait, et Lénine l'a par la suite bien mis en évidence,
que la forme politique nécessaire à l'édification du socialisme est
une démocratie conséquente, qui rompt les limites de classe de la
démocratie bourgeoise mystifiée (parlementarisme, bureaucra-
tisme, division des pouvoirs) et aussitôt impulse le processus
d'extinction de l'État comme force spéciale de répression, comme
machine séparée de la société : « Développer la démocratie jusqu'au
bout, rechercher les formes de ce développement, les mettre à
l'épreuve de la pratique... telle est une des tâches essentielles de
la lutte pour la révolution sociale »2. Nous y trouvons la concep-
tion d'une série d'institutions politiques « démocratiques », appa-
rues déjà lors de la Commune : contrôle direct du peuple sur
l'appareil d'État tout entier, électivité complète et révocabilité
des élus, « salaire ouvrier » pour les fonctionnaires, etc. C'est
pour cela qu'il ne considère pas l'expérience soviétique comme
n'appartenant qu'à la Russie, mais comme le premier exemple
d'un nouveau type de pouvoir à valeur universelle.
que la forme politique nécessaire à l'édification du socialisme est
une démocratie conséquente, qui rompt les limites de classe de la
démocratie bourgeoise mystifiée (parlementarisme, bureaucra-
tisme, division des pouvoirs) et aussitôt impulse le processus
d'extinction de l'État comme force spéciale de répression, comme
machine séparée de la société : « Développer la démocratie jusqu'au
bout, rechercher les formes de ce développement, les mettre à
l'épreuve de la pratique... telle est une des tâches essentielles de
la lutte pour la révolution sociale »2. Nous y trouvons la concep-
tion d'une série d'institutions politiques « démocratiques », appa-
rues déjà lors de la Commune : contrôle direct du peuple sur
l'appareil d'État tout entier, électivité complète et révocabilité
des élus, « salaire ouvrier » pour les fonctionnaires, etc. C'est
pour cela qu'il ne considère pas l'expérience soviétique comme
n'appartenant qu'à la Russie, mais comme le premier exemple
d'un nouveau type de pouvoir à valeur universelle.
Certes, la démocratie est encore une forme d'État. Et la démo-
cratie socialiste est la forme du pouvoir d'État dont le prolétariat
a besoin « durant la phase de transition d'une société capitaliste à
une société socialiste », la « dictature du prolétariat ». L'essence
de la dictature du prolétariat, comme de toute dictature, est
d'être un pouvoir de coercition, pouvoir d'une classe qui « réprime
l'autre en tant que telle ». Cependant, une telle « dictature » peut
cratie socialiste est la forme du pouvoir d'État dont le prolétariat
a besoin « durant la phase de transition d'une société capitaliste à
une société socialiste », la « dictature du prolétariat ». L'essence
de la dictature du prolétariat, comme de toute dictature, est
d'être un pouvoir de coercition, pouvoir d'une classe qui « réprime
l'autre en tant que telle ». Cependant, une telle « dictature » peut
1. LÉNINE : « L'État et la Révolution », p. 351. Œuvres choisies (N.d.t.),
t. II, Moscou, 1962.
t. II, Moscou, 1962.
2. Op. cit., p. 402. (N.d.t.)
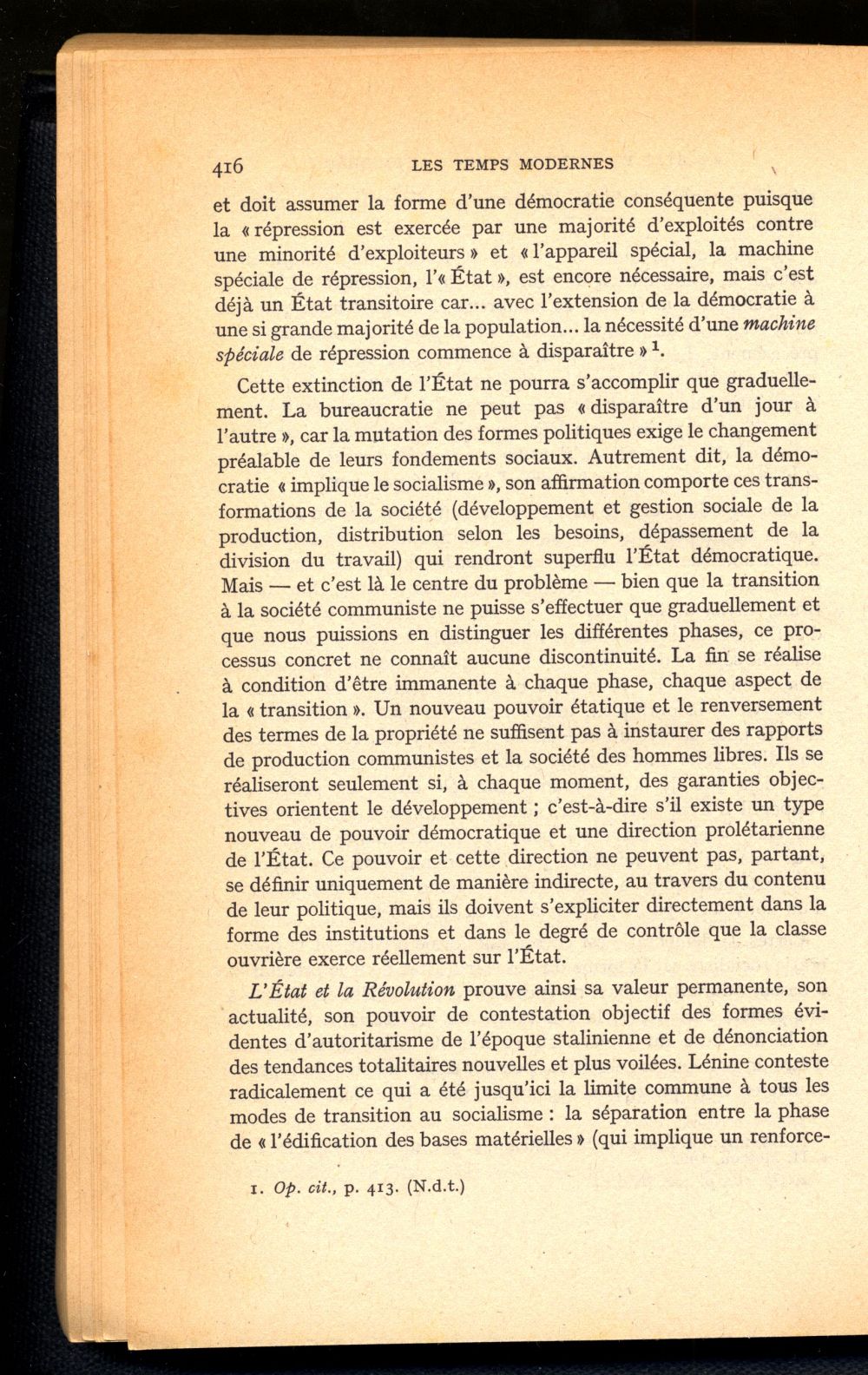

416
LES TEMPS MODERNES
et doit assumer la forme d'une démocratie conséquente puisque
la « répression est exercée par une majorité d'exploités contre
une minorité d'exploiteurs » et « l'appareil spécial, la machine
spéciale de répression, l'« État », est encore nécessaire, mais c'est
déjà un État transitoire car... avec l'extension de la démocratie à
une si grande majorité de la population... la nécessité d'une machine
spéciale de répression commence à disparaître »1.
la « répression est exercée par une majorité d'exploités contre
une minorité d'exploiteurs » et « l'appareil spécial, la machine
spéciale de répression, l'« État », est encore nécessaire, mais c'est
déjà un État transitoire car... avec l'extension de la démocratie à
une si grande majorité de la population... la nécessité d'une machine
spéciale de répression commence à disparaître »1.
Cette extinction de l'État ne pourra s'accomplir que graduelle-
ment. La bureaucratie ne peut pas « disparaître d'un jour à
l'autre », car la mutation des formes politiques exige le changement
préalable de leurs fondements sociaux. Autrement dit, la démo-
cratie « implique le socialisme », son affirmation comporte ces trans-
formations de la société (développement et gestion sociale de la
production, distribution selon les besoins, dépassement de la
division du travail) qui rendront superflu l'État démocratique.
Mais — et c'est là le centre du problème —• bien que la transition
à la société communiste ne puisse s'effectuer que graduellement et
que nous puissions en distinguer les différentes phases, ce pro-
cessus concret ne connaît aucune discontinuité. La fin se réalise
à condition d'être immanente à chaque phase, chaque aspect de
la « transition ». Un nouveau pouvoir étatique et le renversement
des termes de la propriété ne suffisent pas à instaurer des rapports
de production communistes et la société des hommes libres. Ils se
réaliseront seulement si, à chaque moment, des garanties objec-
tives orientent le développement ; c'est-à-dire s'il existe un type
nouveau de pouvoir démocratique et une direction prolétarienne
de l'État. Ce pouvoir et cette direction ne peuvent pas, partant,
se définir uniquement de manière indirecte, au travers du contenu
de leur politique, mais ils doivent s'expliciter directement dans la
forme des institutions et dans le degré de contrôle que la classe
ouvrière exerce réellement sur l'État.
ment. La bureaucratie ne peut pas « disparaître d'un jour à
l'autre », car la mutation des formes politiques exige le changement
préalable de leurs fondements sociaux. Autrement dit, la démo-
cratie « implique le socialisme », son affirmation comporte ces trans-
formations de la société (développement et gestion sociale de la
production, distribution selon les besoins, dépassement de la
division du travail) qui rendront superflu l'État démocratique.
Mais — et c'est là le centre du problème —• bien que la transition
à la société communiste ne puisse s'effectuer que graduellement et
que nous puissions en distinguer les différentes phases, ce pro-
cessus concret ne connaît aucune discontinuité. La fin se réalise
à condition d'être immanente à chaque phase, chaque aspect de
la « transition ». Un nouveau pouvoir étatique et le renversement
des termes de la propriété ne suffisent pas à instaurer des rapports
de production communistes et la société des hommes libres. Ils se
réaliseront seulement si, à chaque moment, des garanties objec-
tives orientent le développement ; c'est-à-dire s'il existe un type
nouveau de pouvoir démocratique et une direction prolétarienne
de l'État. Ce pouvoir et cette direction ne peuvent pas, partant,
se définir uniquement de manière indirecte, au travers du contenu
de leur politique, mais ils doivent s'expliciter directement dans la
forme des institutions et dans le degré de contrôle que la classe
ouvrière exerce réellement sur l'État.
L'État et la Révolution prouve ainsi sa valeur permanente, son
actualité, son pouvoir de contestation objectif des formes évi-
dentes d'autoritarisme de l'époque stalinienne et de dénonciation
des tendances totalitaires nouvelles et plus voilées. Lénine conteste
radicalement ce qui a été jusqu'ici la limite commune à tous les
modes de transition au socialisme : la séparation entre la phase
de « l'édification des bases matérielles » (qui implique un renforce-
actualité, son pouvoir de contestation objectif des formes évi-
dentes d'autoritarisme de l'époque stalinienne et de dénonciation
des tendances totalitaires nouvelles et plus voilées. Lénine conteste
radicalement ce qui a été jusqu'ici la limite commune à tous les
modes de transition au socialisme : la séparation entre la phase
de « l'édification des bases matérielles » (qui implique un renforce-
I. Op. cit., p. 413. (N.d.t.)
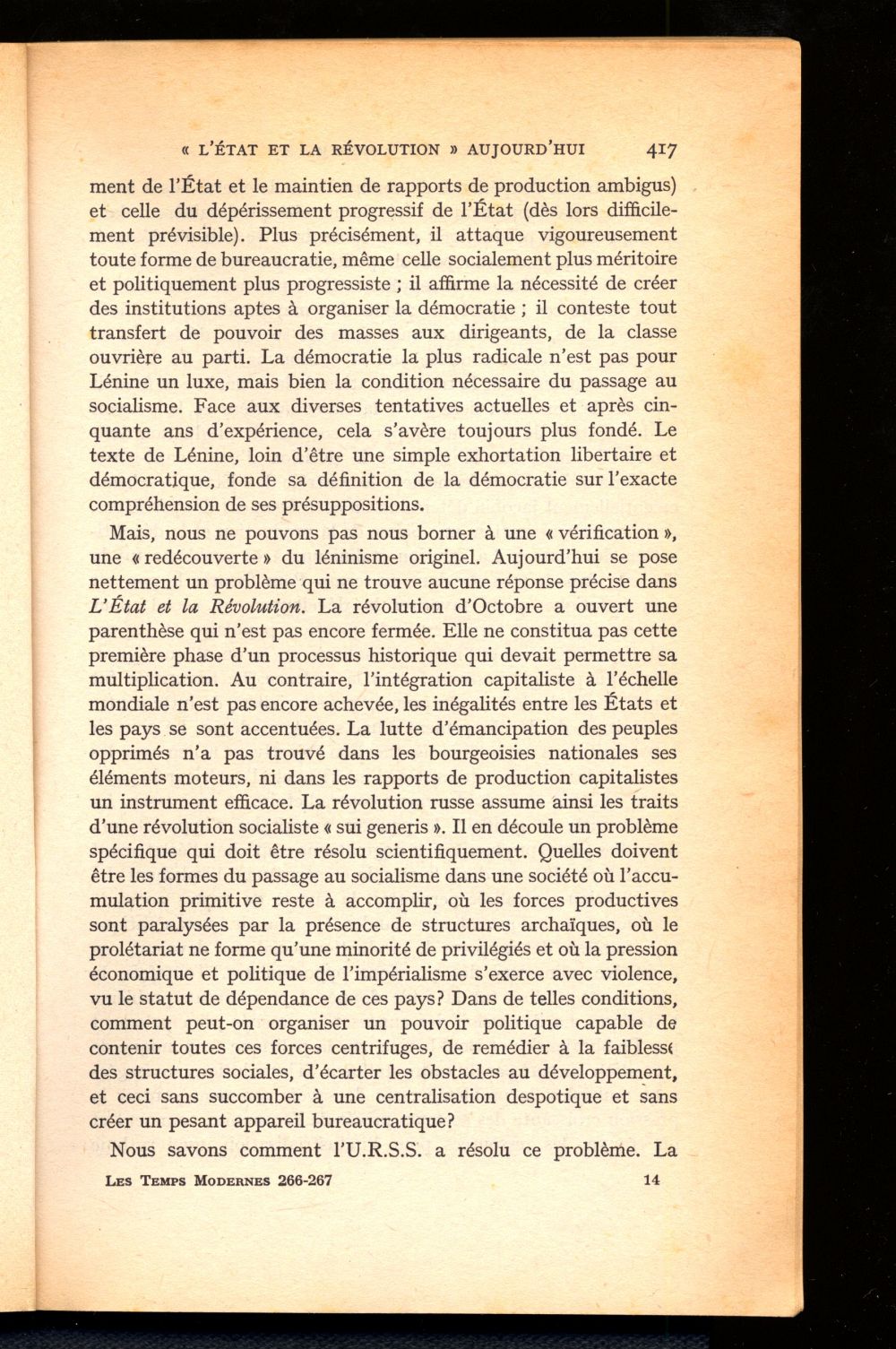

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
ment de l'État et le maintien de rapports de production ambigus)
et celle du dépérissement progressif de l'État (dès lors difficile-
ment prévisible). Plus précisément, il attaque vigoureusement
toute forme de bureaucratie, même celle socialement plus méritoire
et politiquement plus progressiste ; il affirme la nécessité de créer
des institutions aptes à organiser la démocratie ; il conteste tout
transfert de pouvoir des masses aux dirigeants, de la classe
ouvrière au parti. La démocratie la plus radicale n'est pas pour
Lénine un luxe, mais bien la condition nécessaire du passage au
socialisme. Face aux diverses tentatives actuelles et après cin-
quante ans d'expérience, cela s'avère toujours plus fondé. Le
texte de Lénine, loin d'être une simple exhortation libertaire et
démocratique, fonde sa définition de la démocratie sur l'exacte
compréhension de ses présuppositions.
et celle du dépérissement progressif de l'État (dès lors difficile-
ment prévisible). Plus précisément, il attaque vigoureusement
toute forme de bureaucratie, même celle socialement plus méritoire
et politiquement plus progressiste ; il affirme la nécessité de créer
des institutions aptes à organiser la démocratie ; il conteste tout
transfert de pouvoir des masses aux dirigeants, de la classe
ouvrière au parti. La démocratie la plus radicale n'est pas pour
Lénine un luxe, mais bien la condition nécessaire du passage au
socialisme. Face aux diverses tentatives actuelles et après cin-
quante ans d'expérience, cela s'avère toujours plus fondé. Le
texte de Lénine, loin d'être une simple exhortation libertaire et
démocratique, fonde sa définition de la démocratie sur l'exacte
compréhension de ses présuppositions.
Mais, nous ne pouvons pas nous borner à une « vérification »,
une « redécouverte » du léninisme originel. Aujourd'hui se pose
nettement un problème qui ne trouve aucune réponse précise dans
L'État et la Révolution. La révolution d'Octobre a ouvert une
parenthèse qui n'est pas encore fermée. Elle ne constitua pas cette
première phase d'un processus historique qui devait permettre sa
multiplication. Au contraire, l'intégration capitaliste à l'échelle
mondiale n'est pas encore achevée, les inégalités entre les États et
les pays se sont accentuées. La lutte d'émancipation des peuples
opprimés n'a pas trouvé dans les bourgeoisies nationales ses
éléments moteurs, ni dans les rapports de production capitalistes
un instrument efficace. La révolution russe assume ainsi les traits
d'une révolution socialiste « sui generis ». Il en découle un problème
spécifique qui doit être résolu scientifiquement. Quelles doivent
être les formes du passage au socialisme dans une société où l'accu-
mulation primitive reste à accomplir, où les forces productives
sont paralysées par la présence de structures archaïques, où le
prolétariat ne forme qu'une minorité de privilégiés et où la pression
économique et politique de l'impérialisme s'exerce avec violence,
vu le statut de dépendance de ces pays? Dans de telles conditions,
comment peut-on organiser un pouvoir politique capable de
contenir toutes ces forces centrifuges, de remédier à la faibless<
des structures sociales, d'écarter les obstacles au développement,
et ceci sans succomber à une centralisation despotique et sans
créer un pesant appareil bureaucratique?
une « redécouverte » du léninisme originel. Aujourd'hui se pose
nettement un problème qui ne trouve aucune réponse précise dans
L'État et la Révolution. La révolution d'Octobre a ouvert une
parenthèse qui n'est pas encore fermée. Elle ne constitua pas cette
première phase d'un processus historique qui devait permettre sa
multiplication. Au contraire, l'intégration capitaliste à l'échelle
mondiale n'est pas encore achevée, les inégalités entre les États et
les pays se sont accentuées. La lutte d'émancipation des peuples
opprimés n'a pas trouvé dans les bourgeoisies nationales ses
éléments moteurs, ni dans les rapports de production capitalistes
un instrument efficace. La révolution russe assume ainsi les traits
d'une révolution socialiste « sui generis ». Il en découle un problème
spécifique qui doit être résolu scientifiquement. Quelles doivent
être les formes du passage au socialisme dans une société où l'accu-
mulation primitive reste à accomplir, où les forces productives
sont paralysées par la présence de structures archaïques, où le
prolétariat ne forme qu'une minorité de privilégiés et où la pression
économique et politique de l'impérialisme s'exerce avec violence,
vu le statut de dépendance de ces pays? Dans de telles conditions,
comment peut-on organiser un pouvoir politique capable de
contenir toutes ces forces centrifuges, de remédier à la faibless<
des structures sociales, d'écarter les obstacles au développement,
et ceci sans succomber à une centralisation despotique et sans
créer un pesant appareil bureaucratique?
Nous savons comment l'U.R.S.S. a résolu ce problème. La
LES TEMPS MODERNES 266-267 14
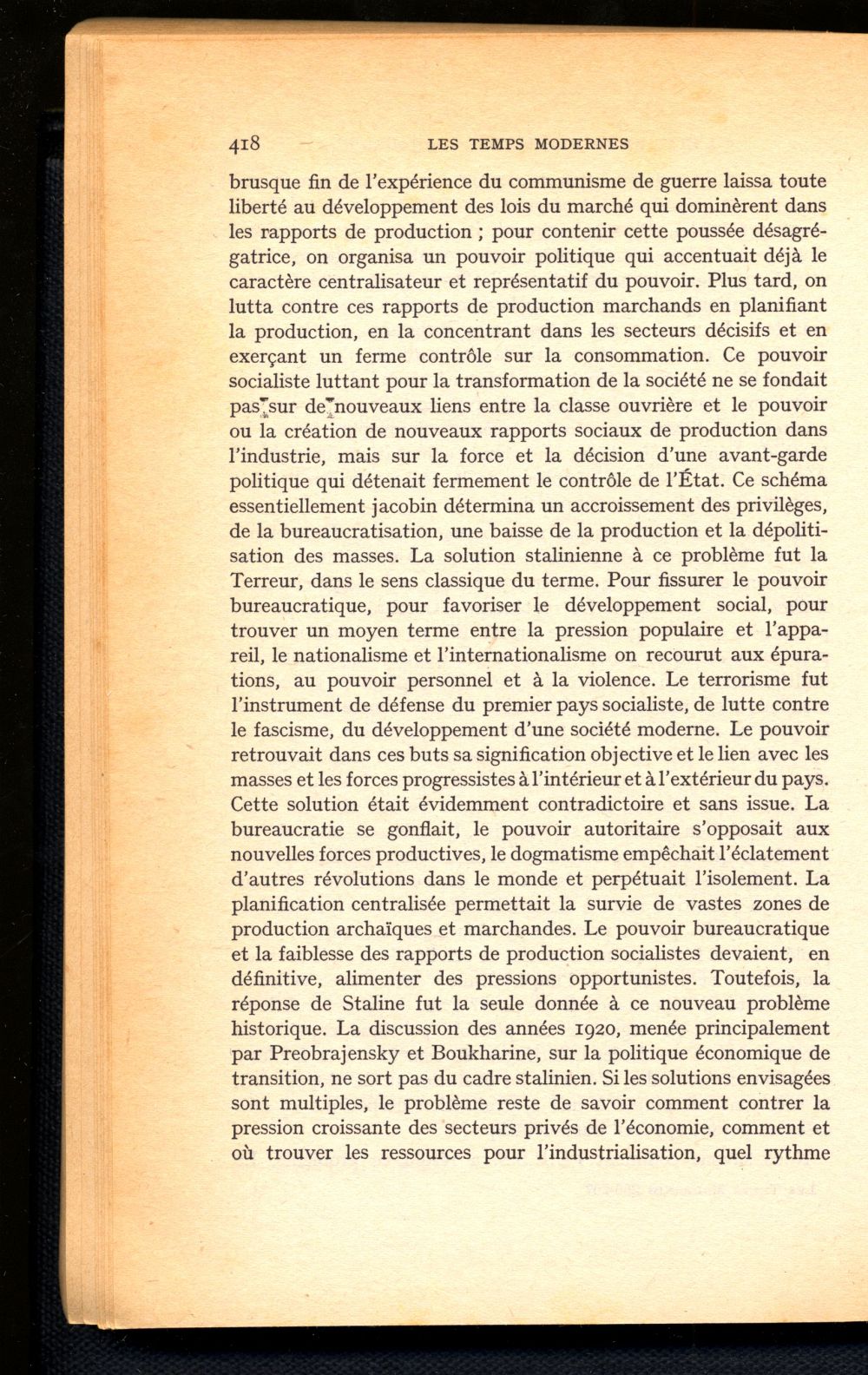

4i8
LES TEMPS MODERNES
brusque fin de l'expérience du communisme de guerre laissa toute
liberté au développement des lois du marché qui dominèrent dans
les rapports de production ; pour contenir cette poussée désagré-
gatrice, on organisa un pouvoir politique qui accentuait déjà le
caractère centralisateur et représentatif du pouvoir. Plus tard, on
lutta contre ces rapports de production marchands en planifiant
la production, en la concentrant dans les secteurs décisifs et en
exerçant un ferme contrôle sur la consommation. Ce pouvoir
socialiste luttant pour la transformation de la société ne se fondait
pas~sur de'nouveaux liens entre la classe ouvrière et le pouvoir
ou la création de nouveaux rapports sociaux de production dans
l'industrie, mais sur la force et la décision d'une avant-garde
politique qui détenait fermement le contrôle de l'État. Ce schéma
essentiellement jacobin détermina un accroissement des privilèges,
de la bureaucratisation, une baisse de la production et la dépoliti-
sation des masses. La solution stalinienne à ce problème fut la
Terreur, dans le sens classique du terme. Pour fissurer le pouvoir
bureaucratique, pour favoriser le développement social, pour
trouver un moyen terme entre la pression populaire et l'appa-
reil, le nationalisme et l'internationalisme on recourut aux épura-
tions, au pouvoir personnel et à la violence. Le terrorisme fut
l'instrument de défense du premier pays socialiste, de lutte contre
le fascisme, du développement d'une société moderne. Le pouvoir
retrouvait dans ces buts sa signification objective et le lien avec les
masses et les forces progressistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Cette solution était évidemment contradictoire et sans issue. La
bureaucratie se gonflait, le pouvoir autoritaire s'opposait aux
nouvelles forces productives, le dogmatisme empêchait l'éclatement
d'autres révolutions dans le monde et perpétuait l'isolement. La
planification centralisée permettait la survie de vastes zones de
production archaïques et marchandes. Le pouvoir bureaucratique
et la faiblesse des rapports de production socialistes devaient, en
définitive, alimenter des pressions opportunistes. Toutefois, la
réponse de Staline fut la seule donnée à ce nouveau problème
historique. La discussion des années 1920, menée principalement
par Preobrajensky et Boukharine, sur la politique économique de
transition, ne sort pas du cadre stalinien. Si les solutions envisagées
sont multiples, le problème reste de savoir comment contrer la
pression croissante des secteurs privés de l'économie, comment et
où trouver les ressources pour l'industrialisation, quel rythme
liberté au développement des lois du marché qui dominèrent dans
les rapports de production ; pour contenir cette poussée désagré-
gatrice, on organisa un pouvoir politique qui accentuait déjà le
caractère centralisateur et représentatif du pouvoir. Plus tard, on
lutta contre ces rapports de production marchands en planifiant
la production, en la concentrant dans les secteurs décisifs et en
exerçant un ferme contrôle sur la consommation. Ce pouvoir
socialiste luttant pour la transformation de la société ne se fondait
pas~sur de'nouveaux liens entre la classe ouvrière et le pouvoir
ou la création de nouveaux rapports sociaux de production dans
l'industrie, mais sur la force et la décision d'une avant-garde
politique qui détenait fermement le contrôle de l'État. Ce schéma
essentiellement jacobin détermina un accroissement des privilèges,
de la bureaucratisation, une baisse de la production et la dépoliti-
sation des masses. La solution stalinienne à ce problème fut la
Terreur, dans le sens classique du terme. Pour fissurer le pouvoir
bureaucratique, pour favoriser le développement social, pour
trouver un moyen terme entre la pression populaire et l'appa-
reil, le nationalisme et l'internationalisme on recourut aux épura-
tions, au pouvoir personnel et à la violence. Le terrorisme fut
l'instrument de défense du premier pays socialiste, de lutte contre
le fascisme, du développement d'une société moderne. Le pouvoir
retrouvait dans ces buts sa signification objective et le lien avec les
masses et les forces progressistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays.
Cette solution était évidemment contradictoire et sans issue. La
bureaucratie se gonflait, le pouvoir autoritaire s'opposait aux
nouvelles forces productives, le dogmatisme empêchait l'éclatement
d'autres révolutions dans le monde et perpétuait l'isolement. La
planification centralisée permettait la survie de vastes zones de
production archaïques et marchandes. Le pouvoir bureaucratique
et la faiblesse des rapports de production socialistes devaient, en
définitive, alimenter des pressions opportunistes. Toutefois, la
réponse de Staline fut la seule donnée à ce nouveau problème
historique. La discussion des années 1920, menée principalement
par Preobrajensky et Boukharine, sur la politique économique de
transition, ne sort pas du cadre stalinien. Si les solutions envisagées
sont multiples, le problème reste de savoir comment contrer la
pression croissante des secteurs privés de l'économie, comment et
où trouver les ressources pour l'industrialisation, quel rythme
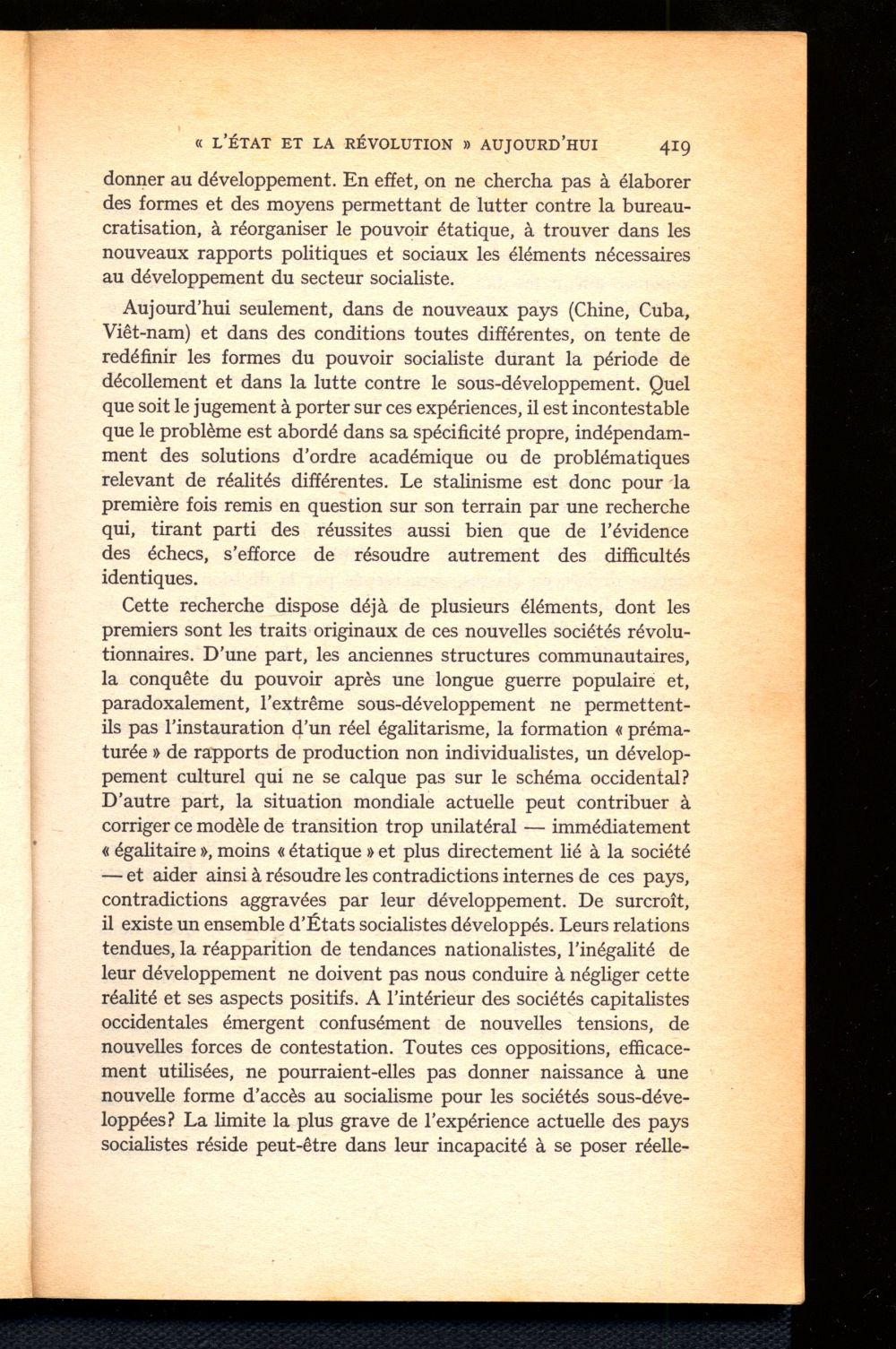

« L ETAT ET LA REVOLUTION » AUJOURD HUI
419
donner au développement. En effet, on ne chercha pas à élaborer
des formes et des moyens permettant de lutter contre la bureau-
cratisation, à réorganiser le pouvoir étatique, à trouver dans les
nouveaux rapports politiques et sociaux les éléments nécessaires
au développement du secteur socialiste.
des formes et des moyens permettant de lutter contre la bureau-
cratisation, à réorganiser le pouvoir étatique, à trouver dans les
nouveaux rapports politiques et sociaux les éléments nécessaires
au développement du secteur socialiste.
Aujourd'hui seulement, dans de nouveaux pays (Chine, Cuba,
Viêt-nam) et dans des conditions toutes différentes, on tente de
redéfinir les formes du pouvoir socialiste durant la période de
décollement et dans la lutte contre le sous-développement. Quel
que soit le jugement à porter sur ces expériences, il est incontestable
que le problème est abordé dans sa spécificité propre, indépendam-
ment des solutions d'ordre académique ou de problématiques
relevant de réalités différentes. Le stalinisme est donc pour la
première fois remis en question sur son terrain par une recherche
qui, tirant parti des réussites aussi bien que de l'évidence
des échecs, s'efforce de résoudre autrement des difficultés
identiques.
Viêt-nam) et dans des conditions toutes différentes, on tente de
redéfinir les formes du pouvoir socialiste durant la période de
décollement et dans la lutte contre le sous-développement. Quel
que soit le jugement à porter sur ces expériences, il est incontestable
que le problème est abordé dans sa spécificité propre, indépendam-
ment des solutions d'ordre académique ou de problématiques
relevant de réalités différentes. Le stalinisme est donc pour la
première fois remis en question sur son terrain par une recherche
qui, tirant parti des réussites aussi bien que de l'évidence
des échecs, s'efforce de résoudre autrement des difficultés
identiques.
Cette recherche dispose déjà de plusieurs éléments, dont les
premiers sont les traits originaux de ces nouvelles sociétés révolu-
tionnaires. D'une part, les anciennes structures communautaires,
la conquête du pouvoir après une longue guerre populaire et,
paradoxalement, l'extrême sous-développement ne permettent-
ils pas l'instauration d'un réel égalitarisme, la formation « préma-
turée » de rapports de production non individualistes, un dévelop-
pement culturel qui ne se calque pas sur le schéma occidental?
D'autre part, la situation mondiale actuelle peut contribuer à
corriger ce modèle de transition trop unilatéral — immédiatement
« égalitaire », moins « étatique » et plus directement lié à la société
— et aider ainsi à résoudre les contradictions internes de ces pays,
contradictions aggravées par leur développement. De surcroît,
il existe un ensemble d'États socialistes développés. Leurs relations
tendues, la réapparition de tendances nationalistes, l'inégalité de
leur développement ne doivent pas nous conduire à négliger cette
réalité et ses aspects positifs. A l'intérieur des sociétés capitalistes
occidentales émergent confusément de nouvelles tensions, de
nouvelles forces de contestation. Toutes ces oppositions, efficace-
ment utilisées, ne pourraient-elles pas donner naissance à une
nouvelle forme d'accès au socialisme pour les sociétés sous-déve-
loppées? La limite la plus grave de l'expérience actuelle des pays
socialistes réside peut-être dans leur incapacité à se poser réelle-
premiers sont les traits originaux de ces nouvelles sociétés révolu-
tionnaires. D'une part, les anciennes structures communautaires,
la conquête du pouvoir après une longue guerre populaire et,
paradoxalement, l'extrême sous-développement ne permettent-
ils pas l'instauration d'un réel égalitarisme, la formation « préma-
turée » de rapports de production non individualistes, un dévelop-
pement culturel qui ne se calque pas sur le schéma occidental?
D'autre part, la situation mondiale actuelle peut contribuer à
corriger ce modèle de transition trop unilatéral — immédiatement
« égalitaire », moins « étatique » et plus directement lié à la société
— et aider ainsi à résoudre les contradictions internes de ces pays,
contradictions aggravées par leur développement. De surcroît,
il existe un ensemble d'États socialistes développés. Leurs relations
tendues, la réapparition de tendances nationalistes, l'inégalité de
leur développement ne doivent pas nous conduire à négliger cette
réalité et ses aspects positifs. A l'intérieur des sociétés capitalistes
occidentales émergent confusément de nouvelles tensions, de
nouvelles forces de contestation. Toutes ces oppositions, efficace-
ment utilisées, ne pourraient-elles pas donner naissance à une
nouvelle forme d'accès au socialisme pour les sociétés sous-déve-
loppées? La limite la plus grave de l'expérience actuelle des pays
socialistes réside peut-être dans leur incapacité à se poser réelle-
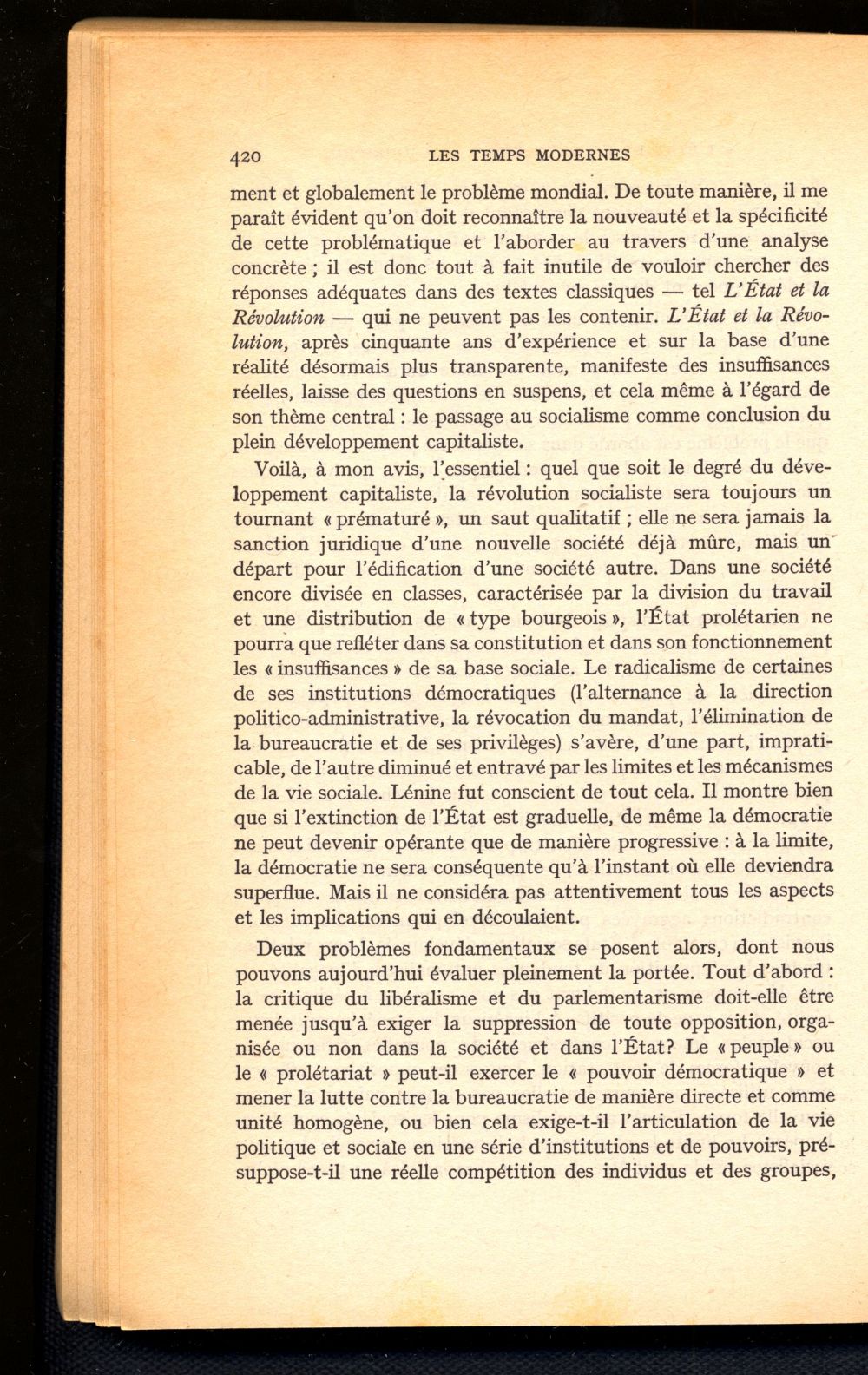

420
LES TEMPS MODERNES
ment et globalement le problème mondial. De toute manière, il me
paraît évident qu'on doit reconnaître la nouveauté et la spécificité
de cette problématique et l'aborder au travers d'une analyse
concrète ; il est donc tout à fait inutile de vouloir chercher des
réponses adéquates dans des textes classiques — tel L'État et la
Révolution — qui ne peuvent pas les contenir. L'État et la Révo-
lution, après cinquante ans d'expérience et sur la base d'une
réalité désormais plus transparente, manifeste des insuffisances
réelles, laisse des questions en suspens, et cela même à l'égard de
son thème central : le passage au socialisme comme conclusion du
plein développement capitaliste.
paraît évident qu'on doit reconnaître la nouveauté et la spécificité
de cette problématique et l'aborder au travers d'une analyse
concrète ; il est donc tout à fait inutile de vouloir chercher des
réponses adéquates dans des textes classiques — tel L'État et la
Révolution — qui ne peuvent pas les contenir. L'État et la Révo-
lution, après cinquante ans d'expérience et sur la base d'une
réalité désormais plus transparente, manifeste des insuffisances
réelles, laisse des questions en suspens, et cela même à l'égard de
son thème central : le passage au socialisme comme conclusion du
plein développement capitaliste.
Voilà, à mon avis, l'essentiel : quel que soit le degré du déve-
loppement capitaliste, la révolution socialiste sera toujours un
tournant «prématuré », un saut qualitatif ; elle ne sera jamais la
sanction juridique d'une nouvelle société déjà mûre, mais un
départ pour l'édification d'une société autre. Dans une société
encore divisée en classes, caractérisée par la division du travail
et une distribution de « type bourgeois », l'État prolétarien ne
pourra que refléter dans sa constitution et dans son fonctionnement
les « insuffisances » de sa base sociale. Le radicalisme de certaines
de ses institutions démocratiques (l'alternance à la direction
politico-administrative, la révocation du mandat, l'élimination de
la bureaucratie et de ses privilèges) s'avère, d'une part, imprati-
cable, de l'autre diminué et entravé par les limites et les mécanismes
de la vie sociale. Lénine fut conscient de tout cela. Il montre bien
que si l'extinction de l'État est graduelle, de même la démocratie
ne peut devenir opérante que de manière progressive : à la limite,
la démocratie ne sera conséquente qu'à l'instant où elle deviendra
superflue. Mais il ne considéra pas attentivement tous les aspects
et les implications qui en découlaient.
loppement capitaliste, la révolution socialiste sera toujours un
tournant «prématuré », un saut qualitatif ; elle ne sera jamais la
sanction juridique d'une nouvelle société déjà mûre, mais un
départ pour l'édification d'une société autre. Dans une société
encore divisée en classes, caractérisée par la division du travail
et une distribution de « type bourgeois », l'État prolétarien ne
pourra que refléter dans sa constitution et dans son fonctionnement
les « insuffisances » de sa base sociale. Le radicalisme de certaines
de ses institutions démocratiques (l'alternance à la direction
politico-administrative, la révocation du mandat, l'élimination de
la bureaucratie et de ses privilèges) s'avère, d'une part, imprati-
cable, de l'autre diminué et entravé par les limites et les mécanismes
de la vie sociale. Lénine fut conscient de tout cela. Il montre bien
que si l'extinction de l'État est graduelle, de même la démocratie
ne peut devenir opérante que de manière progressive : à la limite,
la démocratie ne sera conséquente qu'à l'instant où elle deviendra
superflue. Mais il ne considéra pas attentivement tous les aspects
et les implications qui en découlaient.
Deux problèmes fondamentaux se posent alors, dont nous
pouvons aujourd'hui évaluer pleinement la portée. Tout d'abord :
la critique du libéralisme et du parlementarisme doit-elle être
menée jusqu'à exiger la suppression de toute opposition, orga-
nisée ou non dans la société et dans l'État? Le «peuple» ou
le « prolétariat » peut-il exercer le « pouvoir démocratique » et
mener la lutte contre la bureaucratie de manière directe et comme
unité homogène, ou bien cela exige-t-il l'articulation de la vie
politique et sociale en une série d'institutions et de pouvoirs, pré-
suppose-t-il une réelle compétition des individus et des groupes,
pouvons aujourd'hui évaluer pleinement la portée. Tout d'abord :
la critique du libéralisme et du parlementarisme doit-elle être
menée jusqu'à exiger la suppression de toute opposition, orga-
nisée ou non dans la société et dans l'État? Le «peuple» ou
le « prolétariat » peut-il exercer le « pouvoir démocratique » et
mener la lutte contre la bureaucratie de manière directe et comme
unité homogène, ou bien cela exige-t-il l'articulation de la vie
politique et sociale en une série d'institutions et de pouvoirs, pré-
suppose-t-il une réelle compétition des individus et des groupes,
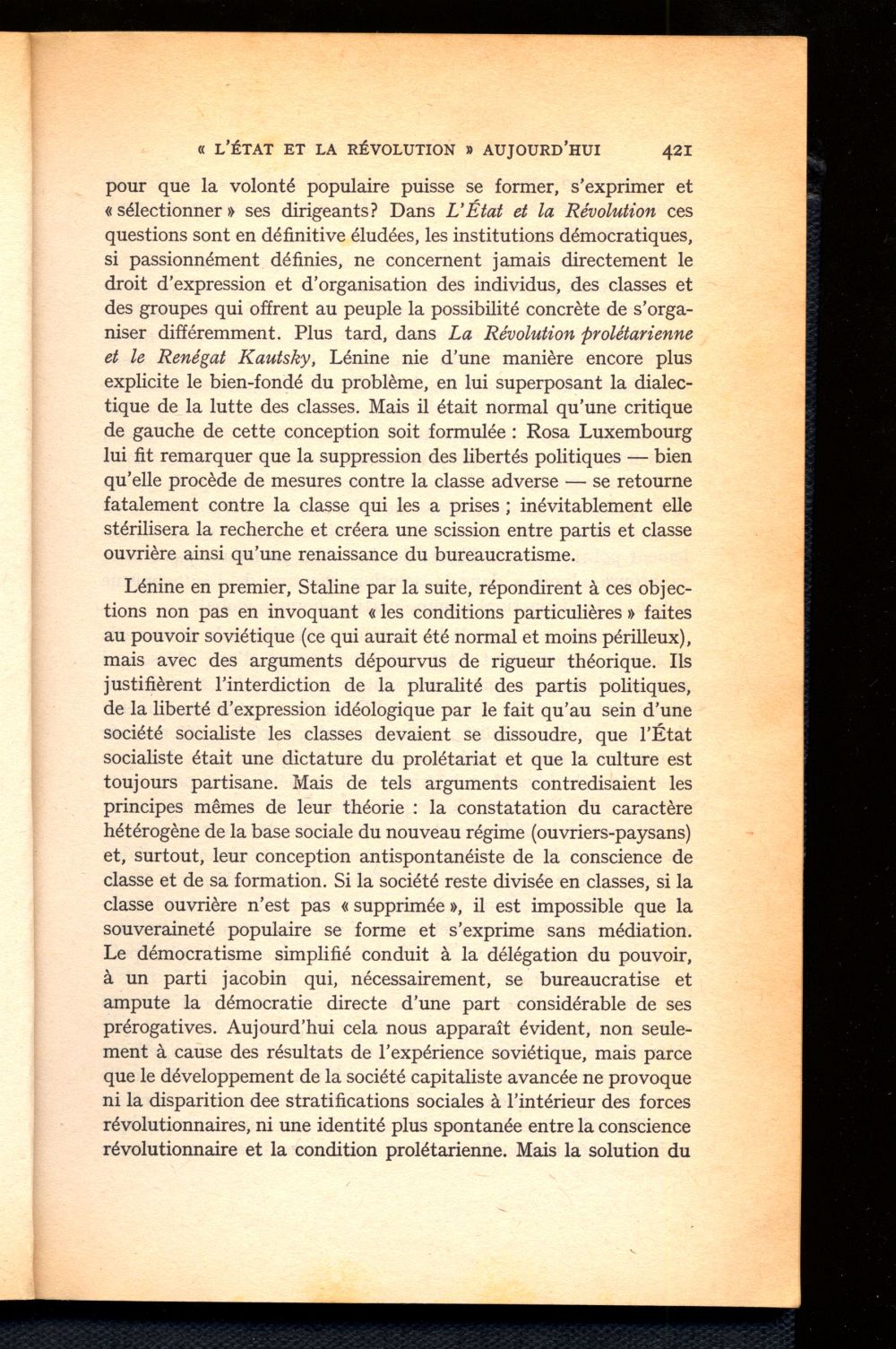

L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
421
pour que la volonté populaire puisse se former, s'exprimer et
« sélectionner » ses dirigeants? Dans L'État et la Révolution ces
questions sont en définitive éludées, les institutions démocratiques,
si passionnément définies, ne concernent jamais directement le
droit d'expression et d'organisation des individus, des classes et
des groupes qui offrent au peuple la possibilité concrète de s'orga-
niser différemment. Plus tard, dans La Révolution prolétarienne
et le Renégat Kautsky, Lénine nie d'une manière encore plus
explicite le bien-fondé du problème, en lui superposant la dialec-
tique de la lutte des classes. Mais il était normal qu'une critique
de gauche de cette conception soit formulée : Rosa Luxembourg
lui fit remarquer que la suppression des libertés politiques — bien
qu'elle procède de mesures contre la classe adverse — se retourne
fatalement contre la classe qui les a prises ; inévitablement elle
stérilisera la recherche et créera une scission entre partis et classe
ouvrière ainsi qu'une renaissance du bureaucratisme.
« sélectionner » ses dirigeants? Dans L'État et la Révolution ces
questions sont en définitive éludées, les institutions démocratiques,
si passionnément définies, ne concernent jamais directement le
droit d'expression et d'organisation des individus, des classes et
des groupes qui offrent au peuple la possibilité concrète de s'orga-
niser différemment. Plus tard, dans La Révolution prolétarienne
et le Renégat Kautsky, Lénine nie d'une manière encore plus
explicite le bien-fondé du problème, en lui superposant la dialec-
tique de la lutte des classes. Mais il était normal qu'une critique
de gauche de cette conception soit formulée : Rosa Luxembourg
lui fit remarquer que la suppression des libertés politiques — bien
qu'elle procède de mesures contre la classe adverse — se retourne
fatalement contre la classe qui les a prises ; inévitablement elle
stérilisera la recherche et créera une scission entre partis et classe
ouvrière ainsi qu'une renaissance du bureaucratisme.
Lénine en premier, Staline par la suite, répondirent à ces objec-
tions non pas en invoquant « les conditions particulières » faites
au pouvoir soviétique (ce qui aurait été normal et moins périlleux),
mais avec des arguments dépourvus de rigueur théorique. Ils
justifièrent l'interdiction de la pluralité des partis politiques,
de la liberté d'expression idéologique par le fait qu'au sein d'une
société socialiste les classes devaient se dissoudre, que l'État
socialiste était une dictature du prolétariat et que la culture est
toujours partisane. Mais de tels arguments contredisaient les
principes mêmes de leur théorie : la constatation du caractère
hétérogène de la base sociale du nouveau régime (ouvriers-paysans)
et, surtout, leur conception antispontanéiste de la conscience de
classe et de sa formation. Si la société reste divisée en classes, si la
classe ouvrière n'est pas « supprimée », il est impossible que la
souveraineté populaire se forme et s'exprime sans médiation.
Le démocratisme simplifié conduit à la délégation du pouvoir,
à un parti jacobin qui, nécessairement, se bureaucratise et
ampute la démocratie directe d'une part considérable de ses
prérogatives. Aujourd'hui cela nous apparaît évident, non seule-
ment à cause des résultats de l'expérience soviétique, mais parce
que le développement de la société capitaliste avancée ne provoque
ni la disparition dee stratifications sociales à l'intérieur des forces
révolutionnaires, ni une identité plus spontanée entre la conscience
révolutionnaire et la condition prolétarienne. Mais la solution du
tions non pas en invoquant « les conditions particulières » faites
au pouvoir soviétique (ce qui aurait été normal et moins périlleux),
mais avec des arguments dépourvus de rigueur théorique. Ils
justifièrent l'interdiction de la pluralité des partis politiques,
de la liberté d'expression idéologique par le fait qu'au sein d'une
société socialiste les classes devaient se dissoudre, que l'État
socialiste était une dictature du prolétariat et que la culture est
toujours partisane. Mais de tels arguments contredisaient les
principes mêmes de leur théorie : la constatation du caractère
hétérogène de la base sociale du nouveau régime (ouvriers-paysans)
et, surtout, leur conception antispontanéiste de la conscience de
classe et de sa formation. Si la société reste divisée en classes, si la
classe ouvrière n'est pas « supprimée », il est impossible que la
souveraineté populaire se forme et s'exprime sans médiation.
Le démocratisme simplifié conduit à la délégation du pouvoir,
à un parti jacobin qui, nécessairement, se bureaucratise et
ampute la démocratie directe d'une part considérable de ses
prérogatives. Aujourd'hui cela nous apparaît évident, non seule-
ment à cause des résultats de l'expérience soviétique, mais parce
que le développement de la société capitaliste avancée ne provoque
ni la disparition dee stratifications sociales à l'intérieur des forces
révolutionnaires, ni une identité plus spontanée entre la conscience
révolutionnaire et la condition prolétarienne. Mais la solution du
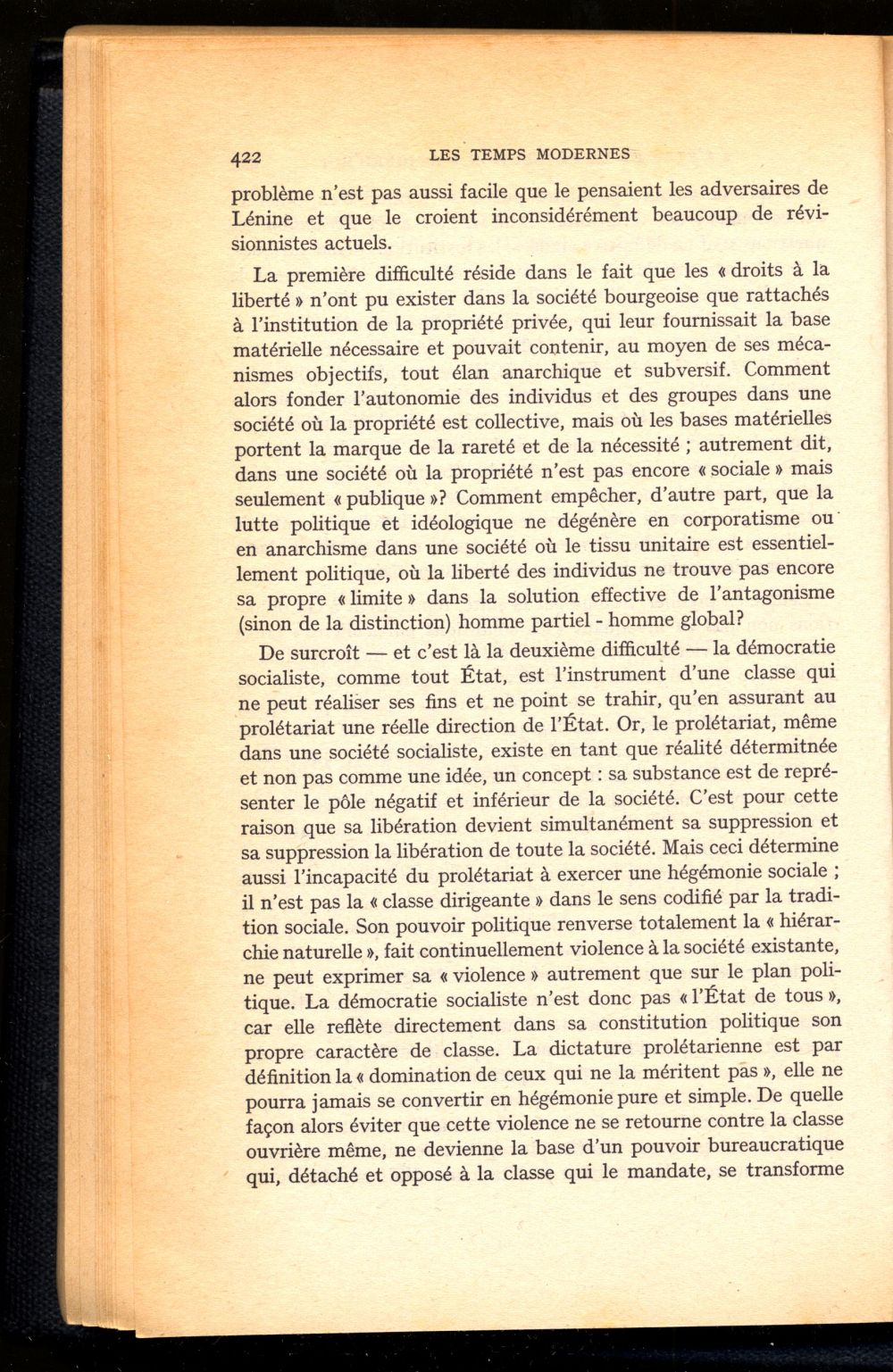

422
LES TEMPS MODERNES
problème n'est pas aussi facile que le pensaient les adversaires de
Lénine et que le croient inconsidérément beaucoup de révi-
sionnistes actuels.
Lénine et que le croient inconsidérément beaucoup de révi-
sionnistes actuels.
La première difficulté réside dans le fait que les « droits à la
liberté » n'ont pu exister dans la société bourgeoise que rattachés
à l'institution de la propriété privée, qui leur fournissait la base
matérielle nécessaire et pouvait contenir, au moyen de ses méca-
nismes objectifs, tout élan anarchique et subversif. Comment
alors fonder l'autonomie des individus et des groupes dans une
société où la propriété est collective, mais où les bases matérielles
portent la marque de la rareté et de la nécessité ; autrement dit,
dans une société où la propriété n'est pas encore « sociale » mais
seulement « publique »? Comment empêcher, d'autre part, que la
lutte politique et idéologique ne dégénère en corporatisme ou
en anarchisme dans une société où le tissu unitaire est essentiel-
lement politique, où la liberté des individus ne trouve pas encore
sa propre « limite » dans la solution effective de l'antagonisme
(sinon de la distinction) homme partiel - homme global?
liberté » n'ont pu exister dans la société bourgeoise que rattachés
à l'institution de la propriété privée, qui leur fournissait la base
matérielle nécessaire et pouvait contenir, au moyen de ses méca-
nismes objectifs, tout élan anarchique et subversif. Comment
alors fonder l'autonomie des individus et des groupes dans une
société où la propriété est collective, mais où les bases matérielles
portent la marque de la rareté et de la nécessité ; autrement dit,
dans une société où la propriété n'est pas encore « sociale » mais
seulement « publique »? Comment empêcher, d'autre part, que la
lutte politique et idéologique ne dégénère en corporatisme ou
en anarchisme dans une société où le tissu unitaire est essentiel-
lement politique, où la liberté des individus ne trouve pas encore
sa propre « limite » dans la solution effective de l'antagonisme
(sinon de la distinction) homme partiel - homme global?
De surcroît — et c'est là la deuxième difficulté — la démocratie
socialiste, comme tout État, est l'instrument d'une classe qui
ne peut réaliser ses fins et ne point se trahir, qu'en assurant au
prolétariat une réelle direction de l'État. Or, le prolétariat, même
dans une société socialiste, existe en tant que réalité détermitnée
et non pas comme une idée, un concept : sa substance est de repré-
senter le pôle négatif et inférieur de la société. C'est pour cette
raison que sa libération devient simultanément sa suppression et
sa suppression la libération de toute la société. Mais ceci détermine
aussi l'incapacité du prolétariat à exercer une hégémonie sociale ;
il n'est pas la « classe dirigeante » dans le sens codifié par la tradi-
tion sociale. Son pouvoir politique renverse totalement la « hiérar-
chie naturelle », fait continuellement violence à la société existante,
ne peut exprimer sa « violence » autrement que sur le plan poli-
tique. La démocratie socialiste n'est donc pas « l'État de tous »,
car elle reflète directement dans sa constitution politique son
propre caractère de classe. La dictature prolétarienne est par
définition la « domination de ceux qui ne la méritent pas », elle ne
pourra jamais se convertir en hégémonie pure et simple. De quelle
façon alors éviter que cette violence ne se retourne contre la classe
ouvrière même, ne devienne la base d'un pouvoir bureaucratique
qui, détaché et opposé à la classe qui le mandate, se transforme
socialiste, comme tout État, est l'instrument d'une classe qui
ne peut réaliser ses fins et ne point se trahir, qu'en assurant au
prolétariat une réelle direction de l'État. Or, le prolétariat, même
dans une société socialiste, existe en tant que réalité détermitnée
et non pas comme une idée, un concept : sa substance est de repré-
senter le pôle négatif et inférieur de la société. C'est pour cette
raison que sa libération devient simultanément sa suppression et
sa suppression la libération de toute la société. Mais ceci détermine
aussi l'incapacité du prolétariat à exercer une hégémonie sociale ;
il n'est pas la « classe dirigeante » dans le sens codifié par la tradi-
tion sociale. Son pouvoir politique renverse totalement la « hiérar-
chie naturelle », fait continuellement violence à la société existante,
ne peut exprimer sa « violence » autrement que sur le plan poli-
tique. La démocratie socialiste n'est donc pas « l'État de tous »,
car elle reflète directement dans sa constitution politique son
propre caractère de classe. La dictature prolétarienne est par
définition la « domination de ceux qui ne la méritent pas », elle ne
pourra jamais se convertir en hégémonie pure et simple. De quelle
façon alors éviter que cette violence ne se retourne contre la classe
ouvrière même, ne devienne la base d'un pouvoir bureaucratique
qui, détaché et opposé à la classe qui le mandate, se transforme
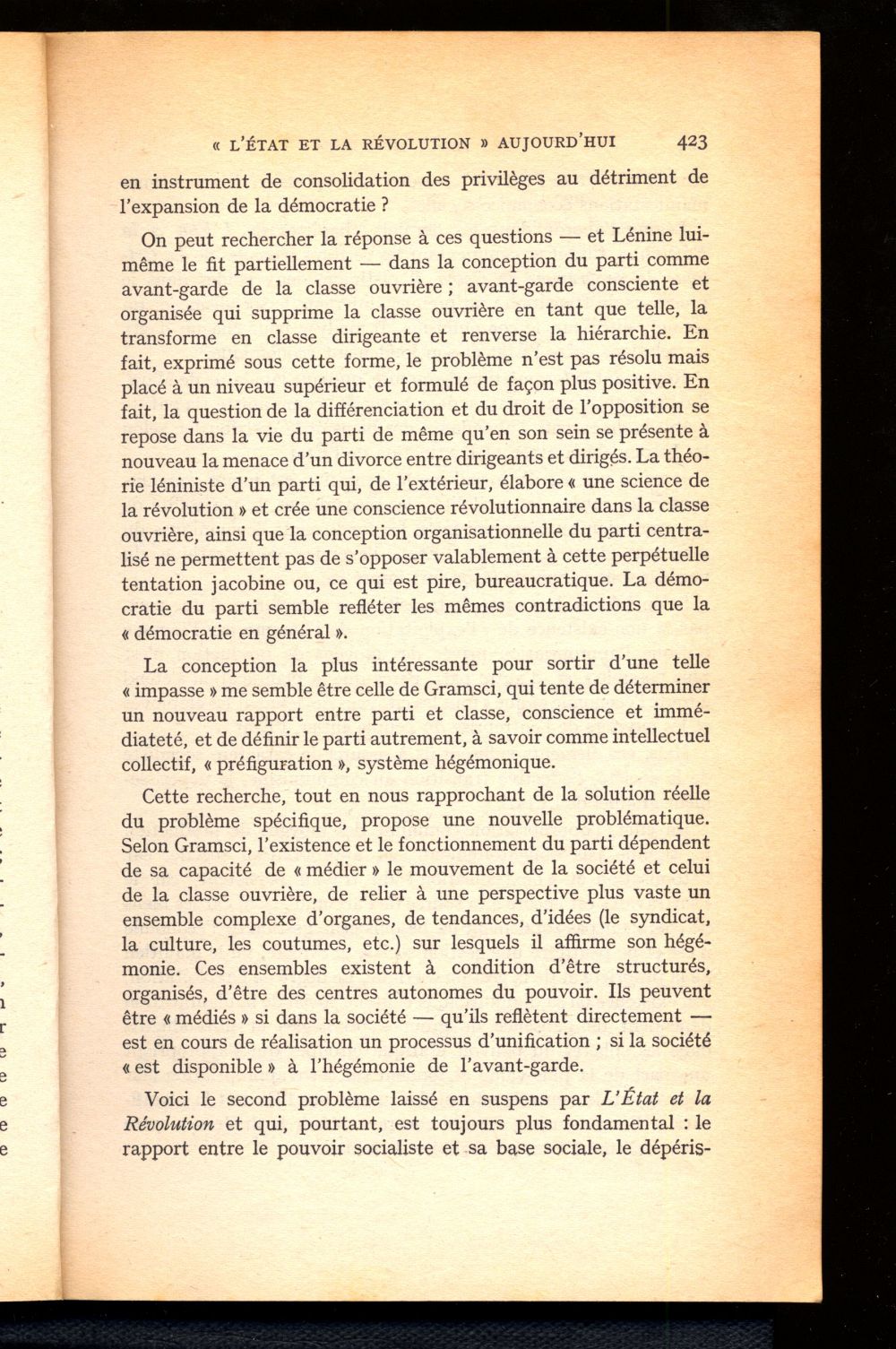

« L ETAT ET LA REVOLUTION » AUJOURD HUI
423
en instrument de consolidation des privilèges au détriment de
l'expansion de la démocratie ?
l'expansion de la démocratie ?
On peut rechercher la réponse à ces questions — et Lénine lui-
même le fit partiellement — dans la conception du parti comme
avant-garde de la classe ouvrière ; avant-garde consciente et
organisée qui supprime la classe ouvrière en tant que telle, la
transforme en classe dirigeante et renverse la hiérarchie. En
fait, exprimé sous cette forme, le problème n'est pas résolu mais
placé à un niveau supérieur et formulé de façon plus positive. En
fait, la question de la différenciation et du droit de l'opposition se
repose dans la vie du parti de même qu'en son sein se présente à
nouveau la menace d'un divorce entre dirigeants et dirigés. La théo-
rie léniniste d'un parti qui, de l'extérieur, élabore « une science de
la révolution » et crée une conscience révolutionnaire dans la classe
ouvrière, ainsi que la conception organisationnelle du parti centra-
lisé ne permettent pas de s'opposer valablement à cette perpétuelle
tentation jacobine ou, ce qui est pire, bureaucratique. La démo-
cratie du parti semble refléter les mêmes contradictions que la
« démocratie en général ».
même le fit partiellement — dans la conception du parti comme
avant-garde de la classe ouvrière ; avant-garde consciente et
organisée qui supprime la classe ouvrière en tant que telle, la
transforme en classe dirigeante et renverse la hiérarchie. En
fait, exprimé sous cette forme, le problème n'est pas résolu mais
placé à un niveau supérieur et formulé de façon plus positive. En
fait, la question de la différenciation et du droit de l'opposition se
repose dans la vie du parti de même qu'en son sein se présente à
nouveau la menace d'un divorce entre dirigeants et dirigés. La théo-
rie léniniste d'un parti qui, de l'extérieur, élabore « une science de
la révolution » et crée une conscience révolutionnaire dans la classe
ouvrière, ainsi que la conception organisationnelle du parti centra-
lisé ne permettent pas de s'opposer valablement à cette perpétuelle
tentation jacobine ou, ce qui est pire, bureaucratique. La démo-
cratie du parti semble refléter les mêmes contradictions que la
« démocratie en général ».
La conception la plus intéressante pour sortir d'une telle
« impasse » me semble être celle de Gramsci, qui tente de déterminer
un nouveau rapport entre parti et classe, conscience et immé-
diateté, et de définir le parti autrement, à savoir comme intellectuel
collectif, « préfiguration », système hégémonique.
« impasse » me semble être celle de Gramsci, qui tente de déterminer
un nouveau rapport entre parti et classe, conscience et immé-
diateté, et de définir le parti autrement, à savoir comme intellectuel
collectif, « préfiguration », système hégémonique.
Cette recherche, tout en nous rapprochant de la solution réelle
du problème spécifique, propose une nouvelle problématique.
Selon Gramsci, l'existence et le fonctionnement du parti dépendent
de sa capacité de « médier » le mouvement de la société et celui
de la classe ouvrière, de relier à une perspective plus vaste un
ensemble complexe d'organes, de tendances, d'idées (le syndicat,
la culture, les coutumes, etc.) sur lesquels il affirme son hégé-
monie. Ces ensembles existent à condition d'être structurés,
organisés, d'être des centres autonomes du pouvoir. Ils peuvent
être « médiés » si dans la société — qu'ils reflètent directement —
est en cours de réalisation un processus d'unification ; si la société
« est disponible » à l'hégémonie de l'avant-garde.
du problème spécifique, propose une nouvelle problématique.
Selon Gramsci, l'existence et le fonctionnement du parti dépendent
de sa capacité de « médier » le mouvement de la société et celui
de la classe ouvrière, de relier à une perspective plus vaste un
ensemble complexe d'organes, de tendances, d'idées (le syndicat,
la culture, les coutumes, etc.) sur lesquels il affirme son hégé-
monie. Ces ensembles existent à condition d'être structurés,
organisés, d'être des centres autonomes du pouvoir. Ils peuvent
être « médiés » si dans la société — qu'ils reflètent directement —
est en cours de réalisation un processus d'unification ; si la société
« est disponible » à l'hégémonie de l'avant-garde.
Voici le second problème laissé en suspens par L'État et la
Révolution et qui, pourtant, est toujours plus fondamental : le
rapport entre le pouvoir socialiste et sa base sociale, le dépéris-
Révolution et qui, pourtant, est toujours plus fondamental : le
rapport entre le pouvoir socialiste et sa base sociale, le dépéris-
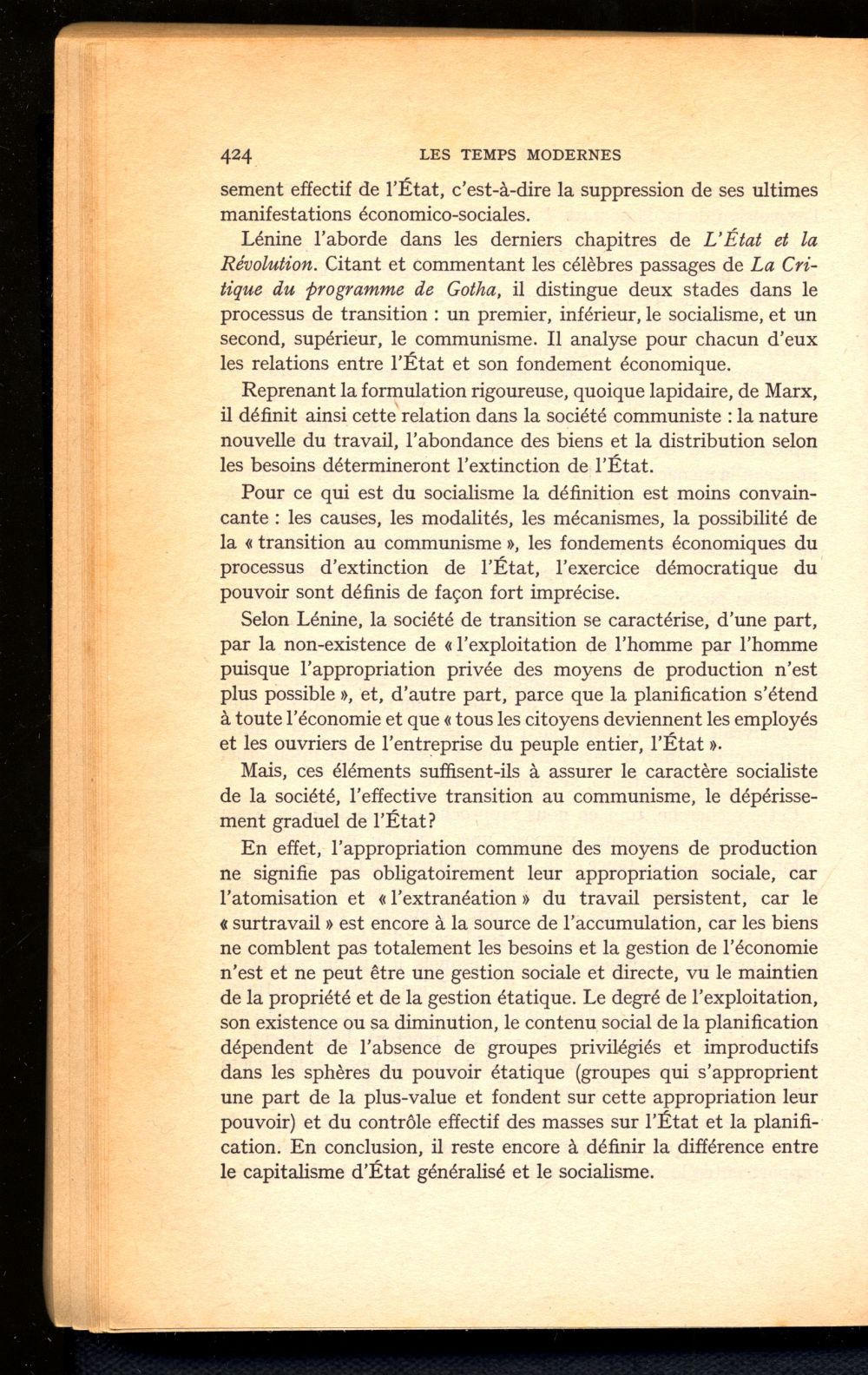

424 LES TEMPS MODERNES
sèment effectif de l'État, c'est-à-dire la suppression de ses ultimes
manifestations économico-sociales.
manifestations économico-sociales.
Lénine l'aborde dans les derniers chapitres de L'État et la
Révolution. Citant et commentant les célèbres passages de La Cri-
tique du programme de Gotha, il distingue deux stades dans le
processus de transition : un premier, inférieur, le socialisme, et un
second, supérieur, le communisme. Il analyse pour chacun d'eux
les relations entre l'État et son fondement économique.
Révolution. Citant et commentant les célèbres passages de La Cri-
tique du programme de Gotha, il distingue deux stades dans le
processus de transition : un premier, inférieur, le socialisme, et un
second, supérieur, le communisme. Il analyse pour chacun d'eux
les relations entre l'État et son fondement économique.
Reprenant la formulation rigoureuse, quoique lapidaire, de Marx,
il définit ainsi cette relation dans la société communiste : la nature
nouvelle du travail, l'abondance des biens et la distribution selon
les besoins détermineront l'extinction de l'État.
il définit ainsi cette relation dans la société communiste : la nature
nouvelle du travail, l'abondance des biens et la distribution selon
les besoins détermineront l'extinction de l'État.
Pour ce qui est du socialisme la définition est moins convain-
cante : les causes, les modalités, les mécanismes, la possibilité de
la « transition au communisme », les fondements économiques du
processus d'extinction de l'État, l'exercice démocratique du
pouvoir sont définis de façon fort imprécise.
cante : les causes, les modalités, les mécanismes, la possibilité de
la « transition au communisme », les fondements économiques du
processus d'extinction de l'État, l'exercice démocratique du
pouvoir sont définis de façon fort imprécise.
Selon Lénine, la société de transition se caractérise, d'une part,
par la non-existence de « l'exploitation de l'homme par l'homme
puisque l'appropriation privée des moyens de production n'est
plus possible », et, d'autre part, parce que la planification s'étend
à toute l'économie et que « tous les citoyens deviennent les employés
et les ouvriers de l'entreprise du peuple entier, l'État ».
par la non-existence de « l'exploitation de l'homme par l'homme
puisque l'appropriation privée des moyens de production n'est
plus possible », et, d'autre part, parce que la planification s'étend
à toute l'économie et que « tous les citoyens deviennent les employés
et les ouvriers de l'entreprise du peuple entier, l'État ».
Mais, ces éléments suffisent-ils à assurer le caractère socialiste
de la société, l'effective transition au communisme, le dépérisse-
ment graduel de l'État?
de la société, l'effective transition au communisme, le dépérisse-
ment graduel de l'État?
En effet, l'appropriation commune des moyens de production
ne signifie pas obligatoirement leur appropriation sociale, car
l'atomisation et « l'extranéation » du travail persistent, car le
« surtravail » est encore à la source de l'accumulation, car les biens
ne comblent pas totalement les besoins et la gestion de l'économie
n'est et ne peut être une gestion sociale et directe, vu le maintien
de la propriété et de la gestion étatique. Le degré de l'exploitation,
son existence ou sa diminution, le contenu social de la planification
dépendent de l'absence de groupes privilégiés et improductifs
dans les sphères du pouvoir étatique (groupes qui s'approprient
une part de la plus-value et fondent sur cette appropriation leur
pouvoir) et du contrôle effectif des masses sur l'État et la planifi-
cation. En conclusion, il reste encore à définir la différence entre
le capitalisme d'État généralisé et le socialisme.
ne signifie pas obligatoirement leur appropriation sociale, car
l'atomisation et « l'extranéation » du travail persistent, car le
« surtravail » est encore à la source de l'accumulation, car les biens
ne comblent pas totalement les besoins et la gestion de l'économie
n'est et ne peut être une gestion sociale et directe, vu le maintien
de la propriété et de la gestion étatique. Le degré de l'exploitation,
son existence ou sa diminution, le contenu social de la planification
dépendent de l'absence de groupes privilégiés et improductifs
dans les sphères du pouvoir étatique (groupes qui s'approprient
une part de la plus-value et fondent sur cette appropriation leur
pouvoir) et du contrôle effectif des masses sur l'État et la planifi-
cation. En conclusion, il reste encore à définir la différence entre
le capitalisme d'État généralisé et le socialisme.
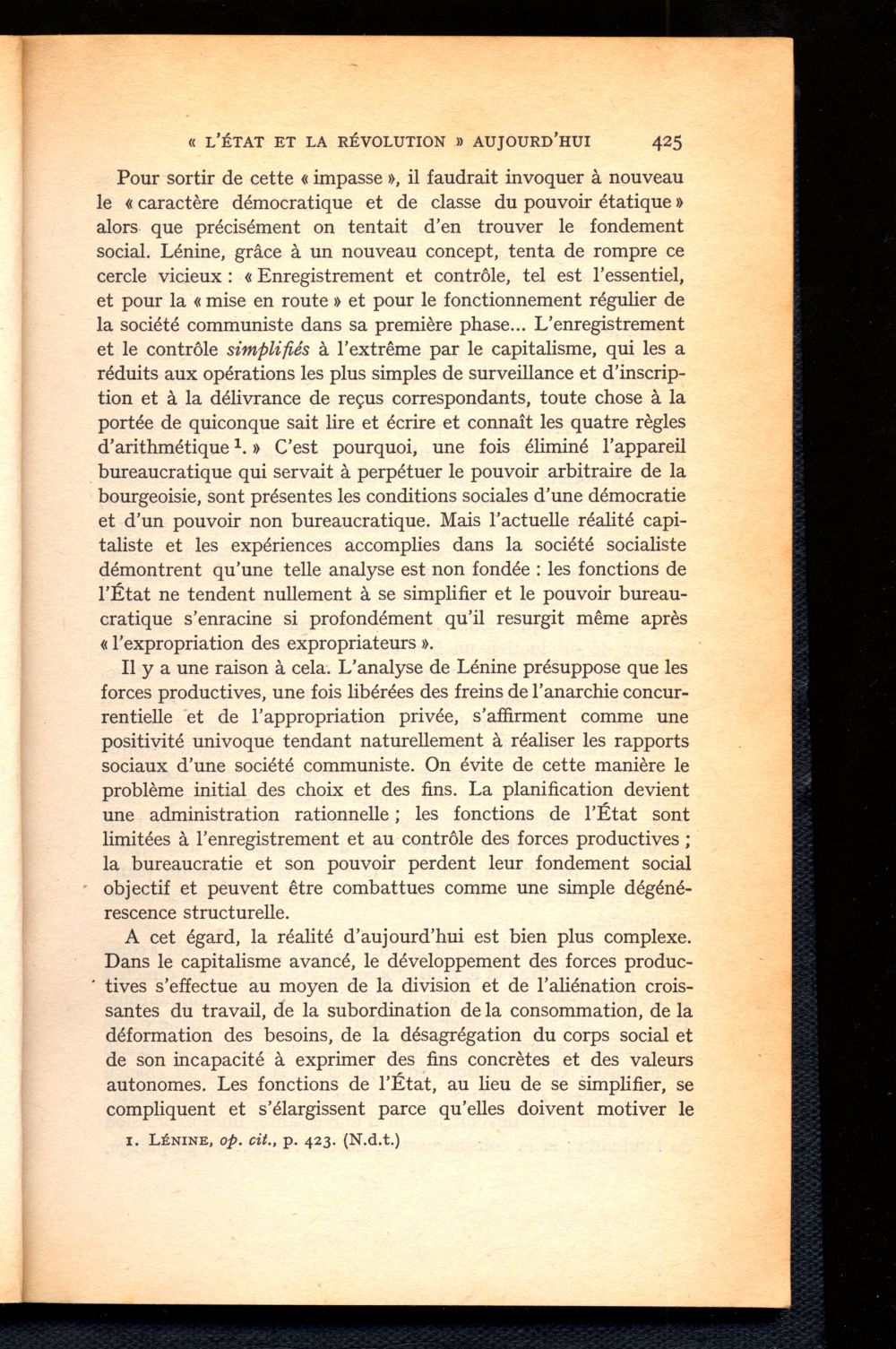

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
425
Pour sortir de cette « impasse », il faudrait invoquer à nouveau
le « caractère démocratique et de classe du pouvoir étatique »
alors que précisément on tentait d'en trouver le fondement
social. Lénine, grâce à un nouveau concept, tenta de rompre ce
cercle vicieux : « Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel,
et pour la « mise en route » et pour le fonctionnement régulier de
la société communiste dans sa première phase... L'enregistrement
et le contrôle simplifiés à l'extrême par le capitalisme, qui les a
réduits aux opérations les plus simples de surveillance et d'inscrip-
tion et à la délivrance de reçus correspondants, toute chose à la
portée de quiconque sait lire et écrire et connaît les quatre règles
d'arithmétique1. » C'est pourquoi, une fois éliminé l'appareil
bureaucratique qui servait à perpétuer le pouvoir arbitraire de la
bourgeoisie, sont présentes les conditions sociales d'une démocratie
et d'un pouvoir non bureaucratique. Mais l'actuelle réalité capi-
taliste et les expériences accomplies dans la société socialiste
démontrent qu'une telle analyse est non fondée : les fonctions de
l'État ne tendent nullement à se simplifier et le pouvoir bureau-
cratique s'enracine si profondément qu'il resurgit même après
« l'expropriation des expropriateurs ».
le « caractère démocratique et de classe du pouvoir étatique »
alors que précisément on tentait d'en trouver le fondement
social. Lénine, grâce à un nouveau concept, tenta de rompre ce
cercle vicieux : « Enregistrement et contrôle, tel est l'essentiel,
et pour la « mise en route » et pour le fonctionnement régulier de
la société communiste dans sa première phase... L'enregistrement
et le contrôle simplifiés à l'extrême par le capitalisme, qui les a
réduits aux opérations les plus simples de surveillance et d'inscrip-
tion et à la délivrance de reçus correspondants, toute chose à la
portée de quiconque sait lire et écrire et connaît les quatre règles
d'arithmétique1. » C'est pourquoi, une fois éliminé l'appareil
bureaucratique qui servait à perpétuer le pouvoir arbitraire de la
bourgeoisie, sont présentes les conditions sociales d'une démocratie
et d'un pouvoir non bureaucratique. Mais l'actuelle réalité capi-
taliste et les expériences accomplies dans la société socialiste
démontrent qu'une telle analyse est non fondée : les fonctions de
l'État ne tendent nullement à se simplifier et le pouvoir bureau-
cratique s'enracine si profondément qu'il resurgit même après
« l'expropriation des expropriateurs ».
Il y a une raison à cela. L'analyse de Lénine présuppose que les
forces productives, une fois libérées des freins de l'anarchie concur-
rentielle et de l'appropriation privée, s'affirment comme une
positivité univoque tendant naturellement à réaliser les rapports
sociaux d'une société communiste. On évite de cette manière le
problème initial des choix et des fins. La planification devient
une administration rationnelle ; les fonctions de l'État sont
limitées à l'enregistrement et au contrôle des forces productives ;
la bureaucratie et son pouvoir perdent leur fondement social
objectif et peuvent être combattues comme une simple dégéné-
rescence structurelle.
forces productives, une fois libérées des freins de l'anarchie concur-
rentielle et de l'appropriation privée, s'affirment comme une
positivité univoque tendant naturellement à réaliser les rapports
sociaux d'une société communiste. On évite de cette manière le
problème initial des choix et des fins. La planification devient
une administration rationnelle ; les fonctions de l'État sont
limitées à l'enregistrement et au contrôle des forces productives ;
la bureaucratie et son pouvoir perdent leur fondement social
objectif et peuvent être combattues comme une simple dégéné-
rescence structurelle.
A cet égard, la réalité d'aujourd'hui est bien plus complexe.
Dans le capitalisme avancé, le développement des forces produc-
' tives s'effectue au moyen de la division et de l'aliénation crois-
santes du travail, de la subordination de la consommation, de la
déformation des besoins, de la désagrégation du corps social et
de son incapacité à exprimer des fins concrètes et des valeurs
autonomes. Les fonctions de l'État, au lieu de se simplifier, se
compliquent et s'élargissent parce qu'elles doivent motiver le
Dans le capitalisme avancé, le développement des forces produc-
' tives s'effectue au moyen de la division et de l'aliénation crois-
santes du travail, de la subordination de la consommation, de la
déformation des besoins, de la désagrégation du corps social et
de son incapacité à exprimer des fins concrètes et des valeurs
autonomes. Les fonctions de l'État, au lieu de se simplifier, se
compliquent et s'élargissent parce qu'elles doivent motiver le
i. LÉNINE, op. cit., p. 423. (N.d.t.)
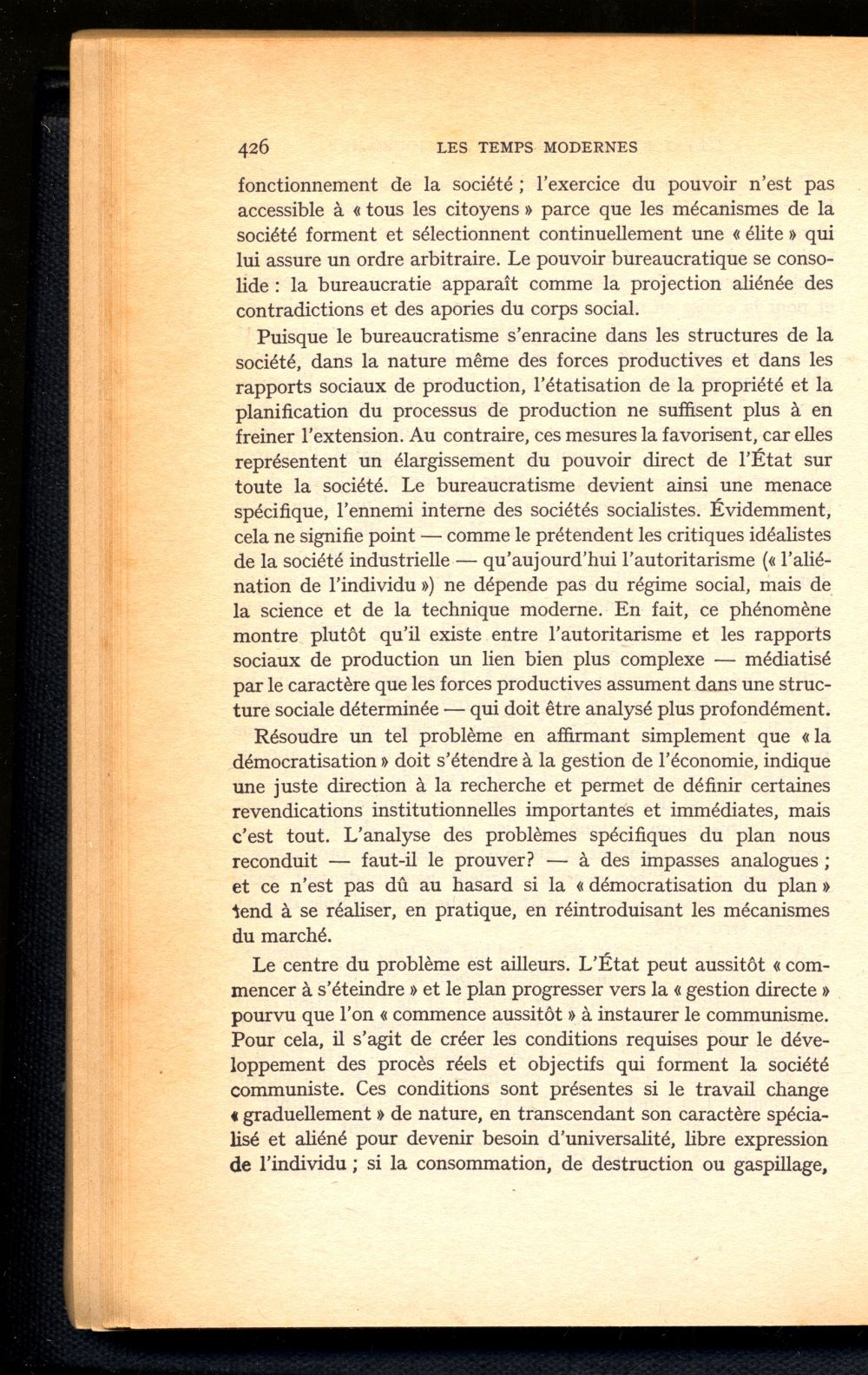

426
LES TEMPS MODERNES
fonctionnement de la société ; l'exercice du pouvoir n'est pas
accessible à « tous les citoyens » parce que les mécanismes de la
société forment et sélectionnent continuellement une « élite » qui
lui assure un ordre arbitraire. Le pouvoir bureaucratique se conso-
lide : la bureaucratie apparaît comme la projection aliénée des
contradictions et des apories du corps social.
accessible à « tous les citoyens » parce que les mécanismes de la
société forment et sélectionnent continuellement une « élite » qui
lui assure un ordre arbitraire. Le pouvoir bureaucratique se conso-
lide : la bureaucratie apparaît comme la projection aliénée des
contradictions et des apories du corps social.
Puisque le bureaucratisme s'enracine dans les structures de la
société, dans la nature même des forces productives et dans les
rapports sociaux de production, l'étatisation de la propriété et la
planification du processus de production ne suffisent plus à en
freiner l'extension. Au contraire, ces mesures la favorisent, car elles
représentent un élargissement du pouvoir direct de l'État sur
toute la société. Le bureaucratisme devient ainsi une menace
spécifique, l'ennemi interne des sociétés socialistes. Évidemment,
cela ne signifie point — comme le prétendent les critiques idéalistes
de la société industrielle — qu'aujourd'hui l'autoritarisme (« l'alié-
nation de l'individu ») ne dépende pas du régime social, mais de
la science et de la technique moderne. En fait, ce phénomène
montre plutôt qu'il existe entre l'autoritarisme et les rapports
sociaux de production un lien bien plus complexe — médiatisé
par le caractère que les forces productives assument dans une struc-
ture sociale déterminée — qui doit être analysé plus profondément.
société, dans la nature même des forces productives et dans les
rapports sociaux de production, l'étatisation de la propriété et la
planification du processus de production ne suffisent plus à en
freiner l'extension. Au contraire, ces mesures la favorisent, car elles
représentent un élargissement du pouvoir direct de l'État sur
toute la société. Le bureaucratisme devient ainsi une menace
spécifique, l'ennemi interne des sociétés socialistes. Évidemment,
cela ne signifie point — comme le prétendent les critiques idéalistes
de la société industrielle — qu'aujourd'hui l'autoritarisme (« l'alié-
nation de l'individu ») ne dépende pas du régime social, mais de
la science et de la technique moderne. En fait, ce phénomène
montre plutôt qu'il existe entre l'autoritarisme et les rapports
sociaux de production un lien bien plus complexe — médiatisé
par le caractère que les forces productives assument dans une struc-
ture sociale déterminée — qui doit être analysé plus profondément.
Résoudre un tel problème en affirmant simplement que « la
démocratisation » doit s'étendre à la gestion de l'économie, indique
une juste direction à la recherche et permet de définir certaines
revendications institutionnelles importantes et immédiates, mais
c'est tout. L'analyse des problèmes spécifiques du plan nous
reconduit — faut-il le prouver? — à des impasses analogues ;
et ce n'est pas dû au hasard si la « démocratisation du plan »
•tend à se réaliser, en pratique, en réintroduisant les mécanismes
du marché.
démocratisation » doit s'étendre à la gestion de l'économie, indique
une juste direction à la recherche et permet de définir certaines
revendications institutionnelles importantes et immédiates, mais
c'est tout. L'analyse des problèmes spécifiques du plan nous
reconduit — faut-il le prouver? — à des impasses analogues ;
et ce n'est pas dû au hasard si la « démocratisation du plan »
•tend à se réaliser, en pratique, en réintroduisant les mécanismes
du marché.
Le centre du problème est ailleurs. L'État peut aussitôt « com-
mencer à s'éteindre » et le plan progresser vers la « gestion directe »
pourvu que l'on « commence aussitôt » à instaurer le communisme.
Pour cela, il s'agit de créer les conditions requises pour le déve-
loppement des procès réels et objectifs qui forment la société
communiste. Ces conditions sont présentes si le travail change
« graduellement » de nature, en transcendant son caractère spécia-
lisé et aliéné pour devenir besoin d'universalité, libre expression
de l'individu ; si la consommation, de destruction ou gaspillage,
mencer à s'éteindre » et le plan progresser vers la « gestion directe »
pourvu que l'on « commence aussitôt » à instaurer le communisme.
Pour cela, il s'agit de créer les conditions requises pour le déve-
loppement des procès réels et objectifs qui forment la société
communiste. Ces conditions sont présentes si le travail change
« graduellement » de nature, en transcendant son caractère spécia-
lisé et aliéné pour devenir besoin d'universalité, libre expression
de l'individu ; si la consommation, de destruction ou gaspillage,
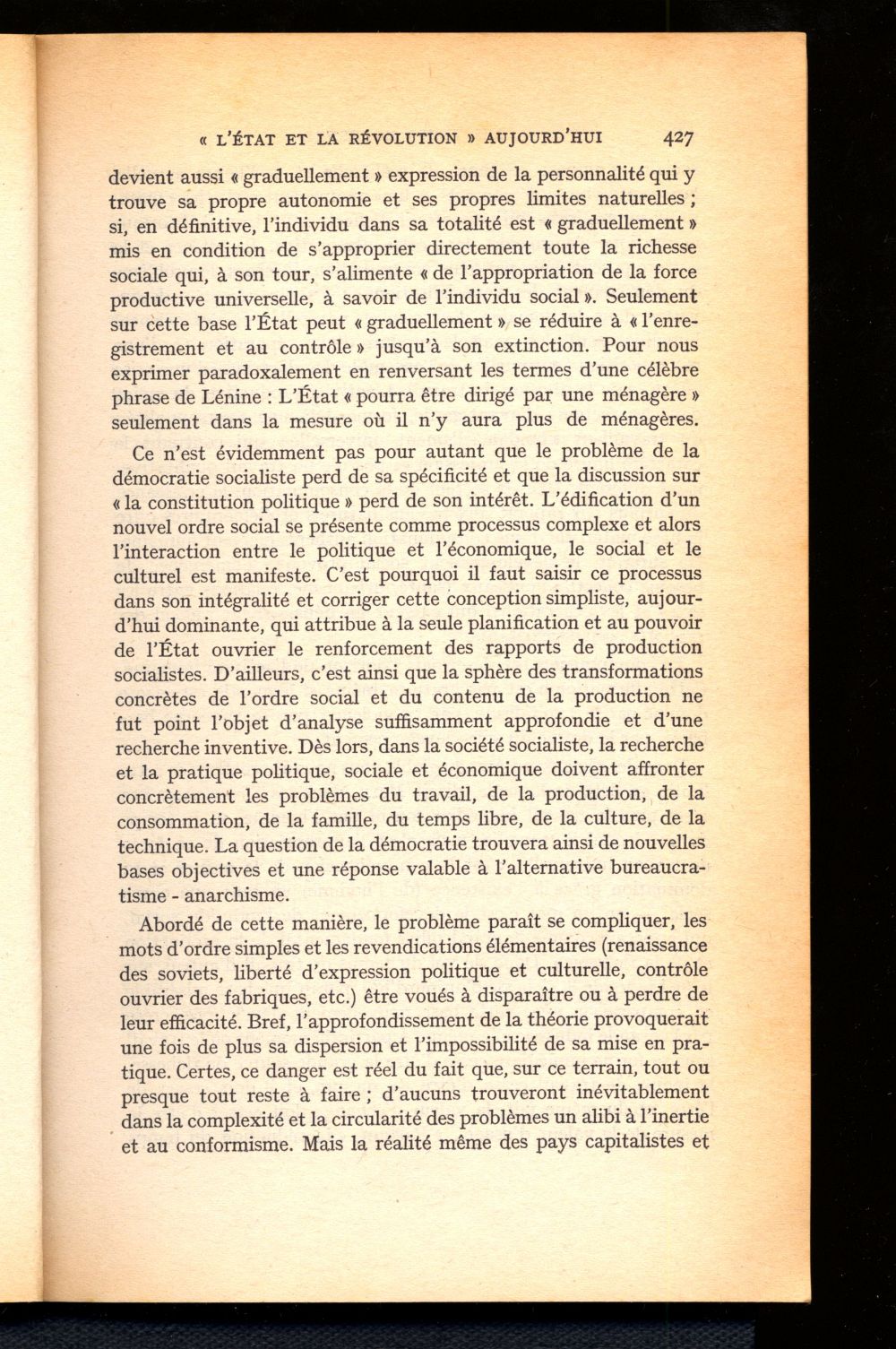

L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
427
devient aussi « graduellement » expression de la personnalité qui y
trouve sa propre autonomie et ses propres limites naturelles ;
si, en définitive, l'individu dans sa totalité est « graduellement »
mis en condition de s'approprier directement toute la richesse
sociale qui, à son tour, s'alimente « de l'appropriation de la force
productive universelle, à savoir de l'individu social ». Seulement
sur cette base l'État peut « graduellement » se réduire à « l'enre-
gistrement et au contrôle » jusqu'à son extinction. Pour nous
exprimer paradoxalement en renversant les termes d'une célèbre
phrase de Lénine : L'État « pourra être dirigé par une ménagère »
seulement dans la mesure où il n'y aura plus de ménagères.
trouve sa propre autonomie et ses propres limites naturelles ;
si, en définitive, l'individu dans sa totalité est « graduellement »
mis en condition de s'approprier directement toute la richesse
sociale qui, à son tour, s'alimente « de l'appropriation de la force
productive universelle, à savoir de l'individu social ». Seulement
sur cette base l'État peut « graduellement » se réduire à « l'enre-
gistrement et au contrôle » jusqu'à son extinction. Pour nous
exprimer paradoxalement en renversant les termes d'une célèbre
phrase de Lénine : L'État « pourra être dirigé par une ménagère »
seulement dans la mesure où il n'y aura plus de ménagères.
Ce n'est évidemment pas pour autant que le problème de la
démocratie socialiste perd de sa spécificité et que la discussion sur
« la constitution politique » perd de son intérêt. L'édification d'un
nouvel ordre social se présente comme processus complexe et alors
l'interaction entre le politique et l'économique, le social et le
culturel est manifeste. C'est pourquoi il faut saisir ce processus
dans son intégralité et corriger cette conception simpliste, aujour-
d'hui dominante, qui attribue à la seule planification et au pouvoir
de l'État ouvrier le renforcement des rapports de production
socialistes. D'ailleurs, c'est ainsi que la sphère des transformations
concrètes de l'ordre social et du contenu de la production ne
fut point l'objet d'analyse suffisamment approfondie et d'une
recherche inventive. Dès lors, dans la société socialiste, la recherche
et la pratique politique, sociale et économique doivent affronter
concrètement les problèmes du travail, de la production, de la
consommation, de la famille, du temps libre, de la culture, de la
technique. La question de la démocratie trouvera ainsi de nouvelles
bases objectives et une réponse valable à l'alternative bureaucra-
tisme - anarchisme.
démocratie socialiste perd de sa spécificité et que la discussion sur
« la constitution politique » perd de son intérêt. L'édification d'un
nouvel ordre social se présente comme processus complexe et alors
l'interaction entre le politique et l'économique, le social et le
culturel est manifeste. C'est pourquoi il faut saisir ce processus
dans son intégralité et corriger cette conception simpliste, aujour-
d'hui dominante, qui attribue à la seule planification et au pouvoir
de l'État ouvrier le renforcement des rapports de production
socialistes. D'ailleurs, c'est ainsi que la sphère des transformations
concrètes de l'ordre social et du contenu de la production ne
fut point l'objet d'analyse suffisamment approfondie et d'une
recherche inventive. Dès lors, dans la société socialiste, la recherche
et la pratique politique, sociale et économique doivent affronter
concrètement les problèmes du travail, de la production, de la
consommation, de la famille, du temps libre, de la culture, de la
technique. La question de la démocratie trouvera ainsi de nouvelles
bases objectives et une réponse valable à l'alternative bureaucra-
tisme - anarchisme.
Abordé de cette manière, le problème paraît se compliquer, les
mots d'ordre simples et les revendications élémentaires (renaissance
des soviets, liberté d'expression politique et culturelle, contrôle
ouvrier des fabriques, etc.) être voués à disparaître ou à perdre de
leur efficacité. Bref, l'approfondissement de la théorie provoquerait
une fois de plus sa dispersion et l'impossibilité de sa mise en pra-
tique. Certes, ce danger est réel du fait que, sur ce terrain, tout ou
presque tout reste à faire ; d'aucuns trouveront inévitablement
dans la complexité et la circularité des problèmes un alibi à l'inertie
et au conformisme. Mais la réalité même des pays capitalistes et
mots d'ordre simples et les revendications élémentaires (renaissance
des soviets, liberté d'expression politique et culturelle, contrôle
ouvrier des fabriques, etc.) être voués à disparaître ou à perdre de
leur efficacité. Bref, l'approfondissement de la théorie provoquerait
une fois de plus sa dispersion et l'impossibilité de sa mise en pra-
tique. Certes, ce danger est réel du fait que, sur ce terrain, tout ou
presque tout reste à faire ; d'aucuns trouveront inévitablement
dans la complexité et la circularité des problèmes un alibi à l'inertie
et au conformisme. Mais la réalité même des pays capitalistes et
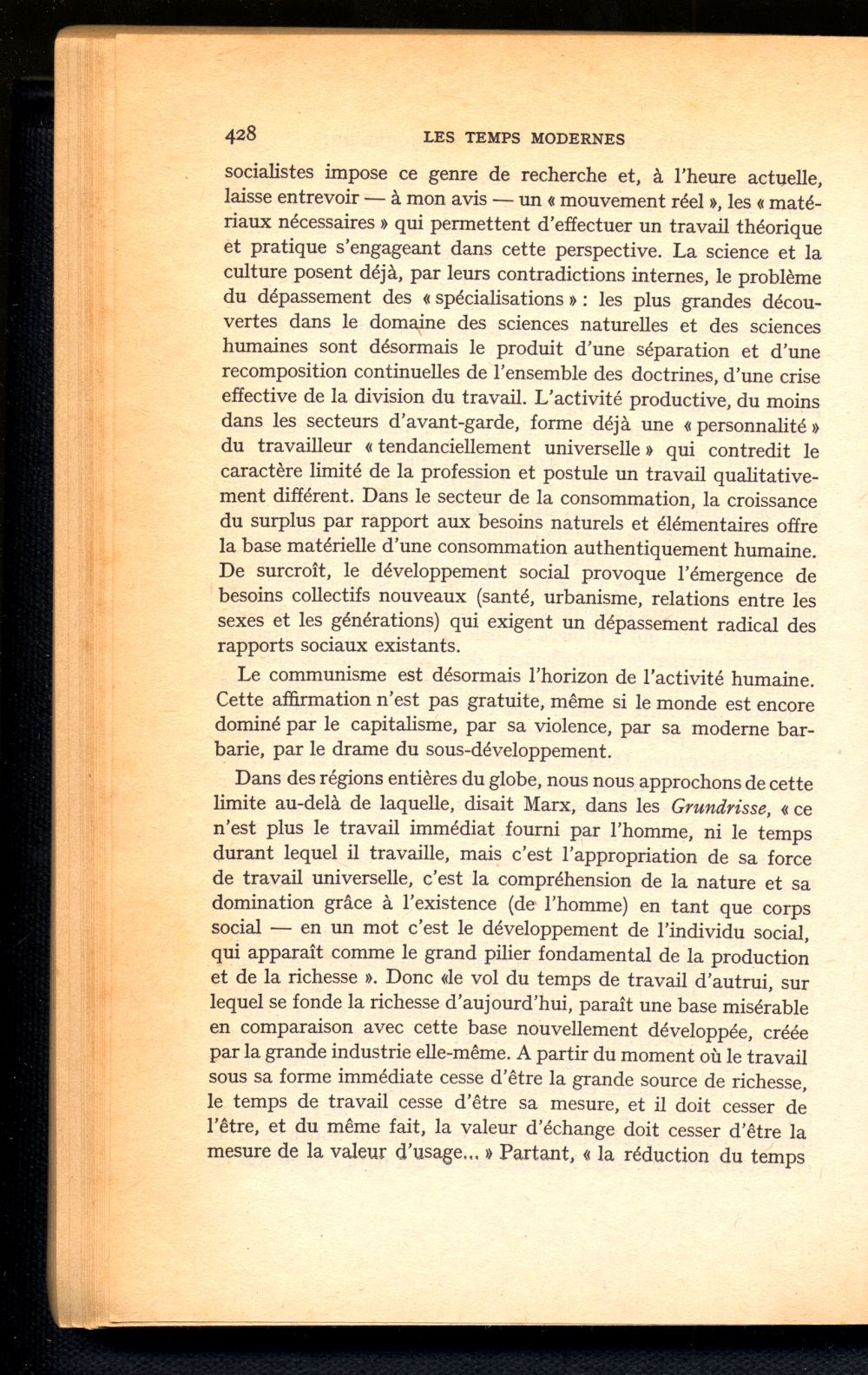

428
LES TEMPS MODERNES
socialistes impose ce genre de recherche et, à l'heure actuelle,
laisse entrevoir — à mon avis — un « mouvement réel », les « maté-
riaux nécessaires » qui permettent d'effectuer un travail théorique
et pratique s'engageant dans cette perspective. La science et la
culture posent déjà, par leurs contradictions internes, le problème
du dépassement des « spécialisations » : les plus grandes décou-
vertes dans le domaine des sciences naturelles et des sciences
humaines sont désormais le produit d'une séparation et d'une
recomposition continuelles de l'ensemble des doctrines, d'une crise
effective de la division du travail. L'activité productive, du moins
dans les secteurs d'avant-garde, forme déjà une « personnalité »
du travailleur « tendanciellement universelle » qui contredit le
caractère limité de la profession et postule un travail qualitative-
ment différent. Dans le secteur de la consommation, la croissance
du surplus par rapport aux besoins naturels et élémentaires offre
la base matérielle d'une consommation authentiquement humaine.
De surcroît, le développement social provoque l'émergence de
besoins collectifs nouveaux (santé, urbanisme, relations entre les
sexes et les générations) qui exigent un dépassement radical des
rapports sociaux existants.
laisse entrevoir — à mon avis — un « mouvement réel », les « maté-
riaux nécessaires » qui permettent d'effectuer un travail théorique
et pratique s'engageant dans cette perspective. La science et la
culture posent déjà, par leurs contradictions internes, le problème
du dépassement des « spécialisations » : les plus grandes décou-
vertes dans le domaine des sciences naturelles et des sciences
humaines sont désormais le produit d'une séparation et d'une
recomposition continuelles de l'ensemble des doctrines, d'une crise
effective de la division du travail. L'activité productive, du moins
dans les secteurs d'avant-garde, forme déjà une « personnalité »
du travailleur « tendanciellement universelle » qui contredit le
caractère limité de la profession et postule un travail qualitative-
ment différent. Dans le secteur de la consommation, la croissance
du surplus par rapport aux besoins naturels et élémentaires offre
la base matérielle d'une consommation authentiquement humaine.
De surcroît, le développement social provoque l'émergence de
besoins collectifs nouveaux (santé, urbanisme, relations entre les
sexes et les générations) qui exigent un dépassement radical des
rapports sociaux existants.
Le communisme est désormais l'horizon de l'activité humaine.
Cette affirmation n'est pas gratuite, même si le monde est encore
dominé par le capitalisme, par sa violence, par sa moderne bar-
barie, par le drame du sous-développement.
Cette affirmation n'est pas gratuite, même si le monde est encore
dominé par le capitalisme, par sa violence, par sa moderne bar-
barie, par le drame du sous-développement.
Dans des régions entières du globe, nous nous approchons de cette
limite au-delà de laquelle, disait Marx, dans les Grundrisse, « ce
n'est plus le travail immédiat fourni par l'homme, ni le temps
durant lequel il travaille, mais c'est l'appropriation de sa force
de travail universelle, c'est la compréhension de la nature et sa
domination grâce à l'existence (de l'homme) en tant que corps
social — en un mot c'est le développement de l'individu social,
qui apparaît comme le grand pilier fondamental de la production
et de la richesse ». Donc «le vol du temps de travail d'autrui, sur
lequel se fonde la richesse d'aujourd'hui, paraît une base misérable
en comparaison avec cette base nouvellement développée, créée
par la grande industrie elle-même. A partir du moment où le travail
sous sa forme immédiate cesse d'être la grande source de richesse,
le temps de travail cesse d'être sa mesure, et il doit cesser de
l'être, et du même fait, la valeur d'échange doit cesser d'être la
mesure de la valeur d'usage.,, » Partant, « la réduction du temps
limite au-delà de laquelle, disait Marx, dans les Grundrisse, « ce
n'est plus le travail immédiat fourni par l'homme, ni le temps
durant lequel il travaille, mais c'est l'appropriation de sa force
de travail universelle, c'est la compréhension de la nature et sa
domination grâce à l'existence (de l'homme) en tant que corps
social — en un mot c'est le développement de l'individu social,
qui apparaît comme le grand pilier fondamental de la production
et de la richesse ». Donc «le vol du temps de travail d'autrui, sur
lequel se fonde la richesse d'aujourd'hui, paraît une base misérable
en comparaison avec cette base nouvellement développée, créée
par la grande industrie elle-même. A partir du moment où le travail
sous sa forme immédiate cesse d'être la grande source de richesse,
le temps de travail cesse d'être sa mesure, et il doit cesser de
l'être, et du même fait, la valeur d'échange doit cesser d'être la
mesure de la valeur d'usage.,, » Partant, « la réduction du temps
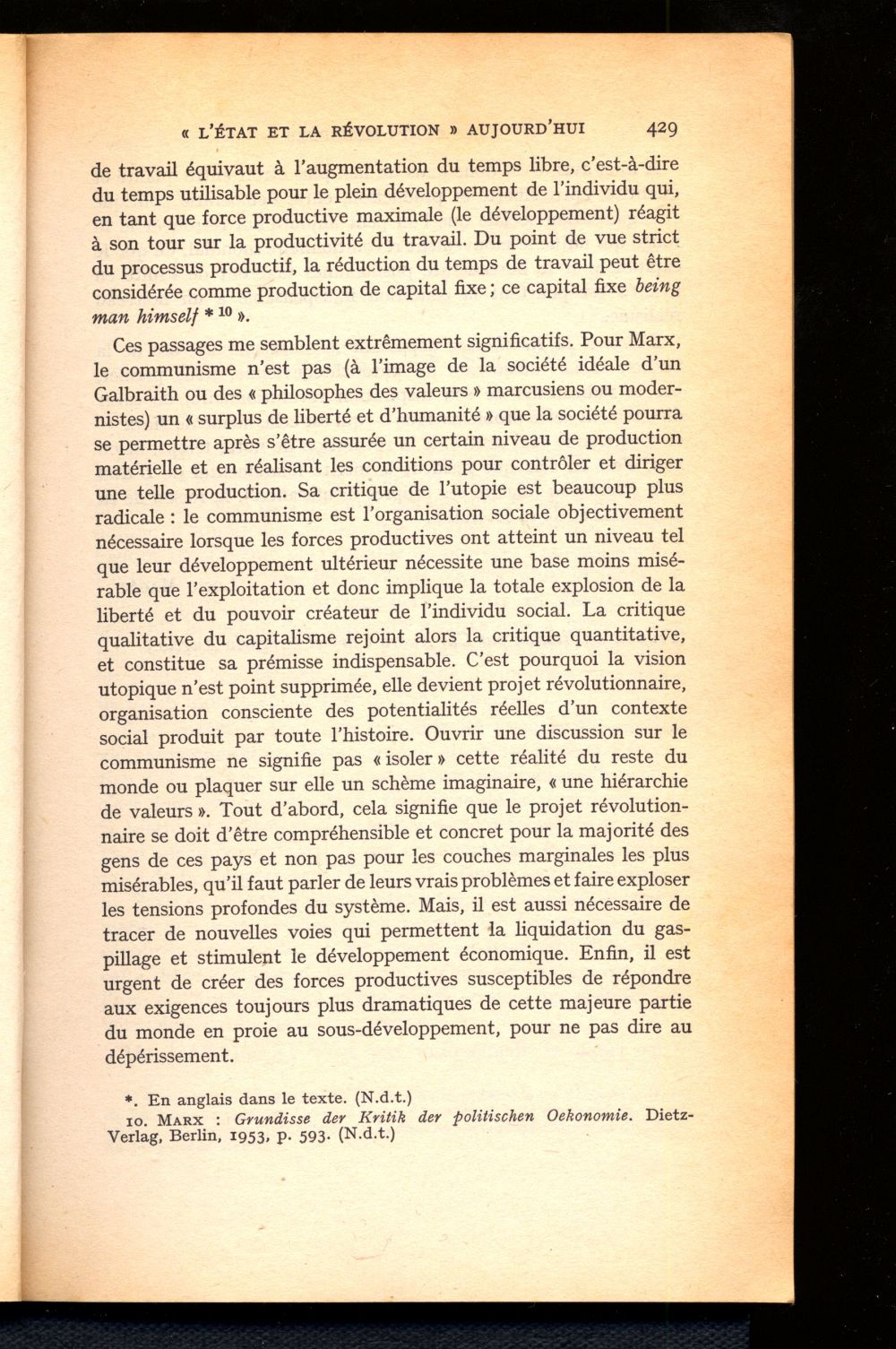

« L'ÉTAT ET LA RÉVOLUTION » AUJOURD'HUI
429
de travail équivaut à l'augmentation du temps libre, c'est-à-dire
du temps utilisable pour le plein développement de l'individu qui,
en tant que force productive maximale (le développement) réagit
à son tour sur la productivité du travail. Du point de vue strict
du processus productif, la réduction du temps de travail peut être
considérée comme production de capital fixe ; ce capital fixe being
man himself * w ».
du temps utilisable pour le plein développement de l'individu qui,
en tant que force productive maximale (le développement) réagit
à son tour sur la productivité du travail. Du point de vue strict
du processus productif, la réduction du temps de travail peut être
considérée comme production de capital fixe ; ce capital fixe being
man himself * w ».
Ces passages me semblent extrêmement significatifs. Pour Marx,
le communisme n'est pas (à l'image de la société idéale d'un
Galbraith ou des « philosophes des valeurs » marcusiens ou moder-
nistes) un « surplus de liberté et d'humanité » que la société pourra
se permettre après s'être assurée un certain niveau de production
matérielle et en réalisant les conditions pour contrôler et diriger
une telle production. Sa critique de l'utopie est beaucoup plus
radicale : le communisme est l'organisation sociale objectivement
nécessaire lorsque les forces productives ont atteint un niveau tel
que leur développement ultérieur nécessite une base moins misé-
rable que l'exploitation et donc implique la totale explosion de la
liberté et du pouvoir créateur de l'individu social. La critique
qualitative du capitalisme rejoint alors la critique quantitative,
et constitue sa prémisse indispensable. C'est pourquoi la vision
utopique n'est point supprimée, elle devient projet révolutionnaire,
organisation consciente des potentialités réelles d'un contexte
social produit par toute l'histoire. Ouvrir une discussion sur le
communisme ne signifie pas « isoler » cette réalité du reste du
monde ou plaquer sur elle un schème imaginaire, « une hiérarchie
de valeurs ». Tout d'abord, cela signifie que le projet révolution-
naire se doit d'être compréhensible et concret pour la majorité des
gens de ces pays et non pas pour les couches marginales les plus
misérables, qu'il faut parler de leurs vrais problèmes et faire exploser
les tensions profondes du système. Mais, il est aussi nécessaire de
tracer de nouvelles voies qui permettent la liquidation du gas-
pillage et stimulent le développement économique. Enfin, il est
urgent de créer des forces productives susceptibles de répondre
aux exigences toujours plus dramatiques de cette majeure partie
du monde en proie au sous-développement, pour ne pas dire au
dépérissement.
le communisme n'est pas (à l'image de la société idéale d'un
Galbraith ou des « philosophes des valeurs » marcusiens ou moder-
nistes) un « surplus de liberté et d'humanité » que la société pourra
se permettre après s'être assurée un certain niveau de production
matérielle et en réalisant les conditions pour contrôler et diriger
une telle production. Sa critique de l'utopie est beaucoup plus
radicale : le communisme est l'organisation sociale objectivement
nécessaire lorsque les forces productives ont atteint un niveau tel
que leur développement ultérieur nécessite une base moins misé-
rable que l'exploitation et donc implique la totale explosion de la
liberté et du pouvoir créateur de l'individu social. La critique
qualitative du capitalisme rejoint alors la critique quantitative,
et constitue sa prémisse indispensable. C'est pourquoi la vision
utopique n'est point supprimée, elle devient projet révolutionnaire,
organisation consciente des potentialités réelles d'un contexte
social produit par toute l'histoire. Ouvrir une discussion sur le
communisme ne signifie pas « isoler » cette réalité du reste du
monde ou plaquer sur elle un schème imaginaire, « une hiérarchie
de valeurs ». Tout d'abord, cela signifie que le projet révolution-
naire se doit d'être compréhensible et concret pour la majorité des
gens de ces pays et non pas pour les couches marginales les plus
misérables, qu'il faut parler de leurs vrais problèmes et faire exploser
les tensions profondes du système. Mais, il est aussi nécessaire de
tracer de nouvelles voies qui permettent la liquidation du gas-
pillage et stimulent le développement économique. Enfin, il est
urgent de créer des forces productives susceptibles de répondre
aux exigences toujours plus dramatiques de cette majeure partie
du monde en proie au sous-développement, pour ne pas dire au
dépérissement.
*. En anglais dans le texte. (N.d.t.)
10. MARX : Grundisse der Kritik der politischen Oekonomie. Dietz-
Verlag, Berlin, 1953, p. 593. (N.d.t.)
Verlag, Berlin, 1953, p. 593. (N.d.t.)
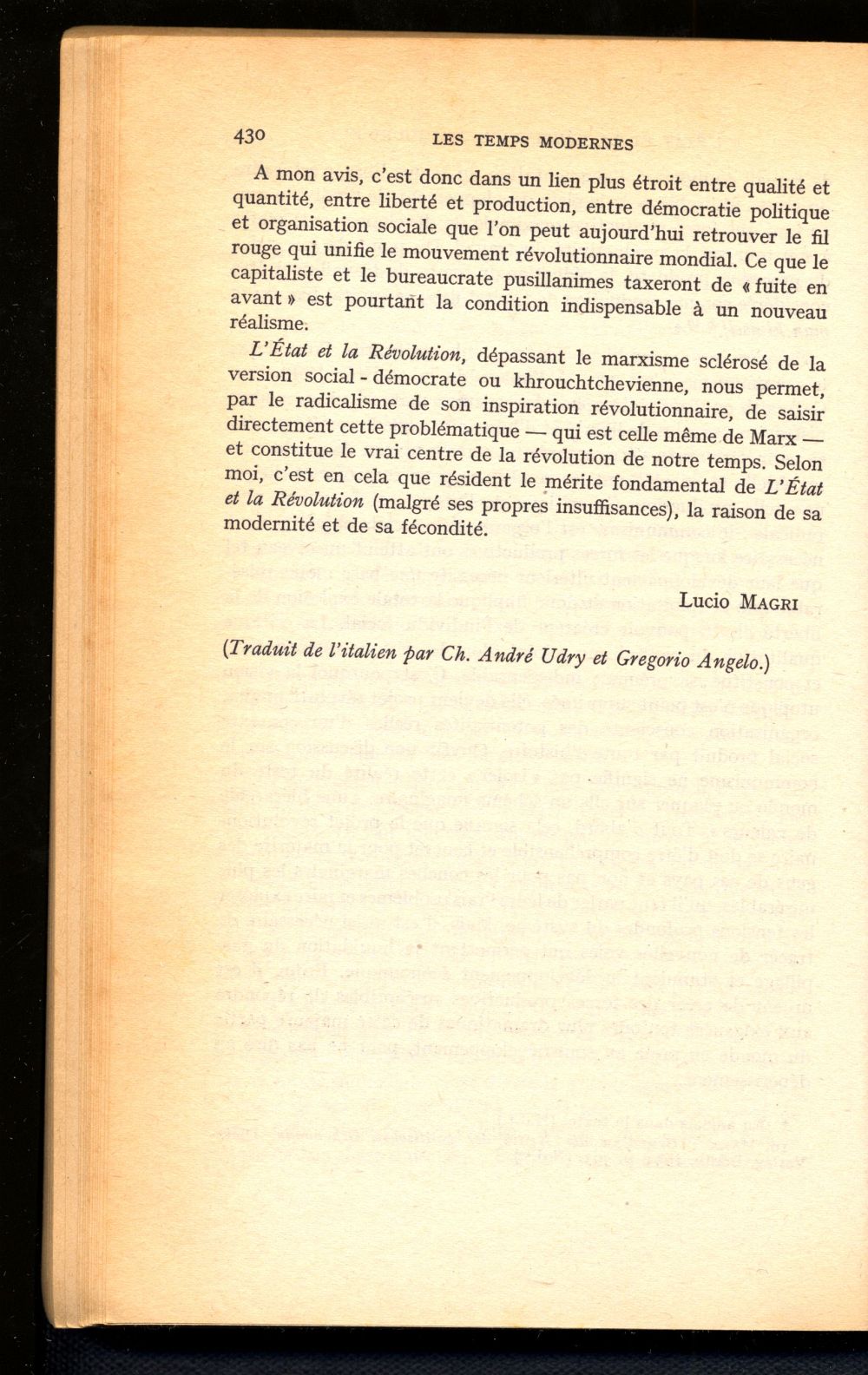

430
LES TEMPS MODERNES
A mon avis, c'est donc dans un lien plus étroit entre qualité et
quantité, entre liberté et production, entre démocratie politique
et organisation sociale que l'on peut aujourd'hui retrouver le fil
rouge qui unifie le mouvement révolutionnaire mondial. Ce que le
capitaliste et le bureaucrate pusillanimes taxeront de « fuite en
avant » est pourtant la condition indispensable à un nouveau
réalisme.
quantité, entre liberté et production, entre démocratie politique
et organisation sociale que l'on peut aujourd'hui retrouver le fil
rouge qui unifie le mouvement révolutionnaire mondial. Ce que le
capitaliste et le bureaucrate pusillanimes taxeront de « fuite en
avant » est pourtant la condition indispensable à un nouveau
réalisme.
L'État et la Révolution, dépassant le marxisme sclérosé de la
version social - démocrate ou khrouchtchevienne, nous permet,
par le radicalisme de son inspiration révolutionnaire, de saisir
directement cette problématique — qui est celle même de Marx —
et constitue le vrai centre de la révolution de notre temps. Selon
moi, c'est en cela que résident le mérite fondamental de L'État
et la Révolution (malgré ses propres insuffisances), la raison de sa
modernité et de sa fécondité.
version social - démocrate ou khrouchtchevienne, nous permet,
par le radicalisme de son inspiration révolutionnaire, de saisir
directement cette problématique — qui est celle même de Marx —
et constitue le vrai centre de la révolution de notre temps. Selon
moi, c'est en cela que résident le mérite fondamental de L'État
et la Révolution (malgré ses propres insuffisances), la raison de sa
modernité et de sa fécondité.
Lucio MAGRI
(Traduit de l'italien par Ch. André Udry et Gregorio Angelo.)
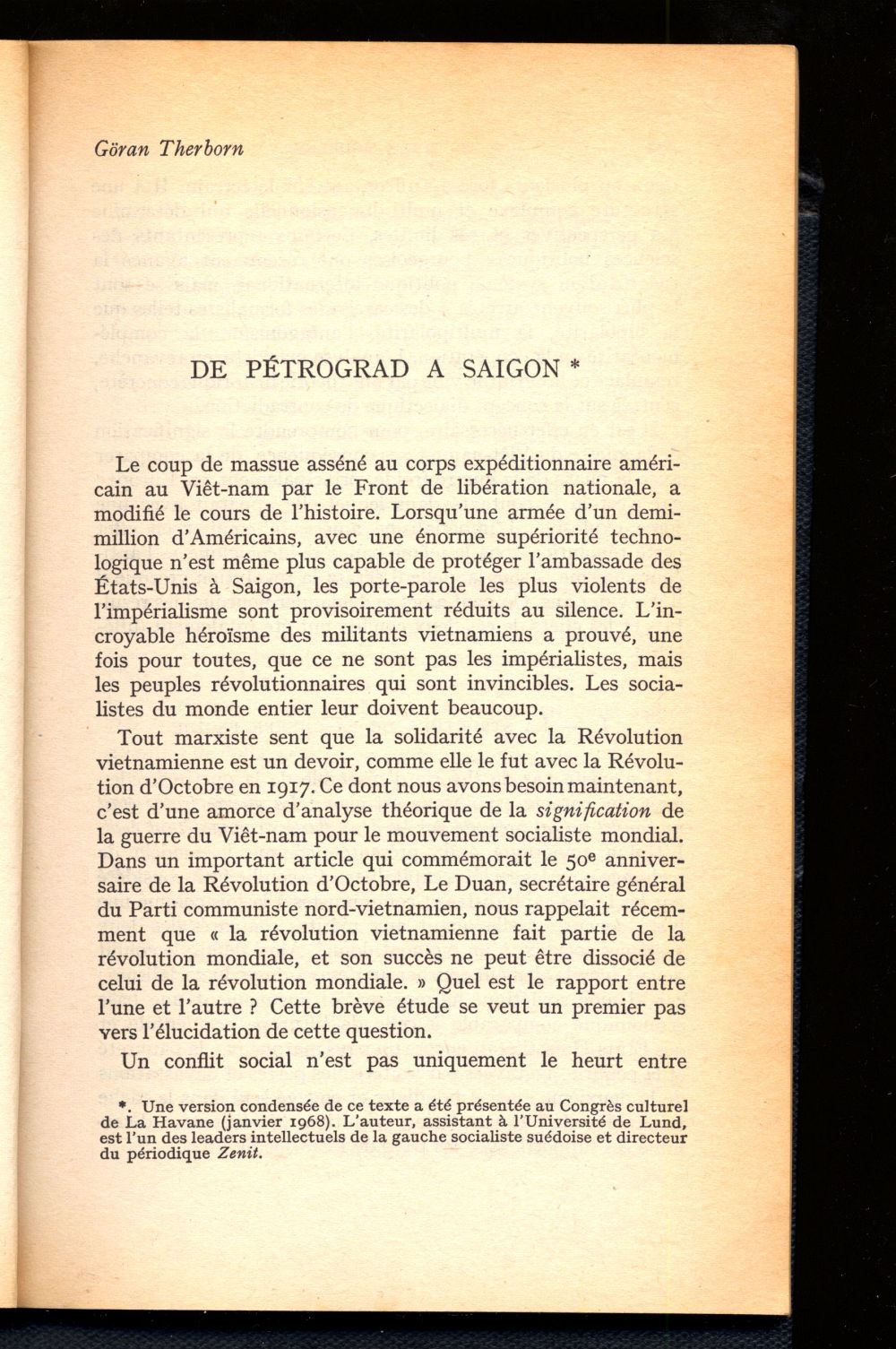

Gôran Therborn
DE PETROGRAD A SAIGON *
Le coup de massue asséné au corps expéditionnaire améri-
cain au Viêt-nam par le Front de libération nationale, a
modifié le cours de l'histoire. Lorsqu'une armée d'un demi-
million d'Américains, avec une énorme supériorité techno-
logique n'est même plus capable de protéger l'ambassade des
États-Unis à Saigon, les porte-parole les plus violents de
l'impérialisme sont provisoirement réduits au silence. L'in-
croyable héroïsme des militants vietnamiens a prouvé, une
fois pour toutes, que ce ne sont pas les impérialistes, mais
les peuples révolutionnaires qui sont invincibles. Les socia-
listes du monde entier leur doivent beaucoup.
cain au Viêt-nam par le Front de libération nationale, a
modifié le cours de l'histoire. Lorsqu'une armée d'un demi-
million d'Américains, avec une énorme supériorité techno-
logique n'est même plus capable de protéger l'ambassade des
États-Unis à Saigon, les porte-parole les plus violents de
l'impérialisme sont provisoirement réduits au silence. L'in-
croyable héroïsme des militants vietnamiens a prouvé, une
fois pour toutes, que ce ne sont pas les impérialistes, mais
les peuples révolutionnaires qui sont invincibles. Les socia-
listes du monde entier leur doivent beaucoup.
Tout marxiste sent que la solidarité avec la Révolution
vietnamienne est un devoir, comme elle le fut avec la Révolu-
tion d'Octobre en 1917. Ce dont nous avons besoin maintenant,
c'est d'une amorce d'analyse théorique de la signification de
la guerre du Viêt-nam pour le mouvement socialiste mondial.
Dans un important article qui commémorait le 50e anniver-
saire de la Révolution d'Octobre, Le Duan, secrétaire général
du Parti communiste nord-vietnamien, nous rappelait récem-
ment que « la révolution vietnamienne fait partie de la
révolution mondiale, et son succès ne peut être dissocié de
celui de la révolution mondiale. » Quel est le rapport entre
l'une et l'autre ? Cette brève étude se veut un premier pas
vers l'élucidation de cette question.
vietnamienne est un devoir, comme elle le fut avec la Révolu-
tion d'Octobre en 1917. Ce dont nous avons besoin maintenant,
c'est d'une amorce d'analyse théorique de la signification de
la guerre du Viêt-nam pour le mouvement socialiste mondial.
Dans un important article qui commémorait le 50e anniver-
saire de la Révolution d'Octobre, Le Duan, secrétaire général
du Parti communiste nord-vietnamien, nous rappelait récem-
ment que « la révolution vietnamienne fait partie de la
révolution mondiale, et son succès ne peut être dissocié de
celui de la révolution mondiale. » Quel est le rapport entre
l'une et l'autre ? Cette brève étude se veut un premier pas
vers l'élucidation de cette question.
Un conflit social n'est pas uniquement le heurt entre
*. Une version condensée de ce texte a été présentée au Congrès culturel
de La Havane (janvier 1968). L'auteur, assistant à l'Université de Lund,
est l'un des leaders intellectuels de la gauche socialiste suédoise et directeur
du périodique Zenit.
de La Havane (janvier 1968). L'auteur, assistant à l'Université de Lund,
est l'un des leaders intellectuels de la gauche socialiste suédoise et directeur
du périodique Zenit.
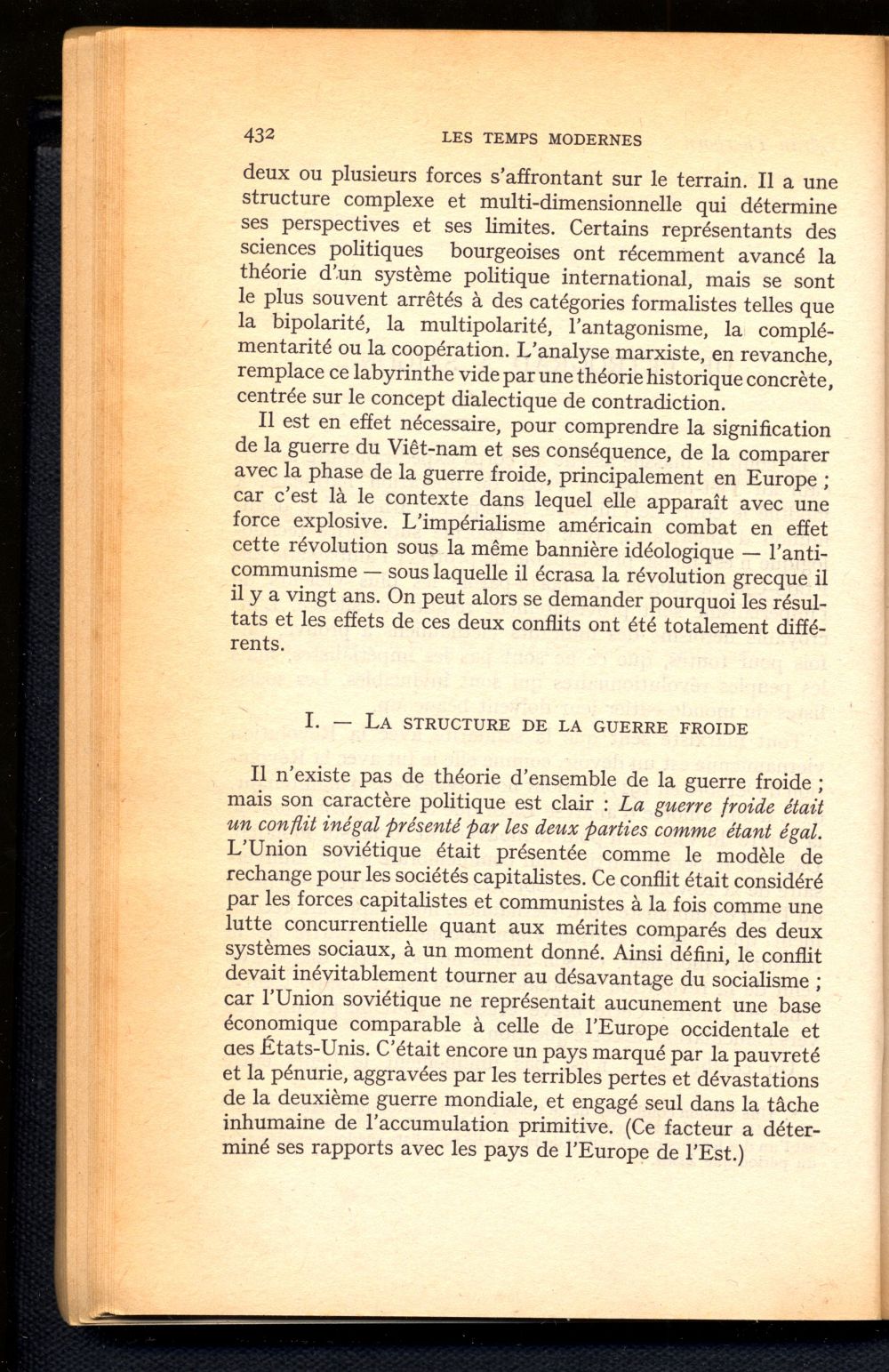

432
LES TEMPS MODERNES
deux ou plusieurs forces s'affrontant sur le terrain. Il a une
structure complexe et multi-dimensionnelle qui détermine
ses perspectives et ses limites. Certains représentants des
sciences politiques bourgeoises ont récemment avancé la
théorie d'un système politique international, mais se sont
le plus souvent arrêtés à des catégories formalistes telles que
la bipolarité, la multipolarité, l'antagonisme, la complé-
mentarité ou la coopération. L'analyse marxiste, en revanche,
remplace ce labyrinthe vide par une théorie historique concrète,
centrée sur le concept dialectique de contradiction.
structure complexe et multi-dimensionnelle qui détermine
ses perspectives et ses limites. Certains représentants des
sciences politiques bourgeoises ont récemment avancé la
théorie d'un système politique international, mais se sont
le plus souvent arrêtés à des catégories formalistes telles que
la bipolarité, la multipolarité, l'antagonisme, la complé-
mentarité ou la coopération. L'analyse marxiste, en revanche,
remplace ce labyrinthe vide par une théorie historique concrète,
centrée sur le concept dialectique de contradiction.
Il est en effet nécessaire, pour comprendre la signification
de la guerre du Viêt-nam et ses conséquence, de la comparer
avec la phase de la guerre froide, principalement en Europe ;
car c'est là le contexte dans lequel elle apparaît avec une
force explosive. L'impérialisme américain combat en effet
cette révolution sous la même bannière idéologique — l'anti-
communisme — sous laquelle il écrasa la révolution grecque il
il y a vingt ans. On peut alors se demander pourquoi les résul-
tats et les effets de ces deux conflits ont été totalement diffé-
rents.
de la guerre du Viêt-nam et ses conséquence, de la comparer
avec la phase de la guerre froide, principalement en Europe ;
car c'est là le contexte dans lequel elle apparaît avec une
force explosive. L'impérialisme américain combat en effet
cette révolution sous la même bannière idéologique — l'anti-
communisme — sous laquelle il écrasa la révolution grecque il
il y a vingt ans. On peut alors se demander pourquoi les résul-
tats et les effets de ces deux conflits ont été totalement diffé-
rents.
I.
LA STRUCTURE DE LA GUERRE FROIDE
II n'existe pas de théorie d'ensemble de la guerre froide ;
mais son caractère politique est clair : La guerre froide était
un conflit inégal présenté par les deux parties comme étant égal.
L'Union soviétique était présentée comme le modèle de
rechange pour les sociétés capitalistes. Ce conflit était considéré
par les forces capitalistes et communistes à la fois comme une
lutte concurrentielle quant aux mérites comparés des deux
systèmes sociaux, à un moment donné. Ainsi défini, le conflit
devait inévitablement tourner au désavantage du socialisme ;
car l'Union soviétique ne représentait aucunement une base
économique comparable à celle de l'Europe occidentale et
aes États-Unis. C'était encore un pays marqué par la pauvreté
et la pénurie, aggravées par les terribles pertes et dévastations
de la deuxième guerre mondiale, et engagé seul dans la tâche
inhumaine de l'accumulation primitive. (Ce facteur a déter-
miné ses rapports avec les pays de l'Europe de l'Est.)
mais son caractère politique est clair : La guerre froide était
un conflit inégal présenté par les deux parties comme étant égal.
L'Union soviétique était présentée comme le modèle de
rechange pour les sociétés capitalistes. Ce conflit était considéré
par les forces capitalistes et communistes à la fois comme une
lutte concurrentielle quant aux mérites comparés des deux
systèmes sociaux, à un moment donné. Ainsi défini, le conflit
devait inévitablement tourner au désavantage du socialisme ;
car l'Union soviétique ne représentait aucunement une base
économique comparable à celle de l'Europe occidentale et
aes États-Unis. C'était encore un pays marqué par la pauvreté
et la pénurie, aggravées par les terribles pertes et dévastations
de la deuxième guerre mondiale, et engagé seul dans la tâche
inhumaine de l'accumulation primitive. (Ce facteur a déter-
miné ses rapports avec les pays de l'Europe de l'Est.)
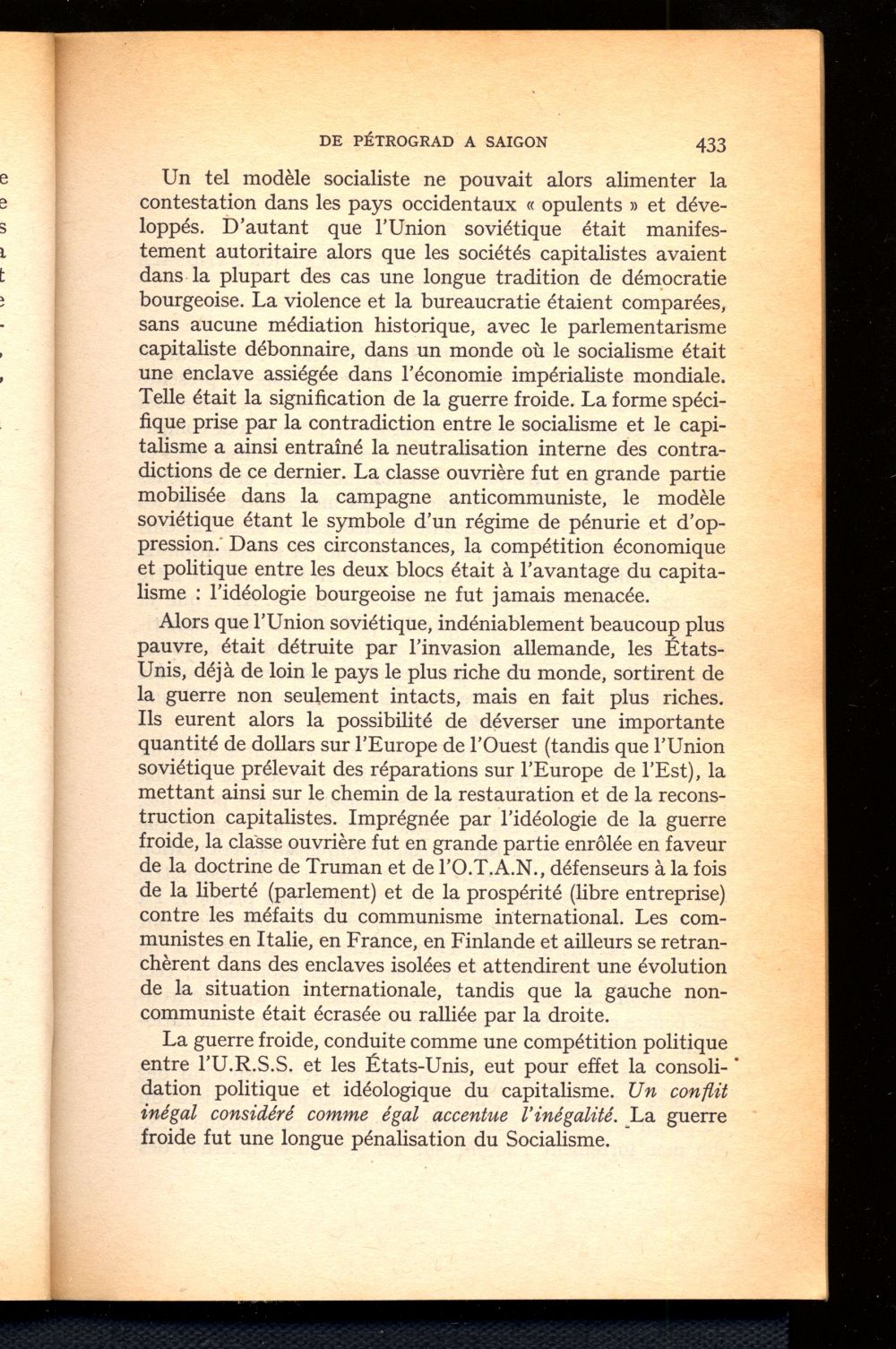

DE PÉTROGRAD A SAIGON
433
Un tel modèle socialiste ne pouvait alors alimenter la
contestation dans les pays occidentaux « opulents » et déve-
loppés. D'autant que l'Union soviétique était manifes-
tement autoritaire alors que les sociétés capitalistes avaient
dans la plupart des cas une longue tradition de démocratie
bourgeoise. La violence et la bureaucratie étaient comparées,
sans aucune médiation historique, avec le parlementarisme
capitaliste débonnaire, dans un monde où le socialisme était
une enclave assiégée dans l'économie impérialiste mondiale.
Telle était la signification de la guerre froide. La forme spéci-
fique prise par la contradiction entre le socialisme et le capi-
talisme a ainsi entraîné la neutralisation interne des contra-
dictions de ce dernier. La classe ouvrière fut en grande partie
mobilisée dans la campagne anticommuniste, le modèle
soviétique étant le symbole d'un régime de pénurie et d'op-
pression. Dans ces circonstances, la compétition économique
et politique entre les deux blocs était à l'avantage du capita-
lisme : l'idéologie bourgeoise ne fut jamais menacée.
contestation dans les pays occidentaux « opulents » et déve-
loppés. D'autant que l'Union soviétique était manifes-
tement autoritaire alors que les sociétés capitalistes avaient
dans la plupart des cas une longue tradition de démocratie
bourgeoise. La violence et la bureaucratie étaient comparées,
sans aucune médiation historique, avec le parlementarisme
capitaliste débonnaire, dans un monde où le socialisme était
une enclave assiégée dans l'économie impérialiste mondiale.
Telle était la signification de la guerre froide. La forme spéci-
fique prise par la contradiction entre le socialisme et le capi-
talisme a ainsi entraîné la neutralisation interne des contra-
dictions de ce dernier. La classe ouvrière fut en grande partie
mobilisée dans la campagne anticommuniste, le modèle
soviétique étant le symbole d'un régime de pénurie et d'op-
pression. Dans ces circonstances, la compétition économique
et politique entre les deux blocs était à l'avantage du capita-
lisme : l'idéologie bourgeoise ne fut jamais menacée.
Alors que l'Union soviétique, indéniablement beaucoup plus
pauvre, était détruite par l'invasion allemande, les États-
Unis, déjà de loin le pays le plus riche du monde, sortirent de
la guerre non seulement intacts, mais en fait plus riches.
Ils eurent alors la possibilité de déverser une importante
quantité de dollars sur l'Europe de l'Ouest (tandis que l'Union
soviétique prélevait des réparations sur l'Europe de l'Est), la
mettant ainsi sur le chemin de la restauration et de la recons-
truction capitalistes. Imprégnée par l'idéologie de la guerre
froide, la classe ouvrière fut en grande partie enrôlée en faveur
de la doctrine de Truman et de l'O.T.A.N., défenseurs à la fois
de la liberté (parlement) et de la prospérité (libre entreprise)
contre les méfaits du communisme international. Les com-
munistes en Italie, en France, en Finlande et ailleurs se retran-
chèrent dans des enclaves isolées et attendirent une évolution
de la situation internationale, tandis que la gauche non-
communiste était écrasée ou ralliée par la droite.
pauvre, était détruite par l'invasion allemande, les États-
Unis, déjà de loin le pays le plus riche du monde, sortirent de
la guerre non seulement intacts, mais en fait plus riches.
Ils eurent alors la possibilité de déverser une importante
quantité de dollars sur l'Europe de l'Ouest (tandis que l'Union
soviétique prélevait des réparations sur l'Europe de l'Est), la
mettant ainsi sur le chemin de la restauration et de la recons-
truction capitalistes. Imprégnée par l'idéologie de la guerre
froide, la classe ouvrière fut en grande partie enrôlée en faveur
de la doctrine de Truman et de l'O.T.A.N., défenseurs à la fois
de la liberté (parlement) et de la prospérité (libre entreprise)
contre les méfaits du communisme international. Les com-
munistes en Italie, en France, en Finlande et ailleurs se retran-
chèrent dans des enclaves isolées et attendirent une évolution
de la situation internationale, tandis que la gauche non-
communiste était écrasée ou ralliée par la droite.
La guerre froide, conduite comme une compétition politique
entre l'U.R.S.S. et les États-Unis, eut pour effet la consoli-
dation politique et idéologique du capitalisme. Un conflit
inégal considéré comme égal accentue l'inégalité. La guerre
froide fut une longue pénalisation du Socialisme.
entre l'U.R.S.S. et les États-Unis, eut pour effet la consoli-
dation politique et idéologique du capitalisme. Un conflit
inégal considéré comme égal accentue l'inégalité. La guerre
froide fut une longue pénalisation du Socialisme.
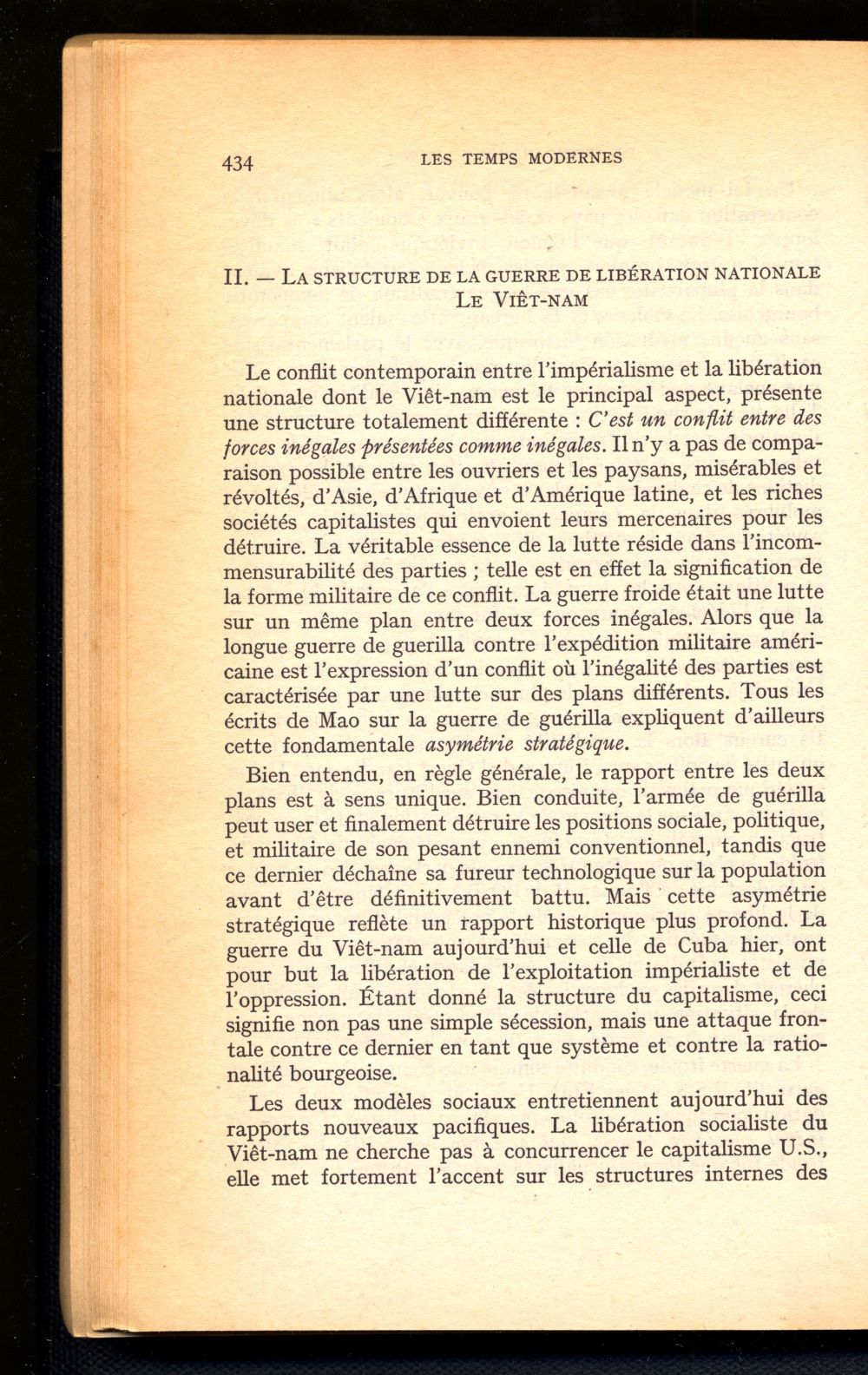

434
LES TEMPS MODERNES
II. — LA STRUCTURE DE LA GUERRE DE LIBÉRATION NATIONALE
LE VIÊT-NAM
Le conflit contemporain entre l'impérialisme et la libération
nationale dont le Viêt-nam est le principal aspect, présente
une structure totalement différente : C'est un conflit entre des
forces inégales présentées comme inégales. Il n'y a pas de compa-
raison possible entre les ouvriers et les paysans, misérables et
révoltés, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et les riches
sociétés capitalistes qui envoient leurs mercenaires pour les
détruire. La véritable essence de la lutte réside dans l'incom-
mensurabilité des parties ; telle est en effet la signification de
la forme militaire de ce conflit. La guerre froide était une lutte
sur un même plan entre deux forces inégales. Alors que la
longue guerre de guérilla contre l'expédition militaire améri-
caine est l'expression d'un conflit où l'inégalité des parties est
caractérisée par une lutte sur des plans différents. Tous les
écrits de Mao sur la guerre de guérilla expliquent d'ailleurs
cette fondamentale asymétrie stratégique.
nationale dont le Viêt-nam est le principal aspect, présente
une structure totalement différente : C'est un conflit entre des
forces inégales présentées comme inégales. Il n'y a pas de compa-
raison possible entre les ouvriers et les paysans, misérables et
révoltés, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, et les riches
sociétés capitalistes qui envoient leurs mercenaires pour les
détruire. La véritable essence de la lutte réside dans l'incom-
mensurabilité des parties ; telle est en effet la signification de
la forme militaire de ce conflit. La guerre froide était une lutte
sur un même plan entre deux forces inégales. Alors que la
longue guerre de guérilla contre l'expédition militaire améri-
caine est l'expression d'un conflit où l'inégalité des parties est
caractérisée par une lutte sur des plans différents. Tous les
écrits de Mao sur la guerre de guérilla expliquent d'ailleurs
cette fondamentale asymétrie stratégique.
Bien entendu, en règle générale, le rapport entre les deux
plans est à sens unique. Bien conduite, l'armée de guérilla
peut user et finalement détruire les positions sociale, politique,
et militaire de son pesant ennemi conventionnel, tandis que
ce dernier déchaîne sa fureur technologique sur la population
avant d'être définitivement battu. Mais cette asymétrie
stratégique reflète un rapport historique plus profond. La
guerre du Viêt-nam aujourd'hui et celle de Cuba hier, ont
pour but la libération de l'exploitation impérialiste et de
l'oppression. Étant donné la structure du capitalisme, ceci
signifie non pas une simple sécession, mais une attaque fron-
tale contre ce dernier en tant que système et contre la ratio-
nalité bourgeoise.
plans est à sens unique. Bien conduite, l'armée de guérilla
peut user et finalement détruire les positions sociale, politique,
et militaire de son pesant ennemi conventionnel, tandis que
ce dernier déchaîne sa fureur technologique sur la population
avant d'être définitivement battu. Mais cette asymétrie
stratégique reflète un rapport historique plus profond. La
guerre du Viêt-nam aujourd'hui et celle de Cuba hier, ont
pour but la libération de l'exploitation impérialiste et de
l'oppression. Étant donné la structure du capitalisme, ceci
signifie non pas une simple sécession, mais une attaque fron-
tale contre ce dernier en tant que système et contre la ratio-
nalité bourgeoise.
Les deux modèles sociaux entretiennent aujourd'hui des
rapports nouveaux pacifiques. La libération socialiste du
Viêt-nam ne cherche pas à concurrencer le capitalisme U.S.,
elle met fortement l'accent sur les structures internes des
rapports nouveaux pacifiques. La libération socialiste du
Viêt-nam ne cherche pas à concurrencer le capitalisme U.S.,
elle met fortement l'accent sur les structures internes des
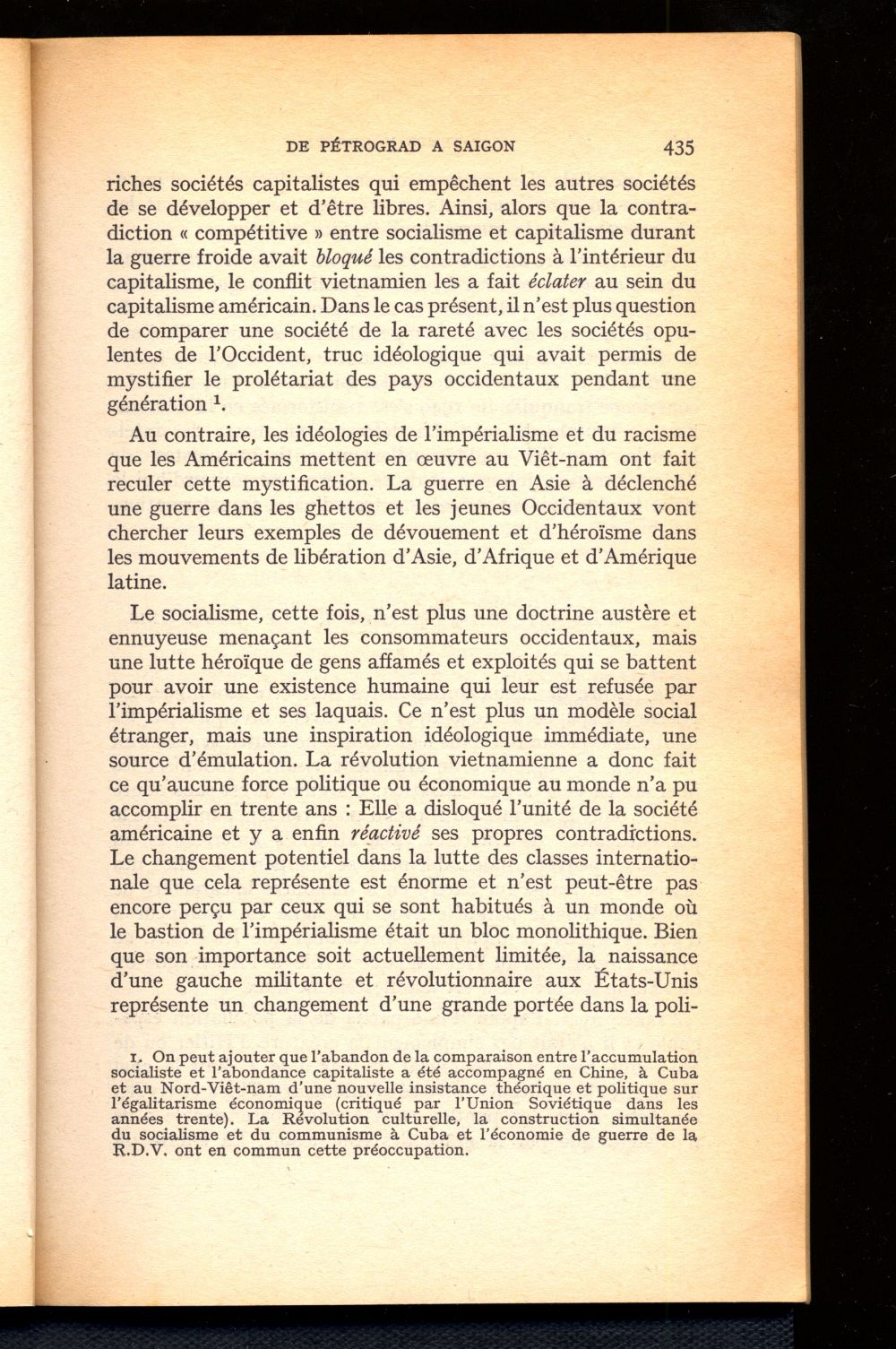

DE PÉTROGRAD A SAIGON
435
riches sociétés capitalistes qui empêchent les autres sociétés
de se développer et d'être libres. Ainsi, alors que la contra-
diction « compétitive » entre socialisme et capitalisme durant
la guerre froide avait bloqué les contradictions à l'intérieur du
capitalisme, le conflit vietnamien les a fait éclater au sein du
capitalisme américain. Dans le cas présent, il n'est plus question
de comparer une société de la rareté avec les sociétés opu-
lentes de l'Occident, truc idéologique qui avait permis de
mystifier le prolétariat des pays occidentaux pendant une
génération 1.
de se développer et d'être libres. Ainsi, alors que la contra-
diction « compétitive » entre socialisme et capitalisme durant
la guerre froide avait bloqué les contradictions à l'intérieur du
capitalisme, le conflit vietnamien les a fait éclater au sein du
capitalisme américain. Dans le cas présent, il n'est plus question
de comparer une société de la rareté avec les sociétés opu-
lentes de l'Occident, truc idéologique qui avait permis de
mystifier le prolétariat des pays occidentaux pendant une
génération 1.
Au contraire, les idéologies de l'impérialisme et du racisme
que les Américains mettent en œuvre au Viêt-nam ont fait
reculer cette mystification. La guerre en Asie à déclenché
une guerre dans les ghettos et les jeunes Occidentaux vont
chercher leurs exemples de dévouement et d'héroïsme dans
les mouvements de libération d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine.
que les Américains mettent en œuvre au Viêt-nam ont fait
reculer cette mystification. La guerre en Asie à déclenché
une guerre dans les ghettos et les jeunes Occidentaux vont
chercher leurs exemples de dévouement et d'héroïsme dans
les mouvements de libération d'Asie, d'Afrique et d'Amérique
latine.
Le socialisme, cette fois, n'est plus une doctrine austère et
ennuyeuse menaçant les consommateurs occidentaux, mais
une lutte héroïque de gens affamés et exploités qui se battent
pour avoir une existence humaine qui leur est refusée par
l'impérialisme et ses laquais. Ce n'est plus un modèle social
étranger, mais une inspiration idéologique immédiate, une
source d'émulation. La révolution vietnamienne a donc fait
ce qu'aucune force politique ou économique au monde n'a pu
accomplir en trente ans : Elle a disloqué l'unité de la société
américaine et y a enfin réactivé ses propres contradictions.
Le changement potentiel dans la lutte des classes internatio-
nale que cela représente est énorme et n'est peut-être pas
encore perçu par ceux qui se sont habitués à un monde où
le bastion de l'impérialisme était un bloc monolithique. Bien
que son importance soit actuellement limitée, la naissance
d'une gauche militante et révolutionnaire aux États-Unis
représente un changement d'une grande portée dans la poli-
ennuyeuse menaçant les consommateurs occidentaux, mais
une lutte héroïque de gens affamés et exploités qui se battent
pour avoir une existence humaine qui leur est refusée par
l'impérialisme et ses laquais. Ce n'est plus un modèle social
étranger, mais une inspiration idéologique immédiate, une
source d'émulation. La révolution vietnamienne a donc fait
ce qu'aucune force politique ou économique au monde n'a pu
accomplir en trente ans : Elle a disloqué l'unité de la société
américaine et y a enfin réactivé ses propres contradictions.
Le changement potentiel dans la lutte des classes internatio-
nale que cela représente est énorme et n'est peut-être pas
encore perçu par ceux qui se sont habitués à un monde où
le bastion de l'impérialisme était un bloc monolithique. Bien
que son importance soit actuellement limitée, la naissance
d'une gauche militante et révolutionnaire aux États-Unis
représente un changement d'une grande portée dans la poli-
i. On peut ajouter que l'abandon de la comparaison entre l'accumulation
socialiste et l'abondance capitaliste a été accompagné en Chine, à Cuba
et au Nord-Viêt-nam d'une nouvelle insistance théorique et politique sur
l'égalitarisme économique (critiqué par l'Union Soviétique dans les
années trente). La Révolution culturelle, la construction simultanée
du socialisme et du communisme à Cuba et l'économie de guerre de la
R.D.V. ont en commun cette préoccupation.
socialiste et l'abondance capitaliste a été accompagné en Chine, à Cuba
et au Nord-Viêt-nam d'une nouvelle insistance théorique et politique sur
l'égalitarisme économique (critiqué par l'Union Soviétique dans les
années trente). La Révolution culturelle, la construction simultanée
du socialisme et du communisme à Cuba et l'économie de guerre de la
R.D.V. ont en commun cette préoccupation.
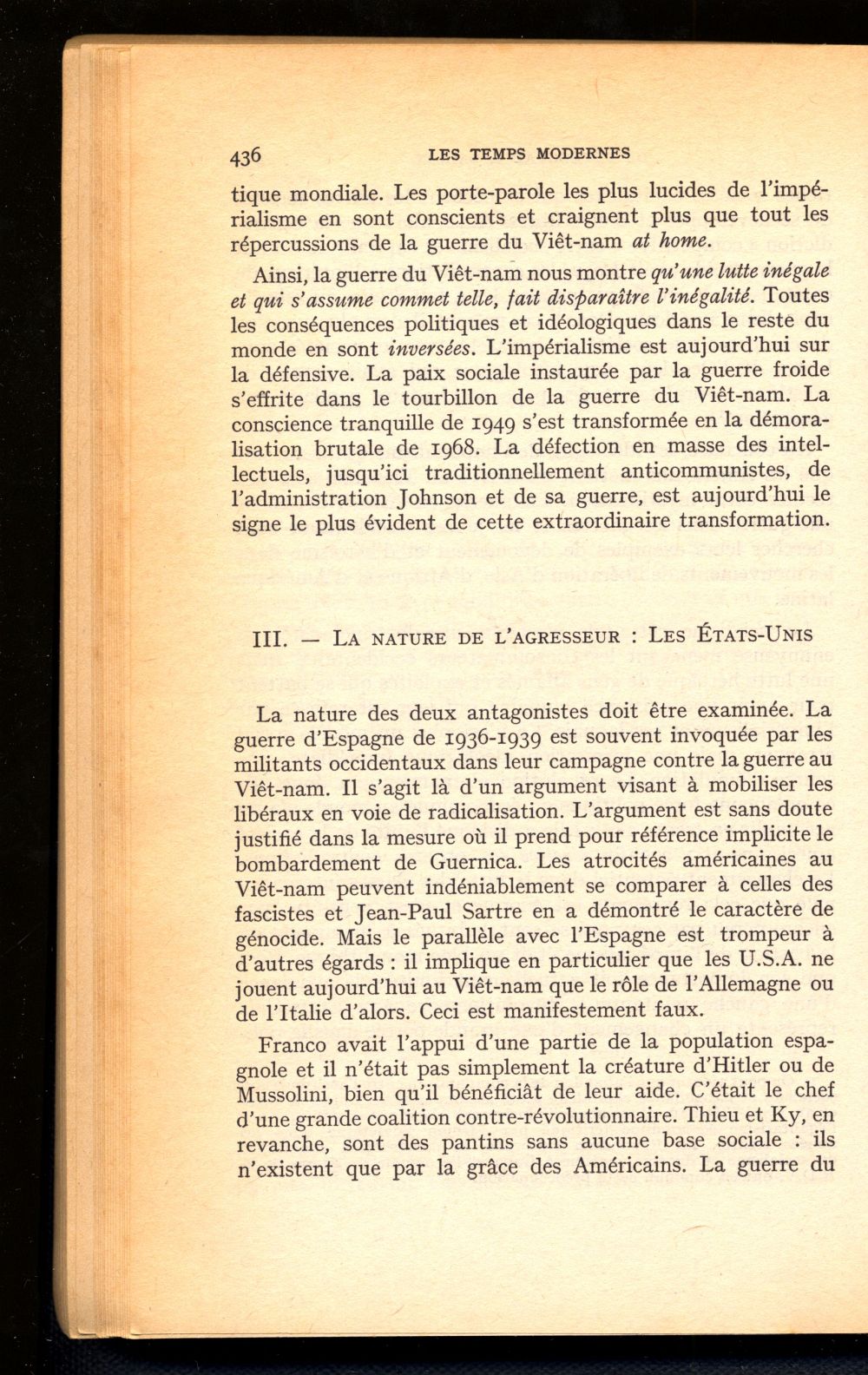

436 LES TEMPS MODERNES
tique mondiale. Les porte-parole les plus lucides de l'impé-
rialisme en sont conscients et craignent plus que tout les
répercussions de la guerre du Viêt-nam at home.
rialisme en sont conscients et craignent plus que tout les
répercussions de la guerre du Viêt-nam at home.
Ainsi, la guerre du Viêt-nam nous montre qu'une lutte inégale
et qui s'assume commet telle, fait disparaître l'inégalité. Toutes
les conséquences politiques et idéologiques dans le reste du
monde en sont inversées. L'impérialisme est aujourd'hui sur
la défensive. La paix sociale instaurée par la guerre froide
s'effrite dans le tourbillon de la guerre du Viêt-nam. La
conscience tranquille de 1949 s'est transformée en la démora-
lisation brutale de 1968. La défection en masse des intel-
lectuels, jusqu'ici traditionnellement anticommunistes, de
l'administration Johnson et de sa guerre, est aujourd'hui le
signe le plus évident de cette extraordinaire transformation.
et qui s'assume commet telle, fait disparaître l'inégalité. Toutes
les conséquences politiques et idéologiques dans le reste du
monde en sont inversées. L'impérialisme est aujourd'hui sur
la défensive. La paix sociale instaurée par la guerre froide
s'effrite dans le tourbillon de la guerre du Viêt-nam. La
conscience tranquille de 1949 s'est transformée en la démora-
lisation brutale de 1968. La défection en masse des intel-
lectuels, jusqu'ici traditionnellement anticommunistes, de
l'administration Johnson et de sa guerre, est aujourd'hui le
signe le plus évident de cette extraordinaire transformation.
III. — LA NATURE DE I/AGRESSEUR : LES ÉTATS-UNIS
La nature des deux antagonistes doit être examinée. La
guerre d'Espagne de 1936-1939 est souvent invoquée par les
militants occidentaux dans leur campagne contre la guerre au
Viêt-nam. Il s'agit là d'un argument visant à mobiliser les
libéraux en voie de radicalisation. L'argument est sans doute
justifié dans la mesure où il prend pour référence implicite le
bombardement de Guernica. Les atrocités américaines au
Viêt-nam peuvent indéniablement se comparer à celles des
fascistes et Jean-Paul Sartre en a démontré le caractère de
génocide. Mais le parallèle avec l'Espagne est trompeur à
d'autres égards : il implique en particulier que les U.S.A. ne
jouent aujourd'hui au Viêt-nam que le rôle de l'Allemagne ou
de l'Italie d'alors. Ceci est manifestement faux.
guerre d'Espagne de 1936-1939 est souvent invoquée par les
militants occidentaux dans leur campagne contre la guerre au
Viêt-nam. Il s'agit là d'un argument visant à mobiliser les
libéraux en voie de radicalisation. L'argument est sans doute
justifié dans la mesure où il prend pour référence implicite le
bombardement de Guernica. Les atrocités américaines au
Viêt-nam peuvent indéniablement se comparer à celles des
fascistes et Jean-Paul Sartre en a démontré le caractère de
génocide. Mais le parallèle avec l'Espagne est trompeur à
d'autres égards : il implique en particulier que les U.S.A. ne
jouent aujourd'hui au Viêt-nam que le rôle de l'Allemagne ou
de l'Italie d'alors. Ceci est manifestement faux.
Franco avait l'appui d'une partie de la population espa-
gnole et il n'était pas simplement la créature d'Hitler ou de
Mussolini, bien qu'il bénéficiât de leur aide. C'était le chef
d'une grande coalition contre-révolutionnaire. Thieu et Ky, en
revanche, sont des pantins sans aucune base sociale : ils
n'existent que par la grâce des Américains. La guerre du
gnole et il n'était pas simplement la créature d'Hitler ou de
Mussolini, bien qu'il bénéficiât de leur aide. C'était le chef
d'une grande coalition contre-révolutionnaire. Thieu et Ky, en
revanche, sont des pantins sans aucune base sociale : ils
n'existent que par la grâce des Américains. La guerre du
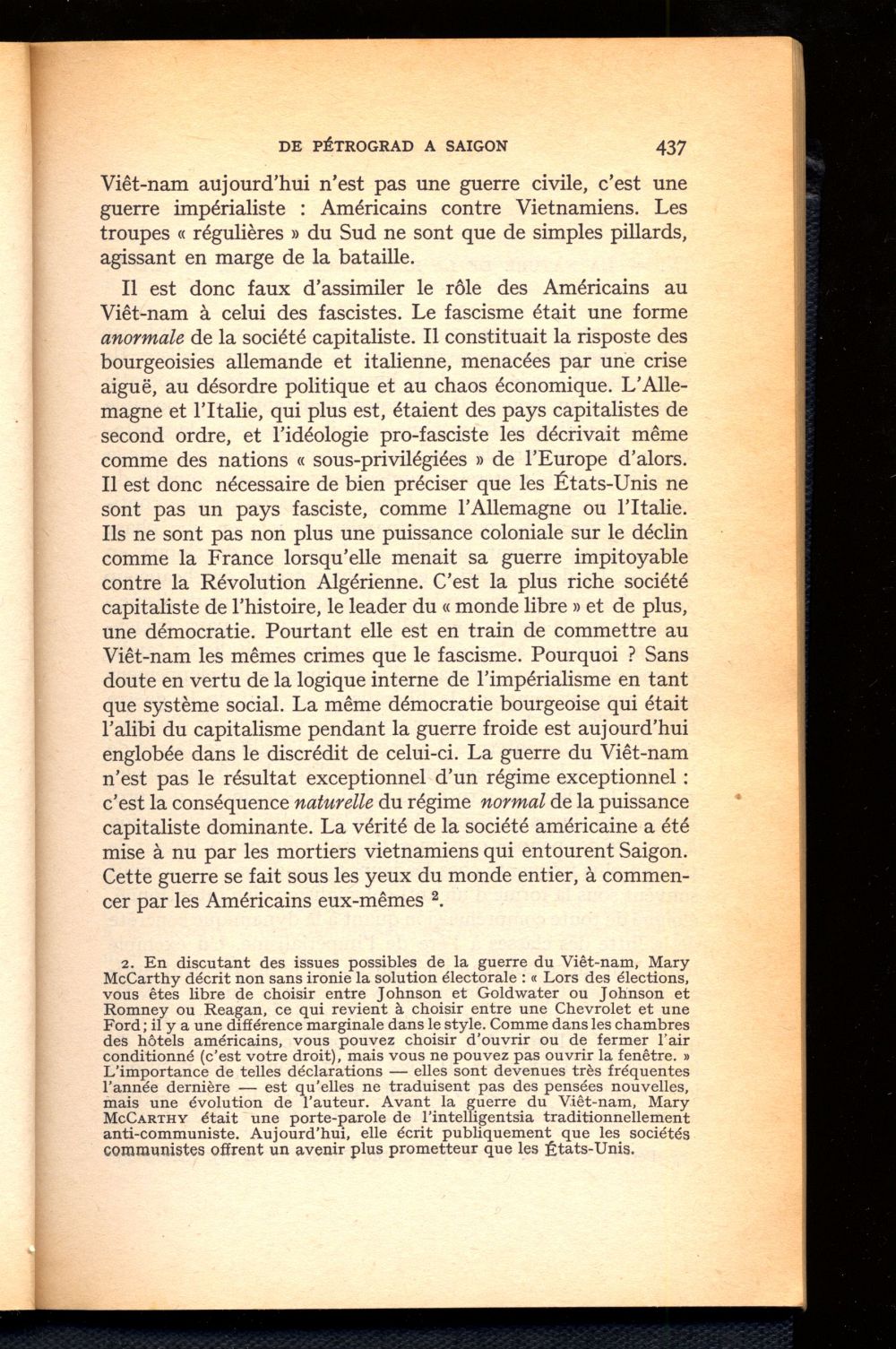

DE PÉTROGRAD A SAIGON
437
Viêt-nam aujourd'hui n'est pas une guerre civile, c'est une
guerre impérialiste : Américains contre Vietnamiens. Les
troupes « régulières » du Sud ne sont que de simples pillards,
agissant en marge de la bataille.
guerre impérialiste : Américains contre Vietnamiens. Les
troupes « régulières » du Sud ne sont que de simples pillards,
agissant en marge de la bataille.
Il est donc faux d'assimiler le rôle des Américains au
Viêt-nam à celui des fascistes. Le fascisme était une forme
anormale de la société capitaliste. Il constituait la risposte des
bourgeoisies allemande et italienne, menacées par une crise
aiguë, au désordre politique et au chaos économique. L'Alle-
magne et l'Italie, qui plus est, étaient des pays capitalistes de
second ordre, et l'idéologie pro-fasciste les décrivait même
comme des nations « sous-privilégiées » de l'Europe d'alors.
Il est donc nécessaire de bien préciser que les États-Unis ne
sont pas un pays fasciste, comme l'Allemagne ou l'Italie.
Ils ne sont pas non plus une puissance coloniale sur le déclin
comme la France lorsqu'elle menait sa guerre impitoyable
contre la Révolution Algérienne. C'est la plus riche société
capitaliste de l'histoire, le leader du « monde libre » et de plus,
une démocratie. Pourtant elle est en train de commettre au
Viêt-nam les mêmes crimes que le fascisme. Pourquoi ? Sans
doute en vertu de la logique interne de l'impérialisme en tant
que système social. La même démocratie bourgeoise qui était
l'alibi du capitalisme pendant la guerre froide est aujourd'hui
englobée dans le discrédit de celui-ci. La guerre du Viêt-nam
n'est pas le résultat exceptionnel d'un régime exceptionnel :
c'est la conséquence naturelle du régime normal de la puissance
capitaliste dominante. La vérité de la société américaine a été
mise à nu par les mortiers vietnamiens qui entourent Saigon.
Cette guerre se fait sous les yeux du monde entier, à commen-
cer par les Américains eux-mêmes 2.
Viêt-nam à celui des fascistes. Le fascisme était une forme
anormale de la société capitaliste. Il constituait la risposte des
bourgeoisies allemande et italienne, menacées par une crise
aiguë, au désordre politique et au chaos économique. L'Alle-
magne et l'Italie, qui plus est, étaient des pays capitalistes de
second ordre, et l'idéologie pro-fasciste les décrivait même
comme des nations « sous-privilégiées » de l'Europe d'alors.
Il est donc nécessaire de bien préciser que les États-Unis ne
sont pas un pays fasciste, comme l'Allemagne ou l'Italie.
Ils ne sont pas non plus une puissance coloniale sur le déclin
comme la France lorsqu'elle menait sa guerre impitoyable
contre la Révolution Algérienne. C'est la plus riche société
capitaliste de l'histoire, le leader du « monde libre » et de plus,
une démocratie. Pourtant elle est en train de commettre au
Viêt-nam les mêmes crimes que le fascisme. Pourquoi ? Sans
doute en vertu de la logique interne de l'impérialisme en tant
que système social. La même démocratie bourgeoise qui était
l'alibi du capitalisme pendant la guerre froide est aujourd'hui
englobée dans le discrédit de celui-ci. La guerre du Viêt-nam
n'est pas le résultat exceptionnel d'un régime exceptionnel :
c'est la conséquence naturelle du régime normal de la puissance
capitaliste dominante. La vérité de la société américaine a été
mise à nu par les mortiers vietnamiens qui entourent Saigon.
Cette guerre se fait sous les yeux du monde entier, à commen-
cer par les Américains eux-mêmes 2.
2. En discutant des issues possibles de la guerre du Viêt-nam, Mary
McCarthy décrit non sans ironie la solution électorale : « Lors des élections,
vous êtes libre de choisir entre Johnson et Goldwater ou Johnson et
Romney ou Reagan, ce qui revient à choisir entre une Chevrolet et une
Ford ; il y a une différence marginale dans le style. Comme dans les chambres
des hôtels américains, vous pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer l'air
conditionné (c'est votre droit), mais vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. »
L'importance de telles déclarations — elles sont devenues très fréquentes
l'année dernière •— est qu'elles ne traduisent pas des pensées nouvelles,
mais une évolution de l'auteur. Avant la guerre du Viêt-nam, Mary
MCCARTHY était une porte-parole de l'intelligentsia traditionnellement
anti-communiste. Aujourd'hui, elle écrit publiquement que les sociétés
communistes offrent un avenir plus prometteur que les États-Unis.
McCarthy décrit non sans ironie la solution électorale : « Lors des élections,
vous êtes libre de choisir entre Johnson et Goldwater ou Johnson et
Romney ou Reagan, ce qui revient à choisir entre une Chevrolet et une
Ford ; il y a une différence marginale dans le style. Comme dans les chambres
des hôtels américains, vous pouvez choisir d'ouvrir ou de fermer l'air
conditionné (c'est votre droit), mais vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. »
L'importance de telles déclarations — elles sont devenues très fréquentes
l'année dernière •— est qu'elles ne traduisent pas des pensées nouvelles,
mais une évolution de l'auteur. Avant la guerre du Viêt-nam, Mary
MCCARTHY était une porte-parole de l'intelligentsia traditionnellement
anti-communiste. Aujourd'hui, elle écrit publiquement que les sociétés
communistes offrent un avenir plus prometteur que les États-Unis.
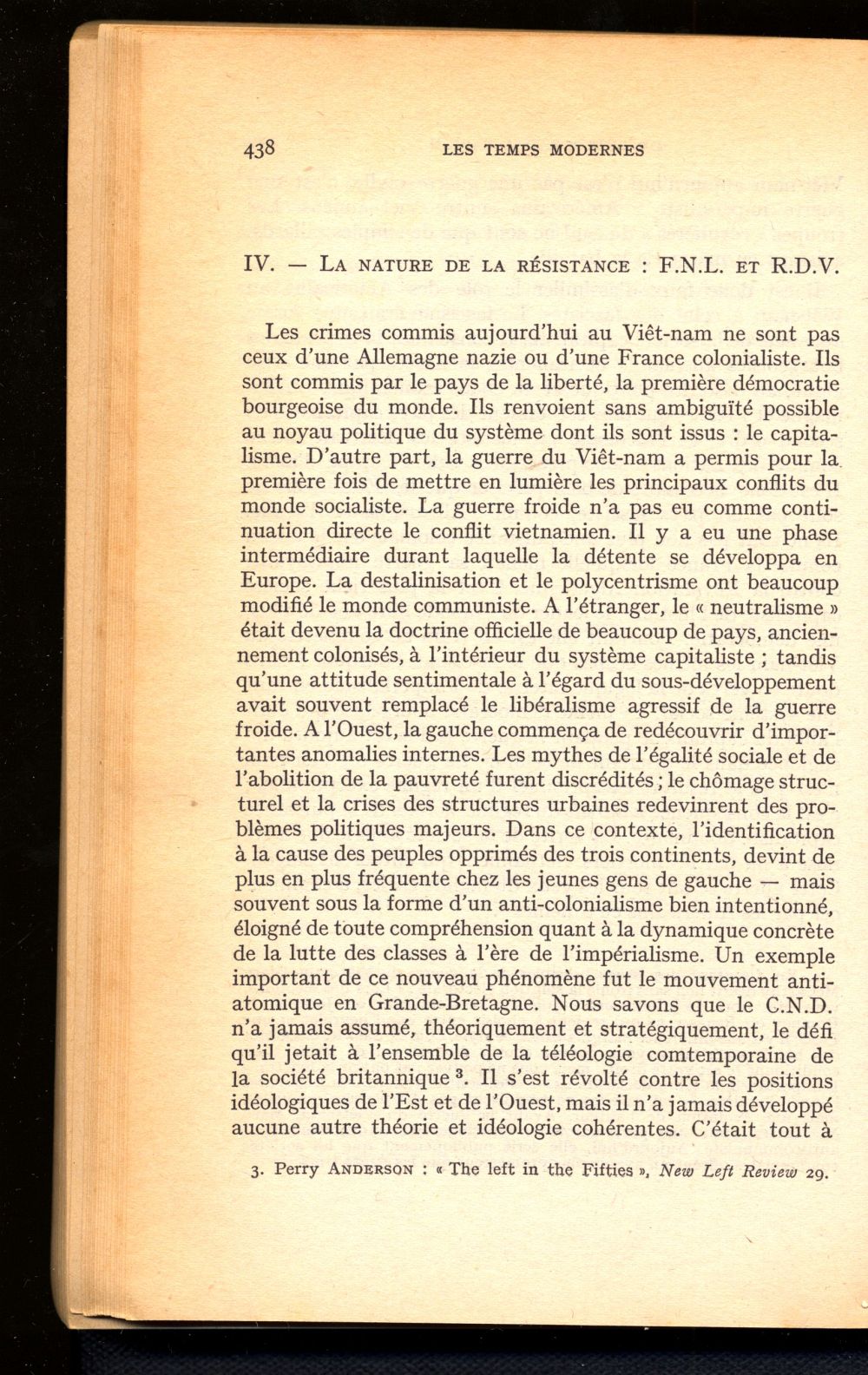

438
LES TEMPS MODERNES
IV. — LA NATURE DE LA RÉSISTANCE : F.N.L. ET R.D.V.
Les crimes commis aujourd'hui au Viêt-nam ne sont pas
ceux d'une Allemagne nazie ou d'une France colonialiste. Ils
sont commis par le pays de la liberté, la première démocratie
bourgeoise du monde. Ils renvoient sans ambiguïté possible
au noyau politique du système dont ils sont issus : le capita-
lisme. D'autre part, la guerre du Viêt-nam a permis pour la
première fois de mettre en lumière les principaux conflits du
monde socialiste. La guerre froide n'a pas eu comme conti-
nuation directe le conflit vietnamien. Il y a eu une phase
intermédiaire durant laquelle la détente se développa en
Europe. La destalinisation et le polycentrisme ont beaucoup
modifié le monde communiste. A l'étranger, le « neutralisme »
était devenu la doctrine officielle de beaucoup de pays, ancien-
nement colonisés, à l'intérieur du système capitaliste ; tandis
qu'une attitude sentimentale à l'égard du sous-développement
avait souvent remplacé le libéralisme agressif de la guerre
froide. A l'Ouest, la gauche commença de redécouvrir d'impor-
tantes anomalies internes. Les mythes de l'égalité sociale et de
l'abolition de la pauvreté furent discrédités ; le chômage struc-
turel et la crises des structures urbaines redevinrent des pro-
blèmes politiques majeurs. Dans ce contexte, l'identification
à la cause des peuples opprimés des trois continents, devint de
plus en plus fréquente chez les jeunes gens de gauche — mais
souvent sous la forme d'un anti-colonialisme bien intentionné,
éloigné de toute compréhension quant à la dynamique concrète
de la lutte des classes à l'ère de l'impérialisme. Un exemple
important de ce nouveau phénomène fut le mouvement anti-
atomique en Grande-Bretagne. Nous savons que le C.N.D.
n'a jamais assumé, théoriquement et stratégiquement, le défi
qu'il jetait à l'ensemble de la téléologie comtemporaine de
la société britannique 3. Il s'est révolté contre les positions
idéologiques de l'Est et de l'Ouest, mais il n'a jamais développé
aucune autre théorie et idéologie cohérentes. C'était tout à
ceux d'une Allemagne nazie ou d'une France colonialiste. Ils
sont commis par le pays de la liberté, la première démocratie
bourgeoise du monde. Ils renvoient sans ambiguïté possible
au noyau politique du système dont ils sont issus : le capita-
lisme. D'autre part, la guerre du Viêt-nam a permis pour la
première fois de mettre en lumière les principaux conflits du
monde socialiste. La guerre froide n'a pas eu comme conti-
nuation directe le conflit vietnamien. Il y a eu une phase
intermédiaire durant laquelle la détente se développa en
Europe. La destalinisation et le polycentrisme ont beaucoup
modifié le monde communiste. A l'étranger, le « neutralisme »
était devenu la doctrine officielle de beaucoup de pays, ancien-
nement colonisés, à l'intérieur du système capitaliste ; tandis
qu'une attitude sentimentale à l'égard du sous-développement
avait souvent remplacé le libéralisme agressif de la guerre
froide. A l'Ouest, la gauche commença de redécouvrir d'impor-
tantes anomalies internes. Les mythes de l'égalité sociale et de
l'abolition de la pauvreté furent discrédités ; le chômage struc-
turel et la crises des structures urbaines redevinrent des pro-
blèmes politiques majeurs. Dans ce contexte, l'identification
à la cause des peuples opprimés des trois continents, devint de
plus en plus fréquente chez les jeunes gens de gauche — mais
souvent sous la forme d'un anti-colonialisme bien intentionné,
éloigné de toute compréhension quant à la dynamique concrète
de la lutte des classes à l'ère de l'impérialisme. Un exemple
important de ce nouveau phénomène fut le mouvement anti-
atomique en Grande-Bretagne. Nous savons que le C.N.D.
n'a jamais assumé, théoriquement et stratégiquement, le défi
qu'il jetait à l'ensemble de la téléologie comtemporaine de
la société britannique 3. Il s'est révolté contre les positions
idéologiques de l'Est et de l'Ouest, mais il n'a jamais développé
aucune autre théorie et idéologie cohérentes. C'était tout à
3. Perry ANDERSON : « The left in thé Fifties », New Lefl Review 29.
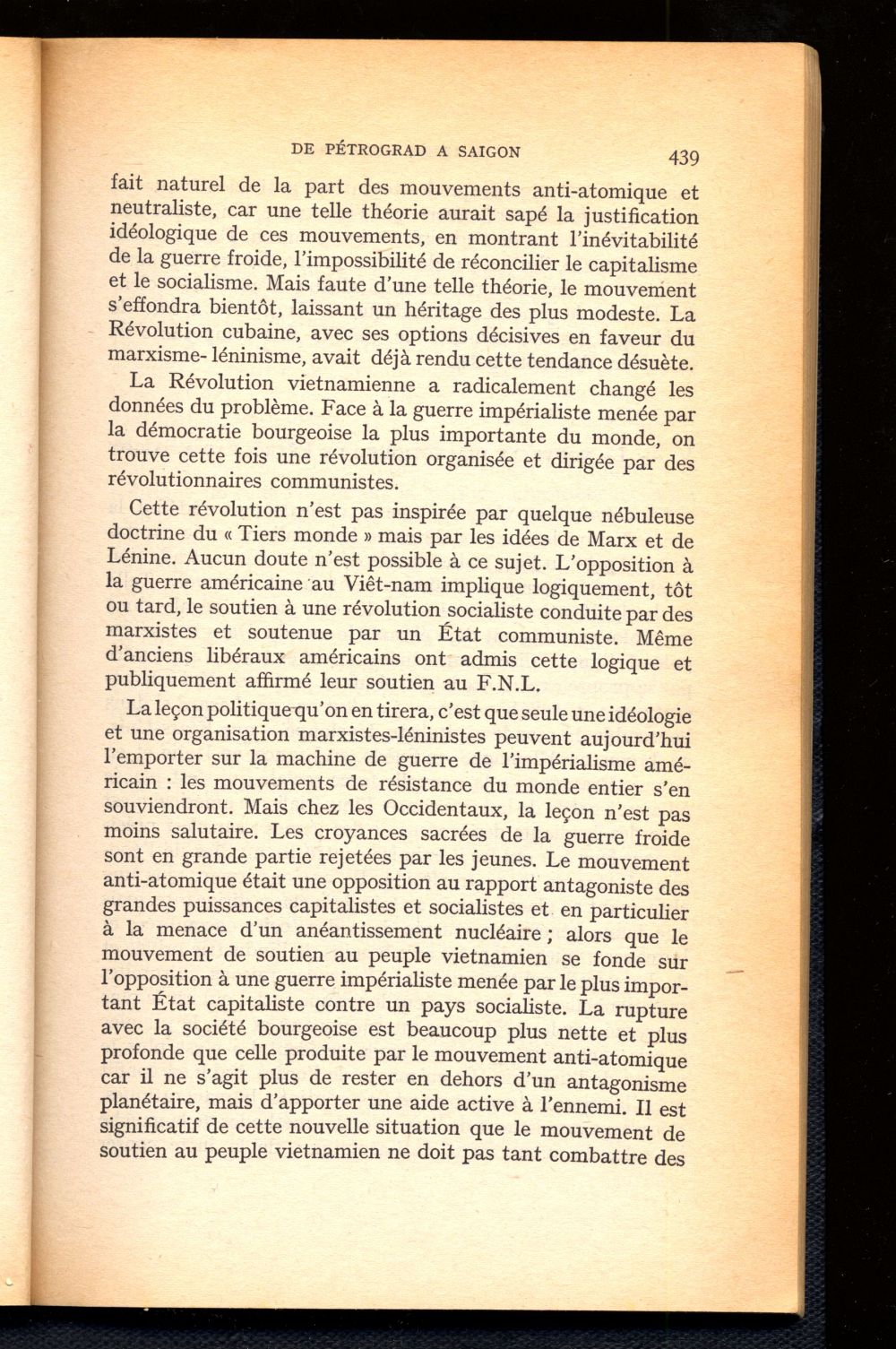

DE PETROGRAD A SAIGON
439
fait naturel de la part des mouvements anti-atomique et
neutraliste, car une telle théorie aurait sapé la justification
idéologique de ces mouvements, en montrant l'inévitabilité
de la guerre froide, l'impossibilité de réconcilier le capitalisme
et le socialisme. Mais faute d'une telle théorie, le mouvement
s'effondra bientôt, laissant un héritage des plus modeste. La
Révolution cubaine, avec ses options décisives en faveur du
marxisme- léninisme, avait déjà rendu cette tendance désuète.
neutraliste, car une telle théorie aurait sapé la justification
idéologique de ces mouvements, en montrant l'inévitabilité
de la guerre froide, l'impossibilité de réconcilier le capitalisme
et le socialisme. Mais faute d'une telle théorie, le mouvement
s'effondra bientôt, laissant un héritage des plus modeste. La
Révolution cubaine, avec ses options décisives en faveur du
marxisme- léninisme, avait déjà rendu cette tendance désuète.
La Révolution vietnamienne a radicalement changé les
données du problème. Face à la guerre impérialiste menée par
la démocratie bourgeoise la plus importante du monde, on
trouve cette fois une révolution organisée et dirigée par des
révolutionnaires communistes.
données du problème. Face à la guerre impérialiste menée par
la démocratie bourgeoise la plus importante du monde, on
trouve cette fois une révolution organisée et dirigée par des
révolutionnaires communistes.
Cette révolution n'est pas inspirée par quelque nébuleuse
doctrine du « Tiers monde » mais par les idées de Marx et de
Lénine. Aucun doute n'est possible à ce sujet. L'opposition à
la guerre américaine au Viêt-nam implique logiquement, tôt
ou tard, le soutien à une révolution socialiste conduite par des
marxistes et soutenue par un État communiste. Même
d'anciens libéraux américains ont admis cette logique et
publiquement affirmé leur soutien au F.N.L.
doctrine du « Tiers monde » mais par les idées de Marx et de
Lénine. Aucun doute n'est possible à ce sujet. L'opposition à
la guerre américaine au Viêt-nam implique logiquement, tôt
ou tard, le soutien à une révolution socialiste conduite par des
marxistes et soutenue par un État communiste. Même
d'anciens libéraux américains ont admis cette logique et
publiquement affirmé leur soutien au F.N.L.
La leçon politique qu'on en tirera, c'est que seule une idéologie
et une organisation marxistes-léninistes peuvent aujourd'hui
l'emporter sur la machine de guerre de l'impérialisme amé-
ricain : les mouvements de résistance du monde entier s'en
souviendront. Mais chez les Occidentaux, la leçon n'est pas
moins salutaire. Les croyances sacrées de la guerre froide
sont en grande partie rejetées par les jeunes. Le mouvement
anti-atomique était une opposition au rapport antagoniste des
grandes puissances capitalistes et socialistes et en particulier
à la menace d'un anéantissement nucléaire ; alors que le
mouvement de soutien au peuple vietnamien se fonde sur
l'opposition à une guerre impérialiste menée par le plus impor-
tant État capitaliste contre un pays socialiste. La rupture
avec la société bourgeoise est beaucoup plus nette et plus
profonde que celle produite par le mouvement anti-atomique
car il ne s'agit plus de rester en dehors d'un antagonisme
planétaire, mais d'apporter une aide active à l'ennemi. Il est
significatif de cette nouvelle situation que le mouvement de
soutien au peuple vietnamien ne doit pas tant combattre des
et une organisation marxistes-léninistes peuvent aujourd'hui
l'emporter sur la machine de guerre de l'impérialisme amé-
ricain : les mouvements de résistance du monde entier s'en
souviendront. Mais chez les Occidentaux, la leçon n'est pas
moins salutaire. Les croyances sacrées de la guerre froide
sont en grande partie rejetées par les jeunes. Le mouvement
anti-atomique était une opposition au rapport antagoniste des
grandes puissances capitalistes et socialistes et en particulier
à la menace d'un anéantissement nucléaire ; alors que le
mouvement de soutien au peuple vietnamien se fonde sur
l'opposition à une guerre impérialiste menée par le plus impor-
tant État capitaliste contre un pays socialiste. La rupture
avec la société bourgeoise est beaucoup plus nette et plus
profonde que celle produite par le mouvement anti-atomique
car il ne s'agit plus de rester en dehors d'un antagonisme
planétaire, mais d'apporter une aide active à l'ennemi. Il est
significatif de cette nouvelle situation que le mouvement de
soutien au peuple vietnamien ne doit pas tant combattre des
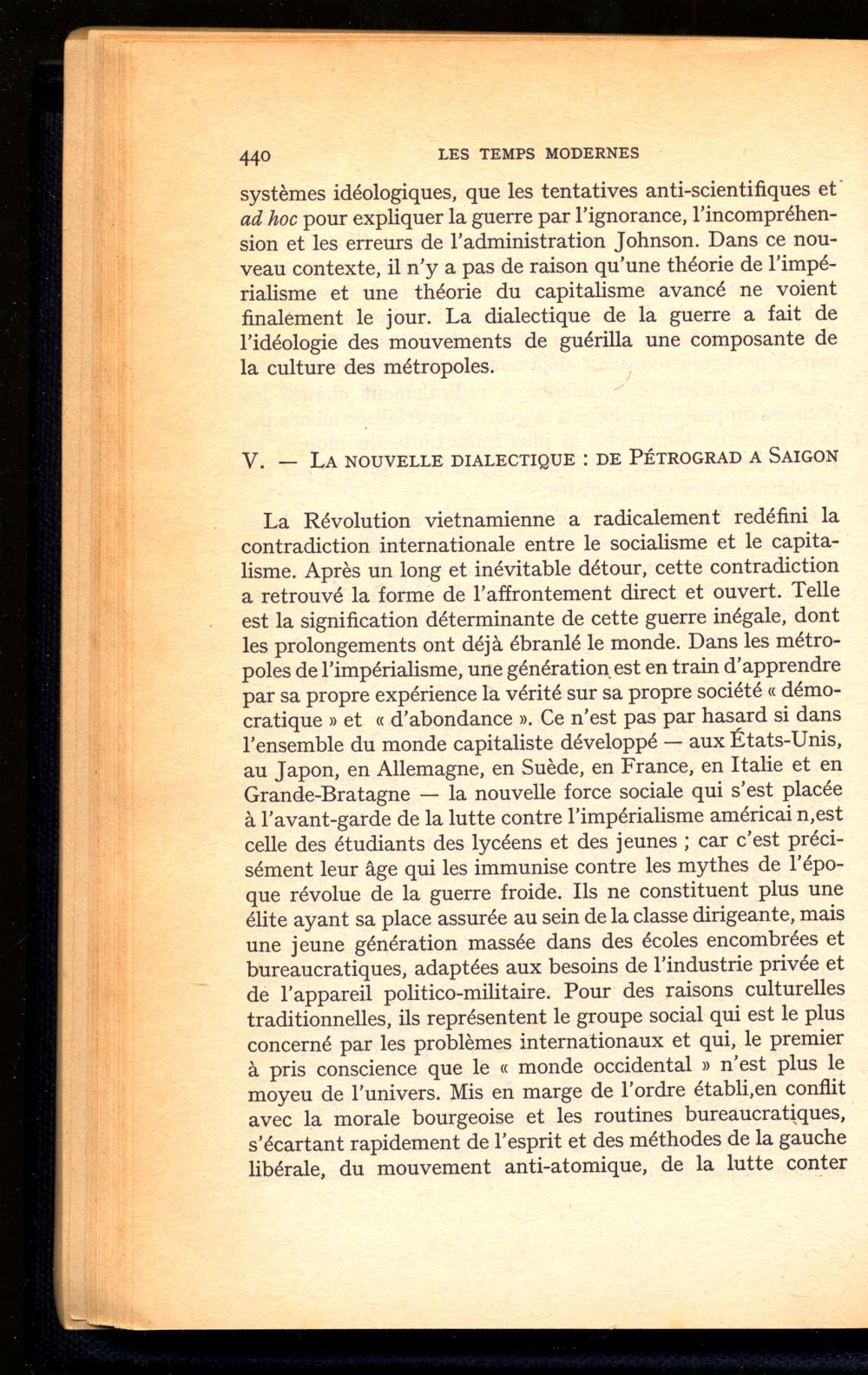

440
LES TEMPS MODERNES
systèmes idéologiques, que les tentatives anti-scientifiques et
ad hoc pour expliquer la guerre par l'ignorance, l'incompréhen-
sion et les erreurs de l'administration Johnson. Dans ce nou-
veau contexte, il n'y a pas de raison qu'une théorie de l'impé-
rialisme et une théorie du capitalisme avancé ne voient
finalement le jour. La dialectique de la guerre a fait de
l'idéologie des mouvements de guérilla une composante de
la culture des métropoles.
ad hoc pour expliquer la guerre par l'ignorance, l'incompréhen-
sion et les erreurs de l'administration Johnson. Dans ce nou-
veau contexte, il n'y a pas de raison qu'une théorie de l'impé-
rialisme et une théorie du capitalisme avancé ne voient
finalement le jour. La dialectique de la guerre a fait de
l'idéologie des mouvements de guérilla une composante de
la culture des métropoles.
V. — LA NOUVELLE DIALECTIQUE : DE PÉTROGRAD A SAIGON
La Révolution vietnamienne a radicalement redéfini la
contradiction internationale entre le socialisme et le capita-
lisme. Après un long et inévitable détour, cette contradiction
a retrouvé la forme de l'affrontement direct et ouvert. Telle
est la signification déterminante de cette guerre inégale, dont
les prolongements ont déjà ébranlé le monde. Dans les métro-
poles de l'impérialisme, une génération est en train d'apprendre
par sa propre expérience la vérité sur sa propre société « démo-
cratique » et « d'abondance ». Ce n'est pas par hasard si dans
l'ensemble du monde capitaliste développé — aux États-Unis,
au Japon, en Allemagne, en Suède, en France, en Italie et en
Grande-Bratagne — la nouvelle force sociale qui s'est placée
à l'avant-garde de la lutte contre l'impérialisme américai n,est
celle des étudiants des lycéens et des jeunes ; car c'est préci-
sément leur âge qui les immunise contre les mythes de l'épo-
que révolue de la guerre froide. Ils ne constituent plus une
élite ayant sa place assurée au sein de la classe dirigeante, mais
une jeune génération massée dans des écoles encombrées et
bureaucratiques, adaptées aux besoins de l'industrie privée et
de l'appareil politico-militaire. Pour des raisons culturelles
traditionnelles, ils représentent le groupe social qui est le plus
concerné par les problèmes internationaux et qui, le premier
à pris conscience que le « monde occidental » n'est plus le
moyeu de l'univers. Mis en marge de l'ordre établi,en conflit
avec la morale bourgeoise et les routines bureaucratiques,
s'écartant rapidement de l'esprit et des méthodes de la gauche
libérale, du mouvement anti-atomique, de la lutte conter
contradiction internationale entre le socialisme et le capita-
lisme. Après un long et inévitable détour, cette contradiction
a retrouvé la forme de l'affrontement direct et ouvert. Telle
est la signification déterminante de cette guerre inégale, dont
les prolongements ont déjà ébranlé le monde. Dans les métro-
poles de l'impérialisme, une génération est en train d'apprendre
par sa propre expérience la vérité sur sa propre société « démo-
cratique » et « d'abondance ». Ce n'est pas par hasard si dans
l'ensemble du monde capitaliste développé — aux États-Unis,
au Japon, en Allemagne, en Suède, en France, en Italie et en
Grande-Bratagne — la nouvelle force sociale qui s'est placée
à l'avant-garde de la lutte contre l'impérialisme américai n,est
celle des étudiants des lycéens et des jeunes ; car c'est préci-
sément leur âge qui les immunise contre les mythes de l'épo-
que révolue de la guerre froide. Ils ne constituent plus une
élite ayant sa place assurée au sein de la classe dirigeante, mais
une jeune génération massée dans des écoles encombrées et
bureaucratiques, adaptées aux besoins de l'industrie privée et
de l'appareil politico-militaire. Pour des raisons culturelles
traditionnelles, ils représentent le groupe social qui est le plus
concerné par les problèmes internationaux et qui, le premier
à pris conscience que le « monde occidental » n'est plus le
moyeu de l'univers. Mis en marge de l'ordre établi,en conflit
avec la morale bourgeoise et les routines bureaucratiques,
s'écartant rapidement de l'esprit et des méthodes de la gauche
libérale, du mouvement anti-atomique, de la lutte conter
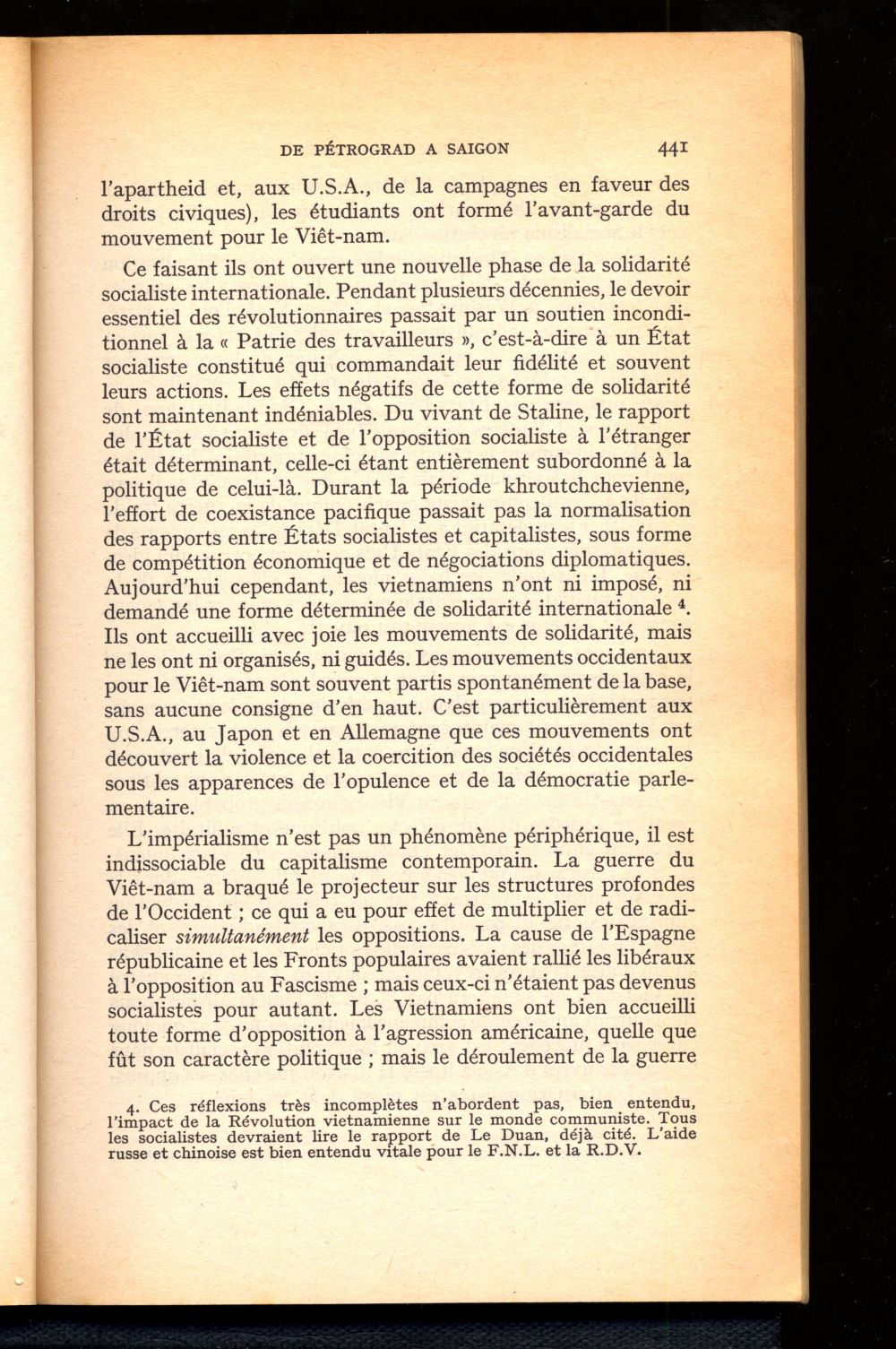

DE PÉTROGRAD A SAIGON
441
l'apartheid et, aux U.S.A., de la campagnes en faveur des
droits civiques), les étudiants ont formé l'avant-garde du
mouvement pour le Viêt-nam.
droits civiques), les étudiants ont formé l'avant-garde du
mouvement pour le Viêt-nam.
Ce faisant ils ont ouvert une nouvelle phase de la solidarité
socialiste internationale. Pendant plusieurs décennies, le devoir
essentiel des révolutionnaires passait par un soutien incondi-
tionnel à la « Patrie des travailleurs », c'est-à-dire à un État
socialiste constitué qui commandait leur fidélité et souvent
leurs actions. Les effets négatifs de cette forme de solidarité
sont maintenant indéniables. Du vivant de Staline, le rapport
de l'État socialiste et de l'opposition socialiste à l'étranger
était déterminant, celle-ci étant entièrement subordonné à la
politique de celui-là. Durant la période khroutchchevienne,
l'effort de coexistance pacifique passait pas la normalisation
des rapports entre États socialistes et capitalistes, sous forme
de compétition économique et de négociations diplomatiques.
Aujourd'hui cependant, les vietnamiens n'ont ni imposé, ni
demandé une forme déterminée de solidarité internationale 4.
Ils ont accueilli avec joie les mouvements de solidarité, mais
ne les ont ni organisés, ni guidés. Les mouvements occidentaux
pour le Viêt-nam sont souvent partis spontanément de la base,
sans aucune consigne d'en haut. C'est particulièrement aux
U.S.A., au Japon et en Allemagne que ces mouvements ont
découvert la violence et la coercition des sociétés occidentales
sous les apparences de l'opulence et de la démocratie parle-
mentaire.
socialiste internationale. Pendant plusieurs décennies, le devoir
essentiel des révolutionnaires passait par un soutien incondi-
tionnel à la « Patrie des travailleurs », c'est-à-dire à un État
socialiste constitué qui commandait leur fidélité et souvent
leurs actions. Les effets négatifs de cette forme de solidarité
sont maintenant indéniables. Du vivant de Staline, le rapport
de l'État socialiste et de l'opposition socialiste à l'étranger
était déterminant, celle-ci étant entièrement subordonné à la
politique de celui-là. Durant la période khroutchchevienne,
l'effort de coexistance pacifique passait pas la normalisation
des rapports entre États socialistes et capitalistes, sous forme
de compétition économique et de négociations diplomatiques.
Aujourd'hui cependant, les vietnamiens n'ont ni imposé, ni
demandé une forme déterminée de solidarité internationale 4.
Ils ont accueilli avec joie les mouvements de solidarité, mais
ne les ont ni organisés, ni guidés. Les mouvements occidentaux
pour le Viêt-nam sont souvent partis spontanément de la base,
sans aucune consigne d'en haut. C'est particulièrement aux
U.S.A., au Japon et en Allemagne que ces mouvements ont
découvert la violence et la coercition des sociétés occidentales
sous les apparences de l'opulence et de la démocratie parle-
mentaire.
L'impérialisme n'est pas un phénomène périphérique, il est
indissociable du capitalisme contemporain. La guerre du
Viêt-nam a braqué le projecteur sur les structures profondes
de l'Occident ; ce qui a eu pour effet de multiplier et de radi-
caliser simultanément les oppositions. La cause de l'Espagne
républicaine et les Fronts populaires avaient rallié les libéraux
à l'opposition au Fascisme ; mais ceux-ci n'étaient pas devenus
socialistes pour autant. Les Vietnamiens ont bien accueilli
toute forme d'opposition à l'agression américaine, quelle que
fût son caractère politique ; mais le déroulement de la guerre
indissociable du capitalisme contemporain. La guerre du
Viêt-nam a braqué le projecteur sur les structures profondes
de l'Occident ; ce qui a eu pour effet de multiplier et de radi-
caliser simultanément les oppositions. La cause de l'Espagne
républicaine et les Fronts populaires avaient rallié les libéraux
à l'opposition au Fascisme ; mais ceux-ci n'étaient pas devenus
socialistes pour autant. Les Vietnamiens ont bien accueilli
toute forme d'opposition à l'agression américaine, quelle que
fût son caractère politique ; mais le déroulement de la guerre
4. Ces réflexions très incomplètes n'abordent pas, bien entendu,
l'impact de la Révolution vietnamienne sur le monde communiste. Tous
les socialistes devraient lire le rapport de Le Duan, déjà cité. L'aide
russe et chinoise est bien entendu vitale pour le F.N.L. et la R.D.V.
l'impact de la Révolution vietnamienne sur le monde communiste. Tous
les socialistes devraient lire le rapport de Le Duan, déjà cité. L'aide
russe et chinoise est bien entendu vitale pour le F.N.L. et la R.D.V.
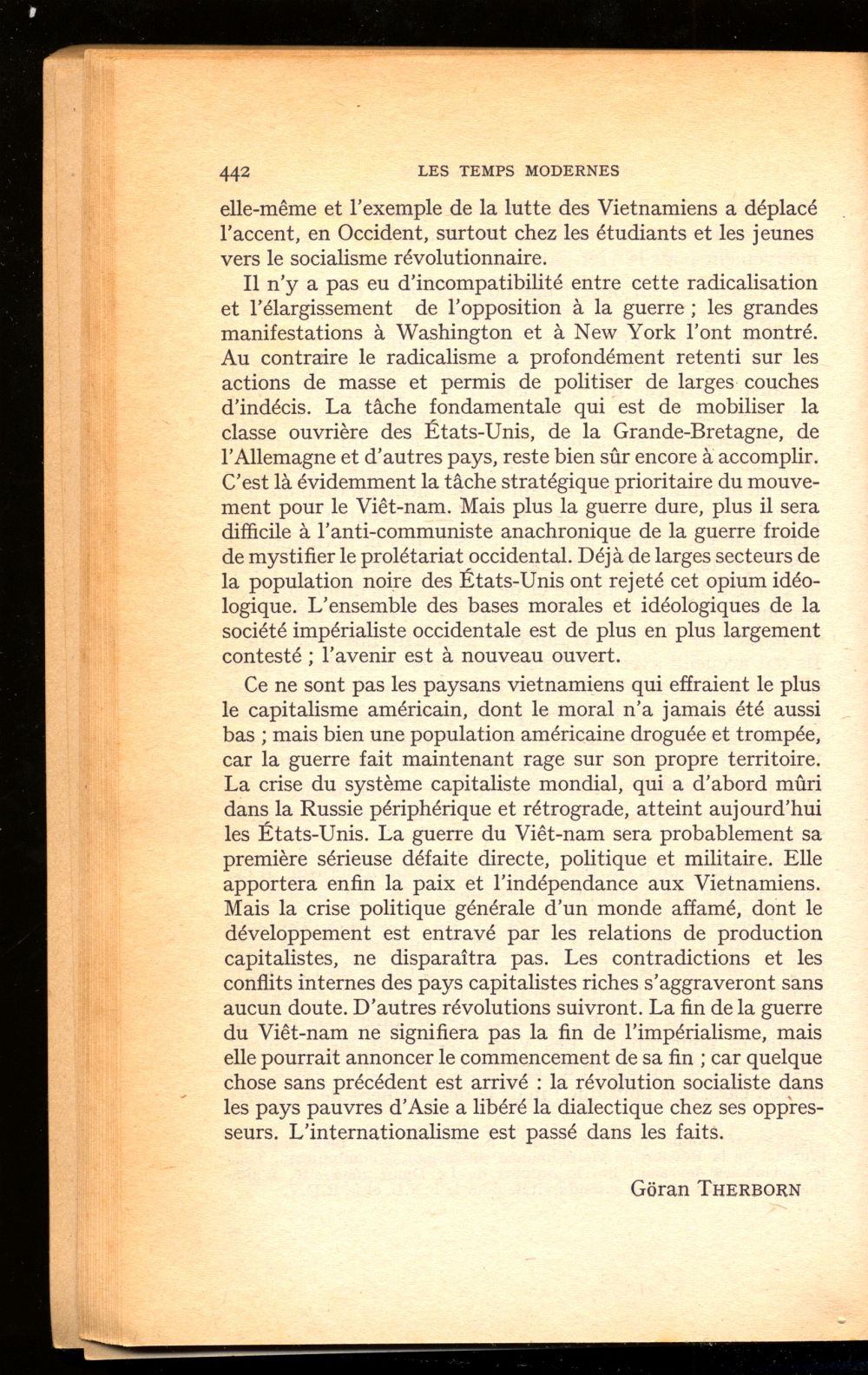

442 LES TEMPS MODERNES
elle-même et l'exemple de la lutte des Vietnamiens a déplacé
l'accent, en Occident, surtout chez les étudiants et les jeunes
vers le socialisme révolutionnaire.
l'accent, en Occident, surtout chez les étudiants et les jeunes
vers le socialisme révolutionnaire.
Il n'y a pas eu d'incompatibilité entre cette radicalisation
et l'élargissement de l'opposition à la guerre ; les grandes
manifestations à Washington et à New York l'ont montré.
Au contraire le radicalisme a profondément retenti sur les
actions de masse et permis de politiser de larges couches
d'indécis. La tâche fondamentale qui est de mobiliser la
classe ouvrière des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Allemagne et d'autres pays, reste bien sûr encore à accomplir.
C'est là évidemment la tâche stratégique prioritaire du mouve-
ment pour le Viêt-nam. Mais plus la guerre dure, plus il sera
difficile à l'anti-communiste anachronique de la guerre froide
de mystifier le prolétariat occidental. Déjà de larges secteurs de
la population noire des États-Unis ont rejeté cet opium idéo-
logique. L'ensemble des bases morales et idéologiques de la
société impérialiste occidentale est de plus en plus largement
contesté ; l'avenir est à nouveau ouvert.
et l'élargissement de l'opposition à la guerre ; les grandes
manifestations à Washington et à New York l'ont montré.
Au contraire le radicalisme a profondément retenti sur les
actions de masse et permis de politiser de larges couches
d'indécis. La tâche fondamentale qui est de mobiliser la
classe ouvrière des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Allemagne et d'autres pays, reste bien sûr encore à accomplir.
C'est là évidemment la tâche stratégique prioritaire du mouve-
ment pour le Viêt-nam. Mais plus la guerre dure, plus il sera
difficile à l'anti-communiste anachronique de la guerre froide
de mystifier le prolétariat occidental. Déjà de larges secteurs de
la population noire des États-Unis ont rejeté cet opium idéo-
logique. L'ensemble des bases morales et idéologiques de la
société impérialiste occidentale est de plus en plus largement
contesté ; l'avenir est à nouveau ouvert.
Ce ne sont pas les paysans vietnamiens qui effraient le plus
le capitalisme américain, dont le moral n'a jamais été aussi
bas ; mais bien une population américaine droguée et trompée,
car la guerre fait maintenant rage sur son propre territoire.
La crise du système capitaliste mondial, qui a d'abord mûri
dans la Russie périphérique et rétrograde, atteint aujourd'hui
les États-Unis. La guerre du Viêt-nam sera probablement sa
première sérieuse défaite directe, politique et militaire. Elle
apportera enfin la paix et l'indépendance aux Vietnamiens.
Mais la crise politique générale d'un monde affamé, dont le
développement est entravé par les relations de production
capitalistes, ne disparaîtra pas. Les contradictions et les
conflits internes des pays capitalistes riches s'aggraveront sans
aucun doute. D'autres révolutions suivront. La fin de la guerre
du Viêt-nam ne signifiera pas la fin de l'impérialisme, mais
elle pourrait annoncer le commencement de sa fin ; car quelque
chose sans précédent est arrivé : la révolution socialiste dans
les pays pauvres d'Asie a libéré la dialectique chez ses oppres-
seurs. L'internationalisme est passé dans les faits.
le capitalisme américain, dont le moral n'a jamais été aussi
bas ; mais bien une population américaine droguée et trompée,
car la guerre fait maintenant rage sur son propre territoire.
La crise du système capitaliste mondial, qui a d'abord mûri
dans la Russie périphérique et rétrograde, atteint aujourd'hui
les États-Unis. La guerre du Viêt-nam sera probablement sa
première sérieuse défaite directe, politique et militaire. Elle
apportera enfin la paix et l'indépendance aux Vietnamiens.
Mais la crise politique générale d'un monde affamé, dont le
développement est entravé par les relations de production
capitalistes, ne disparaîtra pas. Les contradictions et les
conflits internes des pays capitalistes riches s'aggraveront sans
aucun doute. D'autres révolutions suivront. La fin de la guerre
du Viêt-nam ne signifiera pas la fin de l'impérialisme, mais
elle pourrait annoncer le commencement de sa fin ; car quelque
chose sans précédent est arrivé : la révolution socialiste dans
les pays pauvres d'Asie a libéré la dialectique chez ses oppres-
seurs. L'internationalisme est passé dans les faits.
Gôran THERBORN
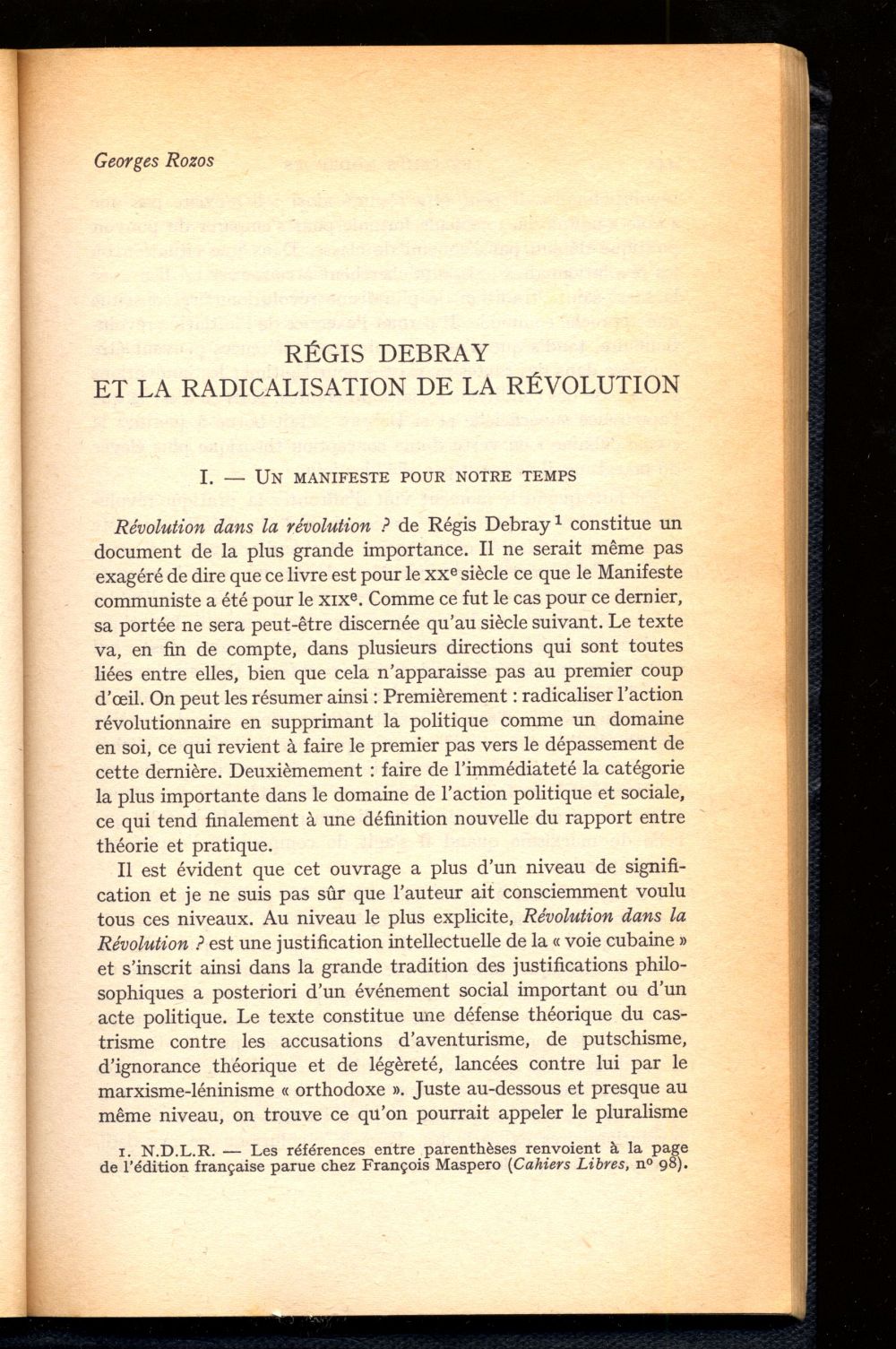

Georges Rozos
RÉGIS DEBRAY
ET LA RADICALISATION DE LA RÉVOLUTION
ET LA RADICALISATION DE LA RÉVOLUTION
I.
UN MANIFESTE POUR NOTRE TEMPS
Révolution dans la révolution ? de Régis Debray1 constitue un
document de la plus grande importance. Il ne serait même pas
exagéré de dire que ce livre est pour le XXe siècle ce que le Manifeste
communiste a été pour le xixe. Comme ce fut le cas pour ce dernier,
sa portée ne sera peut-être discernée qu'au siècle suivant. Le texte
va, en fin de compte, dans plusieurs directions qui sont toutes
liées entre elles, bien que cela n'apparaisse pas au premier coup
d'œil. On peut les résumer ainsi : Premièrement : radicaliser l'action
révolutionnaire en supprimant la politique comme un domaine
en soi, ce qui revient à faire le premier pas vers le dépassement de
cette dernière. Deuxièmement : faire de l'immédiateté la catégorie
la plus importante dans le domaine de l'action politique et sociale,
ce qui tend finalement à une définition nouvelle du rapport entre
théorie et pratique.
document de la plus grande importance. Il ne serait même pas
exagéré de dire que ce livre est pour le XXe siècle ce que le Manifeste
communiste a été pour le xixe. Comme ce fut le cas pour ce dernier,
sa portée ne sera peut-être discernée qu'au siècle suivant. Le texte
va, en fin de compte, dans plusieurs directions qui sont toutes
liées entre elles, bien que cela n'apparaisse pas au premier coup
d'œil. On peut les résumer ainsi : Premièrement : radicaliser l'action
révolutionnaire en supprimant la politique comme un domaine
en soi, ce qui revient à faire le premier pas vers le dépassement de
cette dernière. Deuxièmement : faire de l'immédiateté la catégorie
la plus importante dans le domaine de l'action politique et sociale,
ce qui tend finalement à une définition nouvelle du rapport entre
théorie et pratique.
Il est évident que cet ouvrage a plus d'un niveau de signifi-
cation et je ne suis pas sûr que l'auteur ait consciemment voulu
tous ces niveaux. Au niveau le plus explicite, Révolution dans la
Révolution ? est une justification intellectuelle de la « voie cubaine »
et s'inscrit ainsi dans la grande tradition des justifications philo-
sophiques a posteriori d'un événement social important ou d'un
acte politique. Le texte constitue une défense théorique du cas-
trisme contre les accusations d'aventurisme, de putschisme,
d'ignorance théorique et de légèreté, lancées contre lui par le
marxisme-léninisme « orthodoxe ». Juste au-dessous et presque au
même niveau, on trouve ce qu'on pourrait appeler le pluralisme
cation et je ne suis pas sûr que l'auteur ait consciemment voulu
tous ces niveaux. Au niveau le plus explicite, Révolution dans la
Révolution ? est une justification intellectuelle de la « voie cubaine »
et s'inscrit ainsi dans la grande tradition des justifications philo-
sophiques a posteriori d'un événement social important ou d'un
acte politique. Le texte constitue une défense théorique du cas-
trisme contre les accusations d'aventurisme, de putschisme,
d'ignorance théorique et de légèreté, lancées contre lui par le
marxisme-léninisme « orthodoxe ». Juste au-dessous et presque au
même niveau, on trouve ce qu'on pourrait appeler le pluralisme
i. N.D.L.R. — Les références entre parenthèses renvoient à la page
de l'édition française parue chez François Maspero (Cahiers Libres, n° 98).
de l'édition française parue chez François Maspero (Cahiers Libres, n° 98).
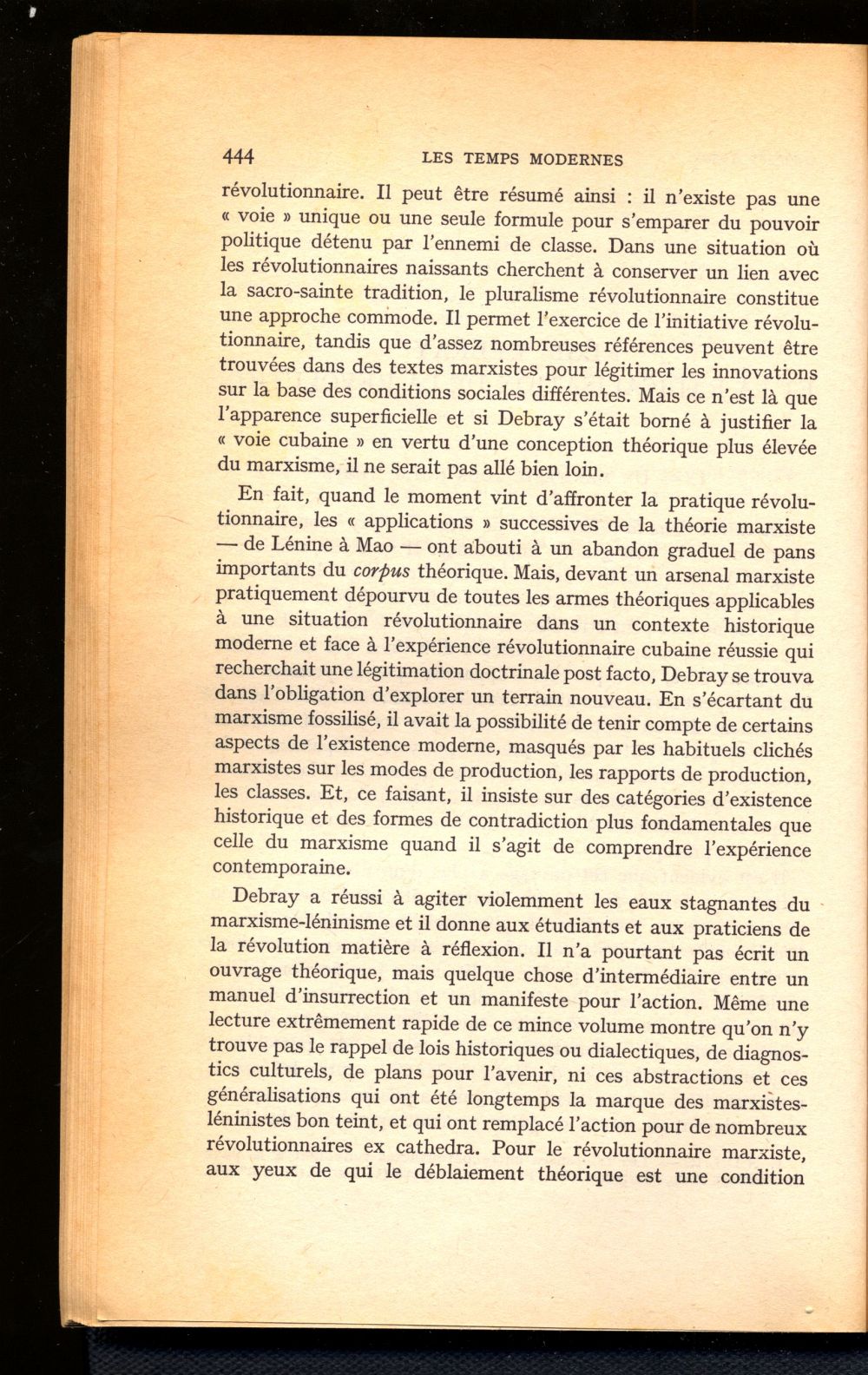

444
LES TEMPS MODERNES
révolutionnaire. Il peut être résumé ainsi : il n'existe pas une
« voie » unique ou une seule formule pour s'emparer du pouvoir
politique détenu par l'ennemi de classe. Dans une situation où
les révolutionnaires naissants cherchent à conserver un lien avec
la sacro-sainte tradition, le pluralisme révolutionnaire constitue
une approche commode. Il permet l'exercice de l'initiative révolu-
tionnaire, tandis que d'assez nombreuses références peuvent être
trouvées dans des textes marxistes pour légitimer les innovations
sur la base des conditions sociales différentes. Mais ce n'est là que
l'apparence superficielle et si Debray s'était borné à justifier la
« voie cubaine » en vertu d'une conception théorique plus élevée
du marxisme, il ne serait pas allé bien loin.
« voie » unique ou une seule formule pour s'emparer du pouvoir
politique détenu par l'ennemi de classe. Dans une situation où
les révolutionnaires naissants cherchent à conserver un lien avec
la sacro-sainte tradition, le pluralisme révolutionnaire constitue
une approche commode. Il permet l'exercice de l'initiative révolu-
tionnaire, tandis que d'assez nombreuses références peuvent être
trouvées dans des textes marxistes pour légitimer les innovations
sur la base des conditions sociales différentes. Mais ce n'est là que
l'apparence superficielle et si Debray s'était borné à justifier la
« voie cubaine » en vertu d'une conception théorique plus élevée
du marxisme, il ne serait pas allé bien loin.
En fait, quand le moment vint d'affronter la pratique révolu-
tionnaire, les « applications » successives de la théorie marxiste
— de Lénine à Mao — ont abouti à un abandon graduel de pans
importants du corpus théorique. Mais, devant un arsenal marxiste
pratiquement dépourvu de toutes les armes théoriques applicables
à une situation révolutionnaire dans un contexte historique
moderne et face à l'expérience révolutionnaire cubaine réussie qui
recherchait une légitimation doctrinale post facto, Debray se trouva
dans l'obligation d'explorer un terrain nouveau. En s'écartant du
marxisme fossilisé, il avait la possibilité de tenir compte de certains
aspects de l'existence moderne, masqués par les habituels clichés
marxistes sur les modes de production, les rapports de production,
les classes. Et, ce faisant, il insiste sur des catégories d'existence
historique et des formes de contradiction plus fondamentales que
celle du marxisme quand il s'agit de comprendre l'expérience
contemporaine.
tionnaire, les « applications » successives de la théorie marxiste
— de Lénine à Mao — ont abouti à un abandon graduel de pans
importants du corpus théorique. Mais, devant un arsenal marxiste
pratiquement dépourvu de toutes les armes théoriques applicables
à une situation révolutionnaire dans un contexte historique
moderne et face à l'expérience révolutionnaire cubaine réussie qui
recherchait une légitimation doctrinale post facto, Debray se trouva
dans l'obligation d'explorer un terrain nouveau. En s'écartant du
marxisme fossilisé, il avait la possibilité de tenir compte de certains
aspects de l'existence moderne, masqués par les habituels clichés
marxistes sur les modes de production, les rapports de production,
les classes. Et, ce faisant, il insiste sur des catégories d'existence
historique et des formes de contradiction plus fondamentales que
celle du marxisme quand il s'agit de comprendre l'expérience
contemporaine.
Debray a réussi à agiter violemment les eaux stagnantes du
marxisme-léninisme et il donne aux étudiants et aux praticiens de
la révolution matière à réflexion. Il n'a pourtant pas écrit un
ouvrage théorique, mais quelque chose d'intermédiaire entre un
manuel d'insurrection et un manifeste pour l'action. Même une
lecture extrêmement rapide de ce mince volume montre qu'on n'y
trouve pas le rappel de lois historiques ou dialectiques, de diagnos-
tics culturels, de plans pour l'avenir, ni ces abstractions et ces
généralisations qui ont été longtemps la marque des marxistes-
léninistes bon teint, et qui ont remplacé l'action pour de nombreux
révolutionnaires ex cathedra. Pour le révolutionnaire marxiste,
aux yeux de qui le déblaiement théorique est une condition
marxisme-léninisme et il donne aux étudiants et aux praticiens de
la révolution matière à réflexion. Il n'a pourtant pas écrit un
ouvrage théorique, mais quelque chose d'intermédiaire entre un
manuel d'insurrection et un manifeste pour l'action. Même une
lecture extrêmement rapide de ce mince volume montre qu'on n'y
trouve pas le rappel de lois historiques ou dialectiques, de diagnos-
tics culturels, de plans pour l'avenir, ni ces abstractions et ces
généralisations qui ont été longtemps la marque des marxistes-
léninistes bon teint, et qui ont remplacé l'action pour de nombreux
révolutionnaires ex cathedra. Pour le révolutionnaire marxiste,
aux yeux de qui le déblaiement théorique est une condition
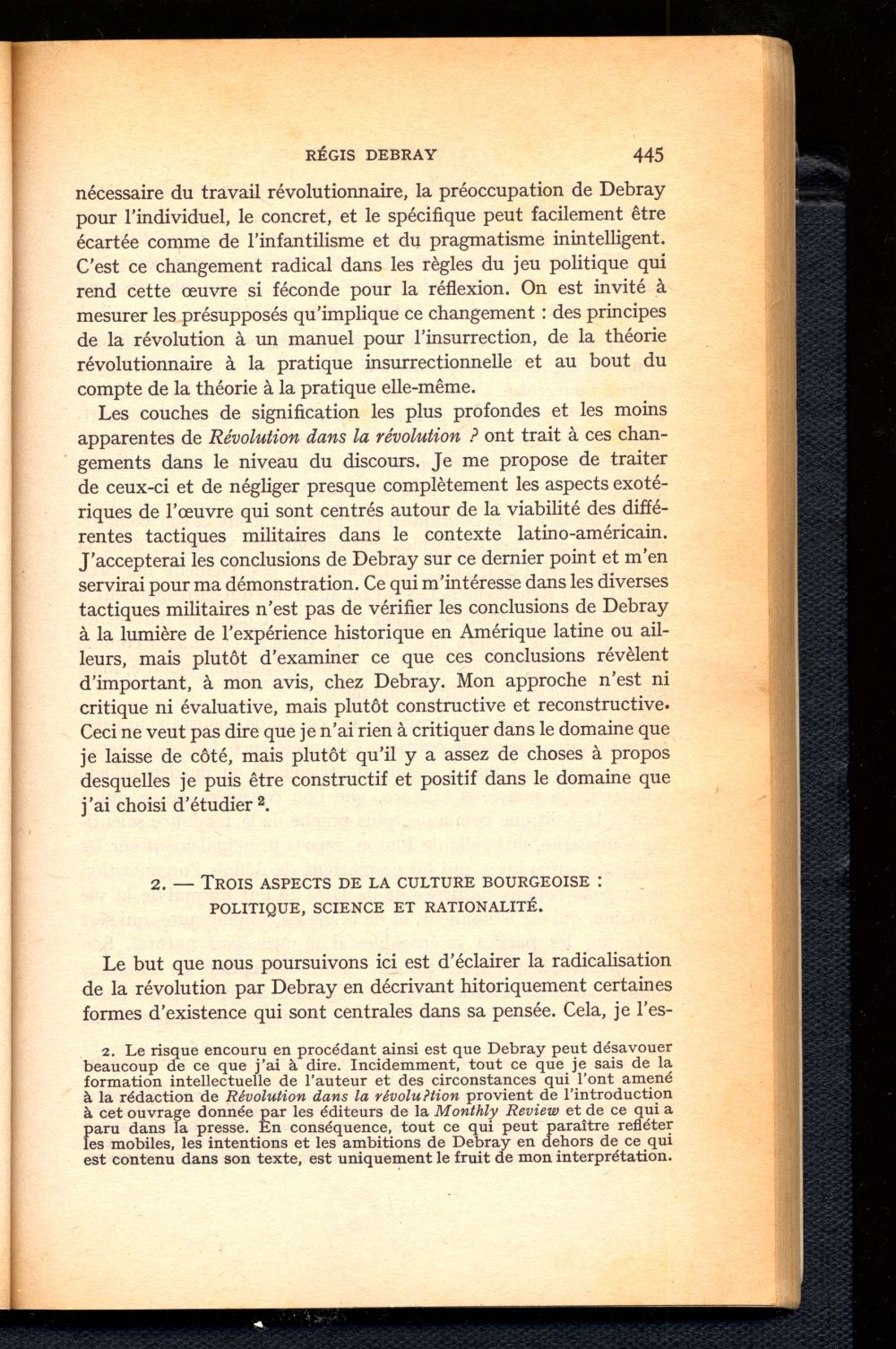

RÉGIS DEBRAY
445
nécessaire du travail révolutionnaire, la préoccupation de Debray
pour l'individuel, le concret, et le spécifique peut facilement être
écartée comme de l'infantilisme et du pragmatisme inintelligent.
C'est ce changement radical dans les règles du jeu politique qui
rend cette œuvre si féconde pour la réflexion. On est invité à
mesurer les présupposés qu'impliqué ce changement : des principes
de la révolution à un manuel pour l'insurrection, de la théorie
révolutionnaire à la pratique insurrectionnelle et au bout du
compte de la théorie à la pratique elle-même.
pour l'individuel, le concret, et le spécifique peut facilement être
écartée comme de l'infantilisme et du pragmatisme inintelligent.
C'est ce changement radical dans les règles du jeu politique qui
rend cette œuvre si féconde pour la réflexion. On est invité à
mesurer les présupposés qu'impliqué ce changement : des principes
de la révolution à un manuel pour l'insurrection, de la théorie
révolutionnaire à la pratique insurrectionnelle et au bout du
compte de la théorie à la pratique elle-même.
Les couches de signification les plus profondes et les moins
apparentes de Révolution dans la révolution ? ont trait à ces chan-
gements dans le niveau du discours. Je me propose de traiter
de ceux-ci et de négliger presque complètement les aspects exoté-
riques de l'œuvre qui sont centrés autour de la viabilité des diffé-
rentes tactiques militaires dans le contexte latino-américain.
J'accepterai les conclusions de Debray sur ce dernier point et m'en
servirai pour ma démonstration. Ce qui m'intéresse dans les diverses
tactiques militaires n'est pas de vérifier les conclusions de Debray
à la lumière de l'expérience historique en Amérique latine ou ail-
leurs, mais plutôt d'examiner ce que ces conclusions révèlent
d'important, à mon avis, chez Debray. Mon approche n'est ni
critique ni évaluative, mais plutôt constructive et reconstructive.
Ceci ne veut pas dire que je n'ai rien à critiquer dans le domaine que
je laisse de côté, mais plutôt qu'il y a assez de choses à propos
desquelles je puis être constructif et positif dans le domaine que
j'ai choisi d'étudier 2.
apparentes de Révolution dans la révolution ? ont trait à ces chan-
gements dans le niveau du discours. Je me propose de traiter
de ceux-ci et de négliger presque complètement les aspects exoté-
riques de l'œuvre qui sont centrés autour de la viabilité des diffé-
rentes tactiques militaires dans le contexte latino-américain.
J'accepterai les conclusions de Debray sur ce dernier point et m'en
servirai pour ma démonstration. Ce qui m'intéresse dans les diverses
tactiques militaires n'est pas de vérifier les conclusions de Debray
à la lumière de l'expérience historique en Amérique latine ou ail-
leurs, mais plutôt d'examiner ce que ces conclusions révèlent
d'important, à mon avis, chez Debray. Mon approche n'est ni
critique ni évaluative, mais plutôt constructive et reconstructive.
Ceci ne veut pas dire que je n'ai rien à critiquer dans le domaine que
je laisse de côté, mais plutôt qu'il y a assez de choses à propos
desquelles je puis être constructif et positif dans le domaine que
j'ai choisi d'étudier 2.
2. — TROIS ASPECTS DE LA CULTURE BOURGEOISE :
POLITIQUE, SCIENCE ET RATIONALITÉ.
POLITIQUE, SCIENCE ET RATIONALITÉ.
Le but que nous poursuivons ici est d'éclairer la radicalisation
de la révolution par Debray en décrivant hitoriquement certaines
formes d'existence qui sont centrales dans sa pensée. Cela, je l'es-
de la révolution par Debray en décrivant hitoriquement certaines
formes d'existence qui sont centrales dans sa pensée. Cela, je l'es-
2. Le risque encouru en procédant ainsi est que Debray peut désavouer
beaucoup de ce que j'ai à dire. Incidemment, tout ce que je sais de la
formation intellectuelle de l'auteur et des circonstances qui l'ont amené
à la rédaction de Révolution dans la révolu ftion provient de l'introduction
à cet ouvrage donnée par les éditeurs de la Monthly Review et de ce qui a
paru dans la presse. En conséquence, tout ce qui peut paraître refléter
les mobiles, les intentions et les ambitions de Debray en dehors de ce qui
est contenu dans son texte, est uniquement le fruit de mon interprétation.
beaucoup de ce que j'ai à dire. Incidemment, tout ce que je sais de la
formation intellectuelle de l'auteur et des circonstances qui l'ont amené
à la rédaction de Révolution dans la révolu ftion provient de l'introduction
à cet ouvrage donnée par les éditeurs de la Monthly Review et de ce qui a
paru dans la presse. En conséquence, tout ce qui peut paraître refléter
les mobiles, les intentions et les ambitions de Debray en dehors de ce qui
est contenu dans son texte, est uniquement le fruit de mon interprétation.
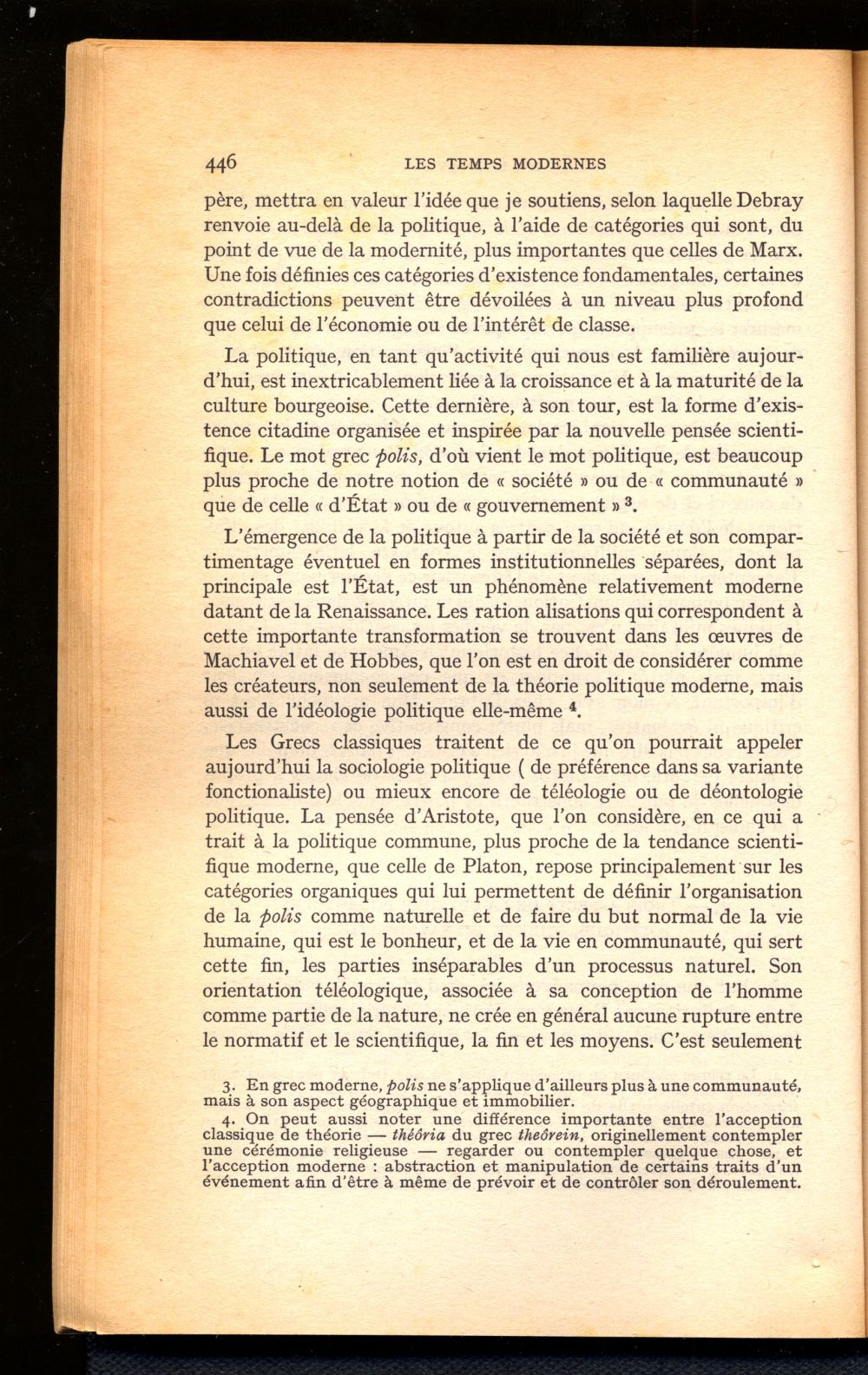

446
LES TEMPS MODERNES
père, mettra en valeur l'idée que je soutiens, selon laquelle Debray
renvoie au-delà de la politique, à l'aide de catégories qui sont, du
point de vue de la modernité, plus importantes que celles de Marx.
Une fois définies ces catégories d'existence fondamentales, certaines
contradictions peuvent être dévoilées à un niveau plus profond
que celui de l'économie ou de l'intérêt de classe.
renvoie au-delà de la politique, à l'aide de catégories qui sont, du
point de vue de la modernité, plus importantes que celles de Marx.
Une fois définies ces catégories d'existence fondamentales, certaines
contradictions peuvent être dévoilées à un niveau plus profond
que celui de l'économie ou de l'intérêt de classe.
La politique, en tant qu'activité qui nous est familière aujour-
d'hui, est inextricablement liée à la croissance et à la maturité de la
culture bourgeoise. Cette dernière, à son tour, est la forme d'exis-
tence citadine organisée et inspirée par la nouvelle pensée scienti-
fique. Le mot grec polis, d'où vient le mot politique, est beaucoup
plus proche de notre notion de « société » ou de « communauté »
que de celle « d'État » ou de « gouvernement » 3.
d'hui, est inextricablement liée à la croissance et à la maturité de la
culture bourgeoise. Cette dernière, à son tour, est la forme d'exis-
tence citadine organisée et inspirée par la nouvelle pensée scienti-
fique. Le mot grec polis, d'où vient le mot politique, est beaucoup
plus proche de notre notion de « société » ou de « communauté »
que de celle « d'État » ou de « gouvernement » 3.
L'émergence de la politique à partir de la société et son compar-
timentage éventuel en formes institutionnelles séparées, dont la
principale est l'État, est un phénomène relativement moderne
datant de la Renaissance. Les ration alisations qui correspondent à
cette importante transformation se trouvent dans les œuvres de
Machiavel et de Hobbes, que l'on est en droit de considérer comme
les créateurs, non seulement de la théorie politique moderne, mais
aussi de l'idéologie politique elle-même *.
timentage éventuel en formes institutionnelles séparées, dont la
principale est l'État, est un phénomène relativement moderne
datant de la Renaissance. Les ration alisations qui correspondent à
cette importante transformation se trouvent dans les œuvres de
Machiavel et de Hobbes, que l'on est en droit de considérer comme
les créateurs, non seulement de la théorie politique moderne, mais
aussi de l'idéologie politique elle-même *.
Les Grecs classiques traitent de ce qu'on pourrait appeler
aujourd'hui la sociologie politique ( de préférence dans sa variante
fonctionaliste) ou mieux encore de téléologie ou de déontologie
politique. La pensée d'Aristote, que l'on considère, en ce qui a
trait à la politique commune, plus proche de la tendance scienti-
fique moderne, que celle de Platon, repose principalement sur les
catégories organiques qui lui permettent de définir l'organisation
de la polis comme naturelle et de faire du but normal de la vie
humaine, qui est le bonheur, et de la vie en communauté, qui sert
cette fin, les parties inséparables d'un processus naturel. Son
orientation téléologique, associée à sa conception de l'homme
comme partie de la nature, ne crée en général aucune rupture entre
le normatif et le scientifique, la fin et les moyens. C'est seulement
aujourd'hui la sociologie politique ( de préférence dans sa variante
fonctionaliste) ou mieux encore de téléologie ou de déontologie
politique. La pensée d'Aristote, que l'on considère, en ce qui a
trait à la politique commune, plus proche de la tendance scienti-
fique moderne, que celle de Platon, repose principalement sur les
catégories organiques qui lui permettent de définir l'organisation
de la polis comme naturelle et de faire du but normal de la vie
humaine, qui est le bonheur, et de la vie en communauté, qui sert
cette fin, les parties inséparables d'un processus naturel. Son
orientation téléologique, associée à sa conception de l'homme
comme partie de la nature, ne crée en général aucune rupture entre
le normatif et le scientifique, la fin et les moyens. C'est seulement
3. En grec moderne, polis ne s'applique d'ailleurs plus à une communauté,
mais à son aspect géographique et immobilier.
mais à son aspect géographique et immobilier.
4. On peut aussi noter une différence importante entre l'acception
classique de théorie — théôria du grec theôrein, originellement contempler
une cérémonie religieuse — regarder ou contempler quelque chose, et
l'acception moderne : abstraction et manipulation de certains traits d'un
événement afin d'être à même de prévoir et de contrôler son déroulement.
classique de théorie — théôria du grec theôrein, originellement contempler
une cérémonie religieuse — regarder ou contempler quelque chose, et
l'acception moderne : abstraction et manipulation de certains traits d'un
événement afin d'être à même de prévoir et de contrôler son déroulement.
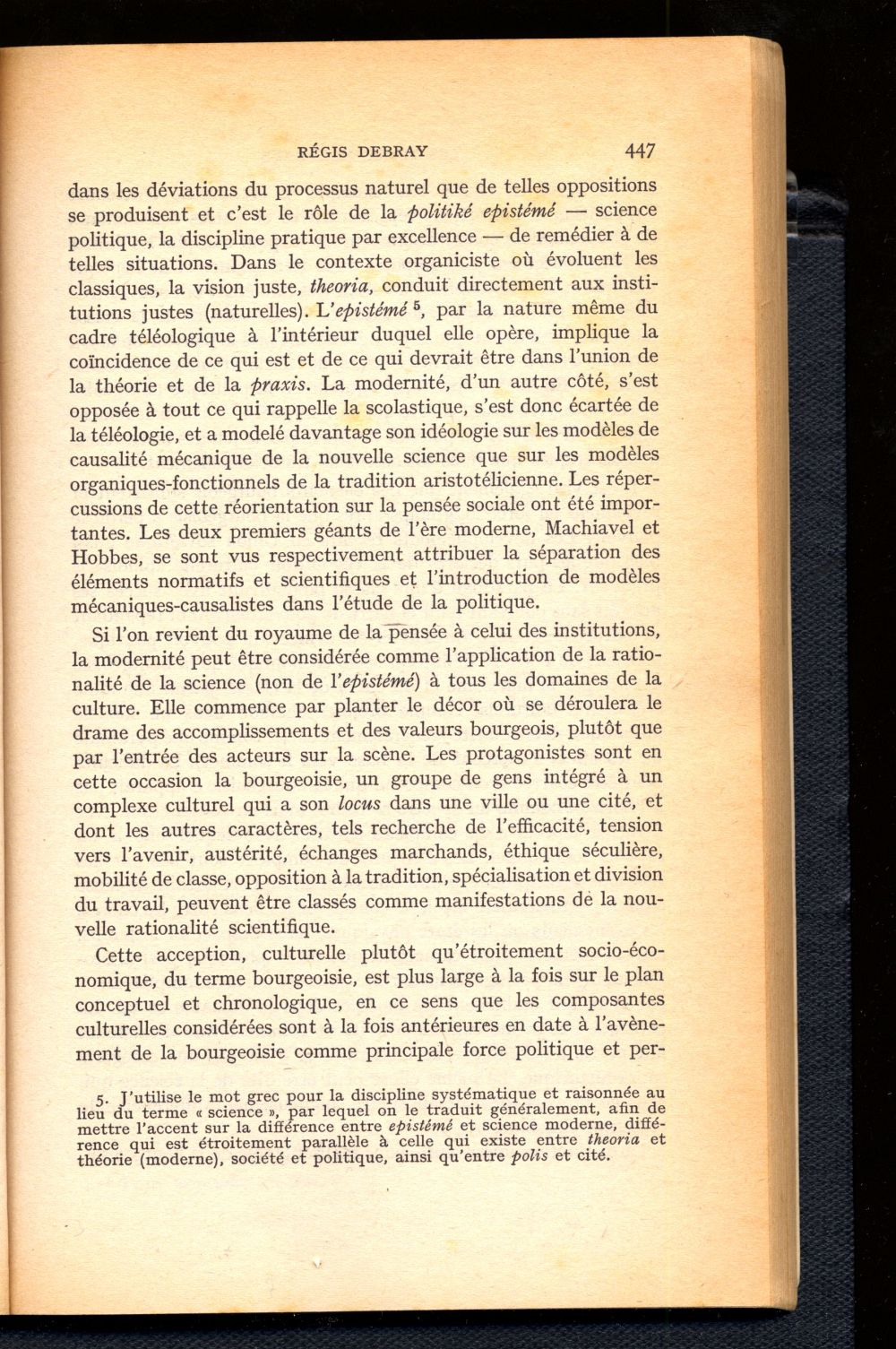

REGIS DEBRAY
447
dans les déviations du processus naturel que de telles oppositions
se produisent et c'est le rôle de la politiké epistémé — science
politique, la discipline pratique par excellence — de remédier à de
telles situations. Dans le contexte organiciste où évoluent les
classiques, la vision juste, theoria, conduit directement aux insti-
tutions justes (naturelles). U epistémé 5, par la nature même du
cadre téléologique à l'intérieur duquel elle opère, implique la
coïncidence de ce qui est et de ce qui devrait être dans l'union de
la théorie et de la praxis. La modernité, d'un autre côté, s'est
opposée à tout ce qui rappelle la scolastique, s'est donc écartée de
la téléologie, et a modelé davantage son idéologie sur les modèles de
causalité mécanique de la nouvelle science que sur les modèles
organiques-fonctionnels de la tradition aristotélicienne. Les réper-
cussions de cette réorientation sur la pensée sociale ont été impor-
tantes. Les deux premiers géants de l'ère moderne, Machiavel et
Hobbes, se sont vus respectivement attribuer la séparation des
éléments normatifs et scientifiques et l'introduction de modèles
mécaniques-causalistes dans l'étude de la politique.
se produisent et c'est le rôle de la politiké epistémé — science
politique, la discipline pratique par excellence — de remédier à de
telles situations. Dans le contexte organiciste où évoluent les
classiques, la vision juste, theoria, conduit directement aux insti-
tutions justes (naturelles). U epistémé 5, par la nature même du
cadre téléologique à l'intérieur duquel elle opère, implique la
coïncidence de ce qui est et de ce qui devrait être dans l'union de
la théorie et de la praxis. La modernité, d'un autre côté, s'est
opposée à tout ce qui rappelle la scolastique, s'est donc écartée de
la téléologie, et a modelé davantage son idéologie sur les modèles de
causalité mécanique de la nouvelle science que sur les modèles
organiques-fonctionnels de la tradition aristotélicienne. Les réper-
cussions de cette réorientation sur la pensée sociale ont été impor-
tantes. Les deux premiers géants de l'ère moderne, Machiavel et
Hobbes, se sont vus respectivement attribuer la séparation des
éléments normatifs et scientifiques et l'introduction de modèles
mécaniques-causalistes dans l'étude de la politique.
Si l'on revient du royaume de la pensée à celui des institutions,
la modernité peut être considérée comme l'application de la ratio-
nalité de la science (non de l'epistémé] à tous les domaines de la
culture. Elle commence par planter le décor où se déroulera le
drame des accomplissements et des valeurs bourgeois, plutôt que
par l'entrée des acteurs sur la scène. Les protagonistes sont en
cette occasion la bourgeoisie, un groupe de gens intégré à un
complexe culturel qui a son locus dans une ville ou une cité, et
dont les autres caractères, tels recherche de l'efficacité, tension
vers l'avenir, austérité, échanges marchands, éthique séculière,
mobilité de classe, opposition à la tradition, spécialisation et division
du travail, peuvent être classés comme manifestations de la nou-
velle rationalité scientifique.
la modernité peut être considérée comme l'application de la ratio-
nalité de la science (non de l'epistémé] à tous les domaines de la
culture. Elle commence par planter le décor où se déroulera le
drame des accomplissements et des valeurs bourgeois, plutôt que
par l'entrée des acteurs sur la scène. Les protagonistes sont en
cette occasion la bourgeoisie, un groupe de gens intégré à un
complexe culturel qui a son locus dans une ville ou une cité, et
dont les autres caractères, tels recherche de l'efficacité, tension
vers l'avenir, austérité, échanges marchands, éthique séculière,
mobilité de classe, opposition à la tradition, spécialisation et division
du travail, peuvent être classés comme manifestations de la nou-
velle rationalité scientifique.
Cette acception, culturelle plutôt qu'étroitement socio-éco-
nomique, du terme bourgeoisie, est plus large à la fois sur le plan
conceptuel et chronologique, en ce sens que les composantes
culturelles considérées sont à la fois antérieures en date à l'avène-
ment de la bourgeoisie comme principale force politique et per-
nomique, du terme bourgeoisie, est plus large à la fois sur le plan
conceptuel et chronologique, en ce sens que les composantes
culturelles considérées sont à la fois antérieures en date à l'avène-
ment de la bourgeoisie comme principale force politique et per-
5. J'utilise le mot grec pour la discipline systématique et raisonnée au
lieu du terme « science », par lequel on le traduit généralement, afin de
mettre l'accent sur la différence entre epistémé et science moderne, diffé-
rence qui est étroitement parallèle à celle qui existe entre theoria et
théorie (moderne), société et politique, ainsi qu'entre polis et cité.
lieu du terme « science », par lequel on le traduit généralement, afin de
mettre l'accent sur la différence entre epistémé et science moderne, diffé-
rence qui est étroitement parallèle à celle qui existe entre theoria et
théorie (moderne), société et politique, ainsi qu'entre polis et cité.
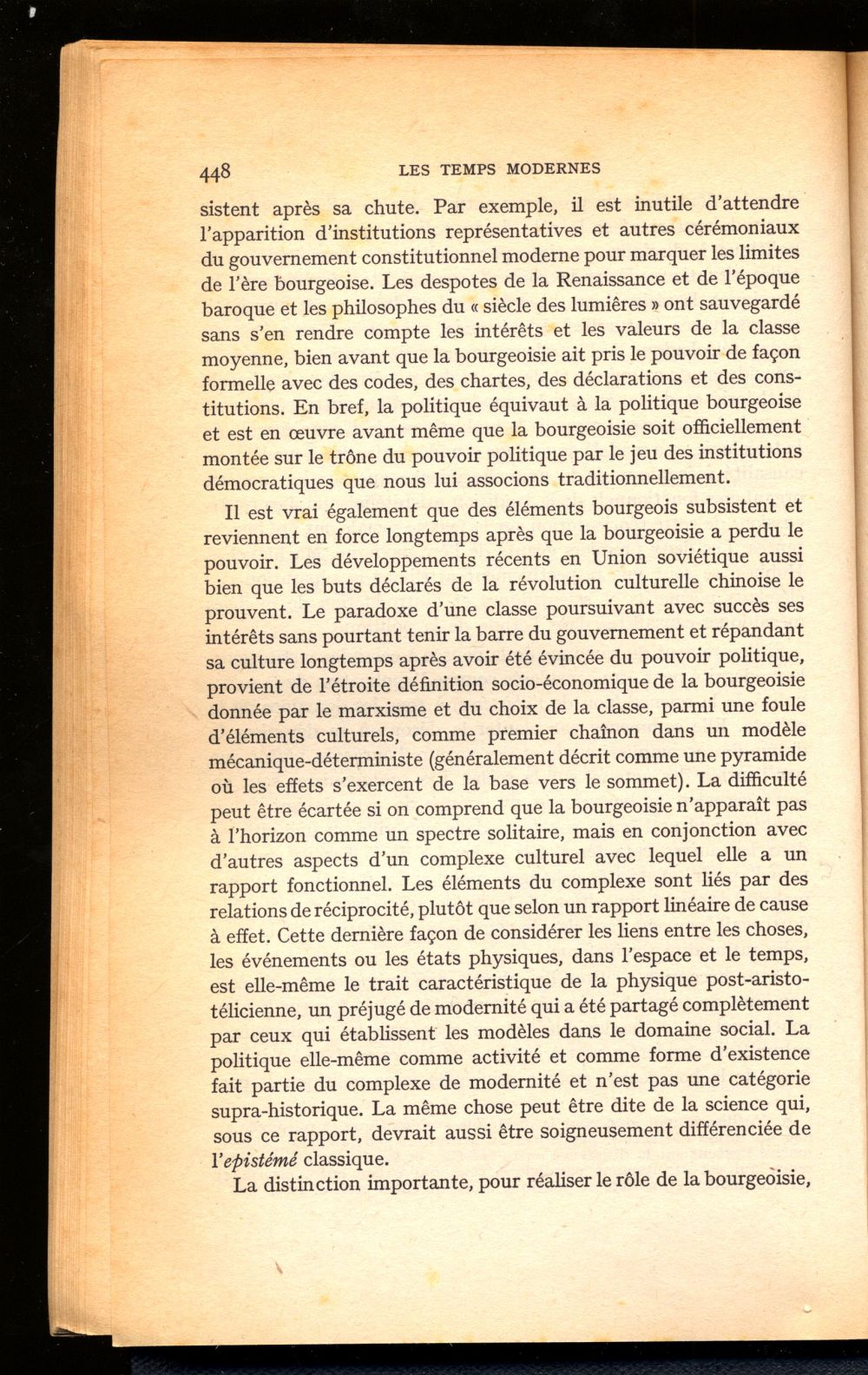

448 LES TEMPS MODERNES
sistent après sa chute. Par exemple, il est inutile d'attendre
l'apparition d'institutions représentatives et autres cérémoniaux
du gouvernement constitutionnel moderne pour marquer les limites
de l'ère bourgeoise. Les despotes de la Renaissance et de l'époque
baroque et les philosophes du « siècle des lumières » ont sauvegardé
sans s'en rendre compte les intérêts et les valeurs de la classe
moyenne, bien avant que la bourgeoisie ait pris le pouvoir de façon
formelle avec des codes, des chartes, des déclarations et des cons-
titutions. En bref, la politique équivaut à la politique bourgeoise
et est en œuvre avant même que la bourgeoisie soit officiellement
montée sur le trône du pouvoir politique par le jeu des institutions
démocratiques que nous lui associons traditionnellement.
l'apparition d'institutions représentatives et autres cérémoniaux
du gouvernement constitutionnel moderne pour marquer les limites
de l'ère bourgeoise. Les despotes de la Renaissance et de l'époque
baroque et les philosophes du « siècle des lumières » ont sauvegardé
sans s'en rendre compte les intérêts et les valeurs de la classe
moyenne, bien avant que la bourgeoisie ait pris le pouvoir de façon
formelle avec des codes, des chartes, des déclarations et des cons-
titutions. En bref, la politique équivaut à la politique bourgeoise
et est en œuvre avant même que la bourgeoisie soit officiellement
montée sur le trône du pouvoir politique par le jeu des institutions
démocratiques que nous lui associons traditionnellement.
Il est vrai également que des éléments bourgeois subsistent et
reviennent en force longtemps après que la bourgeoisie a perdu le
pouvoir. Les développements récents en Union soviétique aussi
bien que les buts déclarés de la révolution culturelle chinoise le
prouvent. Le paradoxe d'une classe poursuivant avec succès ses
intérêts sans pourtant tenir la barre du gouvernement et répandant
sa culture longtemps après avoir été évincée du pouvoir politique,
provient de l'étroite définition socio-économique de la bourgeoisie
donnée par le marxisme et du choix de la classe, parmi une foule
d'éléments culturels, comme premier chaînon dans un modèle
mécanique-déterministe (généralement décrit comme une pyramide
où les effets s'exercent de la base vers le sommet). La difficulté
peut être écartée si on comprend que la bourgeoisie n'apparaît pas
à l'horizon comme un spectre solitaire, mais en conjonction avec
d'autres aspects d'un complexe culturel avec lequel elle a un
rapport fonctionnel. Les éléments du complexe sont liés par des
relations de réciprocité, plutôt que selon un rapport linéaire de cause
à effet. Cette dernière façon de considérer les liens entre les choses,
les événements ou les états physiques, dans l'espace et le temps,
est elle-même le trait caractéristique de la physique post-aristo-
télicienne, un préjugé de modernité qui a été partagé complètement
par ceux qui établissent les modèles dans le domaine social. La
politique elle-même comme activité et comme forme d'existence
fait partie du complexe de modernité et n'est pas une catégorie
supra-historique. La même chose peut être dite de la science qui,
sous ce rapport, devrait aussi être soigneusement différenciée de
Ye-pistémé classique.
reviennent en force longtemps après que la bourgeoisie a perdu le
pouvoir. Les développements récents en Union soviétique aussi
bien que les buts déclarés de la révolution culturelle chinoise le
prouvent. Le paradoxe d'une classe poursuivant avec succès ses
intérêts sans pourtant tenir la barre du gouvernement et répandant
sa culture longtemps après avoir été évincée du pouvoir politique,
provient de l'étroite définition socio-économique de la bourgeoisie
donnée par le marxisme et du choix de la classe, parmi une foule
d'éléments culturels, comme premier chaînon dans un modèle
mécanique-déterministe (généralement décrit comme une pyramide
où les effets s'exercent de la base vers le sommet). La difficulté
peut être écartée si on comprend que la bourgeoisie n'apparaît pas
à l'horizon comme un spectre solitaire, mais en conjonction avec
d'autres aspects d'un complexe culturel avec lequel elle a un
rapport fonctionnel. Les éléments du complexe sont liés par des
relations de réciprocité, plutôt que selon un rapport linéaire de cause
à effet. Cette dernière façon de considérer les liens entre les choses,
les événements ou les états physiques, dans l'espace et le temps,
est elle-même le trait caractéristique de la physique post-aristo-
télicienne, un préjugé de modernité qui a été partagé complètement
par ceux qui établissent les modèles dans le domaine social. La
politique elle-même comme activité et comme forme d'existence
fait partie du complexe de modernité et n'est pas une catégorie
supra-historique. La même chose peut être dite de la science qui,
sous ce rapport, devrait aussi être soigneusement différenciée de
Ye-pistémé classique.
La distinction importante, pour réaliser le rôle de la bourgeoisie,
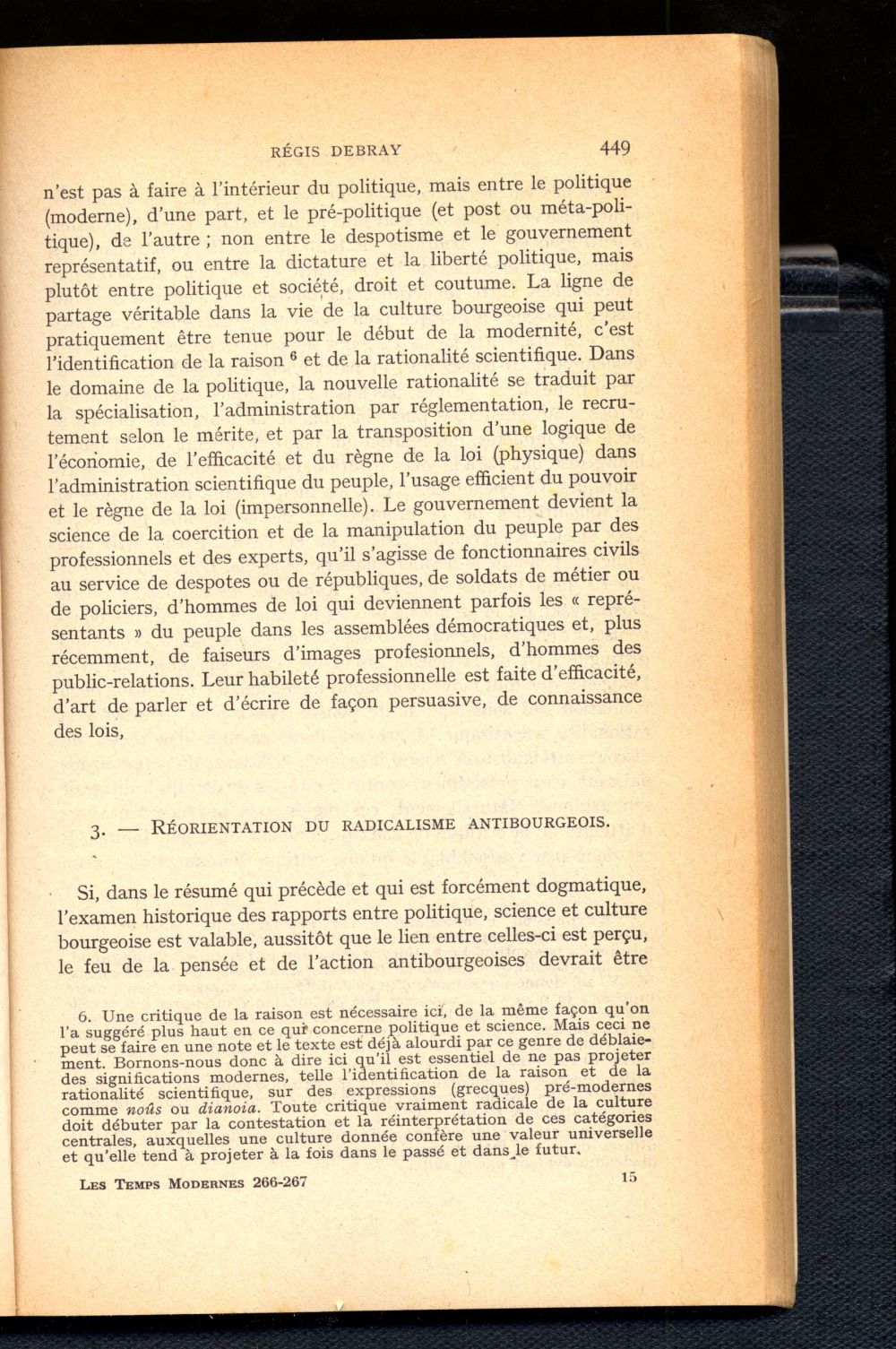

REGIS DEBRAY
449
n'est pas à faire à l'intérieur du politique, mais entre le politique
(moderne), d'une part, et le pré-politique (et post ou méta-poli-
tique), de l'autre ; non entre le despotisme et le gouvernement
représentatif, ou entre la dictature et la liberté politique, mais
plutôt entre politique et société, droit et coutume. La ligne de
partage véritable clans la vie de la culture bourgeoise qui peut
pratiquement être ternie pour le début de la modernité, c'est
l'identification de la raison 6 et de la rationalité scientifique. Dans
le domaine de la politique, la nouvelle rationalité se traduit par
la spécialisation, l'administration par réglementation, le recru-
tement salon le mérite, et par la transposition d'une logique de
l'économie, de l'efficacité et du règne de la loi (physique) dans
l'administration scientifique du peuple, l'usage efficient du pouvoir
et le règne de la loi (impersonnelle). Le gouvernement devient la
science de la coercition et de la manipulation du peuple par des
professionnels et des experts, qu'il s'agisse de fonctionnaires civils
au service de despotes ou de républiques, de soldats de métier ou
de policiers, d'hommes de loi qui deviennent parfois les « repré-
sentants » du peuple dans les assemblées démocratiques et, plus
récemment, de faiseurs d'images profesionnels, d'hommes des
public-relations. Leur habileté professionnelle est faite d'efficacité,
d'art de parler et d'écrire de façon persuasive, de connaissance
des lois,
(moderne), d'une part, et le pré-politique (et post ou méta-poli-
tique), de l'autre ; non entre le despotisme et le gouvernement
représentatif, ou entre la dictature et la liberté politique, mais
plutôt entre politique et société, droit et coutume. La ligne de
partage véritable clans la vie de la culture bourgeoise qui peut
pratiquement être ternie pour le début de la modernité, c'est
l'identification de la raison 6 et de la rationalité scientifique. Dans
le domaine de la politique, la nouvelle rationalité se traduit par
la spécialisation, l'administration par réglementation, le recru-
tement salon le mérite, et par la transposition d'une logique de
l'économie, de l'efficacité et du règne de la loi (physique) dans
l'administration scientifique du peuple, l'usage efficient du pouvoir
et le règne de la loi (impersonnelle). Le gouvernement devient la
science de la coercition et de la manipulation du peuple par des
professionnels et des experts, qu'il s'agisse de fonctionnaires civils
au service de despotes ou de républiques, de soldats de métier ou
de policiers, d'hommes de loi qui deviennent parfois les « repré-
sentants » du peuple dans les assemblées démocratiques et, plus
récemment, de faiseurs d'images profesionnels, d'hommes des
public-relations. Leur habileté professionnelle est faite d'efficacité,
d'art de parler et d'écrire de façon persuasive, de connaissance
des lois,
3. — RÉORIENTATION DU RADICALISME ANTIBOURGEOIS.
Si, dans le résumé qui précède et qui est forcément dogmatique,
l'examen historique des rapports entre politique, science et culture
bourgeoise est valable, aussitôt que le lien entre celles-ci est perçu,
le feu de la pensée et de l'action antibourgeoises devrait être
l'examen historique des rapports entre politique, science et culture
bourgeoise est valable, aussitôt que le lien entre celles-ci est perçu,
le feu de la pensée et de l'action antibourgeoises devrait être
0. Une critique de la raison est nécessaire ici, de la même façon qu'on
l'a suggéré plus haut en ce qui concerne politique et science. Mais ceci ne
peut se faire en une note et le texte est déjà alourdi par ce genre de déblaie-
ment. Bornons-nous donc à dire ici qu'il est essentiel de ne pas projeter
des significations modernes, telle l'identification de la raison et de la
rationalité scientifique, sur des expressions (grecques) pré-modernes
comme nous ou dianoia. Toute critique vraiment radicale de la culture
doit débuter par la contestation et la réinterprétation de ces catégories
centrales, auxquelles une culture donnée confère une valeur universelle
et qu'elle tend à projeter à la fois dans le passé et dans Je futur,
l'a suggéré plus haut en ce qui concerne politique et science. Mais ceci ne
peut se faire en une note et le texte est déjà alourdi par ce genre de déblaie-
ment. Bornons-nous donc à dire ici qu'il est essentiel de ne pas projeter
des significations modernes, telle l'identification de la raison et de la
rationalité scientifique, sur des expressions (grecques) pré-modernes
comme nous ou dianoia. Toute critique vraiment radicale de la culture
doit débuter par la contestation et la réinterprétation de ces catégories
centrales, auxquelles une culture donnée confère une valeur universelle
et qu'elle tend à projeter à la fois dans le passé et dans Je futur,
LES TEMPS MODERNES 26H-267 If,
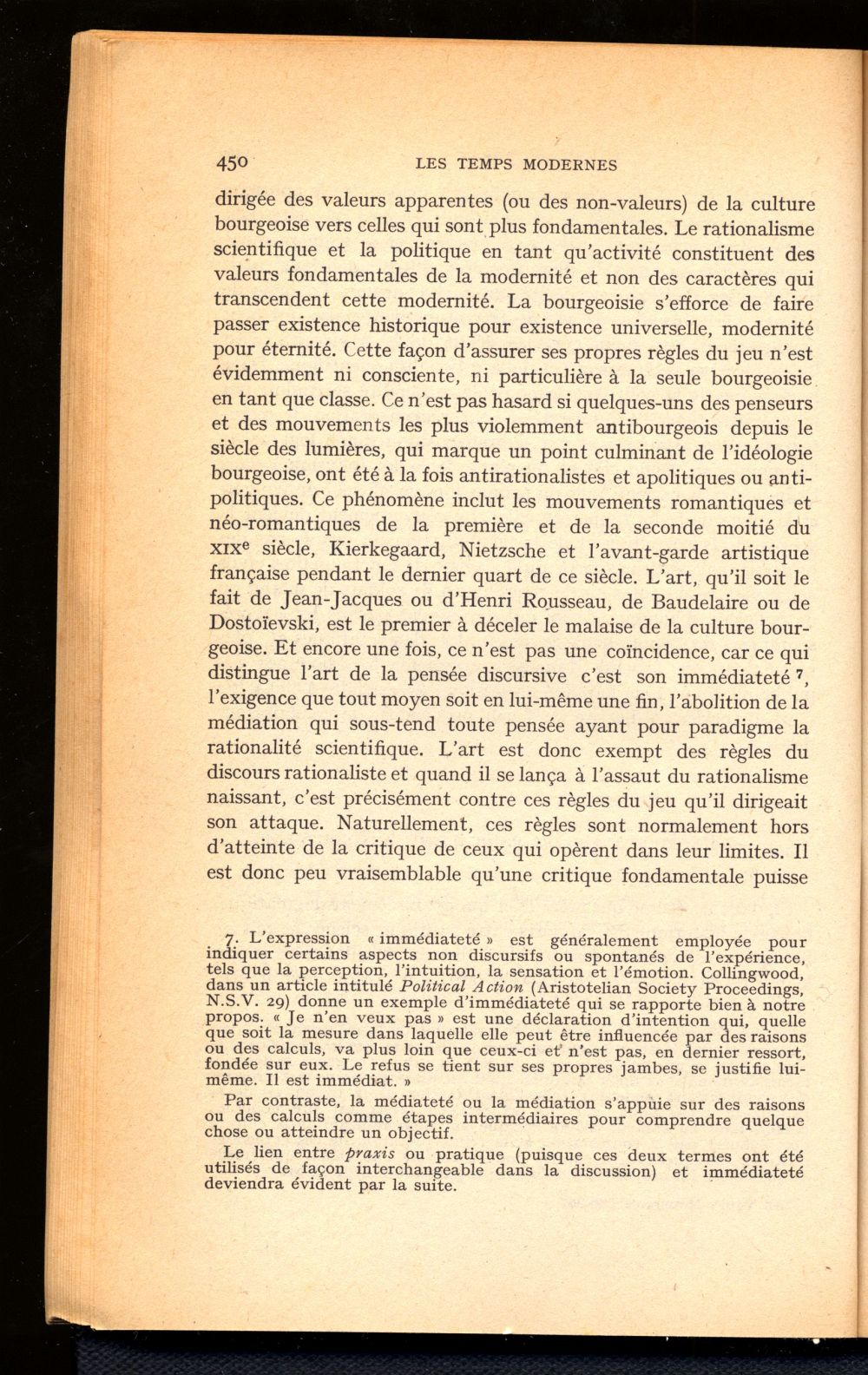

450
LES TEMPS MODERNES
dirigée des valeurs apparentes (ou des non-valeurs) de la culture
bourgeoise vers celles qui sont plus fondamentales. Le rationalisme
scientifique et la politique en tant qu'activité constituent des
valeurs fondamentales de la modernité et non des caractères qui
transcendent cette modernité. La bourgeoisie s'efforce de faire
passer existence historique pour existence universelle, modernité
pour éternité. Cette façon d'assurer ses propres règles du jeu n'est
évidemment ni consciente, ni particulière à la seule bourgeoisie
en tant que classe. Ce n'est pas hasard si quelques-uns des penseurs
et des mouvements les plus violemment antibourgeois depuis le
siècle des lumières, qui marque un point culminant de l'idéologie
bourgeoise, ont été à la fois antirationalistes et apolitiques ou anti-
politiques. Ce phénomène inclut les mouvements romantiques et
néo-romantiques de la première et de la seconde moitié du
xixe siècle, Kierkegaard, Nietzsche et l'avant-garde artistique
française pendant le dernier quart de ce siècle. L'art, qu'il soit le
fait de Jean-Jacques ou d'Henri Rousseau, de Baudelaire ou de
Dostoïevski, est le premier à déceler le malaise de la culture bour-
geoise. Et encore une fois, ce n'est pas une coïncidence, car ce qui
distingue l'art de la pensée discursive c'est son immédiateté 7,
l'exigence que tout moyen soit en lui-même une fin, l'abolition de la
médiation qui sous-tend toute pensée ayant pour paradigme la
rationalité scientifique. L'art est donc exempt des règles du
discours rationaliste et quand il se lança à l'assaut du rationalisme
naissant, c'est précisément contre ces règles du jeu qu'il dirigeait
son attaque. Naturellement, ces règles sont normalement hors
d'atteinte de la critique de ceux qui opèrent dans leur limites. Il
est donc peu vraisemblable qu'une critique fondamentale puisse
bourgeoise vers celles qui sont plus fondamentales. Le rationalisme
scientifique et la politique en tant qu'activité constituent des
valeurs fondamentales de la modernité et non des caractères qui
transcendent cette modernité. La bourgeoisie s'efforce de faire
passer existence historique pour existence universelle, modernité
pour éternité. Cette façon d'assurer ses propres règles du jeu n'est
évidemment ni consciente, ni particulière à la seule bourgeoisie
en tant que classe. Ce n'est pas hasard si quelques-uns des penseurs
et des mouvements les plus violemment antibourgeois depuis le
siècle des lumières, qui marque un point culminant de l'idéologie
bourgeoise, ont été à la fois antirationalistes et apolitiques ou anti-
politiques. Ce phénomène inclut les mouvements romantiques et
néo-romantiques de la première et de la seconde moitié du
xixe siècle, Kierkegaard, Nietzsche et l'avant-garde artistique
française pendant le dernier quart de ce siècle. L'art, qu'il soit le
fait de Jean-Jacques ou d'Henri Rousseau, de Baudelaire ou de
Dostoïevski, est le premier à déceler le malaise de la culture bour-
geoise. Et encore une fois, ce n'est pas une coïncidence, car ce qui
distingue l'art de la pensée discursive c'est son immédiateté 7,
l'exigence que tout moyen soit en lui-même une fin, l'abolition de la
médiation qui sous-tend toute pensée ayant pour paradigme la
rationalité scientifique. L'art est donc exempt des règles du
discours rationaliste et quand il se lança à l'assaut du rationalisme
naissant, c'est précisément contre ces règles du jeu qu'il dirigeait
son attaque. Naturellement, ces règles sont normalement hors
d'atteinte de la critique de ceux qui opèrent dans leur limites. Il
est donc peu vraisemblable qu'une critique fondamentale puisse
7. L'expression « immédiateté » est généralement employée pour
indiquer certains aspects non discursifs ou spontanés de l'expérience,
tels que la perception, l'intuition, la sensation et l'émotion. Collingwood,
dans un article intitulé Political Action (Aristotelian Society Proceedings,
N.S.V. 29) donne un exemple d'immédiateté qui se rapporte bien à notre
propos. « Je n'en veux pas » est une déclaration d'intention qui, quelle
que soit la mesure dans laquelle elle peut être influencée par des raisons
ou des calculs, va plus loin que ceux-ci et n'est pas, en dernier ressort,
fondée sur eux. Le refus se tient sur ses propres jambes, se justifie lui-
même. Il est immédiat. »
indiquer certains aspects non discursifs ou spontanés de l'expérience,
tels que la perception, l'intuition, la sensation et l'émotion. Collingwood,
dans un article intitulé Political Action (Aristotelian Society Proceedings,
N.S.V. 29) donne un exemple d'immédiateté qui se rapporte bien à notre
propos. « Je n'en veux pas » est une déclaration d'intention qui, quelle
que soit la mesure dans laquelle elle peut être influencée par des raisons
ou des calculs, va plus loin que ceux-ci et n'est pas, en dernier ressort,
fondée sur eux. Le refus se tient sur ses propres jambes, se justifie lui-
même. Il est immédiat. »
Par contraste, la médiateté ou la médiation s'appuie sur des raisons
ou des calculs comme étapes intermédiaires pour comprendre quelque
chose ou atteindre un objectif.
ou des calculs comme étapes intermédiaires pour comprendre quelque
chose ou atteindre un objectif.
Le lien entre praxis ou pratique (puisque ces deux termes ont été
utilisés de façon interchangeable dans la discussion) et immédiateté
deviendra évident par la suite.
utilisés de façon interchangeable dans la discussion) et immédiateté
deviendra évident par la suite.
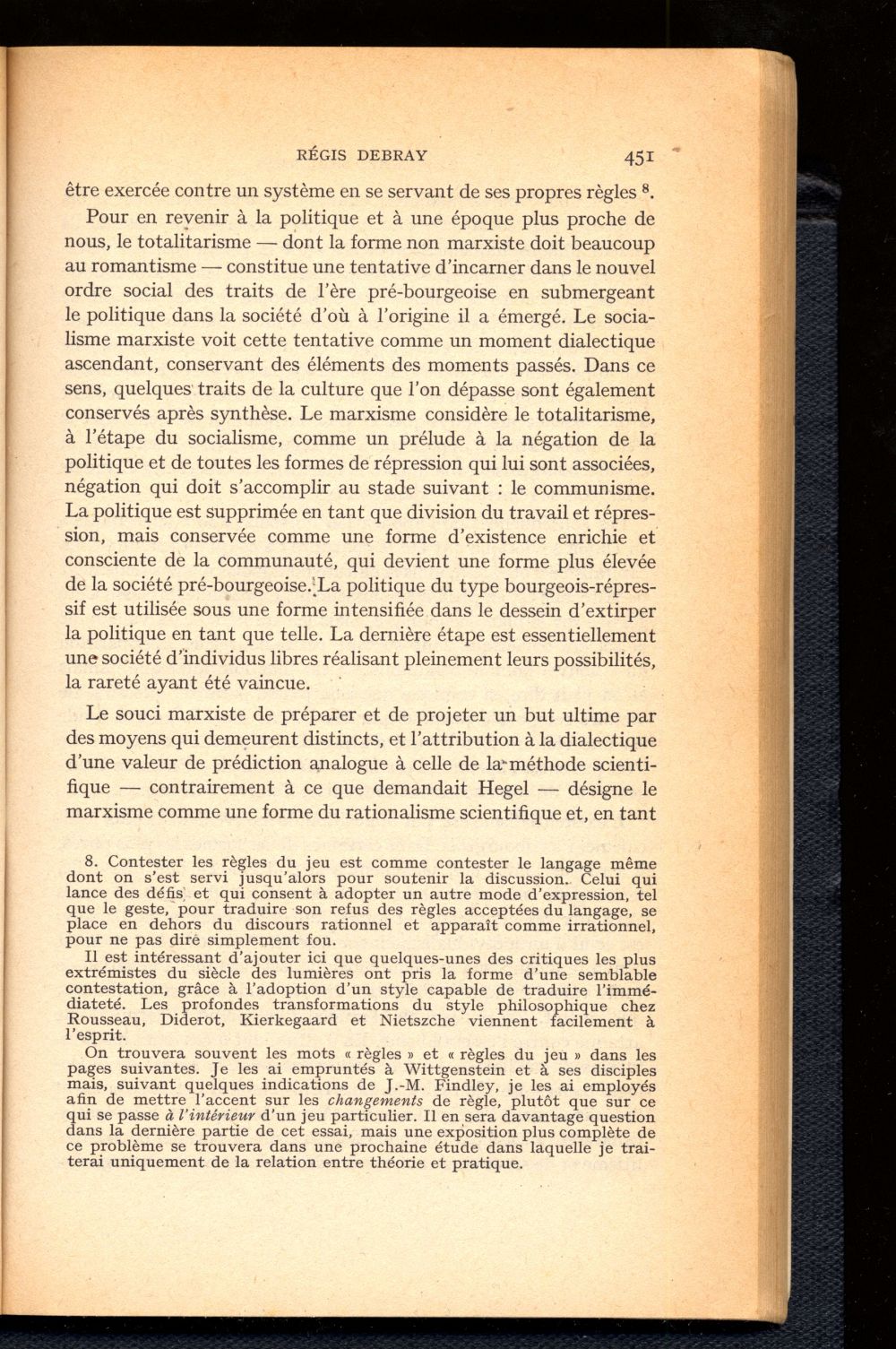

REGIS DEBRAY
451
être exercée contre un système en se servant de ses propres règles 8.
Pour en revenir à la politique et à une époque plus proche de
nous, le totalitarisme — dont la forme non marxiste doit beaucoup
au romantisme — constitue une tentative d'incarner dans le nouvel
ordre social des traits de l'ère pré-bourgeoise en submergeant
le politique dans la société d'où à l'origine il a émergé. Le socia-
lisme marxiste voit cette tentative comme un moment dialectique
ascendant, conservant des éléments des moments passés. Dans ce
sens, quelques traits de la culture que l'on dépasse sont également
conservés après synthèse. Le marxisme considère le totalitarisme,
à l'étape du socialisme, comme un prélude à la négation de la
politique et de toutes les formes de répression qui lui sont associées,
négation qui doit s'accomplir au stade suivant : le communisme.
La politique est supprimée en tant que division du travail et répres-
sion, mais conservée comme une forme d'existence enrichie et
consciente de la communauté, qui devient une forme plus élevée
de la société pré-bourgeoise.;La politique du type bourgeois-répres-
sif est utilisée sous une forme intensifiée dans le dessein d'extirper
la politique en tant que telle. La dernière étape est essentiellement
une société d'individus libres réalisant pleinement leurs possibilités,
la rareté ayant été vaincue.
Pour en revenir à la politique et à une époque plus proche de
nous, le totalitarisme — dont la forme non marxiste doit beaucoup
au romantisme — constitue une tentative d'incarner dans le nouvel
ordre social des traits de l'ère pré-bourgeoise en submergeant
le politique dans la société d'où à l'origine il a émergé. Le socia-
lisme marxiste voit cette tentative comme un moment dialectique
ascendant, conservant des éléments des moments passés. Dans ce
sens, quelques traits de la culture que l'on dépasse sont également
conservés après synthèse. Le marxisme considère le totalitarisme,
à l'étape du socialisme, comme un prélude à la négation de la
politique et de toutes les formes de répression qui lui sont associées,
négation qui doit s'accomplir au stade suivant : le communisme.
La politique est supprimée en tant que division du travail et répres-
sion, mais conservée comme une forme d'existence enrichie et
consciente de la communauté, qui devient une forme plus élevée
de la société pré-bourgeoise.;La politique du type bourgeois-répres-
sif est utilisée sous une forme intensifiée dans le dessein d'extirper
la politique en tant que telle. La dernière étape est essentiellement
une société d'individus libres réalisant pleinement leurs possibilités,
la rareté ayant été vaincue.
Le souci marxiste de préparer et de projeter un but ultime par
des moyens qui demeurent distincts, et l'attribution à la dialectique
d'une valeur de prédiction analogue à celle de la~ méthode scienti-
fique — contrairement à ce que demandait Hegel — désigne le
marxisme comme une forme du rationalisme scientifique et, en tant
des moyens qui demeurent distincts, et l'attribution à la dialectique
d'une valeur de prédiction analogue à celle de la~ méthode scienti-
fique — contrairement à ce que demandait Hegel — désigne le
marxisme comme une forme du rationalisme scientifique et, en tant
8. Contester les règles du jeu est comme contester le langage même
dont on s'est servi jusqu'alors pour soutenir la discussion. Celui qui
lance des défis et qui consent à adopter un autre mode d'expression, tel
que le geste, pour traduire son refus des règles acceptées du langage, se
place en dehors du discours rationnel et apparaît comme irrationnel,
pour ne pas dire simplement fou.
dont on s'est servi jusqu'alors pour soutenir la discussion. Celui qui
lance des défis et qui consent à adopter un autre mode d'expression, tel
que le geste, pour traduire son refus des règles acceptées du langage, se
place en dehors du discours rationnel et apparaît comme irrationnel,
pour ne pas dire simplement fou.
Il est intéressant d'ajouter ici que quelques-unes des critiques les plus
extrémistes du siècle des lumières ont pris la forme d'une semblable
contestation, grâce à l'adoption d'un style capable de traduire l'immé-
diateté. Les profondes transformations du style philosophique chez
Rousseau, Diderot, Kierkegaard et Nietszche viennent facilement à
l'esprit.
extrémistes du siècle des lumières ont pris la forme d'une semblable
contestation, grâce à l'adoption d'un style capable de traduire l'immé-
diateté. Les profondes transformations du style philosophique chez
Rousseau, Diderot, Kierkegaard et Nietszche viennent facilement à
l'esprit.
On trouvera souvent les mots « règles » et « règles du jeu » dans les
pages suivantes. Je les ai empruntés à Wittgenstein et à ses disciples
mais, suivant quelques indications de J.-M. Findley, je les ai employés
afin de mettre l'accent sur les changements de règle, plutôt que sur ce
qui se passe à l'intérieur d'un jeu particulier. Il en sera davantage question
dans la dernière partie de cet essai, mais une exposition plus complète de
ce problème se trouvera dans une prochaine étude dans laquelle je trai-
terai uniquement de la relation entre théorie et pratique.
pages suivantes. Je les ai empruntés à Wittgenstein et à ses disciples
mais, suivant quelques indications de J.-M. Findley, je les ai employés
afin de mettre l'accent sur les changements de règle, plutôt que sur ce
qui se passe à l'intérieur d'un jeu particulier. Il en sera davantage question
dans la dernière partie de cet essai, mais une exposition plus complète de
ce problème se trouvera dans une prochaine étude dans laquelle je trai-
terai uniquement de la relation entre théorie et pratique.
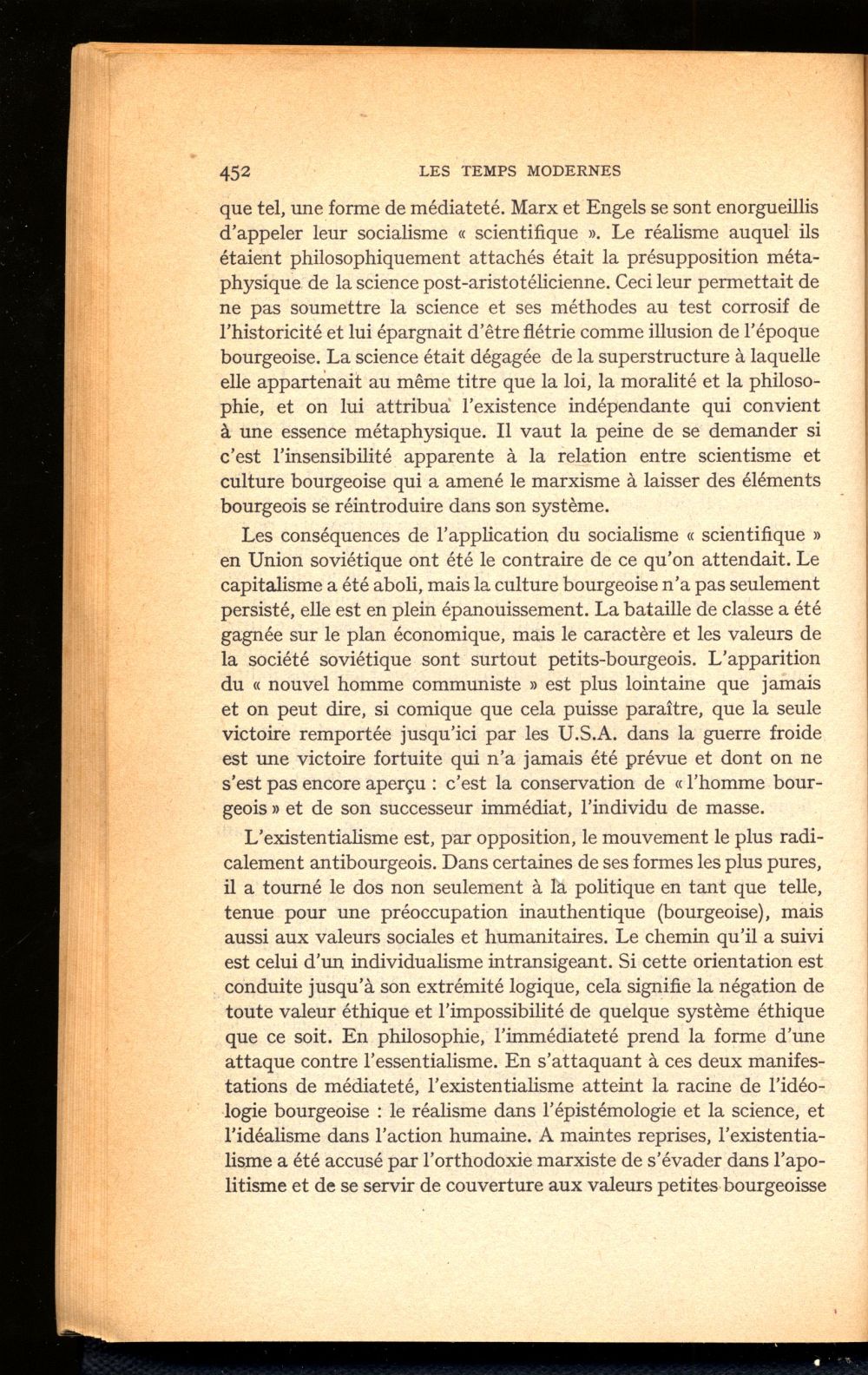

452
LES TEMPS MODERNES
que tel, une forme de médiateté. Marx et Engels se sont enorgueillis
d'appeler leur socialisme « scientifique ». Le réalisme auquel ils
étaient philosophiquement attachés était la présupposition méta-
physique de la science post-aristotélicienne. Ceci leur permettait de
ne pas soumettre la science et ses méthodes au test corrosif de
l'historicité et lui épargnait d'être flétrie comme illusion de l'époque
bourgeoise. La science était dégagée de la superstructure à laquelle
elle appartenait au même titre que la loi, la moralité et la philoso-
phie, et on lui attribua l'existence indépendante qui convient
à une essence métaphysique. Il vaut la peine de se demander si
c'est l'insensibilité apparente à la relation entre scientisme et
culture bourgeoise qui a amené le marxisme à laisser des éléments
bourgeois se réintroduire dans son système.
d'appeler leur socialisme « scientifique ». Le réalisme auquel ils
étaient philosophiquement attachés était la présupposition méta-
physique de la science post-aristotélicienne. Ceci leur permettait de
ne pas soumettre la science et ses méthodes au test corrosif de
l'historicité et lui épargnait d'être flétrie comme illusion de l'époque
bourgeoise. La science était dégagée de la superstructure à laquelle
elle appartenait au même titre que la loi, la moralité et la philoso-
phie, et on lui attribua l'existence indépendante qui convient
à une essence métaphysique. Il vaut la peine de se demander si
c'est l'insensibilité apparente à la relation entre scientisme et
culture bourgeoise qui a amené le marxisme à laisser des éléments
bourgeois se réintroduire dans son système.
Les conséquences de l'application du socialisme « scientifique »
en Union soviétique ont été le contraire de ce qu'on attendait. Le
capitalisme a été aboli, mais la culture bourgeoise n'a pas seulement
persisté, elle est en plein épanouissement. La bataille de classe a été
gagnée sur le plan économique, mais le caractère et les valeurs de
la société soviétique sont surtout petits-bourgeois. L'apparition
du « nouvel homme communiste » est plus lointaine que jamais
et on peut dire, si comique que cela puisse paraître, que la seule
victoire remportée jusqu'ici par les U.S.A. dans la guerre froide
est une victoire fortuite qui n'a jamais été prévue et dont on ne
s'est pas encore aperçu : c'est la conservation de « l'homme bour-
geois » et de son successeur immédiat, l'individu de masse.
en Union soviétique ont été le contraire de ce qu'on attendait. Le
capitalisme a été aboli, mais la culture bourgeoise n'a pas seulement
persisté, elle est en plein épanouissement. La bataille de classe a été
gagnée sur le plan économique, mais le caractère et les valeurs de
la société soviétique sont surtout petits-bourgeois. L'apparition
du « nouvel homme communiste » est plus lointaine que jamais
et on peut dire, si comique que cela puisse paraître, que la seule
victoire remportée jusqu'ici par les U.S.A. dans la guerre froide
est une victoire fortuite qui n'a jamais été prévue et dont on ne
s'est pas encore aperçu : c'est la conservation de « l'homme bour-
geois » et de son successeur immédiat, l'individu de masse.
L'existentialisme est, par opposition, le mouvement le plus radi-
calement antibourgeois. Dans certaines de ses formes les plus pures,
il a tourné le dos non seulement à la politique en tant que telle,
tenue pour une préoccupation inauthentique (bourgeoise), mais
aussi aux valeurs sociales et humanitaires. Le chemin qu'il a suivi
est celui d'un individualisme intransigeant. Si cette orientation est
conduite jusqu'à son extrémité logique, cela signifie la négation de
toute valeur éthique et l'impossibilité de quelque système éthique
que ce soit. En philosophie, l'immédiateté prend la forme d'une
attaque contre l'essentialisme. En s'attaquant à ces deux manifes-
tations de médiateté, l'existentialisme atteint la racine de l'idéo-
logie bourgeoise : le réalisme dans l'épistémologie et la science, et
l'idéalisme dans l'action humaine. A maintes reprises, l'existentia-
lisme a été accusé par l'orthodoxie marxiste de s'évader dans l'apo-
litisme et de se servir de couverture aux valeurs petites bourgeoisse
calement antibourgeois. Dans certaines de ses formes les plus pures,
il a tourné le dos non seulement à la politique en tant que telle,
tenue pour une préoccupation inauthentique (bourgeoise), mais
aussi aux valeurs sociales et humanitaires. Le chemin qu'il a suivi
est celui d'un individualisme intransigeant. Si cette orientation est
conduite jusqu'à son extrémité logique, cela signifie la négation de
toute valeur éthique et l'impossibilité de quelque système éthique
que ce soit. En philosophie, l'immédiateté prend la forme d'une
attaque contre l'essentialisme. En s'attaquant à ces deux manifes-
tations de médiateté, l'existentialisme atteint la racine de l'idéo-
logie bourgeoise : le réalisme dans l'épistémologie et la science, et
l'idéalisme dans l'action humaine. A maintes reprises, l'existentia-
lisme a été accusé par l'orthodoxie marxiste de s'évader dans l'apo-
litisme et de se servir de couverture aux valeurs petites bourgeoisse
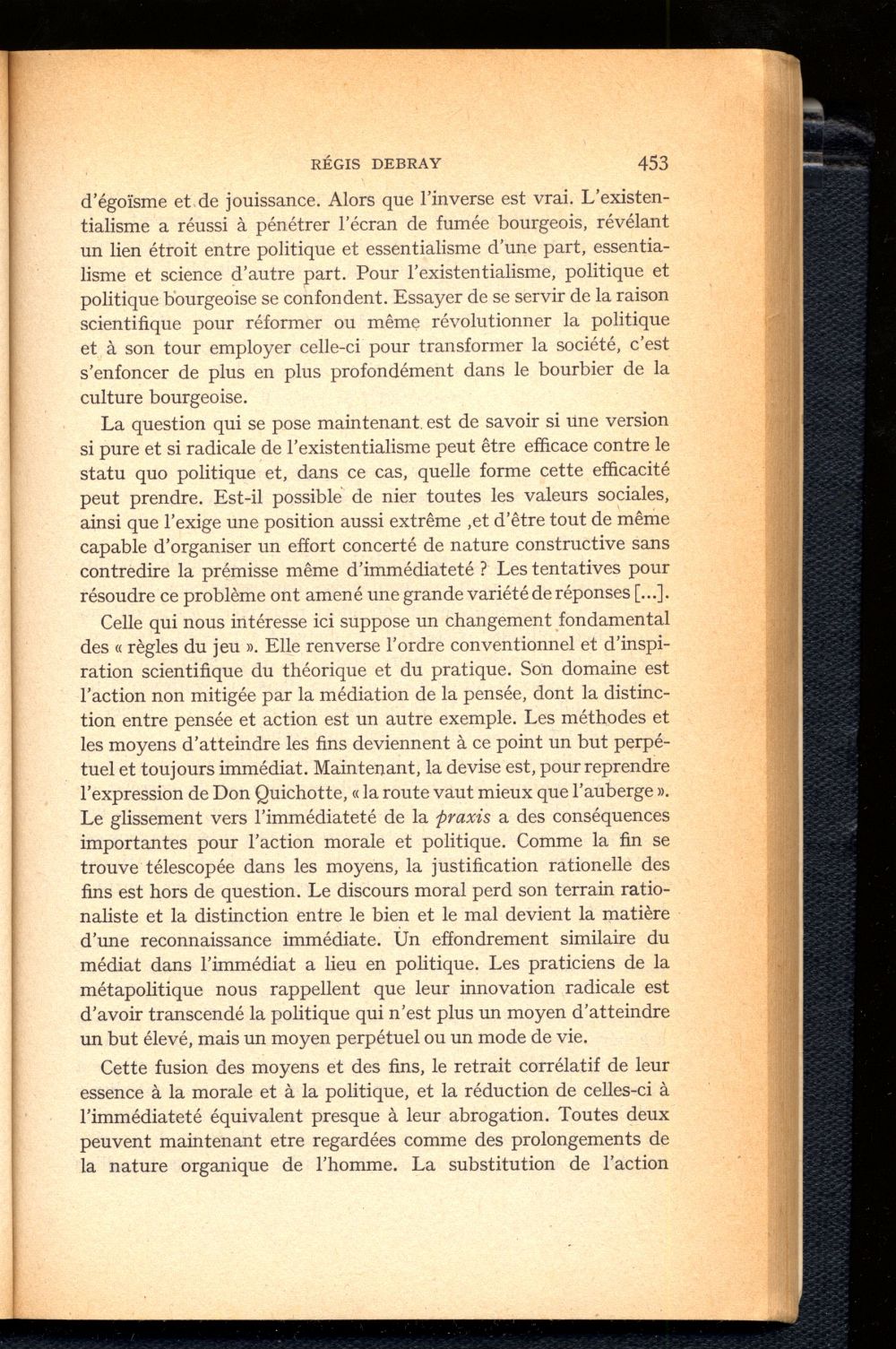

REGIS DEBRAY
453
d'égoïsme et de jouissance. Alors que l'inverse est vrai. L'existen-
tialisme a réussi à pénétrer l'écran de fumée bourgeois, révélant
un lien étroit entre politique et essentialisme d'une part, essentia-
lisme et science d'autre part. Pour l'existentialisme, politique et
politique bourgeoise se confondent. Essayer de se servir de la raison
scientifique pour réformer ou même révolutionner la politique
et à son tour employer celle-ci pour transformer la société, c'est
s'enfoncer de plus en plus profondément dans le bourbier clé la
culture bourgeoise.
tialisme a réussi à pénétrer l'écran de fumée bourgeois, révélant
un lien étroit entre politique et essentialisme d'une part, essentia-
lisme et science d'autre part. Pour l'existentialisme, politique et
politique bourgeoise se confondent. Essayer de se servir de la raison
scientifique pour réformer ou même révolutionner la politique
et à son tour employer celle-ci pour transformer la société, c'est
s'enfoncer de plus en plus profondément dans le bourbier clé la
culture bourgeoise.
La question qui se pose maintenant, est de savoir si une version
si pure et si radicale de l'existentialisme peut être efficace contre le
statu quo politique et, dans ce cas, quelle forme cette efficacité
peut prendre. Est-il possible de nier toutes les valeurs sociales,
ainsi que l'exige une position aussi extrême ,et d'être tout de même
capable d'organiser un effort concerté de nature constructive sans
contredire la prémisse même d'immédiateté ? Les tentatives pour
résoudre ce problème ont amen é une grande variété de réponses [...].
si pure et si radicale de l'existentialisme peut être efficace contre le
statu quo politique et, dans ce cas, quelle forme cette efficacité
peut prendre. Est-il possible de nier toutes les valeurs sociales,
ainsi que l'exige une position aussi extrême ,et d'être tout de même
capable d'organiser un effort concerté de nature constructive sans
contredire la prémisse même d'immédiateté ? Les tentatives pour
résoudre ce problème ont amen é une grande variété de réponses [...].
Celle qui nous intéresse ici suppose un changement fondamental
des « règles du jeu ». Elle renverse l'ordre conventionnel et d'inspi-
ration scientifique du théorique et du pratique. Son domaine est
l'action non mitigée par la médiation de la pensée, dont la distinc-
tion entre pensée et action est un autre exemple. Les méthodes et
les moyens d'atteindre les fins deviennent à ce point un but perpé-
tuel et toujours immédiat. Maintenant, la devise est, pour reprendre
l'expression de Don Quichotte, « la route vaut mieux que l'auberge ».
Le glissement vers l'immédiateté de la praxis a des conséquences
importantes pour l'action morale et politique. Comme la fin se
trouve télescopée dans les moyens, la justification rationelle des
fins est hors de question. Le discours moral perd son terrain ratio-
naliste et la distinction entre le bien et le mal devient la matière
d'une reconnaissance immédiate. Un effondrement similaire du
médiat dans l'immédiat a lieu en politique. Les praticiens de la
métapolitique nous rappellent que leur innovation radicale est
d'avoir transcendé la politique qui n'est plus un moyen d'atteindre
un but élevé, mais un moyen perpétuel ou un mode de vie.
des « règles du jeu ». Elle renverse l'ordre conventionnel et d'inspi-
ration scientifique du théorique et du pratique. Son domaine est
l'action non mitigée par la médiation de la pensée, dont la distinc-
tion entre pensée et action est un autre exemple. Les méthodes et
les moyens d'atteindre les fins deviennent à ce point un but perpé-
tuel et toujours immédiat. Maintenant, la devise est, pour reprendre
l'expression de Don Quichotte, « la route vaut mieux que l'auberge ».
Le glissement vers l'immédiateté de la praxis a des conséquences
importantes pour l'action morale et politique. Comme la fin se
trouve télescopée dans les moyens, la justification rationelle des
fins est hors de question. Le discours moral perd son terrain ratio-
naliste et la distinction entre le bien et le mal devient la matière
d'une reconnaissance immédiate. Un effondrement similaire du
médiat dans l'immédiat a lieu en politique. Les praticiens de la
métapolitique nous rappellent que leur innovation radicale est
d'avoir transcendé la politique qui n'est plus un moyen d'atteindre
un but élevé, mais un moyen perpétuel ou un mode de vie.
Cette fusion des moyens et des fins, le retrait corrélatif de leur
essence à la morale et à la politique, et la réduction de celles-ci à
l'immédiateté équivalent presque à leur abrogation. Toutes deux
peuvent maintenant être regardées comme des prolongements de
la nature organique de l'homme. La substitution de l'action
essence à la morale et à la politique, et la réduction de celles-ci à
l'immédiateté équivalent presque à leur abrogation. Toutes deux
peuvent maintenant être regardées comme des prolongements de
la nature organique de l'homme. La substitution de l'action
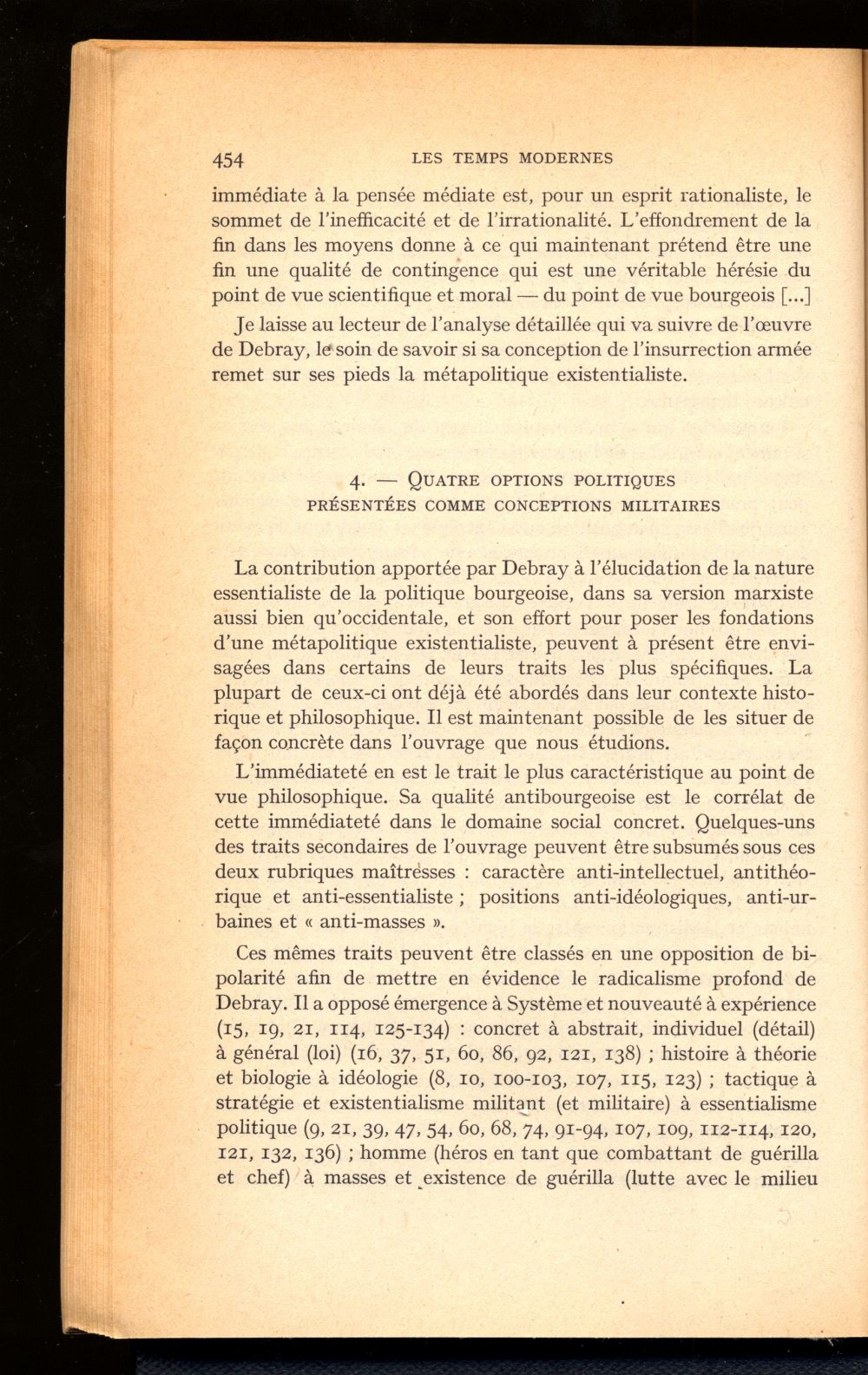

454 LES TEMPS MODERNES
immédiate à la pensée médiate est, pour un esprit rationaliste, le
sommet de l'inefficacité et de l'irrationalité. L'effondrement de la
fin dans les moyens donne à ce qui maintenant prétend être une
fin une qualité de contingence qui est une véritable hérésie du
point de vue scientifique et moral — du point de vue bourgeois [...]
Je laisse au lecteur de l'analyse détaillée qui va suivre de l'œuvre
de Debray, le soin de savoir si sa conception de l'insurrection armée
remet sur ses pieds la métapolitique existentialiste.
sommet de l'inefficacité et de l'irrationalité. L'effondrement de la
fin dans les moyens donne à ce qui maintenant prétend être une
fin une qualité de contingence qui est une véritable hérésie du
point de vue scientifique et moral — du point de vue bourgeois [...]
Je laisse au lecteur de l'analyse détaillée qui va suivre de l'œuvre
de Debray, le soin de savoir si sa conception de l'insurrection armée
remet sur ses pieds la métapolitique existentialiste.
4. — QUATRE OPTIONS POLITIQUES
PRÉSENTÉES COMME CONCEPTIONS MILITAIRES
PRÉSENTÉES COMME CONCEPTIONS MILITAIRES
La contribution apportée par Debray à l'élucidation de la nature
essentialiste de la politique bourgeoise, dans sa version marxiste
aussi bien qu'occidentale, et son effort pour poser les fondations
d'une métapolitique existentialiste, peuvent à présent être envi-
sagées dans certains de leurs traits les plus spécifiques. La
plupart de ceux-ci ont déjà été abordés dans leur contexte histo-
rique et philosophique. Il est maintenant possible de les situer de
façon concrète dans l'ouvrage que nous étudions.
essentialiste de la politique bourgeoise, dans sa version marxiste
aussi bien qu'occidentale, et son effort pour poser les fondations
d'une métapolitique existentialiste, peuvent à présent être envi-
sagées dans certains de leurs traits les plus spécifiques. La
plupart de ceux-ci ont déjà été abordés dans leur contexte histo-
rique et philosophique. Il est maintenant possible de les situer de
façon concrète dans l'ouvrage que nous étudions.
L'immédiateté en est le trait le plus caractéristique au point de
vue philosophique. Sa qualité antibourgeoise est le corrélat de
cette immédiateté dans le domaine social concret. Quelques-uns
des traits secondaires de l'ouvrage peuvent être subsumés sous ces
deux rubriques maîtresses : caractère anti-intellectuel, antithéo-
rique et anti-essentialiste ; positions anti-idéologiques, anti-ur-
baines et « anti-masses ».
vue philosophique. Sa qualité antibourgeoise est le corrélat de
cette immédiateté dans le domaine social concret. Quelques-uns
des traits secondaires de l'ouvrage peuvent être subsumés sous ces
deux rubriques maîtresses : caractère anti-intellectuel, antithéo-
rique et anti-essentialiste ; positions anti-idéologiques, anti-ur-
baines et « anti-masses ».
Ces mêmes traits peuvent être classés en une opposition de bi-
polarité afin de mettre en évidence le radicalisme profond de
Debray. Il a opposé émergence à Système et nouveauté à expérience
(15, 19, 21, 114, 125-134) : concret à abstrait, individuel (détail)
à général (loi) (16, 37, 51, 60, 86, 92, 121, 138) ; histoire à théorie
et biologie à idéologie (8, 10, 100-103, 107, 115, 123) ; tactique à
stratégie et existentialisme militant (et militaire) à essentialisme
politique (9, 21, 39, 47, 54, 60, 68, 74, 91-94, 107, 109, 112-114, 120,
121, 132, 136) ; homme (héros en tant que combattant de guérilla
et chef) à masses et existence de guérilla (lutte avec le milieu
polarité afin de mettre en évidence le radicalisme profond de
Debray. Il a opposé émergence à Système et nouveauté à expérience
(15, 19, 21, 114, 125-134) : concret à abstrait, individuel (détail)
à général (loi) (16, 37, 51, 60, 86, 92, 121, 138) ; histoire à théorie
et biologie à idéologie (8, 10, 100-103, 107, 115, 123) ; tactique à
stratégie et existentialisme militant (et militaire) à essentialisme
politique (9, 21, 39, 47, 54, 60, 68, 74, 91-94, 107, 109, 112-114, 120,
121, 132, 136) ; homme (héros en tant que combattant de guérilla
et chef) à masses et existence de guérilla (lutte avec le milieu
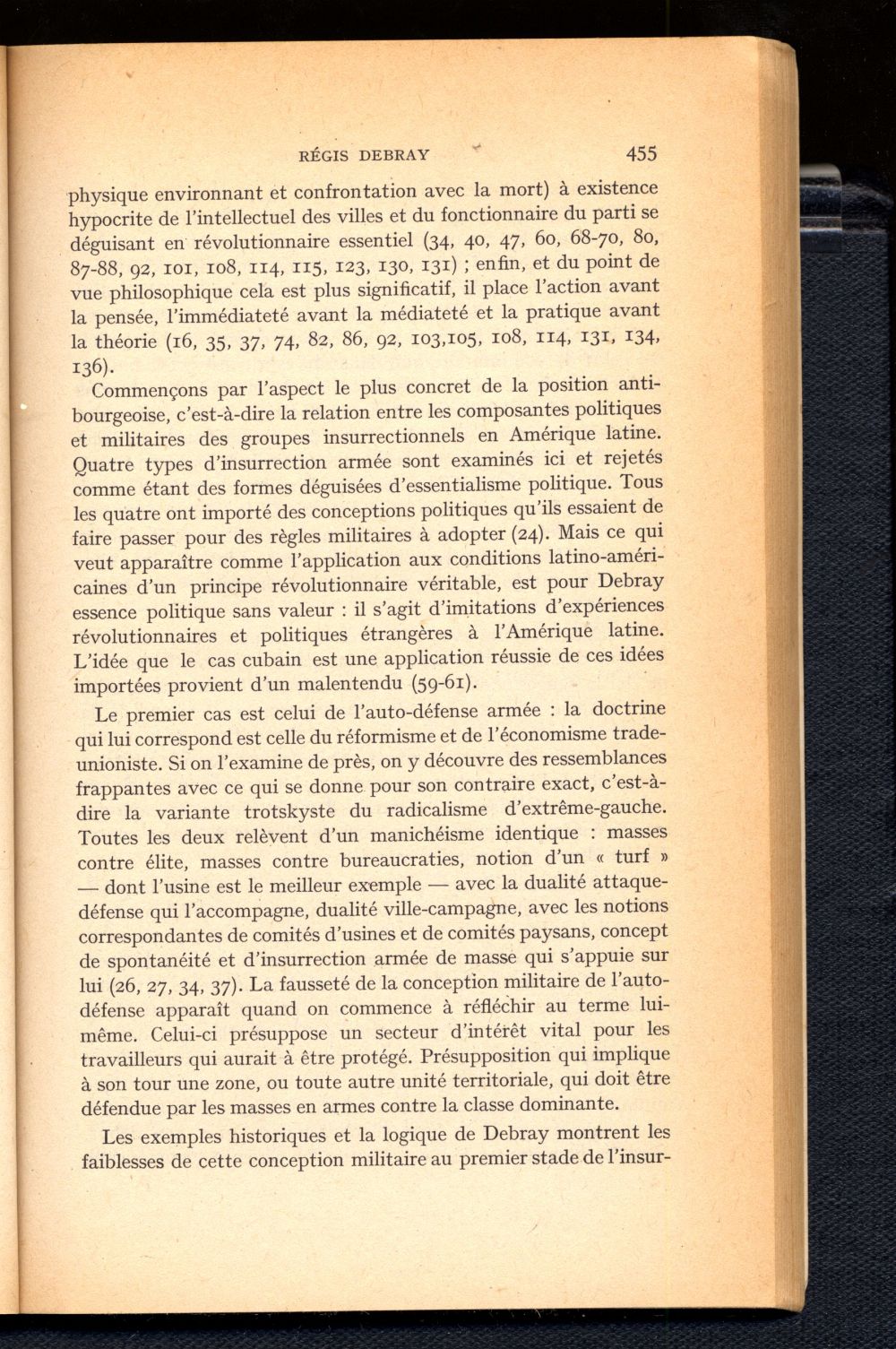

RÉGIS DEBRAY ' 455
physique environnant et confrontation avec la mort) à existence
hypocrite de l'intellectuel des villes et du fonctionnaire du parti se
déguisant en révolutionnaire essentiel (34, 40, 47, 60, 68-70, 80,
87-88, 92, 101, 108, 114, 115, 123, 130, 131) ; enfin, et du point de
vue philosophique cela est plus significatif, il place l'action avant
la pensée, l'immédiateté avant la médiateté et la pratique avant
la théorie (16, 35, 37, 74, 82, 86, 92, 103,105, 108, 114, 131, 134,
136).
hypocrite de l'intellectuel des villes et du fonctionnaire du parti se
déguisant en révolutionnaire essentiel (34, 40, 47, 60, 68-70, 80,
87-88, 92, 101, 108, 114, 115, 123, 130, 131) ; enfin, et du point de
vue philosophique cela est plus significatif, il place l'action avant
la pensée, l'immédiateté avant la médiateté et la pratique avant
la théorie (16, 35, 37, 74, 82, 86, 92, 103,105, 108, 114, 131, 134,
136).
Commençons par l'aspect le plus concret de la position anti-
bourgeoise, c'est-à-dire la relation entre les composantes politiques
et militaires des groupes insurrectionnels en Amérique latine.
Quatre types d'insurrection armée sont examinés ici et rejetés
comme étant des formes déguisées d'essentialisme politique. Tous
les quatre ont importe des conceptions politiques qu'ils essaient de
faire passer pour des règles militaires à adopter (24). Mais ce qui
veut apparaître comme l'application aux conditions latino-améri-
caines d'un principe révolutionnaire véritable, est pour Debray
essence politique sans valeur : il s'agit d'imitations d'expériences
révolutionnaires et politiques étrangères à l'Amérique latine.
L'idée que le cas cubain est une application réussie de ces idées
importées provient d'un malentendu (59-61).
bourgeoise, c'est-à-dire la relation entre les composantes politiques
et militaires des groupes insurrectionnels en Amérique latine.
Quatre types d'insurrection armée sont examinés ici et rejetés
comme étant des formes déguisées d'essentialisme politique. Tous
les quatre ont importe des conceptions politiques qu'ils essaient de
faire passer pour des règles militaires à adopter (24). Mais ce qui
veut apparaître comme l'application aux conditions latino-améri-
caines d'un principe révolutionnaire véritable, est pour Debray
essence politique sans valeur : il s'agit d'imitations d'expériences
révolutionnaires et politiques étrangères à l'Amérique latine.
L'idée que le cas cubain est une application réussie de ces idées
importées provient d'un malentendu (59-61).
Le premier cas est celui de l'auto-défense armée : la doctrine
qui lui correspond est celle du réformisme et de l'économisme trade-
unioniste. Si on l'examine de près, on y découvre des ressemblances
frappantes avec ce qui se donne pour son contraire exact, c'est-à-
dire la variante trotskyste du radicalisme d'extrême-gauche.
Toutes les deux relèvent d'un manichéisme identique : masses
contre élite, masses contre bureaucraties, notion d'un « turf »
— dont l'usine est le meilleur exemple — avec la dualité attaque-
défense qui l'accompagne, dualité ville-campagne, avec les notions
correspondantes de comités d'usines et de comités paysans, concept
de spontanéité et d'insurrection armée de masse qui s'appuie sur
lui (26, 27, 34, 37). La fausseté de la conception militaire de l'auto-
défense apparaît quand on commence à réfléchir au terme lui-
même. Celui-ci présuppose un secteur d'intérêt vital pour les
travailleurs qui aurait à être protégé. Présupposition qui implique
à son tour une zone, ou toute autre unité territoriale, qui doit être
défendue par les masses en armes contre la classe dominante.
qui lui correspond est celle du réformisme et de l'économisme trade-
unioniste. Si on l'examine de près, on y découvre des ressemblances
frappantes avec ce qui se donne pour son contraire exact, c'est-à-
dire la variante trotskyste du radicalisme d'extrême-gauche.
Toutes les deux relèvent d'un manichéisme identique : masses
contre élite, masses contre bureaucraties, notion d'un « turf »
— dont l'usine est le meilleur exemple — avec la dualité attaque-
défense qui l'accompagne, dualité ville-campagne, avec les notions
correspondantes de comités d'usines et de comités paysans, concept
de spontanéité et d'insurrection armée de masse qui s'appuie sur
lui (26, 27, 34, 37). La fausseté de la conception militaire de l'auto-
défense apparaît quand on commence à réfléchir au terme lui-
même. Celui-ci présuppose un secteur d'intérêt vital pour les
travailleurs qui aurait à être protégé. Présupposition qui implique
à son tour une zone, ou toute autre unité territoriale, qui doit être
défendue par les masses en armes contre la classe dominante.
Les exemples historiques et la logique de Debray montrent les
faiblesses de cette conception militaire au premier stade de l'insur-
faiblesses de cette conception militaire au premier stade de l'insur-
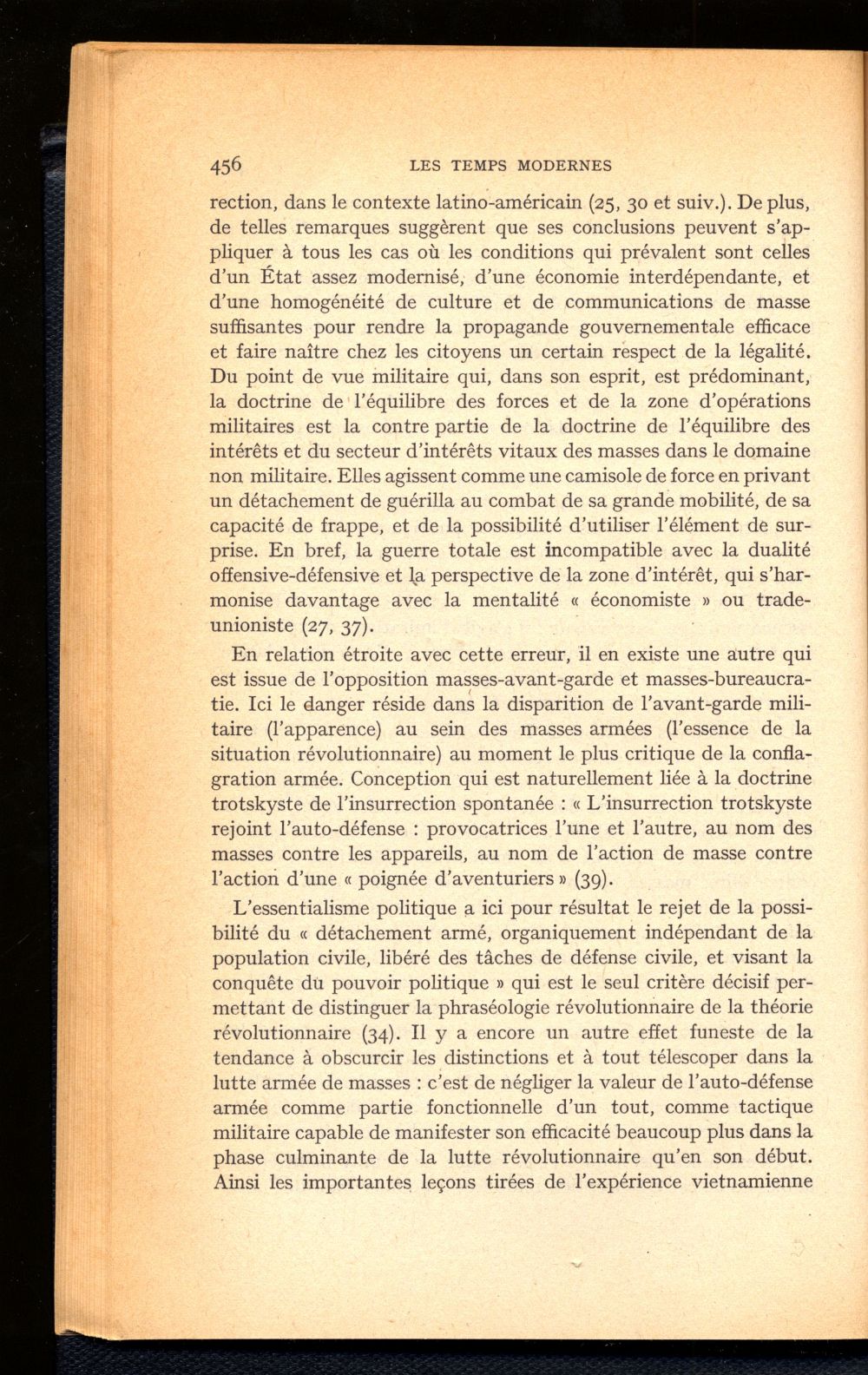

456 LES TEMPS MODERNES
rection, dans le contexte latino-américain (25, 30 et suiv.). De plus,
de telles remarques suggèrent que ses conclusions peuvent s'ap-
pliquer à tous les cas où les conditions qui prévalent sont celles
d'un État assez modernisé, d'une économie interdépendante, et
d'une homogénéité de culture et de communications de masse
suffisantes pour rendre la propagande gouvernementale efficace
et faire naître chez les citoyens un certain respect de la légalité.
Du point de vue militaire qui, dans son esprit, est prédominant,
la doctrine de l'équilibre des forces et de la zone d'opérations
militaires est la contre partie de la doctrine de l'équilibre des
intérêts et du secteur d'intérêts vitaux des masses dans le domaine
non militaire. Elles agissent comme une camisole de force en privant
un détachement de guérilla au combat de sa grande mobilité, de sa
capacité de frappe, et de la possibilité d'utiliser l'élément de sur-
prise. En bref, la guerre totale est incompatible avec la dualité
offensive-défensive et la perspective de la zone d'intérêt, qui s'har-
monise davantage avec la mentalité « économiste » ou trade-
unioniste (27, 37).
de telles remarques suggèrent que ses conclusions peuvent s'ap-
pliquer à tous les cas où les conditions qui prévalent sont celles
d'un État assez modernisé, d'une économie interdépendante, et
d'une homogénéité de culture et de communications de masse
suffisantes pour rendre la propagande gouvernementale efficace
et faire naître chez les citoyens un certain respect de la légalité.
Du point de vue militaire qui, dans son esprit, est prédominant,
la doctrine de l'équilibre des forces et de la zone d'opérations
militaires est la contre partie de la doctrine de l'équilibre des
intérêts et du secteur d'intérêts vitaux des masses dans le domaine
non militaire. Elles agissent comme une camisole de force en privant
un détachement de guérilla au combat de sa grande mobilité, de sa
capacité de frappe, et de la possibilité d'utiliser l'élément de sur-
prise. En bref, la guerre totale est incompatible avec la dualité
offensive-défensive et la perspective de la zone d'intérêt, qui s'har-
monise davantage avec la mentalité « économiste » ou trade-
unioniste (27, 37).
En relation étroite avec cette erreur, il en existe une autre qui
est issue de l'opposition masses-avant-garde et masses-bureaucra-
tie. Ici le danger réside dans la disparition de l'avant-garde mili-
taire (l'apparence) au sein des masses armées (l'essence de la
situation révolutionnaire) au moment le plus critique de la confla-
gration armée. Conception qui est naturellement liée à la doctrine
trotskyste de l'insurrection spontanée : « L'insurrection trotskyste
rejoint l'auto-défense : provocatrices l'une et l'autre, au nom des
masses contre les appareils, au nom de l'action de masse contre
l'action d'une « poignée d'aventuriers » (39).
est issue de l'opposition masses-avant-garde et masses-bureaucra-
tie. Ici le danger réside dans la disparition de l'avant-garde mili-
taire (l'apparence) au sein des masses armées (l'essence de la
situation révolutionnaire) au moment le plus critique de la confla-
gration armée. Conception qui est naturellement liée à la doctrine
trotskyste de l'insurrection spontanée : « L'insurrection trotskyste
rejoint l'auto-défense : provocatrices l'une et l'autre, au nom des
masses contre les appareils, au nom de l'action de masse contre
l'action d'une « poignée d'aventuriers » (39).
L'essentialisme politique a ici pour résultat le rejet de la possi-
bilité du « détachement armé, organiquement indépendant de la
population civile, libéré des tâches de défense civile, et visant la
conquête du pouvoir politique » qui est le seul critère décisif per-
mettant de distinguer la phraséologie révolutionnaire de la théorie
révolutionnaire (34). Il y a encore un autre effet funeste de la
tendance à obscurcir les distinctions et à tout télescoper dans la
lutte armée de masses : c'est de négliger la valeur de l'auto-défense
armée comme partie fonctionnelle d'un tout, comme tactique
militaire capable de manifester son efficacité beaucoup plus dans la
phase culminante de la lutte révolutionnaire qu'en son début.
Ainsi les importantes leçons tirées de l'expérience vietnamienne
bilité du « détachement armé, organiquement indépendant de la
population civile, libéré des tâches de défense civile, et visant la
conquête du pouvoir politique » qui est le seul critère décisif per-
mettant de distinguer la phraséologie révolutionnaire de la théorie
révolutionnaire (34). Il y a encore un autre effet funeste de la
tendance à obscurcir les distinctions et à tout télescoper dans la
lutte armée de masses : c'est de négliger la valeur de l'auto-défense
armée comme partie fonctionnelle d'un tout, comme tactique
militaire capable de manifester son efficacité beaucoup plus dans la
phase culminante de la lutte révolutionnaire qu'en son début.
Ainsi les importantes leçons tirées de l'expérience vietnamienne
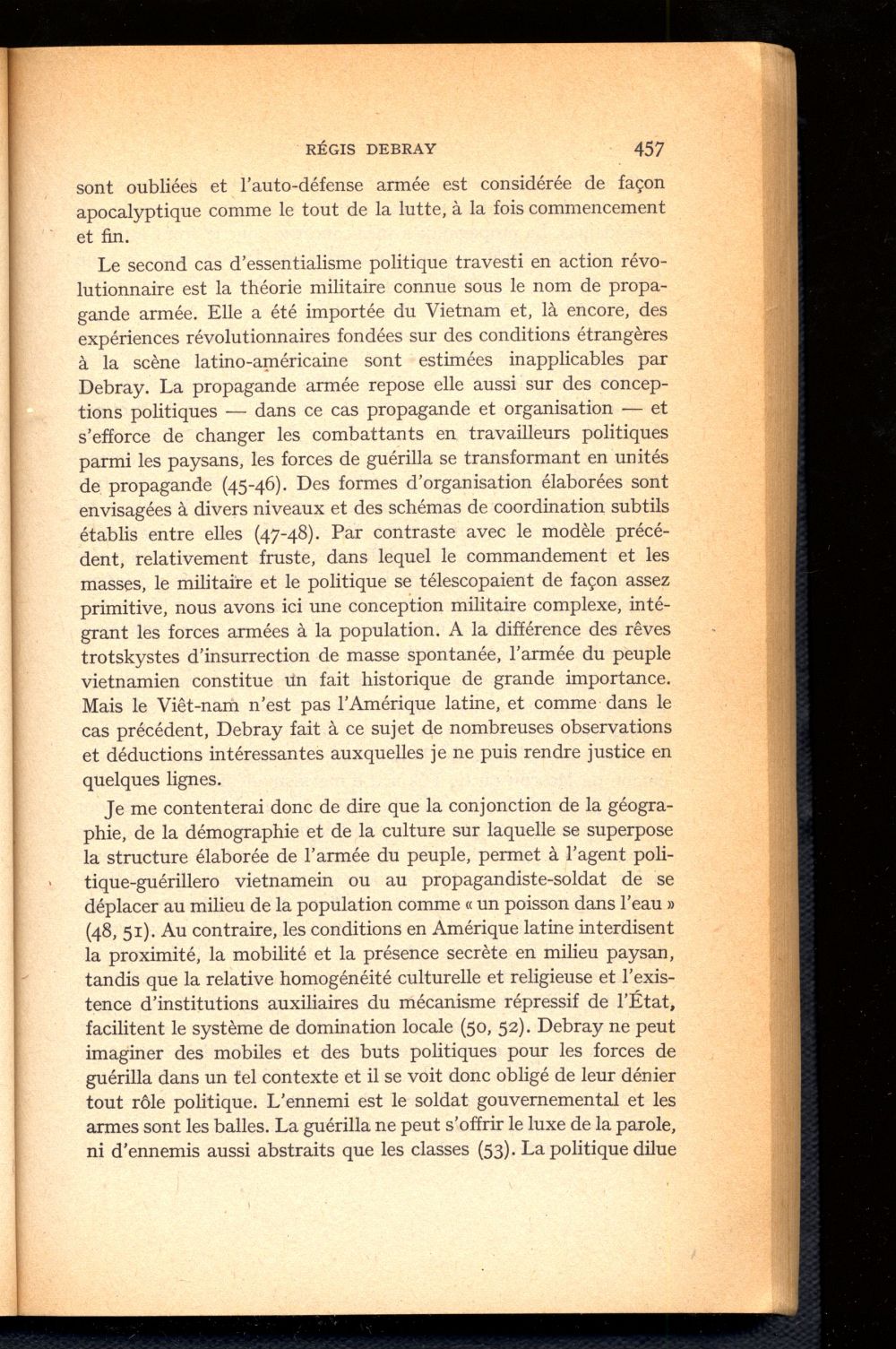

REGIS DEBRAY
457
sont oubliées et l'auto-défense armée est considérée de façon
apocalyptique comme le tout de la lutte, à la fois commencement
et fin.
apocalyptique comme le tout de la lutte, à la fois commencement
et fin.
Le second cas d'essentialisme politique travesti en action révo-
lutionnaire est la théorie militaire connue sous le nom de propa-
gande armée. Elle a été importée du Vietnam et, là encore, des
expériences révolutionnaires fondées sur des conditions étrangères
à la scène latino-américaine sont estimées inapplicables par
Debray. La propagande armée repose elle aussi sur des concep-
tions politiques — dans ce cas propagande et organisation •— et
s'efforce de changer les combattants en travailleurs politiques
parmi les paysans, les forces de guérilla se transformant en unités
de propagande (45-46). Des formes d'organisation élaborées sont
envisagées à divers niveaux et des schémas de coordination subtils
établis entre elles (47-48). Par contraste avec le modèle précé-
dent, relativement fruste, dans lequel le commandement et les
masses, le militaire et le politique se télescopaient de façon assez
primitive, nous avons ici une conception militaire complexe, inté-
grant les forces armées à la population. A la différence des rêves
trotskystes d'insurrection de masse spontanée, l'armée du peuple
vietnamien constitue un fait historique de grande importance.
Mais le Viêt-nam n'est pas l'Amérique latine, et comme dans le
cas précédent, Debray fait à ce sujet de nombreuses observations
et déductions intéressantes auxquelles je ne puis rendre justice en
quelques lignes.
lutionnaire est la théorie militaire connue sous le nom de propa-
gande armée. Elle a été importée du Vietnam et, là encore, des
expériences révolutionnaires fondées sur des conditions étrangères
à la scène latino-américaine sont estimées inapplicables par
Debray. La propagande armée repose elle aussi sur des concep-
tions politiques — dans ce cas propagande et organisation •— et
s'efforce de changer les combattants en travailleurs politiques
parmi les paysans, les forces de guérilla se transformant en unités
de propagande (45-46). Des formes d'organisation élaborées sont
envisagées à divers niveaux et des schémas de coordination subtils
établis entre elles (47-48). Par contraste avec le modèle précé-
dent, relativement fruste, dans lequel le commandement et les
masses, le militaire et le politique se télescopaient de façon assez
primitive, nous avons ici une conception militaire complexe, inté-
grant les forces armées à la population. A la différence des rêves
trotskystes d'insurrection de masse spontanée, l'armée du peuple
vietnamien constitue un fait historique de grande importance.
Mais le Viêt-nam n'est pas l'Amérique latine, et comme dans le
cas précédent, Debray fait à ce sujet de nombreuses observations
et déductions intéressantes auxquelles je ne puis rendre justice en
quelques lignes.
Je me contenterai donc de dire que la conjonction de la géogra-
phie, de la démographie et de la culture sur laquelle se superpose
la structure élaborée de l'armée du peuple, permet à l'agent poli-
tique-guérillero vietnamein ou au propagandiste-soldat de se
déplacer au milieu de la population comme « un poisson dans l'eau »
(48, 51). Au contraire, les conditions en Amérique latine interdisent
la proximité, la mobilité et la présence secrète en milieu paysan,
tandis que la relative homogénéité culturelle et religieuse et l'exis-
tence d'institutions auxiliaires du mécanisme répressif de l'État,
facilitent le système de domination locale (50, 52). Debray ne peut
imaginer des mobiles et des buts politiques pour les forces de
guérilla dans un tel contexte et il se voit donc obligé de leur dénier
tout rôle politique. L'ennemi est le soldat gouvernemental et les
armes sont les balles. La guérilla ne peut s'offrir le luxe de la parole,
ni d'ennemis aussi abstraits que les classes (53). La politique dilue
phie, de la démographie et de la culture sur laquelle se superpose
la structure élaborée de l'armée du peuple, permet à l'agent poli-
tique-guérillero vietnamein ou au propagandiste-soldat de se
déplacer au milieu de la population comme « un poisson dans l'eau »
(48, 51). Au contraire, les conditions en Amérique latine interdisent
la proximité, la mobilité et la présence secrète en milieu paysan,
tandis que la relative homogénéité culturelle et religieuse et l'exis-
tence d'institutions auxiliaires du mécanisme répressif de l'État,
facilitent le système de domination locale (50, 52). Debray ne peut
imaginer des mobiles et des buts politiques pour les forces de
guérilla dans un tel contexte et il se voit donc obligé de leur dénier
tout rôle politique. L'ennemi est le soldat gouvernemental et les
armes sont les balles. La guérilla ne peut s'offrir le luxe de la parole,
ni d'ennemis aussi abstraits que les classes (53). La politique dilue
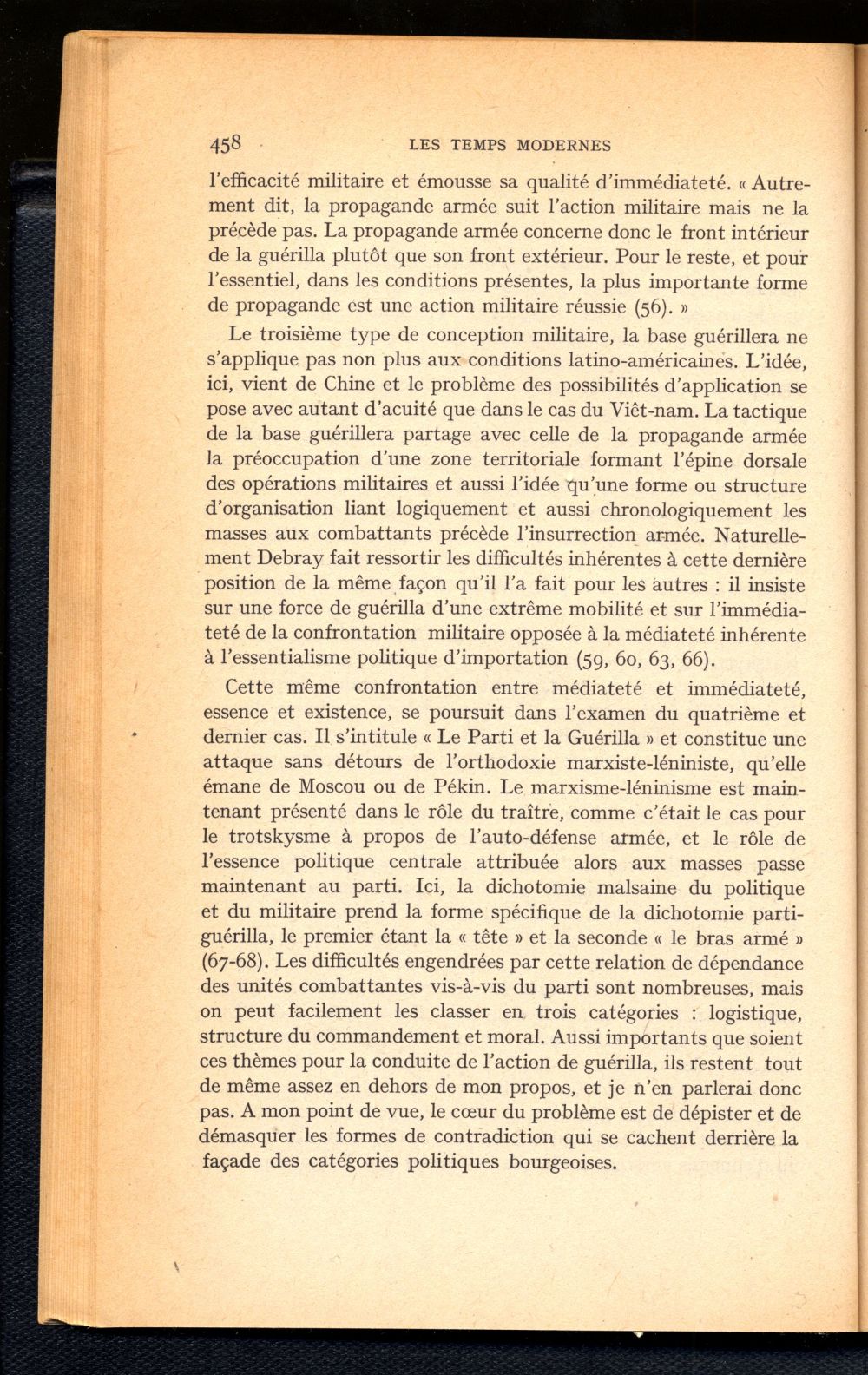

458 LES TEMPS MODERNES
l'efficacité militaire et émousse sa qualité d'immédiateté. « Autre-
ment dit, la propagande armée suit l'action militaire mais ne la
précède pas. La propagande armée concerne donc le front intérieur
de la guérilla plutôt que son front extérieur. Pour le reste, et pour
l'essentiel, dans les conditions présentes, la plus importante forme
de propagande est une action militaire réussie (56). »
ment dit, la propagande armée suit l'action militaire mais ne la
précède pas. La propagande armée concerne donc le front intérieur
de la guérilla plutôt que son front extérieur. Pour le reste, et pour
l'essentiel, dans les conditions présentes, la plus importante forme
de propagande est une action militaire réussie (56). »
Le troisième type de conception militaire, la base guérillera ne
s'applique pas non plus aux conditions latino-américaines. L'idée,
ici, vient de Chine et le problème des possibilités d'application se
pose avec autant d'acuité que dans le cas du Viêt-nam. La tactique
de la base guérillera partage avec celle de la propagande armée
la préoccupation d'une zone territoriale formant l'épine dorsale
des opérations militaires et aussi l'idée qu'une forme ou structure
d'organisation liant logiquement et aussi chronologiquement les
masses aux combattants précède l'insurrection armée. Naturelle-
ment Debray fait ressortir les difficultés inhérentes à cette dernière
position de la même façon qu'il l'a fait pour les autres : il insiste
sur une force de guérilla d'une extrême mobilité et sur l'immédia-
teté de la confrontation militaire opposée à la médiateté inhérente
à l'essentialisme politique d'importation (59, 60, 63, 66).
s'applique pas non plus aux conditions latino-américaines. L'idée,
ici, vient de Chine et le problème des possibilités d'application se
pose avec autant d'acuité que dans le cas du Viêt-nam. La tactique
de la base guérillera partage avec celle de la propagande armée
la préoccupation d'une zone territoriale formant l'épine dorsale
des opérations militaires et aussi l'idée qu'une forme ou structure
d'organisation liant logiquement et aussi chronologiquement les
masses aux combattants précède l'insurrection armée. Naturelle-
ment Debray fait ressortir les difficultés inhérentes à cette dernière
position de la même façon qu'il l'a fait pour les autres : il insiste
sur une force de guérilla d'une extrême mobilité et sur l'immédia-
teté de la confrontation militaire opposée à la médiateté inhérente
à l'essentialisme politique d'importation (59, 60, 63, 66).
Cette même confrontation entre médiateté et immédiateté,
essence et existence, se poursuit dans l'examen du quatrième et
dernier cas. Il s'intitule « Le Parti et la Guérilla » et constitue une
attaque sans détours de l'orthodoxie marxiste-léniniste, qu'elle
émane de Moscou ou de Pékin. Le marxisme-léninisme est main-
tenant présenté dans le rôle du traître, comme c'était le cas pour
le trotskysme à propos de l'auto-défense armée, et le rôle de
l'essence politique centrale attribuée alors aux masses passe
maintenant au parti. Ici, la dichotomie malsaine du politique
et du militaire prend la forme spécifique de la dichotomie parti-
guérilla, le premier étant la « tête » et la seconde « le bras armé »
(67-68). Les difficultés engendrées par cette relation de dépendance
des unités combattantes vis-à-vis du parti sont nombreuses, mais
on peut facilement les classer en trois catégories : logistique,
structure du commandement et moral. Aussi importants que soient
ces thèmes pour la conduite de l'action de guérilla, ils restent tout
de même assez en dehors de mon propos, et je n'en parlerai donc
pas. A mon point de vue, le cœur du problème est de dépister et de
démasquer les formes de contradiction qui se cachent derrière la
façade des catégories politiques bourgeoises.
essence et existence, se poursuit dans l'examen du quatrième et
dernier cas. Il s'intitule « Le Parti et la Guérilla » et constitue une
attaque sans détours de l'orthodoxie marxiste-léniniste, qu'elle
émane de Moscou ou de Pékin. Le marxisme-léninisme est main-
tenant présenté dans le rôle du traître, comme c'était le cas pour
le trotskysme à propos de l'auto-défense armée, et le rôle de
l'essence politique centrale attribuée alors aux masses passe
maintenant au parti. Ici, la dichotomie malsaine du politique
et du militaire prend la forme spécifique de la dichotomie parti-
guérilla, le premier étant la « tête » et la seconde « le bras armé »
(67-68). Les difficultés engendrées par cette relation de dépendance
des unités combattantes vis-à-vis du parti sont nombreuses, mais
on peut facilement les classer en trois catégories : logistique,
structure du commandement et moral. Aussi importants que soient
ces thèmes pour la conduite de l'action de guérilla, ils restent tout
de même assez en dehors de mon propos, et je n'en parlerai donc
pas. A mon point de vue, le cœur du problème est de dépister et de
démasquer les formes de contradiction qui se cachent derrière la
façade des catégories politiques bourgeoises.
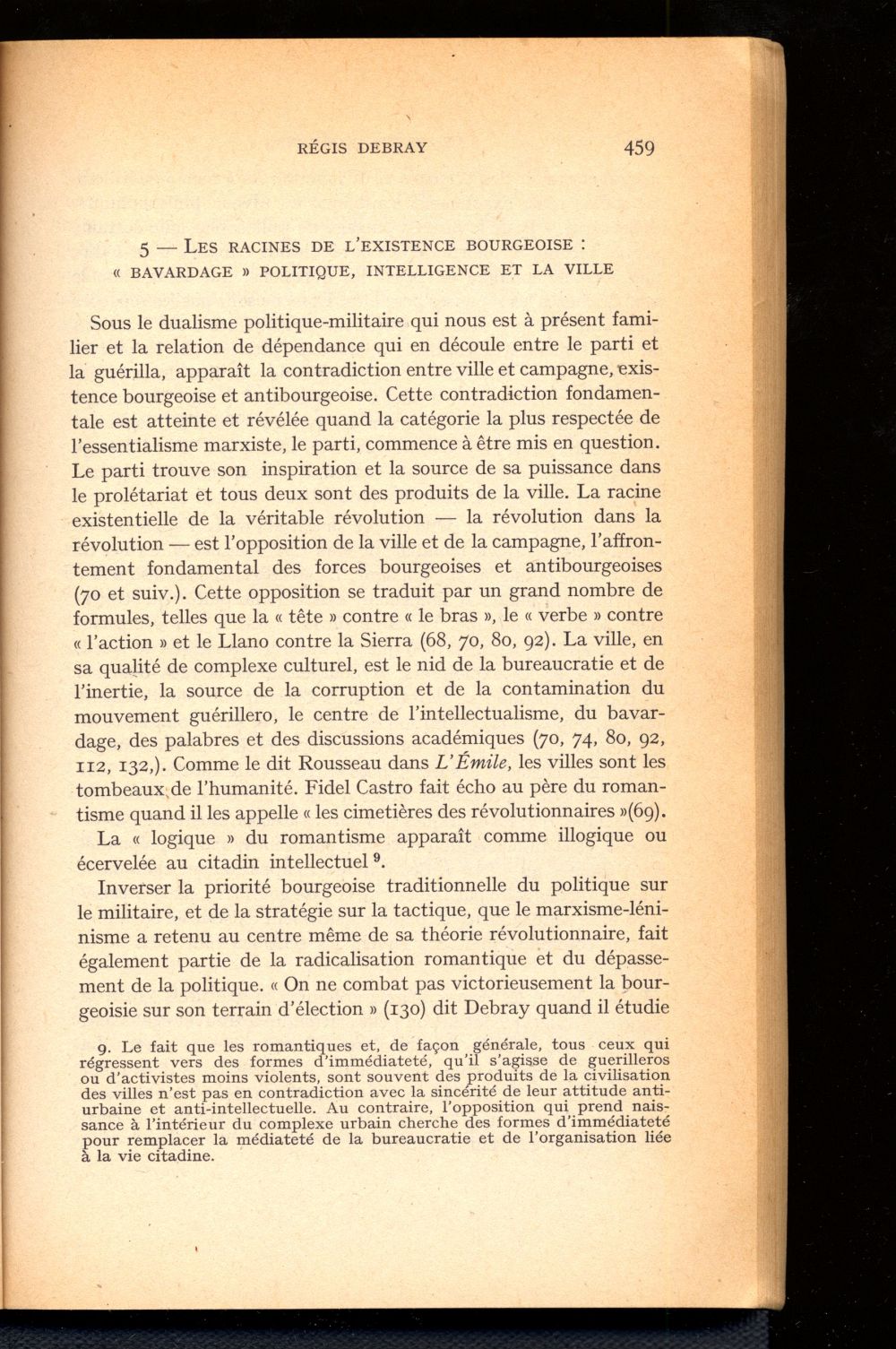

REGIS DEBKAY
459
5 — LES RACINES DE L'EXISTENCE BOURGEOISE :
« BAVARDAGE » POLITIQUE, INTELLIGENCE ET LA VILLE
« BAVARDAGE » POLITIQUE, INTELLIGENCE ET LA VILLE
Sous le dualisme politique-militaire qui nous est à présent fami-
lier et la relation de dépendance qui en découle entre le parti et
la guérilla, apparaît la contradiction entre ville et campagne, exis-
tence bourgeoise et antibourgeoise. Cette contradiction fondamen-
tale est atteinte et révélée quand la catégorie la plus respectée de
l'essentialisme marxiste, le parti, commence à être mis en question.
Le parti trouve son inspiration et la source de sa puissance dans
le prolétariat et tous deux sont des produits de la ville. La racine
existentielle de la véritable révolution — la révolution dans la
révolution — est l'opposition de la ville et de la campagne, l'affron-
tement fondamental des forces bourgeoises et antibourgeoises
(70 et suiv.). Cette opposition se traduit par un grand nombre de
formules, telles que la « tête » contre « le bras », le « verbe » contre
« l'action » et le Llano contre la Sierra (68, 70, 80, 92). La ville, en
sa qualité de complexe culturel, est le nid de la bureaucratie et de
l'inertie, la source de la corruption et de la contamination du
mouvement guérillero, le centre de l'intellectualisme, du bavar-
dage, des palabres et des discussions académiques (70, 74, 80, 92,
112, 132,). Comme le dit Rousseau dans L'Emile, les villes sont les
tombeaux de l'humanité. Fidel Castro fait écho au père du roman-
tisme quand il les appelle « les cimetières des révolutionnaires «(69).
lier et la relation de dépendance qui en découle entre le parti et
la guérilla, apparaît la contradiction entre ville et campagne, exis-
tence bourgeoise et antibourgeoise. Cette contradiction fondamen-
tale est atteinte et révélée quand la catégorie la plus respectée de
l'essentialisme marxiste, le parti, commence à être mis en question.
Le parti trouve son inspiration et la source de sa puissance dans
le prolétariat et tous deux sont des produits de la ville. La racine
existentielle de la véritable révolution — la révolution dans la
révolution — est l'opposition de la ville et de la campagne, l'affron-
tement fondamental des forces bourgeoises et antibourgeoises
(70 et suiv.). Cette opposition se traduit par un grand nombre de
formules, telles que la « tête » contre « le bras », le « verbe » contre
« l'action » et le Llano contre la Sierra (68, 70, 80, 92). La ville, en
sa qualité de complexe culturel, est le nid de la bureaucratie et de
l'inertie, la source de la corruption et de la contamination du
mouvement guérillero, le centre de l'intellectualisme, du bavar-
dage, des palabres et des discussions académiques (70, 74, 80, 92,
112, 132,). Comme le dit Rousseau dans L'Emile, les villes sont les
tombeaux de l'humanité. Fidel Castro fait écho au père du roman-
tisme quand il les appelle « les cimetières des révolutionnaires «(69).
La « logique » du romantisme apparaît comme illogique ou
écervelée au citadin intellectuel 9.
écervelée au citadin intellectuel 9.
Inverser la priorité bourgeoise traditionnelle du politique sur
le militaire, et de la stratégie sur la tactique, que le marxisme-léni-
nisme a retenu au centre même de sa théorie révolutionnaire, fait
également partie de la radicalisation romantique et du dépasse-
ment de la politique. « On ne combat pas victorieusement la bour-
geoisie sur son terrain d'élection » (130) dit Debray quand il étudie
le militaire, et de la stratégie sur la tactique, que le marxisme-léni-
nisme a retenu au centre même de sa théorie révolutionnaire, fait
également partie de la radicalisation romantique et du dépasse-
ment de la politique. « On ne combat pas victorieusement la bour-
geoisie sur son terrain d'élection » (130) dit Debray quand il étudie
9. Le fait que les romantiques et, de façon générale, tous ceux qui
régressent vers des formes d'immédiateté, qu'il s'agisse de guérilleros
ou d'activistes moins violents, sont souvent des produits de la civilisation
des villes n'est pas en contradiction avec la sincérité de leur attitude anti-
urbaine et anti-intellectuelle. Au contraire, l'opposition qui prend nais-
sance à l'intérieur du complexe urbain cherche des formes d'immédiateté
pour remplacer la médiateté de la bureaucratie et de l'organisation liée
à la vie citadine.
régressent vers des formes d'immédiateté, qu'il s'agisse de guérilleros
ou d'activistes moins violents, sont souvent des produits de la civilisation
des villes n'est pas en contradiction avec la sincérité de leur attitude anti-
urbaine et anti-intellectuelle. Au contraire, l'opposition qui prend nais-
sance à l'intérieur du complexe urbain cherche des formes d'immédiateté
pour remplacer la médiateté de la bureaucratie et de l'organisation liée
à la vie citadine.
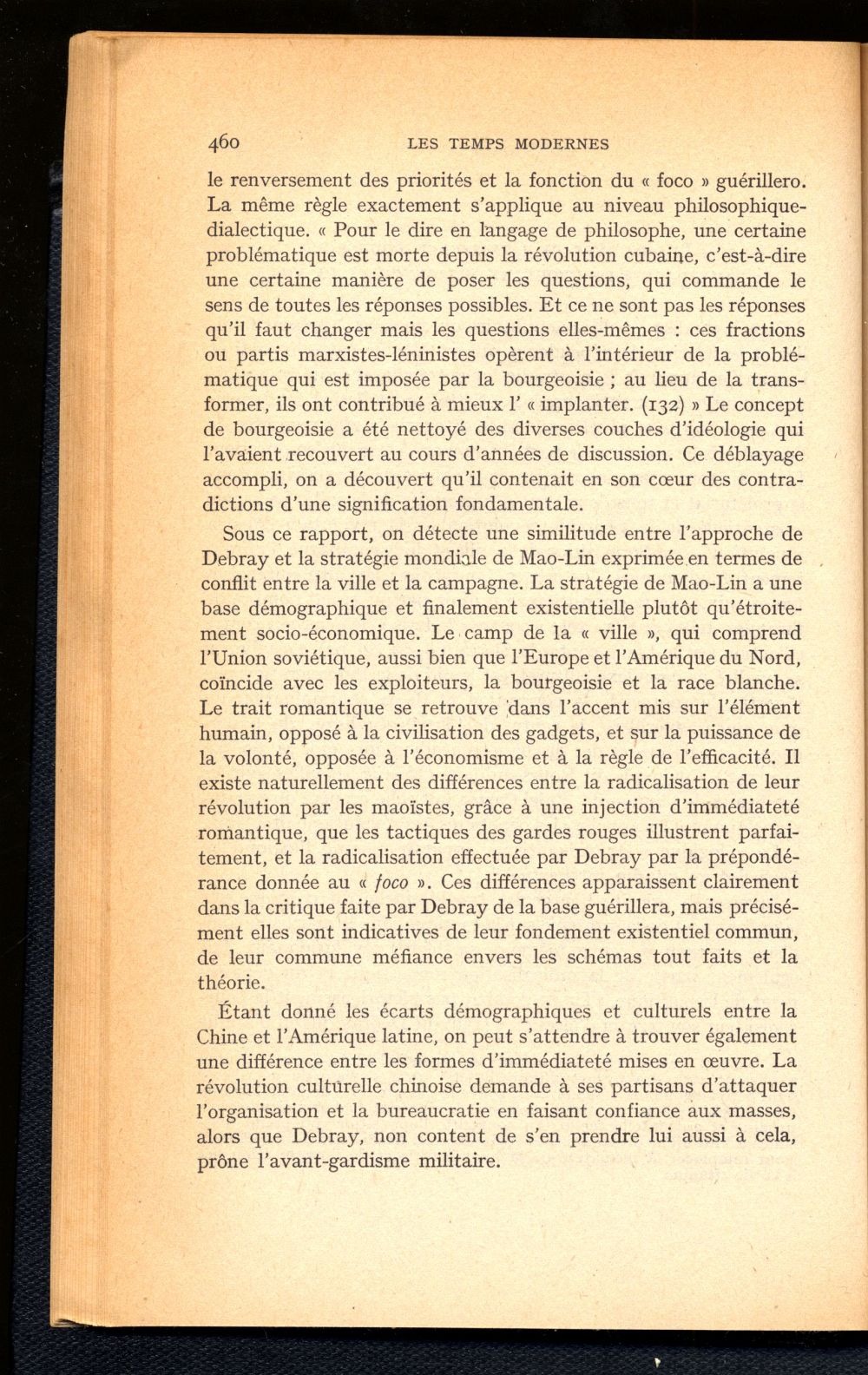

460
LES TEMPS MODERNES
le renversement des priorités et la fonction du « foco » guérillero.
La même règle exactement s'applique au niveau philosophique-
dialectique. « Pour le dire en langage de philosophe, une certaine
problématique est morte depuis la révolution cubaine, c'est-à-dire
une certaine manière de poser les questions, qui commande le
sens de toutes les réponses possibles. Et ce ne sont pas les réponses
qu'il faut changer mais les questions elles-mêmes : ces fractions
ou partis marxistes-léninistes opèrent à l'intérieur de la problé-
matique qui est imposée par la bourgeoisie ; au lieu de la trans-
former, ils ont contribué à mieux 1' « implanter. (132) » Le concept
de bourgeoisie a été nettoyé des diverses couches d'idéologie qui
l'avaient recouvert au cours d'années de discussion. Ce déblayage
accompli, on a découvert qu'il contenait en son cœur des contra-
dictions d'une signification fondamentale.
La même règle exactement s'applique au niveau philosophique-
dialectique. « Pour le dire en langage de philosophe, une certaine
problématique est morte depuis la révolution cubaine, c'est-à-dire
une certaine manière de poser les questions, qui commande le
sens de toutes les réponses possibles. Et ce ne sont pas les réponses
qu'il faut changer mais les questions elles-mêmes : ces fractions
ou partis marxistes-léninistes opèrent à l'intérieur de la problé-
matique qui est imposée par la bourgeoisie ; au lieu de la trans-
former, ils ont contribué à mieux 1' « implanter. (132) » Le concept
de bourgeoisie a été nettoyé des diverses couches d'idéologie qui
l'avaient recouvert au cours d'années de discussion. Ce déblayage
accompli, on a découvert qu'il contenait en son cœur des contra-
dictions d'une signification fondamentale.
Sous ce rapport, on détecte une similitude entre l'approche de
Debray et la stratégie mondiale de Mao-Lin exprimée en termes de
conflit entre la ville et la campagne. La stratégie de Mao-Lin a une
base démographique et finalement existentielle plutôt qu'étroite-
ment socio-économique. Le camp de la « ville », qui comprend
l'Union soviétique, aussi bien que l'Europe et l'Amérique du Nord,
coïncide avec les exploiteurs, la bourgeoisie et la race blanche.
Le trait romantique se retrouve 'dans l'accent mis sur l'élément
humain, opposé à la civilisation des gadgets, et sur la puissance de
la volonté, opposée à l'économisme et à la règle de l'efficacité. Il
existe naturellement des différences entre la radicalisation de leur
révolution par les maoïstes, grâce à une injection d'immédiateté
romantique, que les tactiques des gardes rouges illustrent parfai-
tement, et la radicalisation effectuée par Debray par la prépondé-
rance donnée au « foco ». Ces différences apparaissent clairement
dans la critique faite par Debray de la base guérillera, mais précisé-
ment elles sont indicatives de leur fondement existentiel commun,
de leur commune méfiance envers les schémas tout faits et la
théorie.
Debray et la stratégie mondiale de Mao-Lin exprimée en termes de
conflit entre la ville et la campagne. La stratégie de Mao-Lin a une
base démographique et finalement existentielle plutôt qu'étroite-
ment socio-économique. Le camp de la « ville », qui comprend
l'Union soviétique, aussi bien que l'Europe et l'Amérique du Nord,
coïncide avec les exploiteurs, la bourgeoisie et la race blanche.
Le trait romantique se retrouve 'dans l'accent mis sur l'élément
humain, opposé à la civilisation des gadgets, et sur la puissance de
la volonté, opposée à l'économisme et à la règle de l'efficacité. Il
existe naturellement des différences entre la radicalisation de leur
révolution par les maoïstes, grâce à une injection d'immédiateté
romantique, que les tactiques des gardes rouges illustrent parfai-
tement, et la radicalisation effectuée par Debray par la prépondé-
rance donnée au « foco ». Ces différences apparaissent clairement
dans la critique faite par Debray de la base guérillera, mais précisé-
ment elles sont indicatives de leur fondement existentiel commun,
de leur commune méfiance envers les schémas tout faits et la
théorie.
Etant donné les écarts démographiques et culturels entre la
Chine et l'Amérique latine, on peut s'attendre à trouver également
une différence entre les formes d'immédiateté mises en œuvre. La
révolution culturelle chinoise demande à ses partisans d'attaquer
l'organisation et la bureaucratie en faisant confiance aux masses,
alors que Debray, non content de s'en prendre lui aussi à cela,
prône l'avant-gardisme militaire.
Chine et l'Amérique latine, on peut s'attendre à trouver également
une différence entre les formes d'immédiateté mises en œuvre. La
révolution culturelle chinoise demande à ses partisans d'attaquer
l'organisation et la bureaucratie en faisant confiance aux masses,
alors que Debray, non content de s'en prendre lui aussi à cela,
prône l'avant-gardisme militaire.
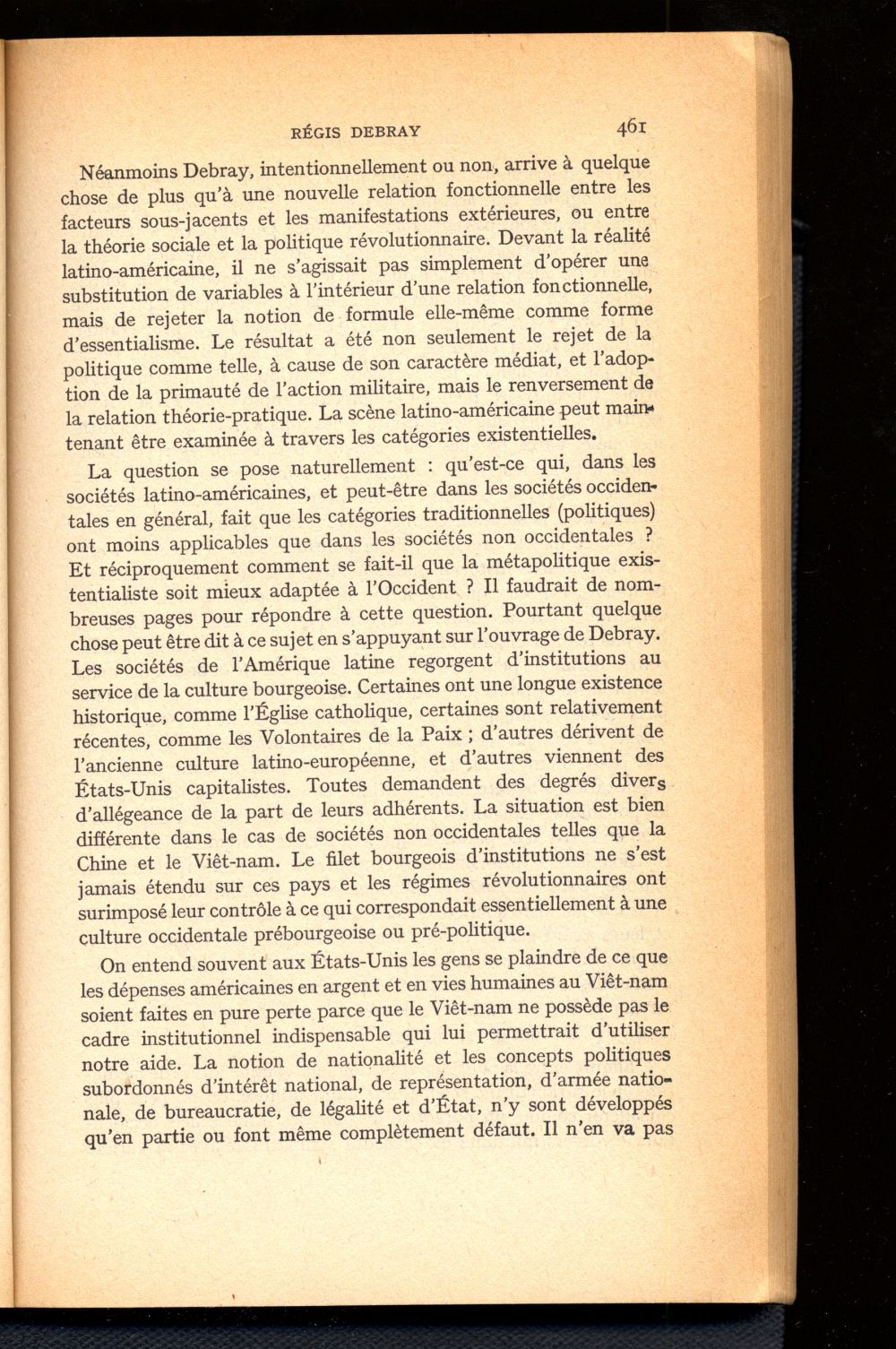

RÉGIS DEBRAY
46l
Néanmoins Debray, intentionnellement ou non, arrive à quelque
chose de plus qu'à une nouvelle relation fonctionnelle entre les
facteurs sous-jacents et les manifestations extérieures, ou entre
la théorie sociale et la politique révolutionnaire. Devant la réalité
latino-américaine, il ne s'agissait pas simplement d'opérer une
substitution de variables à l'intérieur d'une relation fonctionnelle,
mais de rejeter la notion de formule elle-même comme forme
d'essentialisme. Le résultat a été non seulement le rejet de la
politique comme telle, à cause de son caractère médiat, et l'adop-
tion de la primauté de l'action militaire, mais le renversement de
la relation théorie-pratique. La scène latino-américaine peut main-
tenant être examinée à travers les catégories existentielles.
chose de plus qu'à une nouvelle relation fonctionnelle entre les
facteurs sous-jacents et les manifestations extérieures, ou entre
la théorie sociale et la politique révolutionnaire. Devant la réalité
latino-américaine, il ne s'agissait pas simplement d'opérer une
substitution de variables à l'intérieur d'une relation fonctionnelle,
mais de rejeter la notion de formule elle-même comme forme
d'essentialisme. Le résultat a été non seulement le rejet de la
politique comme telle, à cause de son caractère médiat, et l'adop-
tion de la primauté de l'action militaire, mais le renversement de
la relation théorie-pratique. La scène latino-américaine peut main-
tenant être examinée à travers les catégories existentielles.
La question se pose naturellement : qu'est-ce qui, dans les
sociétés latino-américaines, et peut-être dans les sociétés occiden-
tales en général, fait que les catégories traditionnelles (politiques)
ont moins applicables que dans les sociétés non occidentales ?
Et réciproquement comment se fait-il que la métapolitique exis-
tentialiste soit mieux adaptée à l'Occident ? Il faudrait de nom-
breuses pages pour répondre à cette question. Pourtant quelque
chose peut être dit à ce sujet en s'appuyant sur l'ouvrage de Debray.
Les sociétés de l'Amérique latine regorgent d'institutions au
service de la culture bourgeoise. Certaines ont une longue existence
historique, comme l'Église catholique, certaines sont relativement
récentes, comme les Volontaires de la Paix ; d'autres dérivent de
l'ancienne culture latino-européenne, et d'autres viennent des
États-Unis capitalistes. Toutes demandent des degrés divers
d'allégeance de la part de leurs adhérents. La situation est bien
différente dans le cas de sociétés non occidentales telles que la
Chine et le Viêt-nam. Le filet bourgeois d'institutions ne s'est
jamais étendu sur ces pays et les régimes révolutionnaires ont
surimposé leur contrôle à ce qui correspondait essentiellement à une
culture occidentale prébourgeoise ou pré-politique.
sociétés latino-américaines, et peut-être dans les sociétés occiden-
tales en général, fait que les catégories traditionnelles (politiques)
ont moins applicables que dans les sociétés non occidentales ?
Et réciproquement comment se fait-il que la métapolitique exis-
tentialiste soit mieux adaptée à l'Occident ? Il faudrait de nom-
breuses pages pour répondre à cette question. Pourtant quelque
chose peut être dit à ce sujet en s'appuyant sur l'ouvrage de Debray.
Les sociétés de l'Amérique latine regorgent d'institutions au
service de la culture bourgeoise. Certaines ont une longue existence
historique, comme l'Église catholique, certaines sont relativement
récentes, comme les Volontaires de la Paix ; d'autres dérivent de
l'ancienne culture latino-européenne, et d'autres viennent des
États-Unis capitalistes. Toutes demandent des degrés divers
d'allégeance de la part de leurs adhérents. La situation est bien
différente dans le cas de sociétés non occidentales telles que la
Chine et le Viêt-nam. Le filet bourgeois d'institutions ne s'est
jamais étendu sur ces pays et les régimes révolutionnaires ont
surimposé leur contrôle à ce qui correspondait essentiellement à une
culture occidentale prébourgeoise ou pré-politique.
On entend souvent aux États-Unis les gens se plaindre de ce que
les dépenses américaines en argent et en vies humaines au Viêt-nam
soient faites en pure perte parce que le Viêt-nam ne possède pas le
cadre institutionnel indispensable qui lui permettrait d'utiliser
notre aide. La notion de nationalité et les concepts politiques
subordonnés d'intérêt national, de représentation, d'armée natio-
nale, de bureaucratie, de légalité et d'État, n'y sont développés
qu'en partie ou font même complètement défaut. Il n'en va pas
les dépenses américaines en argent et en vies humaines au Viêt-nam
soient faites en pure perte parce que le Viêt-nam ne possède pas le
cadre institutionnel indispensable qui lui permettrait d'utiliser
notre aide. La notion de nationalité et les concepts politiques
subordonnés d'intérêt national, de représentation, d'armée natio-
nale, de bureaucratie, de légalité et d'État, n'y sont développés
qu'en partie ou font même complètement défaut. Il n'en va pas
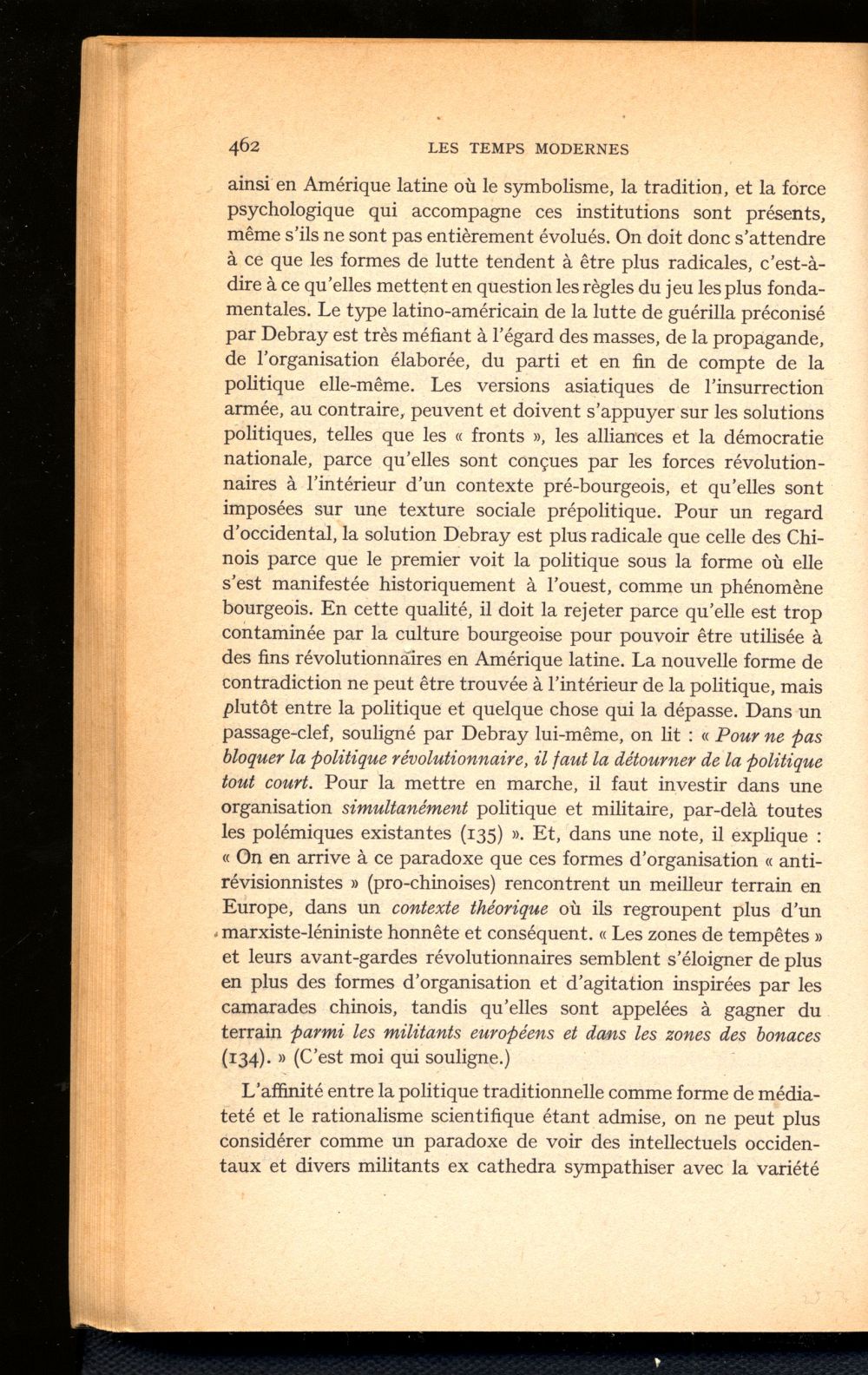

462
LES TEMPS MODERNES
ainsi en Amérique latine où le symbolisme, la tradition, et la force
psychologique qui accompagne ces institutions sont présents,
même s'ils ne sont pas entièrement évolués. On doit donc s'attendre
à ce que les formes de lutte tendent à être plus radicales, c'est-à-
dire à ce qu'elles mettent en question les règles du jeu les plus fonda-
mentales. Le type latino-américain de la lutte de guérilla préconisé
par Debray est très méfiant à l'égard des masses, de la propagande,
de l'organisation élaborée, du parti et en fin de compte de la
politique elle-même. Les versions asiatiques de l'insurrection
armée, au contraire, peuvent et doivent s'appuyer sur les solutions
politiques, telles que les « fronts », les alliances et la démocratie
nationale, parce qu'elles sont conçues par les forces révolution-
naires à l'intérieur d'un contexte pré-bourgeois, et qu'elles sont
imposées sur une texture sociale prépolitique. Pour un regard
d'occidental, la solution Debray est plus radicale que celle des Chi-
nois parce que le premier voit la politique sous la forme où elle
s'est manifestée historiquement à l'ouest, comme un phénomène
bourgeois. En cette qualité, il doit la rejeter parce qu'elle est trop
contaminée par la culture bourgeoise pour pouvoir être utilisée à
des fins révolutionnaires en Amérique latine. La nouvelle forme de
contradiction ne peut être trouvée à l'intérieur de la politique, mais
plutôt entre la politique et quelque chose qui la dépasse. Dans un
passage-clef, souligné par Debray lui-même, on lit : « Pour ne pas
bloquer la politique révolutionnaire, il faut la détourner de la politique
tout court. Pour la mettre en marche, il faut investir dans une
organisation simultanément politique et militaire, par-delà toutes
les polémiques existantes (135) ». Et, dans une note, il explique :
« On en arrive à ce paradoxe que ces formes d'organisation « anti-
révisionnistes » (pro-chinoises) rencontrent un meilleur terrain en
Europe, dans un contexte théorique où ils regroupent plus d'un
. marxiste-léniniste honnête et conséquent. « Les zones de tempêtes »
et leurs avant-gardes révolutionnaires semblent s'éloigner de plus
en plus des formes d'organisation et d'agitation inspirées par les
camarades chinois, tandis qu'elles sont appelées à gagner du
terrain parmi les militants européens et dans les zones des bonaces
(134). » (C'est moi qui souligne.)
psychologique qui accompagne ces institutions sont présents,
même s'ils ne sont pas entièrement évolués. On doit donc s'attendre
à ce que les formes de lutte tendent à être plus radicales, c'est-à-
dire à ce qu'elles mettent en question les règles du jeu les plus fonda-
mentales. Le type latino-américain de la lutte de guérilla préconisé
par Debray est très méfiant à l'égard des masses, de la propagande,
de l'organisation élaborée, du parti et en fin de compte de la
politique elle-même. Les versions asiatiques de l'insurrection
armée, au contraire, peuvent et doivent s'appuyer sur les solutions
politiques, telles que les « fronts », les alliances et la démocratie
nationale, parce qu'elles sont conçues par les forces révolution-
naires à l'intérieur d'un contexte pré-bourgeois, et qu'elles sont
imposées sur une texture sociale prépolitique. Pour un regard
d'occidental, la solution Debray est plus radicale que celle des Chi-
nois parce que le premier voit la politique sous la forme où elle
s'est manifestée historiquement à l'ouest, comme un phénomène
bourgeois. En cette qualité, il doit la rejeter parce qu'elle est trop
contaminée par la culture bourgeoise pour pouvoir être utilisée à
des fins révolutionnaires en Amérique latine. La nouvelle forme de
contradiction ne peut être trouvée à l'intérieur de la politique, mais
plutôt entre la politique et quelque chose qui la dépasse. Dans un
passage-clef, souligné par Debray lui-même, on lit : « Pour ne pas
bloquer la politique révolutionnaire, il faut la détourner de la politique
tout court. Pour la mettre en marche, il faut investir dans une
organisation simultanément politique et militaire, par-delà toutes
les polémiques existantes (135) ». Et, dans une note, il explique :
« On en arrive à ce paradoxe que ces formes d'organisation « anti-
révisionnistes » (pro-chinoises) rencontrent un meilleur terrain en
Europe, dans un contexte théorique où ils regroupent plus d'un
. marxiste-léniniste honnête et conséquent. « Les zones de tempêtes »
et leurs avant-gardes révolutionnaires semblent s'éloigner de plus
en plus des formes d'organisation et d'agitation inspirées par les
camarades chinois, tandis qu'elles sont appelées à gagner du
terrain parmi les militants européens et dans les zones des bonaces
(134). » (C'est moi qui souligne.)
L'affinité entre la politique traditionnelle comme forme de média-
tête et le rationalisme scientifique étant admise, on ne peut plus
considérer comme un paradoxe de voir des intellectuels occiden-
taux et divers militants ex cathedra sympathiser avec la variété
tête et le rationalisme scientifique étant admise, on ne peut plus
considérer comme un paradoxe de voir des intellectuels occiden-
taux et divers militants ex cathedra sympathiser avec la variété
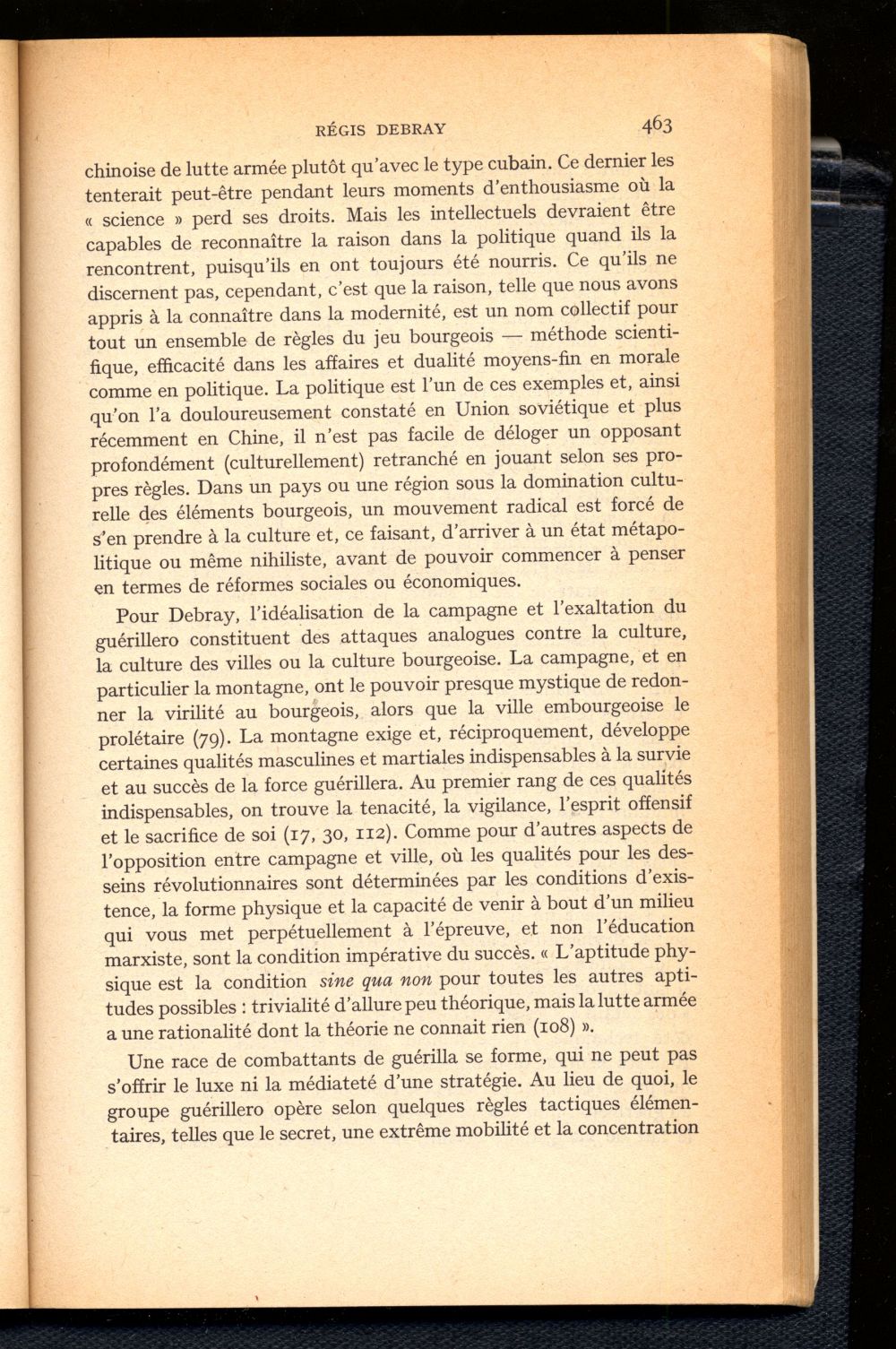

REGIS DEBRAY
463
chinoise de lutte armée plutôt qu'avec le type cubain. Ce dernier les
tenterait peut-être pendant leurs moments d'enthousiasme où la
« science » perd ses droits. Mais les intellectuels devraient être
capables de reconnaître la raison dans la politique quand ils la
rencontrent, puisqu'ils en ont toujours été nourris. Ce qu'ils ne
discernent pas, cependant, c'est que la raison, telle que nous avons
appris à la connaître dans la modernité, est un nom collectif pour
tout un ensemble de règles du jeu bourgeois — méthode scienti-
fique, efficacité dans les affaires et dualité moyens-fin en morale
comme en politique. La politique est l'un de ces exemples et, ainsi
qu'on l'a douloureusement constaté en Union soviétique et plus
récemment en Chine, il n'est pas facile de déloger un opposant
profondément (culturellement) retranché en jouant selon ses pro-
pres règles. Dans un pays ou une région sous la domination cultu-
relle des éléments bourgeois, un mouvement radical est forcé de
s'en prendre à la culture et, ce faisant, d'arriver à un état métapo-
litique ou même nihiliste, avant de pouvoir commencer à penser
en termes de réformes sociales ou économiques.
tenterait peut-être pendant leurs moments d'enthousiasme où la
« science » perd ses droits. Mais les intellectuels devraient être
capables de reconnaître la raison dans la politique quand ils la
rencontrent, puisqu'ils en ont toujours été nourris. Ce qu'ils ne
discernent pas, cependant, c'est que la raison, telle que nous avons
appris à la connaître dans la modernité, est un nom collectif pour
tout un ensemble de règles du jeu bourgeois — méthode scienti-
fique, efficacité dans les affaires et dualité moyens-fin en morale
comme en politique. La politique est l'un de ces exemples et, ainsi
qu'on l'a douloureusement constaté en Union soviétique et plus
récemment en Chine, il n'est pas facile de déloger un opposant
profondément (culturellement) retranché en jouant selon ses pro-
pres règles. Dans un pays ou une région sous la domination cultu-
relle des éléments bourgeois, un mouvement radical est forcé de
s'en prendre à la culture et, ce faisant, d'arriver à un état métapo-
litique ou même nihiliste, avant de pouvoir commencer à penser
en termes de réformes sociales ou économiques.
Pour Debray, l'idéalisation de la campagne et l'exaltation du
guérillero constituent des attaques analogues contre la culture,
la culture des villes ou la culture bourgeoise. La campagne, et en
particulier la montagne, ont le pouvoir presque mystique de redon-
ner la virilité au bourgeois, alors que la ville embourgeoise le
prolétaire (79). La montagne exige et, réciproquement, développe
certaines qualités masculines et martiales indispensables à la survie
et au succès de la force guérillera. Au premier rang de ces qualités
indispensables, on trouve la ténacité, la vigilance, l'esprit offensif
et le sacrifice de soi (17, 30, 112). Comme pour d'autres aspects de
l'opposition entre campagne et ville, où les qualités pour les des-
seins révolutionnaires sont déterminées par les conditions d'exis-
tence, la forme physique et la capacité de venir à bout d'un milieu
qui vous met perpétuellement à l'épreuve, et non l'éducation
marxiste, sont la condition impérative du succès. « L'aptitude phy-
sique est la condition sine qua non pour toutes les autres apti-
tudes possibles : trivialité d'allure peu théorique, mais la lutte armée
a une rationalité dont la théorie ne connaît rien (108) ».
guérillero constituent des attaques analogues contre la culture,
la culture des villes ou la culture bourgeoise. La campagne, et en
particulier la montagne, ont le pouvoir presque mystique de redon-
ner la virilité au bourgeois, alors que la ville embourgeoise le
prolétaire (79). La montagne exige et, réciproquement, développe
certaines qualités masculines et martiales indispensables à la survie
et au succès de la force guérillera. Au premier rang de ces qualités
indispensables, on trouve la ténacité, la vigilance, l'esprit offensif
et le sacrifice de soi (17, 30, 112). Comme pour d'autres aspects de
l'opposition entre campagne et ville, où les qualités pour les des-
seins révolutionnaires sont déterminées par les conditions d'exis-
tence, la forme physique et la capacité de venir à bout d'un milieu
qui vous met perpétuellement à l'épreuve, et non l'éducation
marxiste, sont la condition impérative du succès. « L'aptitude phy-
sique est la condition sine qua non pour toutes les autres apti-
tudes possibles : trivialité d'allure peu théorique, mais la lutte armée
a une rationalité dont la théorie ne connaît rien (108) ».
Une race de combattants de guérilla se forme, qui ne peut pas
s'offrir le luxe ni la médiateté d'une stratégie. Au lieu de quoi, le
groupe guérillero opère selon quelques règles tactiques élémen-
taires, telles que le secret, une extrême mobilité et la concentration
s'offrir le luxe ni la médiateté d'une stratégie. Au lieu de quoi, le
groupe guérillero opère selon quelques règles tactiques élémen-
taires, telles que le secret, une extrême mobilité et la concentration
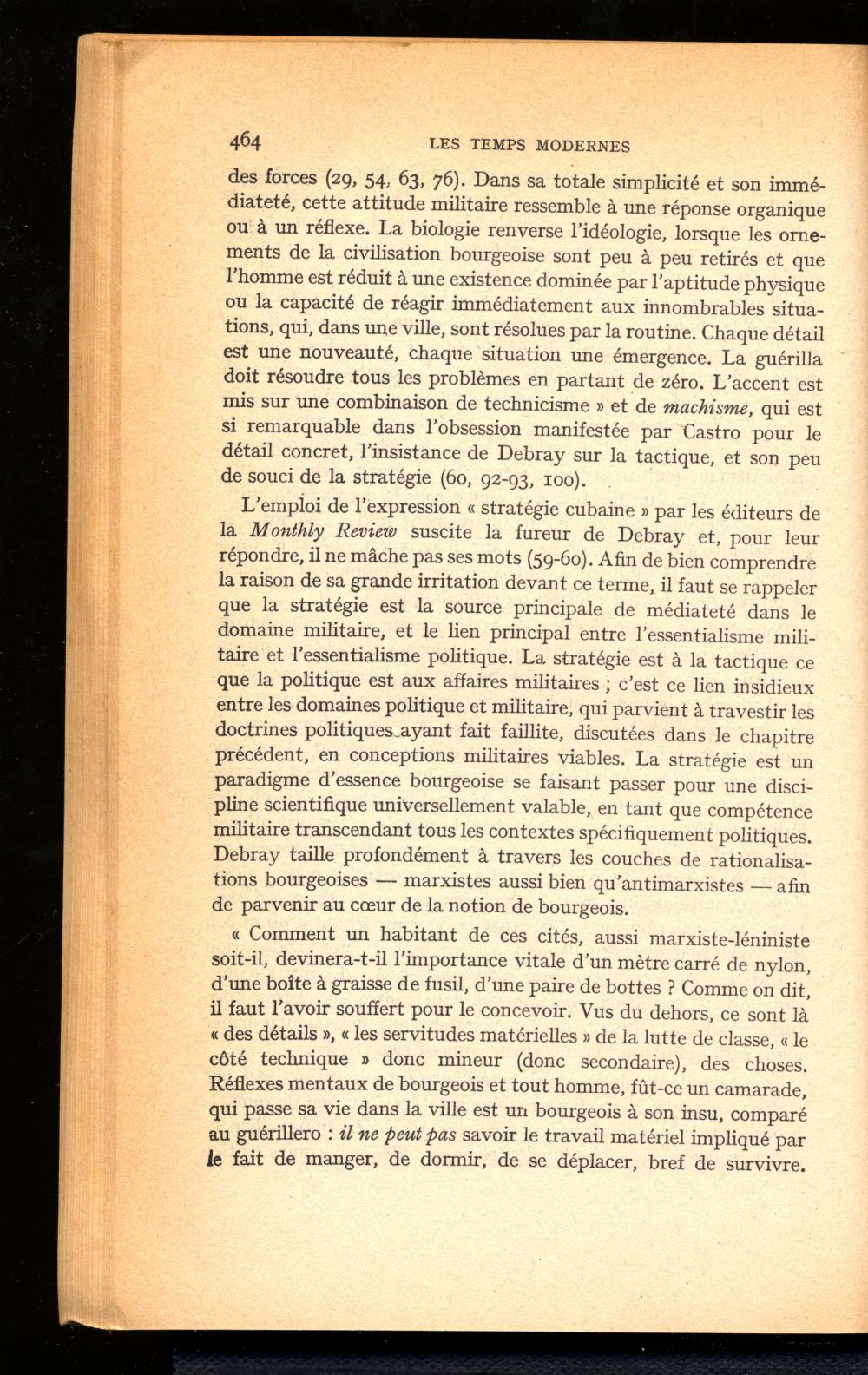

464 LES TEMPS MODERNES
des forces (29, 54, 63, 76). Dans sa totale simplicité et son immé-
diateté, cette attitude militaire ressemble à une réponse organique
ou à un réflexe. La biologie renverse l'idéologie, lorsque les orne-
ments de la civilisation bourgeoise sont peu à peu retirés et que
l'homme est réduit à une existence dominée par l'aptitude physique
ou la capacité de réagir immédiatement aux innombrables situa-
tions, qui, dans une ville, sont résolues par la routine. Chaque détail
est une nouveauté, chaque situation une émergence. La guérilla
doit résoudre tous les problèmes en partant de zéro. L'accent est
mis sur une combinaison de technicisme » et de machisme, qui est
si remarquable dans l'obsession manifestée par Castro pour le
détail concret, l'insistance de Debray sur la tactique, et son peu
de souci de la stratégie (60, 92-93, 100).
diateté, cette attitude militaire ressemble à une réponse organique
ou à un réflexe. La biologie renverse l'idéologie, lorsque les orne-
ments de la civilisation bourgeoise sont peu à peu retirés et que
l'homme est réduit à une existence dominée par l'aptitude physique
ou la capacité de réagir immédiatement aux innombrables situa-
tions, qui, dans une ville, sont résolues par la routine. Chaque détail
est une nouveauté, chaque situation une émergence. La guérilla
doit résoudre tous les problèmes en partant de zéro. L'accent est
mis sur une combinaison de technicisme » et de machisme, qui est
si remarquable dans l'obsession manifestée par Castro pour le
détail concret, l'insistance de Debray sur la tactique, et son peu
de souci de la stratégie (60, 92-93, 100).
L'emploi de l'expression « stratégie cubaine » par les éditeurs de
la Monthly Review suscite la fureur de Debray et, pour leur
répondre, il ne mâche pas ses mots (59-60). Afin de bien comprendre
la raison de sa grande irritation devant ce terme, il faut se rappeler
que la stratégie est la source principale de médiateté dans le
domaine militaire, et le lien principal entre l'essentialismc mili-
taire et l'essentialisme politique. La stratégie est à la tactique ce
que la politique est aux affaires militaires ; c'est ce lien insidieux
entre les domaines politique et militaire, qui parvient à travestir les
doctrines politiques.ayant fait faillite, discutées dans le chapitre
précédent, en conceptions militaires viables. La stratégie est un
paradigme d'essence bourgeoise se faisant passer pour une disci-
pline scientifique universellement valable, en tant que compétence
militaire transcendant tous les contextes spécifiquement politiques.
Debray taille profondément à travers les couches de rationalisa-
tions bourgeoises — marxistes aussi bien qu'antimarxistes — afin
de parvenir au cœur de la notion de bourgeois.
la Monthly Review suscite la fureur de Debray et, pour leur
répondre, il ne mâche pas ses mots (59-60). Afin de bien comprendre
la raison de sa grande irritation devant ce terme, il faut se rappeler
que la stratégie est la source principale de médiateté dans le
domaine militaire, et le lien principal entre l'essentialismc mili-
taire et l'essentialisme politique. La stratégie est à la tactique ce
que la politique est aux affaires militaires ; c'est ce lien insidieux
entre les domaines politique et militaire, qui parvient à travestir les
doctrines politiques.ayant fait faillite, discutées dans le chapitre
précédent, en conceptions militaires viables. La stratégie est un
paradigme d'essence bourgeoise se faisant passer pour une disci-
pline scientifique universellement valable, en tant que compétence
militaire transcendant tous les contextes spécifiquement politiques.
Debray taille profondément à travers les couches de rationalisa-
tions bourgeoises — marxistes aussi bien qu'antimarxistes — afin
de parvenir au cœur de la notion de bourgeois.
« Comment un habitant de ces cités, aussi marxiste-léniniste
soit-il, devinera-t-il l'importance vitale d'un mètre carré de nylon,
d'une boîte à graisse de fusil, d'une paire de bottes ? Comme on dit,
il faut l'avoir souffert pour le concevoir. Vus du dehors, ce sont là
« des détails », « les servitudes matérielles » de la lutte de classe, « le
côté technique » donc mineur (donc secondaire), des choses.
Réflexes mentaux de bourgeois et tout homme, fût-ce un camarade,
qui passe sa vie dans la ville est un bourgeois à son insu, comparé
au guérillero : il ne peut pas savoir le travail matériel impliqué par
le fait de manger, de dormir, de se déplacer, bref de survivre.
soit-il, devinera-t-il l'importance vitale d'un mètre carré de nylon,
d'une boîte à graisse de fusil, d'une paire de bottes ? Comme on dit,
il faut l'avoir souffert pour le concevoir. Vus du dehors, ce sont là
« des détails », « les servitudes matérielles » de la lutte de classe, « le
côté technique » donc mineur (donc secondaire), des choses.
Réflexes mentaux de bourgeois et tout homme, fût-ce un camarade,
qui passe sa vie dans la ville est un bourgeois à son insu, comparé
au guérillero : il ne peut pas savoir le travail matériel impliqué par
le fait de manger, de dormir, de se déplacer, bref de survivre.
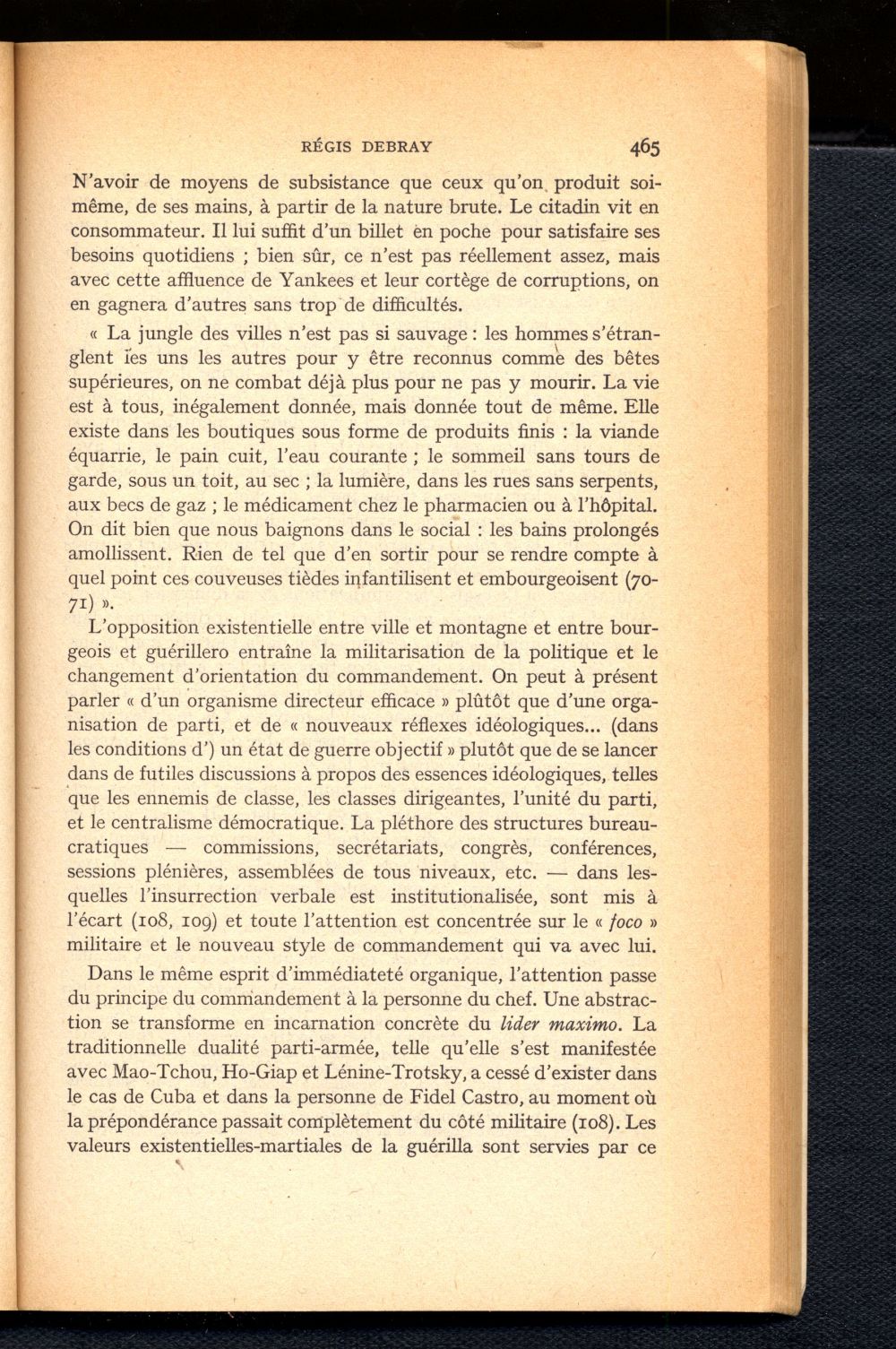

REGIS DEBRAY
465
N'avoir de moyens de subsistance que ceux qu'on produit soi-
même, de ses mains, à partir de la nature brute. Le citadin vit en
consommateur. Il lui surfit d'un billet en poche pour satisfaire ses
besoins quotidiens ; bien sûr, ce n'est pas réellement assez, mais
avec cette affluence de Yankees et leur cortège de corruptions, on
en gagnera d'autres sans trop de difficultés.
même, de ses mains, à partir de la nature brute. Le citadin vit en
consommateur. Il lui surfit d'un billet en poche pour satisfaire ses
besoins quotidiens ; bien sûr, ce n'est pas réellement assez, mais
avec cette affluence de Yankees et leur cortège de corruptions, on
en gagnera d'autres sans trop de difficultés.
« La jungle des villes n'est pas si sauvage : les hommes s'étran-
glent l'es uns les autres pour y être reconnus comme des bêtes
supérieures, on ne combat déjà plus pour ne pas y mourir. La vie
est à tous, inégalement donnée, mais donnée tout de même. Elle
existe dans les boutiques sous forme de produits finis : la viande
équarrie, le pain cuit, l'eau courante ; le sommeil sans tours de
garde, sous un toit, au sec ; la lumière, dans les rues sans serpents,
aux becs de gaz ; le médicament chez le pharmacien ou à l'hôpital.
On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés
amollissent. Rien de tel que d'en sortir pour se rendre compte à
quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent (70-
71) ».
glent l'es uns les autres pour y être reconnus comme des bêtes
supérieures, on ne combat déjà plus pour ne pas y mourir. La vie
est à tous, inégalement donnée, mais donnée tout de même. Elle
existe dans les boutiques sous forme de produits finis : la viande
équarrie, le pain cuit, l'eau courante ; le sommeil sans tours de
garde, sous un toit, au sec ; la lumière, dans les rues sans serpents,
aux becs de gaz ; le médicament chez le pharmacien ou à l'hôpital.
On dit bien que nous baignons dans le social : les bains prolongés
amollissent. Rien de tel que d'en sortir pour se rendre compte à
quel point ces couveuses tièdes infantilisent et embourgeoisent (70-
71) ».
L'opposition existentielle entre ville et montagne et entre bour-
geois et guérillero entraîne la militarisation de la politique et le
changement d'orientation du commandement. On peut à présent
parler « d'un organisme directeur efficace » plutôt que d'une orga-
nisation de parti, et de « nouveaux réflexes idéologiques... (dans
les conditions d') un état de guerre objectif » plutôt que de se lancer
dans de futiles discussions à propos des essences idéologiques, telles
que les ennemis de classe, les classes dirigeantes, l'unité du parti,
et le centralisme démocratique. La pléthore des structures bureau-
cratiques — commissions, secrétariats, congrès, conférences,
sessions plénières, assemblées de tous niveaux, etc. — dans les-
quelles l'insurrection verbale est institutionalisée, sont mis à
l'écart (108, 109) et toute l'attention est concentrée sur le « foco »
militaire et le nouveau style de commandement qui va avec lui.
geois et guérillero entraîne la militarisation de la politique et le
changement d'orientation du commandement. On peut à présent
parler « d'un organisme directeur efficace » plutôt que d'une orga-
nisation de parti, et de « nouveaux réflexes idéologiques... (dans
les conditions d') un état de guerre objectif » plutôt que de se lancer
dans de futiles discussions à propos des essences idéologiques, telles
que les ennemis de classe, les classes dirigeantes, l'unité du parti,
et le centralisme démocratique. La pléthore des structures bureau-
cratiques — commissions, secrétariats, congrès, conférences,
sessions plénières, assemblées de tous niveaux, etc. — dans les-
quelles l'insurrection verbale est institutionalisée, sont mis à
l'écart (108, 109) et toute l'attention est concentrée sur le « foco »
militaire et le nouveau style de commandement qui va avec lui.
Dans le même esprit d'immédiateté organique, l'attention passe
du principe du commandement à la personne du chef. Une abstrac-
tion se transforme en incarnation concrète du lider maximo. La
traditionnelle dualité parti-armée, telle qu'elle s'est manifestée
avec Mao-Tchou, Ho-Giap et Lénine-Trotsky, a cessé d'exister dans
le cas de Cuba et dans la personne de Fidel Castro, au moment où
la prépondérance passait complètement du côté militaire (108). Les
valeurs existentielles-martiales de la guérilla sont servies par ce
du principe du commandement à la personne du chef. Une abstrac-
tion se transforme en incarnation concrète du lider maximo. La
traditionnelle dualité parti-armée, telle qu'elle s'est manifestée
avec Mao-Tchou, Ho-Giap et Lénine-Trotsky, a cessé d'exister dans
le cas de Cuba et dans la personne de Fidel Castro, au moment où
la prépondérance passait complètement du côté militaire (108). Les
valeurs existentielles-martiales de la guérilla sont servies par ce
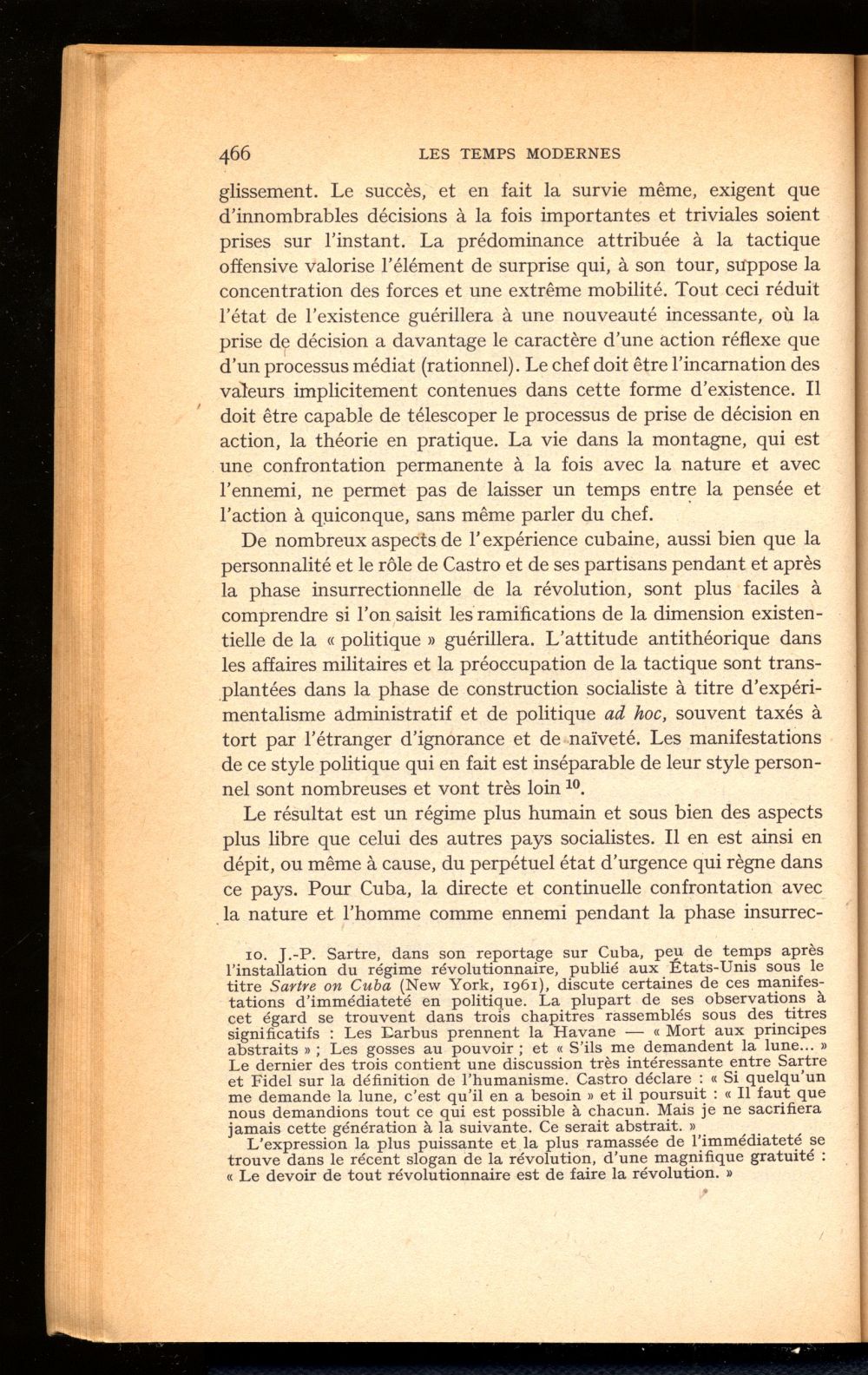

466
LES TEMPS MODERNES
glissement. Le succès, et en fait la survie même, exigent que
d'innombrables décisions à la fois importantes et triviales soient
prises sur l'instant. La prédominance attribuée à la tactique
offensive valorise l'élément de surprise qui, à son tour, suppose la
concentration des forces et une extrême mobilité. Tout ceci réduit
l'état de l'existence guérillera à une nouveauté incessante, où la
prise de décision a davantage le caractère d'une action réflexe que
d'un processus médiat (rationnel). Le chef doit être l'incarnation des
valeurs implicitement contenues dans cette forme d'existence. Il
doit être capable de télescoper le processus de prise de décision en
action, la théorie en pratique. La vie dans la montagne, qui est
une confrontation permanente à la fois avec la nature et avec
l'ennemi, ne permet pas de laisser un temps entre la pensée et
l'action à quiconque, sans même parler du chef.
d'innombrables décisions à la fois importantes et triviales soient
prises sur l'instant. La prédominance attribuée à la tactique
offensive valorise l'élément de surprise qui, à son tour, suppose la
concentration des forces et une extrême mobilité. Tout ceci réduit
l'état de l'existence guérillera à une nouveauté incessante, où la
prise de décision a davantage le caractère d'une action réflexe que
d'un processus médiat (rationnel). Le chef doit être l'incarnation des
valeurs implicitement contenues dans cette forme d'existence. Il
doit être capable de télescoper le processus de prise de décision en
action, la théorie en pratique. La vie dans la montagne, qui est
une confrontation permanente à la fois avec la nature et avec
l'ennemi, ne permet pas de laisser un temps entre la pensée et
l'action à quiconque, sans même parler du chef.
De nombreux aspects de l'expérience cubaine, aussi bien que la
personnalité et le rôle de Castro et de ses partisans pendant et après
la phase insurrectionnelle de la révolution, sont plus faciles à
comprendre si l'on saisit les ramifications de la dimension existen-
tielle de la « politique » guérillera. L'attitude antithéorique dans
les affaires militaires et la préoccupation de la tactique sont trans-
plantées dans la phase de construction socialiste à titre d'expéri-
mentalisme administratif et de politique ad hoc, souvent taxés à
tort par l'étranger d'ignorance et de naïveté. Les manifestations
de ce style politique qui en fait est inséparable de leur style person-
nel sont nombreuses et vont très loin10.
personnalité et le rôle de Castro et de ses partisans pendant et après
la phase insurrectionnelle de la révolution, sont plus faciles à
comprendre si l'on saisit les ramifications de la dimension existen-
tielle de la « politique » guérillera. L'attitude antithéorique dans
les affaires militaires et la préoccupation de la tactique sont trans-
plantées dans la phase de construction socialiste à titre d'expéri-
mentalisme administratif et de politique ad hoc, souvent taxés à
tort par l'étranger d'ignorance et de naïveté. Les manifestations
de ce style politique qui en fait est inséparable de leur style person-
nel sont nombreuses et vont très loin10.
Le résultat est un régime plus humain et sous bien des aspects
plus libre que celui des autres pays socialistes. Il en est ainsi en
dépit, ou même à cause, du perpétuel état d'urgence qui règne dans
ce pays. Pour Cuba, la directe et continuelle confrontation avec
la nature et l'homme comme ennemi pendant la phase insurrec-
plus libre que celui des autres pays socialistes. Il en est ainsi en
dépit, ou même à cause, du perpétuel état d'urgence qui règne dans
ce pays. Pour Cuba, la directe et continuelle confrontation avec
la nature et l'homme comme ennemi pendant la phase insurrec-
10. J.-P. Sartre, dans son reportage sur Cuba, peu de temps après
l'installation du régime révolutionnaire, publié aux États-Unis sous le
titre Sartre on Cuba (New York, 1961), discute certaines de ces manifes-
tations d'immédiateté en politique. La plupart de ses observations à
cet égard se trouvent dans trois chapitres rassemblés sous des titres
significatifs : Les Earbus prennent la Havane — « Mort aux principes
abstraits » ; Les gosses au pouvoir ; et « S'ils me demandent la lune... »
Le dernier des trois contient une discussion très intéressante entre Sartre
et Fidel sur la définition de l'humanisme. Castro déclare : « Si quelqu'un
me demande la lune, c'est qu'il en a besoin » et il poursuit : « II faut que
nous demandions tout ce qui est possible à chacun. Mais je ne sacrifiera
jamais cette génération à la suivante. Ce serait abstrait. »
l'installation du régime révolutionnaire, publié aux États-Unis sous le
titre Sartre on Cuba (New York, 1961), discute certaines de ces manifes-
tations d'immédiateté en politique. La plupart de ses observations à
cet égard se trouvent dans trois chapitres rassemblés sous des titres
significatifs : Les Earbus prennent la Havane — « Mort aux principes
abstraits » ; Les gosses au pouvoir ; et « S'ils me demandent la lune... »
Le dernier des trois contient une discussion très intéressante entre Sartre
et Fidel sur la définition de l'humanisme. Castro déclare : « Si quelqu'un
me demande la lune, c'est qu'il en a besoin » et il poursuit : « II faut que
nous demandions tout ce qui est possible à chacun. Mais je ne sacrifiera
jamais cette génération à la suivante. Ce serait abstrait. »
L'expression la plus puissante et la plus ramassée de l'immédiateté se
trouve dans le récent slogan de la révolution, d'une magnifique gratuité :
« Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. »
trouve dans le récent slogan de la révolution, d'une magnifique gratuité :
« Le devoir de tout révolutionnaire est de faire la révolution. »
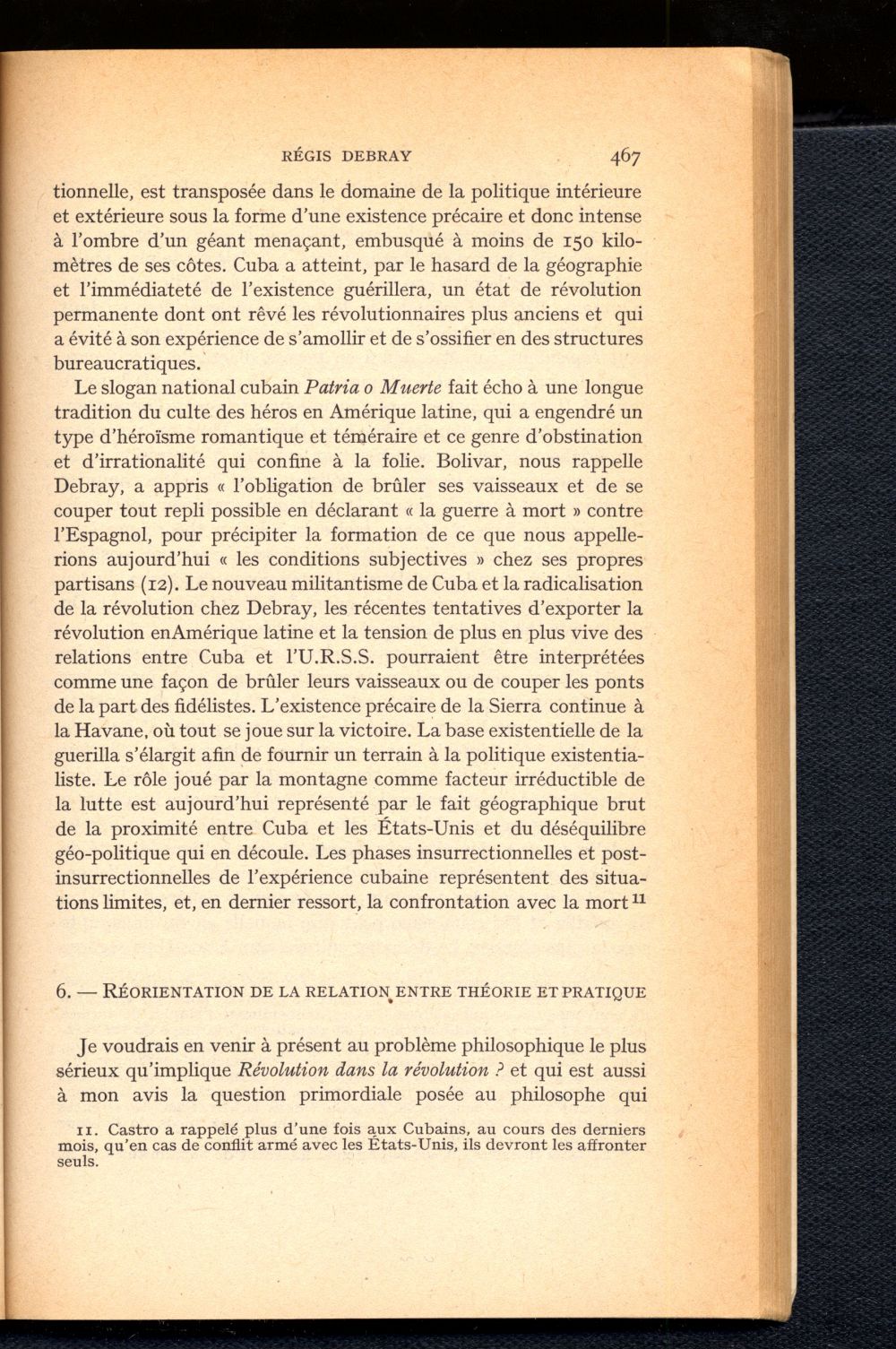

KEGIS DEBRAY
467
tionnelle, est transposée dans le domaine de la politique intérieure
et extérieure sous la forme d'une existence précaire et donc intense
à l'ombre d'un géant menaçant, embusqué à moins de 150 kilo-
mètres de ses côtes. Cuba a atteint, par le hasard de la géographie
et l'immédiateté de l'existence guérillera, un état de révolution
permanente dont ont rêvé les révolutionnaires plus anciens et qui
a évité à son expérience de s'amollir et de s'ossifier en des structures
bureaucratiques.
et extérieure sous la forme d'une existence précaire et donc intense
à l'ombre d'un géant menaçant, embusqué à moins de 150 kilo-
mètres de ses côtes. Cuba a atteint, par le hasard de la géographie
et l'immédiateté de l'existence guérillera, un état de révolution
permanente dont ont rêvé les révolutionnaires plus anciens et qui
a évité à son expérience de s'amollir et de s'ossifier en des structures
bureaucratiques.
Le slogan national cubain Patria o Mnerte fait écho à une longue
tradition du culte des héros en Amérique latine, qui a engendré un
type d'héroïsme romantique et téméraire et ce genre d'obstination
et d'irrationalité qui confine à la folie. Bolivar, nous rappelle
Debray, a appris « l'obligation de brûler ses vaisseaux et de se
couper tout repli possible en déclarant « la guerre à mort » contre
l'Espagnol, pour précipiter la formation de ce que nous appelle-
rions aujourd'hui « les conditions subjectives » chez ses propres
partisans (12). Le nouveau militantisme de Cuba et la radicalisation
de la révolution chez Debray, les récentes tentatives d'exporter la
révolution enAmérique latine et la tension de plus en plus vive des
relations entre Cuba et l'U.R.S.S. pourraient être interprétées
comme une façon de brûler leurs vaisseaux ou de couper les ponts
de la part des fidélistes. L'existence précaire de la Sierra continue à
la Havane, où tout se joue sur la victoire. La base existentielle de la
guérilla s'élargit afin de fournir un terrain à la politique existentia-
liste. Le rôle joué par la montagne comme facteur irréductible de
la lutte est aujourd'hui représenté par le fait géographique brut
de la proximité entre Cuba et les États-Unis et du déséquilibre
géo-politique qui en découle. Les phases insurrectionnelles et post-
insurrectionnelles de l'expérience cubaine représentent des situa-
tions limites, et, en dernier ressort, la confrontation avec la mortu
tradition du culte des héros en Amérique latine, qui a engendré un
type d'héroïsme romantique et téméraire et ce genre d'obstination
et d'irrationalité qui confine à la folie. Bolivar, nous rappelle
Debray, a appris « l'obligation de brûler ses vaisseaux et de se
couper tout repli possible en déclarant « la guerre à mort » contre
l'Espagnol, pour précipiter la formation de ce que nous appelle-
rions aujourd'hui « les conditions subjectives » chez ses propres
partisans (12). Le nouveau militantisme de Cuba et la radicalisation
de la révolution chez Debray, les récentes tentatives d'exporter la
révolution enAmérique latine et la tension de plus en plus vive des
relations entre Cuba et l'U.R.S.S. pourraient être interprétées
comme une façon de brûler leurs vaisseaux ou de couper les ponts
de la part des fidélistes. L'existence précaire de la Sierra continue à
la Havane, où tout se joue sur la victoire. La base existentielle de la
guérilla s'élargit afin de fournir un terrain à la politique existentia-
liste. Le rôle joué par la montagne comme facteur irréductible de
la lutte est aujourd'hui représenté par le fait géographique brut
de la proximité entre Cuba et les États-Unis et du déséquilibre
géo-politique qui en découle. Les phases insurrectionnelles et post-
insurrectionnelles de l'expérience cubaine représentent des situa-
tions limites, et, en dernier ressort, la confrontation avec la mortu
6. — RÉORIENTATION DE LA RELATION^ ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE
Je voudrais en venir à présent au problème philosophique le plus
sérieux qu'impliqué Révolution dans la révolution ? et qui est aussi
à mon avis la question primordiale posée au philosophe qui
sérieux qu'impliqué Révolution dans la révolution ? et qui est aussi
à mon avis la question primordiale posée au philosophe qui
il. Castro a rappelé plus d'une fois aux Cubains, au cours des derniers
mois, qu'en cas de conflit armé avec les États-Unis, ils devront les affronter
seuls.
mois, qu'en cas de conflit armé avec les États-Unis, ils devront les affronter
seuls.
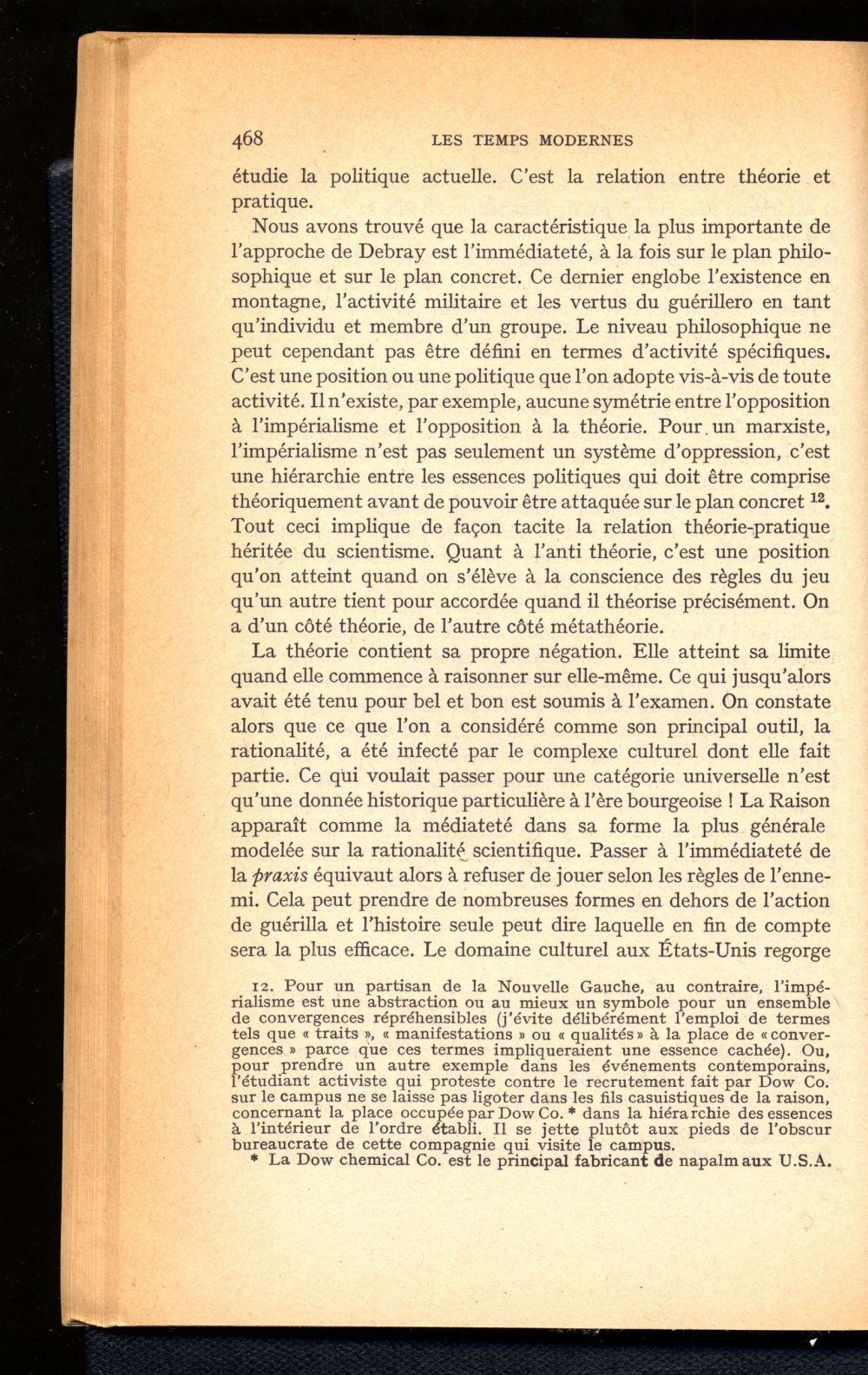

468 LES TEMPS MODERNES
étudie la politique actuelle. C'est la relation entre théorie et
pratique.
pratique.
Nous avons trouvé que la caractéristique la plus importante de
l'approche de Debray est l'immédiateté, à la fois sur le plan philo-
sophique et sur le plan concret. Ce dernier englobe l'existence en
montagne, l'activité militaire et les vertus du guérillero en tant
qu'individu et membre d'un groupe. Le niveau philosophique ne
peut cependant pas être défini en termes d'activité spécifiques.
C'est une position ou une politique que l'on adopte vis-à-vis de toute
activité. Il n'existe, par exemple, aucune symétrie entre l'opposition
à l'impérialisme et l'opposition à la théorie. Pour un marxiste,
l'impérialisme n'est pas seulement un système d'oppression, c'est
une hiérarchie entre les essences politiques qui doit être comprise
théoriquement avant de pouvoir être attaquée sur le plan concret 12.
Tout ceci implique de façon tacite la relation théorie-pratique
héritée du scientisme. Quant à l'anti théorie, c'est une position
qu'on atteint quand on s'élève à la conscience des règles du jeu
qu'un autre tient pour accordée quand il théorise précisément. On
a d'un côté théorie, de l'autre côté métathéorie.
l'approche de Debray est l'immédiateté, à la fois sur le plan philo-
sophique et sur le plan concret. Ce dernier englobe l'existence en
montagne, l'activité militaire et les vertus du guérillero en tant
qu'individu et membre d'un groupe. Le niveau philosophique ne
peut cependant pas être défini en termes d'activité spécifiques.
C'est une position ou une politique que l'on adopte vis-à-vis de toute
activité. Il n'existe, par exemple, aucune symétrie entre l'opposition
à l'impérialisme et l'opposition à la théorie. Pour un marxiste,
l'impérialisme n'est pas seulement un système d'oppression, c'est
une hiérarchie entre les essences politiques qui doit être comprise
théoriquement avant de pouvoir être attaquée sur le plan concret 12.
Tout ceci implique de façon tacite la relation théorie-pratique
héritée du scientisme. Quant à l'anti théorie, c'est une position
qu'on atteint quand on s'élève à la conscience des règles du jeu
qu'un autre tient pour accordée quand il théorise précisément. On
a d'un côté théorie, de l'autre côté métathéorie.
La théorie contient sa propre négation. Elle atteint sa limite
quand elle commence à raisonner sur elle-même. Ce qui jusqu'alors
avait été tenu pour bel et bon est soumis à l'examen. On constate
alors que ce que l'on a considéré comme son principal outil, la
rationalité, a été infecté par le complexe culturel dont elle fait
partie. Ce qui voulait passer pour une catégorie universelle n'est
qu'une donnée historique particulière à l'ère bourgeoise ! La Raison
apparaît comme la médiateté dans sa forme la plus générale
modelée sur la rationalité scientifique. Passer à l'immédiateté de
la praxis équivaut alors à refuser de jouer selon les règles de l'enne-
mi. Cela peut prendre de nombreuses formes en dehors de l'action
de guérilla et l'histoire seule peut dire laquelle en fin de compte
sera la plus efficace. Le domaine culturel aux États-Unis regorge
quand elle commence à raisonner sur elle-même. Ce qui jusqu'alors
avait été tenu pour bel et bon est soumis à l'examen. On constate
alors que ce que l'on a considéré comme son principal outil, la
rationalité, a été infecté par le complexe culturel dont elle fait
partie. Ce qui voulait passer pour une catégorie universelle n'est
qu'une donnée historique particulière à l'ère bourgeoise ! La Raison
apparaît comme la médiateté dans sa forme la plus générale
modelée sur la rationalité scientifique. Passer à l'immédiateté de
la praxis équivaut alors à refuser de jouer selon les règles de l'enne-
mi. Cela peut prendre de nombreuses formes en dehors de l'action
de guérilla et l'histoire seule peut dire laquelle en fin de compte
sera la plus efficace. Le domaine culturel aux États-Unis regorge
12. Pour un partisan de la Nouvelle Gauche, au contraire, l'impé-
rialisme est une abstraction ou au mieux un symbole pour un ensemble
de convergences répréhensibles (j'évite délibérément l'emploi de termes
tels que « traits », « manifestations » ou <c qualités » à la place de « conver-
gences » parce que ces termes impliqueraient une essence cachée). Ou,
pour prendre un autre exemple dans les événements contemporains,
l'étudiant activiste qui proteste contre le recrutement fait par Dow Co.
sur le campus ne se laisse pas ligoter dans les fils casuistiques de la raison,
concernant la place occupée par DowCo. * dans la hiérarchie des essences
à l'intérieur de l'ordre établi. Il se jette plutôt aux pieds de l'obscur
rialisme est une abstraction ou au mieux un symbole pour un ensemble
de convergences répréhensibles (j'évite délibérément l'emploi de termes
tels que « traits », « manifestations » ou <c qualités » à la place de « conver-
gences » parce que ces termes impliqueraient une essence cachée). Ou,
pour prendre un autre exemple dans les événements contemporains,
l'étudiant activiste qui proteste contre le recrutement fait par Dow Co.
sur le campus ne se laisse pas ligoter dans les fils casuistiques de la raison,
concernant la place occupée par DowCo. * dans la hiérarchie des essences
à l'intérieur de l'ordre établi. Il se jette plutôt aux pieds de l'obscur
bureaucrate de cette compagnie qui visite le campus.
* La Dow chemical Co. est le principal fabricant de napal
m aux U.S. A.
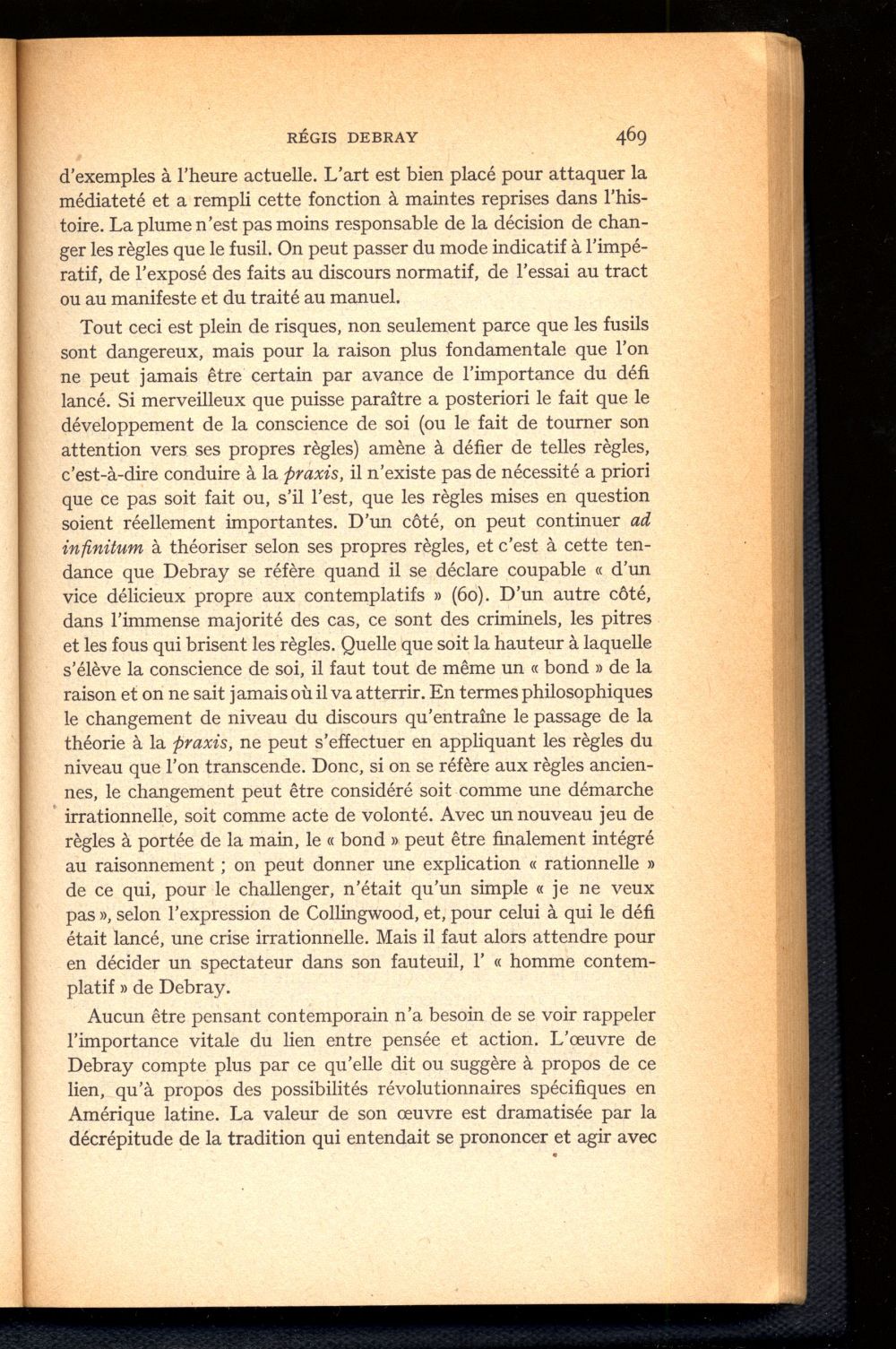

RÉGIS DEBRAY
469
d'exemples à l'heure actuelle. L'art est bien placé pour attaquer la
médiateté et a rempli cette fonction à maintes reprises dans l'his-
toire. La plume n'est pas moins responsable de la décision de chan-
ger les règles que le fusil. On peut passer du mode indicatif à l'impé-
ratif, de l'exposé des faits au discours normatif, de l'essai au tract
ou au manifeste et du traité au manuel.
médiateté et a rempli cette fonction à maintes reprises dans l'his-
toire. La plume n'est pas moins responsable de la décision de chan-
ger les règles que le fusil. On peut passer du mode indicatif à l'impé-
ratif, de l'exposé des faits au discours normatif, de l'essai au tract
ou au manifeste et du traité au manuel.
Tout ceci est plein de risques, non seulement parce que les fusils
sont dangereux, mais pour la raison plus fondamentale que l'on
ne peut jamais être certain par avance de l'importance du défi
lancé. Si merveilleux que puisse paraître a posteriori le fait que le
développement de la conscience de soi (ou le fait de tourner son
attention vers ses propres règles) amène à défier de telles règles,
c'est-à-dire conduire à la praxis, il n'existe pas de nécessité a priori
que ce pas soit fait ou, s'il l'est, que les règles mises en question
soient réellement importantes. D'un côté, on peut continuer ad
infinitum à théoriser selon ses propres règles, et c'est à cette ten-
dance que Debray se réfère quand il se déclare coupable « d'un
vice délicieux propre aux contemplatifs » (60). D'un autre côté,
dans l'immense majorité des cas, ce sont des criminels, les pitres
et les fous qui brisent les règles. Quelle que soit la hauteur à laquelle
s'élève la conscience de soi, il faut tout de même un « bond » de la
raison et on ne sait jamais où il va atterrir. En termes philosophiques
le changement de niveau du discours qu'entraîné le passage de la
théorie à la praxis, ne peut s'effectuer en appliquant les règles du
niveau que l'on transcende. Donc, si on se réfère aux règles ancien-
nes, le changement peut être considéré soit comme une démarche
irrationnelle, soit comme acte de volonté. Avec un nouveau jeu de
règles à portée de la main, le « bond » peut être finalement intégré
au raisonnement ; on peut donner une explication « rationnelle »
de ce qui, pour le challenger, n'était qu'un simple « je ne veux
pas », selon l'expression de Collingwood, et, pour celui à qui le défi
était lancé, une crise irrationnelle. Mais il faut alors attendre pour
en décider un spectateur dans son fauteuil, 1' « homme contem-
platif » de Debray.
sont dangereux, mais pour la raison plus fondamentale que l'on
ne peut jamais être certain par avance de l'importance du défi
lancé. Si merveilleux que puisse paraître a posteriori le fait que le
développement de la conscience de soi (ou le fait de tourner son
attention vers ses propres règles) amène à défier de telles règles,
c'est-à-dire conduire à la praxis, il n'existe pas de nécessité a priori
que ce pas soit fait ou, s'il l'est, que les règles mises en question
soient réellement importantes. D'un côté, on peut continuer ad
infinitum à théoriser selon ses propres règles, et c'est à cette ten-
dance que Debray se réfère quand il se déclare coupable « d'un
vice délicieux propre aux contemplatifs » (60). D'un autre côté,
dans l'immense majorité des cas, ce sont des criminels, les pitres
et les fous qui brisent les règles. Quelle que soit la hauteur à laquelle
s'élève la conscience de soi, il faut tout de même un « bond » de la
raison et on ne sait jamais où il va atterrir. En termes philosophiques
le changement de niveau du discours qu'entraîné le passage de la
théorie à la praxis, ne peut s'effectuer en appliquant les règles du
niveau que l'on transcende. Donc, si on se réfère aux règles ancien-
nes, le changement peut être considéré soit comme une démarche
irrationnelle, soit comme acte de volonté. Avec un nouveau jeu de
règles à portée de la main, le « bond » peut être finalement intégré
au raisonnement ; on peut donner une explication « rationnelle »
de ce qui, pour le challenger, n'était qu'un simple « je ne veux
pas », selon l'expression de Collingwood, et, pour celui à qui le défi
était lancé, une crise irrationnelle. Mais il faut alors attendre pour
en décider un spectateur dans son fauteuil, 1' « homme contem-
platif » de Debray.
Aucun être pensant contemporain n'a besoin de se voir rappeler
l'importance vitale du lien entre pensée et action. L'œuvre de
Debray compte plus par ce qu'elle dit ou suggère à propos de ce
lien, qu'à propos des possibilités révolutionnaires spécifiques en
Amérique latine. La valeur de son œuvre est dramatisée par la
décrépitude de la tradition qui entendait se prononcer et agir avec
l'importance vitale du lien entre pensée et action. L'œuvre de
Debray compte plus par ce qu'elle dit ou suggère à propos de ce
lien, qu'à propos des possibilités révolutionnaires spécifiques en
Amérique latine. La valeur de son œuvre est dramatisée par la
décrépitude de la tradition qui entendait se prononcer et agir avec
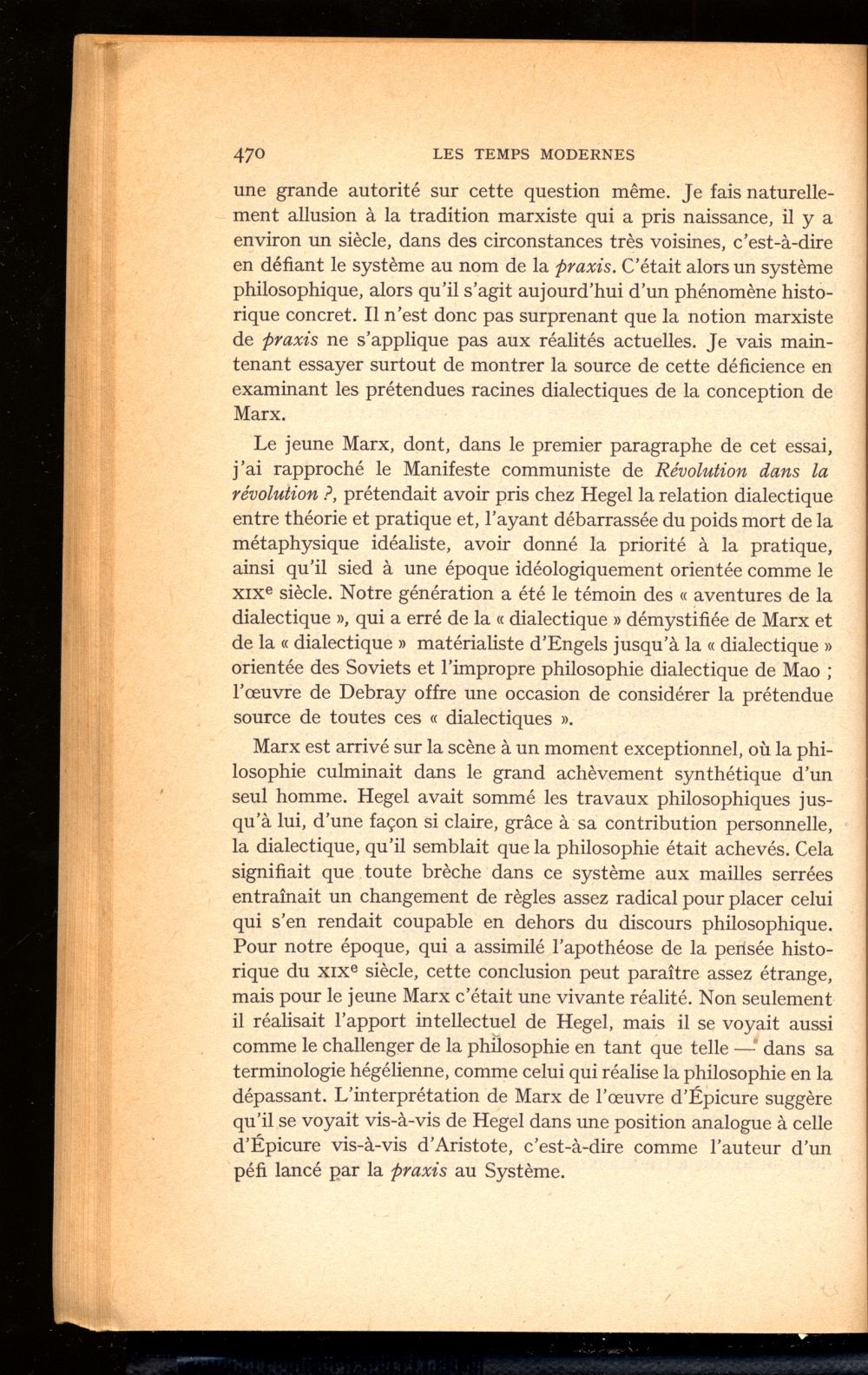

470
LES TEMPS MODERNES
une grande autorité sur cette question même. Je fais naturelle-
ment allusion à la tradition marxiste qui a pris naissance, il y a
environ un siècle, dans des circonstances très voisines, c'est-à-dire
en défiant le système au nom de la praxis. C'était alors un système
philosophique, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'un phénomène histo-
rique concret. Il n'est donc pas surprenant que la notion marxiste
de praxis ne s'applique pas aux réalités actuelles. Je vais main-
tenant essayer surtout de montrer la source de cette déficience en
examinant les prétendues racines dialectiques de la conception de
Marx.
ment allusion à la tradition marxiste qui a pris naissance, il y a
environ un siècle, dans des circonstances très voisines, c'est-à-dire
en défiant le système au nom de la praxis. C'était alors un système
philosophique, alors qu'il s'agit aujourd'hui d'un phénomène histo-
rique concret. Il n'est donc pas surprenant que la notion marxiste
de praxis ne s'applique pas aux réalités actuelles. Je vais main-
tenant essayer surtout de montrer la source de cette déficience en
examinant les prétendues racines dialectiques de la conception de
Marx.
Le jeune Marx, dont, dans le premier paragraphe de cet essai,
j'ai rapproché le Manifeste communiste de Révolution dans la
révolution ?, prétendait avoir pris chez Hegel la relation dialectique
entre théorie et pratique et, l'ayant débarrassée du poids mort de la
métaphysique idéaliste, avoir donné la priorité à la pratique,
ainsi qu'il sied à une époque idéologiquement orientée comme le
XIXe siècle. Notre génération a été le témoin des « aventures de la
dialectique », qui a erré de la « dialectique » démystifiée de Marx et
de la « dialectique » matérialiste d'Engels jusqu'à la « dialectique »
orientée des Soviets et l'impropre philosophie dialectique de Mao ;
l'œuvre de Debray offre une occasion de considérer la prétendue
source de toutes ces « dialectiques ».
j'ai rapproché le Manifeste communiste de Révolution dans la
révolution ?, prétendait avoir pris chez Hegel la relation dialectique
entre théorie et pratique et, l'ayant débarrassée du poids mort de la
métaphysique idéaliste, avoir donné la priorité à la pratique,
ainsi qu'il sied à une époque idéologiquement orientée comme le
XIXe siècle. Notre génération a été le témoin des « aventures de la
dialectique », qui a erré de la « dialectique » démystifiée de Marx et
de la « dialectique » matérialiste d'Engels jusqu'à la « dialectique »
orientée des Soviets et l'impropre philosophie dialectique de Mao ;
l'œuvre de Debray offre une occasion de considérer la prétendue
source de toutes ces « dialectiques ».
Marx est arrivé sur la scène à un moment exceptionnel, où la phi-
losophie culminait dans le grand achèvement synthétique d'un
seul homme. Hegel avait sommé les travaux philosophiques jus-
qu'à lui, d'une façon si claire, grâce à sa contribution personnelle,
la dialectique, qu'il semblait que la philosophie était achevés. Cela
signifiait que toute brèche dans ce système aux mailles serrées
entraînait un changement de règles assez radical pour placer celui
qui s'en rendait coupable en dehors du discours philosophique.
Pour notre époque, qui a assimilé l'apothéose de la pensée histo-
rique du xixe siècle, cette conclusion peut paraître assez étrange,
mais pour le jeune Marx c'était une vivante réalité. Non seulement
il réalisait l'apport intellectuel de Hegel, mais il se voyait aussi
comme le challenger de la philosophie en tant que telle — dans sa
terminologie hégélienne, comme celui qui réalise la philosophie en la
dépassant. L'interprétation de Marx de l'œuvre d'Épicure suggère
qu'il se voyait vis-à-vis de Hegel dans une position analogue à celle
d'Épicure vis-à-vis d'Aristote, c'est-à-dire comme l'auteur d'un
péfi lancé par la praxis au Système.
losophie culminait dans le grand achèvement synthétique d'un
seul homme. Hegel avait sommé les travaux philosophiques jus-
qu'à lui, d'une façon si claire, grâce à sa contribution personnelle,
la dialectique, qu'il semblait que la philosophie était achevés. Cela
signifiait que toute brèche dans ce système aux mailles serrées
entraînait un changement de règles assez radical pour placer celui
qui s'en rendait coupable en dehors du discours philosophique.
Pour notre époque, qui a assimilé l'apothéose de la pensée histo-
rique du xixe siècle, cette conclusion peut paraître assez étrange,
mais pour le jeune Marx c'était une vivante réalité. Non seulement
il réalisait l'apport intellectuel de Hegel, mais il se voyait aussi
comme le challenger de la philosophie en tant que telle — dans sa
terminologie hégélienne, comme celui qui réalise la philosophie en la
dépassant. L'interprétation de Marx de l'œuvre d'Épicure suggère
qu'il se voyait vis-à-vis de Hegel dans une position analogue à celle
d'Épicure vis-à-vis d'Aristote, c'est-à-dire comme l'auteur d'un
péfi lancé par la praxis au Système.
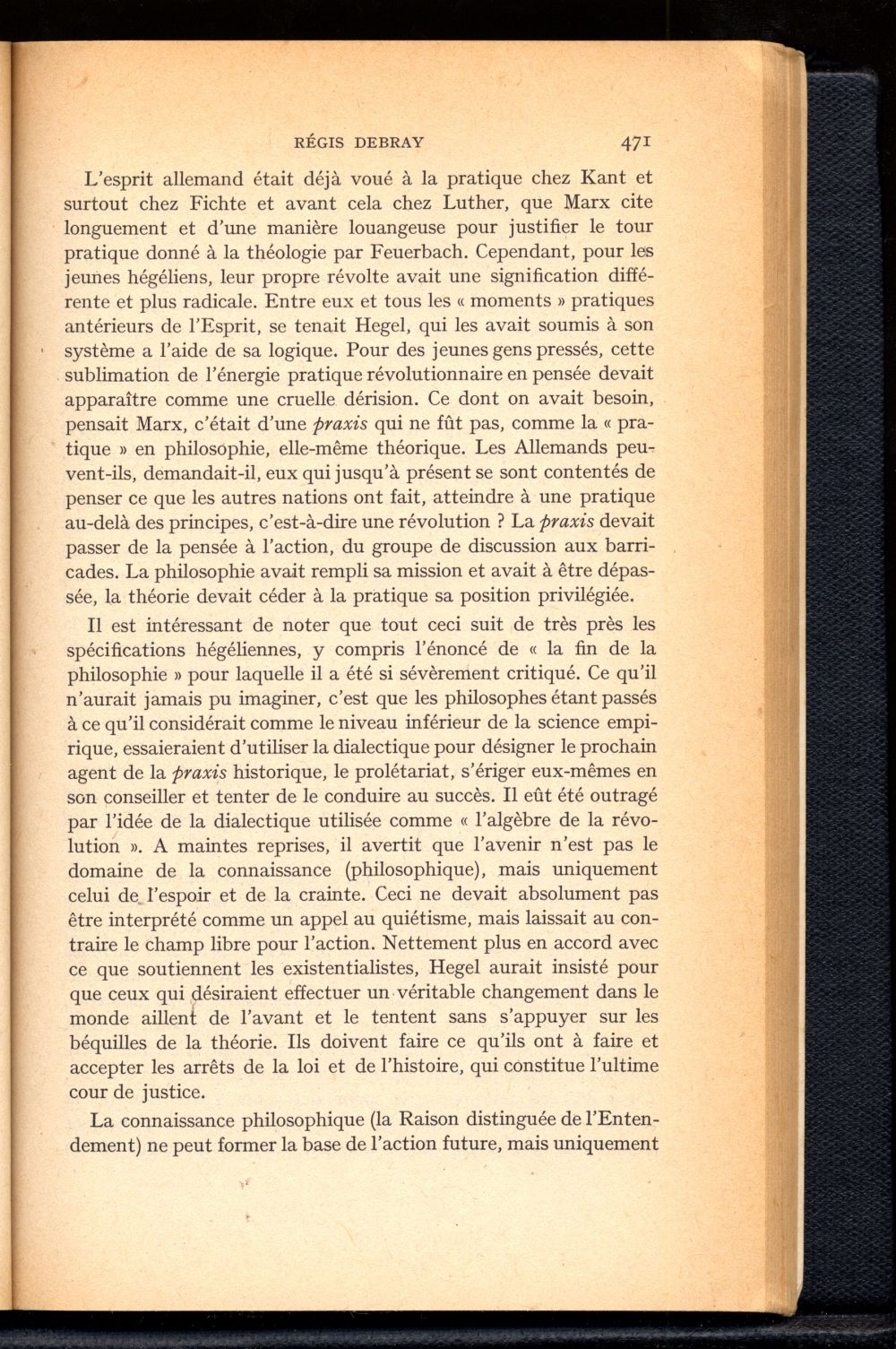

REGIS DEBRAY
471
L'esprit allemand était déjà voué à la pratique chez Kant et
surtout chez Fichte et avant cela chez Luther, que Marx cite
longuement et d'une manière louangeuse pour justifier le tour
pratique donné à la théologie par Feuerbach. Cependant, pour les
jeunes hégéliens, leur propre révolte avait une signification diffé-
rente et plus radicale. Entre eux et tous les « moments » pratiques
antérieurs de l'Esprit, se tenait Hegel, qui les avait soumis à son
système a l'aide de sa logique. Pour des jeunes gens pressés, cette
sublimation de l'énergie pratique révolutionnaire en pensée devait
apparaître comme une cruelle dérision. Ce dont on avait besoin,
pensait Marx, c'était d'une praxis qui ne fût pas, comme la « pra-
tique » en philosophie, elle-même théorique. Les Allemands peu-
vent-ils, demandait-il, eux qui jusqu'à présent se sont contentés de
penser ce que les autres nations ont fait, atteindre à une pratique
au-delà des principes, c'est-à-dire une révolution ? La praxis devait
passer de la pensée à l'action, du groupe de discussion aux barri-
cades. La philosophie avait rempli sa mission et avait à être dépas-
sée, la théorie devait céder à la pratique sa position privilégiée.
surtout chez Fichte et avant cela chez Luther, que Marx cite
longuement et d'une manière louangeuse pour justifier le tour
pratique donné à la théologie par Feuerbach. Cependant, pour les
jeunes hégéliens, leur propre révolte avait une signification diffé-
rente et plus radicale. Entre eux et tous les « moments » pratiques
antérieurs de l'Esprit, se tenait Hegel, qui les avait soumis à son
système a l'aide de sa logique. Pour des jeunes gens pressés, cette
sublimation de l'énergie pratique révolutionnaire en pensée devait
apparaître comme une cruelle dérision. Ce dont on avait besoin,
pensait Marx, c'était d'une praxis qui ne fût pas, comme la « pra-
tique » en philosophie, elle-même théorique. Les Allemands peu-
vent-ils, demandait-il, eux qui jusqu'à présent se sont contentés de
penser ce que les autres nations ont fait, atteindre à une pratique
au-delà des principes, c'est-à-dire une révolution ? La praxis devait
passer de la pensée à l'action, du groupe de discussion aux barri-
cades. La philosophie avait rempli sa mission et avait à être dépas-
sée, la théorie devait céder à la pratique sa position privilégiée.
Il est intéressant de noter que tout ceci suit de très près les
spécifications hégéliennes, y compris l'énoncé de « la fin de la
philosophie » pour laquelle il a été si sévèrement critiqué. Ce qu'il
n'aurait jamais pu imaginer, c'est que les philosophes étant passés
à ce qu'il considérait comme le niveau inférieur de la science empi-
rique, essaieraient d'utiliser la dialectique pour désigner le prochain
agent de la praxis historique, le prolétariat, s'ériger eux-mêmes en
son conseiller et tenter de le conduire au succès. Il eût été outragé
par l'idée de la dialectique utilisée comme « l'algèbre de la révo-
lution ». A maintes reprises, il avertit que l'avenir n'est pas le
domaine de la connaissance (philosophique), mais uniquement
celui de l'espoir et de la crainte. Ceci ne devait absolument pas
être interprété comme un appel au quiétisme, mais laissait au con-
traire le champ libre pour l'action. Nettement plus en accord avec
ce que soutiennent les existentialistes, Hegel aurait insisté pour
que ceux qui désiraient effectuer un véritable changement dans le
monde aillent de l'avant et le tentent sans s'appuyer sur les
béquilles de la théorie. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire et
accepter les arrêts de la loi et de l'histoire, qui constitue l'ultime
cour de justice.
spécifications hégéliennes, y compris l'énoncé de « la fin de la
philosophie » pour laquelle il a été si sévèrement critiqué. Ce qu'il
n'aurait jamais pu imaginer, c'est que les philosophes étant passés
à ce qu'il considérait comme le niveau inférieur de la science empi-
rique, essaieraient d'utiliser la dialectique pour désigner le prochain
agent de la praxis historique, le prolétariat, s'ériger eux-mêmes en
son conseiller et tenter de le conduire au succès. Il eût été outragé
par l'idée de la dialectique utilisée comme « l'algèbre de la révo-
lution ». A maintes reprises, il avertit que l'avenir n'est pas le
domaine de la connaissance (philosophique), mais uniquement
celui de l'espoir et de la crainte. Ceci ne devait absolument pas
être interprété comme un appel au quiétisme, mais laissait au con-
traire le champ libre pour l'action. Nettement plus en accord avec
ce que soutiennent les existentialistes, Hegel aurait insisté pour
que ceux qui désiraient effectuer un véritable changement dans le
monde aillent de l'avant et le tentent sans s'appuyer sur les
béquilles de la théorie. Ils doivent faire ce qu'ils ont à faire et
accepter les arrêts de la loi et de l'histoire, qui constitue l'ultime
cour de justice.
La connaissance philosophique (la Raison distinguée de l'Enten-
dement) ne peut former la base de l'action future, mais uniquement
dement) ne peut former la base de l'action future, mais uniquement
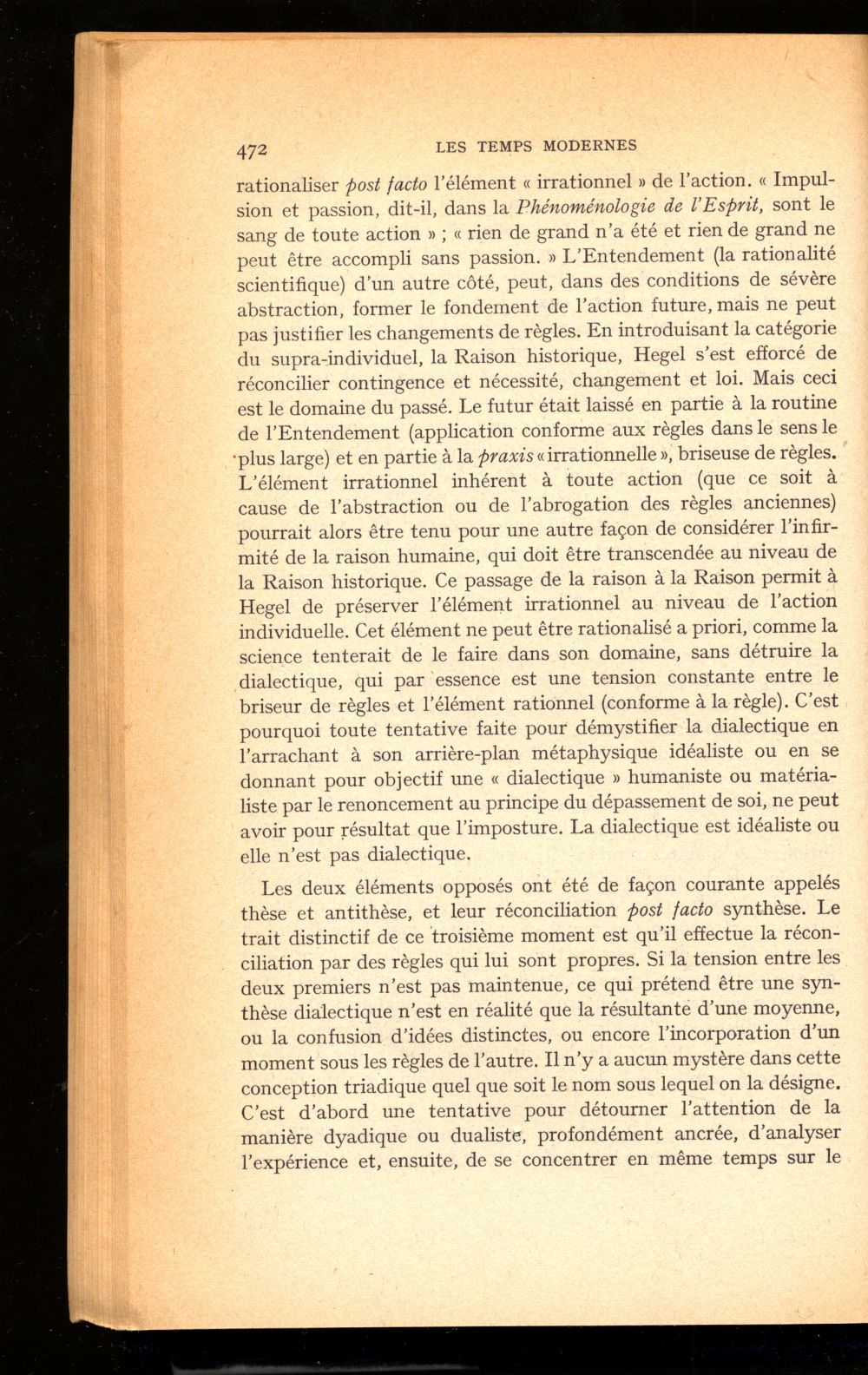

472 LES TEMPS MODERNES
rationaliser post facto l'élément « irrationnel » de l'action. « Impul-
sion et passion, dit-il, dans la Phénoménologie de l'Esprit, sont le
sang de toute action » ; « rien de grand n'a été et rien de grand ne
peut être accompli sans passion. » L'Entendement (la rationalité
scientifique) d'un autre côté, peut, dans des conditions de sévère
abstraction, former le fondement de l'action future, mais ne peut
pas justifier les changements de règles. En introduisant la catégorie
du supra-individuel, la Raison historique, Hegel s'est efforcé de
réconcilier contingence et nécessité, changement et loi. Mais ceci
est le domaine du passé. Le futur était laissé en partie à la routine
de l'Entendement (application conforme aux règles dans le sens le
•plus large) et en partie à la praxis «irrationnelle », briseuse de règles.
L'élément irrationnel inhérent à toute action (que ce soit à
cause de l'abstraction ou de l'abrogation des règles anciennes)
pourrait alors être tenu pour une autre façon de considérer l'infir-
mité de la raison humaine, qui doit être transcendée au niveau de
la Raison historique. Ce passage de la raison à la Raison permit à
Hegel de préserver l'élément irrationnel au niveau de l'action
individuelle. Cet élément ne peut être rationalisé a priori, comme la
science tenterait de le faire dans son domaine, sans détruire la
dialectique, qui par essence est une tension constante entre le
briseur de règles et l'élément rationnel (conforme à la règle). C'est
pourquoi toute tentative faite pour démystifier la dialectique en
l'arrachant à son arrière-plan métaphysique idéaliste ou en se
donnant pour objectif une « dialectique » humaniste ou matéria-
liste par le renoncement au principe du dépassement de soi, ne peut
avoir pour résultat que l'imposture. La dialectique est idéaliste ou
elle n'est pas dialectique.
sion et passion, dit-il, dans la Phénoménologie de l'Esprit, sont le
sang de toute action » ; « rien de grand n'a été et rien de grand ne
peut être accompli sans passion. » L'Entendement (la rationalité
scientifique) d'un autre côté, peut, dans des conditions de sévère
abstraction, former le fondement de l'action future, mais ne peut
pas justifier les changements de règles. En introduisant la catégorie
du supra-individuel, la Raison historique, Hegel s'est efforcé de
réconcilier contingence et nécessité, changement et loi. Mais ceci
est le domaine du passé. Le futur était laissé en partie à la routine
de l'Entendement (application conforme aux règles dans le sens le
•plus large) et en partie à la praxis «irrationnelle », briseuse de règles.
L'élément irrationnel inhérent à toute action (que ce soit à
cause de l'abstraction ou de l'abrogation des règles anciennes)
pourrait alors être tenu pour une autre façon de considérer l'infir-
mité de la raison humaine, qui doit être transcendée au niveau de
la Raison historique. Ce passage de la raison à la Raison permit à
Hegel de préserver l'élément irrationnel au niveau de l'action
individuelle. Cet élément ne peut être rationalisé a priori, comme la
science tenterait de le faire dans son domaine, sans détruire la
dialectique, qui par essence est une tension constante entre le
briseur de règles et l'élément rationnel (conforme à la règle). C'est
pourquoi toute tentative faite pour démystifier la dialectique en
l'arrachant à son arrière-plan métaphysique idéaliste ou en se
donnant pour objectif une « dialectique » humaniste ou matéria-
liste par le renoncement au principe du dépassement de soi, ne peut
avoir pour résultat que l'imposture. La dialectique est idéaliste ou
elle n'est pas dialectique.
Les deux éléments opposés ont été de façon courante appelés
thèse et antithèse, et leur réconciliation post facto synthèse. Le
trait distinctif de ce troisième moment est qu'il effectue la récon-
ciliation par des règles qui lui sont propres. Si la tension entre les
deux premiers n'est pas maintenue, ce qui prétend être une syn-
thèse dialectique n'est en réalité que la résultante d'une moyenne,
ou la confusion d'idées distinctes, ou encore l'incorporation d'un
moment sous les règles de l'autre. Il n'y a aucun mystère dans cette
conception triadique quel que soit le nom sous lequel on la désigne.
C'est d'abord une tentative pour détourner l'attention de la
manière dyadique ou dualiste, profondément ancrée, d'analyser
l'expérience et, ensuite, de se concentrer en même temps sur le
thèse et antithèse, et leur réconciliation post facto synthèse. Le
trait distinctif de ce troisième moment est qu'il effectue la récon-
ciliation par des règles qui lui sont propres. Si la tension entre les
deux premiers n'est pas maintenue, ce qui prétend être une syn-
thèse dialectique n'est en réalité que la résultante d'une moyenne,
ou la confusion d'idées distinctes, ou encore l'incorporation d'un
moment sous les règles de l'autre. Il n'y a aucun mystère dans cette
conception triadique quel que soit le nom sous lequel on la désigne.
C'est d'abord une tentative pour détourner l'attention de la
manière dyadique ou dualiste, profondément ancrée, d'analyser
l'expérience et, ensuite, de se concentrer en même temps sur le
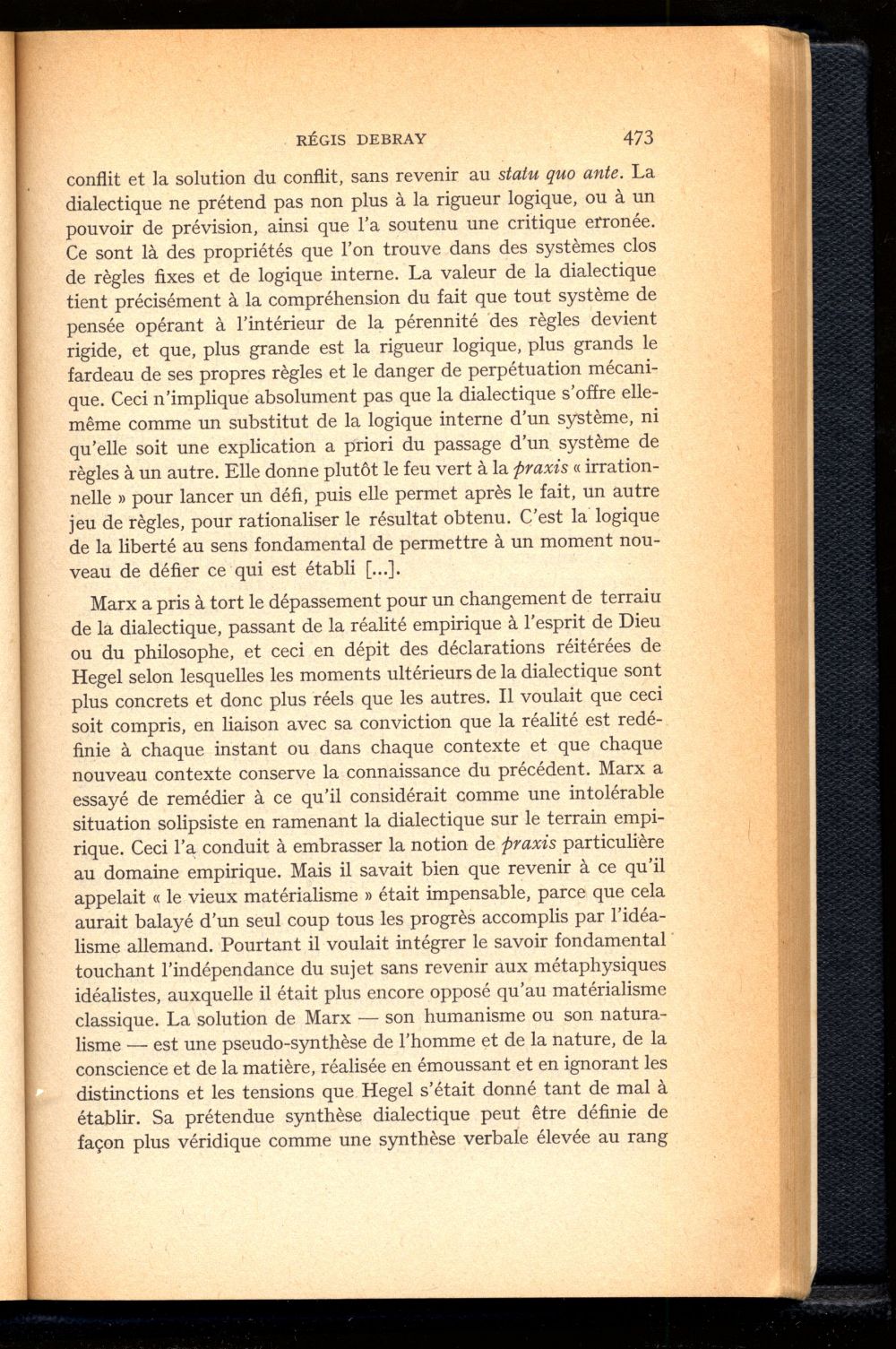

RÉGIS DEBRAY
473
conflit et la solution du conflit, sans revenir au statu quo ante. La
dialectique ne prétend pas non plus à la rigueur logique, ou à un
pouvoir de prévision, ainsi que l'a soutenu une critique erronée.
Ce sont là des propriétés que l'on trouve dans des systèmes clos
de règles fixes et de logique interne. La valeur de la dialectique
tient précisément à la compréhension du fait que tout système de
pensée opérant à l'intérieur de la pérennité des règles devient
rigide, et que, plus grande est la rigueur logique, plus grands le
fardeau de ses propres règles et le danger de perpétuation mécani-
que. Ceci n'implique absolument pas que la dialectique s'offre elle-
même comme un substitut de la logique interne d'un système, ni
qu'elle soit une explication a priori du passage d'un système de
règles à un autre. Elle donne plutôt le feu vert à la praxis « irration-
nelle » pour lancer un défi, puis elle permet après le fait, un autre
jeu de règles, pour rationaliser le résultat obtenu. C'est la logique
de la liberté au sens fondamental de permettre à un moment nou-
veau de défier ce qui est établi [...].
dialectique ne prétend pas non plus à la rigueur logique, ou à un
pouvoir de prévision, ainsi que l'a soutenu une critique erronée.
Ce sont là des propriétés que l'on trouve dans des systèmes clos
de règles fixes et de logique interne. La valeur de la dialectique
tient précisément à la compréhension du fait que tout système de
pensée opérant à l'intérieur de la pérennité des règles devient
rigide, et que, plus grande est la rigueur logique, plus grands le
fardeau de ses propres règles et le danger de perpétuation mécani-
que. Ceci n'implique absolument pas que la dialectique s'offre elle-
même comme un substitut de la logique interne d'un système, ni
qu'elle soit une explication a priori du passage d'un système de
règles à un autre. Elle donne plutôt le feu vert à la praxis « irration-
nelle » pour lancer un défi, puis elle permet après le fait, un autre
jeu de règles, pour rationaliser le résultat obtenu. C'est la logique
de la liberté au sens fondamental de permettre à un moment nou-
veau de défier ce qui est établi [...].
Marx a pris à tort le dépassement pour un changement de terraiu
de la dialectique, passant de la réalité empirique à l'esprit de Dieu
ou du philosophe, et ceci en dépit des déclarations réitérées de
Hegel selon lesquelles les moments ultérieurs de la dialectique sont
plus concrets et donc plus réels que les autres. Il voulait que ceci
soit compris, en liaison avec sa conviction que la réalité est redé-
finie à chaque instant ou dans chaque contexte et que chaque
nouveau contexte conserve la connaissance du précédent. Marx a
essayé de remédier à ce qu'il considérait comme une intolérable
situation solipsiste en ramenant la dialectique sur le terrain empi-
rique. Ceci l'a conduit à embrasser la notion de -praxis particulière
au domaine empirique. Mais il savait bien que revenir à ce qu'il
appelait « le vieux matérialisme » était impensable, parce que cela
aurait balayé d'un seul coup tous les progrès accomplis par l'idéa-
lisme allemand. Pourtant il voulait intégrer le savoir fondamental
touchant l'indépendance du sujet sans revenir aux métaphysiques
idéalistes, auxquelle il était plus encore opposé qu'au matérialisme
classique. La solution de Marx — son humanisme ou son natura-
lisme — est une pseudo-synthèse de l'homme et de la nature, de la
conscience et de la matière, réalisée en émoussant et en ignorant les
distinctions et les tensions que Hegel s'était donné tant de mal à
établir. Sa prétendue synthèse dialectique peut être définie de
façon plus véridique comme une synthèse verbale élevée au rang
de la dialectique, passant de la réalité empirique à l'esprit de Dieu
ou du philosophe, et ceci en dépit des déclarations réitérées de
Hegel selon lesquelles les moments ultérieurs de la dialectique sont
plus concrets et donc plus réels que les autres. Il voulait que ceci
soit compris, en liaison avec sa conviction que la réalité est redé-
finie à chaque instant ou dans chaque contexte et que chaque
nouveau contexte conserve la connaissance du précédent. Marx a
essayé de remédier à ce qu'il considérait comme une intolérable
situation solipsiste en ramenant la dialectique sur le terrain empi-
rique. Ceci l'a conduit à embrasser la notion de -praxis particulière
au domaine empirique. Mais il savait bien que revenir à ce qu'il
appelait « le vieux matérialisme » était impensable, parce que cela
aurait balayé d'un seul coup tous les progrès accomplis par l'idéa-
lisme allemand. Pourtant il voulait intégrer le savoir fondamental
touchant l'indépendance du sujet sans revenir aux métaphysiques
idéalistes, auxquelle il était plus encore opposé qu'au matérialisme
classique. La solution de Marx — son humanisme ou son natura-
lisme — est une pseudo-synthèse de l'homme et de la nature, de la
conscience et de la matière, réalisée en émoussant et en ignorant les
distinctions et les tensions que Hegel s'était donné tant de mal à
établir. Sa prétendue synthèse dialectique peut être définie de
façon plus véridique comme une synthèse verbale élevée au rang
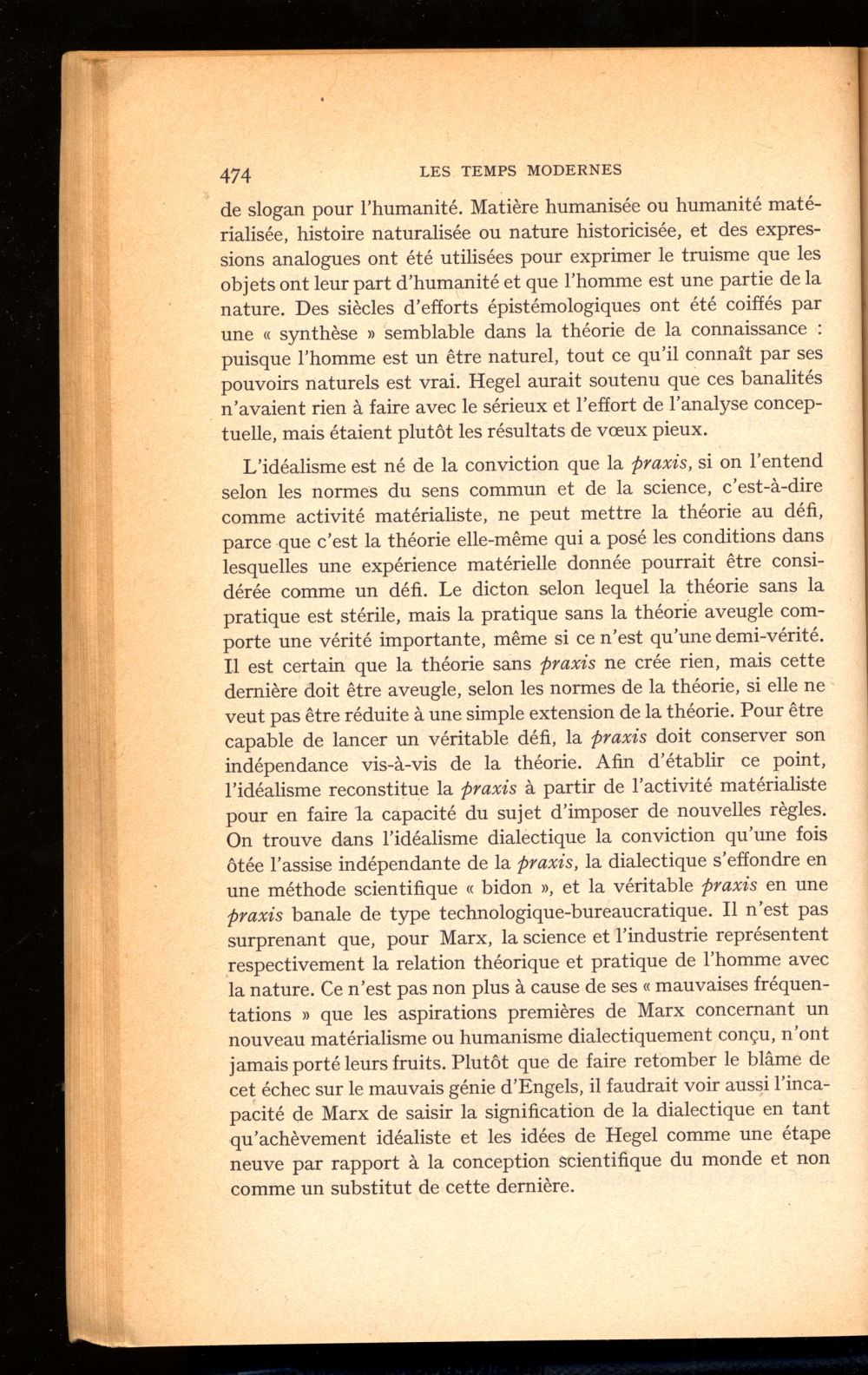

474
LES TEMPS MODERNES
de slogan pour l'humanité. Matière humanisée ou humanité maté-
rialisée, histoire naturalisée ou nature historicisée, et des expres-
sions analogues ont été utilisées pour exprimer le truisme que les
objets ont leur part d'humanité et que l'homme est une partie de la
nature. Des siècles d'efforts épistémologiques ont été coiffés par
une « synthèse » semblable dans la théorie de la connaissance :
puisque l'homme est un être naturel, tout ce qu'il connaît par ses
pouvoirs naturels est vrai. Hegel aurait soutenu que ces banalités
n'avaient rien à faire avec le sérieux et l'effort de l'analyse concep-
tuelle, mais étaient plutôt les résultats de vœux pieux.
rialisée, histoire naturalisée ou nature historicisée, et des expres-
sions analogues ont été utilisées pour exprimer le truisme que les
objets ont leur part d'humanité et que l'homme est une partie de la
nature. Des siècles d'efforts épistémologiques ont été coiffés par
une « synthèse » semblable dans la théorie de la connaissance :
puisque l'homme est un être naturel, tout ce qu'il connaît par ses
pouvoirs naturels est vrai. Hegel aurait soutenu que ces banalités
n'avaient rien à faire avec le sérieux et l'effort de l'analyse concep-
tuelle, mais étaient plutôt les résultats de vœux pieux.
L'idéalisme est né de la conviction que la praxis, si on l'entend
selon les normes du sens commun et de la science, c'est-à-dire
comme activité matérialiste, ne peut mettre la théorie au défi,
parce que c'est la théorie elle-même qui a posé les conditions dans
lesquelles une expérience matérielle donnée pourrait être consi-
dérée comme un défi. Le dicton selon lequel la théorie sans la
pratique est stérile, mais la pratique sans la théorie aveugle com-
porte une vérité importante, même si ce n'est qu'une demi-vérité.
Il est certain que la théorie sans praxis ne crée rien, mais cette
dernière doit être aveugle, selon les normes de la théorie, si elle ne
veut pas être réduite à une simple extension de la théorie. Pour être
capable de lancer un véritable défi, la praxis doit conserver son
indépendance vis-à-vis de la théorie. Afin d'établir ce point,
l'idéalisme reconstitue la praxis à partir de l'activité matérialiste
pour en faire la capacité du sujet d'imposer de nouvelles règles.
On trouve dans l'idéalisme dialectique la conviction qu'une fois
ôtée l'assise indépendante de la praxis, la dialectique s'effondre en
une méthode scientifique « bidon », et la véritable praxis en une
praxis banale de type technologique-bureaucratique. Il n'est pas
surprenant que, pour Marx, la science et l'industrie représentent
respectivement la relation théorique et pratique de l'homme avec
la nature. Ce n'est pas non plus à cause de ses « mauvaises fréquen-
tations » que les aspirations premières de Marx concernant un
nouveau matérialisme ou humanisme dialcctiquement conçu, n'ont
jamais porté leurs fruits. Plutôt que de faire retomber le blâme de
cet échec sur le mauvais génie d'Engels, il faudrait voir aussi l'inca-
pacité de Marx de saisir la signification de la dialectique en tant
qu'achèvement idéaliste et les idées de Hegel comme une étape
neuve par rapport à la conception scientifique du monde et non
comme un substitut de cette dernière.
selon les normes du sens commun et de la science, c'est-à-dire
comme activité matérialiste, ne peut mettre la théorie au défi,
parce que c'est la théorie elle-même qui a posé les conditions dans
lesquelles une expérience matérielle donnée pourrait être consi-
dérée comme un défi. Le dicton selon lequel la théorie sans la
pratique est stérile, mais la pratique sans la théorie aveugle com-
porte une vérité importante, même si ce n'est qu'une demi-vérité.
Il est certain que la théorie sans praxis ne crée rien, mais cette
dernière doit être aveugle, selon les normes de la théorie, si elle ne
veut pas être réduite à une simple extension de la théorie. Pour être
capable de lancer un véritable défi, la praxis doit conserver son
indépendance vis-à-vis de la théorie. Afin d'établir ce point,
l'idéalisme reconstitue la praxis à partir de l'activité matérialiste
pour en faire la capacité du sujet d'imposer de nouvelles règles.
On trouve dans l'idéalisme dialectique la conviction qu'une fois
ôtée l'assise indépendante de la praxis, la dialectique s'effondre en
une méthode scientifique « bidon », et la véritable praxis en une
praxis banale de type technologique-bureaucratique. Il n'est pas
surprenant que, pour Marx, la science et l'industrie représentent
respectivement la relation théorique et pratique de l'homme avec
la nature. Ce n'est pas non plus à cause de ses « mauvaises fréquen-
tations » que les aspirations premières de Marx concernant un
nouveau matérialisme ou humanisme dialcctiquement conçu, n'ont
jamais porté leurs fruits. Plutôt que de faire retomber le blâme de
cet échec sur le mauvais génie d'Engels, il faudrait voir aussi l'inca-
pacité de Marx de saisir la signification de la dialectique en tant
qu'achèvement idéaliste et les idées de Hegel comme une étape
neuve par rapport à la conception scientifique du monde et non
comme un substitut de cette dernière.
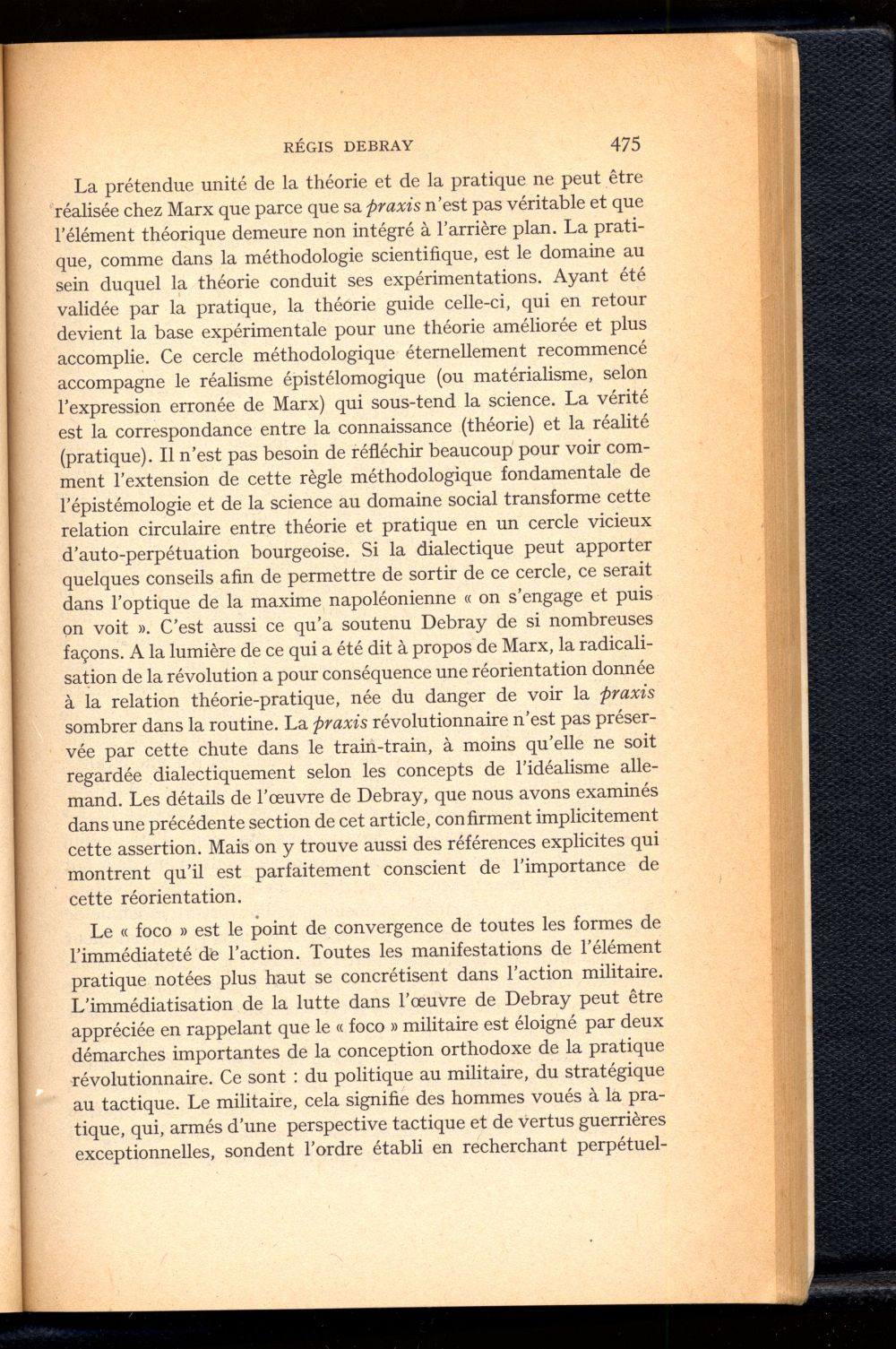

REGIS DEBRAY
475
La prétendue unité de la théorie et de la pratique ne peut être
réalisée chez Marx que parce que sa praxis n'est pas véritable et que
l'élément théorique demeure non intégré à l'arrière plan. La prati-
que, comme dans la méthodologie scientifique, est le domaine au
sein duquel la théorie conduit ses expérimentations. Ayant été
validée par la pratique, la théorie guide celle-ci, qui en retour
devient la base expérimentale pour une théorie améliorée et plus
accomplie. Ce cercle méthodologique éternellement recommencé
accompagne le réalisme épistélomogique (ou matérialisme, selon
l'expression erronée de Marx) qui sous-tend la science. La vérité
est la correspondance entre la connaissance (théorie) et la réalité
(pratique). Il n'est pas besoin de réfléchir beaucoup pour voir com-
ment l'extension de cette règle méthodologique fondamentale de
l'épistémologie et de la science au domaine social transforme cette
relation circulaire entre théorie et pratique en un cercle vicieux
d'auto-perpétuation bourgeoise. Si la dialectique peut apporter
quelques conseils afin de permettre de sortir de ce cercle, ce serait
dans l'optique de la maxime napoléonienne « on s'engage et puis
on voit ». C'est aussi ce qu'a soutenu Debray de si nombreuses
façons. A la lumière de ce qui a été dit à propos de Marx, la radicali-
sation de la révolution a pour conséquence une réorientation donnée
à la relation théorie-pratique, née du danger de voir la praxis
sombrer dans la routine. La praxis révolutionnaire n'est pas préser-
vée par cette chute dans le train-train, à moins qu'elle ne soit
regardée dialectiquement selon les concepts de l'idéalisme alle-
mand. Les détails de l'œuvre de Debray, que nous avons examinés
dans une précédente section de cet article, confirment implicitement
cette assertion. Mais on y trouve aussi des références explicites qui
montrent qu'il est parfaitement conscient de l'importance de
cette réorientation.
réalisée chez Marx que parce que sa praxis n'est pas véritable et que
l'élément théorique demeure non intégré à l'arrière plan. La prati-
que, comme dans la méthodologie scientifique, est le domaine au
sein duquel la théorie conduit ses expérimentations. Ayant été
validée par la pratique, la théorie guide celle-ci, qui en retour
devient la base expérimentale pour une théorie améliorée et plus
accomplie. Ce cercle méthodologique éternellement recommencé
accompagne le réalisme épistélomogique (ou matérialisme, selon
l'expression erronée de Marx) qui sous-tend la science. La vérité
est la correspondance entre la connaissance (théorie) et la réalité
(pratique). Il n'est pas besoin de réfléchir beaucoup pour voir com-
ment l'extension de cette règle méthodologique fondamentale de
l'épistémologie et de la science au domaine social transforme cette
relation circulaire entre théorie et pratique en un cercle vicieux
d'auto-perpétuation bourgeoise. Si la dialectique peut apporter
quelques conseils afin de permettre de sortir de ce cercle, ce serait
dans l'optique de la maxime napoléonienne « on s'engage et puis
on voit ». C'est aussi ce qu'a soutenu Debray de si nombreuses
façons. A la lumière de ce qui a été dit à propos de Marx, la radicali-
sation de la révolution a pour conséquence une réorientation donnée
à la relation théorie-pratique, née du danger de voir la praxis
sombrer dans la routine. La praxis révolutionnaire n'est pas préser-
vée par cette chute dans le train-train, à moins qu'elle ne soit
regardée dialectiquement selon les concepts de l'idéalisme alle-
mand. Les détails de l'œuvre de Debray, que nous avons examinés
dans une précédente section de cet article, confirment implicitement
cette assertion. Mais on y trouve aussi des références explicites qui
montrent qu'il est parfaitement conscient de l'importance de
cette réorientation.
Le « foco » est le point de convergence de toutes les formes de
l'immédiateté de l'action. Toutes les manifestations de l'élément
pratique notées plus haut se concrétisent dans l'action militaire.
L'immédiatisation de la lutte dans l'œuvre de Debray peut être
appréciée en rappelant que le « foco » militaire est éloigné par deux
démarches importantes de la conception orthodoxe de la pratique
révolutionnaire. Ce sont : du politique au militaire, du stratégique
au tactique. Le militaire, cela signifie des hommes voués à la pra-
tique, qui, armés d'une perspective tactique et de vertus guerrières
exceptionnelles, sondent l'ordre établi en recherchant perpétuel-
l'immédiateté de l'action. Toutes les manifestations de l'élément
pratique notées plus haut se concrétisent dans l'action militaire.
L'immédiatisation de la lutte dans l'œuvre de Debray peut être
appréciée en rappelant que le « foco » militaire est éloigné par deux
démarches importantes de la conception orthodoxe de la pratique
révolutionnaire. Ce sont : du politique au militaire, du stratégique
au tactique. Le militaire, cela signifie des hommes voués à la pra-
tique, qui, armés d'une perspective tactique et de vertus guerrières
exceptionnelles, sondent l'ordre établi en recherchant perpétuel-
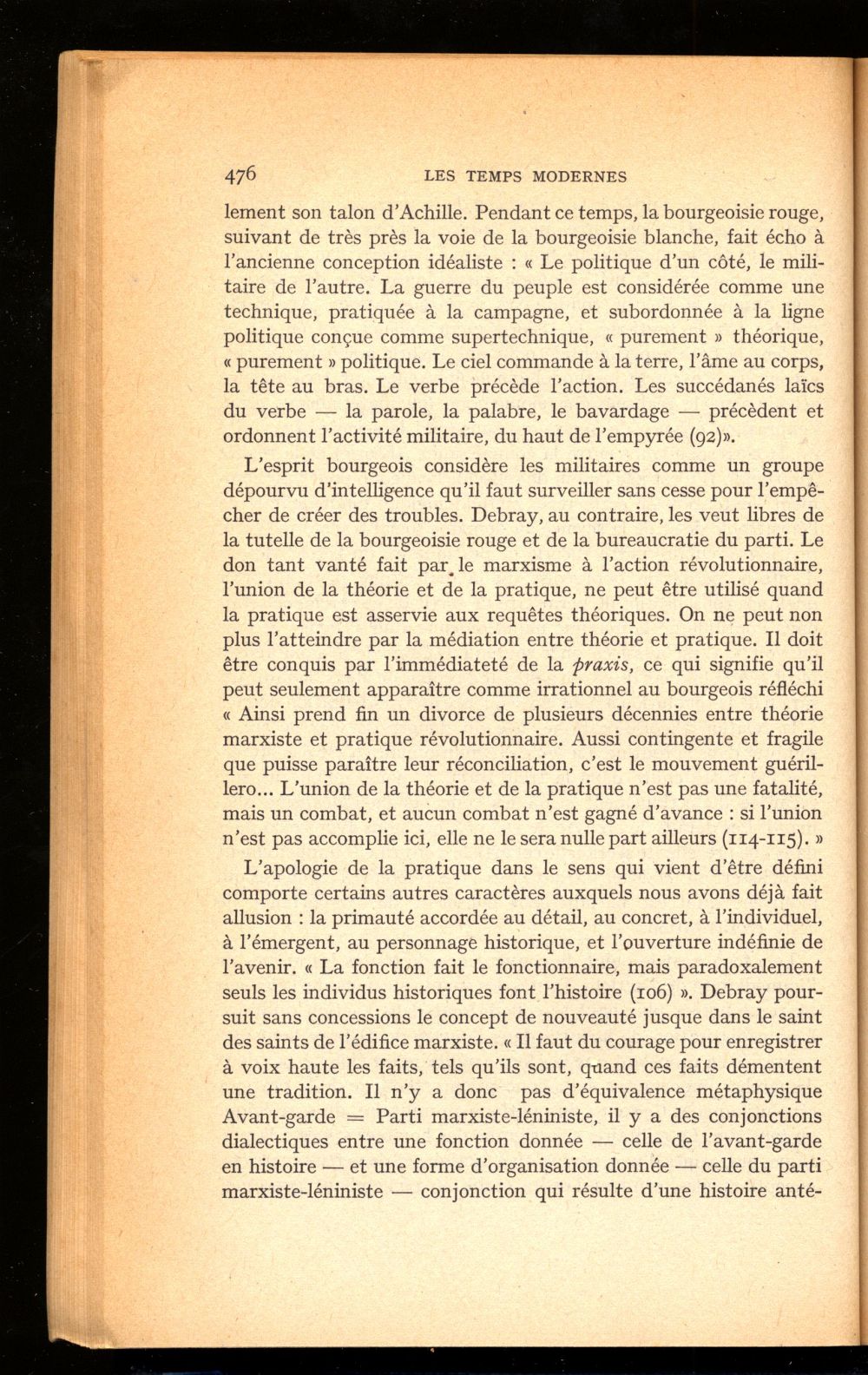

476
LES TEMPS MODERNES
lement son talon d'Achille. Pendant ce temps, la bourgeoisie rouge,
suivant de très près la voie de la bourgeoisie blanche, fait écho à
l'ancienne conception idéaliste : « Le politique d'un côté, le mili-
taire de l'autre. La guerre du peuple est considérée comme une
technique, pratiquée à la campagne, et subordonnée à la ligne
politique conçue comme supertechnique, « purement » théorique,
« purement » politique. Le ciel commande à la terre, l'âme au corps,
la tête au bras. Le verbe précède l'action. Les succédanés laïcs
du verbe — la parole, la palabre, le bavardage — précèdent et
ordonnent l'activité militaire, du haut de l'empyrée (92)».
suivant de très près la voie de la bourgeoisie blanche, fait écho à
l'ancienne conception idéaliste : « Le politique d'un côté, le mili-
taire de l'autre. La guerre du peuple est considérée comme une
technique, pratiquée à la campagne, et subordonnée à la ligne
politique conçue comme supertechnique, « purement » théorique,
« purement » politique. Le ciel commande à la terre, l'âme au corps,
la tête au bras. Le verbe précède l'action. Les succédanés laïcs
du verbe — la parole, la palabre, le bavardage — précèdent et
ordonnent l'activité militaire, du haut de l'empyrée (92)».
L'esprit bourgeois considère les militaires comme un groupe
dépourvu d'intelligence qu'il faut surveiller sans cesse pour l'empê-
cher de créer des troubles. Debray, au contraire, les veut libres de
la tutelle de la bourgeoisie rouge et de la bureaucratie du parti. Le
don tant vanté fait par_ le marxisme à l'action révolutionnaire,
l'union de la théorie et de la pratique, ne peut être utilisé quand
la pratique est asservie aux requêtes théoriques. On ne peut non
plus l'atteindre par la médiation entre théorie et pratique. Il doit
être conquis par l'immédiateté de la praxis, ce qui signifie qu'il
peut seulement apparaître comme irrationnel au bourgeois réfléchi
« Ainsi prend fin un divorce de plusieurs décennies entre théorie
marxiste et pratique révolutionnaire. Aussi contingente et fragile
que puisse paraître leur réconciliation, c'est le mouvement guéril-
lero... L'union de la théorie et de la pratique n'est pas une fatalité,
mais un combat, et aucun combat n'est gagné d'avance : si l'union
n'est pas accomplie ici, elle ne le sera nulle part ailleurs (114-115). »
dépourvu d'intelligence qu'il faut surveiller sans cesse pour l'empê-
cher de créer des troubles. Debray, au contraire, les veut libres de
la tutelle de la bourgeoisie rouge et de la bureaucratie du parti. Le
don tant vanté fait par_ le marxisme à l'action révolutionnaire,
l'union de la théorie et de la pratique, ne peut être utilisé quand
la pratique est asservie aux requêtes théoriques. On ne peut non
plus l'atteindre par la médiation entre théorie et pratique. Il doit
être conquis par l'immédiateté de la praxis, ce qui signifie qu'il
peut seulement apparaître comme irrationnel au bourgeois réfléchi
« Ainsi prend fin un divorce de plusieurs décennies entre théorie
marxiste et pratique révolutionnaire. Aussi contingente et fragile
que puisse paraître leur réconciliation, c'est le mouvement guéril-
lero... L'union de la théorie et de la pratique n'est pas une fatalité,
mais un combat, et aucun combat n'est gagné d'avance : si l'union
n'est pas accomplie ici, elle ne le sera nulle part ailleurs (114-115). »
L'apologie de la pratique dans le sens qui vient d'être défini
comporte certains autres caractères auxquels nous avons déjà fait
allusion : la primauté accordée au détail, au concret, à l'individuel,
à l'émergent, au personnage historique, et l'ouverture indéfinie de
l'avenir. « La fonction fait le fonctionnaire, mais paradoxalement
seuls les individus historiques font l'histoire (106) ». Debray pour-
suit sans concessions le concept de nouveauté jusque dans le saint
des saints de l'édifice marxiste. « II faut du courage pour enregistrer
à voix haute les faits, tels qu'ils sont, quand ces faits démentent
une tradition. Il n'y a donc pas d'équivalence métaphysique
Avant-garde = Parti marxiste-léniniste, il y a des conjonctions
dialectiques entre une fonction donnée — celle de l'avant-garde
en histoire — et une forme d'organisation donnée — celle du parti
marxiste-léniniste — conjonction qui résulte d'une histoire anté-
comporte certains autres caractères auxquels nous avons déjà fait
allusion : la primauté accordée au détail, au concret, à l'individuel,
à l'émergent, au personnage historique, et l'ouverture indéfinie de
l'avenir. « La fonction fait le fonctionnaire, mais paradoxalement
seuls les individus historiques font l'histoire (106) ». Debray pour-
suit sans concessions le concept de nouveauté jusque dans le saint
des saints de l'édifice marxiste. « II faut du courage pour enregistrer
à voix haute les faits, tels qu'ils sont, quand ces faits démentent
une tradition. Il n'y a donc pas d'équivalence métaphysique
Avant-garde = Parti marxiste-léniniste, il y a des conjonctions
dialectiques entre une fonction donnée — celle de l'avant-garde
en histoire — et une forme d'organisation donnée — celle du parti
marxiste-léniniste — conjonction qui résulte d'une histoire anté-
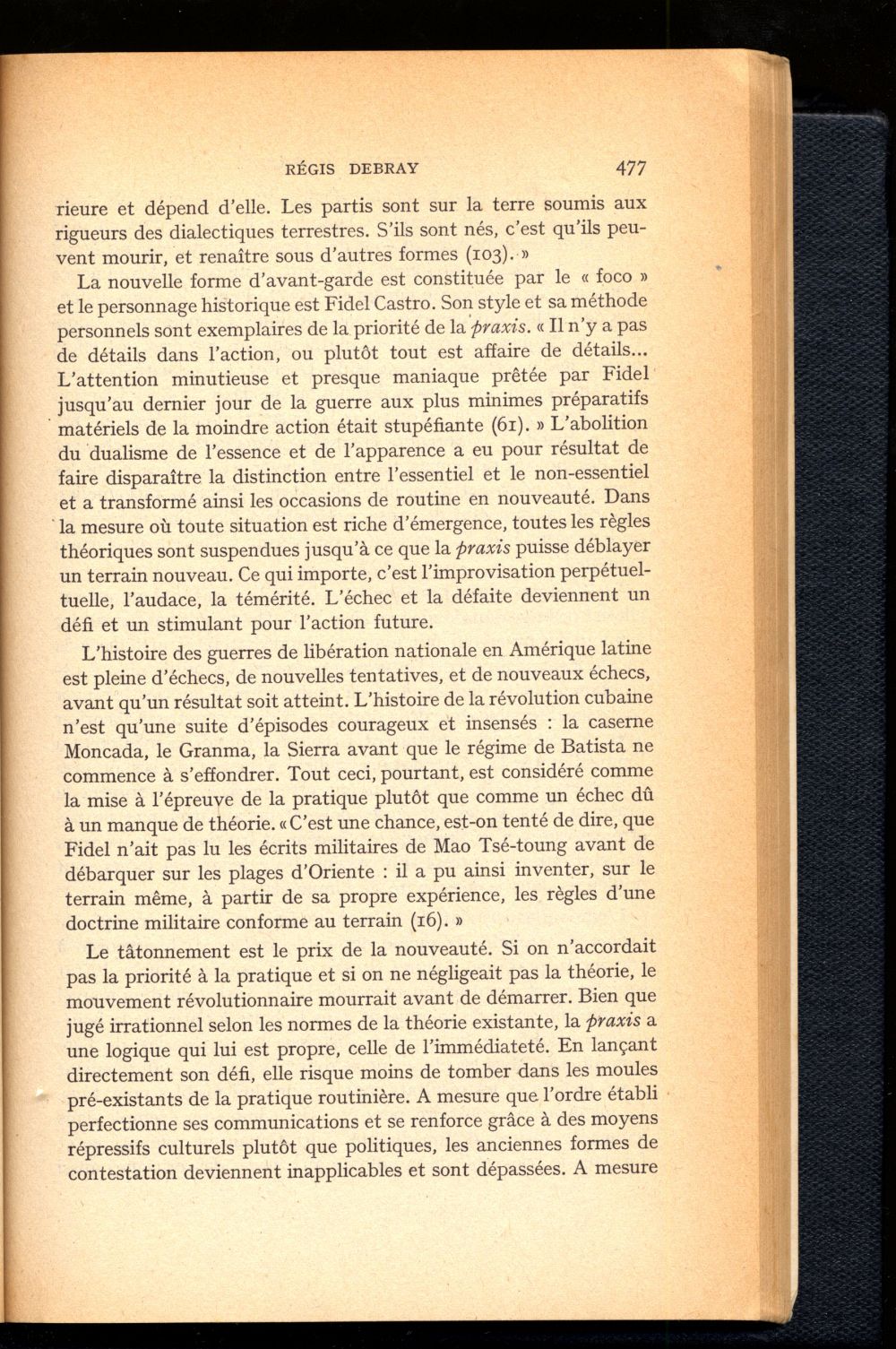

RÉGIS DEBRAY
477
rieure et dépend d'elle. Les partis sont sur la terre soumis aux
rigueurs des dialectiques terrestres. S'ils sont nés, c'est qu'ils peu-
vent mourir, et renaître sous d'autres formes (103). »
rigueurs des dialectiques terrestres. S'ils sont nés, c'est qu'ils peu-
vent mourir, et renaître sous d'autres formes (103). »
La nouvelle forme d'avant-garde est constituée par le « foco »
et le personnage historique est Fidel Castro. Son style et sa méthode
personnels sont exemplaires de la priorité de la praxis. « II n'y a pas
de détails dans l'action, ou plutôt tout est affaire de détails...
L'attention minutieuse et presque maniaque prêtée par Fidel
jusqu'au dernier jour de la guerre aux plus minimes préparatifs
matériels de la moindre action était stupéfiante (61). » L'abolition
du dualisme de l'essence et de l'apparence a eu pour résultat de
faire disparaître la distinction entre l'essentiel et le non-essentiel
et a transformé ainsi les occasions de routine en nouveauté. Dans
la mesure où toute situation est riche d'émergence, toutes les règles
théoriques sont suspendues jusqu'à ce que la praxis puisse déblayer
un terrain nouveau. Ce qui importe, c'est l'improvisation perpétuel-
tuelle, l'audace, la témérité. L'échec et la défaite deviennent un
défi et un stimulant pour l'action future.
et le personnage historique est Fidel Castro. Son style et sa méthode
personnels sont exemplaires de la priorité de la praxis. « II n'y a pas
de détails dans l'action, ou plutôt tout est affaire de détails...
L'attention minutieuse et presque maniaque prêtée par Fidel
jusqu'au dernier jour de la guerre aux plus minimes préparatifs
matériels de la moindre action était stupéfiante (61). » L'abolition
du dualisme de l'essence et de l'apparence a eu pour résultat de
faire disparaître la distinction entre l'essentiel et le non-essentiel
et a transformé ainsi les occasions de routine en nouveauté. Dans
la mesure où toute situation est riche d'émergence, toutes les règles
théoriques sont suspendues jusqu'à ce que la praxis puisse déblayer
un terrain nouveau. Ce qui importe, c'est l'improvisation perpétuel-
tuelle, l'audace, la témérité. L'échec et la défaite deviennent un
défi et un stimulant pour l'action future.
L'histoire des guerres de libération nationale en Amérique latine
est pleine d'échecs, de nouvelles tentatives, et de nouveaux échecs,
avant qu'un résultat soit atteint. L'histoire de la révolution cubaine
n'est qu'une suite d'épisodes courageux et insensés : la caserne
Moncada, le Granma, la Sierra avant que le régime de Batista ne
commence à s'effondrer. Tout ceci, pourtant, est considéré comme
la mise à l'épreuve de la pratique plutôt que comme un échec dû
à un manque de théorie. «C'est une chance, est-on tenté de dire, que
Fidel n'ait pas lu les écrits militaires de Mao Tsé-toung avant de
débarquer sur les plages d'Orienté : il a pu ainsi inventer, sur le
terrain même, à partir de sa propre expérience, les règles d'une
doctrine militaire conforme au terrain (16). »
est pleine d'échecs, de nouvelles tentatives, et de nouveaux échecs,
avant qu'un résultat soit atteint. L'histoire de la révolution cubaine
n'est qu'une suite d'épisodes courageux et insensés : la caserne
Moncada, le Granma, la Sierra avant que le régime de Batista ne
commence à s'effondrer. Tout ceci, pourtant, est considéré comme
la mise à l'épreuve de la pratique plutôt que comme un échec dû
à un manque de théorie. «C'est une chance, est-on tenté de dire, que
Fidel n'ait pas lu les écrits militaires de Mao Tsé-toung avant de
débarquer sur les plages d'Orienté : il a pu ainsi inventer, sur le
terrain même, à partir de sa propre expérience, les règles d'une
doctrine militaire conforme au terrain (16). »
Le tâtonnement est le prix de la nouveauté. Si on n'accordait
pas la priorité à la pratique et si on ne négligeait pas la théorie, le
mouvement révolutionnaire mourrait avant de démarrer. Bien que
jugé irrationnel selon les normes de la théorie existante, la praxis a
une logique qui lui est propre, celle de l'immédiateté. En lançant
directement son défi, elle risque moins de tomber dans les moules
pré-existants de la pratique routinière. A mesure que l'ordre établi
perfectionne ses communications et se renforce grâce à des moyens
répressifs culturels plutôt que politiques, les anciennes formes de
contestation deviennent inapplicables et sont dépassées. A mesure
pas la priorité à la pratique et si on ne négligeait pas la théorie, le
mouvement révolutionnaire mourrait avant de démarrer. Bien que
jugé irrationnel selon les normes de la théorie existante, la praxis a
une logique qui lui est propre, celle de l'immédiateté. En lançant
directement son défi, elle risque moins de tomber dans les moules
pré-existants de la pratique routinière. A mesure que l'ordre établi
perfectionne ses communications et se renforce grâce à des moyens
répressifs culturels plutôt que politiques, les anciennes formes de
contestation deviennent inapplicables et sont dépassées. A mesure
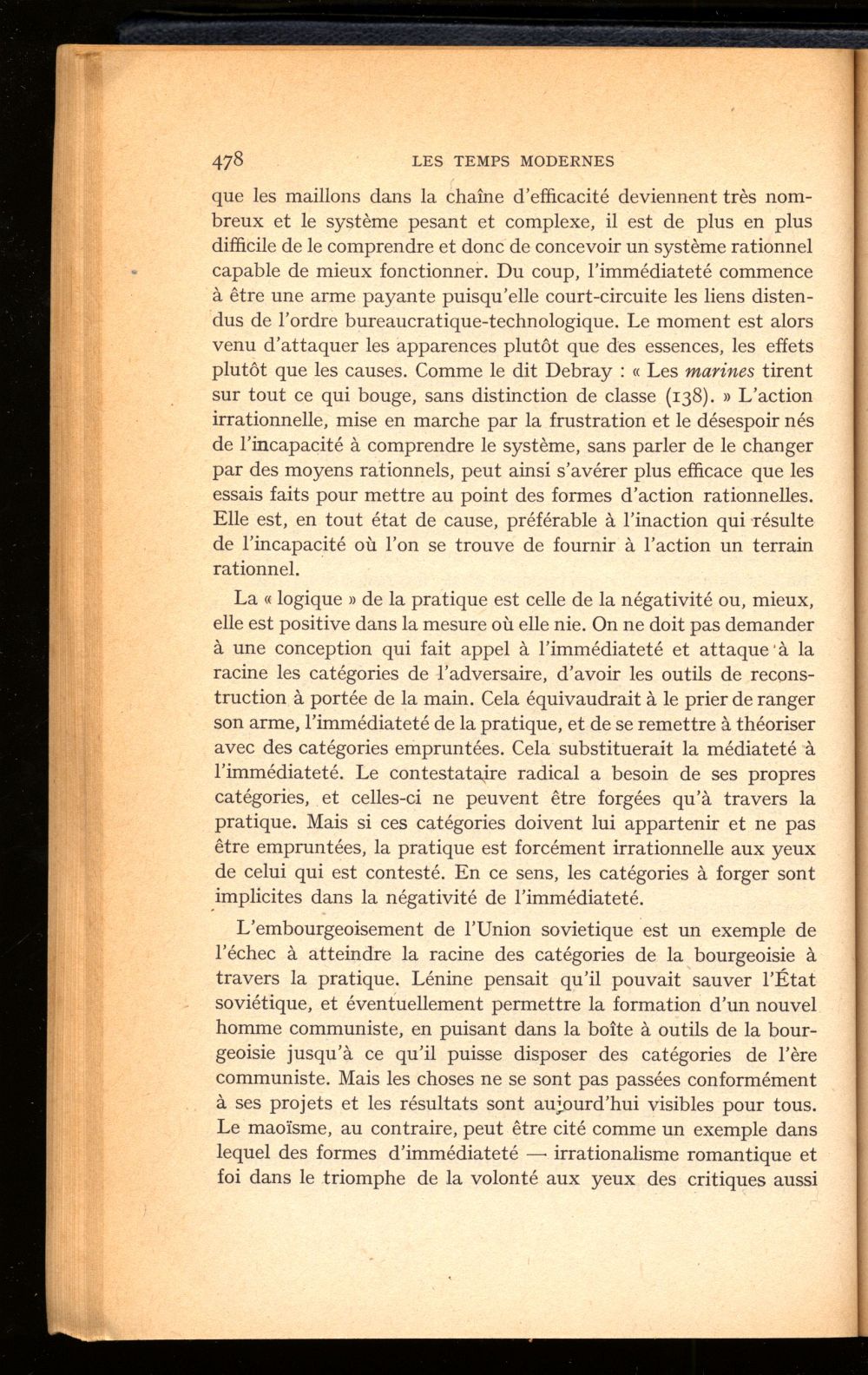

478 LES TEMPS MODERNES
que les maillons dans la chaîne d'efficacité deviennent très nom-
breux et le système pesant et complexe, il est de plus en plus
difficile de le comprendre et donc de concevoir un système rationnel
capable de mieux fonctionner. Du coup, l'immédiateté commence
à être une arme payante puisqu'elle court-circuite les liens disten-
dus de l'ordre bureaucratique-technologique. Le moment est alors
venu d'attaquer les apparences plutôt que des essences, les effets
plutôt que les causes. Comme le dit Debray : « Les marines tirent
sur tout ce qui bouge, sans distinction de classe (138). » L'action
irrationnelle, mise en marche par la frustration et le désespoir nés
de l'incapacité à comprendre le système, sans parler de le changer
par des moyens rationnels, peut ainsi s'avérer plus efficace que les
essais faits pour mettre au point des formes d'action rationnelles.
Elle est, en tout état de cause, préférable à l'inaction qui résulte
de l'incapacité où l'on se trouve de fournir à l'action un terrain
rationnel.
breux et le système pesant et complexe, il est de plus en plus
difficile de le comprendre et donc de concevoir un système rationnel
capable de mieux fonctionner. Du coup, l'immédiateté commence
à être une arme payante puisqu'elle court-circuite les liens disten-
dus de l'ordre bureaucratique-technologique. Le moment est alors
venu d'attaquer les apparences plutôt que des essences, les effets
plutôt que les causes. Comme le dit Debray : « Les marines tirent
sur tout ce qui bouge, sans distinction de classe (138). » L'action
irrationnelle, mise en marche par la frustration et le désespoir nés
de l'incapacité à comprendre le système, sans parler de le changer
par des moyens rationnels, peut ainsi s'avérer plus efficace que les
essais faits pour mettre au point des formes d'action rationnelles.
Elle est, en tout état de cause, préférable à l'inaction qui résulte
de l'incapacité où l'on se trouve de fournir à l'action un terrain
rationnel.
La « logique » de la pratique est celle de la négativité ou, mieux,
elle est positive dans la mesure où elle nie. On ne doit pas demander
à une conception qui fait appel à l'immédiateté et attaque'à la
racine les catégories de l'adversaire, d'avoir les outils de recons-
truction à portée de la main. Cela équivaudrait à le prier de ranger
son arme, l'immédiateté de la pratique, et de se remettre à théoriser
avec des catégories empruntées. Cela substituerait la médiateté à
l'immédiateté. Le contestataire radical a besoin de ses propres
catégories, et celles-ci ne peuvent être forgées qu'à travers la
pratique. Mais si ces catégories doivent lui appartenir et ne pas
être empruntées, la pratique est forcément irrationnelle aux yeux
de celui qui est contesté. En ce sens, les catégories à forger sont
implicites dans la négativité de l'immédiateté.
elle est positive dans la mesure où elle nie. On ne doit pas demander
à une conception qui fait appel à l'immédiateté et attaque'à la
racine les catégories de l'adversaire, d'avoir les outils de recons-
truction à portée de la main. Cela équivaudrait à le prier de ranger
son arme, l'immédiateté de la pratique, et de se remettre à théoriser
avec des catégories empruntées. Cela substituerait la médiateté à
l'immédiateté. Le contestataire radical a besoin de ses propres
catégories, et celles-ci ne peuvent être forgées qu'à travers la
pratique. Mais si ces catégories doivent lui appartenir et ne pas
être empruntées, la pratique est forcément irrationnelle aux yeux
de celui qui est contesté. En ce sens, les catégories à forger sont
implicites dans la négativité de l'immédiateté.
L'embourgeoisement de l'Union soviétique est un exemple de
l'échec à atteindre la racine des catégories de la bourgeoisie à
travers la pratique. Lénine pensait qu'il pouvait sauver l'État
soviétique, et éventuellement permettre la formation d'un nouvel
homme communiste, en puisant dans la boîte à outils de la bour-
geoisie jusqu'à ce qu'il puisse disposer des catégories de l'ère
communiste. Mais les choses ne se sont pas passées conformément
à ses projets et les résultats sont aujourd'hui visibles pour tous.
Le maoïsme, au contraire, peut être cité comme un exemple dans
lequel des formes d'immédiateté —• irrationalisme romantique et
foi dans le triomphe de la volonté aux yeux des critiques aussi
l'échec à atteindre la racine des catégories de la bourgeoisie à
travers la pratique. Lénine pensait qu'il pouvait sauver l'État
soviétique, et éventuellement permettre la formation d'un nouvel
homme communiste, en puisant dans la boîte à outils de la bour-
geoisie jusqu'à ce qu'il puisse disposer des catégories de l'ère
communiste. Mais les choses ne se sont pas passées conformément
à ses projets et les résultats sont aujourd'hui visibles pour tous.
Le maoïsme, au contraire, peut être cité comme un exemple dans
lequel des formes d'immédiateté —• irrationalisme romantique et
foi dans le triomphe de la volonté aux yeux des critiques aussi
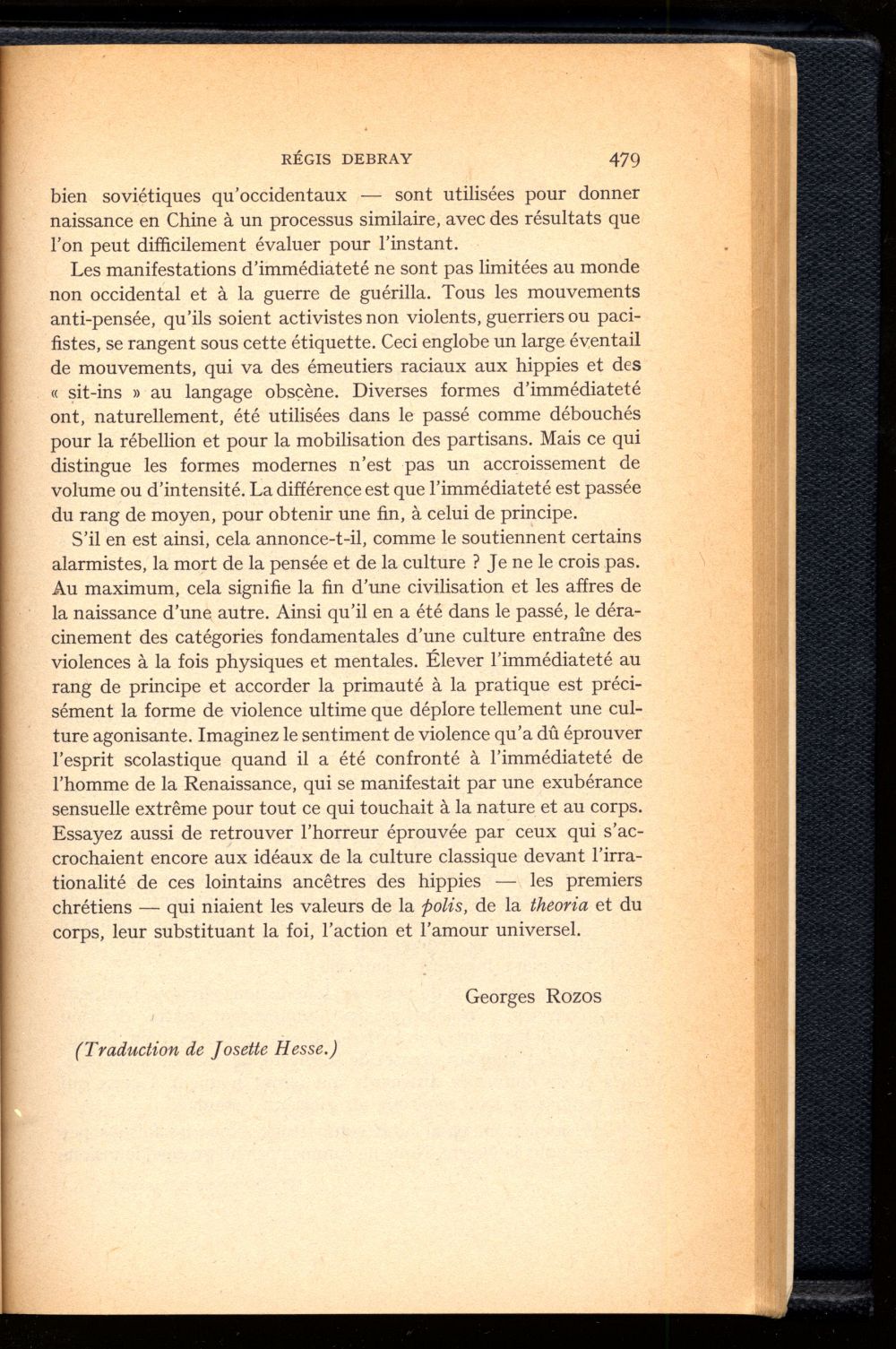

REGIS DEBRAY
479
bien soviétiques qu'occidentaux — sont utilisées pour donner
naissance en Chine à un processus similaire, avec des résultats que
l'on peut difficilement évaluer pour l'instant.
naissance en Chine à un processus similaire, avec des résultats que
l'on peut difficilement évaluer pour l'instant.
Les manifestations d'immédiateté ne sont pas limitées au monde
non occidental et à la guerre de guérilla. Tous les mouvements
anti-pensée, qu'ils soient activistes non violents, guerriers ou paci-
fistes, se rangent sous cette étiquette. Ceci englobe un large éventail
de mouvements, qui va des émeutiers raciaux aux hippies et des
« sit-ins » au langage obscène. Diverses formes d'immédiateté
ont, naturellement, été utilisées dans le passé comme débouchés
pour la rébellion et pour la mobilisation des partisans. Mais ce qui
distingue les formes modernes n'est pas un accroissement de
volume ou d'intensité. La différence est que l'immédiateté est passée
du rang de moyen, pour obtenir une fin, à celui de principe.
non occidental et à la guerre de guérilla. Tous les mouvements
anti-pensée, qu'ils soient activistes non violents, guerriers ou paci-
fistes, se rangent sous cette étiquette. Ceci englobe un large éventail
de mouvements, qui va des émeutiers raciaux aux hippies et des
« sit-ins » au langage obscène. Diverses formes d'immédiateté
ont, naturellement, été utilisées dans le passé comme débouchés
pour la rébellion et pour la mobilisation des partisans. Mais ce qui
distingue les formes modernes n'est pas un accroissement de
volume ou d'intensité. La différence est que l'immédiateté est passée
du rang de moyen, pour obtenir une fin, à celui de principe.
S'il en est ainsi, cela annonce-t-il, comme le soutiennent certains
alarmistes, la mort de la pensée et de la culture ? Je ne le crois pas.
Au maximum, cela signifie la fin d'une civilisation et les affres de
la naissance d'une autre. Ainsi qu'il en a été dans le passé, le déra-
cinement des catégories fondamentales d'une culture entraîne des
violences à la fois physiques et mentales. Élever l'immédiateté au
rang de principe et accorder la primauté à la pratique est préci-
sément la forme de violence ultime que déplore tellement une cul-
ture agonisante. Imaginez le sentiment de violence qu'a dû éprouver
l'esprit scolastique quand il a été confronté à l'immédiateté de
l'homme de la Renaissance, qui se manifestait par une exubérance
sensuelle extrême pour tout ce qui touchait à la nature et au corps.
Essayez aussi de retrouver l'horreur éprouvée par ceux qui s'ac-
crochaient encore aux idéaux de la culture classique devant l'irra-
tionalité de ces lointains ancêtres des hippies — les premiers
chrétiens — qui niaient les valeurs de la polis, de la theoria et du
corps, leur substituant la foi, l'action et l'amour universel.
alarmistes, la mort de la pensée et de la culture ? Je ne le crois pas.
Au maximum, cela signifie la fin d'une civilisation et les affres de
la naissance d'une autre. Ainsi qu'il en a été dans le passé, le déra-
cinement des catégories fondamentales d'une culture entraîne des
violences à la fois physiques et mentales. Élever l'immédiateté au
rang de principe et accorder la primauté à la pratique est préci-
sément la forme de violence ultime que déplore tellement une cul-
ture agonisante. Imaginez le sentiment de violence qu'a dû éprouver
l'esprit scolastique quand il a été confronté à l'immédiateté de
l'homme de la Renaissance, qui se manifestait par une exubérance
sensuelle extrême pour tout ce qui touchait à la nature et au corps.
Essayez aussi de retrouver l'horreur éprouvée par ceux qui s'ac-
crochaient encore aux idéaux de la culture classique devant l'irra-
tionalité de ces lointains ancêtres des hippies — les premiers
chrétiens — qui niaient les valeurs de la polis, de la theoria et du
corps, leur substituant la foi, l'action et l'amour universel.
Georges Rozos
(Traduction de Josette Resse.)
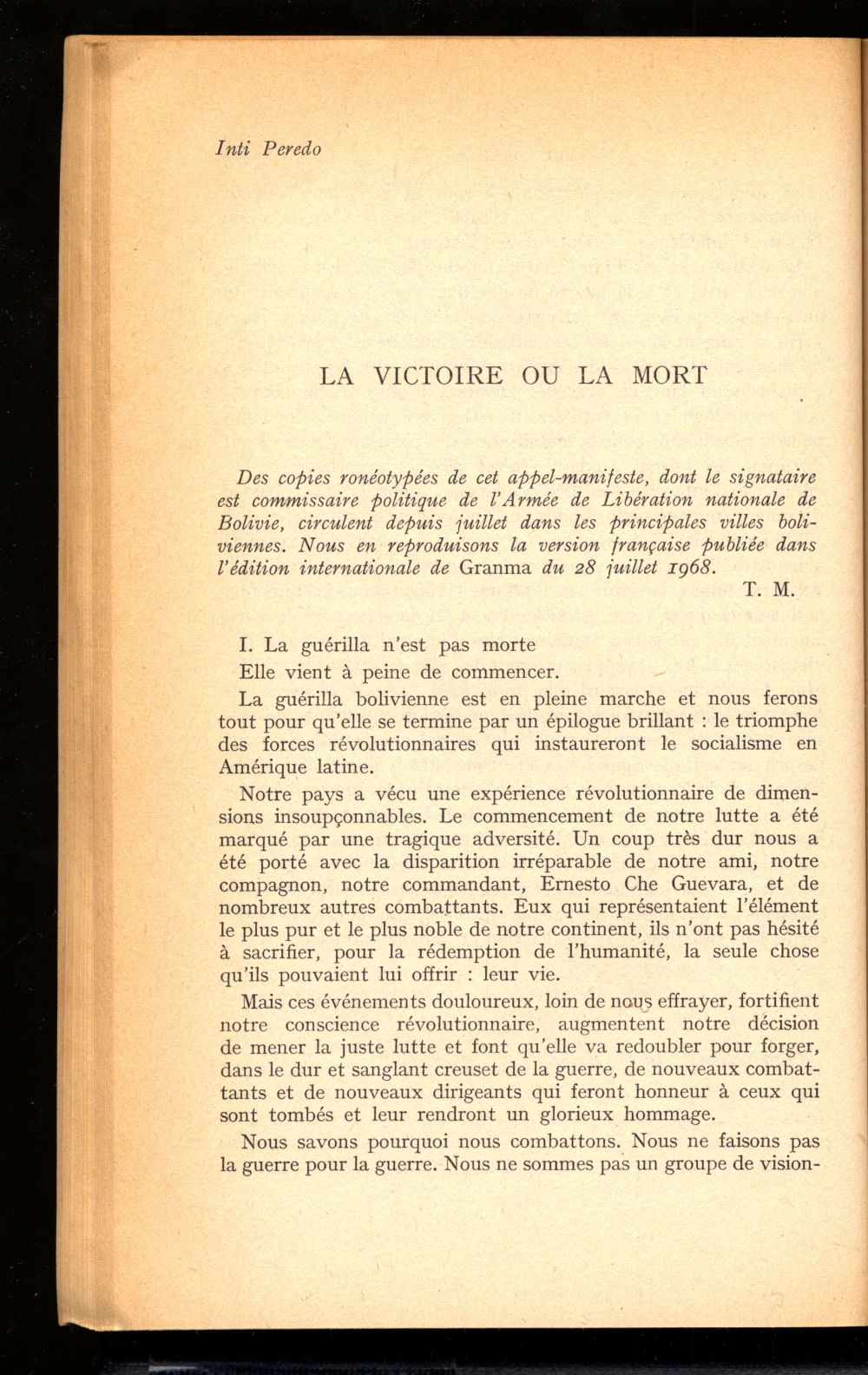

Inti Peredo
LA VICTOIRE OU LA MORT
Des copies ronéotypées de cet appel-manifeste, dont le signataire
est commissaire politique de l'Armée de Libération nationale de
Bolivie, circulent depuis juillet dans les principales villes boli-
viennes. Nous en reproduisons la version française publiée dans
l'édition internationale de Granma du 28 juillet 1968.
est commissaire politique de l'Armée de Libération nationale de
Bolivie, circulent depuis juillet dans les principales villes boli-
viennes. Nous en reproduisons la version française publiée dans
l'édition internationale de Granma du 28 juillet 1968.
T. M.
I. La guérilla n'est pas morte
Elle vient à peine de commencer.
La guérilla bolivienne est en pleine marche et nous ferons
tout pour qu'elle se termine par un épilogue brillant : le triomphe
des forces révolutionnaires qui instaureront le socialisme en
Amérique latine.
tout pour qu'elle se termine par un épilogue brillant : le triomphe
des forces révolutionnaires qui instaureront le socialisme en
Amérique latine.
Notre pays a vécu une expérience révolutionnaire de dimen-
sions insoupçonnables. Le commencement de notre lutte a été
marqué par une tragique adversité. Un coup très dur nous a
été porté avec la disparition irréparable de notre ami, notre
compagnon, notre commandant, Ernesto Che Guevara, et de
nombreux autres combattants. Eux qui représentaient l'élément
le plus pur et le plus noble de notre continent, ils n'ont pas hésité
à sacrifier, pour la rédemption de l'humanité, la seule chose
qu'ils pouvaient lui offrir : leur vie.
sions insoupçonnables. Le commencement de notre lutte a été
marqué par une tragique adversité. Un coup très dur nous a
été porté avec la disparition irréparable de notre ami, notre
compagnon, notre commandant, Ernesto Che Guevara, et de
nombreux autres combattants. Eux qui représentaient l'élément
le plus pur et le plus noble de notre continent, ils n'ont pas hésité
à sacrifier, pour la rédemption de l'humanité, la seule chose
qu'ils pouvaient lui offrir : leur vie.
Mais ces événements douloureux, loin de nous effrayer, fortifient
notre conscience révolutionnaire, augmentent notre décision
de mener la juste lutte et font qu'elle va redoubler pour forger,
dans le dur et sanglant creuset de la guerre, de nouveaux combat-
tants et de nouveaux dirigeants qui feront honneur à ceux qui
sont tombés et leur rendront un glorieux hommage.
notre conscience révolutionnaire, augmentent notre décision
de mener la juste lutte et font qu'elle va redoubler pour forger,
dans le dur et sanglant creuset de la guerre, de nouveaux combat-
tants et de nouveaux dirigeants qui feront honneur à ceux qui
sont tombés et leur rendront un glorieux hommage.
Nous savons pourquoi nous combattons. Nous ne faisons pas
la guerre pour la guerre. Nous ne sommes pas un groupe de vision-
la guerre pour la guerre. Nous ne sommes pas un groupe de vision-
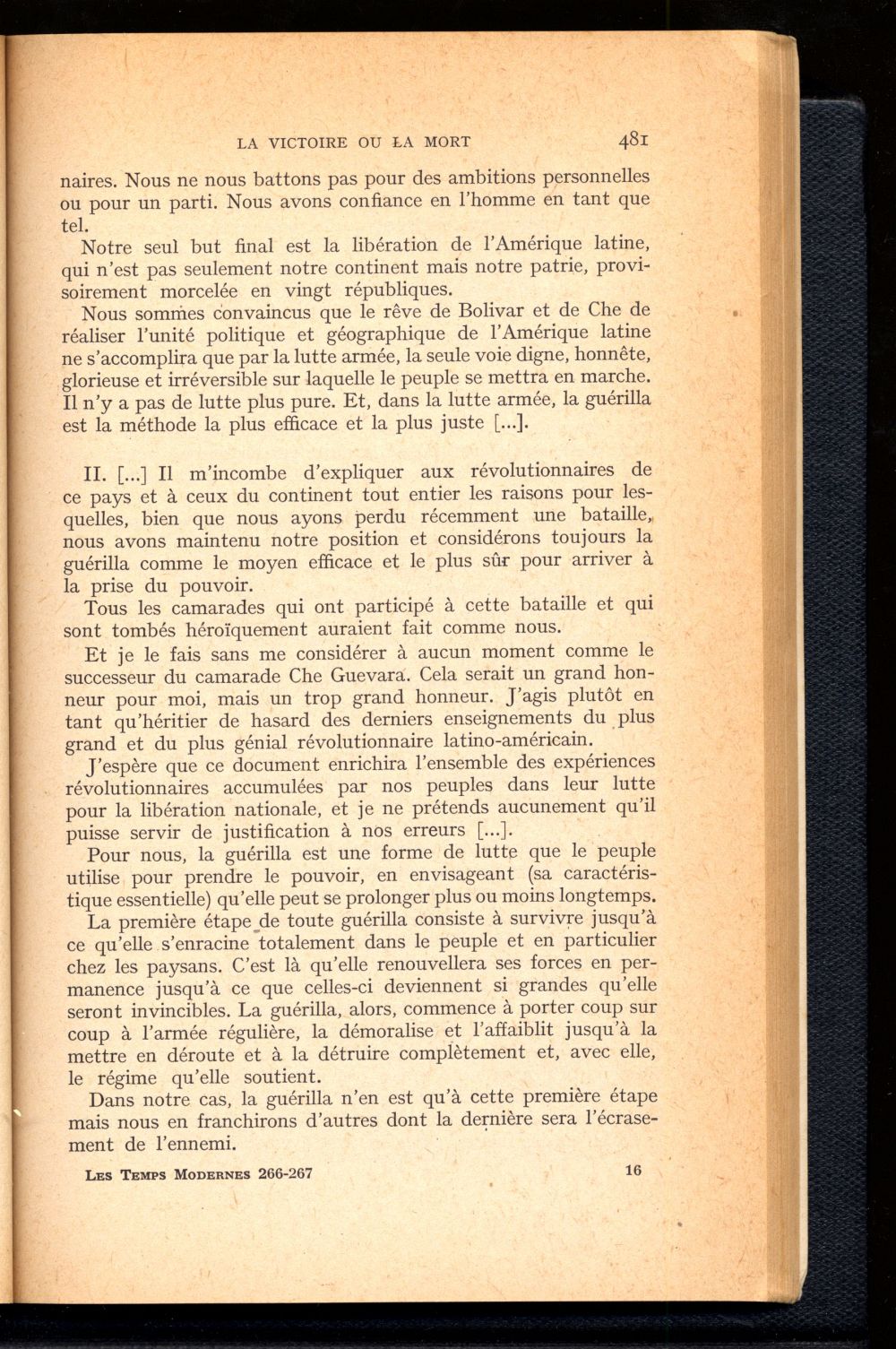

LA VICTOIRE OU LA MORT
481
naires. Nous ne nous battons pas pour des ambitions personnelles
ou pour un parti. Nous avons confiance en l'homme en tant que
tel.
ou pour un parti. Nous avons confiance en l'homme en tant que
tel.
Notre seul but final est la libération de l'Amérique latine,
qui n'est pas seulement notre continent niais notre patrie, provi-
soirement morcelée en vingt républiques.
qui n'est pas seulement notre continent niais notre patrie, provi-
soirement morcelée en vingt républiques.
Nous sommes convaincus que le rêve de Bolivar et de Che de
réaliser l'unité politique et géographique de l'Amérique latine
ne s'accomplira que par la lutte armée, la seule voie digne, honnête,
glorieuse et irréversible sur laquelle le peuple se mettra en marche.
Il n'y a pas de lutte plus pure. Et, dans la lutte armée, la guérilla
est la méthode la plus efficace et la plus juste [...].
réaliser l'unité politique et géographique de l'Amérique latine
ne s'accomplira que par la lutte armée, la seule voie digne, honnête,
glorieuse et irréversible sur laquelle le peuple se mettra en marche.
Il n'y a pas de lutte plus pure. Et, dans la lutte armée, la guérilla
est la méthode la plus efficace et la plus juste [...].
II. [...] Il m'incombe d'expliquer aux révolutionnaires de
ce pays et à ceux du continent tout entier les raisons pour les-
quelles, bien que nous ayons perdu récemment une bataille,
nous avons maintenu notre position et considérons toujours la
guérilla comme le moyen efficace et le plus sûr pour arriver à
la prise du pouvoir.
ce pays et à ceux du continent tout entier les raisons pour les-
quelles, bien que nous ayons perdu récemment une bataille,
nous avons maintenu notre position et considérons toujours la
guérilla comme le moyen efficace et le plus sûr pour arriver à
la prise du pouvoir.
Tous les camarades qui ont participé à cette bataille et qui
sont tombés héroïquement auraient fait comme nous.
sont tombés héroïquement auraient fait comme nous.
Et je le fais sans me considérer à aucun moment comme le
successeur du camarade Che Guevara. Cela serait un grand hon-
neur pour moi, mais un trop grand honneur. J'agis plutôt en
tant qu'héritier de hasard des derniers enseignements du plus
grand et du plus génial révolutionnaire latino-américain.
successeur du camarade Che Guevara. Cela serait un grand hon-
neur pour moi, mais un trop grand honneur. J'agis plutôt en
tant qu'héritier de hasard des derniers enseignements du plus
grand et du plus génial révolutionnaire latino-américain.
J'espère que ce document enrichira l'ensemble des expériences
révolutionnaires accumulées par nos peuples dans leur lutte
pour la libération nationale, et je ne prétends aucunement qu'il
puisse servir de justification à nos erreurs [...].
révolutionnaires accumulées par nos peuples dans leur lutte
pour la libération nationale, et je ne prétends aucunement qu'il
puisse servir de justification à nos erreurs [...].
Pour nous, la guérilla est une forme de lutte que le peuple
utilise pour prendre le pouvoir, en envisageant (sa caractéris-
tique essentielle) qu'elle peut se prolonger plus ou moins longtemps.
utilise pour prendre le pouvoir, en envisageant (sa caractéris-
tique essentielle) qu'elle peut se prolonger plus ou moins longtemps.
La première étape de toute guérilla consiste à survivre jusqu'à
ce qu'elle s'enracine totalement dans le peuple et en particulier
chez les paysans. C'est là qu'elle renouvellera ses forces en per-
manence jusqu'à ce que celles-ci deviennent si grandes qu'elle
seront invincibles. La guérilla, alors, commence à porter coup sur
coup à l'armée régulière, la démoralise et l'affaiblit jusqu'à la
mettre en déroute et à la détruire complètement et, avec elle,
le régime qu'elle soutient.
ce qu'elle s'enracine totalement dans le peuple et en particulier
chez les paysans. C'est là qu'elle renouvellera ses forces en per-
manence jusqu'à ce que celles-ci deviennent si grandes qu'elle
seront invincibles. La guérilla, alors, commence à porter coup sur
coup à l'armée régulière, la démoralise et l'affaiblit jusqu'à la
mettre en déroute et à la détruire complètement et, avec elle,
le régime qu'elle soutient.
Dans notre cas, la guérilla n'en est qu'à cette première étape
mais nous en franchirons d'autres dont la dernière sera l'écrase-
ment de l'ennemi.
mais nous en franchirons d'autres dont la dernière sera l'écrase-
ment de l'ennemi.
LES TEMPS MODERNES 266-267
16
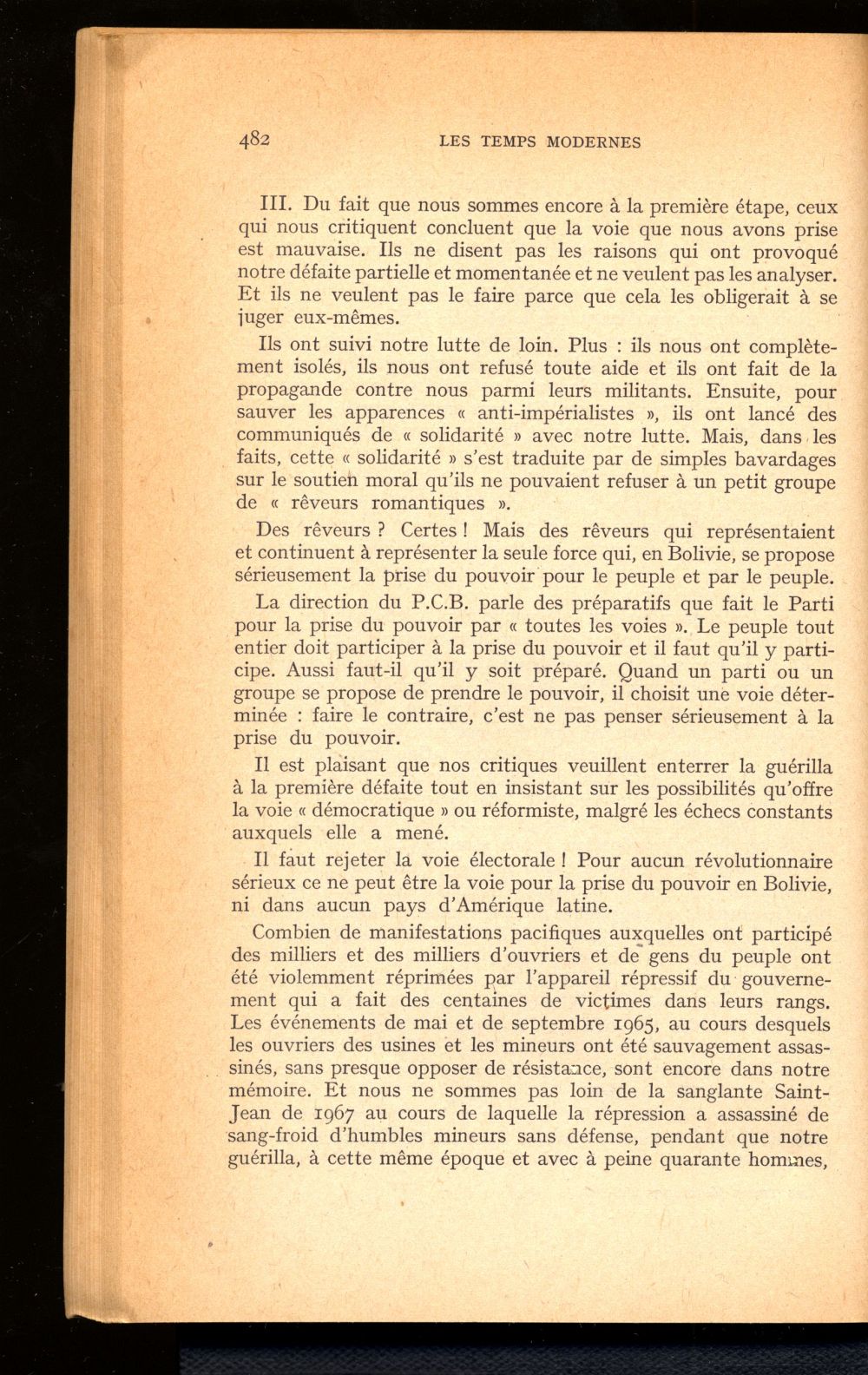

LES TEMPS MODERNES
III. Du fait que nous sommes encore à la première étape, ceux
qui nous critiquent concluent que la voie que nous avons prise
est mauvaise. Ils ne disent pas les raisons qui ont provoqué
notre défaite partielle et momentanée et ne veulent pas les analyser.
Et ils ne veulent pas le faire parce que cela les obligerait à se
juger eux-mêmes.
qui nous critiquent concluent que la voie que nous avons prise
est mauvaise. Ils ne disent pas les raisons qui ont provoqué
notre défaite partielle et momentanée et ne veulent pas les analyser.
Et ils ne veulent pas le faire parce que cela les obligerait à se
juger eux-mêmes.
Ils ont suivi notre lutte de loin. Plus : ils nous ont complète-
ment isolés, ils nous ont refusé toute aide et ils ont fait de la
propagande contre nous parmi leurs militants. Ensuite, pour
sauver les apparences « anti-impérialistes », ils ont lancé des
communiqués de « solidarité » avec notre lutte. Mais, dans les
faits, cette « solidarité » s'est traduite par de simples bavardages
sur le soutien moral qu'ils ne pouvaient refuser à un petit groupe
de « rêveurs romantiques ».
ment isolés, ils nous ont refusé toute aide et ils ont fait de la
propagande contre nous parmi leurs militants. Ensuite, pour
sauver les apparences « anti-impérialistes », ils ont lancé des
communiqués de « solidarité » avec notre lutte. Mais, dans les
faits, cette « solidarité » s'est traduite par de simples bavardages
sur le soutien moral qu'ils ne pouvaient refuser à un petit groupe
de « rêveurs romantiques ».
Des rêveurs ? Certes ! Mais des rêveurs qui représentaient
et continuent à représenter la seule force qui, en Bolivie, se propose
sérieusement la prise du pouvoir pour le peuple et par le peuple.
et continuent à représenter la seule force qui, en Bolivie, se propose
sérieusement la prise du pouvoir pour le peuple et par le peuple.
La direction du P.C.B. parle des préparatifs que fait le Parti
pour la prise du pouvoir par « toutes les voies ». Le peuple tout
entier doit participer à la prise du pouvoir et il faut qu'il y parti-
cipe. Aussi faut-il qu'il y soit préparé. Quand un parti ou un
groupe se propose de prendre le pouvoir, il choisit une voie déter-
minée : faire le contraire, c'est ne pas penser sérieusement à la
prise du pouvoir.
pour la prise du pouvoir par « toutes les voies ». Le peuple tout
entier doit participer à la prise du pouvoir et il faut qu'il y parti-
cipe. Aussi faut-il qu'il y soit préparé. Quand un parti ou un
groupe se propose de prendre le pouvoir, il choisit une voie déter-
minée : faire le contraire, c'est ne pas penser sérieusement à la
prise du pouvoir.
Il est plaisant que nos critiques veuillent enterrer la guérilla
à la première défaite tout en insistant sur les possibilités qu'offre
la voie « démocratique » ou réformiste, malgré les échecs constants
auxquels elle a mené.
à la première défaite tout en insistant sur les possibilités qu'offre
la voie « démocratique » ou réformiste, malgré les échecs constants
auxquels elle a mené.
Il faut rejeter la voie électorale ! Pour aucun révolutionnaire
sérieux ce ne peut être la voie pour la prise du pouvoir en Bolivie,
ni dans aucun pays d'Amérique latine.
sérieux ce ne peut être la voie pour la prise du pouvoir en Bolivie,
ni dans aucun pays d'Amérique latine.
Combien de manifestations pacifiques auxquelles ont participé
des milliers et des milliers d'ouvriers et de gens du peuple ont
été violemment réprimées par l'appareil répressif du gouverne-
ment qui a fait des centaines de victimes dans leurs rangs.
Les événements de mai et de septembre 1965, au cours desquels
les ouvriers des usines et les mineurs ont été sauvagement assas-
sinés, sans presque opposer de résistance, sont encore dans notre
mémoire. Et nous ne sommes pas loin de la sanglante Saint-
Jean de 1967 au cours de laquelle la répression a assassiné de
sang-froid d'humbles mineurs sans défense, pendant que notre
guérilla, à cette même époque et avec à peine quarante hommes,
des milliers et des milliers d'ouvriers et de gens du peuple ont
été violemment réprimées par l'appareil répressif du gouverne-
ment qui a fait des centaines de victimes dans leurs rangs.
Les événements de mai et de septembre 1965, au cours desquels
les ouvriers des usines et les mineurs ont été sauvagement assas-
sinés, sans presque opposer de résistance, sont encore dans notre
mémoire. Et nous ne sommes pas loin de la sanglante Saint-
Jean de 1967 au cours de laquelle la répression a assassiné de
sang-froid d'humbles mineurs sans défense, pendant que notre
guérilla, à cette même époque et avec à peine quarante hommes,
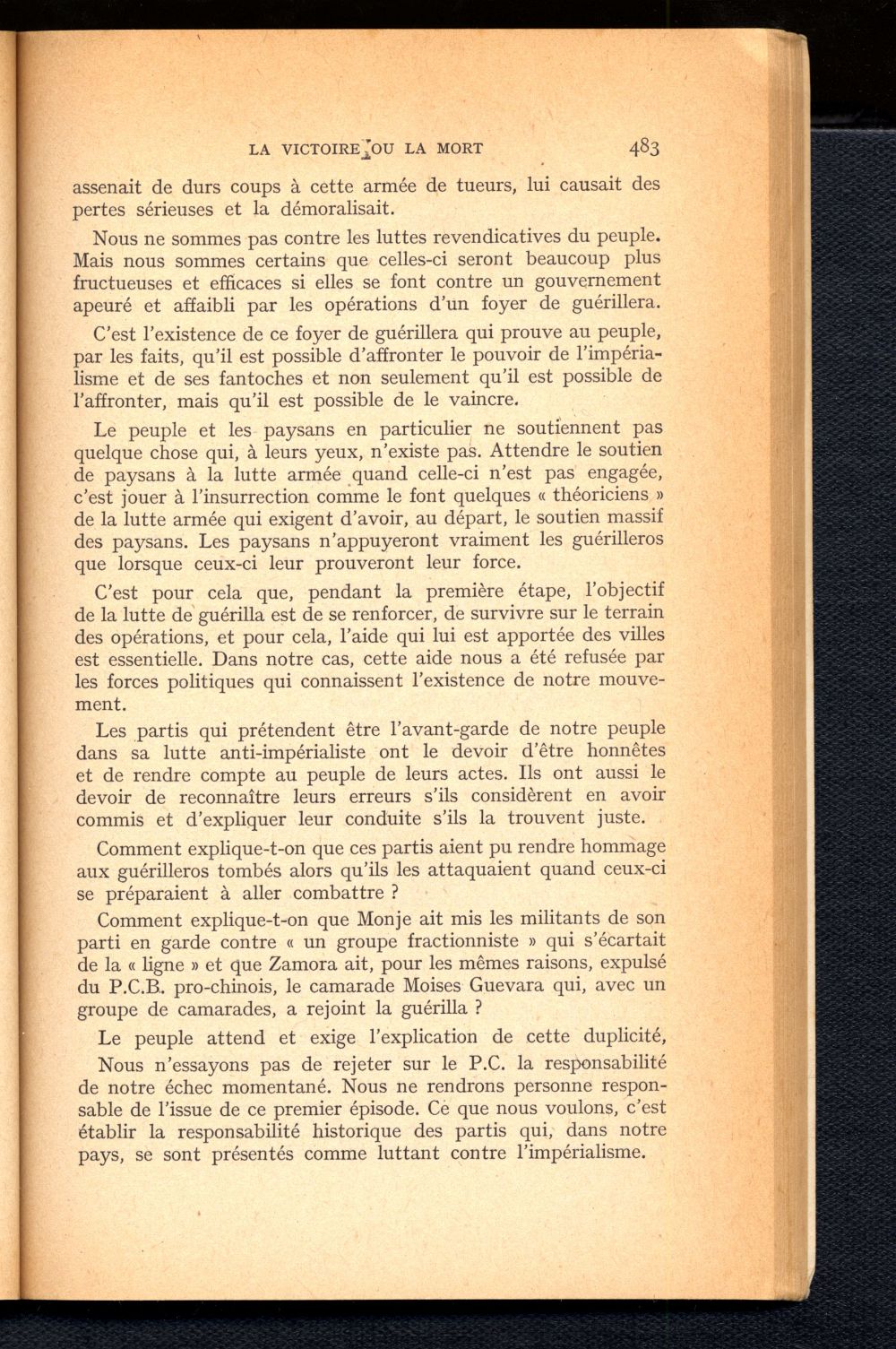

LA VICTOIRE,"OU LA MORT
483
assenait de durs coups à cette armée de tueurs, lui causait des
pertes sérieuses et la démoralisait.
pertes sérieuses et la démoralisait.
Nous ne sommes pas contre les luttes revendicatives du peuple.
Mais nous sommes certains que celles-ci seront beaucoup plus
fructueuses et efficaces si elles se font contre un gouvernement
apeuré et affaibli par les opérations d'un foyer de guérillera.
Mais nous sommes certains que celles-ci seront beaucoup plus
fructueuses et efficaces si elles se font contre un gouvernement
apeuré et affaibli par les opérations d'un foyer de guérillera.
C'est l'existence de ce foyer de guérillera qui prouve au peuple,
par les faits, qu'il est possible d'affronter le pouvoir de l'impéria-
lisme et de ses fantoches et non seulement qu'il est possible de
l'affronter, mais qu'il est possible de le vaincre.
par les faits, qu'il est possible d'affronter le pouvoir de l'impéria-
lisme et de ses fantoches et non seulement qu'il est possible de
l'affronter, mais qu'il est possible de le vaincre.
Le peuple et les paysans en particulier ne soutiennent pas
quelque chose qui, à leurs yeux, n'existe pas. Attendre le soutien
de paysans à la lutte armée quand celle-ci n'est pas engagée,
c'est jouer à l'insurrection comme le font quelques « théoriciens »
de la lutte armée qui exigent d'avoir, au départ, le soutien massif
des paysans. Les paysans n'appuyèrent vraiment les guérilleros
que lorsque ceux-ci leur prouveront leur force.
quelque chose qui, à leurs yeux, n'existe pas. Attendre le soutien
de paysans à la lutte armée quand celle-ci n'est pas engagée,
c'est jouer à l'insurrection comme le font quelques « théoriciens »
de la lutte armée qui exigent d'avoir, au départ, le soutien massif
des paysans. Les paysans n'appuyèrent vraiment les guérilleros
que lorsque ceux-ci leur prouveront leur force.
C'est pour cela que, pendant la première étape, l'objectif
de la lutte de guérilla est de se renforcer, de survivre sur le terrain
des opérations, et pour cela, l'aide qui lui est apportée des villes
est essentielle. Dans notre cas, cette aide nous a été refusée par
les forces politiques qui connaissent l'existence de notre mouve-
ment.
de la lutte de guérilla est de se renforcer, de survivre sur le terrain
des opérations, et pour cela, l'aide qui lui est apportée des villes
est essentielle. Dans notre cas, cette aide nous a été refusée par
les forces politiques qui connaissent l'existence de notre mouve-
ment.
Les partis qui prétendent être l'avant-garde de notre peuple
dans sa lutte anti-impérialiste ont le devoir d'être honnêtes
et de rendre compte au peuple de leurs actes. Ils ont aussi le
devoir de reconnaître leurs erreurs s'ils considèrent en avoir
commis et d'expliquer leur conduite s'ils la trouvent juste.
dans sa lutte anti-impérialiste ont le devoir d'être honnêtes
et de rendre compte au peuple de leurs actes. Ils ont aussi le
devoir de reconnaître leurs erreurs s'ils considèrent en avoir
commis et d'expliquer leur conduite s'ils la trouvent juste.
Comment explique-t-on que ces partis aient pu rendre hommage
aux guérilleros tombés alors qu'ils les attaquaient quand ceux-ci
se préparaient à aller combattre ?
aux guérilleros tombés alors qu'ils les attaquaient quand ceux-ci
se préparaient à aller combattre ?
Comment explique-t-on que Mon je ait mis les militants de son
parti en garde contre « un groupe fractionniste » qui s'écartait
de la « ligne » et que Zamora ait, pour les mêmes raisons, expulsé
du P.C.B. pro-chinois, le camarade Moises Guevara qui, avec un
groupe de camarades, a rejoint la guérilla ?
parti en garde contre « un groupe fractionniste » qui s'écartait
de la « ligne » et que Zamora ait, pour les mêmes raisons, expulsé
du P.C.B. pro-chinois, le camarade Moises Guevara qui, avec un
groupe de camarades, a rejoint la guérilla ?
Le peuple attend et exige l'explication de cette duplicité,
Nous n'essayons pas de rejeter sur le P.C. la responsabilité
de notre échec momentané. Nous ne rendrons personne respon-
sable de l'issue de ce premier épisode. Ce que nous voulons, c'est
établir la responsabilité historique des partis qui, dans notre
pays, se sont présentés comme luttant contre l'impérialisme.
Nous n'essayons pas de rejeter sur le P.C. la responsabilité
de notre échec momentané. Nous ne rendrons personne respon-
sable de l'issue de ce premier épisode. Ce que nous voulons, c'est
établir la responsabilité historique des partis qui, dans notre
pays, se sont présentés comme luttant contre l'impérialisme.
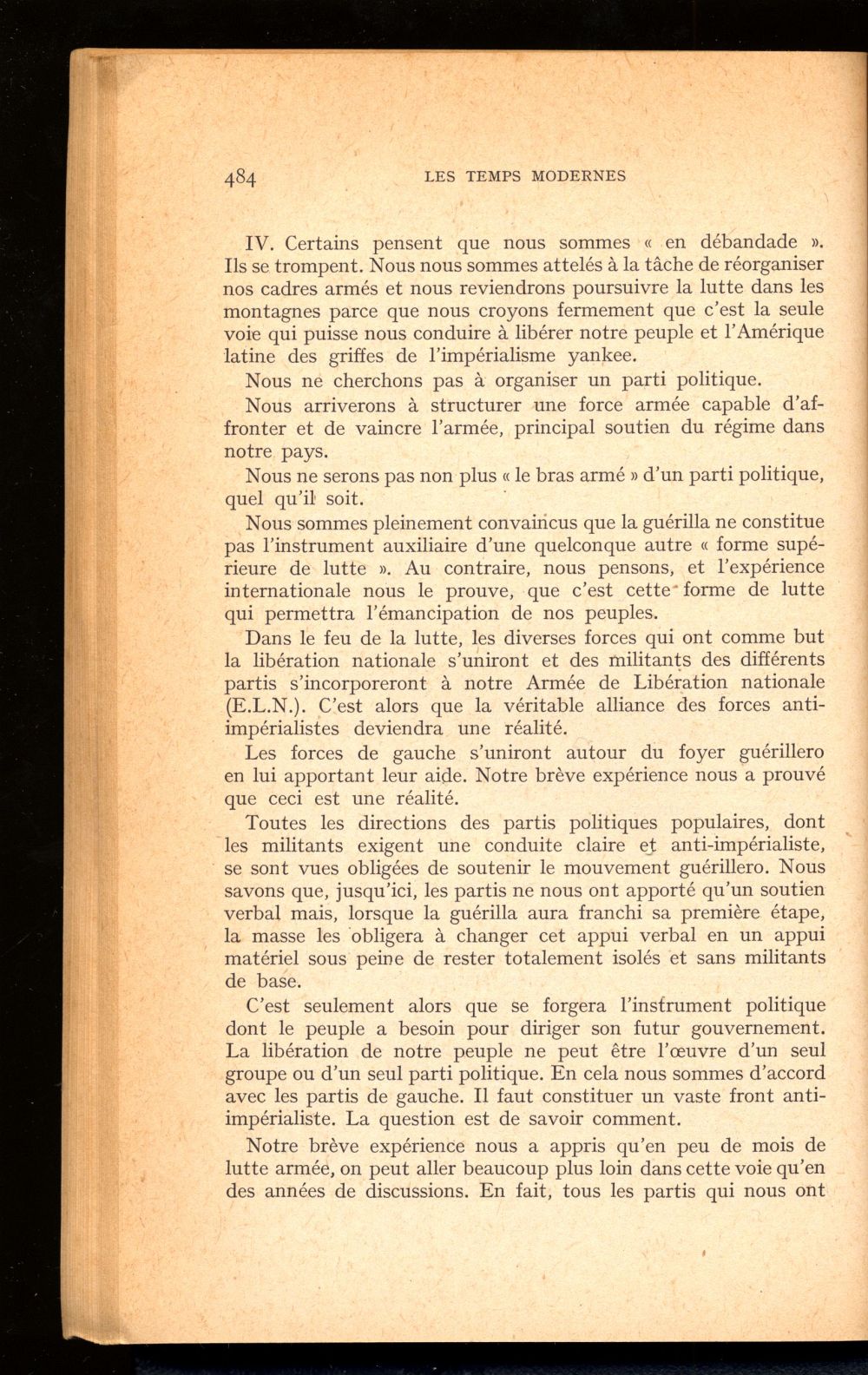

484
LES TEMPS MODERNES
IV. Certains pensent que nous sommes « en débandade ».
Ils se trompent. Nous nous sommes attelés à la tâche de réorganiser
nos cadres armés et nous reviendrons poursuivre la lutte dans les
montagnes parce que nous croyons fermement que c'est la seule
voie qui puisse nous conduire à libérer notre peuple et l'Amérique
latine des griffes de l'impérialisme yankcc.
Ils se trompent. Nous nous sommes attelés à la tâche de réorganiser
nos cadres armés et nous reviendrons poursuivre la lutte dans les
montagnes parce que nous croyons fermement que c'est la seule
voie qui puisse nous conduire à libérer notre peuple et l'Amérique
latine des griffes de l'impérialisme yankcc.
Nous ne cherchons pas à organiser un parti politique.
Nous arriverons à structurer une force armée capable d'af-
fronter et de vaincre l'armée, principal soutien du régime dans
notre pays.
fronter et de vaincre l'armée, principal soutien du régime dans
notre pays.
Nous ne serons pas non plus « le bras armé » d'un parti politique,
quel qu'il soit.
quel qu'il soit.
Nous sommes pleinement convaincus que la guérilla ne constitue
pas l'instrument auxiliaire d'une quelconque autre « forme supé-
rieure de lutte ». Au contraire, nous pensons, et l'expérience
internationale nous le prouve, que c'est cette forme de lutte
qui permettra l'émancipation de nos peuples.
pas l'instrument auxiliaire d'une quelconque autre « forme supé-
rieure de lutte ». Au contraire, nous pensons, et l'expérience
internationale nous le prouve, que c'est cette forme de lutte
qui permettra l'émancipation de nos peuples.
Dans le feu de la lutte, les diverses forces qui ont comme but
la libération nationale s'uniront et des militants des différents
partis s'incorporeront à notre Armée de Libération nationale
(E.L.N.). C'est alors que la véritable alliance des forces anti-
impérialistes deviendra une réalité.
la libération nationale s'uniront et des militants des différents
partis s'incorporeront à notre Armée de Libération nationale
(E.L.N.). C'est alors que la véritable alliance des forces anti-
impérialistes deviendra une réalité.
Les forces de gauche s'uniront autour du foyer guérillero
en lui apportant leur aide. Notre brève expérience nous a prouvé
que ceci est une réalité.
en lui apportant leur aide. Notre brève expérience nous a prouvé
que ceci est une réalité.
Toutes les directions des partis politiques populaires, dont
les militants exigent une conduite claire et anti-impérialiste,
se sont vues obligées de soutenir le mouvement guérillero. Nous
savons que, jusqu'ici, les partis ne nous ont apporté qu'un soutien
verbal mais, lorsque la guérilla aura franchi sa première étape,
la masse les obligera à changer cet appui verbal en un appui
matériel sous peine de rester totalement isolés et sans militants
de base.
les militants exigent une conduite claire et anti-impérialiste,
se sont vues obligées de soutenir le mouvement guérillero. Nous
savons que, jusqu'ici, les partis ne nous ont apporté qu'un soutien
verbal mais, lorsque la guérilla aura franchi sa première étape,
la masse les obligera à changer cet appui verbal en un appui
matériel sous peine de rester totalement isolés et sans militants
de base.
C'est seulement alors que se forgera l'instrument politique
dont le peuple a besoin pour diriger son futur gouvernement.
La libération de notre peuple ne peut être l'œuvre d'un seul
groupe ou d'un seul parti politique. En cela nous sommes d'accord
avec les partis de gauche. Il faut constituer un vaste front anti-
impérialiste. La question est de savoir comment.
dont le peuple a besoin pour diriger son futur gouvernement.
La libération de notre peuple ne peut être l'œuvre d'un seul
groupe ou d'un seul parti politique. En cela nous sommes d'accord
avec les partis de gauche. Il faut constituer un vaste front anti-
impérialiste. La question est de savoir comment.
Notre brève expérience nous a appris qu'en peu de mois de
lutte armée, on peut aller beaucoup plus loin dans cette voie qu'en
des années de discussions. En fait, tous les partis qui nous ont
lutte armée, on peut aller beaucoup plus loin dans cette voie qu'en
des années de discussions. En fait, tous les partis qui nous ont
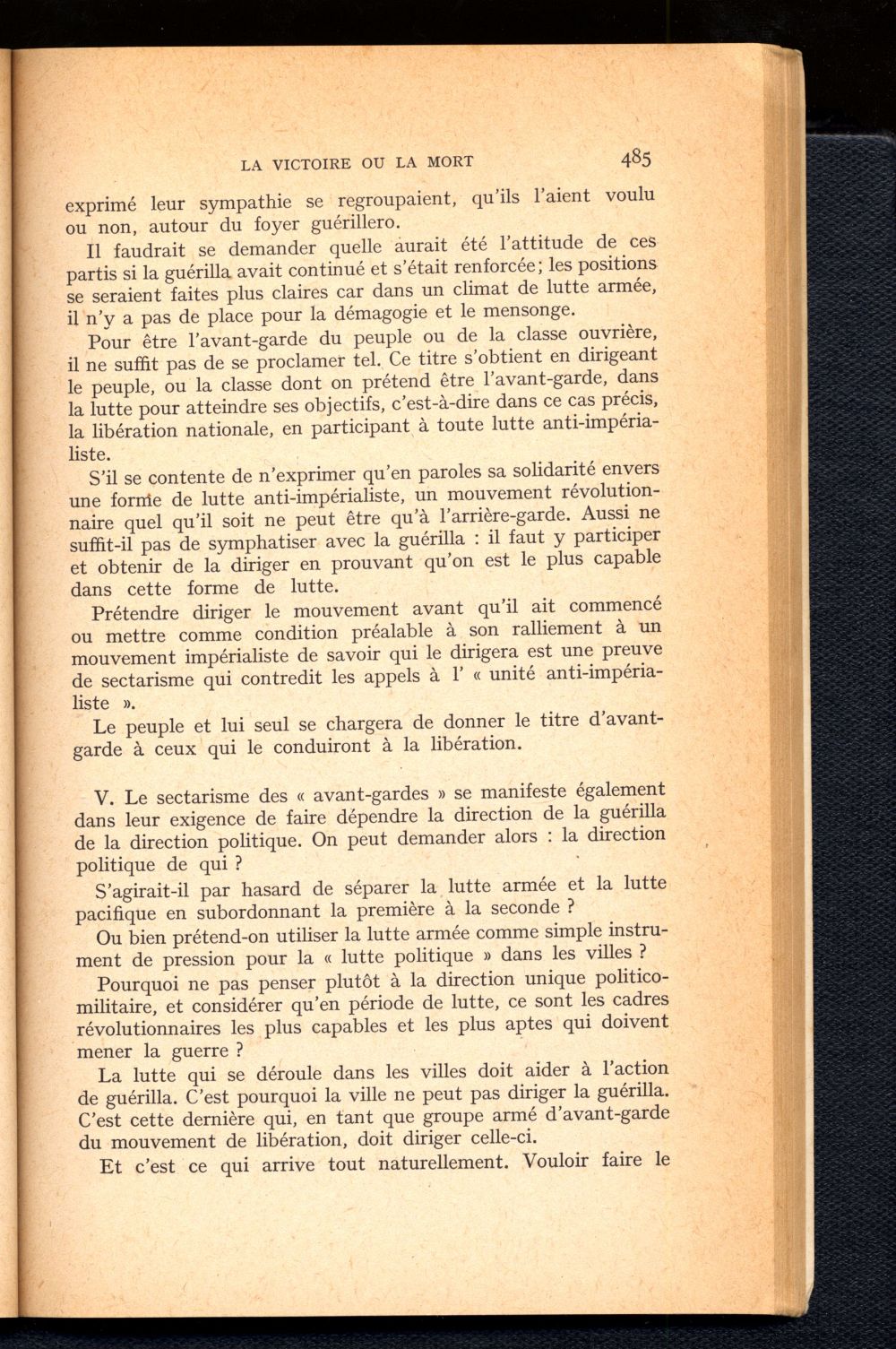

LA VICTOIRE OU LA MORT
485
exprimé leur sympathie se regroupaient, qu'ils l'aient voulu
ou non, autour du foyer guérillero.
ou non, autour du foyer guérillero.
Il faudrait se demander quelle aurait été l'attitude de ces
partis si la guérilla avait continué et s'était renforcée; les positions
se seraient faites plus claires car dans un climat de lutte armée,
il n'y a pas de place pour la démagogie et le mensonge.
partis si la guérilla avait continué et s'était renforcée; les positions
se seraient faites plus claires car dans un climat de lutte armée,
il n'y a pas de place pour la démagogie et le mensonge.
Pour être l'avant-garde du peuple ou de la classe ouvrière,
il ne suffit pas de se proclamer tel. Ce titre s'obtient en dirigeant
le peuple, ou la classe dont on prétend être l'avant-garde, dans
la lutte pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire dans ce cas précis,
la libération nationale, en participant à toute lutte anti-impéria-
liste.
il ne suffit pas de se proclamer tel. Ce titre s'obtient en dirigeant
le peuple, ou la classe dont on prétend être l'avant-garde, dans
la lutte pour atteindre ses objectifs, c'est-à-dire dans ce cas précis,
la libération nationale, en participant à toute lutte anti-impéria-
liste.
S'il se contente de n'exprimer qu'en paroles sa solidarité envers
une forme de lutte anti-impérialiste, un mouvement révolution-
naire quel qu'il soit ne peut être qu'à l'arrière-garde. Aussi ne
suffit-il pas de symphatiser avec la guérilla : il faut y participer
et obtenir de la diriger en prouvant qu'on est le plus capable
dans cette forme de lutte.
une forme de lutte anti-impérialiste, un mouvement révolution-
naire quel qu'il soit ne peut être qu'à l'arrière-garde. Aussi ne
suffit-il pas de symphatiser avec la guérilla : il faut y participer
et obtenir de la diriger en prouvant qu'on est le plus capable
dans cette forme de lutte.
Prétendre diriger le mouvement avant qu'il ait commencé
ou mettre comme condition préalable à son ralliement à un
mouvement impérialiste de savoir qui le dirigera est une preuve
de sectarisme qui contredit les appels à 1' « unité anti-impéria-
liste ».
ou mettre comme condition préalable à son ralliement à un
mouvement impérialiste de savoir qui le dirigera est une preuve
de sectarisme qui contredit les appels à 1' « unité anti-impéria-
liste ».
Le peuple et lui seul se chargera de donner le titre d'avant-
garde à ceux qui le conduiront à la libération.
garde à ceux qui le conduiront à la libération.
V. Le sectarisme des « avant-gardes » se manifeste également
dans leur exigence de faire dépendre la direction de la guérilla
de la direction politique. On peut demander alors : la direction
politique de qui ?
dans leur exigence de faire dépendre la direction de la guérilla
de la direction politique. On peut demander alors : la direction
politique de qui ?
S'agirait-il par hasard de séparer la lutte armée et la lutte
pacifique en subordonnant la première à la seconde ?
pacifique en subordonnant la première à la seconde ?
Ou bien prétend-on utiliser la lutte armée comme simple instru-
ment de pression pour la « lutte politique » dans les villes ?
ment de pression pour la « lutte politique » dans les villes ?
Pourquoi ne pas penser plutôt à la direction unique politico-
militaire, et considérer qu'en période de lutte, ce sont les cadres
révolutionnaires les plus capables et les plus aptes qui doivent
mener la guerre ?
militaire, et considérer qu'en période de lutte, ce sont les cadres
révolutionnaires les plus capables et les plus aptes qui doivent
mener la guerre ?
La lutte qui se déroule dans les villes doit aider à l'action
de guérilla. C'est pourquoi la ville ne peut pas diriger la guérilla.
C'est cette dernière qui, en tant que groupe armé d'avant-garde
du mouvement de libération, doit diriger celle-ci.
de guérilla. C'est pourquoi la ville ne peut pas diriger la guérilla.
C'est cette dernière qui, en tant que groupe armé d'avant-garde
du mouvement de libération, doit diriger celle-ci.
Et c'est ce qui arrive tout naturellement. Vouloir faire le
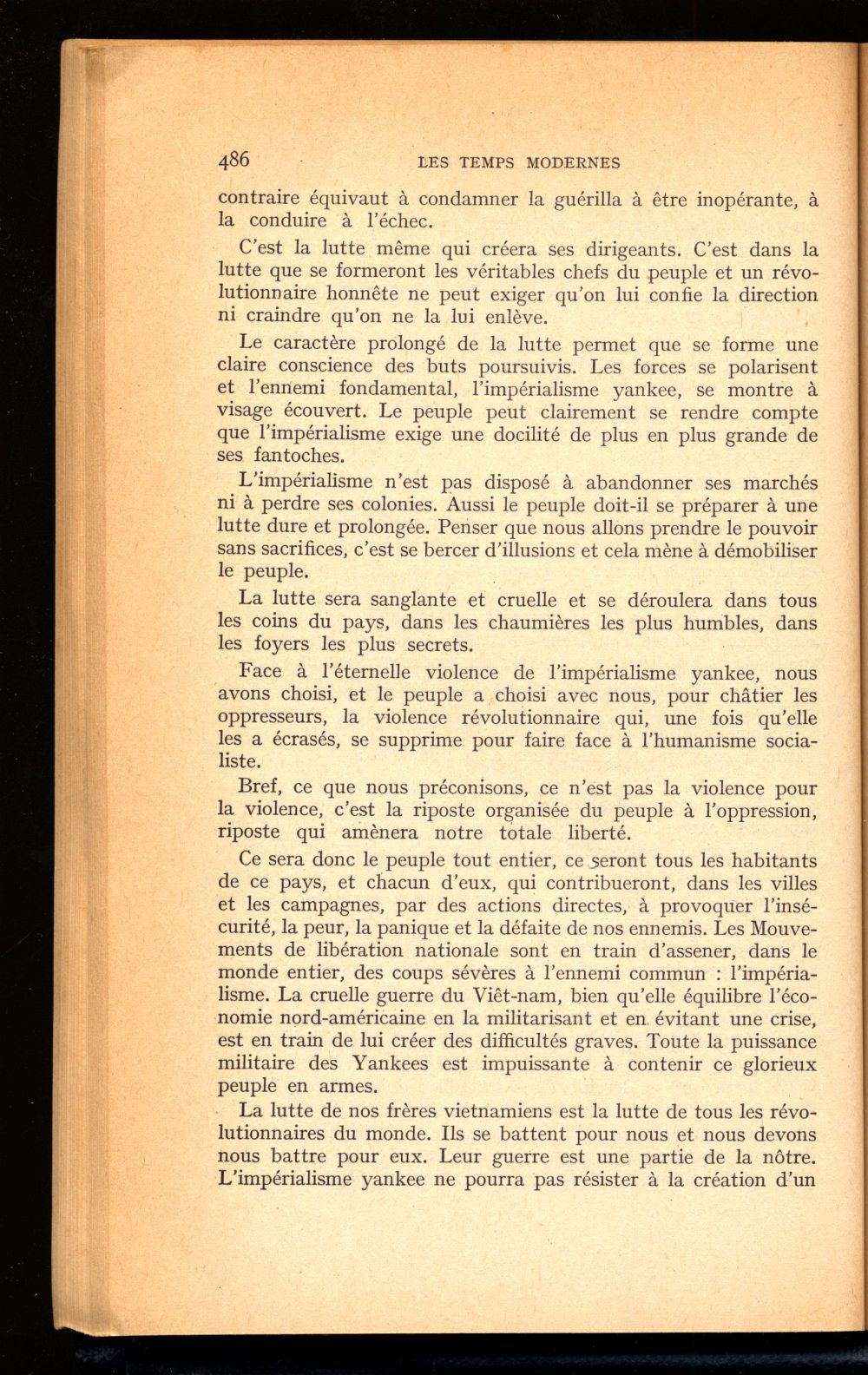

486
LES TEMPS MODERNES
contraire équivaut à condamner la guérilla à être inopérante, à
la conduire à l'échec.
la conduire à l'échec.
C'est la lutte même qui créera ses dirigeants. C'est dans la
lutte que se formeront les véritables chefs du peuple et un révo-
lutionnaire honnête ne peut exiger qu'on lui confie la direction
ni craindre qu'on ne la lui enlève.
lutte que se formeront les véritables chefs du peuple et un révo-
lutionnaire honnête ne peut exiger qu'on lui confie la direction
ni craindre qu'on ne la lui enlève.
Le caractère prolongé de la lutte permet que se forme une
claire conscience des buts poursuivis. Les forces se polarisent
et l'ennemi fondamental, l'impérialisme yankee, se montre à
visage écouvert. Le peuple peut clairement se rendre compte
que l'impérialisme exige une docilité de plus en plus grande de
ses fantoches.
claire conscience des buts poursuivis. Les forces se polarisent
et l'ennemi fondamental, l'impérialisme yankee, se montre à
visage écouvert. Le peuple peut clairement se rendre compte
que l'impérialisme exige une docilité de plus en plus grande de
ses fantoches.
L'impérialisme n'est pas disposé à abandonner ses marchés
ni à perdre ses colonies. Aussi le peuple doit-il se préparer à une
lutte dure et prolongée. Penser que nous allons prendre le pouvoir
sans sacrifices, c'est se bercer d'illusions et cela mène à démobiliser
le peuple.
ni à perdre ses colonies. Aussi le peuple doit-il se préparer à une
lutte dure et prolongée. Penser que nous allons prendre le pouvoir
sans sacrifices, c'est se bercer d'illusions et cela mène à démobiliser
le peuple.
La lutte sera sanglante et cruelle et se déroulera dans tous
les coins du pays, dans les chaumières les plus humbles, dans
les foyers les plus secrets.
les coins du pays, dans les chaumières les plus humbles, dans
les foyers les plus secrets.
Face à l'éternelle violence de l'impérialisme yankee, nous
avons choisi, et le peuple a choisi avec nous, pour châtier les
oppresseurs, la violence révolutionnaire qui, une fois qu'elle
les a écrasés, se supprime pour faire face à l'humanisme socia-
liste.
avons choisi, et le peuple a choisi avec nous, pour châtier les
oppresseurs, la violence révolutionnaire qui, une fois qu'elle
les a écrasés, se supprime pour faire face à l'humanisme socia-
liste.
Bref, ce que nous préconisons, ce n'est pas la violence pour
la violence, c'est la riposte organisée du peuple à l'oppression,
riposte qui amènera notre totale liberté.
la violence, c'est la riposte organisée du peuple à l'oppression,
riposte qui amènera notre totale liberté.
Ce sera donc le peuple tout entier, ce seront tous les habitants
de ce pays, et chacun d'eux, qui contribueront, dans les villes
et les campagnes, par des actions directes, à provoquer l'insé-
curité, la peur, la panique et la défaite de nos ennemis. Les Mouve-
ments de libération nationale sont en train d'assener, dans le
monde entier, des coups sévères à l'ennemi commun : l'impéria-
lisme. La cruelle guerre du Viêt-nam, bien qu'elle équilibre l'éco-
nomie nord-américaine en la militarisant et en évitant une crise,
est en train de lui créer des difficultés graves. Toute la puissance
militaire des Yankees est impuissante à contenir ce glorieux
peuple en armes.
de ce pays, et chacun d'eux, qui contribueront, dans les villes
et les campagnes, par des actions directes, à provoquer l'insé-
curité, la peur, la panique et la défaite de nos ennemis. Les Mouve-
ments de libération nationale sont en train d'assener, dans le
monde entier, des coups sévères à l'ennemi commun : l'impéria-
lisme. La cruelle guerre du Viêt-nam, bien qu'elle équilibre l'éco-
nomie nord-américaine en la militarisant et en évitant une crise,
est en train de lui créer des difficultés graves. Toute la puissance
militaire des Yankees est impuissante à contenir ce glorieux
peuple en armes.
La lutte de nos frères vietnamiens est la lutte de tous les révo-
lutionnaires du monde. Ils se battent pour nous et nous devons
nous battre pour eux. Leur guerre est une partie de la nôtre.
L'impérialisme yankee ne pourra pas résister à la création d'un
lutionnaires du monde. Ils se battent pour nous et nous devons
nous battre pour eux. Leur guerre est une partie de la nôtre.
L'impérialisme yankee ne pourra pas résister à la création d'un
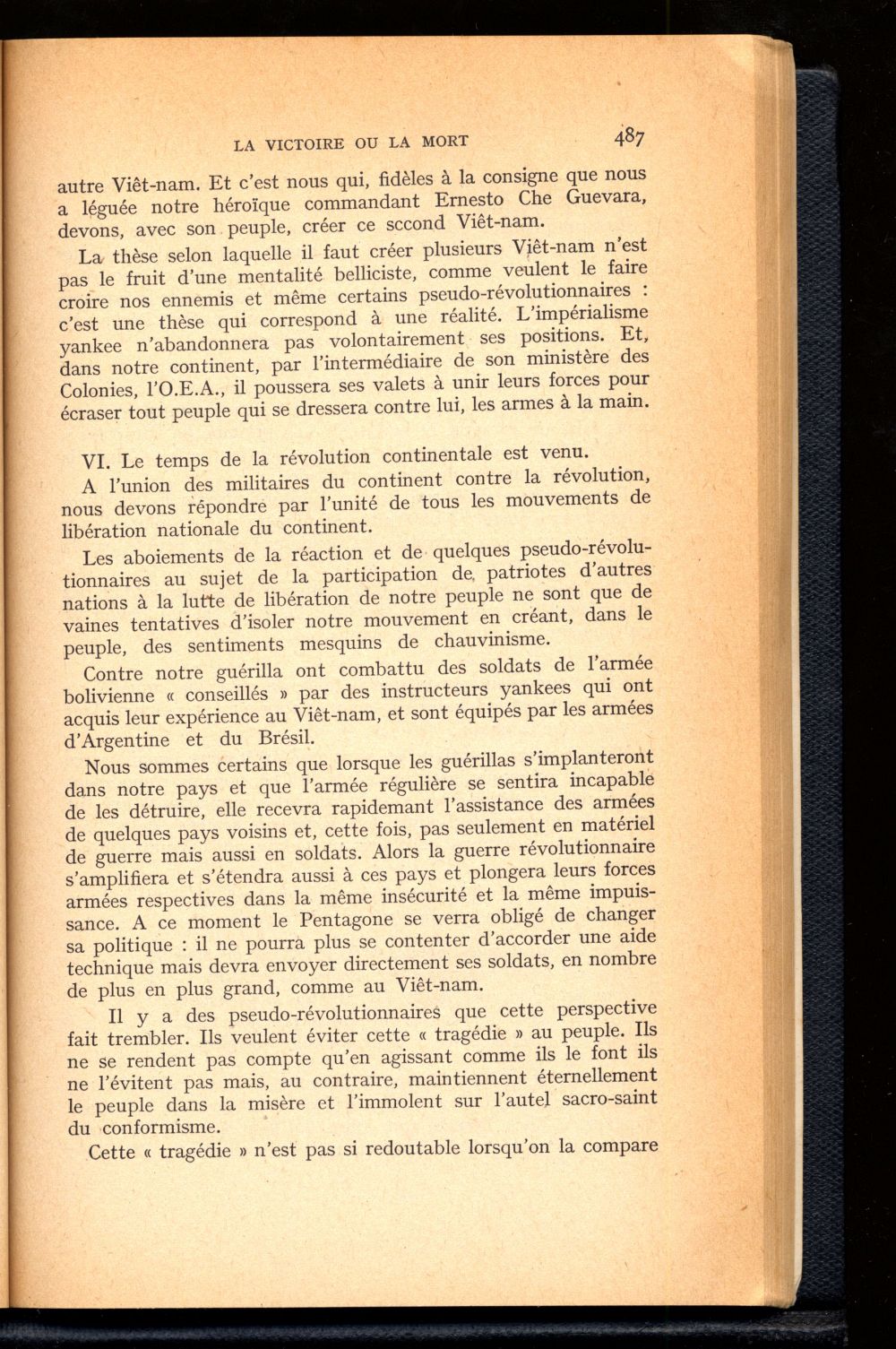

LA VICTOIRE OU LA MORT
487
autre Viêt-nam. Et c'est nous qui, fidèles à la consigne que nous
a léguée notre héroïque commandant Ernesto Che Guevara,
devons, avec son peuple, créer ce second Viêt-nam.
a léguée notre héroïque commandant Ernesto Che Guevara,
devons, avec son peuple, créer ce second Viêt-nam.
La thèse selon laquelle il faut créer plusieurs Viêt-nam n'est
pas le fruit d'une mentalité belliciste, comme veulent le faire
croire nos ennemis et même certains pseudo-révolutionnaires :
c'est une thèse qui correspond à une réalité. L'impérialisme
yankee n'abandonnera pas volontairement ses positions. Et,
dans notre continent, par l'intermédiaire de son ministère des
Colonies, l'O.E.A., il poussera ses valets à unir leurs forces pour
écraser tout peuple qui se dressera contre lui, les armes à la main.
pas le fruit d'une mentalité belliciste, comme veulent le faire
croire nos ennemis et même certains pseudo-révolutionnaires :
c'est une thèse qui correspond à une réalité. L'impérialisme
yankee n'abandonnera pas volontairement ses positions. Et,
dans notre continent, par l'intermédiaire de son ministère des
Colonies, l'O.E.A., il poussera ses valets à unir leurs forces pour
écraser tout peuple qui se dressera contre lui, les armes à la main.
VI. Le temps de la révolution continentale est venu.
A l'union des militaires du continent contre la révolution,
nous devons répondre par l'unité de tous les mouvements de
libération nationale du continent.
nous devons répondre par l'unité de tous les mouvements de
libération nationale du continent.
Les aboiements de la réaction et de quelques pseudo-révolu-
tionnaires au sujet de la participation de. patriotes d'autres
nations à la lutte de libération de notre peuple ne sont que de
vaines tentatives d'isoler notre mouvement en créant, dans le
peuple, des sentiments mesquins de chauvinisme.
tionnaires au sujet de la participation de. patriotes d'autres
nations à la lutte de libération de notre peuple ne sont que de
vaines tentatives d'isoler notre mouvement en créant, dans le
peuple, des sentiments mesquins de chauvinisme.
Contre notre guérilla ont combattu des soldats de l'armée
bolivienne « conseillés » par des instructeurs yankees qui ont
acquis leur expérience au Viêt-nam, et sont équipés par les armées
d'Argentine et du Brésil.
bolivienne « conseillés » par des instructeurs yankees qui ont
acquis leur expérience au Viêt-nam, et sont équipés par les armées
d'Argentine et du Brésil.
Nous sommes certains que lorsque les guérillas s'implanteront
da.ns notre pays et que l'armée régulière se sentira incapable
de les détruire, elle recevra rapidemant l'assistance des armées
de quelques pays voisins et, cette fois, pas seulement en matériel
de guerre mais aussi en soldats. Alors la guerre révolutionnaire
s'amplifiera et s'étendra aussi à ces pays et plongera leurs forces
armées respectives dans la même insécurité et la même impuis-
sance. A ce moment le Pentagone se verra obligé de changer
sa politique : il ne pourra plus se contenter d'accorder une aide
technique mais devra envoyer directement ses soldats, en nombre
de plus en plus grand, comme au Viêt-nam.
da.ns notre pays et que l'armée régulière se sentira incapable
de les détruire, elle recevra rapidemant l'assistance des armées
de quelques pays voisins et, cette fois, pas seulement en matériel
de guerre mais aussi en soldats. Alors la guerre révolutionnaire
s'amplifiera et s'étendra aussi à ces pays et plongera leurs forces
armées respectives dans la même insécurité et la même impuis-
sance. A ce moment le Pentagone se verra obligé de changer
sa politique : il ne pourra plus se contenter d'accorder une aide
technique mais devra envoyer directement ses soldats, en nombre
de plus en plus grand, comme au Viêt-nam.
Il y a des pseudo-révolutionnaires que cette perspective
fait trembler. Ils veulent éviter cette « tragédie » au peuple. Ils
ne se rendent pas compte qu'en agissant comme ils le font ils
ne l'évitent pas mais, au contraire, maintiennent éternellement
le peuple dans la misère et l'immolent sur l'autel sacro-saint
du conformisme.
fait trembler. Ils veulent éviter cette « tragédie » au peuple. Ils
ne se rendent pas compte qu'en agissant comme ils le font ils
ne l'évitent pas mais, au contraire, maintiennent éternellement
le peuple dans la misère et l'immolent sur l'autel sacro-saint
du conformisme.
Cette « tragédie » n'est pas si redoutable lorsqu'on la compare
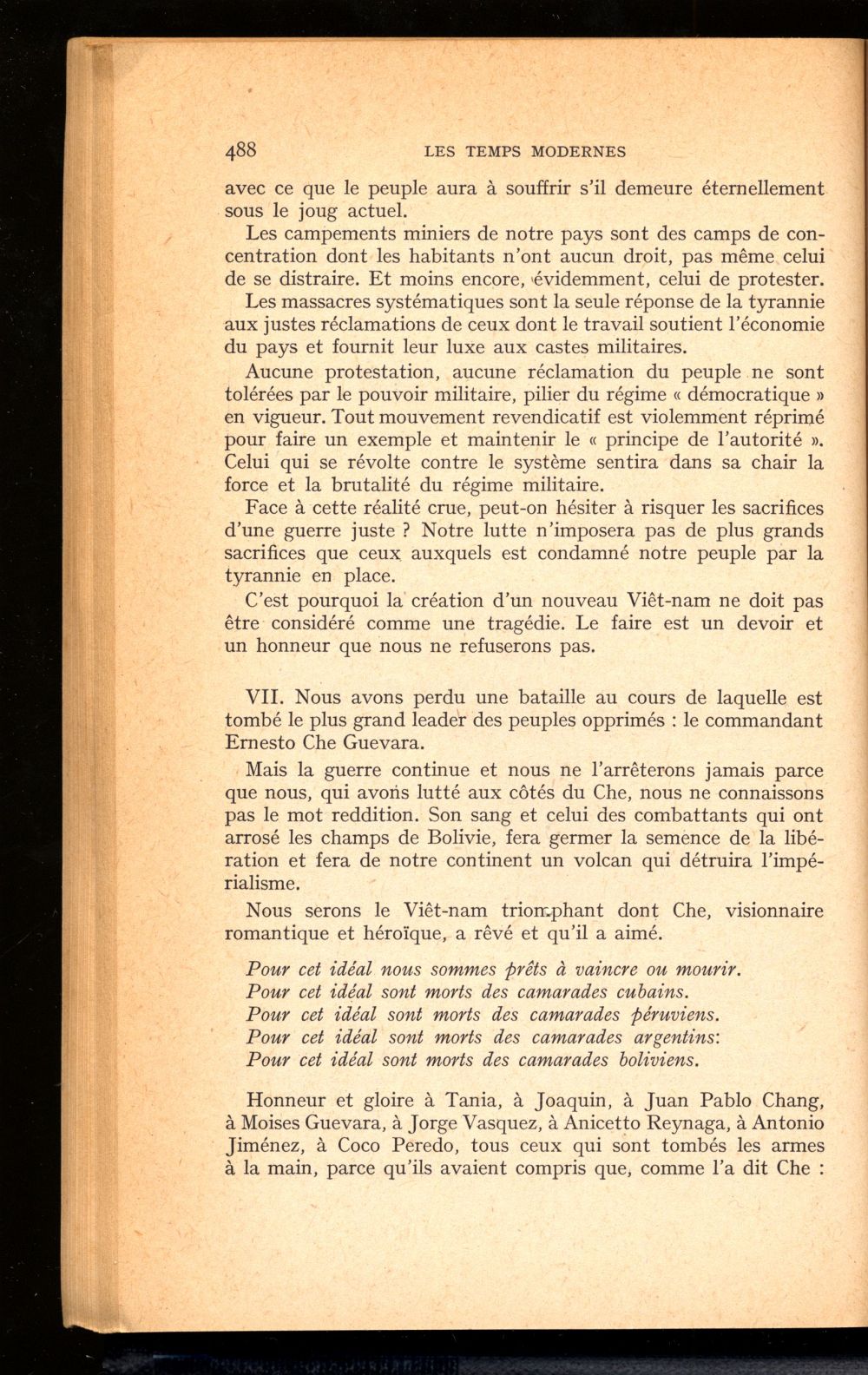

488
LES TEMPS MODERNES
avec ce que le peuple aura à souffrir s'il demeure éternellement
sous le joug actuel.
sous le joug actuel.
Les campements miniers de notre pays sont des camps de con-
centration dont les habitants n'ont aucun droit, pas même celui
de se distraire. Et moins encore, -évidemment, celui de protester.
centration dont les habitants n'ont aucun droit, pas même celui
de se distraire. Et moins encore, -évidemment, celui de protester.
Les massacres systématiques sont la seule réponse de la tyrannie
aux justes réclamations de ceux dont le travail soutient l'économie
du pays et fournit leur luxe aux castes militaires.
aux justes réclamations de ceux dont le travail soutient l'économie
du pays et fournit leur luxe aux castes militaires.
Aucune protestation, aucune réclamation du peuple ne sont
tolérées par le pouvoir militaire, pilier du régime « démocratique »
en vigueur. Tout mouvement revendicatif est violemment réprimé
pour faire un exemple et maintenir le « principe de l'autorité ».
Celui qui se révolte contre le système sentira dans sa chair la
force et la brutalité du régime militaire.
tolérées par le pouvoir militaire, pilier du régime « démocratique »
en vigueur. Tout mouvement revendicatif est violemment réprimé
pour faire un exemple et maintenir le « principe de l'autorité ».
Celui qui se révolte contre le système sentira dans sa chair la
force et la brutalité du régime militaire.
Face à cette réalité crue, peut-on hésiter à risquer les sacrifices
d'une guerre juste ? Notre lutte n'imposera pas de plus grands
sacrifices que ceux auxquels est condamné notre peuple par la
tyrannie en place.
d'une guerre juste ? Notre lutte n'imposera pas de plus grands
sacrifices que ceux auxquels est condamné notre peuple par la
tyrannie en place.
C'est pourquoi la création d'un nouveau Viêt-nam ne doit pas
être considéré comme une tragédie. Le faire est un devoir et
un honneur que nous ne refuserons pas.
être considéré comme une tragédie. Le faire est un devoir et
un honneur que nous ne refuserons pas.
VII. Nous avons perdu une bataille au cours de laquelle est
tombé le plus grand leader des peuples opprimés : le commandant
Ernesto Che Guevara.
tombé le plus grand leader des peuples opprimés : le commandant
Ernesto Che Guevara.
Mais la guerre continue et nous ne l'arrêterons jamais parce
que nous, qui avons lutté aux côtés du Che, nous ne connaissons
pas le mot reddition. Son sang et celui des combattants qui ont
arrosé les champs de Bolivie, fera germer la semence de la libé-
ration et fera de notre continent un volcan qui détruira l'impé-
rialisme.
que nous, qui avons lutté aux côtés du Che, nous ne connaissons
pas le mot reddition. Son sang et celui des combattants qui ont
arrosé les champs de Bolivie, fera germer la semence de la libé-
ration et fera de notre continent un volcan qui détruira l'impé-
rialisme.
Nous serons le Viêt-nam triomphant dont Che, visionnaire
romantique et héroïque, a rêvé et qu'il a aimé.
romantique et héroïque, a rêvé et qu'il a aimé.
Pour cet idéal nous sommes prêts à vaincre ou mourir.
Pour cet idéal sont morts des camarades cubains.
Pour cet idéal sont morts des camarades -péruviens.
Pour cet idéal sont morts des camarades argentins:
Pour cet idéal sont morts des camarades boliviens.
Pour cet idéal sont morts des camarades cubains.
Pour cet idéal sont morts des camarades -péruviens.
Pour cet idéal sont morts des camarades argentins:
Pour cet idéal sont morts des camarades boliviens.
Honneur et gloire à Tania, à Joaquin, à Juan Pablo Chang,
à Moises Guevara, à Jorge Vasquez, à Anicetto Reynaga, à Antonio
Jiménez, à Coco Peredo, tous ceux qui sont tombés les armes
à la main, parce qu'ils avaient compris que, comme l'a dit Che :
à Moises Guevara, à Jorge Vasquez, à Anicetto Reynaga, à Antonio
Jiménez, à Coco Peredo, tous ceux qui sont tombés les armes
à la main, parce qu'ils avaient compris que, comme l'a dit Che :
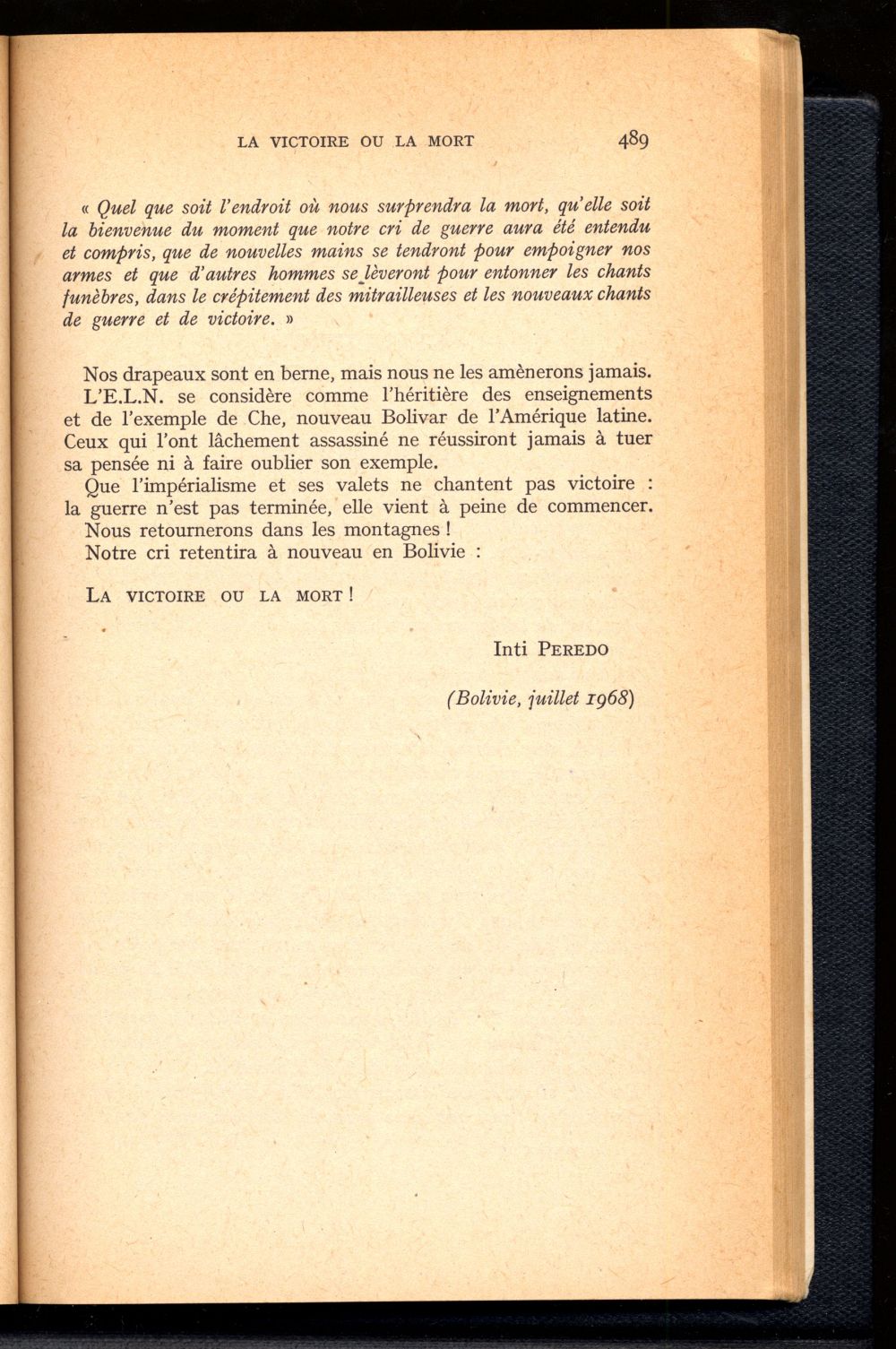

LA VICTOIRE OU LA MORT
489
« Quel que soit l'endroit où nous surprendra la mort, quelle soit
la bienvenue du moment que notre cri de guerre aura été entendu
et compris, que de nouvelles mains se tendront pour empoigner nos
armes et que d'autres hommes se lèveront pour entonner les chants
funèbres, dans le crépitement des mitrailleuses et les nouveaux chants
de guerre et de victoire. »
la bienvenue du moment que notre cri de guerre aura été entendu
et compris, que de nouvelles mains se tendront pour empoigner nos
armes et que d'autres hommes se lèveront pour entonner les chants
funèbres, dans le crépitement des mitrailleuses et les nouveaux chants
de guerre et de victoire. »
Nos drapeaux sont en berne, mais nous ne les amènerons jamais.
L'E.L.N. se considère comme l'héritière des enseignements
et de l'exemple de Che, nouveau Bolivar de l'Amérique latine.
Ceux qui l'ont lâchement assassiné ne réussiront jamais à tuer
sa pensée ni à faire oublier son exemple.
et de l'exemple de Che, nouveau Bolivar de l'Amérique latine.
Ceux qui l'ont lâchement assassiné ne réussiront jamais à tuer
sa pensée ni à faire oublier son exemple.
Que l'impérialisme et ses valets ne chantent pas victoire :
la guerre n'est pas terminée, elle vient à peine de commencer.
la guerre n'est pas terminée, elle vient à peine de commencer.
Nous retournerons dans les montagnes !
Notre cri retentira à nouveau en Bolivie :
LA VICTOIRE OU LA MORT !
Inti PEREDO
(Bolivie, juillet ig68)
(Bolivie, juillet ig68)
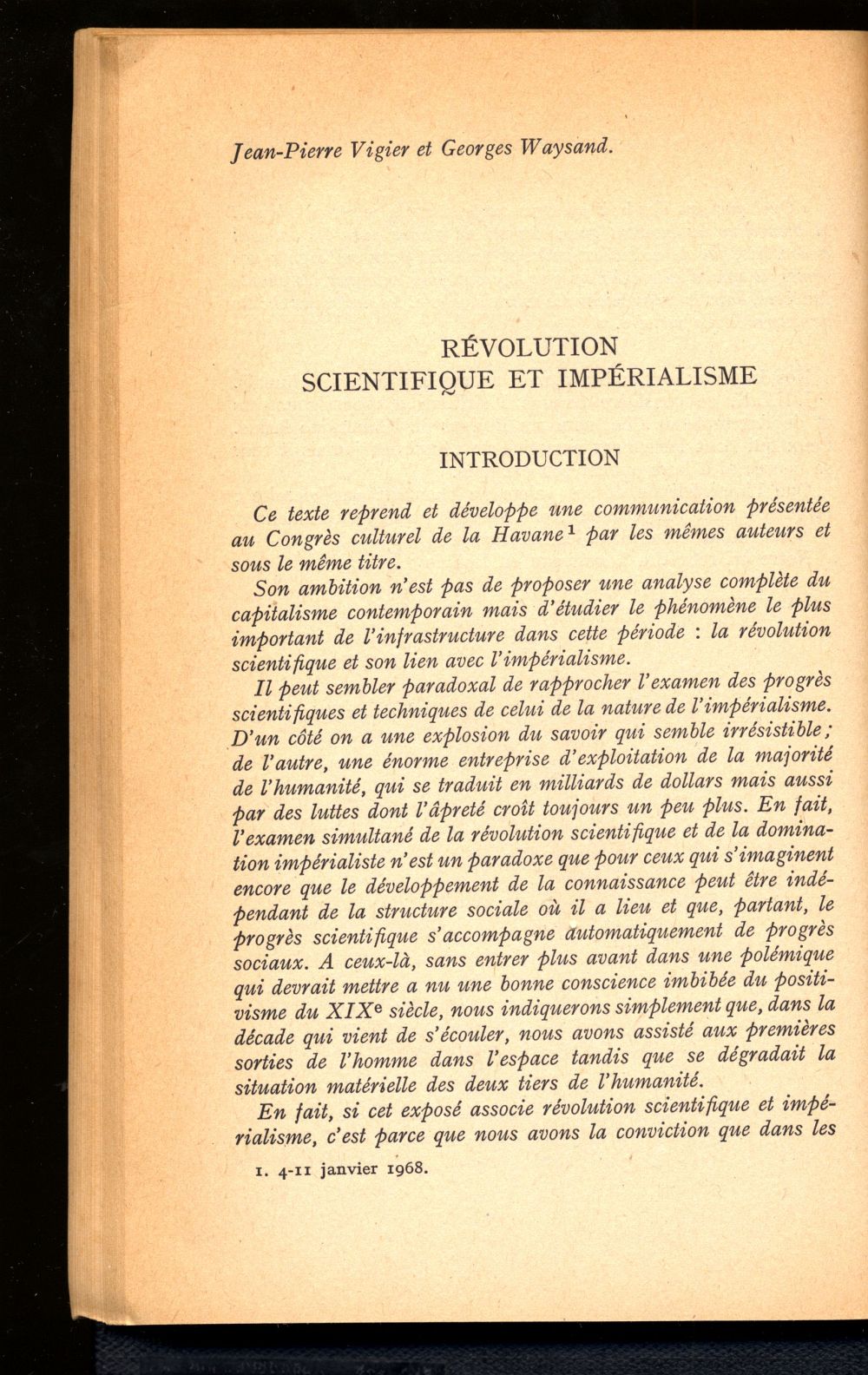

Jean-Pierre Vigier et Georges Waysand.
RÉVOLUTION
SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
INTRODUCTION
Ce texte reprend et développe une communication présentée
au Congrès culturel de la Havane* par les mêmes auteurs et
sous le même titre.
au Congrès culturel de la Havane* par les mêmes auteurs et
sous le même titre.
Son ambition n'est pas de proposer une analyse complète du
capitalisme contemporain mais d'étudier le phénomène le plus
important de l'infrastructure dans cette période : la révolution
scientifique et son lien avec l'impérialisme.
capitalisme contemporain mais d'étudier le phénomène le plus
important de l'infrastructure dans cette période : la révolution
scientifique et son lien avec l'impérialisme.
Il peut sembler paradoxal de rapprocher l'examen des progrès
scientifiques et techniques de celui de la nature de l'impérialisme.
D'un côté on a une explosion du savoir qui semble irrésistible ;
de l'autre, une énorme entreprise d'exploitation de la majorité
de l'humanité, qui se traduit en milliards de dollars mais aussi
par des luttes dont l'âpreté croît toujours un peu plus. En fait,
l'examen simultané de la révolution scientifique et de la domina-
tion impérialiste n'est un paradoxe que pour ceux qui s'imaginent
encore que le développement de la connaissance peut être indé-
pendant de la structure sociale où il a lieu et que, partant, le
progrès scientifique s'accompagne automatiquement de progrès
sociaux. A ceux-là, sans entrer plus avant dans une polémique
qui devrait mettre a nu une bonne conscience imbibée du positi-
visme du XIXe siècle, nous indiquerons simplement que, dans la
décade qui vient de s'écouler, nous avons assisté aux premières
sorties de l'homme dans l'espace tandis que se dégradait la
situation matérielle des deux tiers de l'humanité.
scientifiques et techniques de celui de la nature de l'impérialisme.
D'un côté on a une explosion du savoir qui semble irrésistible ;
de l'autre, une énorme entreprise d'exploitation de la majorité
de l'humanité, qui se traduit en milliards de dollars mais aussi
par des luttes dont l'âpreté croît toujours un peu plus. En fait,
l'examen simultané de la révolution scientifique et de la domina-
tion impérialiste n'est un paradoxe que pour ceux qui s'imaginent
encore que le développement de la connaissance peut être indé-
pendant de la structure sociale où il a lieu et que, partant, le
progrès scientifique s'accompagne automatiquement de progrès
sociaux. A ceux-là, sans entrer plus avant dans une polémique
qui devrait mettre a nu une bonne conscience imbibée du positi-
visme du XIXe siècle, nous indiquerons simplement que, dans la
décade qui vient de s'écouler, nous avons assisté aux premières
sorties de l'homme dans l'espace tandis que se dégradait la
situation matérielle des deux tiers de l'humanité.
En fait, si cet exposé associe révolution scientifique et impé-
rialisme, c'est parce que nous avons la conviction que dans les
rialisme, c'est parce que nous avons la conviction que dans les
i. 4-11 janvier 1968.
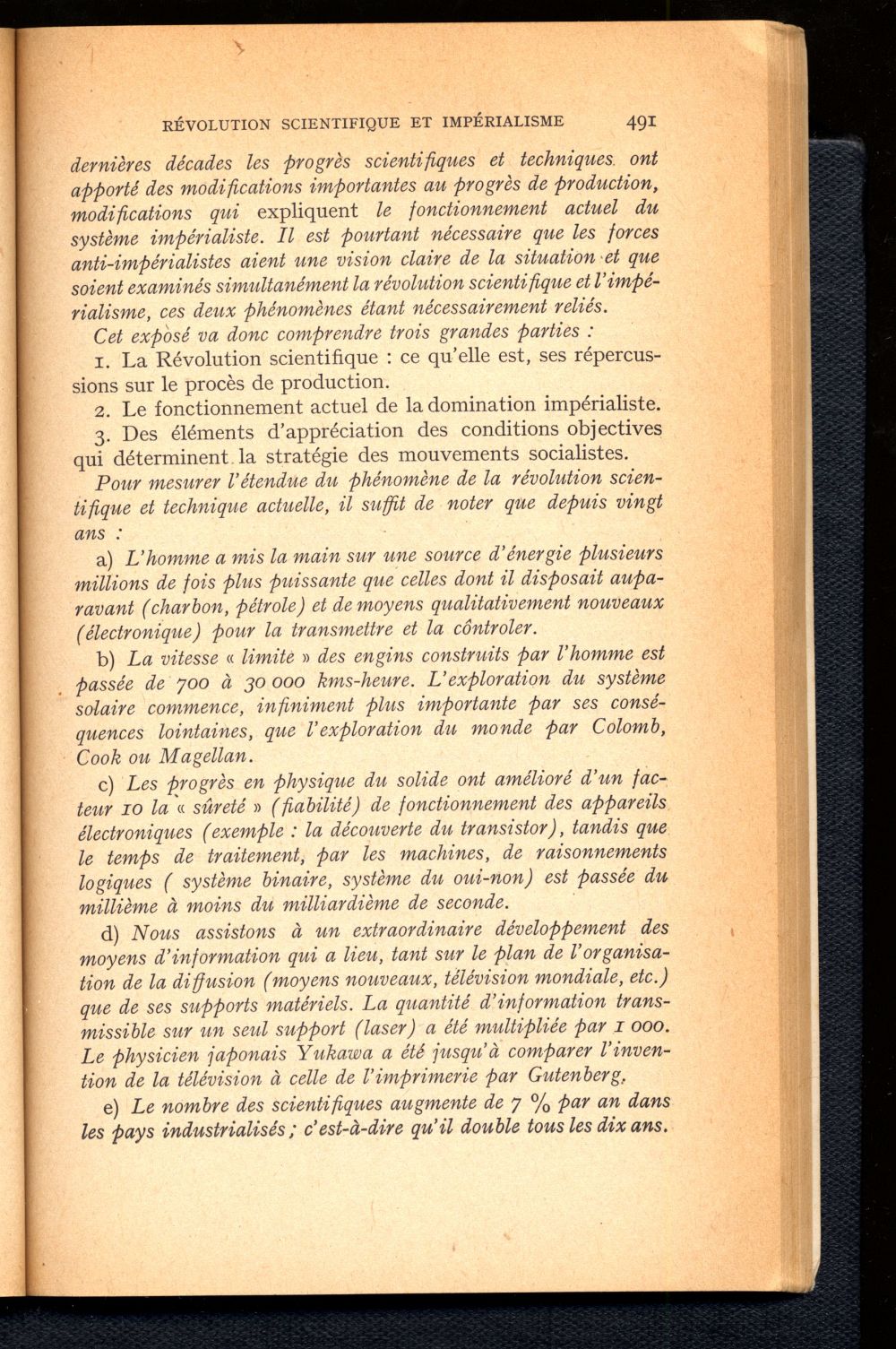

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
491
dernières décades les progrès scientifiques et techniques, ont
apporté des modifications importantes au progrès de production,
modifications qui expliquent le fonctionnement actuel du
système impérialiste. Il est pourtant nécessaire que les forces
anti-impérialistes aient une vision claire de la situation et que
soient examinés simultanément la révolution scientifique et l'impé-
rialisme, ces deux phénomènes étant nécessairement reliés.
Cet exposé va donc comprendre trois grandes parties :
apporté des modifications importantes au progrès de production,
modifications qui expliquent le fonctionnement actuel du
système impérialiste. Il est pourtant nécessaire que les forces
anti-impérialistes aient une vision claire de la situation et que
soient examinés simultanément la révolution scientifique et l'impé-
rialisme, ces deux phénomènes étant nécessairement reliés.
Cet exposé va donc comprendre trois grandes parties :
1. La Révolution scientifique : ce qu'elle est, ses répercus-
sions sur le procès de production.
sions sur le procès de production.
2. Le fonctionnement actuel de la domination impérialiste.
3. Des éléments d'appréciation des conditions objectives
qui déterminent la stratégie des mouvements socialistes.
qui déterminent la stratégie des mouvements socialistes.
Pour mesurer l'étendue du phénomène de la révolution scien-
tifique et technique actuelle, il suffit de noter que depuis vingt
ans :
tifique et technique actuelle, il suffit de noter que depuis vingt
ans :
a) L'homme a mis la main sur une source d'énergie plusieurs
millions de fois plus puissante que celles dont il disposait aupa-
ravant (charbon, pétrole) et de moyens qualitativement nouveaux
(électronique) pour la transmettre et la contrôler.
millions de fois plus puissante que celles dont il disposait aupa-
ravant (charbon, pétrole) et de moyens qualitativement nouveaux
(électronique) pour la transmettre et la contrôler.
b) La vitesse « limite » des engins construits par l'homme est
passée de joo à 30 ooo kms-heure. L'exploration du système
solaire commence, infiniment plus importante par ses consé-
quences lointaines, que l'exploration du monde par Colomb,
Cook ou Magellan.
passée de joo à 30 ooo kms-heure. L'exploration du système
solaire commence, infiniment plus importante par ses consé-
quences lointaines, que l'exploration du monde par Colomb,
Cook ou Magellan.
c) Les progrès en physique du solide ont amélioré d'un fac-
teur 10 la « sûreté » (fiabilité) de fonctionnement des appareils
électroniques (exemple : la découverte du transistor), tandis que
le temps de traitement, par les machines, de raisonnements
logiques ( système binaire, système du oui-non) est passée du
millième à moins du milliardième de seconde.
teur 10 la « sûreté » (fiabilité) de fonctionnement des appareils
électroniques (exemple : la découverte du transistor), tandis que
le temps de traitement, par les machines, de raisonnements
logiques ( système binaire, système du oui-non) est passée du
millième à moins du milliardième de seconde.
d) Nous assistons à un extraordinaire développement des
moyens d'information qui a lieu, tant sur le plan de l'organisa-
tion de la diffusion (moyens nouveaux, télévision mondiale, etc.)
que de ses supports matériels. La quantité d'information trans-
missible sur un seul support (laser) a été multipliée par i ooo.
Le physicien japonais Ytikawa a été jusqu'à comparer l'inven-
tion de la télévision à celle de l'imprimerie par Gutenberg.
moyens d'information qui a lieu, tant sur le plan de l'organisa-
tion de la diffusion (moyens nouveaux, télévision mondiale, etc.)
que de ses supports matériels. La quantité d'information trans-
missible sur un seul support (laser) a été multipliée par i ooo.
Le physicien japonais Ytikawa a été jusqu'à comparer l'inven-
tion de la télévision à celle de l'imprimerie par Gutenberg.
e) Le nombre des scientifiques augmente de 7 % par an dans
les pays industrialisés ; c'est-à-dire qu'il double tous les dix ans.
les pays industrialisés ; c'est-à-dire qu'il double tous les dix ans.
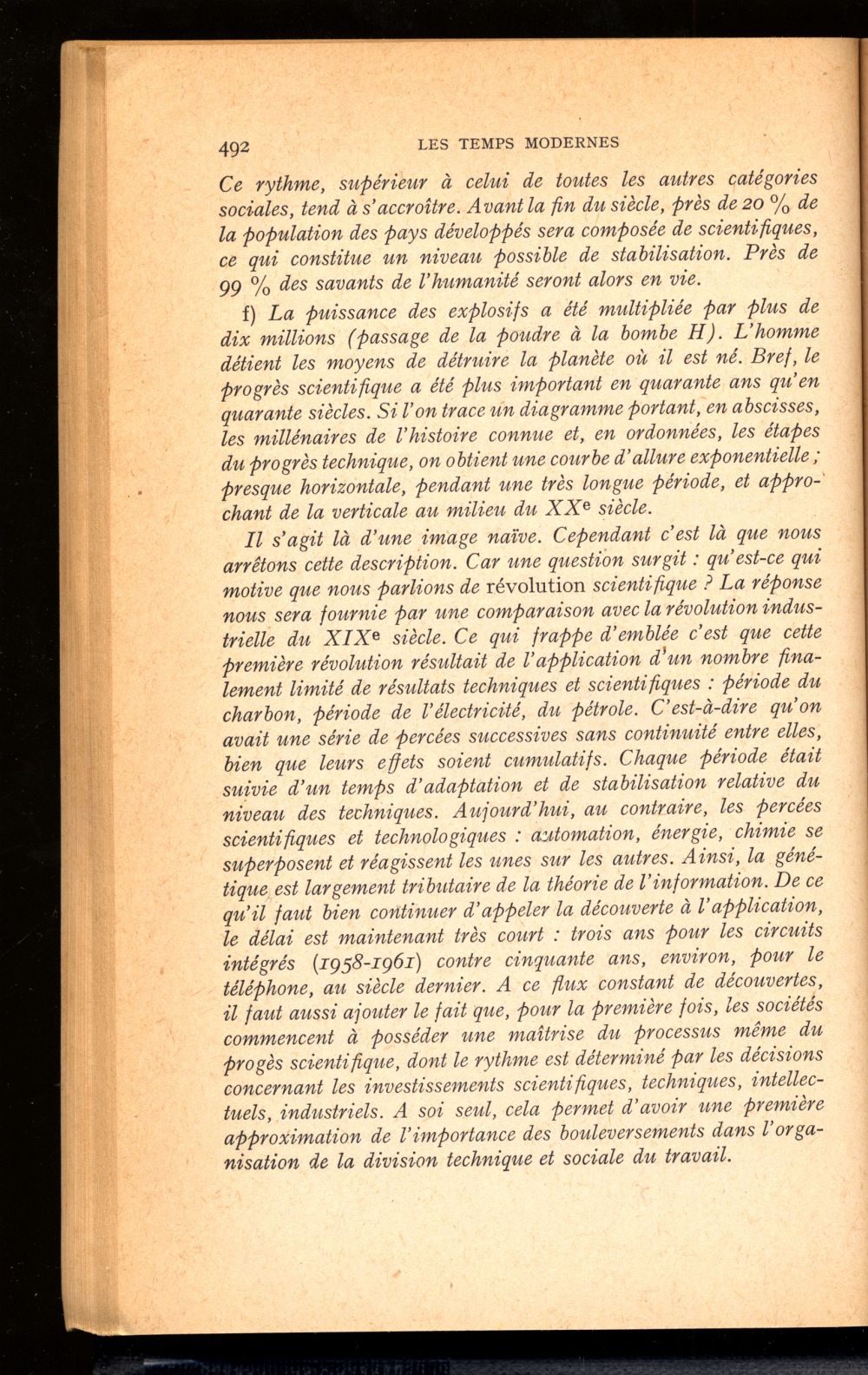

492
LES TEMPS MODERNES
Ce rythme, supérieur à celui de toutes les aiitres catégories
sociales, tend à s'accroître. Avant la fin du siècle, près de 20 % de
la population des pays développés sera composée de scientifiques,
ce qui constitue un niveau possible de stabilisation. Près de
99 % des savants de l'humanité seront alors en vie.
sociales, tend à s'accroître. Avant la fin du siècle, près de 20 % de
la population des pays développés sera composée de scientifiques,
ce qui constitue un niveau possible de stabilisation. Près de
99 % des savants de l'humanité seront alors en vie.
f) La puissance des explosifs a été multipliée par plus de
dix millions (passage de la poudre à la bombe H). L'homme
détient les moyens de détruire la planète où il est né. Bref, le
progrès scientifique a été plus important en quarante ans qu'en
quarante siècles. Si l'on trace un diagramme portant, en abscisses,
les millénaires de l'histoire connue et, en ordonnées, les étapes
du progrès technique, on obtient une courbe d'allure exponentielle ;
-presque horizontale, pendant une très longue période, et appro-
chant de la verticale au milieu du XXe siècle.
dix millions (passage de la poudre à la bombe H). L'homme
détient les moyens de détruire la planète où il est né. Bref, le
progrès scientifique a été plus important en quarante ans qu'en
quarante siècles. Si l'on trace un diagramme portant, en abscisses,
les millénaires de l'histoire connue et, en ordonnées, les étapes
du progrès technique, on obtient une courbe d'allure exponentielle ;
-presque horizontale, pendant une très longue période, et appro-
chant de la verticale au milieu du XXe siècle.
Il s'agit là d'une image naïve. Cependant c'est là que nous
arrêtons cette description. Car une question surgit : qu'est-ce qui
motive que nous parlions de révolution scientifique P La réponse
nous sera fournie par une comparaison avec la révolution indus-
trielle du XIXe siècle. Ce qui frappe d'emblée c'est que cette
première révolution résultait de l'application d un nombre fina-
lement limité de résultats techniques et scientifiques : période du
charbon, période de l'électricité, du pétrole. C'est-à-dire qu'on
avait une série de percées successives sans continuité entre elles,
bien que leurs effets soient cumulatifs. Chaque période était
suivie d'un temps d'adaptation et de stabilisation relative du
niveau des techniques. Aujourd'hui, au contraire, les percées
scientifiques et technologiques : automation, énergie, chimie se
superposent et réagissent les unes sur les autres. Ainsi, la géné-
tique est largement tributaire de la théorie de l'information. De ce
qu'il faut bien continuer d'appeler la découverte à l'application,
le délai est maintenant très court : trois ans pour les circuits
intégrés (1958-1961) contre cinquante ans, environ, pour le
téléphone, au siècle dernier. A ce flux constant de découvertes,
il faut aussi ajouter le fait que, pour la première fois, les sociétés
commencent à posséder une maîtrise du processus même du
progès scientifique, dont le rythme est déterminé par les décisions
concernant les investissements scientifiques, techniques, intellec-
tuels, industriels. A soi seul, cela permet d'avoir une première
approximation de l'importance des bouleversements dans l'orga-
nisation de la division technique et sociale du travail.
arrêtons cette description. Car une question surgit : qu'est-ce qui
motive que nous parlions de révolution scientifique P La réponse
nous sera fournie par une comparaison avec la révolution indus-
trielle du XIXe siècle. Ce qui frappe d'emblée c'est que cette
première révolution résultait de l'application d un nombre fina-
lement limité de résultats techniques et scientifiques : période du
charbon, période de l'électricité, du pétrole. C'est-à-dire qu'on
avait une série de percées successives sans continuité entre elles,
bien que leurs effets soient cumulatifs. Chaque période était
suivie d'un temps d'adaptation et de stabilisation relative du
niveau des techniques. Aujourd'hui, au contraire, les percées
scientifiques et technologiques : automation, énergie, chimie se
superposent et réagissent les unes sur les autres. Ainsi, la géné-
tique est largement tributaire de la théorie de l'information. De ce
qu'il faut bien continuer d'appeler la découverte à l'application,
le délai est maintenant très court : trois ans pour les circuits
intégrés (1958-1961) contre cinquante ans, environ, pour le
téléphone, au siècle dernier. A ce flux constant de découvertes,
il faut aussi ajouter le fait que, pour la première fois, les sociétés
commencent à posséder une maîtrise du processus même du
progès scientifique, dont le rythme est déterminé par les décisions
concernant les investissements scientifiques, techniques, intellec-
tuels, industriels. A soi seul, cela permet d'avoir une première
approximation de l'importance des bouleversements dans l'orga-
nisation de la division technique et sociale du travail.
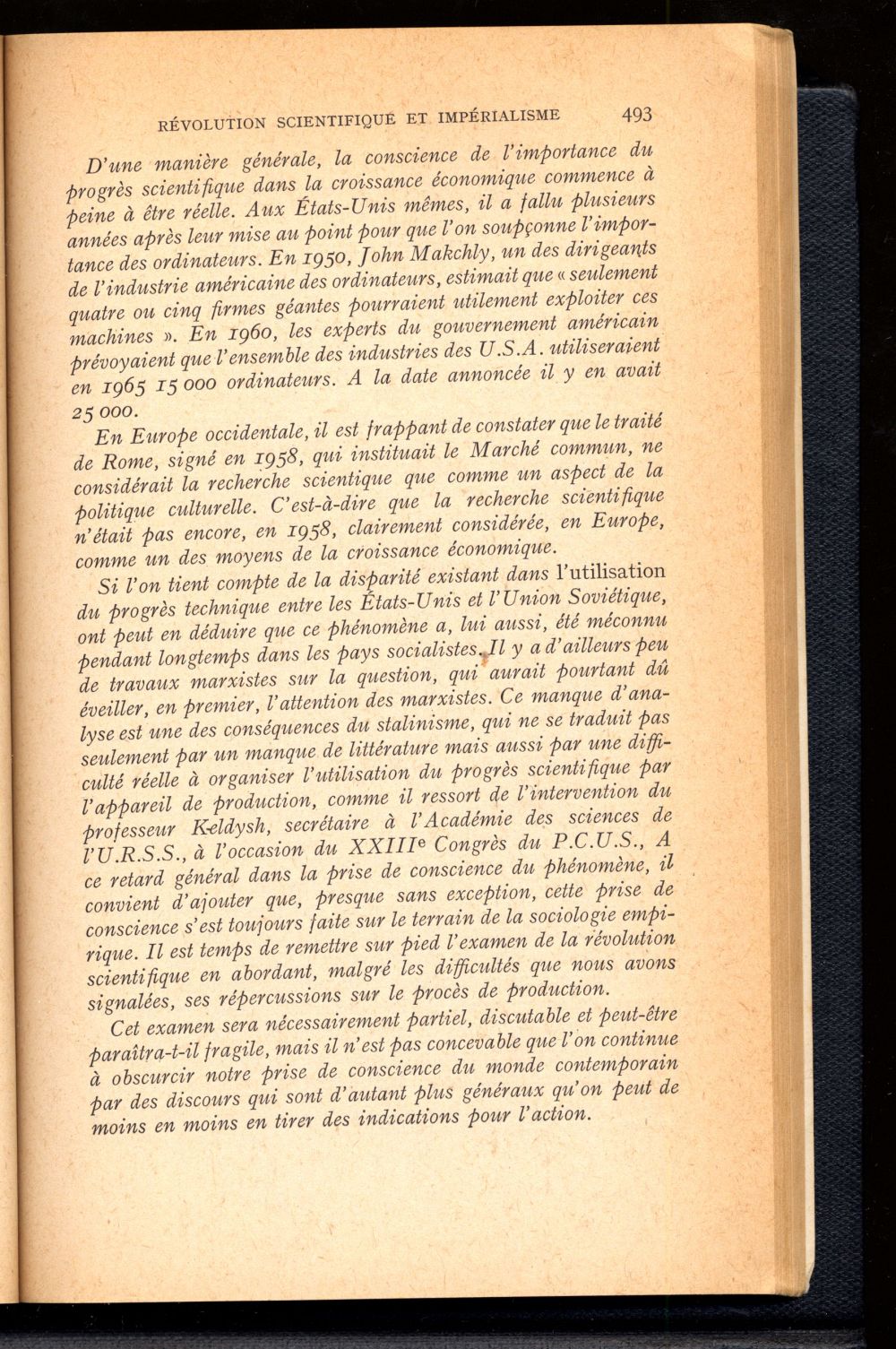

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
493
D'une manière générale, la conscience de l'importance du
progrès scientifique dans la croissance économique commence à
peine à être réelle. Aux Etats-Unis mêmes, il a fallu plusieurs
années après leur mise au point pour que l'on soupçonne l'impor-
tance des ordinateurs. En 1950, John Makchly, un des dirigeants
de l'industrie américaine des ordinateurs, estimait que « seulement
quatre ou cinq firmes géantes pourraient utilement exploiter ces
machines ». En içôo, les experts du gouvernement américain
prévoyaient que l'ensemble des industries des U.S.A. utiliseraient
en 1965 J5 ooo ordinateurs. A la date annoncée il y en avait
25 ooo.
progrès scientifique dans la croissance économique commence à
peine à être réelle. Aux Etats-Unis mêmes, il a fallu plusieurs
années après leur mise au point pour que l'on soupçonne l'impor-
tance des ordinateurs. En 1950, John Makchly, un des dirigeants
de l'industrie américaine des ordinateurs, estimait que « seulement
quatre ou cinq firmes géantes pourraient utilement exploiter ces
machines ». En içôo, les experts du gouvernement américain
prévoyaient que l'ensemble des industries des U.S.A. utiliseraient
en 1965 J5 ooo ordinateurs. A la date annoncée il y en avait
25 ooo.
En Europe occidentale, il est frappant de constater que le traité
de Rome, signé en 1958, qui instituait le Marché commun, ne
considérait la recherche scientique que comme un aspect de la
politique culturelle. C'est-à-dire que la recherche scientifique
•n'était pas encore, en 1958, clairement considérée, en Europe,
comme un des moyens de la croissance économique.
de Rome, signé en 1958, qui instituait le Marché commun, ne
considérait la recherche scientique que comme un aspect de la
politique culturelle. C'est-à-dire que la recherche scientifique
•n'était pas encore, en 1958, clairement considérée, en Europe,
comme un des moyens de la croissance économique.
Si l'on tient compte de la disparité existant dans l'utilisation
du progrès technique entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique,
ont peut en déduire que ce phénomène a, lui aussi, été méconnu
pendant longtemps dans les pays socialistes.il y a d'ailleurs peu
de travaux marxistes sur la question, qui aurait pourtant dû
éveiller, en premier, l'attention des marxistes. Ce manque d'ana-
lyse est une des conséquences du stalinisme, qui ne se traduit pas
seulement par un manque de littérature mais aussi par une diffi-
culté réelle à organiser l'utilisation du progrès scientifique par
l'appareil de production, comme il ressort de l'intervention du
professeur K-eldysh, secrétaire à l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S., à l'occasion du XXIIIe Congrès du P.C.U.S., A
ce retard général dans la prise de conscience du phénomène, il
convient d'ajouter que, presque sans exception, cette prise de
conscience s'est toujours faite sur le terrain de la sociologie empi-
rique. Il est temps de remettre sur pied l'examen de la révolution
scientifique en abordant, malgré les difficultés que nous avons
signalées, ses répercussions sur le procès de production.
du progrès technique entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique,
ont peut en déduire que ce phénomène a, lui aussi, été méconnu
pendant longtemps dans les pays socialistes.il y a d'ailleurs peu
de travaux marxistes sur la question, qui aurait pourtant dû
éveiller, en premier, l'attention des marxistes. Ce manque d'ana-
lyse est une des conséquences du stalinisme, qui ne se traduit pas
seulement par un manque de littérature mais aussi par une diffi-
culté réelle à organiser l'utilisation du progrès scientifique par
l'appareil de production, comme il ressort de l'intervention du
professeur K-eldysh, secrétaire à l'Académie des sciences de
l'U.R.S.S., à l'occasion du XXIIIe Congrès du P.C.U.S., A
ce retard général dans la prise de conscience du phénomène, il
convient d'ajouter que, presque sans exception, cette prise de
conscience s'est toujours faite sur le terrain de la sociologie empi-
rique. Il est temps de remettre sur pied l'examen de la révolution
scientifique en abordant, malgré les difficultés que nous avons
signalées, ses répercussions sur le procès de production.
Cet examen sera nécessairement partiel, discutable et peut-être
paraîtra-t-il fragile, mais il n'est pas concevable que l'on continue
à obscurcir notre prise de conscience du monde contemporain
par des discours qui sont d'autant plus généraux qu'on peut de
moins en moins en tirer des indications pour l'action.
paraîtra-t-il fragile, mais il n'est pas concevable que l'on continue
à obscurcir notre prise de conscience du monde contemporain
par des discours qui sont d'autant plus généraux qu'on peut de
moins en moins en tirer des indications pour l'action.
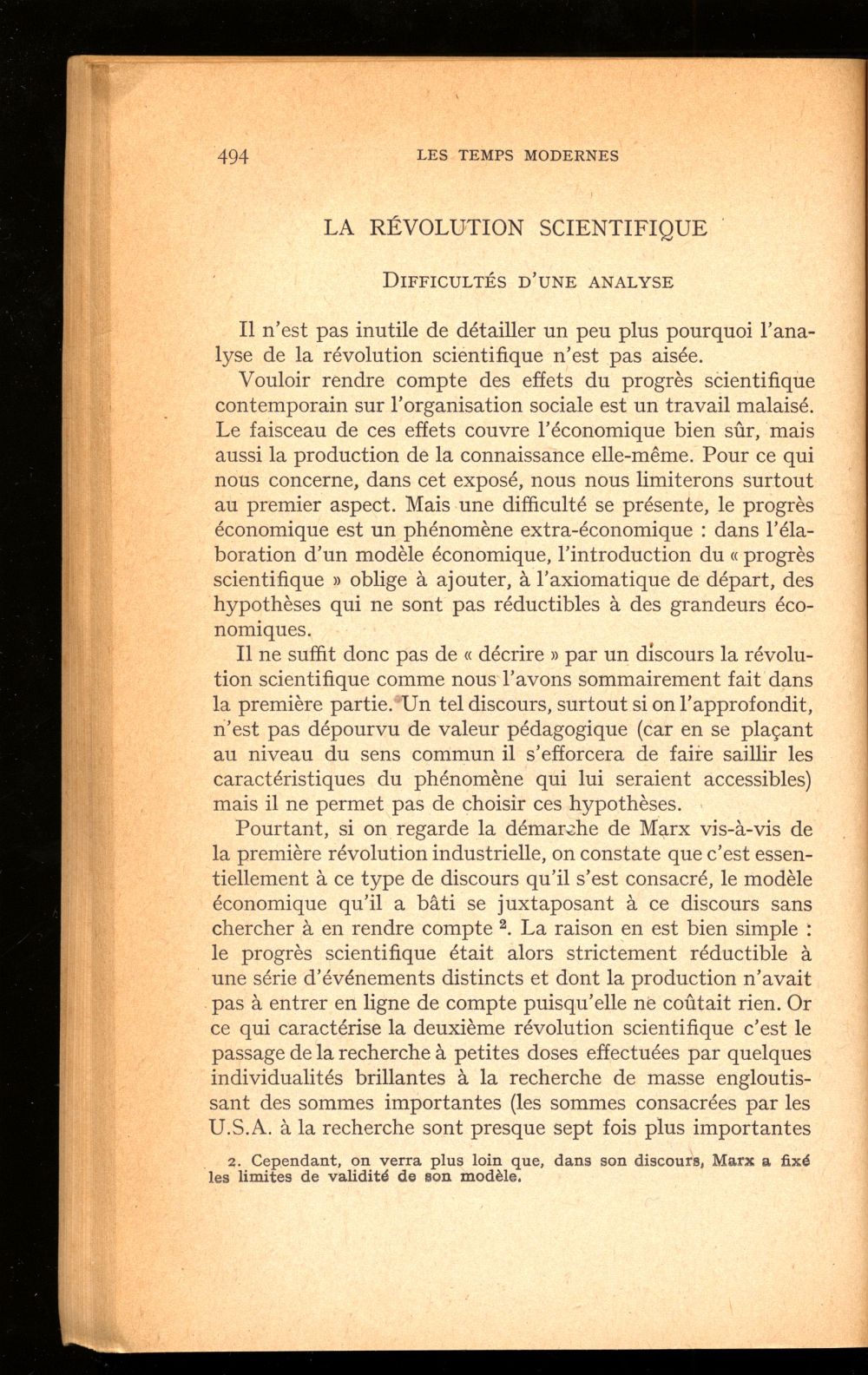

494
LES TEMPS MODERNES
LA RÉVOLUTION SCIENTIFIOUE
DIFFICULTÉS D'UNE ANALYSE
II n'est pas inutile de détailler un peu plus pourquoi l'ana-
lyse de la révolution scientifique n'est pas aisée.
lyse de la révolution scientifique n'est pas aisée.
Vouloir rendre compte des effets du progrès scientifique
contemporain sur l'organisation sociale est un travail malaisé.
Le faisceau de ces effets couvre l'économique bien sûr, mais
aussi la production de la connaissance elle-même. Pour ce qui
nous concerne, dans cet exposé, nous nous limiterons surtout
au premier aspect. Mais une difficulté se présente, le progrès
économique est un phénomène extra-économique : dans l'éla-
boration d'un modèle économique, l'introduction du « progrès
scientifique » oblige à ajouter, à l'axiornatique de départ, des
hypothèses qui ne sont pas réductibles à des grandeurs éco-
nomiques.
contemporain sur l'organisation sociale est un travail malaisé.
Le faisceau de ces effets couvre l'économique bien sûr, mais
aussi la production de la connaissance elle-même. Pour ce qui
nous concerne, dans cet exposé, nous nous limiterons surtout
au premier aspect. Mais une difficulté se présente, le progrès
économique est un phénomène extra-économique : dans l'éla-
boration d'un modèle économique, l'introduction du « progrès
scientifique » oblige à ajouter, à l'axiornatique de départ, des
hypothèses qui ne sont pas réductibles à des grandeurs éco-
nomiques.
Il ne suffit donc pas de « décrire » par un discours la révolu-
tion scientifique comme nous l'avons sommairement fait dans
la première partie. Un tel discours, surtout si on l'approfondit,
n'est pas dépourvu de valeur pédagogique (car en se plaçant
au niveau du sens commun il s'efforcera de faire saillir les
caractéristiques du phénomène qui lui seraient accessibles)
mais il ne permet pas de choisir ces hypothèses.
tion scientifique comme nous l'avons sommairement fait dans
la première partie. Un tel discours, surtout si on l'approfondit,
n'est pas dépourvu de valeur pédagogique (car en se plaçant
au niveau du sens commun il s'efforcera de faire saillir les
caractéristiques du phénomène qui lui seraient accessibles)
mais il ne permet pas de choisir ces hypothèses.
Pourtant, si on regarde la démarche de Marx vis-à-vis de
la première révolution industrielle, on constate que c'est essen-
tiellement à ce type de discours qu'il s'est consacré, le modèle
économique qu'il a bâti se juxtaposant à ce discours sans
chercher à en rendre compte 2. La raison en est bien simple :
le progrès scientifique était alors strictement réductible à
une série d'événements distincts et dont la production n'avait
pas à entrer en ligne de compte puisqu'elle ne coûtait rien. Or
ce qui caractérise la deuxième révolution scientifique c'est le
passage de la recherche à petites doses effectuées par quelques
individualités brillantes à la recherche de masse engloutis-
sant des sommes importantes (les sommes consacrées par les
U.S.A. à la recherche sont presque sept fois plus importantes
la première révolution industrielle, on constate que c'est essen-
tiellement à ce type de discours qu'il s'est consacré, le modèle
économique qu'il a bâti se juxtaposant à ce discours sans
chercher à en rendre compte 2. La raison en est bien simple :
le progrès scientifique était alors strictement réductible à
une série d'événements distincts et dont la production n'avait
pas à entrer en ligne de compte puisqu'elle ne coûtait rien. Or
ce qui caractérise la deuxième révolution scientifique c'est le
passage de la recherche à petites doses effectuées par quelques
individualités brillantes à la recherche de masse engloutis-
sant des sommes importantes (les sommes consacrées par les
U.S.A. à la recherche sont presque sept fois plus importantes
2. Cependant, on verra plus loin que, dans son discours, Matx a fixé
les limites de validité de son modèle.
les limites de validité de son modèle.
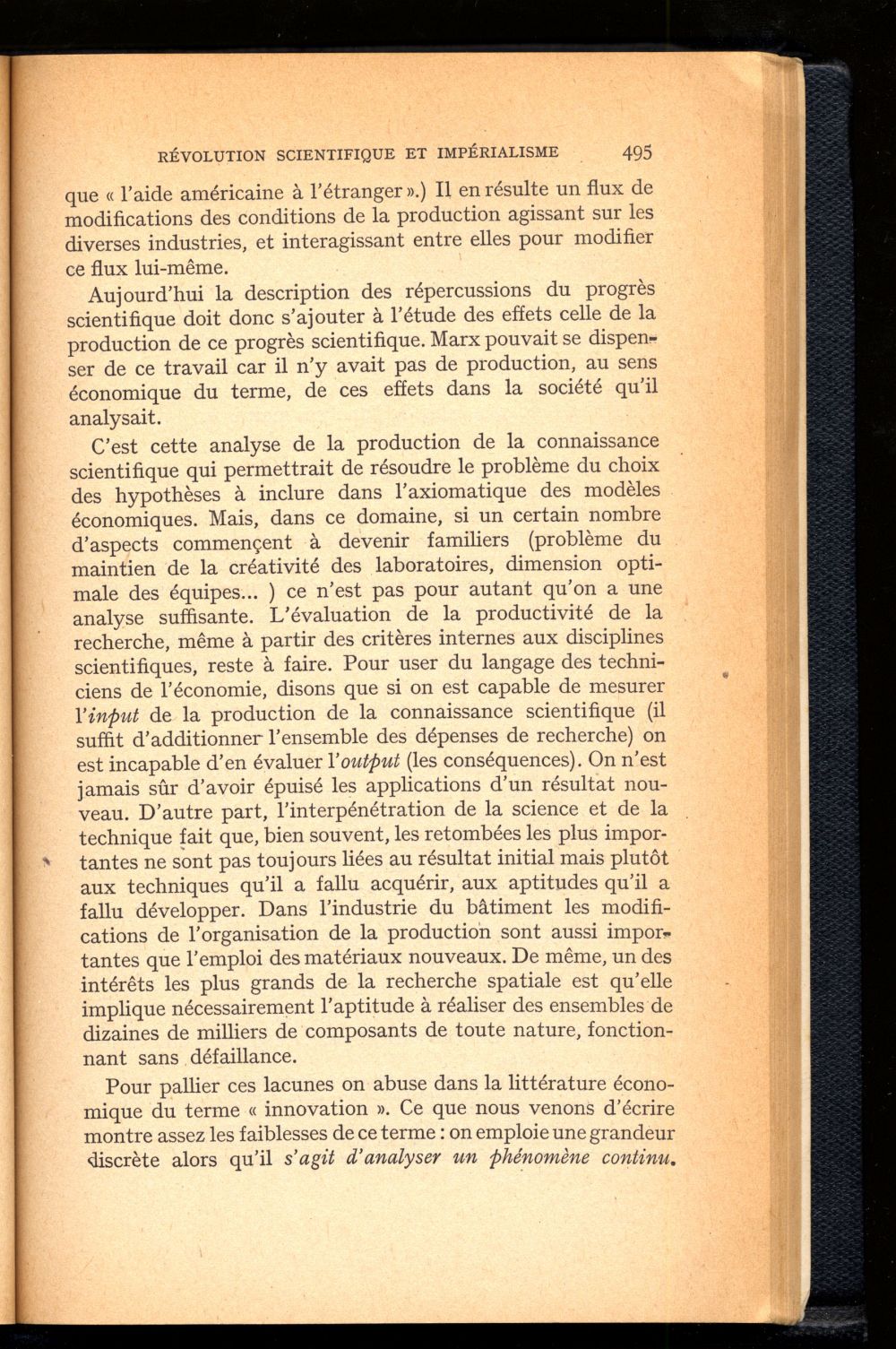

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
495
que « l'aide américaine à l'étranger».) Il en résulte un flux de
modifications des conditions de la production agissant sur les
diverses industries, et interagissant entre elles pour modifier
ce flux lui-même.
modifications des conditions de la production agissant sur les
diverses industries, et interagissant entre elles pour modifier
ce flux lui-même.
Aujourd'hui la description des répercussions du progrès
scientifique doit donc s'ajouter à l'étude des effets celle de la
production de ce progrès scientifique. Marx pouvait se dispen-
ser de ce travail car il n'y avait pas de production, au sens
économique du terme, de ces effets dans la société qu'il
analysait.
scientifique doit donc s'ajouter à l'étude des effets celle de la
production de ce progrès scientifique. Marx pouvait se dispen-
ser de ce travail car il n'y avait pas de production, au sens
économique du terme, de ces effets dans la société qu'il
analysait.
C'est cette analyse de la production de la connaissance
scientifique qui permettrait de résoudre le problème du choix
des hypothèses à inclure dans l'axiomatique des modèles
économiques. Mais, dans ce domaine, si un certain nombre
d'aspects commencent à devenir familiers (problème du
maintien de la créativité des laboratoires, dimension opti-
male des équipes... ) ce n'est pas pour autant qu'on a une
analyse suffisante. L'évaluation de la productivité de la
recherche, même à partir des critères internes aux disciplines
scientifiques, reste à faire. Pour user du langage des techni-
ciens de l'économie, disons que si on est capable de mesurer
Vinput de la production de la connaissance scientifique (il
suffit d'additionner l'ensemble des dépenses de recherche) on
est incapable d'en évaluer Youtput (les conséquences). On n'est
jamais sûr d'avoir épuisé les applications d'un résultat nou-
veau. D'autre part, l'interpénétration de la science et de la
technique fait que, bien souvent, les retombées les plus impor-
tantes ne sont pas toujours liées au résultat initial mais plutôt
aux techniques qu'il a fallu acquérir, aux aptitudes qu'il a
fallu développer. Dans l'industrie du bâtiment les modifi-
cations de l'organisation de la production sont aussi impor-
tantes que l'emploi des matériaux nouveaux. De même, un des
intérêts les plus grands de la recherche spatiale est qu'elle
implique nécessairement l'aptitude à réaliser des ensembles de
dizaines de milliers de composants de toute nature, fonction-
nant sans défaillance.
scientifique qui permettrait de résoudre le problème du choix
des hypothèses à inclure dans l'axiomatique des modèles
économiques. Mais, dans ce domaine, si un certain nombre
d'aspects commencent à devenir familiers (problème du
maintien de la créativité des laboratoires, dimension opti-
male des équipes... ) ce n'est pas pour autant qu'on a une
analyse suffisante. L'évaluation de la productivité de la
recherche, même à partir des critères internes aux disciplines
scientifiques, reste à faire. Pour user du langage des techni-
ciens de l'économie, disons que si on est capable de mesurer
Vinput de la production de la connaissance scientifique (il
suffit d'additionner l'ensemble des dépenses de recherche) on
est incapable d'en évaluer Youtput (les conséquences). On n'est
jamais sûr d'avoir épuisé les applications d'un résultat nou-
veau. D'autre part, l'interpénétration de la science et de la
technique fait que, bien souvent, les retombées les plus impor-
tantes ne sont pas toujours liées au résultat initial mais plutôt
aux techniques qu'il a fallu acquérir, aux aptitudes qu'il a
fallu développer. Dans l'industrie du bâtiment les modifi-
cations de l'organisation de la production sont aussi impor-
tantes que l'emploi des matériaux nouveaux. De même, un des
intérêts les plus grands de la recherche spatiale est qu'elle
implique nécessairement l'aptitude à réaliser des ensembles de
dizaines de milliers de composants de toute nature, fonction-
nant sans défaillance.
Pour pallier ces lacunes on abuse dans la littérature écono-
mique du terme « innovation ». Ce que nous venons d'écrire
montre assez les faiblesses de ce terme : on emploie une grandeur
discrète alors qu'il s'agit d'analyser un phénomène continu.
mique du terme « innovation ». Ce que nous venons d'écrire
montre assez les faiblesses de ce terme : on emploie une grandeur
discrète alors qu'il s'agit d'analyser un phénomène continu.
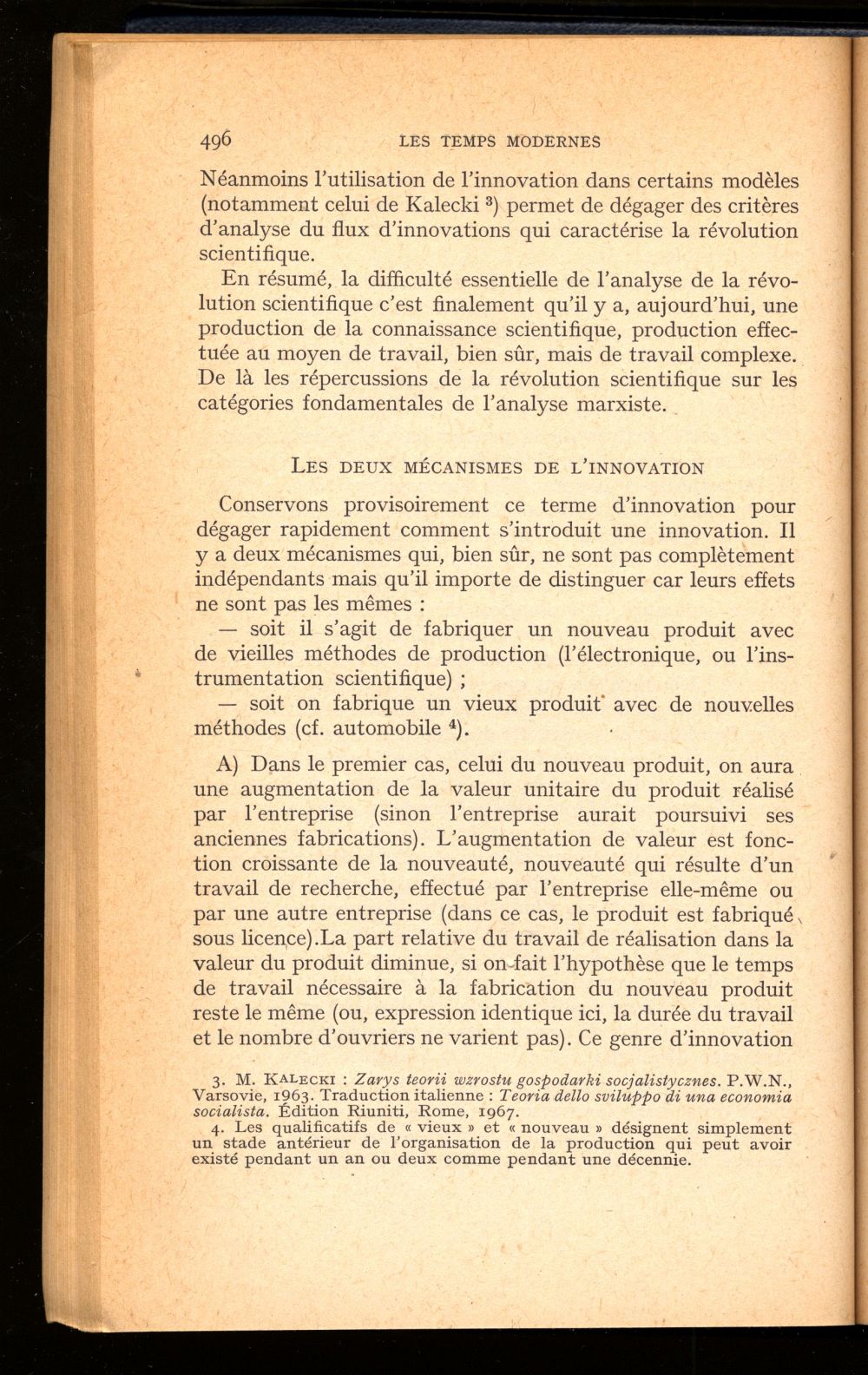

496
LES TEMPS MODERNES
Néanmoins l'utilisation de l'innovation dans certains modèles
(notamment celui de Kalecki3) permet de dégager des critères
d'analyse du flux d'innovations qui caractérise la révolution
scientifique.
(notamment celui de Kalecki3) permet de dégager des critères
d'analyse du flux d'innovations qui caractérise la révolution
scientifique.
En résumé, la difficulté essentielle de l'analyse de la révo-
lution scientifique c'est finalement qu'il y a, aujourd'hui, une
production de la connaissance scientifique, production effec-
tuée au moyen de travail, bien sûr, mais de travail complexe.
De là les répercussions de la révolution scientifique sur les
catégories fondamentales de l'analyse marxiste.
lution scientifique c'est finalement qu'il y a, aujourd'hui, une
production de la connaissance scientifique, production effec-
tuée au moyen de travail, bien sûr, mais de travail complexe.
De là les répercussions de la révolution scientifique sur les
catégories fondamentales de l'analyse marxiste.
LES DEUX MÉCANISMES DE L'INNOVATION
Conservons provisoirement ce terme d'innovation pour
dégager rapidement comment s'introduit une innovation. Il
y a deux mécanismes qui, bien sûr, ne sont pas complètement
indépendants mais qu'il importe de distinguer car leurs effets
ne sont pas les mêmes :
dégager rapidement comment s'introduit une innovation. Il
y a deux mécanismes qui, bien sûr, ne sont pas complètement
indépendants mais qu'il importe de distinguer car leurs effets
ne sont pas les mêmes :
— soit il s'agit de fabriquer un nouveau produit avec
de vieilles méthodes de production (l'électronique, ou l'ins-
trumentation scientifique) ;
de vieilles méthodes de production (l'électronique, ou l'ins-
trumentation scientifique) ;
— soit on fabrique un vieux produit' avec de nouvelles
méthodes (cf. automobile 4).
méthodes (cf. automobile 4).
A) Dans le premier cas, celui du nouveau produit, on aura
une augmentation de la valeur unitaire du produit réalisé
par l'entreprise (sinon l'entreprise aurait poursuivi ses
anciennes fabrications). L'augmentation de valeur est fonc-
tion croissante de la nouveauté, nouvea.uté qui résulte d'un
travail de recherche, effectué par l'entreprise elle-même ou
par une autre entreprise (dans ce cas, le produit est fabriqué.
sous licence).La part relative du travail de réalisation dans la
valeur du produit diminue, si on fait l'hypothèse que le temps
de travail nécessaire à la fabrication du nouveau produit
reste le même (ou, expression identique ici, la durée du travail
et le nombre d'ouvriers ne varient pas). Ce genre d'innovation
une augmentation de la valeur unitaire du produit réalisé
par l'entreprise (sinon l'entreprise aurait poursuivi ses
anciennes fabrications). L'augmentation de valeur est fonc-
tion croissante de la nouveauté, nouvea.uté qui résulte d'un
travail de recherche, effectué par l'entreprise elle-même ou
par une autre entreprise (dans ce cas, le produit est fabriqué.
sous licence).La part relative du travail de réalisation dans la
valeur du produit diminue, si on fait l'hypothèse que le temps
de travail nécessaire à la fabrication du nouveau produit
reste le même (ou, expression identique ici, la durée du travail
et le nombre d'ouvriers ne varient pas). Ce genre d'innovation
3. M. KALECKI : Zarys teorii wzrostit gospodarki socjalistycznes. P.W.N.,
Varsovie, 1963. Traduction italienne : Teoria dello sviluppo ai una economia
socialista. Édition Riuniti, Rome, 1967.
Varsovie, 1963. Traduction italienne : Teoria dello sviluppo ai una economia
socialista. Édition Riuniti, Rome, 1967.
4. Les qualificatifs de « vieux » et « nouveau » désignent simplement
un stade antérieur de l'organisation de la production qui peut avoir
existé pendant un an ou deux comme pendant une décennie.
un stade antérieur de l'organisation de la production qui peut avoir
existé pendant un an ou deux comme pendant une décennie.
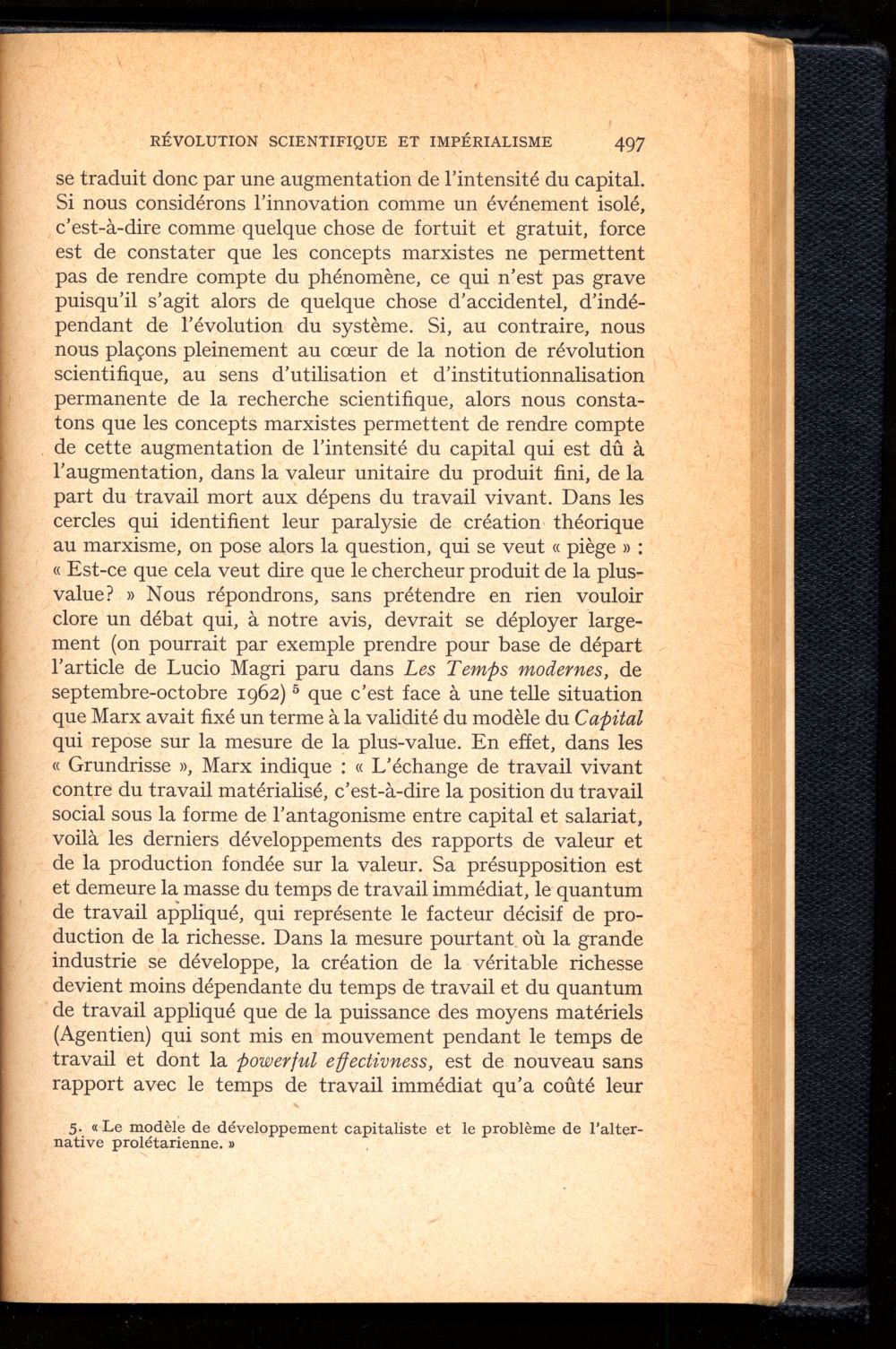

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
497
se traduit donc par une augmentation de l'intensité du capital.
Si nous considérons l'innovation comme un événement isolé,
c'est-à-dire comme quelque chose de fortuit et gratuit, force
est de constater que les concepts marxistes ne permettent
pas de rendre compte du phénomène, ce qui n'est pas grave
puisqu'il s'agit alors de quelque chose d'accidentel, d'indé-
pendant de l'évolution du système. Si, au contraire, nous
nous plaçons pleinement au cœur de la notion de révolution
scientifique, au sens d'utilisation et d'institutionnalisation
permanente de la recherche scientifique, alors nous consta-
tons que les concepts marxistes permettent de rendre compte
de cette augmentation de l'intensité du capital qui est dû à
l'augmentation, dans la valeur unitaire du produit fini, de la
part du travail mort aux dépens du travail vivant. Dans les
cercles qui identifient leur paralysie de création théorique
au marxisme, on pose alors la question, qui se veut « piège » :
« Est-ce que cela veut dire que le chercheur produit de la plus-
value? » Nous répondrons, sans prétendre en rien vouloir
clore un débat qui, à notre avis, devrait se déployer large-
ment (on pourrait par exemple prendre pour base de départ
l'article de Lucio Magri paru dans Les Temps modernes, de
septembre-octobre 1962) 5 que c'est face à une telle situation
que Marx avait fixé un terme à la validité du modèle du Capital
qui repose sur la mesure de la plus-value. En effet, dans les
« Grundrisse », Marx indique : « L'échange de travail vivant
contre du travail matérialisé, c'est-à-dire la position du travail
social sous la forme de l'antagonisme entre capital et salariat,
voilà les derniers développements des rapports de valeur et
de la production fondée sur la valeur. Sa présupposition est
et demeure la masse du temps de travail immédiat, le quantum
de travail appliqué, qui représente le facteur décisif de pro-
duction de la richesse. Dans la mesure pourtant où la grande
industrie se développe, la création de la véritable richesse
devient moins dépendante du temps de travail et du quantum
de travail appliqué que de la puissance des moyens matériels
(Agentien) qui sont mis en mouvement pendant le temps de
travail et dont la powerful effectivness, est de nouveau sans
rapport avec le temps de travail immédiat qu'a coûté leur
Si nous considérons l'innovation comme un événement isolé,
c'est-à-dire comme quelque chose de fortuit et gratuit, force
est de constater que les concepts marxistes ne permettent
pas de rendre compte du phénomène, ce qui n'est pas grave
puisqu'il s'agit alors de quelque chose d'accidentel, d'indé-
pendant de l'évolution du système. Si, au contraire, nous
nous plaçons pleinement au cœur de la notion de révolution
scientifique, au sens d'utilisation et d'institutionnalisation
permanente de la recherche scientifique, alors nous consta-
tons que les concepts marxistes permettent de rendre compte
de cette augmentation de l'intensité du capital qui est dû à
l'augmentation, dans la valeur unitaire du produit fini, de la
part du travail mort aux dépens du travail vivant. Dans les
cercles qui identifient leur paralysie de création théorique
au marxisme, on pose alors la question, qui se veut « piège » :
« Est-ce que cela veut dire que le chercheur produit de la plus-
value? » Nous répondrons, sans prétendre en rien vouloir
clore un débat qui, à notre avis, devrait se déployer large-
ment (on pourrait par exemple prendre pour base de départ
l'article de Lucio Magri paru dans Les Temps modernes, de
septembre-octobre 1962) 5 que c'est face à une telle situation
que Marx avait fixé un terme à la validité du modèle du Capital
qui repose sur la mesure de la plus-value. En effet, dans les
« Grundrisse », Marx indique : « L'échange de travail vivant
contre du travail matérialisé, c'est-à-dire la position du travail
social sous la forme de l'antagonisme entre capital et salariat,
voilà les derniers développements des rapports de valeur et
de la production fondée sur la valeur. Sa présupposition est
et demeure la masse du temps de travail immédiat, le quantum
de travail appliqué, qui représente le facteur décisif de pro-
duction de la richesse. Dans la mesure pourtant où la grande
industrie se développe, la création de la véritable richesse
devient moins dépendante du temps de travail et du quantum
de travail appliqué que de la puissance des moyens matériels
(Agentien) qui sont mis en mouvement pendant le temps de
travail et dont la powerful effectivness, est de nouveau sans
rapport avec le temps de travail immédiat qu'a coûté leur
5. « Le modèle de développement capitaliste et le problème de l'alter-
native prolétarienne. »
native prolétarienne. »
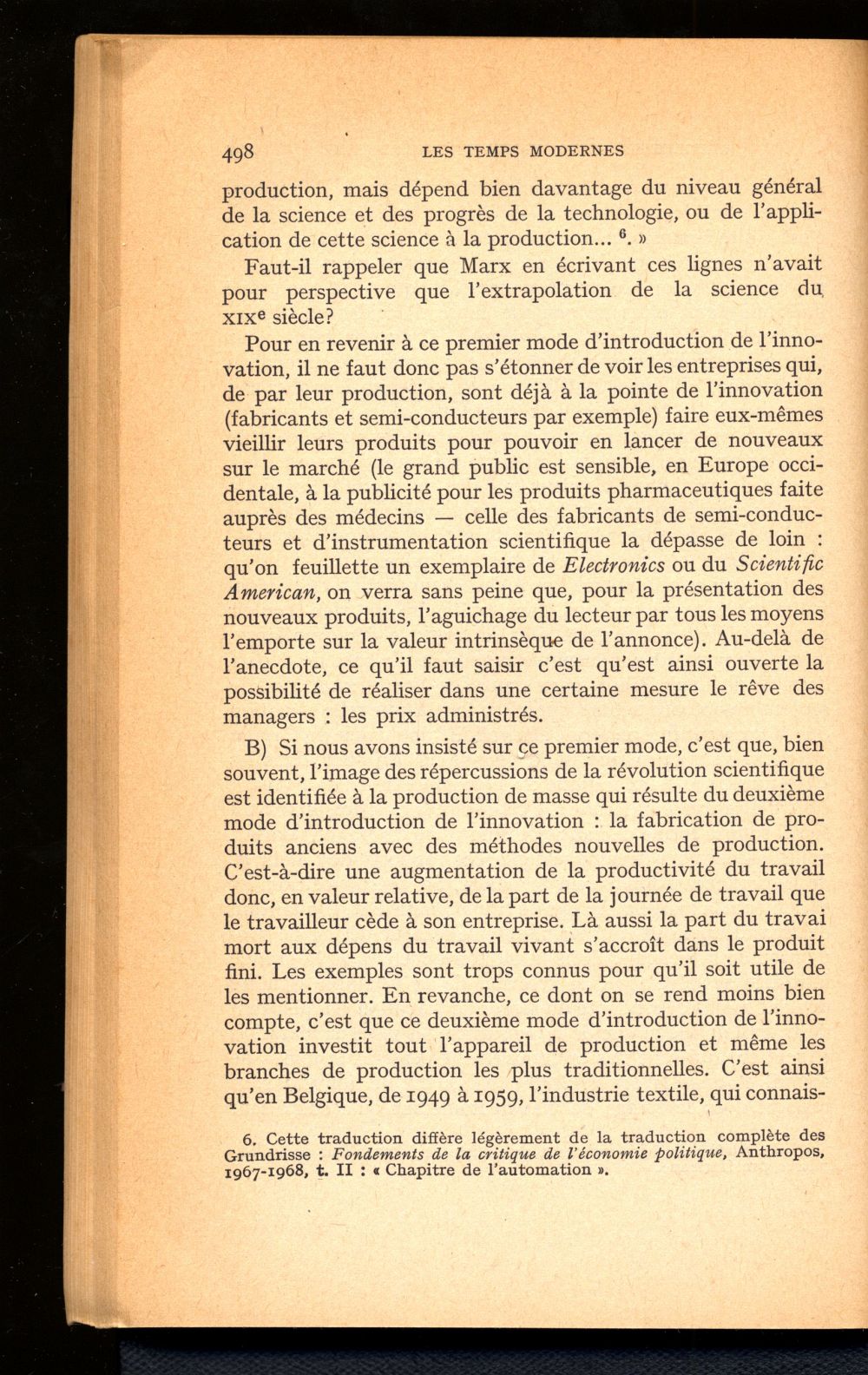

498
LES TEMPS MODERNES
production, mais dépend bien davantage du niveau général
de la science et des progrès de la technologie, ou de l'appli-
cation de cette science à la production... 6. »
de la science et des progrès de la technologie, ou de l'appli-
cation de cette science à la production... 6. »
Faut-il rappeler que Marx en écrivant ces lignes n'avait
pour perspective que l'extrapolation de la science du
xixe siècle?
pour perspective que l'extrapolation de la science du
xixe siècle?
Pour en revenir à ce premier mode d'introduction de l'inno-
vation, il ne faut donc pas s'étonner de voir les entreprises qui,
de par leur production, sont déjà à la pointe de l'innovation
(fabricants et semi-conducteurs par exemple) faire eux-mêmes
vieillir leurs produits pour pouvoir en lancer de nouveaux
sur le marché (le grand public est sensible, en Europe occi-
dentale, à la publicité pour les produits pharmaceutiques faite
auprès des médecins — celle des fabricants de semi-conduc-
teurs et d'instrumentation scientifique la dépasse de loin :
qu'on feuillette un exemplaire de Electronics ou du Scientific
American, on verra sans peine que, pour la présentation des
nouveaux produits, l'aguichage du lecteur par tous les moyens
l'emporte sur la valeur intrinsèque de l'annonce). Au-delà de
l'anecdote, ce qu'il faut saisir c'est qu'est ainsi ouverte la
possibilité de réaliser dans une certaine mesure le rêve des
managers : les prix administrés.
vation, il ne faut donc pas s'étonner de voir les entreprises qui,
de par leur production, sont déjà à la pointe de l'innovation
(fabricants et semi-conducteurs par exemple) faire eux-mêmes
vieillir leurs produits pour pouvoir en lancer de nouveaux
sur le marché (le grand public est sensible, en Europe occi-
dentale, à la publicité pour les produits pharmaceutiques faite
auprès des médecins — celle des fabricants de semi-conduc-
teurs et d'instrumentation scientifique la dépasse de loin :
qu'on feuillette un exemplaire de Electronics ou du Scientific
American, on verra sans peine que, pour la présentation des
nouveaux produits, l'aguichage du lecteur par tous les moyens
l'emporte sur la valeur intrinsèque de l'annonce). Au-delà de
l'anecdote, ce qu'il faut saisir c'est qu'est ainsi ouverte la
possibilité de réaliser dans une certaine mesure le rêve des
managers : les prix administrés.
B) Si nous avons insisté sur ce premier mode, c'est que, bien
souvent, l'image des répercussions de la révolution scientifique
est identifiée à la production de masse qui résulte du deuxième
mode d'introduction de l'innovation : la fabrication de pro-
duits anciens avec des méthodes nouvelles de production.
C'est-à-dire une augmentation de la productivité du travail
donc, en valeur relative, de la part de la journée de travail que
le travailleur cède à son entreprise. Là aussi la part du travai
mort aux dépens du travail vivant s'accroît dans le produit
fini. Les exemples sont trops connus pour qu'il soit utile de
les mentionner. En revanche, ce dont on se rend moins bien
compte, c'est que ce deuxième mode d'introduction de l'inno-
vation investit tout l'appareil de production et même les
branches de production les plus traditionnelles. C'est ainsi
qu'en Belgique, de 1949 à 1959, l'industrie textile, qui connais-
souvent, l'image des répercussions de la révolution scientifique
est identifiée à la production de masse qui résulte du deuxième
mode d'introduction de l'innovation : la fabrication de pro-
duits anciens avec des méthodes nouvelles de production.
C'est-à-dire une augmentation de la productivité du travail
donc, en valeur relative, de la part de la journée de travail que
le travailleur cède à son entreprise. Là aussi la part du travai
mort aux dépens du travail vivant s'accroît dans le produit
fini. Les exemples sont trops connus pour qu'il soit utile de
les mentionner. En revanche, ce dont on se rend moins bien
compte, c'est que ce deuxième mode d'introduction de l'inno-
vation investit tout l'appareil de production et même les
branches de production les plus traditionnelles. C'est ainsi
qu'en Belgique, de 1949 à 1959, l'industrie textile, qui connais-
6. Cette traduction diffère légèrement de la traduction complète des
Grundrisse : Fondements de la critique de l'économie politique, Anthropos,
1967-1968, t. II : « Chapitre de l'automation ».
Grundrisse : Fondements de la critique de l'économie politique, Anthropos,
1967-1968, t. II : « Chapitre de l'automation ».
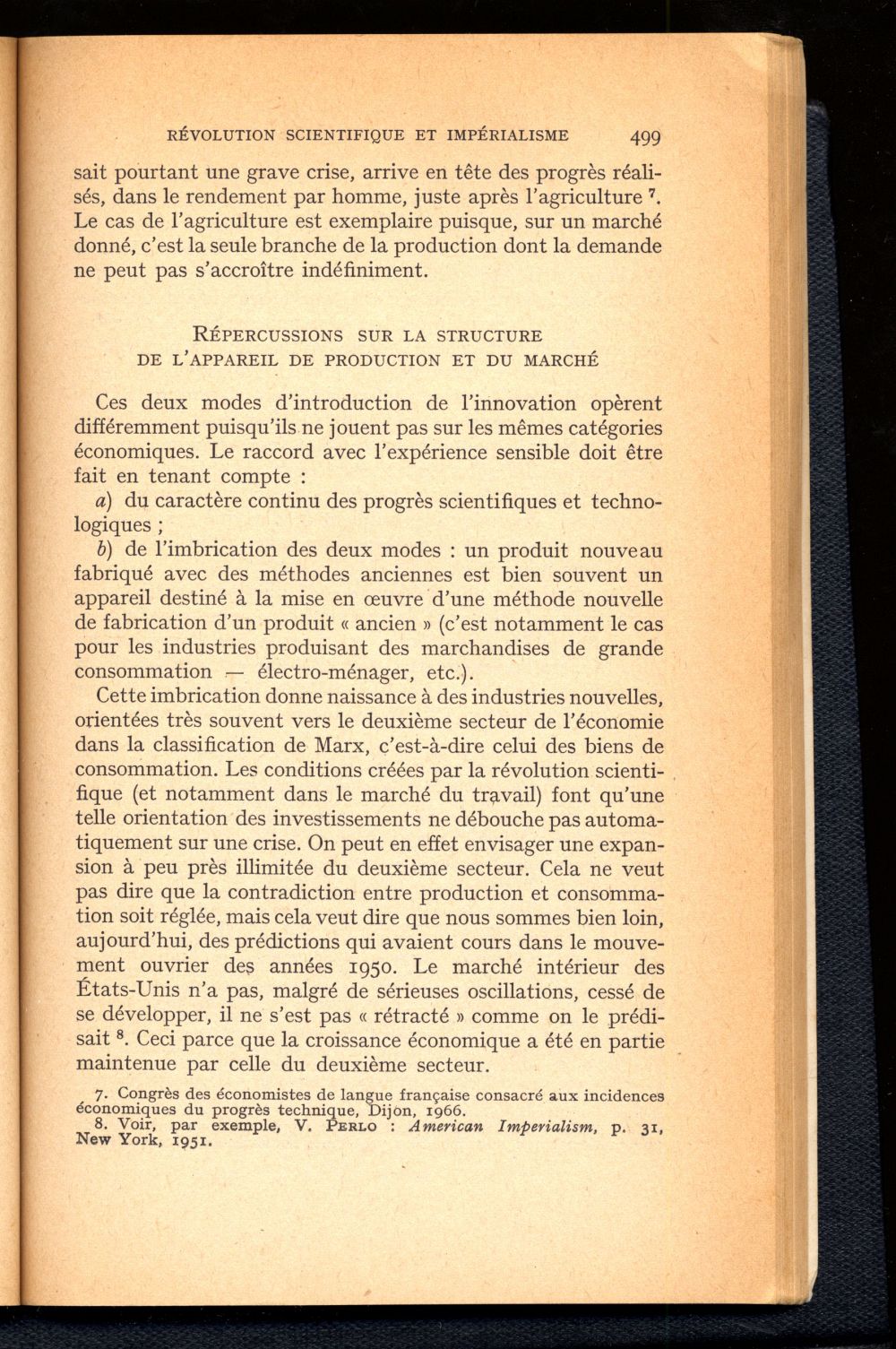

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
499
sait pourtant une grave crise, arrive en tête des progrès réali-
sés, dans le rendement par homme, juste après l'agriculture 7.
Le cas de l'agriculture est exemplaire puisque, sur un marché
donné, c'est la seule branche de la production dont la demande
ne peut pas s'accroître indéfiniment.
sés, dans le rendement par homme, juste après l'agriculture 7.
Le cas de l'agriculture est exemplaire puisque, sur un marché
donné, c'est la seule branche de la production dont la demande
ne peut pas s'accroître indéfiniment.
RÉPERCUSSIONS SUR LA STRUCTURE
DE L'APPAREIL DE PRODUCTION ET DU MARCHÉ
DE L'APPAREIL DE PRODUCTION ET DU MARCHÉ
Ces deux modes d'introduction de l'innovation opèrent
différemment puisqu'ils ne jouent pas sur les mêmes catégories
économiques. Le raccord avec l'expérience sensible doit être
fait en tenant compte :
différemment puisqu'ils ne jouent pas sur les mêmes catégories
économiques. Le raccord avec l'expérience sensible doit être
fait en tenant compte :
a) du caractère continu des progrès scientifiques et techno-
logiques ;
logiques ;
b) de l'imbrication des deux modes : un produit nouveau
fabriqué avec des méthodes anciennes est bien souvent un
appareil destiné à la mise en œuvre d'une méthode nouvelle
de fabrication d'un produit « ancien » (c'est notamment le cas
pour les industries produisant des marchandises de grande
consommation — électro-ménager, etc.).
fabriqué avec des méthodes anciennes est bien souvent un
appareil destiné à la mise en œuvre d'une méthode nouvelle
de fabrication d'un produit « ancien » (c'est notamment le cas
pour les industries produisant des marchandises de grande
consommation — électro-ménager, etc.).
Cette imbrication donne naissance à des industries nouvelles,
orientées très souvent vers le deuxième secteur de l'économie
dans la classification de Marx, c'est-à-dire celui des biens de
consommation. Le? conditions créées par la révolution scienti-
fique (et notamment dans le marché du travail) font qu'une
telle orientation des investissements ne débouche pas automa-
tiquement sur une crise. On peut en effet envisager une expan-
sion à peu près illimitée du deuxième secteur. Cela ne veut
pas dire que la contradiction entre production et consomma-
tion soit réglée, mais cela veut dire que nous sommes bien loin,
aujourd'hui, des prédictions qui avaient cours dans le mouve-
ment ouvrier des années 1950. Le marché intérieur des
États-Unis n'a pas, malgré de sérieuses oscillations, cessé de
se développer, il ne s'est pas « rétracté » comme on le prédi-
sait 8. Ceci parce que la croissance économique a été en partie
maintenue par celle du deuxième secteur.
orientées très souvent vers le deuxième secteur de l'économie
dans la classification de Marx, c'est-à-dire celui des biens de
consommation. Le? conditions créées par la révolution scienti-
fique (et notamment dans le marché du travail) font qu'une
telle orientation des investissements ne débouche pas automa-
tiquement sur une crise. On peut en effet envisager une expan-
sion à peu près illimitée du deuxième secteur. Cela ne veut
pas dire que la contradiction entre production et consomma-
tion soit réglée, mais cela veut dire que nous sommes bien loin,
aujourd'hui, des prédictions qui avaient cours dans le mouve-
ment ouvrier des années 1950. Le marché intérieur des
États-Unis n'a pas, malgré de sérieuses oscillations, cessé de
se développer, il ne s'est pas « rétracté » comme on le prédi-
sait 8. Ceci parce que la croissance économique a été en partie
maintenue par celle du deuxième secteur.
7. Congrès des économistes de langue française consacré aux incidences
économiques du progrès technique, Dijon, 1966.
économiques du progrès technique, Dijon, 1966.
8. Voir, par exemple, V. PBRLO : American Imperialism, p. 31,
New York, 1951.
New York, 1951.
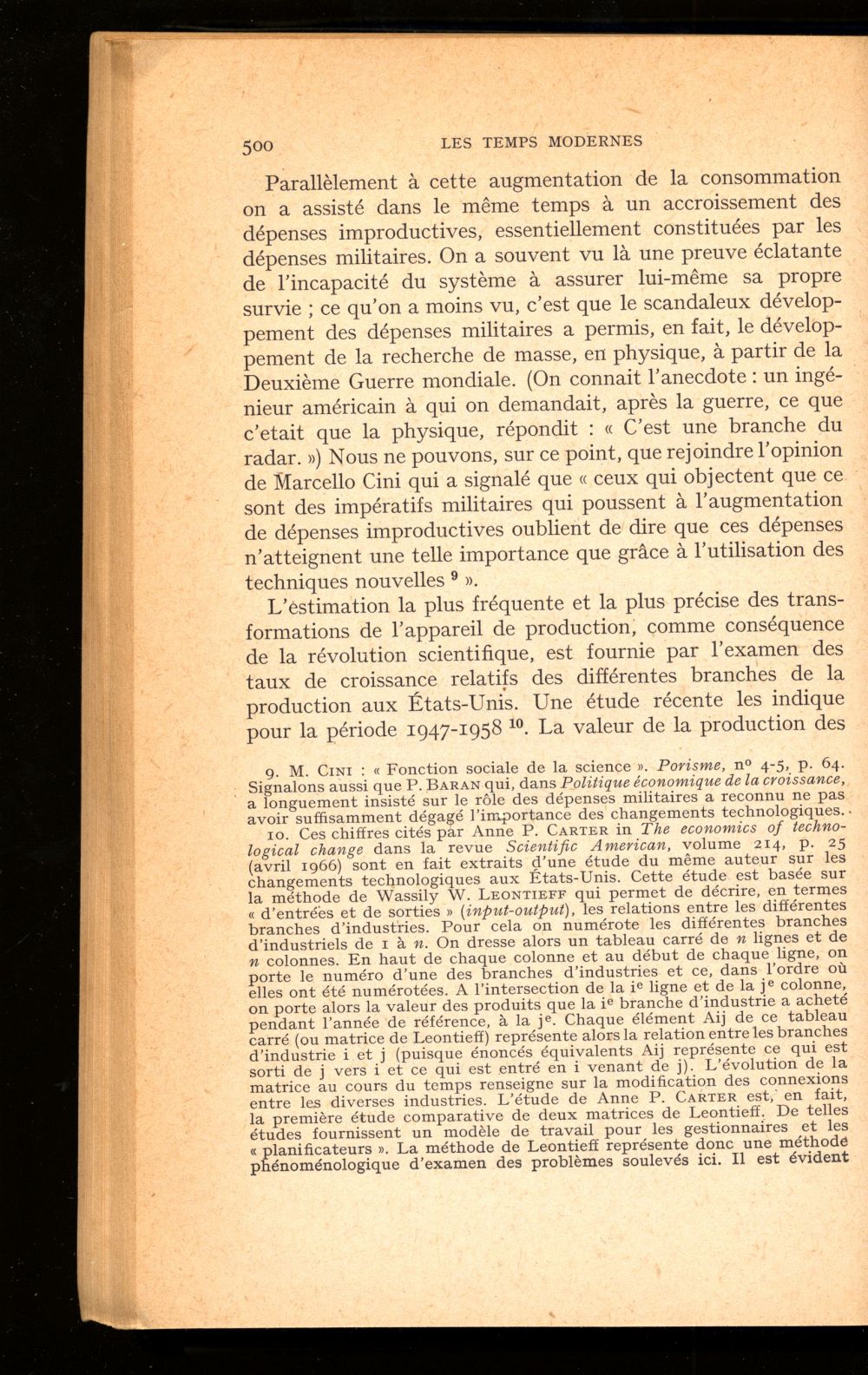

5oo
LES TEMPS MODERNES
Parallèlement à cette augmentation de la consommation
on a assisté clans le même temps à un accroissement des
dépenses improductives, essentiellement constituées par les
dépenses militaires. On a souvent vu là une preuve éclatante
de l'incapacité du système à assurer lui-même sa propre
survie ; ce qu'on a moins vu, c'est que le scandaleux dévelop-
pement des dépenses militaires a permis, en fait, le dévelop-
pement de la recherche de masse, en physique, à partir de la
Deuxième Guerre mondiale. (On connait l'anecdote : un ingé-
nieur américain à qui on demandait, après la guerre, ce que
c'était que la physique, répondit : « C'est une branche du
radar. ») Nous ne pouvons, sur ce point, que rejoindre l'opinion
de Marcello Cini qui a signalé que « ceux qui objectent que ce
sont des impératifs militaires qui poussent à l'augmentation
de dépenses improductives oublient de dire que ces dépenses
n'atteignent une telle importance que grâce à l'utilisation des
techniques nouvelles 9 ».
on a assisté clans le même temps à un accroissement des
dépenses improductives, essentiellement constituées par les
dépenses militaires. On a souvent vu là une preuve éclatante
de l'incapacité du système à assurer lui-même sa propre
survie ; ce qu'on a moins vu, c'est que le scandaleux dévelop-
pement des dépenses militaires a permis, en fait, le dévelop-
pement de la recherche de masse, en physique, à partir de la
Deuxième Guerre mondiale. (On connait l'anecdote : un ingé-
nieur américain à qui on demandait, après la guerre, ce que
c'était que la physique, répondit : « C'est une branche du
radar. ») Nous ne pouvons, sur ce point, que rejoindre l'opinion
de Marcello Cini qui a signalé que « ceux qui objectent que ce
sont des impératifs militaires qui poussent à l'augmentation
de dépenses improductives oublient de dire que ces dépenses
n'atteignent une telle importance que grâce à l'utilisation des
techniques nouvelles 9 ».
L'estimation la plus fréquente et la plus précise des trans-
formations de l'appareil de production, comme conséquence
de la révolution scientifique, est fournie par l'examen des
taux de croissance relatifs des différentes branches de la
production aux États-Unis. Une étude récente les indique
pour la période 1947-1958 10. La valeur de la production des
formations de l'appareil de production, comme conséquence
de la révolution scientifique, est fournie par l'examen des
taux de croissance relatifs des différentes branches de la
production aux États-Unis. Une étude récente les indique
pour la période 1947-1958 10. La valeur de la production des
g. M. CINI : « Fonction sociale de la science ». Porisme, n° 4-5, p. 64.
Signalons aussi que T. BARAN qui, dans Politique économique de la croissance,
a longuement insisté sur le rôle des dépenses militaires a reconnu ne pas
avoir suffisamment dégage l'importance des changements technologiques.-
Signalons aussi que T. BARAN qui, dans Politique économique de la croissance,
a longuement insisté sur le rôle des dépenses militaires a reconnu ne pas
avoir suffisamment dégage l'importance des changements technologiques.-
10. Ces chiffres cités par Anne P. CARTER in The économies of techno-
logical change dans la revue Scientific American, volume 214, p. 25
(avril 1966) sont en fait extraits d'une étude du même auteur sur les
changements technologiques aux États-Unis. Cette étude est basée sur
la méthode de Wassily W. LEONTIEFF qui permet de décrire, en termes
« d'entrées et de sorties » (input-output), les relations entre les différentes
branches d'industries. Pour cela on numérote les différentes branches
d'industriels de i à n. On dresse alors un tableau carré de n lignes et de
n colonnes. En haut de chaque colonne et au début de chaque ligne, on
porte le numéro d'une des branches d'industries et ce, dans l'ordre où
elles ont été numérotées. A l'intersection de la ic ligne et de la jc colonne,
on porte alors la valeur des produits que la i° branche d'industrie a acheté
pendant l'année de référence, à la je. Chaque élément Aij de ce tableau
carré (ou matrice de Leontieff) représente alors la relation entre les branches
d'industrie i et j (puisque énoncés équivalents Aij représente ce qui est
sorti de j vers i et ce qui est entré en i venant de j). L'évolution de la
matrice an cours du temps renseigne sur la modification des connexions
entre les diverses industries. L'étude de Anne P. CARTER est, en fait,
la première étude comparative de deux matrices de Leontieff. De telles
études fournissent un modèle de travail pour les gestionnaires et les
« planificateurs ». La méthode de Leontiefi représente donc une méthode
phénoménologique d'examen des problèmes soulevés ici. Il est évident
logical change dans la revue Scientific American, volume 214, p. 25
(avril 1966) sont en fait extraits d'une étude du même auteur sur les
changements technologiques aux États-Unis. Cette étude est basée sur
la méthode de Wassily W. LEONTIEFF qui permet de décrire, en termes
« d'entrées et de sorties » (input-output), les relations entre les différentes
branches d'industries. Pour cela on numérote les différentes branches
d'industriels de i à n. On dresse alors un tableau carré de n lignes et de
n colonnes. En haut de chaque colonne et au début de chaque ligne, on
porte le numéro d'une des branches d'industries et ce, dans l'ordre où
elles ont été numérotées. A l'intersection de la ic ligne et de la jc colonne,
on porte alors la valeur des produits que la i° branche d'industrie a acheté
pendant l'année de référence, à la je. Chaque élément Aij de ce tableau
carré (ou matrice de Leontieff) représente alors la relation entre les branches
d'industrie i et j (puisque énoncés équivalents Aij représente ce qui est
sorti de j vers i et ce qui est entré en i venant de j). L'évolution de la
matrice an cours du temps renseigne sur la modification des connexions
entre les diverses industries. L'étude de Anne P. CARTER est, en fait,
la première étude comparative de deux matrices de Leontieff. De telles
études fournissent un modèle de travail pour les gestionnaires et les
« planificateurs ». La méthode de Leontiefi représente donc une méthode
phénoménologique d'examen des problèmes soulevés ici. Il est évident
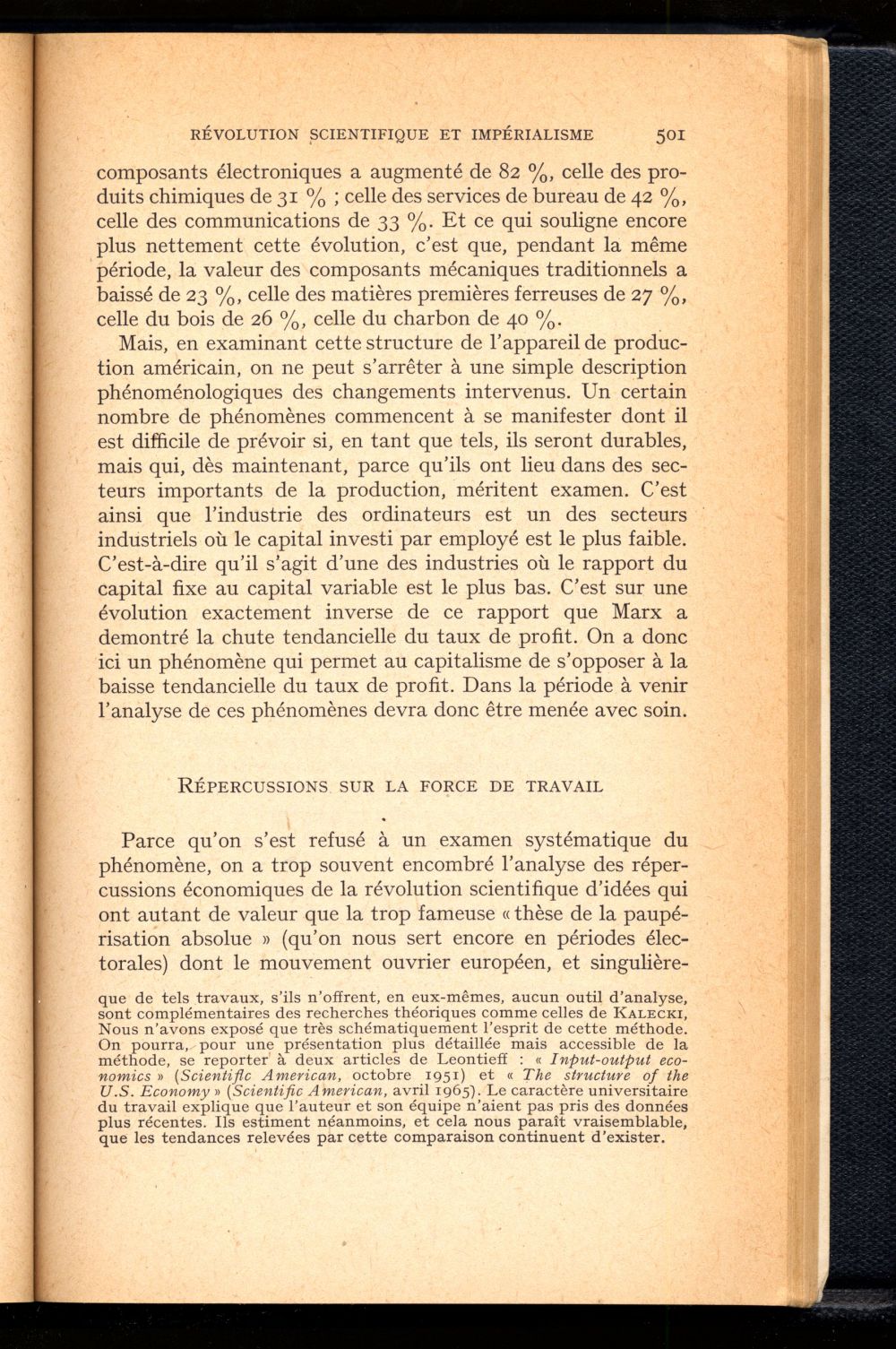

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
501
composants électroniques a augmenté de 82 %, celle des pro-
duits chimiques de 31 % ; celle des services de bureau de 42 %,
celle des communications de 33 %. Et ce qui souligne encore
plus nettement cette évolution, c'est que, pendant la même
période, la valeur des composants mécaniques traditionnels a
baissé de 23 %, celle des matières premières ferreuses de 27 %,
celle du bois de 26 %, celle du charbon de 40 %.
duits chimiques de 31 % ; celle des services de bureau de 42 %,
celle des communications de 33 %. Et ce qui souligne encore
plus nettement cette évolution, c'est que, pendant la même
période, la valeur des composants mécaniques traditionnels a
baissé de 23 %, celle des matières premières ferreuses de 27 %,
celle du bois de 26 %, celle du charbon de 40 %.
Mais, en examinant cette structure de l'appareil de produc-
tion américain, on ne peut s'arrêter à une simple description
phénoménologiques des changements intervenus. Un certain
nombre de phénomènes commencent à se manifester dont il
est difficile de prévoir si, en tant que tels, ils seront durables,
mais qui, dès maintenant, parce qu'ils ont lieu dans des sec-
teurs importants de la production, méritent examen. C'est
ainsi que l'industrie des ordinateurs est un des secteurs
industriels où le capital investi par employé est le plus faible.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une des industries où le rapport du
capital fixe au capital variable est le plus bas. C'est sur une
évolution exactement inverse de ce rapport que Marx a
démontré la chute tendancielle du taux de profit. On a donc
ici un phénomène qui permet au capitalisme de s'opposer à la
baisse tendancielle du taux de profit. Dans la période à venir
l'analyse de ces phénomènes devra donc être menée avec soin.
tion américain, on ne peut s'arrêter à une simple description
phénoménologiques des changements intervenus. Un certain
nombre de phénomènes commencent à se manifester dont il
est difficile de prévoir si, en tant que tels, ils seront durables,
mais qui, dès maintenant, parce qu'ils ont lieu dans des sec-
teurs importants de la production, méritent examen. C'est
ainsi que l'industrie des ordinateurs est un des secteurs
industriels où le capital investi par employé est le plus faible.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'une des industries où le rapport du
capital fixe au capital variable est le plus bas. C'est sur une
évolution exactement inverse de ce rapport que Marx a
démontré la chute tendancielle du taux de profit. On a donc
ici un phénomène qui permet au capitalisme de s'opposer à la
baisse tendancielle du taux de profit. Dans la période à venir
l'analyse de ces phénomènes devra donc être menée avec soin.
RÉPERCUSSIONS SUR LA FORCE DE TRAVAIL
Parce qu'on s'est refusé à un examen systématique du
phénomène, on a trop souvent encombré l'analyse des réper-
cussions économiques de la révolution scientifique d'idées qui
ont autant de valeur que la trop fameuse « thèse de la paupé-
risation absolue » (qu'on nous sert encore en périodes élec-
torales) dont le mouvement ouvrier européen, et singulière-
phénomène, on a trop souvent encombré l'analyse des réper-
cussions économiques de la révolution scientifique d'idées qui
ont autant de valeur que la trop fameuse « thèse de la paupé-
risation absolue » (qu'on nous sert encore en périodes élec-
torales) dont le mouvement ouvrier européen, et singulière-
que de tels travaux, s'ils n'offrent, en eux-mêmes, aucun outil d'analyse,
sont complémentaires des recherches théoriques comme celles de KALECKI,
Nous n'avons exposé que très schcmatiqucmcnt l'esprit de cette méthode.
On pourra, pour une présentation plus détaillée mais accessible de la
méthode, se reporter à deux articles de "Lcoiitieff : « Input-output éco-
nomies » (Scientiflc American, octobre 1951) et « The structure of thé
U.S. Economy » (Scientific American, avril 1965'). Le caractère universitaire
du travail explique que l'auteur et son équipe n'aient pas pris des données
plus récentes. Ils estiment néanmoins, et cela nous paraît vraisemblable,
que les tendances relevées par cette comparaison continuent d'exister.
sont complémentaires des recherches théoriques comme celles de KALECKI,
Nous n'avons exposé que très schcmatiqucmcnt l'esprit de cette méthode.
On pourra, pour une présentation plus détaillée mais accessible de la
méthode, se reporter à deux articles de "Lcoiitieff : « Input-output éco-
nomies » (Scientiflc American, octobre 1951) et « The structure of thé
U.S. Economy » (Scientific American, avril 1965'). Le caractère universitaire
du travail explique que l'auteur et son équipe n'aient pas pris des données
plus récentes. Ils estiment néanmoins, et cela nous paraît vraisemblable,
que les tendances relevées par cette comparaison continuent d'exister.
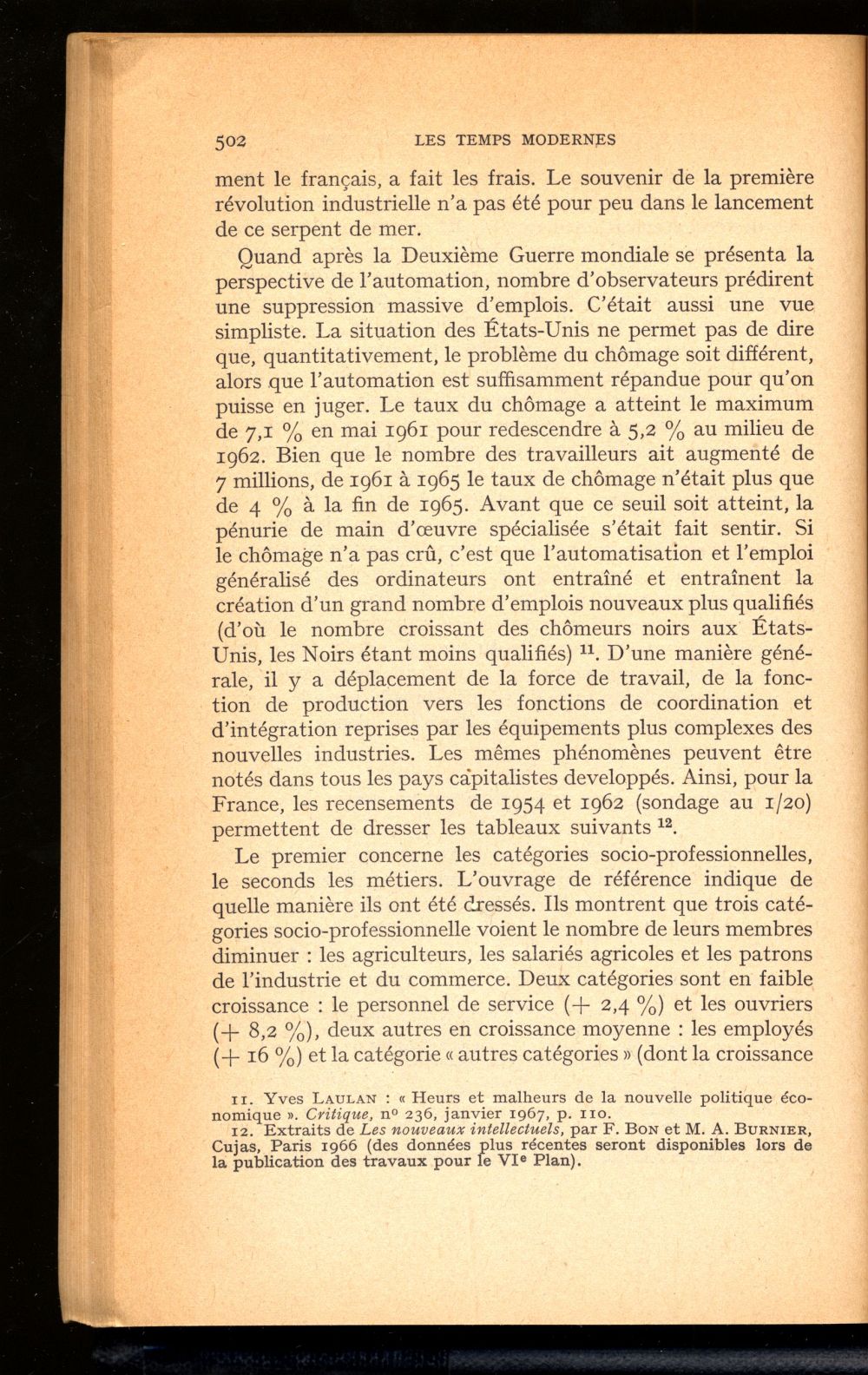

502
LES TEMPS MODERNES
ment le français, a fait les frais. Le souvenir de la première
révolution industrielle n'a pas été pour peu dans le lancement
de ce serpent de mer.
révolution industrielle n'a pas été pour peu dans le lancement
de ce serpent de mer.
Quand après la Deuxième Guerre mondiale se présenta la
perspective de l'automation, nombre d'observateurs prédirent
une suppression massive d'emplois. C'était aussi une vue
simpliste. La situation des États-Unis ne permet pas de dire
que, quantitativement, le problème du chômage soit différent,
alors que l'automation est suffisamment répandue pour qu'on
puisse en juger. Le taux du chômage a atteint le maximum
de 7,1 % en mai 1961 pour redescendre à 5,2 % au milieu de
1962. Bien que le nombre des travailleurs ait augmenté de
7 millions, de 1961 à 1965 le taux de chômage n'était plus que
de 4 % à la fin de 1965. Avant que ce seuil soit atteint, la
pénurie de main d'œuvre spécialisée s'était fait sentir. Si
le chômage n'a pas crû, c'est que l'automatisation et l'emploi
généralisé des ordinateurs ont entraîné et entraînent la
création d'un grand nombre d'emplois nouveaux plus qualifiés
(d'où le nombre croissant des chômeurs noirs aux Etats-
Unis, les Noirs étant moins qualifiés) n. D'une manière géné-
rale, il y a déplacement de la force de travail, de la fonc-
tion de production vers les fonctions de coordination et
d'intégration reprises par les équipements plus complexes des
nouvelles industries. Les mêmes phénomènes peuvent être
notés dans tous les pays capitalistes développés. Ainsi, pour la
France, les recensements de 1954 et 1962 (sondage au 1/20)
permettent de dresser les tableaux suivants 12.
Le premier concerne les catégories socio-professionnelles,
le seconds les métiers. L'ouvrage de référence indique de
quelle manière ils ont été dressés. Ils montrent que trois caté-
gories socio-professionnelle voient le nombre de leurs membres
diminuer : les agriculteurs, les salariés agricoles et les patrons
de l'industrie et du commerce. Deux catégories sont en faible
croissance : le personnel de service (+ 2,4 %) et les ouvriers
(4- 8,2 %), deux autres en croissance moyenne : les employés
le seconds les métiers. L'ouvrage de référence indique de
quelle manière ils ont été dressés. Ils montrent que trois caté-
gories socio-professionnelle voient le nombre de leurs membres
diminuer : les agriculteurs, les salariés agricoles et les patrons
de l'industrie et du commerce. Deux catégories sont en faible
croissance : le personnel de service (+ 2,4 %) et les ouvriers
(4- 8,2 %), deux autres en croissance moyenne : les employés
16
et la catégorie « autres catégories » (dont la croissance
11. Yves LAULAN : « Heurs et malheurs de la nouvelle politique éco-
nomique ». Critique, n° 236, janvier 1967, p. no.
nomique ». Critique, n° 236, janvier 1967, p. no.
12. Extraits de Les nouveaux intellectuels, par F. BON et M. A. BURNIER,
Cujas, Paris 1966 (des données plus récentes seront disponibles lors de
la publication des travaux pour le VIe Plan).
Cujas, Paris 1966 (des données plus récentes seront disponibles lors de
la publication des travaux pour le VIe Plan).
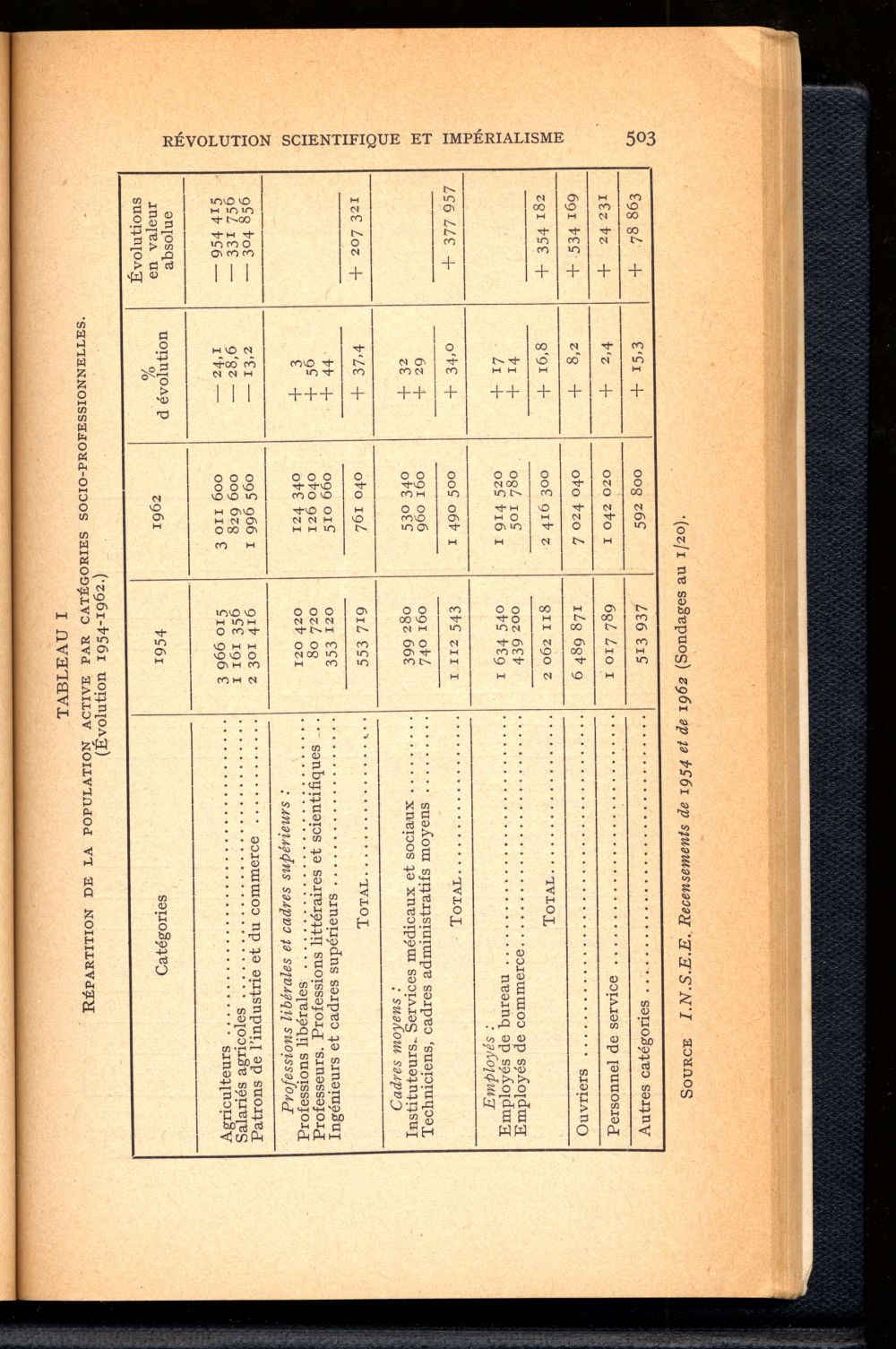

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
503
p
<<
w
_1
w
<<
w
_1
w
<5
H
H
fc'W
"^
i
IN.
in^i
5v£
5
5v£
5
i— i
'O
01
Q!
M
CO
Q!
M
CO
ri 1-1
M 1
n u
O
M 1
n u
O
Ol
O
co
O
CO
O
CO
.2 S §
TJ- i:
TJ- i:
D
ro
M
i— i
Ol
co
i— i
Ol
co
"^ 'rt 'n
^" !•
-i i
^~
^" !•
-i i
^~
j^.
t-^
TJ-
T^-
-rj-
co
T^-
-rj-
co
«3 K* W
in c
oc
)
in c
oc
)
O
m
ir~i
CO
01
£^,
CO
01
£^,
Js-s
O^ o
o oo
1
O^ o
o oo
1
01
+
rO
:
+
+
:
+
+
G _O
4J
Hl VO 01
-t-co" cô
COO ^1-
t
4J
Hl VO 01
-t-co" cô
COO ^1-
t
O
1
CO 1 01
O 00
^.
<?
CO 1 01
O 00
^.
<?
°Sro
01 Ol M
i
in^j-
ro
rooi
co
H M
H
01 Ol M
i
in^j-
ro
rooi
co
H M
H
M
s
+ +
+
+
o o o
000
O
O O
O
O O
o
o
o
o
000
O
O O
O
O O
o
o
o
o
o c
2 ^
3
2 ^
3
O
01 CO
o
01 CO
o
M
0
0
01
MD^
3 L
n
ro O O
O
ro H
MD^
3 L
n
ro O O
O
ro H
m
o
O
00
o
O
00
o
M C
^^
3
^-o o
H
0 0
o
•^t- H
o
^j-
01
Ol
M C
^^
3
^-o o
H
0 0
o
•^t- H
o
^j-
01
Ol
^t C
7>
01 01 M
O
rO'O
7>
01 01 M
O
rO'O
M O
IH
o co ai
M HI in
o co ai
M HI in
in c~i
T^-
O^ in
^
o
o
*n
T^-
O^ in
^
o
o
*n
co
h
-t
h
-t
M
H
« | 0
H
« | 0
3 \i
5
O o o
5
O o o
o o
ro
o o
co
M
ro
o o
co
M
n i-
01 01 01
M
co o
M
co o
^t" O
00
CO
CO
,-j-
o
•o
^f
•^- t>- Hl
c^
O! H
"n
o
•o
^f
•^- t>- Hl
c^
O! H
"n
M
00
00
CTi
in
vO
H
H
O O co
ro
c^ o
Ol
Vf o
01
Ol
^
CO
vO
H
H
O O co
ro
c^ o
Ol
Vf o
01
Ol
^
CO
o\.
D
2
01 co 'n
in
D
2
01 co 'n
in
M
ro ro
ro ro
GO
l-l
M
l-l
M
H r
•o
M CO
in
CO l>-
H
<o ^t-
O
•^
o
in
•o
M CO
in
CO l>-
H
<o ^t-
O
•^
o
in
CO
M
M
M
M
"
M
01
0
Ht
M
01
0
Ht
en
co ^
^ w rt v
^ w rt v
O
'S W
go
'S W
go
i-l
-Sn "O
Sa
-Sn "O
Sa
a
§ 03 '.
"o43
§ 03 '.
"o43
05
o
o
s
o
01 .rt " <
3 ^ H
o
01 .rt " <
3 ^ H
i-3 < H
J
^ v^ =3 O
rt 4J O
^ v^ =3 O
rt 4J O
Û
o
3
§ J.2 H
3 -a H
§ J.2 H
3 -a H
H
c3 0
Agriculteurs .......... Salariés agricoles ...... Patrons de l'industrie et
Professions libérales ei Professions libérales . . . Professeurs. Professions 1 Ingénieurs et cadres supc
Cadres moyens : Instituteurs. Services me Techniciens, cadres admi
Employés : Employés de bureau . . . Employés de commerce.
Agriculteurs .......... Salariés agricoles ...... Patrons de l'industrie et
Professions libérales ei Professions libérales . . . Professeurs. Professions 1 Ingénieurs et cadres supc
Cadres moyens : Instituteurs. Services me Techniciens, cadres admi
Employés : Employés de bureau . . . Employés de commerce.
Ouvriers .............
Personnel de service . . .
Autres catégories ......
Personnel de service . . .
Autres catégories ......
S1
hj
tq
tq
00
W
O
O
PS
p
o
co
p
o
co
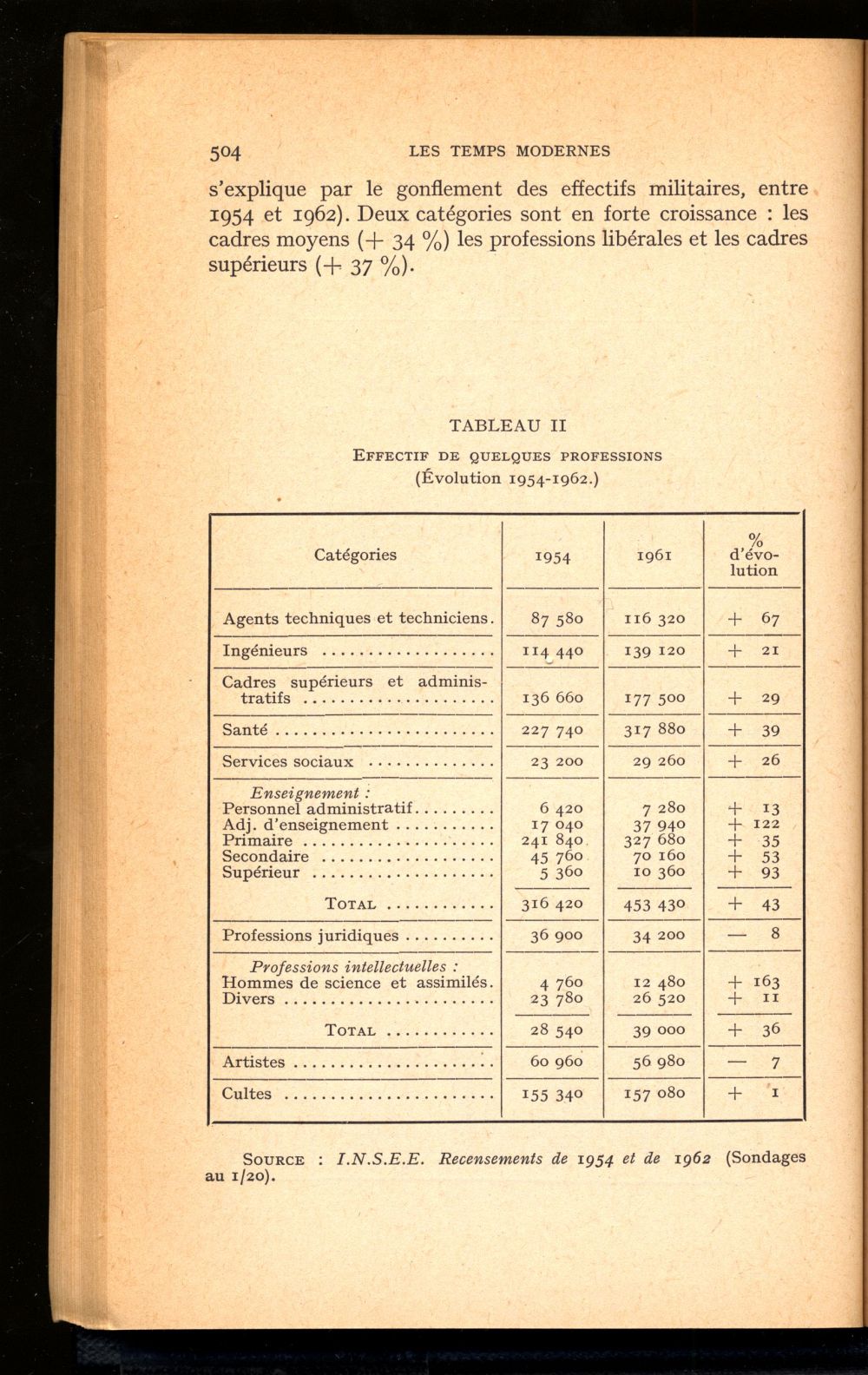

504
LES TEMPS MODERNES
s'explique par le gonflement des effectifs militaires, entre
1954 et 1962). Deux catégories sont en forte croissance : les
cadres moyens (+ 34 %) les professions libérales et les cadres
supérieurs (+ 37 %).
1954 et 1962). Deux catégories sont en forte croissance : les
cadres moyens (+ 34 %) les professions libérales et les cadres
supérieurs (+ 37 %).
TABLEAU II
EFFECTIF DE QUELQUES PROFESSIONS
(Évolution 1954-1962.)
(Évolution 1954-1962.)
Catégories
1954
IQ6l
%
d'évolution
1954
IQ6l
%
d'évolution
Agents techniques et techniciens .
87 580
116 320
+ 67
87 580
116 320
+ 67
Cadres supérieurs et adminis-
4- 2Q
317 880
-1- 3Q
-1- 3Q
-4- 26
Enseignement :
7 280
+ n
+ n
17 OAO
37 940
+ 122
37 940
+ 122
Primaire ................
241 840
327 680
+ 35
241 840
327 680
+ 35
Secondaire ...................
45 760
70 160
+ 53
45 760
70 160
+ 53
Supérieur ...........
^ 360
10 360
+ 93
^ 360
10 360
+ 93
TOTAL ..........
3l6 42O
4-S^ 43O
+ 43
3l6 42O
4-S^ 43O
+ 43
"34 2OO
— 8
— 8
Professions intellectuelles : Hommes de science et assimilés. Divers .......................
4 760
23 780
12 480 20 52O
+ 163 + ii
4 760
23 780
12 480 20 52O
+ 163 + ii
TOTAL ...........
28 S4.O
39 ooo
+ 36
28 S4.O
39 ooo
+ 36
Artistes .......
60 960
56 980
— 7
60 960
56 980
— 7
Cultes .....
I S7 080
-f i
-f i
SOURCE
au 1/20).
au 1/20).
I.N.S.E.E. Recensements de 1954 et de 1962 (Sondages
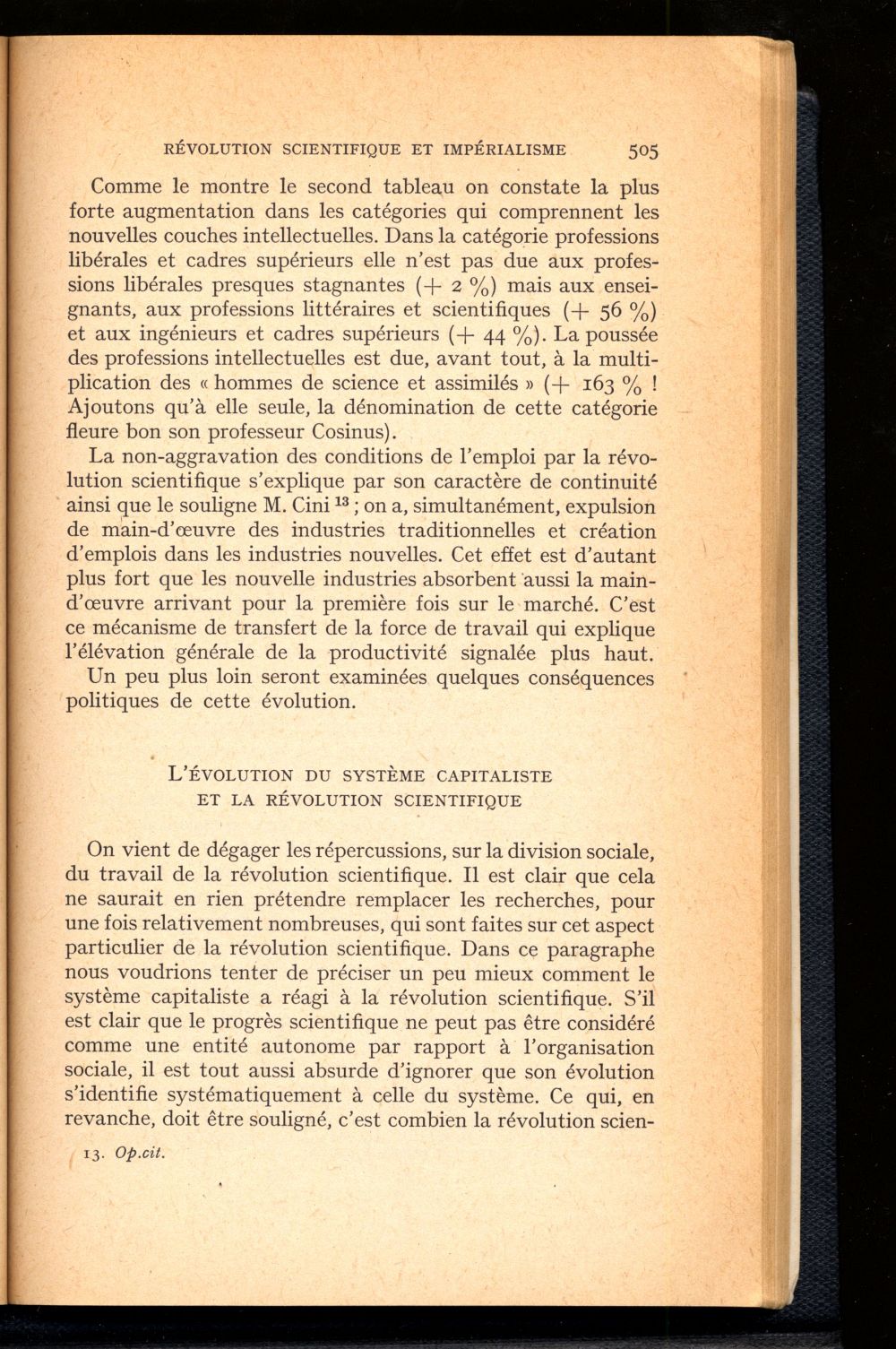

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
505
Comme le montre le second tableau on constate la plus
forte augmentation dans les catégories qui comprennent les
nouvelles couches intellectuelles. Dans la catégorie professions
libérales et cadres supérieurs elle n'est pas due aux profes-
sions libérales presques stagnantes (+ 2 %) mais aux ensei-
gnants, aux professions littéraires et scientifiques (-[- 56 %)
et aux ingénieurs et cadres supérieurs (+ 44 %)• La poussée
des professions intellectuelles est due, avant tout, à la multi-
plication des « hommes de science et assimilés » (+ 163 % !
Ajoutons qu'à elle seule, la dénomination de cette catégorie
fleure bon son professeur Cosinus).
forte augmentation dans les catégories qui comprennent les
nouvelles couches intellectuelles. Dans la catégorie professions
libérales et cadres supérieurs elle n'est pas due aux profes-
sions libérales presques stagnantes (+ 2 %) mais aux ensei-
gnants, aux professions littéraires et scientifiques (-[- 56 %)
et aux ingénieurs et cadres supérieurs (+ 44 %)• La poussée
des professions intellectuelles est due, avant tout, à la multi-
plication des « hommes de science et assimilés » (+ 163 % !
Ajoutons qu'à elle seule, la dénomination de cette catégorie
fleure bon son professeur Cosinus).
La non-aggravation des conditions de l'emploi par la révo-
lution scientifique s'explique par son caractère de continuité
ainsi que le souligne M. Cini13 ; on a, simultanément, expulsion
de main-d'œuvre des industries traditionnelles et création
d'emplois dans les industries nouvelles. Cet effet est d'autant
plus fort que les nouvelle industries absorbent aussi la main-
d'œuvre arrivant pour la première fois sur le marché. C'est
ce mécanisme de transfert de la force de travail qui explique
l'élévation générale de la productivité signalée plus haut.
lution scientifique s'explique par son caractère de continuité
ainsi que le souligne M. Cini13 ; on a, simultanément, expulsion
de main-d'œuvre des industries traditionnelles et création
d'emplois dans les industries nouvelles. Cet effet est d'autant
plus fort que les nouvelle industries absorbent aussi la main-
d'œuvre arrivant pour la première fois sur le marché. C'est
ce mécanisme de transfert de la force de travail qui explique
l'élévation générale de la productivité signalée plus haut.
Un peu plus loin seront examinées quelques conséquences
politiques de cette évolution.
politiques de cette évolution.
L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME CAPITALISTE
ET LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE
ET LA RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE
On vient de dégager les répercussions, sur la division sociale,
du travail de la révolution scientifique. Il est clair que cela
ne saurait en rien prétendre remplacer les recherches, pour
une fois relativement nombreuses, qui sont faites sur cet aspect
particulier de la révolution scientifique. Dans ce paragraphe
nous voudrions tenter de préciser un peu mieux comment le
système capitaliste a réagi à la révolution scientifique. S'il
est clair que le progrès scientifique ne peut pas être considéré
comme une entité autonome par rapport à l'organisation
sociale, il est tout aussi absurde d'ignorer que son évolution
s'identifie systématiquement à celle du système. Ce qui, en
revanche, doit être souligné, c'est combien la révolution scien-
du travail de la révolution scientifique. Il est clair que cela
ne saurait en rien prétendre remplacer les recherches, pour
une fois relativement nombreuses, qui sont faites sur cet aspect
particulier de la révolution scientifique. Dans ce paragraphe
nous voudrions tenter de préciser un peu mieux comment le
système capitaliste a réagi à la révolution scientifique. S'il
est clair que le progrès scientifique ne peut pas être considéré
comme une entité autonome par rapport à l'organisation
sociale, il est tout aussi absurde d'ignorer que son évolution
s'identifie systématiquement à celle du système. Ce qui, en
revanche, doit être souligné, c'est combien la révolution scien-
13. Op.cit.
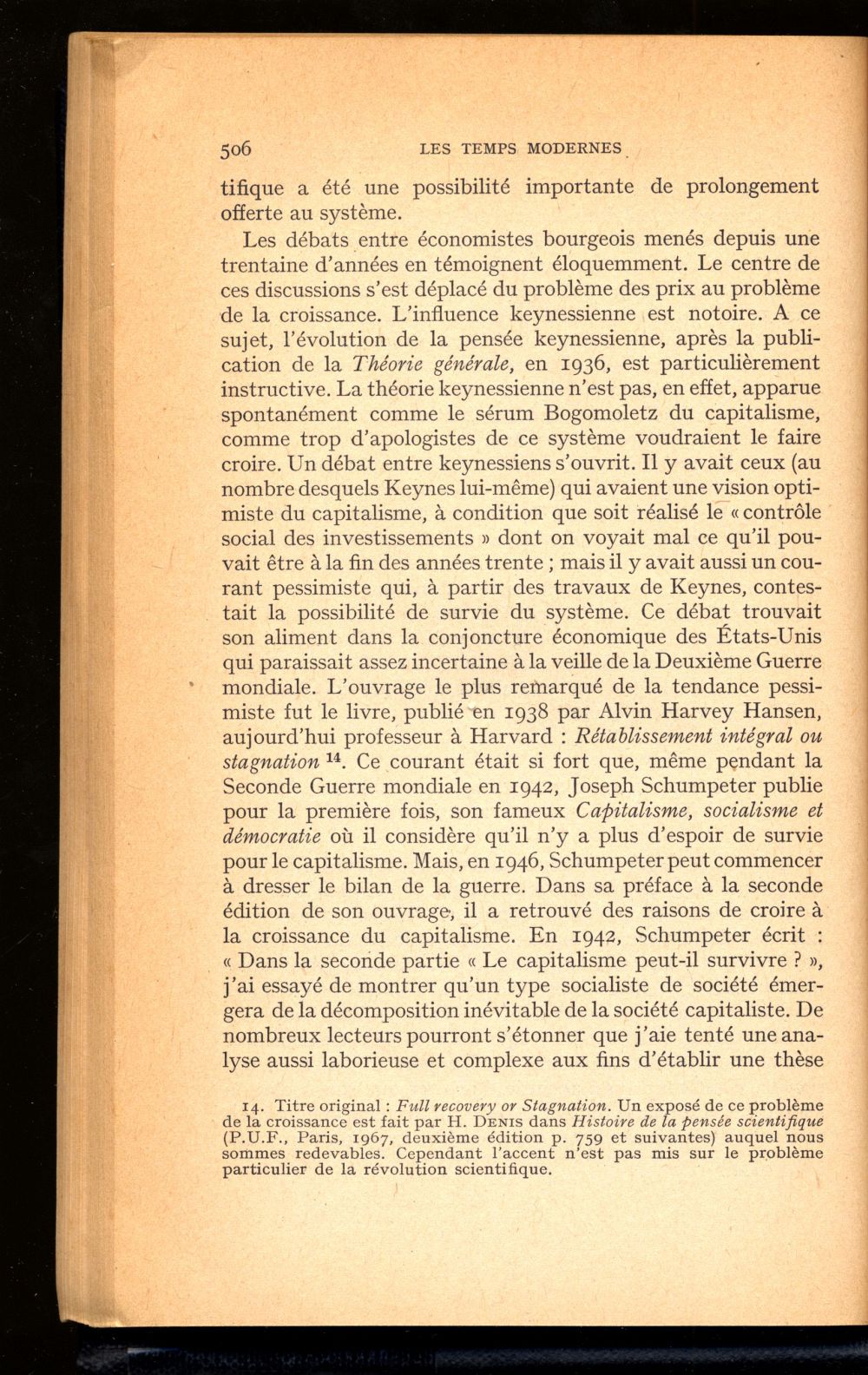

5o6
LES TEMPS MODERNES
tifique a été une possibilité importante de prolongement
offerte au système.
offerte au système.
Les débats entre économistes bourgeois menés depuis une
trentaine d'années en témoignent éloqucmment. Le centre de
ces discussions s'est déplacé du problème des prix au problème
de la croissance. L'influence keynessienne est notoire. A ce
sujet, l'évolution de la pensée keynessienne, après la publi-
cation de la Théorie générale, en 1936, est particulièrement
instructive. La théorie keynessienne n'est pas, en effet, apparue
spontanément comme le sérum Bogomoletz du capitalisme,
comme trop d'apologistes de ce système voudraient le faire
croire. Un débat entre keynessiens s'ouvrit. Il y avait ceux (au
nombre desquels Keynes lui-même) qui avaient une vision opti-
miste du capitalisme, à condition que soit réalisé le « contrôle
social des investissements » dont on voyait mal ce qu'il pou-
vait être à la fin des années trente ; mais il y avait aussi un cou-
rant pessimiste qui, à partir des travaux de Keynes, contes-
tait la possibilité de survie du système. Ce débat trouvait
son aliment clans la conjoncture économique des États-Unis
qui paraissait assez incertaine à la veille de la Deuxième Guerre
mondiale. L'ouvrage le plus remarqué de la tendance pessi-
miste fut le livre, publié en 1938 par Alvin Harvey Hansen,
aujourd'hui professeur à Harvard : Rétablissement intégral ou
stagnation 14. Ce courant était si fort que, même pendant la
Seconde Guerre mondiale en 1942, Joseph Schumpeter publie
pour la première fois, son fameux Capitalisme, socialisme et
démocratie où il considère qu'il n'y a plus d'espoir de survie
pour le capitalisme. Mais, en 1946, Schumpeter peut commencer
à dresser le bilan de la guerre. Dans sa préface à la seconde
édition de son ouvrage, il a retrouvé des raisons de croire à
la croissance du capitalisme. En 1942, Schumpeter écrit :
« Dans la seconde partie « Le capitalisme peut-il survivre ? »,
j'ai essayé de montrer qu'un type socialiste de société émer-
gera de la décomposition inévitable de la société capitaliste. De
nombreux lecteurs pourront s'étonner que j'aie tenté une ana-
lyse aussi laborieuse et complexe aux fins d'établir une thèse
trentaine d'années en témoignent éloqucmment. Le centre de
ces discussions s'est déplacé du problème des prix au problème
de la croissance. L'influence keynessienne est notoire. A ce
sujet, l'évolution de la pensée keynessienne, après la publi-
cation de la Théorie générale, en 1936, est particulièrement
instructive. La théorie keynessienne n'est pas, en effet, apparue
spontanément comme le sérum Bogomoletz du capitalisme,
comme trop d'apologistes de ce système voudraient le faire
croire. Un débat entre keynessiens s'ouvrit. Il y avait ceux (au
nombre desquels Keynes lui-même) qui avaient une vision opti-
miste du capitalisme, à condition que soit réalisé le « contrôle
social des investissements » dont on voyait mal ce qu'il pou-
vait être à la fin des années trente ; mais il y avait aussi un cou-
rant pessimiste qui, à partir des travaux de Keynes, contes-
tait la possibilité de survie du système. Ce débat trouvait
son aliment clans la conjoncture économique des États-Unis
qui paraissait assez incertaine à la veille de la Deuxième Guerre
mondiale. L'ouvrage le plus remarqué de la tendance pessi-
miste fut le livre, publié en 1938 par Alvin Harvey Hansen,
aujourd'hui professeur à Harvard : Rétablissement intégral ou
stagnation 14. Ce courant était si fort que, même pendant la
Seconde Guerre mondiale en 1942, Joseph Schumpeter publie
pour la première fois, son fameux Capitalisme, socialisme et
démocratie où il considère qu'il n'y a plus d'espoir de survie
pour le capitalisme. Mais, en 1946, Schumpeter peut commencer
à dresser le bilan de la guerre. Dans sa préface à la seconde
édition de son ouvrage, il a retrouvé des raisons de croire à
la croissance du capitalisme. En 1942, Schumpeter écrit :
« Dans la seconde partie « Le capitalisme peut-il survivre ? »,
j'ai essayé de montrer qu'un type socialiste de société émer-
gera de la décomposition inévitable de la société capitaliste. De
nombreux lecteurs pourront s'étonner que j'aie tenté une ana-
lyse aussi laborieuse et complexe aux fins d'établir une thèse
14. Titre original : Pull recovery or Stagnation. Un exposé de ce problème
de la croissance est fait par H. DENIS dans Histoire de la pensée scientifique
(P.U.F., Paris, 1967, deuxième édition p. 759 et suivantes) auquel nous
sommes redevables. Cependant l'accent n'est pas mis sur le problème
particulier de la révolution scientifique.
de la croissance est fait par H. DENIS dans Histoire de la pensée scientifique
(P.U.F., Paris, 1967, deuxième édition p. 759 et suivantes) auquel nous
sommes redevables. Cependant l'accent n'est pas mis sur le problème
particulier de la révolution scientifique.
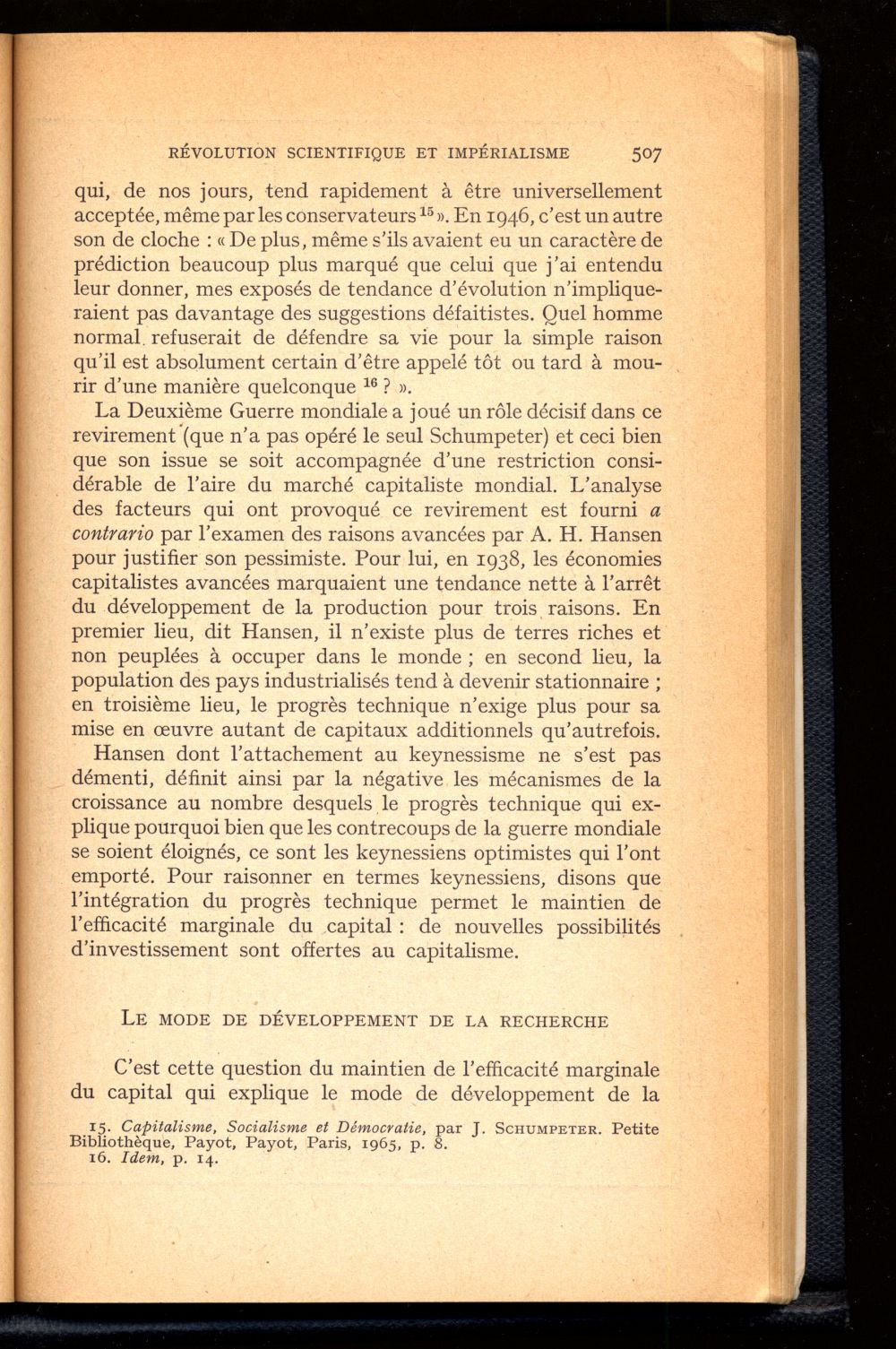

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
507
qui, de nos jours, tend rapidement à être universellement
acceptée, même par les conservateurs15 ». En 1946, c'est un autre
son de cloche : « De plus, même s'ils avaient eu un caractère de
prédiction beaucoup plus marqué que celui que j'ai entendu
leur donner, mes exposés de tendance d'évolution n'implique-
raient pas davantage des suggestions défaitistes. Quel homme
normal, refuserait de défendre sa vie pour la simple raison
qu'il est absolument certain d'être appelé tôt ou tard à mou-
rir d'une manière quelconque 1G ? ».
acceptée, même par les conservateurs15 ». En 1946, c'est un autre
son de cloche : « De plus, même s'ils avaient eu un caractère de
prédiction beaucoup plus marqué que celui que j'ai entendu
leur donner, mes exposés de tendance d'évolution n'implique-
raient pas davantage des suggestions défaitistes. Quel homme
normal, refuserait de défendre sa vie pour la simple raison
qu'il est absolument certain d'être appelé tôt ou tard à mou-
rir d'une manière quelconque 1G ? ».
La Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle décisif dans ce
revirement (que n'a pas opéré le seul Schumpeter) et ceci bien
que son issue se soit accompagnée d'une restriction consi-
dérable de l'aire du marché capitaliste mondial. L'analyse
des facteurs qui ont provoqué ce revirement est fourni a
contrario par l'examen des raisons avancées par A. H. Hansen
pour justifier son pessimiste. Pour lui, en 1938, les économies
capitalistes avancées marquaient une tendance nette à l'arrêt
du développement de la production pour trois raisons. En
premier lieu, dit Hansen, il n'existe plus de terres riches et
non peuplées à occuper dans le monde ; en second lieu, la
population des pays industrialisés tend à devenir stationnaire ;
en troisième lieu, le progrès technique n'exige plus pour sa
mise en œuvre autant de capitaux additionnels qu'autrefois.
revirement (que n'a pas opéré le seul Schumpeter) et ceci bien
que son issue se soit accompagnée d'une restriction consi-
dérable de l'aire du marché capitaliste mondial. L'analyse
des facteurs qui ont provoqué ce revirement est fourni a
contrario par l'examen des raisons avancées par A. H. Hansen
pour justifier son pessimiste. Pour lui, en 1938, les économies
capitalistes avancées marquaient une tendance nette à l'arrêt
du développement de la production pour trois raisons. En
premier lieu, dit Hansen, il n'existe plus de terres riches et
non peuplées à occuper dans le monde ; en second lieu, la
population des pays industrialisés tend à devenir stationnaire ;
en troisième lieu, le progrès technique n'exige plus pour sa
mise en œuvre autant de capitaux additionnels qu'autrefois.
Hansen dont l'attachement au keynessisme ne s'est pas
démenti, définit ainsi par la négative les mécanismes clé la
croissance au nombre desquels le progrès technique qui ex-
plique pourquoi bien que les contrecoups clé la guerre mondiale
se soient éloignés, ce sont les keynessiens optimistes qui l'ont
emporté. Pour raisonner en termes keynessiens, disons que
l'intégration du progrès technique permet le maintien de
l'efficacité marginale du capital : de nouvelles possibilités
d'investissement sont offertes au capitalisme.
démenti, définit ainsi par la négative les mécanismes clé la
croissance au nombre desquels le progrès technique qui ex-
plique pourquoi bien que les contrecoups clé la guerre mondiale
se soient éloignés, ce sont les keynessiens optimistes qui l'ont
emporté. Pour raisonner en termes keynessiens, disons que
l'intégration du progrès technique permet le maintien de
l'efficacité marginale du capital : de nouvelles possibilités
d'investissement sont offertes au capitalisme.
LE MODE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
C'est cette question du maintien de l'efficacité marginale
du capital qui explique le mode de développement de la
du capital qui explique le mode de développement de la
15. Capitalisme, Socialisme et Démocratie, par J. SCHUMPETER. Petite
Bibliothèque, Payot, Payot, Paris, 1965, p. 8.
Bibliothèque, Payot, Payot, Paris, 1965, p. 8.
16. Idem, p. 14.
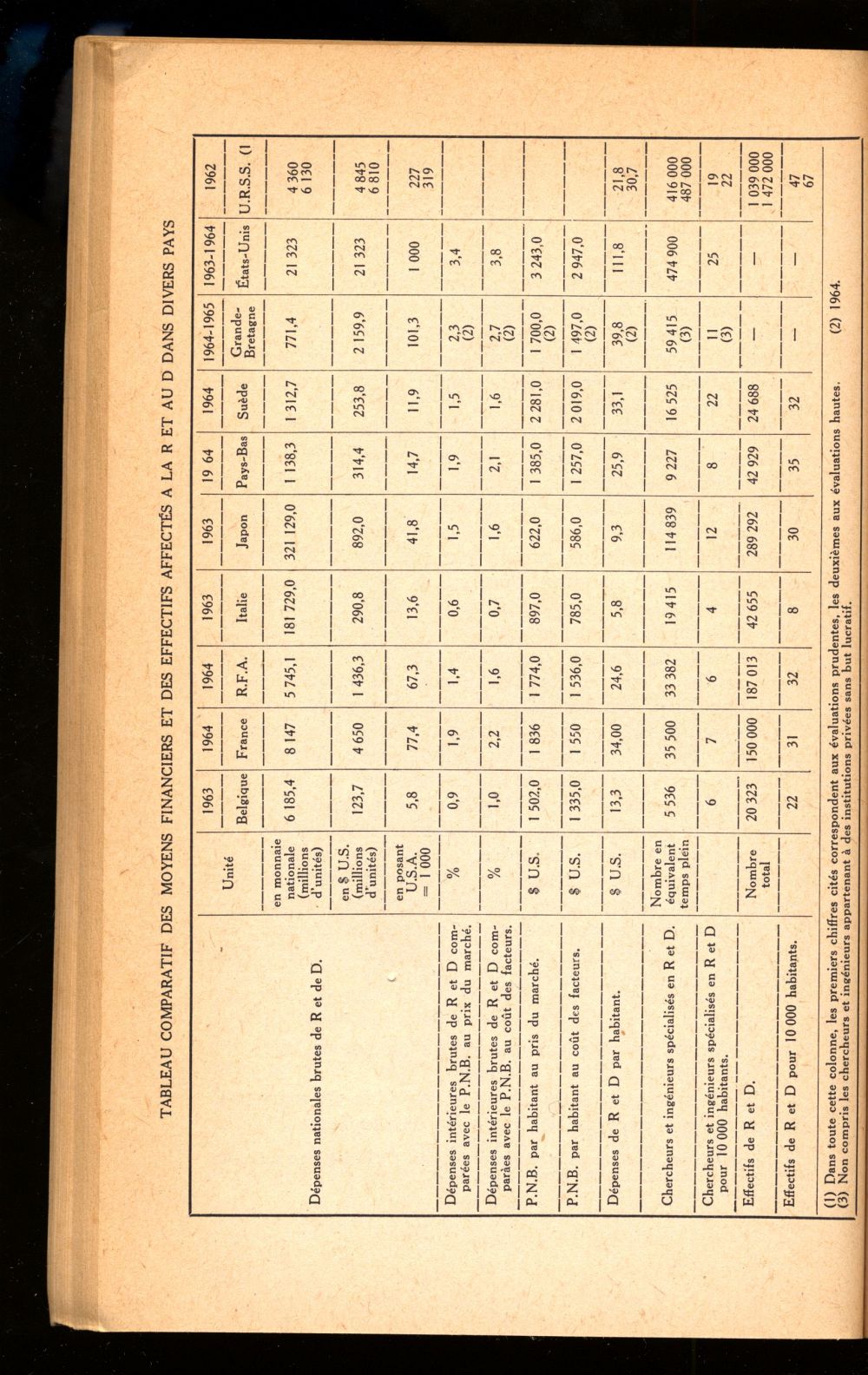

TABLEAU COMPARATIF DES MOYENS FINANCIERS ET DES EFFECTIFS AFFECTÉS A LA R ET AU D DANS DIVERS PAYS
Dépenses nationales brutes de R et de D.
Unité
1963
1964
1964
1963
1963
19 64
1964
1964-1965
1963-1964
1962
Unité
1963
1964
1964
1963
1963
19 64
1964
1964-1965
1963-1964
1962
Belgique
France
R.F.A.
Italie
Japon
Pays-Bas
Suède
Grande-Bretagne
États-Unis
U.R.S.S. (1
France
R.F.A.
Italie
Japon
Pays-Bas
Suède
Grande-Bretagne
États-Unis
U.R.S.S. (1
en monnaie nationale (millions d'unités)
6 185,4
8147
5745,1
181 729,0
321 129,0
I 138,3
1 312,7
771,4
2l 323
4360 6 130
6 185,4
8147
5745,1
181 729,0
321 129,0
I 138,3
1 312,7
771,4
2l 323
4360 6 130
en S U.S. (millions d'unités)
123,7
4650
1 436,3
290,8
892,0
314,4
253,8
2 159,9
21 323
4845 6810
123,7
4650
1 436,3
290,8
892,0
314,4
253,8
2 159,9
21 323
4845 6810
en posant
U.S.A. = 1 000
5,8
77,4
67,3
13,6
41,8
14,7
,1,9
101,3
1 000 227 319
U.S.A. = 1 000
5,8
77,4
67,3
13,6
41,8
14,7
,1,9
101,3
1 000 227 319
Dépenses intérieures brutes de R et D comparées avec le P. N.B. au prix du marché.
o/
0,9
1,9
1,4
0,6
1,5
1,9
1,5
2,3 (2)
3,4
o/
0,9
1,9
1,4
0,6
1,5
1,9
1,5
2,3 (2)
3,4
Dépenses intérieures brutes de R et D com-paràes avec le P.N.B. au coût des facteurs.
%
1,0
2,2
1.6
0,7
1,6
2,1
1,6
2,7 (2)
3,8
%
1,0
2,2
1.6
0,7
1,6
2,1
1,6
2,7 (2)
3,8
P. N.B. par habitant au pris du marché.
S U.S.
1 502,0
1 836
1 774,0
897,0
622,0
1 385,0
2281,0
1 700,0 (2)
3 243,0
S U.S.
1 502,0
1 836
1 774,0
897,0
622,0
1 385,0
2281,0
1 700,0 (2)
3 243,0
P.N.B. par habitant au coût des facteurs.
S U.S.
1 335.0 1 550
1 536,0
785,0
586,0
1 257,0
2019,0
1 497,0 (2)
2947,0
S U.S.
1 335.0 1 550
1 536,0
785,0
586,0
1 257,0
2019,0
1 497,0 (2)
2947,0
Dépenses de R et D par habitant.
S U.S.
13,3
34,00
24,6
5,8
9,3
25,9
33,1
39,8 (2)
111,8
21,8 30,7
S U.S.
13,3
34,00
24,6
5,8
9,3
25,9
33,1
39,8 (2)
111,8
21,8 30,7
Chercheurs et ingénieurs spécialisés en R et D.
Nombre en équivalent temps plein
5536
35500
33382
19415
114839
9227
16525
59415 (3)
474 900
416000 487 000
Nombre en équivalent temps plein
5536
35500
33382
19415
114839
9227
16525
59415 (3)
474 900
416000 487 000
Chercheurs et ingénieurs spécialisés en R et D pour 10000 habitants.
6
7
6
4
12
8
22
(3)
25
19
22
7
6
4
12
8
22
(3)
25
19
22
Effectifs de R et D.
Nombre total
20323
1 50 000
187013
42655
289 292
42929
24688
—
—
1 039 000 1 472 000
Nombre total
20323
1 50 000
187013
42655
289 292
42929
24688
—
—
1 039 000 1 472 000
Effectifs de R et D pour 10000 habitants.
22
31
32
8
30
35
32
—
—
47 67
31
32
8
30
35
32
—
—
47 67
(1) Dans toute cette colonne, les premiers chiffres cités correspondent aux évalua
:ions prudentes, les deuxièmes aux évaluations hautes. (2) 1964. î sans but lucratif.
:ions prudentes, les deuxièmes aux évaluations hautes. (2) 1964. î sans but lucratif.
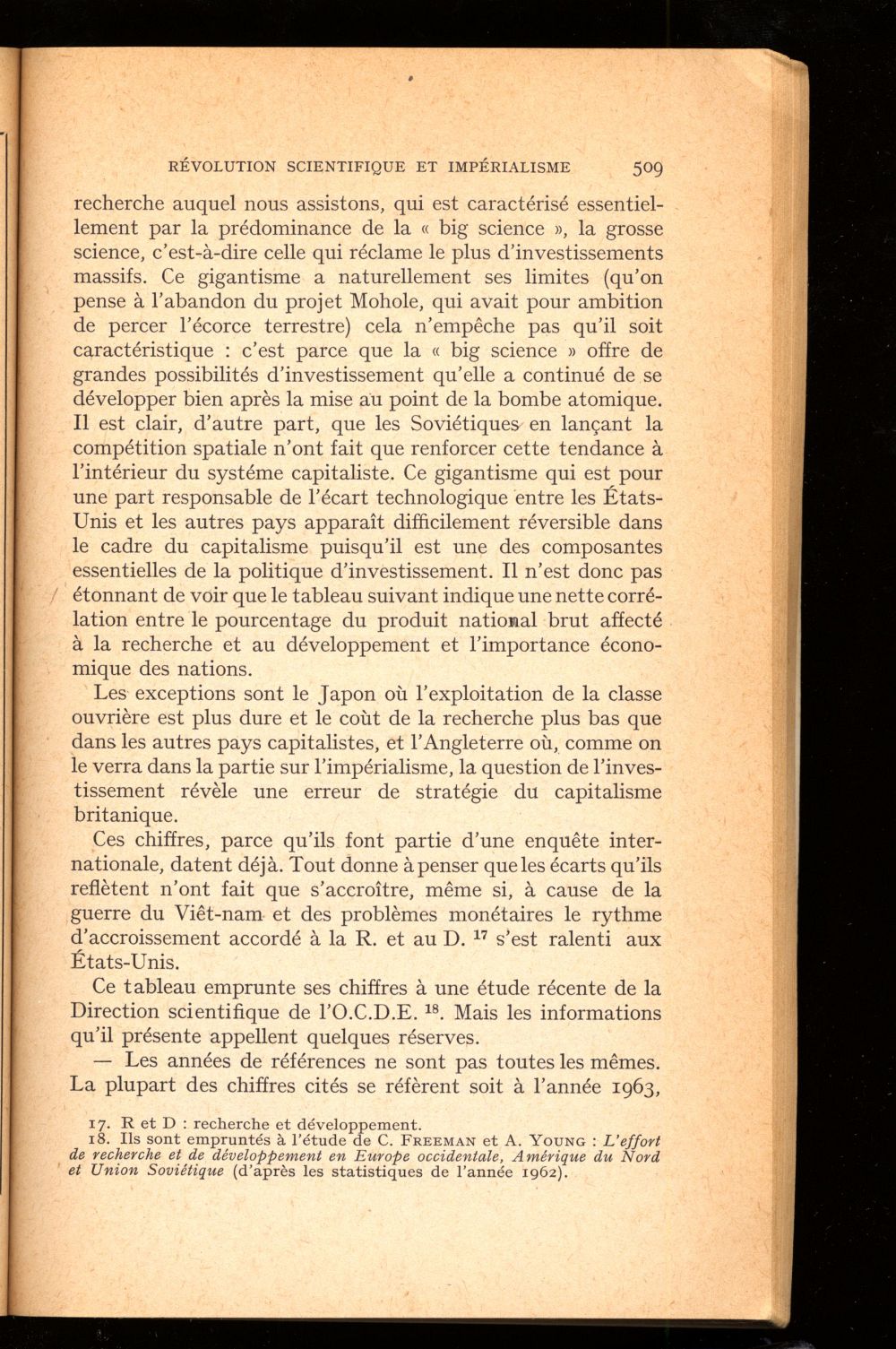

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
recherche auquel nous assistons, qui est caractérisé essentiel-
lement par la prédominance de la « big science », la grosse
science, c'est-à-dire celle qui réclame le plus d'investissements
massifs. Ce gigantisme a naturellement ses limites (qu'on
pense à l'abandon du projet Mohole, qui avait pour ambition
de percer l'écorce terrestre) cela n'empêche pas qu'il soit
caractéristique : c'est parce que la « big science » offre de
grandes possibilités d'investissement qu'elle a continué de se
développer bien après la mise au point de la bombe atomique.
Il est clair, d'autre part, que les Soviétiques en lançant la
compétition spatiale n'ont fait que renforcer cette tendance à
l'intérieur du système capitaliste. Ce gigantisme qui est pour
une part responsable de l'écart technologique entre les États-
Unis et les autres pays apparaît difficilement réversible dans
le cadre du capitalisme puisqu'il est une des composantes
essentielles de la politique d'investissement. Il n'est donc pas
étonnant de voir que le tableau suivant indique une nette corré-
lation entre le pourcentage du produit national brut affecté
à la recherche et au développement et l'importance écono-
mique des nations.
lement par la prédominance de la « big science », la grosse
science, c'est-à-dire celle qui réclame le plus d'investissements
massifs. Ce gigantisme a naturellement ses limites (qu'on
pense à l'abandon du projet Mohole, qui avait pour ambition
de percer l'écorce terrestre) cela n'empêche pas qu'il soit
caractéristique : c'est parce que la « big science » offre de
grandes possibilités d'investissement qu'elle a continué de se
développer bien après la mise au point de la bombe atomique.
Il est clair, d'autre part, que les Soviétiques en lançant la
compétition spatiale n'ont fait que renforcer cette tendance à
l'intérieur du système capitaliste. Ce gigantisme qui est pour
une part responsable de l'écart technologique entre les États-
Unis et les autres pays apparaît difficilement réversible dans
le cadre du capitalisme puisqu'il est une des composantes
essentielles de la politique d'investissement. Il n'est donc pas
étonnant de voir que le tableau suivant indique une nette corré-
lation entre le pourcentage du produit national brut affecté
à la recherche et au développement et l'importance écono-
mique des nations.
Les exceptions sont le Japon où l'exploitation de la classe
ouvrière est plus dure et le coût de la recherche plus bas que
dans les autres pays capitalistes, et l'Angleterre où, comme on
le verra dans la partie sur l'impérialisme, la question de l'inves-
tissement révèle une erreur de stratégie du capitalisme
britanique.
ouvrière est plus dure et le coût de la recherche plus bas que
dans les autres pays capitalistes, et l'Angleterre où, comme on
le verra dans la partie sur l'impérialisme, la question de l'inves-
tissement révèle une erreur de stratégie du capitalisme
britanique.
Ces chiffres, parce qu'ils font partie d'une enquête inter-
nationale, datent déjà. Tout donne à penser que les écarts qu'ils
reflètent n'ont fait que s'accroître, même si, à cause de la
guerre du Viêt-nam et des problèmes monétaires le rythme
d'accroissement accordé à la R. et au D. 17 s'est ralenti aux
États-Unis.
nationale, datent déjà. Tout donne à penser que les écarts qu'ils
reflètent n'ont fait que s'accroître, même si, à cause de la
guerre du Viêt-nam et des problèmes monétaires le rythme
d'accroissement accordé à la R. et au D. 17 s'est ralenti aux
États-Unis.
Ce tableau emprunte ses chiffres à une étude récente de la
Direction scientifique de l'O.C.D.E. 18. Mais les informations
qu'il présente appellent quelques réserves.
Direction scientifique de l'O.C.D.E. 18. Mais les informations
qu'il présente appellent quelques réserves.
— Les années de références ne sont pas toutes les mêmes.
La plupart des chiffres cités se réfèrent soit à l'année 1963,
La plupart des chiffres cités se réfèrent soit à l'année 1963,
17. R et D : recherche et développement.
18. Ils sont empruntés à l'étude de C. FREEMAN et A. YOUNG : L'effort
de recherche et de développement en Europe occidentale, Amérique du Nord
et Union Soviétique (d'après les statistiques de l'année 1962).
de recherche et de développement en Europe occidentale, Amérique du Nord
et Union Soviétique (d'après les statistiques de l'année 1962).


LES TEMPS MODERNES
soit à l'année 1964. Pour les États-Unis et la Grande-Bretagne,
il s'agit des années fiscales 1963-1964 et 1964-1965. Les chiffres
concernant l'Union soviétique 19 sont très approximatifs et
remontent à l'année 1962. Dans ces conditions, il est difficile
d'établir des comparaisons rigoureuses.
il s'agit des années fiscales 1963-1964 et 1964-1965. Les chiffres
concernant l'Union soviétique 19 sont très approximatifs et
remontent à l'année 1962. Dans ces conditions, il est difficile
d'établir des comparaisons rigoureuses.
— De plus, les différences du coût de la recherche d'un
pays à l'autre doivent être prises en considération. La con-
version en dollars des sommes affectées à la R. et D. par les
pays mentionnés devrait être opérée non sur la base du taux
de change officiel à la date indiquée, mais sur la base d'un
« taux de change-recherche » tenant compte des écarts de
coût les plus significatifs.
pays à l'autre doivent être prises en considération. La con-
version en dollars des sommes affectées à la R. et D. par les
pays mentionnés devrait être opérée non sur la base du taux
de change officiel à la date indiquée, mais sur la base d'un
« taux de change-recherche » tenant compte des écarts de
coût les plus significatifs.
Depuis 1953, le total des fonds consacrés à la R. et au D.
aux États-Unis a doublé tous les six ans environ w, comme le
montre le graphique suivant :
aux États-Unis a doublé tous les six ans environ w, comme le
montre le graphique suivant :
1953 J954 1955 1956 1957 1958 1959 19(50 1961 1962 1963 1964
Avec une population comparable, les États-Unis dépensent
trois fois et demie plus que l'Europe occidentale, et cinq fois
plus que l'ensemble des pays du Marché commun dans ce
domaine. On dit souvent que l'essentiel de cet effort de recher-
che est consacré à des fins militaires. C'est exact, mais, même
en défalquant du budget recherche des États-Unis les recher-
trois fois et demie plus que l'Europe occidentale, et cinq fois
plus que l'ensemble des pays du Marché commun dans ce
domaine. On dit souvent que l'essentiel de cet effort de recher-
che est consacré à des fins militaires. C'est exact, mais, même
en défalquant du budget recherche des États-Unis les recher-
19. O.C.D.E., Paris 1965.
20. P. COGNARD : «Les disparités technologiques entre l'Europe et
les U.S. A. Le progrès scientifique, n° 107, avril 1967, p. 22.
les U.S. A. Le progrès scientifique, n° 107, avril 1967, p. 22.
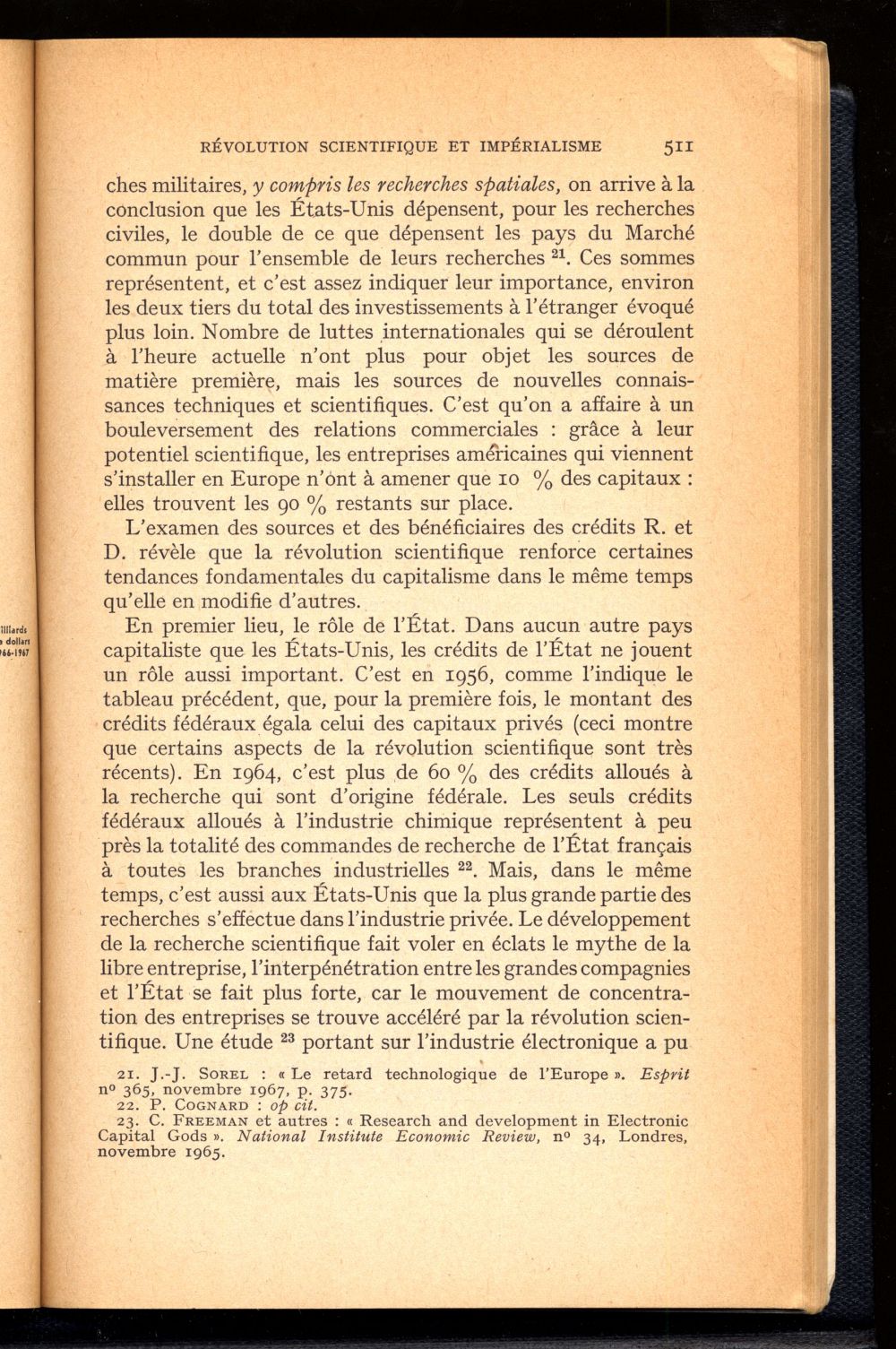

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME 511
ches militaires, y compris les recherches spatiales, on arrive à la
conclusion que les États-Unis dépensent, pour les recherches
civiles, le double de ce que dépensent les pays du Marché
commun pour l'ensemble de leurs recherches 21. Ces sommes
représentent, et c'est assez indiquer leur importance, environ
les deux tiers du total des investissements à l'étranger évoqué
plus loin. Nombre de luttes internationales qui se déroulent
à l'heure actuelle n'ont plus pour objet les sources de
matière première, mais les sources de nouvelles connais-
sances techniques et scientifiques. C'est qu'on a affaire à un
bouleversement des relations commerciales : grâce à leur
potentiel scientifique, les entreprises américaines qui viennent
s'installer en Europe n'ont à amener que 10 % des capitaux :
elles trouvent les 90 % restants sur place.
conclusion que les États-Unis dépensent, pour les recherches
civiles, le double de ce que dépensent les pays du Marché
commun pour l'ensemble de leurs recherches 21. Ces sommes
représentent, et c'est assez indiquer leur importance, environ
les deux tiers du total des investissements à l'étranger évoqué
plus loin. Nombre de luttes internationales qui se déroulent
à l'heure actuelle n'ont plus pour objet les sources de
matière première, mais les sources de nouvelles connais-
sances techniques et scientifiques. C'est qu'on a affaire à un
bouleversement des relations commerciales : grâce à leur
potentiel scientifique, les entreprises américaines qui viennent
s'installer en Europe n'ont à amener que 10 % des capitaux :
elles trouvent les 90 % restants sur place.
L'examen des sources et des bénéficiaires des crédits R. et
D. révèle que la révolution scientifique renforce certaines
tendances fondamentales du capitalisme dans le même temps
qu'elle en modifie d'autres.
D. révèle que la révolution scientifique renforce certaines
tendances fondamentales du capitalisme dans le même temps
qu'elle en modifie d'autres.
En premier lieu, le rôle de l'État. Dans aucun autre pays
capitaliste que les États-Unis, les crédits de l'État ne jouent
un rôle aussi important. C'est en 1956, comme l'indique le
tableau précédent, que, pour la première fois, le montant des
crédits fédéraux égala celui des capitaux privés (ceci montre
que certains aspects de la révolution scientifique sont très
récents). En 1964, c'est plus de 60 % des crédits alloués à
la recherche qui sont d'origine fédérale. Les seuls crédits
fédéraux alloués à l'industrie chimique représentent à peu
près la totalité des commandes de recherche de l'État français
à toutes les branches industrielles 22. Mais, dans le même
temps, c'est aussi aux États-Unis que la plus grande partie des
recherches s'effectue dans l'industrie privée. Le développement
de la recherche scientifique fait voler en éclats le mythe de la
libre entreprise, l'interpénétration entre les grandes compagnies
et l'État se fait plus forte, car le mouvement de concentra-
tion des entreprises se trouve accéléré par la révolution scien-
tifique. Une étude 23 portant sur l'industrie électronique a pu
capitaliste que les États-Unis, les crédits de l'État ne jouent
un rôle aussi important. C'est en 1956, comme l'indique le
tableau précédent, que, pour la première fois, le montant des
crédits fédéraux égala celui des capitaux privés (ceci montre
que certains aspects de la révolution scientifique sont très
récents). En 1964, c'est plus de 60 % des crédits alloués à
la recherche qui sont d'origine fédérale. Les seuls crédits
fédéraux alloués à l'industrie chimique représentent à peu
près la totalité des commandes de recherche de l'État français
à toutes les branches industrielles 22. Mais, dans le même
temps, c'est aussi aux États-Unis que la plus grande partie des
recherches s'effectue dans l'industrie privée. Le développement
de la recherche scientifique fait voler en éclats le mythe de la
libre entreprise, l'interpénétration entre les grandes compagnies
et l'État se fait plus forte, car le mouvement de concentra-
tion des entreprises se trouve accéléré par la révolution scien-
tifique. Une étude 23 portant sur l'industrie électronique a pu
21. J.-J. SOREL : « Le retard technologique de l'Europe ». Esprit
n° 365, novembre 1967, p. 375.
n° 365, novembre 1967, p. 375.
22. P. COGNARD : Op dt.
23. C. FREEMAN et autres : « Research and development in Electronic
Capital Gods ». National Institute Economie Review, n° 34, Londres,
novembre 1965.
Capital Gods ». National Institute Economie Review, n° 34, Londres,
novembre 1965.
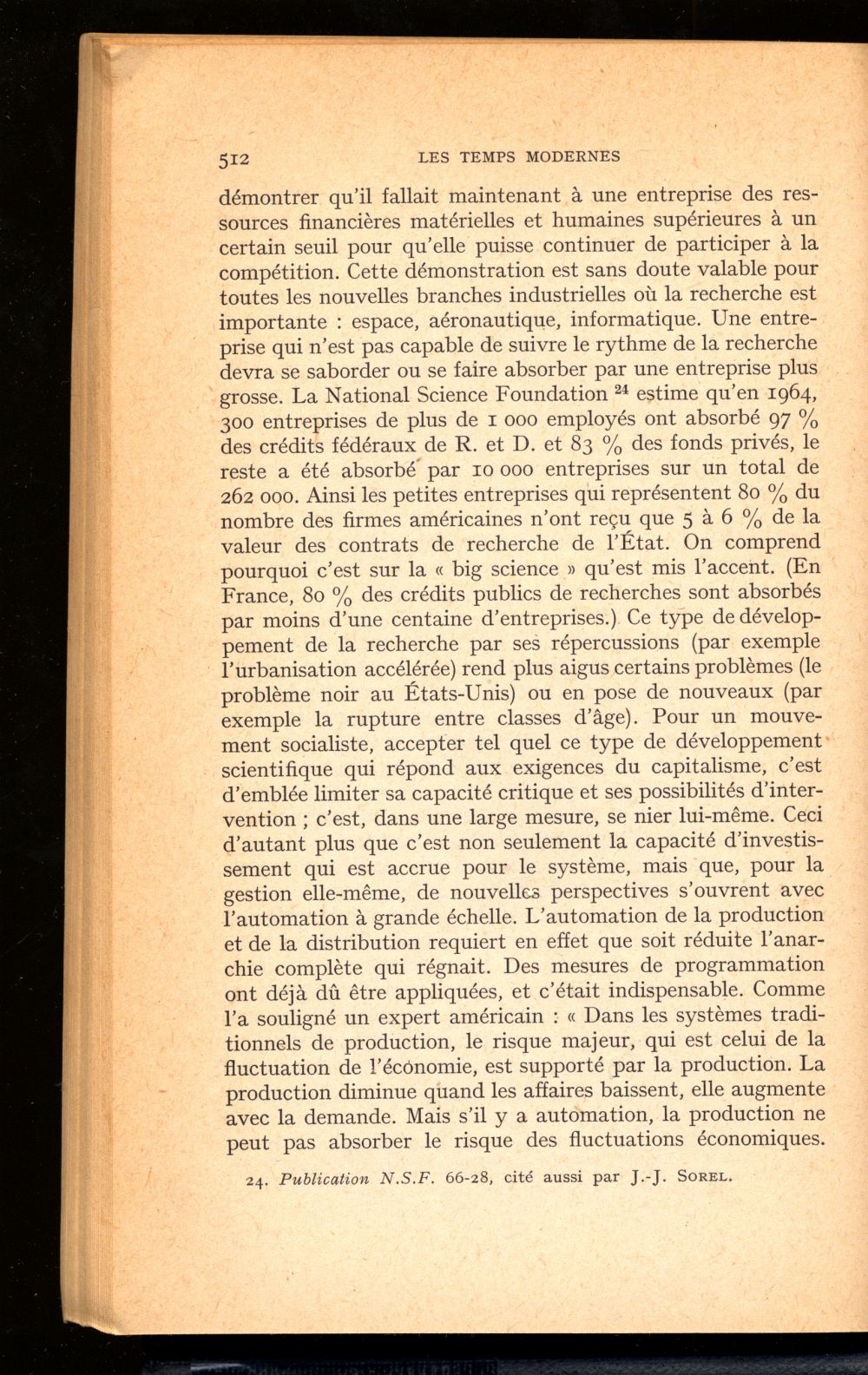

512
LES TEMPS MODERNES
démontrer qu'il fallait maintenant à une entreprise des res-
sources financières matérielles et humaines supérieures à un
certain seuil pour qu'elle puisse continuer de participer à la
compétition. Cette démonstration est sans doute valable pour
toutes les nouvelles branches industrielles où la recherche est
importante : espace, aéronautique, informatique. Une entre-
prise qui n'est pas capable de suivre le rythme de la recherche
devra se saborder ou se faire absorber par une entreprise plus
grosse. La National Science Foundation 24 estime qu'en 1964,
300 entreprises de plus de i ooo employés ont absorbé 97 %
des crédits fédéraux de R. et D. et 83 % des fonds privés, le
reste a été absorbé par 10 ooo entreprises sur un total de
262 ooo. Ainsi les petites entreprises qui représentent 80 % du
nombre des firmes américaines n'ont reçu que 5 à 6 % de la
valeur des contrats de recherche de l'État. On comprend
pourquoi c'est sur la « big science » qu'est mis l'accent. (En
France, 80 % des crédits publics de recherches sont absorbés
par moins d'une centaine d'entreprises.) Ce type de dévelop-
pement de la recherche par ses répercussions (par exemple
l'urbanisation accélérée) rend plus aigus certains problèmes (le
problème noir au États-Unis) ou en pose de nouveaux (par
exemple la rupture entre classes d'âge). Pour un mouve-
ment socialiste, accepter tel quel ce type de développement
scientifique qui répond aux exigences du capitalisme, c'est
d'emblée limiter sa capacité critique et ses possibilités d'inter-
vention ; c'est, dans une large mesure, se nier lui-même. Ceci
d'autant plus que c'est non seulement la capacité d'investis-
sement qui est accrue pour le système, mais que, pour la
gestion elle-même, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec
l'automation à grande échelle. L'automation de la production
et de la distribution requiert en effet que soit réduite l'anar-
chie complète qui régnait. Des mesures de programmation
ont déjà dû être appliquées, et c'était indispensable. Comme
l'a souligné un expert américain : « Dans les systèmes tradi-
tionnels de production, le risque majeur, qui est celui de la
fluctuation de l'économie, est supporté par la production. La
production diminue quand les affaires baissent, elle augmente
avec la demande. Mais s'il y a automation, la production ne
peut pas absorber le risque des fluctuations économiques.
sources financières matérielles et humaines supérieures à un
certain seuil pour qu'elle puisse continuer de participer à la
compétition. Cette démonstration est sans doute valable pour
toutes les nouvelles branches industrielles où la recherche est
importante : espace, aéronautique, informatique. Une entre-
prise qui n'est pas capable de suivre le rythme de la recherche
devra se saborder ou se faire absorber par une entreprise plus
grosse. La National Science Foundation 24 estime qu'en 1964,
300 entreprises de plus de i ooo employés ont absorbé 97 %
des crédits fédéraux de R. et D. et 83 % des fonds privés, le
reste a été absorbé par 10 ooo entreprises sur un total de
262 ooo. Ainsi les petites entreprises qui représentent 80 % du
nombre des firmes américaines n'ont reçu que 5 à 6 % de la
valeur des contrats de recherche de l'État. On comprend
pourquoi c'est sur la « big science » qu'est mis l'accent. (En
France, 80 % des crédits publics de recherches sont absorbés
par moins d'une centaine d'entreprises.) Ce type de dévelop-
pement de la recherche par ses répercussions (par exemple
l'urbanisation accélérée) rend plus aigus certains problèmes (le
problème noir au États-Unis) ou en pose de nouveaux (par
exemple la rupture entre classes d'âge). Pour un mouve-
ment socialiste, accepter tel quel ce type de développement
scientifique qui répond aux exigences du capitalisme, c'est
d'emblée limiter sa capacité critique et ses possibilités d'inter-
vention ; c'est, dans une large mesure, se nier lui-même. Ceci
d'autant plus que c'est non seulement la capacité d'investis-
sement qui est accrue pour le système, mais que, pour la
gestion elle-même, de nouvelles perspectives s'ouvrent avec
l'automation à grande échelle. L'automation de la production
et de la distribution requiert en effet que soit réduite l'anar-
chie complète qui régnait. Des mesures de programmation
ont déjà dû être appliquées, et c'était indispensable. Comme
l'a souligné un expert américain : « Dans les systèmes tradi-
tionnels de production, le risque majeur, qui est celui de la
fluctuation de l'économie, est supporté par la production. La
production diminue quand les affaires baissent, elle augmente
avec la demande. Mais s'il y a automation, la production ne
peut pas absorber le risque des fluctuations économiques.
24. Publication N.S.F. 66-28, cite aussi par J.-J. SOREL.
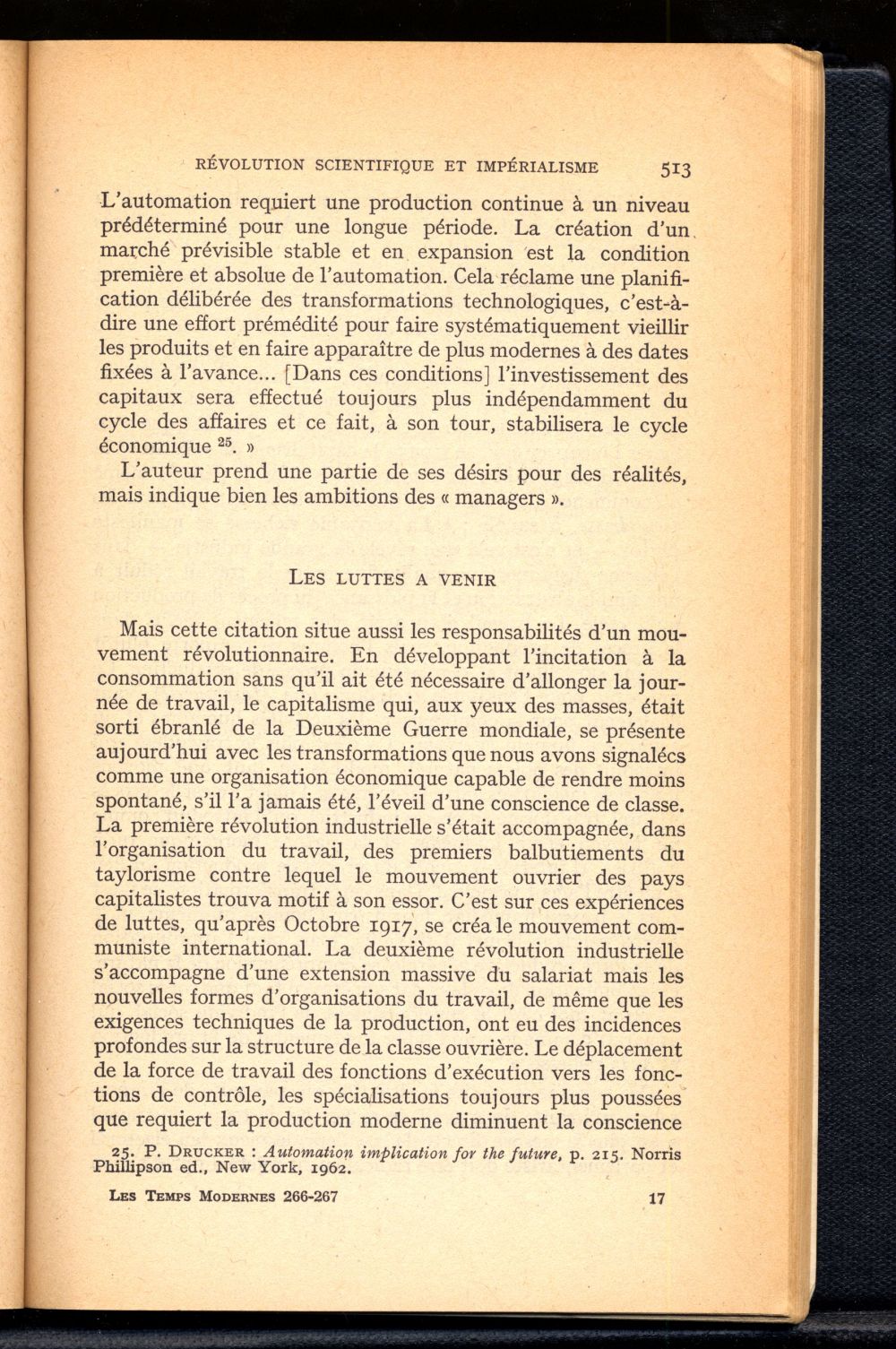

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
513
L'automation requiert une production continue à un niveau
prédéterminé pour une longue période. La création d'un,
marché prévisible stable et en expansion est la condition
première et absolue de l'automation. Cela réclame une planifi-
cation délibérée des transformations technologiques, c'est-à-
dire une effort prémédité pour faire systématiquement vieillir
les produits et en faire apparaître de plus modernes à des dates
fixées à l'avance... [Dans ces conditions] l'investissement des
capitaux sera effectué toujours plus indépendamment du
cycle des affaires et ce fait, à son tour, stabilisera le cycle
économique 25. »
prédéterminé pour une longue période. La création d'un,
marché prévisible stable et en expansion est la condition
première et absolue de l'automation. Cela réclame une planifi-
cation délibérée des transformations technologiques, c'est-à-
dire une effort prémédité pour faire systématiquement vieillir
les produits et en faire apparaître de plus modernes à des dates
fixées à l'avance... [Dans ces conditions] l'investissement des
capitaux sera effectué toujours plus indépendamment du
cycle des affaires et ce fait, à son tour, stabilisera le cycle
économique 25. »
L'auteur prend une partie de ses désirs pour des réalités,
mais indique bien les ambitions des « managers ».
mais indique bien les ambitions des « managers ».
LES LUTTES A VENIR
Mais cette citation situe aussi les responsabilités d'un mou-
vement révolutionnaire. En développant l'incitation à la
consommation sans qu'il ait été nécessaire d'allonger la jour-
née de travail, le capitalisme qui, aux yeux des masses, était
sorti ébranlé de la Deuxième Guerre mondiale, se présente
aujourd'hui avec les transformations que nous avons signalées
comme une organisation économique capable de rendre moins
spontané, s'il l'a jamais été, l'éveil d'une conscience de classe.
La première révolution industrielle s'était accompagnée, dans
l'organisation du travail, des premiers balbutiements du
taylorisme contre lequel le mouvement ouvrier des pays
capitalistes trouva motif à son essor. C'est sur ces expériences
de luttes, qu'après Octobre 1917, se créa le mouvement com-
muniste international. La deuxième révolution industrielle
s'accompagne d'une extension massive du salariat mais les
nouvelles formes d'organisations du travail, de même que les
exigences techniques de la production, ont eu des incidences
profondes sur la structure de la classe ouvrière. Le déplacement
de la force de travail des fonctions d'exécution vers les fonc-
tions de contrôle, les spécialisations toujours plus poussées
que requiert la production moderne diminuent la conscience
vement révolutionnaire. En développant l'incitation à la
consommation sans qu'il ait été nécessaire d'allonger la jour-
née de travail, le capitalisme qui, aux yeux des masses, était
sorti ébranlé de la Deuxième Guerre mondiale, se présente
aujourd'hui avec les transformations que nous avons signalées
comme une organisation économique capable de rendre moins
spontané, s'il l'a jamais été, l'éveil d'une conscience de classe.
La première révolution industrielle s'était accompagnée, dans
l'organisation du travail, des premiers balbutiements du
taylorisme contre lequel le mouvement ouvrier des pays
capitalistes trouva motif à son essor. C'est sur ces expériences
de luttes, qu'après Octobre 1917, se créa le mouvement com-
muniste international. La deuxième révolution industrielle
s'accompagne d'une extension massive du salariat mais les
nouvelles formes d'organisations du travail, de même que les
exigences techniques de la production, ont eu des incidences
profondes sur la structure de la classe ouvrière. Le déplacement
de la force de travail des fonctions d'exécution vers les fonc-
tions de contrôle, les spécialisations toujours plus poussées
que requiert la production moderne diminuent la conscience
25. P. DRUCKER : Aulomation implication for thé future, p. 215. Norris
Phillipson éd., New York, 1962.
Phillipson éd., New York, 1962.
LES TEMPS MODERNES 266-267
17
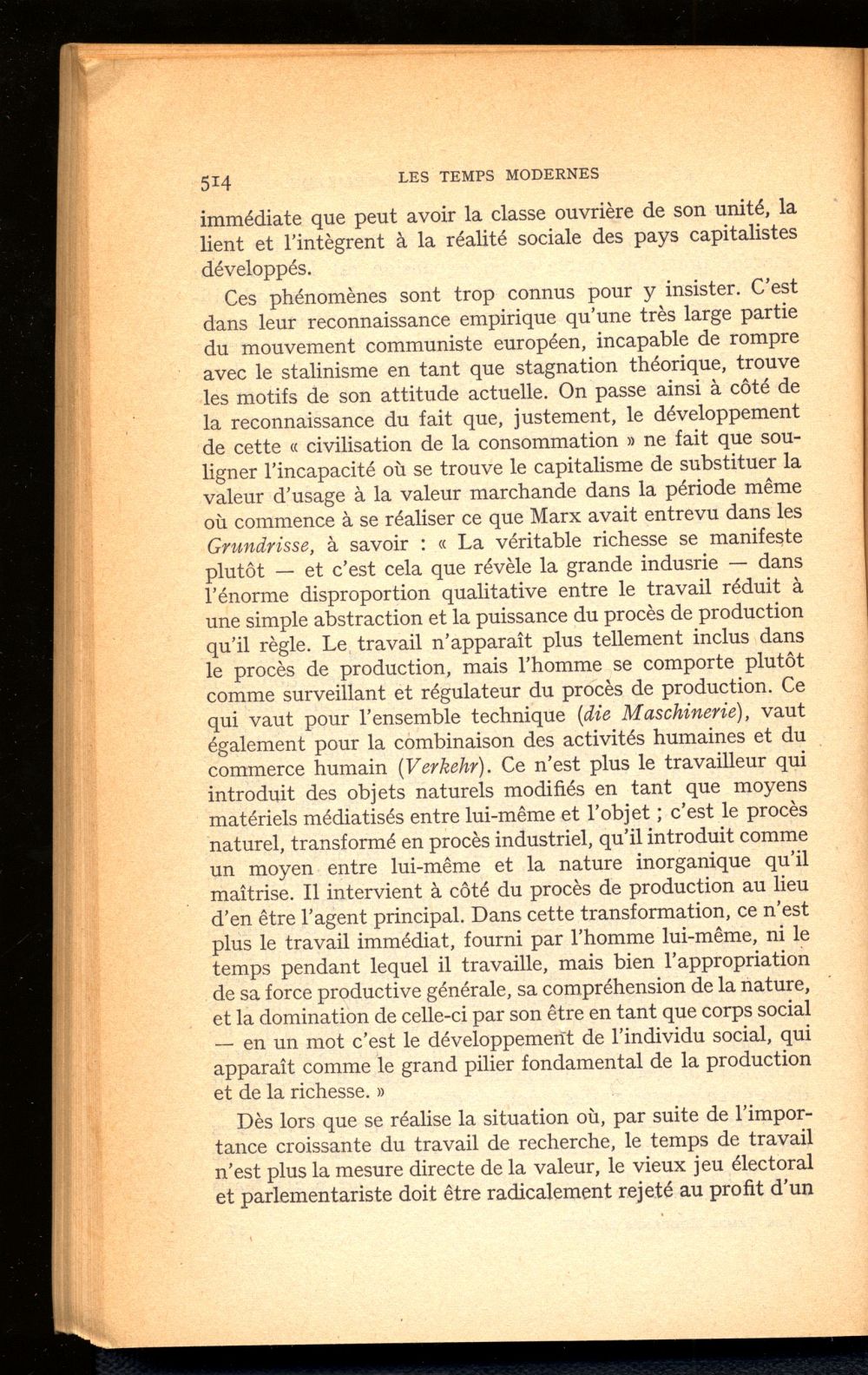

LES TEMPS MODERNES
immédiate que peut avoir la classe ouvrière de son unité, la
lient et l'intègrent à la réalité sociale des pays capitalistes
développés.
lient et l'intègrent à la réalité sociale des pays capitalistes
développés.
Ces phénomènes sont trop connus pour y insister. C'est
dans leur reconnaissance empirique qu'une très large partie
du mouvement communiste européen, incapable de rompre
avec le stalinisme en tant que stagnation théorique, trouve
les motifs de son attitude actuelle. On passe ainsi à côté de
la reconnaissance du fait que, justement, le développement
de cette « civilisation de la consommation » ne fait que sou-
ligner l'incapacité où se trouve le capitalisme de substituer la
valeur d'usage à la valeur marchande dans la période même
où commence à se réaliser ce que Marx avait entrevu dans les
Grundrisse, à savoir : « La véritable richesse se manifeste
plutôt — et c'est cela que révèle la grande indusrie — dans
l'énorme disproportion qualitative entre le travail réduit à
une simple abstraction et la puissance du procès de production
qu'il règle. Le travail n'apparaît plus tellement inclus dans
le procès de production, mais l'homme se comporte plutôt
comme surveillant et régulateur du procès de production. Ce
qui vaut pour l'ensemble technique (die Maschinerie), vaut
également pour la combinaison des activités humaines et du
commerce humain (Verkehr). Ce n'est plus le travailleur qui
introduit des objets naturels modifiés en tant que moyens
matériels médiatisés entre lui-même et l'objet ; c'est le procès
naturel, transformé en procès industriel, qu'il introduit comme
un moyen entre lui-même et la nature inorganique qu'il
maîtrise. Il intervient à côté du procès de production au lieu
d'en être l'agent principal. Dans cette transformation, ce n'est
plus le travail immédiat, fourni par l'homme lui-même, ni le
temps pendant lequel il travaille, mais bien l'appropriation
de sa force productive générale, sa compréhension de la nature,
et la domination de celle-ci par son être en tant que corps social
— en un mot c'est le développement de l'individu social, qui
apparaît comme le grand pilier fondamental de la production
et de la richesse. »
dans leur reconnaissance empirique qu'une très large partie
du mouvement communiste européen, incapable de rompre
avec le stalinisme en tant que stagnation théorique, trouve
les motifs de son attitude actuelle. On passe ainsi à côté de
la reconnaissance du fait que, justement, le développement
de cette « civilisation de la consommation » ne fait que sou-
ligner l'incapacité où se trouve le capitalisme de substituer la
valeur d'usage à la valeur marchande dans la période même
où commence à se réaliser ce que Marx avait entrevu dans les
Grundrisse, à savoir : « La véritable richesse se manifeste
plutôt — et c'est cela que révèle la grande indusrie — dans
l'énorme disproportion qualitative entre le travail réduit à
une simple abstraction et la puissance du procès de production
qu'il règle. Le travail n'apparaît plus tellement inclus dans
le procès de production, mais l'homme se comporte plutôt
comme surveillant et régulateur du procès de production. Ce
qui vaut pour l'ensemble technique (die Maschinerie), vaut
également pour la combinaison des activités humaines et du
commerce humain (Verkehr). Ce n'est plus le travailleur qui
introduit des objets naturels modifiés en tant que moyens
matériels médiatisés entre lui-même et l'objet ; c'est le procès
naturel, transformé en procès industriel, qu'il introduit comme
un moyen entre lui-même et la nature inorganique qu'il
maîtrise. Il intervient à côté du procès de production au lieu
d'en être l'agent principal. Dans cette transformation, ce n'est
plus le travail immédiat, fourni par l'homme lui-même, ni le
temps pendant lequel il travaille, mais bien l'appropriation
de sa force productive générale, sa compréhension de la nature,
et la domination de celle-ci par son être en tant que corps social
— en un mot c'est le développement de l'individu social, qui
apparaît comme le grand pilier fondamental de la production
et de la richesse. »
Dès lors que se réalise la situation où, par suite de l'impor-
tance croissante du travail de recherche, le temps de travail
n'est plus la mesure directe de la valeur, le vieux jeu électoral
et parlementariste doit être radicalement rejeté au profit d'un
tance croissante du travail de recherche, le temps de travail
n'est plus la mesure directe de la valeur, le vieux jeu électoral
et parlementariste doit être radicalement rejeté au profit d'un
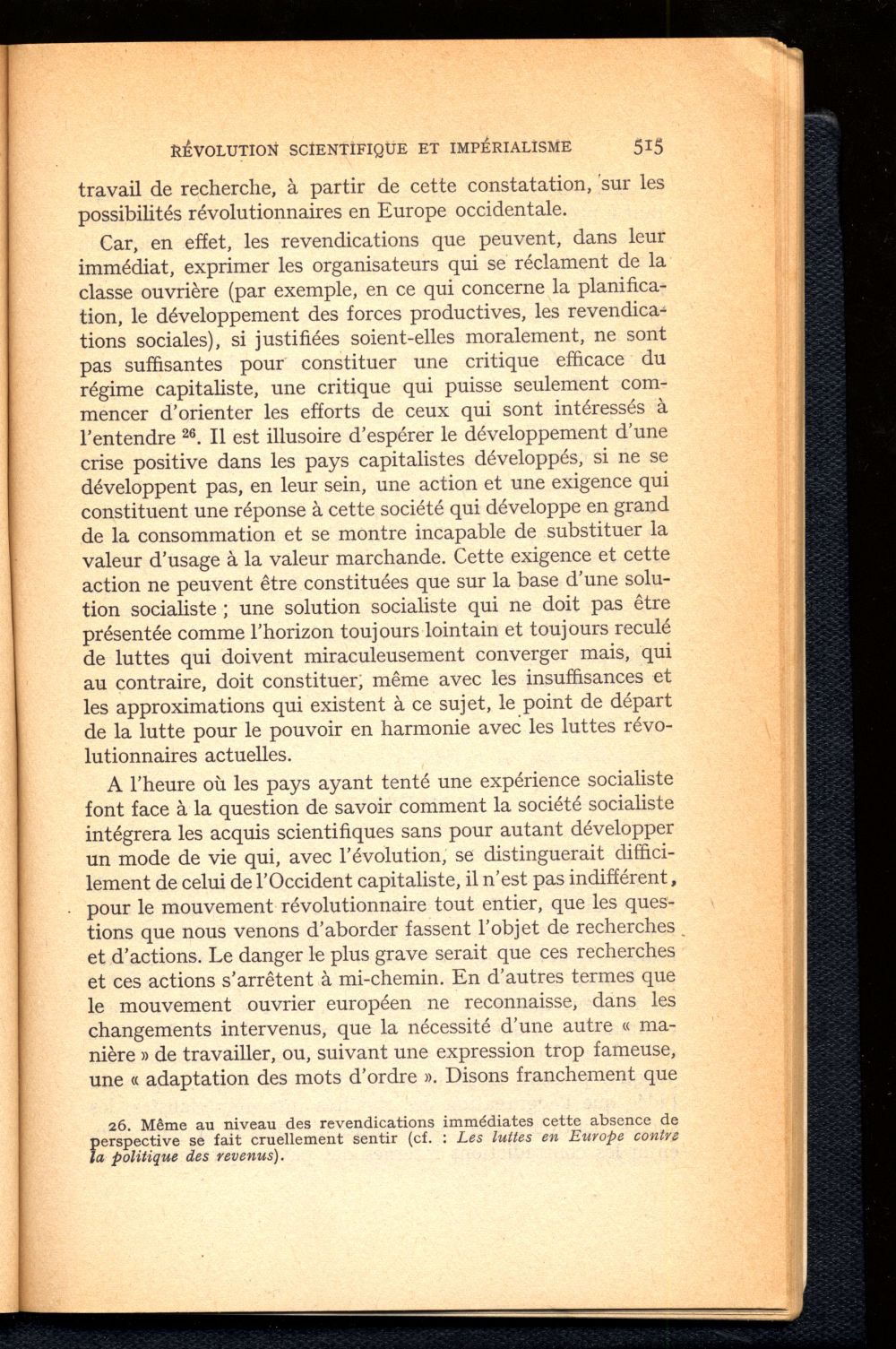

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
515
travail de recherche, à partir de cette constatation, sur les
possibilités révolutionnaires en Europe occidentale.
possibilités révolutionnaires en Europe occidentale.
Car, en effet, les revendications que peuvent, dans leur
immédiat, exprimer les organisateurs qui se réclament de la
classe ouvrière (par exemple, en ce qui concerne la planifica-
tion, le développement des forces productives, les revendica-
tions sociales), si justifiées soient-elles moralement, ne sont
pas suffisantes pour constituer une critique efficace du
régime capitaliste, une critique qui puisse seulement com-
mencer d'orienter les efforts de ceux qui sont intéressés à
l'entendre 26. Il est illusoire d'espérer le développement d'une
crise positive dans les pays capitalistes développés, si ne se
développent pas, en leur sein, une action et une exigence qui
constituent une réponse à cette société qui développe en grand
de la consommation et se montre incapable de substituer la
valeur d'usage à la valeur marchande. Cette exigence et cette
action ne peuvent être constituées que sur la base d'une solu-
tion socialiste ; une solution socialiste qui ne doit pas être
présentée comme l'horizon toujours lointain et toujours reculé
de luttes qui doivent miraculeusement converger mais, qui
au contraire, doit constituer, même avec les insuffisances et
les approximations qui existent à ce sujet, le point de départ
de la lutte pour le pouvoir en harmonie avec les luttes révo-
lutionnaires actuelles.
immédiat, exprimer les organisateurs qui se réclament de la
classe ouvrière (par exemple, en ce qui concerne la planifica-
tion, le développement des forces productives, les revendica-
tions sociales), si justifiées soient-elles moralement, ne sont
pas suffisantes pour constituer une critique efficace du
régime capitaliste, une critique qui puisse seulement com-
mencer d'orienter les efforts de ceux qui sont intéressés à
l'entendre 26. Il est illusoire d'espérer le développement d'une
crise positive dans les pays capitalistes développés, si ne se
développent pas, en leur sein, une action et une exigence qui
constituent une réponse à cette société qui développe en grand
de la consommation et se montre incapable de substituer la
valeur d'usage à la valeur marchande. Cette exigence et cette
action ne peuvent être constituées que sur la base d'une solu-
tion socialiste ; une solution socialiste qui ne doit pas être
présentée comme l'horizon toujours lointain et toujours reculé
de luttes qui doivent miraculeusement converger mais, qui
au contraire, doit constituer, même avec les insuffisances et
les approximations qui existent à ce sujet, le point de départ
de la lutte pour le pouvoir en harmonie avec les luttes révo-
lutionnaires actuelles.
A l'heure où les pays ayant tenté une expérience socialiste
font face à la question de savoir comment la société socialiste
intégrera les acquis scientifiques sans pour autant développer
un mode de vie qui, avec l'évolution, se distinguerait diffici-
lement de celui de l'Occident capitaliste, il n'est pas indifférent,
pour le mouvement révolutionnaire tout entier, que les ques-
tions que nous venons d'aborder fassent l'objet de recherches
et d'actions. Le danger le plus grave serait que ces recherches
et ces actions s'arrêtent à mi-chemin. En d'autres termes que
le mouvement ouvrier européen ne reconnaisse, dans les
changements intervenus, que la nécessité d'une autre « ma-
nière » de travailler, ou, suivant une expression trop fameuse,
une « adaptation des mots d'ordre ». Disons franchement que
font face à la question de savoir comment la société socialiste
intégrera les acquis scientifiques sans pour autant développer
un mode de vie qui, avec l'évolution, se distinguerait diffici-
lement de celui de l'Occident capitaliste, il n'est pas indifférent,
pour le mouvement révolutionnaire tout entier, que les ques-
tions que nous venons d'aborder fassent l'objet de recherches
et d'actions. Le danger le plus grave serait que ces recherches
et ces actions s'arrêtent à mi-chemin. En d'autres termes que
le mouvement ouvrier européen ne reconnaisse, dans les
changements intervenus, que la nécessité d'une autre « ma-
nière » de travailler, ou, suivant une expression trop fameuse,
une « adaptation des mots d'ordre ». Disons franchement que
26. Même au niveau des revendications immédiates cette absence de
perspective se fait cruellement sentir (cf. : Les luttes en Europe contre
la. politique des revenus).
perspective se fait cruellement sentir (cf. : Les luttes en Europe contre
la. politique des revenus).
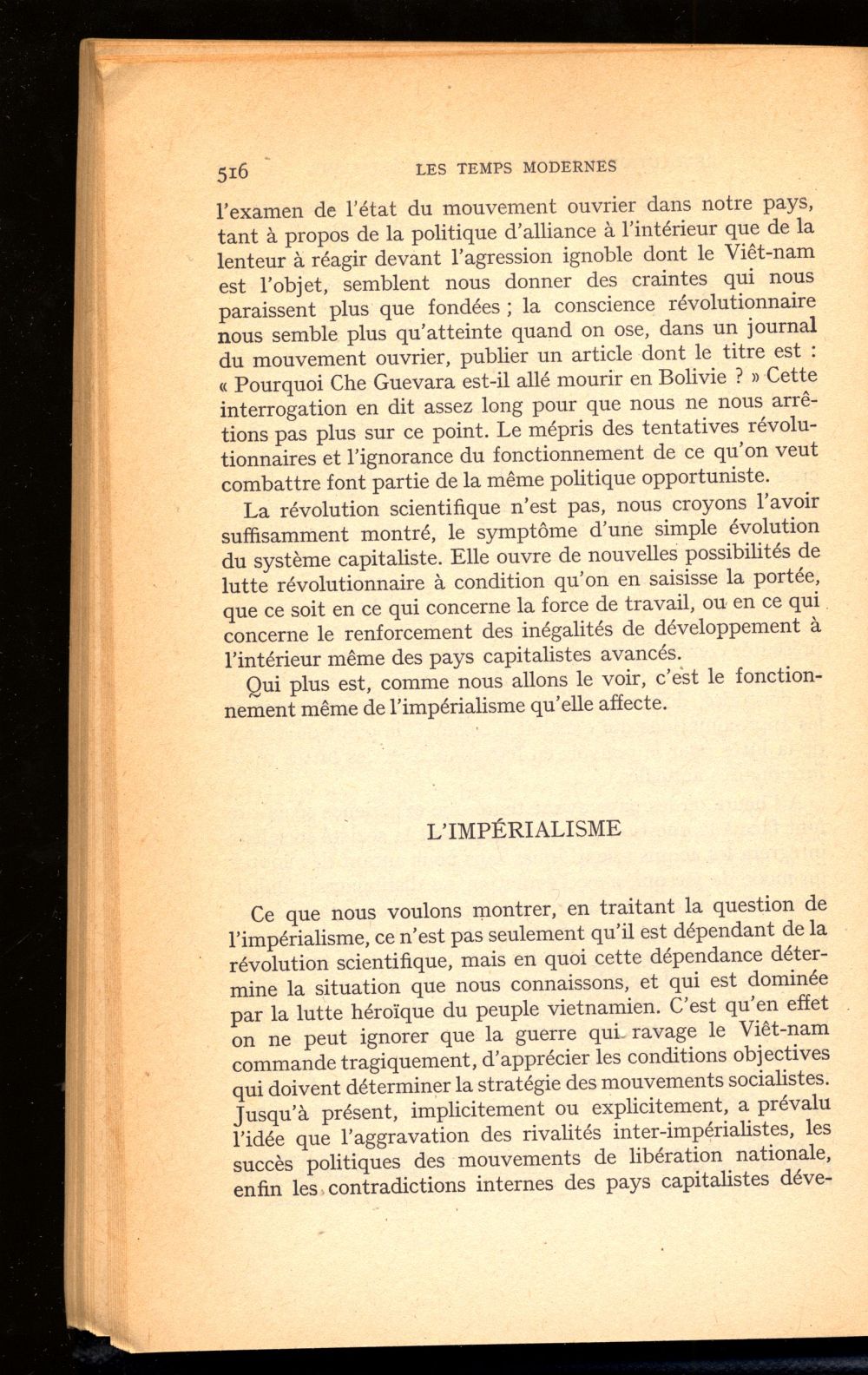

5i6
LES TEMPS MODERNES
l'examen de l'état du mouvement ouvrier dans notre pays,
tant à propos de la politique d'alliance à l'intérieur que de la
lenteur à réagir devant l'agression ignoble dont le Viêt-nam
est l'objet, semblent nous donner des craintes qui nous
paraissent plus que fondées ; la conscience révolutionnaire
nous semble plus qu'atteinte quand on ose, dans un journal
du mouvement ouvrier, publier un article dont le titre est :
« Pourquoi Che Guevara est-il allé mourir en Bolivie ? » Cette
interrogation en dit assez long pour que nous ne nous arrê-
tions pas plus sur ce point. Le mépris des tentatives révolu-
tionnaires et l'ignorance du fonctionnement de ce qu'on veut
combattre font partie de la même politique opportuniste.
tant à propos de la politique d'alliance à l'intérieur que de la
lenteur à réagir devant l'agression ignoble dont le Viêt-nam
est l'objet, semblent nous donner des craintes qui nous
paraissent plus que fondées ; la conscience révolutionnaire
nous semble plus qu'atteinte quand on ose, dans un journal
du mouvement ouvrier, publier un article dont le titre est :
« Pourquoi Che Guevara est-il allé mourir en Bolivie ? » Cette
interrogation en dit assez long pour que nous ne nous arrê-
tions pas plus sur ce point. Le mépris des tentatives révolu-
tionnaires et l'ignorance du fonctionnement de ce qu'on veut
combattre font partie de la même politique opportuniste.
La révolution scientifique n'est pas, nous croyons l'avoir
suffisamment montré, le symptôme d'une simple évolution
du système capitaliste. Elle ouvre de nouvelles possibilités de
lutte révolutionnaire à condition qu'on en saisisse la portée,
que ce soit en ce qui concerne la force de travail, ou en ce qui
concerne le renforcement des inégalités de développement à
l'intérieur même des pays capitalistes avancés.
suffisamment montré, le symptôme d'une simple évolution
du système capitaliste. Elle ouvre de nouvelles possibilités de
lutte révolutionnaire à condition qu'on en saisisse la portée,
que ce soit en ce qui concerne la force de travail, ou en ce qui
concerne le renforcement des inégalités de développement à
l'intérieur même des pays capitalistes avancés.
Qui plus est, comme nous allons le voir, c'est le fonction-
nement même de l'impérialisme qu'elle affecte.
nement même de l'impérialisme qu'elle affecte.
L'IMPÉRIALISME
Ce que nous voulons montrer, en traitant la question de
l'impérialisme, ce n'est pas seulement qu'il est dépendant de la
révolution scientifique, mais en quoi cette dépendance déter-
mine la situation que nous connaissons, et qui est dominée
par la lutte héroïque du peuple vietnamien. C'est qu'en effet
on ne peut ignorer que la guerre qui ravage le Viêt-nam
commande tragiquement, d'apprécier les conditions objectives
qui doivent déterminer la stratégie des mouvements socialistes.
Jusqu'à présent, implicitement ou explicitement, a prévalu
l'idée que l'aggravation des rivalités inter-impérialistes, les
succès politiques des mouvements de libération nationale,
enfin les contradictions internes des pays capitalistes déve-
l'impérialisme, ce n'est pas seulement qu'il est dépendant de la
révolution scientifique, mais en quoi cette dépendance déter-
mine la situation que nous connaissons, et qui est dominée
par la lutte héroïque du peuple vietnamien. C'est qu'en effet
on ne peut ignorer que la guerre qui ravage le Viêt-nam
commande tragiquement, d'apprécier les conditions objectives
qui doivent déterminer la stratégie des mouvements socialistes.
Jusqu'à présent, implicitement ou explicitement, a prévalu
l'idée que l'aggravation des rivalités inter-impérialistes, les
succès politiques des mouvements de libération nationale,
enfin les contradictions internes des pays capitalistes déve-
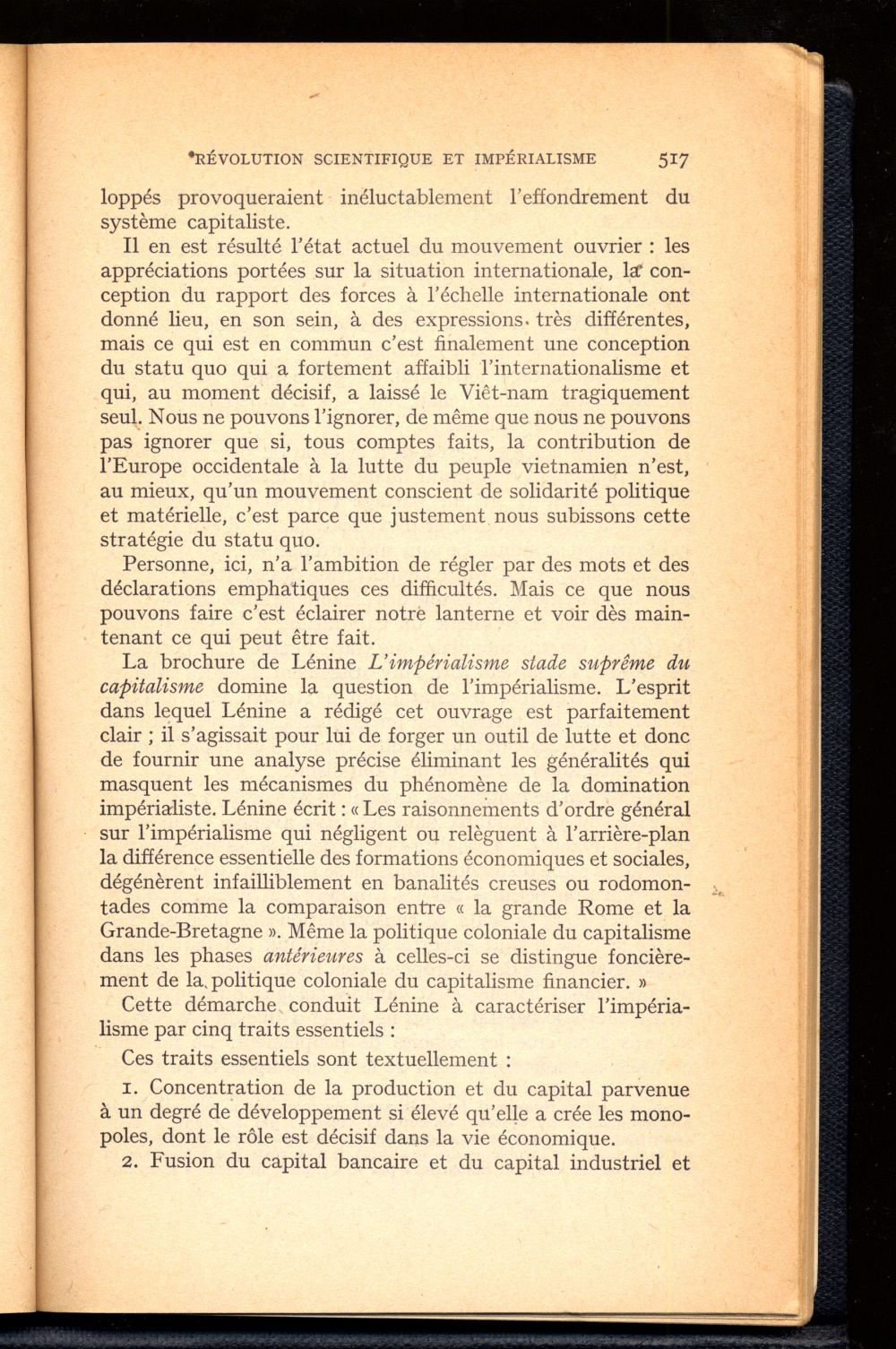

•RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
517
loppés provoqueraient inéluctablement l'effondrement du
système capitaliste.
système capitaliste.
Il en est résulté l'état actuel du mouvement ouvrier : les
appréciations portées sur la situation internationale, la' con-
ception du rapport des forces à l'échelle internationale ont
donné lieu, en son sein, à des expressions, très différentes,
mais ce qui est en commun c'est finalement une conception
du statu quo qui a fortement affaibli l'internationalisme et
qui, au moment décisif, a laissé le Viêt-nam tragiquement
seul. Nous ne pouvons l'ignorer, de même que nous ne pouvons
pas ignorer que si, tous comptes faits, la contribution de
l'Europe occidentale à la lutte du peuple vietnamien n'est,
au mieux, qu'un mouvement conscient de solidarité politique
et matérielle, c'est parce que justement nous subissons cette
stratégie du statu quo.
appréciations portées sur la situation internationale, la' con-
ception du rapport des forces à l'échelle internationale ont
donné lieu, en son sein, à des expressions, très différentes,
mais ce qui est en commun c'est finalement une conception
du statu quo qui a fortement affaibli l'internationalisme et
qui, au moment décisif, a laissé le Viêt-nam tragiquement
seul. Nous ne pouvons l'ignorer, de même que nous ne pouvons
pas ignorer que si, tous comptes faits, la contribution de
l'Europe occidentale à la lutte du peuple vietnamien n'est,
au mieux, qu'un mouvement conscient de solidarité politique
et matérielle, c'est parce que justement nous subissons cette
stratégie du statu quo.
Personne, ici, n'a l'ambition de régler par des mots et des
déclarations emphatiques ces difficultés. Mais ce que nous
pouvons faire c'est éclairer notre lanterne et voir dès main-
tenant ce qui peut être fait.
déclarations emphatiques ces difficultés. Mais ce que nous
pouvons faire c'est éclairer notre lanterne et voir dès main-
tenant ce qui peut être fait.
La brochure de Lénine L'impérialisme stade suprême du
capitalisme domine la question de l'impérialisme. L'esprit
dans lequel Lénine a rédigé cet ouvrage est parfaitement
clair ; il s'agissait pour lui de forger un outil de lutte et donc
de fournir une analyse précise éliminant les généralités qui
masquent les mécanismes du phénomène de la domination
impérialiste. Lénine écrit : «Les raisonnements d'ordre général
sur l'impérialisme qui négligent ou relèguent à l'arrière-plan
la différence essentielle des formations économiques et sociales,
dégénèrent infailliblement en banalités creuses ou rodomon-
tades comme la comparaison entre « la grande Rome et la
Grande-Bretagne ». Même la politique coloniale du capitalisme
dans les phases antérieures à celles-ci se distingue foncière-
ment de la, politique coloniale du capitalisme financier. »
capitalisme domine la question de l'impérialisme. L'esprit
dans lequel Lénine a rédigé cet ouvrage est parfaitement
clair ; il s'agissait pour lui de forger un outil de lutte et donc
de fournir une analyse précise éliminant les généralités qui
masquent les mécanismes du phénomène de la domination
impérialiste. Lénine écrit : «Les raisonnements d'ordre général
sur l'impérialisme qui négligent ou relèguent à l'arrière-plan
la différence essentielle des formations économiques et sociales,
dégénèrent infailliblement en banalités creuses ou rodomon-
tades comme la comparaison entre « la grande Rome et la
Grande-Bretagne ». Même la politique coloniale du capitalisme
dans les phases antérieures à celles-ci se distingue foncière-
ment de la, politique coloniale du capitalisme financier. »
Cette démarche conduit Lénine à caractériser l'impéria-
lisme par cinq traits essentiels :
lisme par cinq traits essentiels :
Ces traits essentiels sont textuellement :
1. Concentration de la production et du capital parvenue
à un degré de développement si élevé qu'elle a crée les mono-
poles, dont le rôle est décisif dans la vie économique.
à un degré de développement si élevé qu'elle a crée les mono-
poles, dont le rôle est décisif dans la vie économique.
2. Fusion du capital bancaire et du capital industriel et
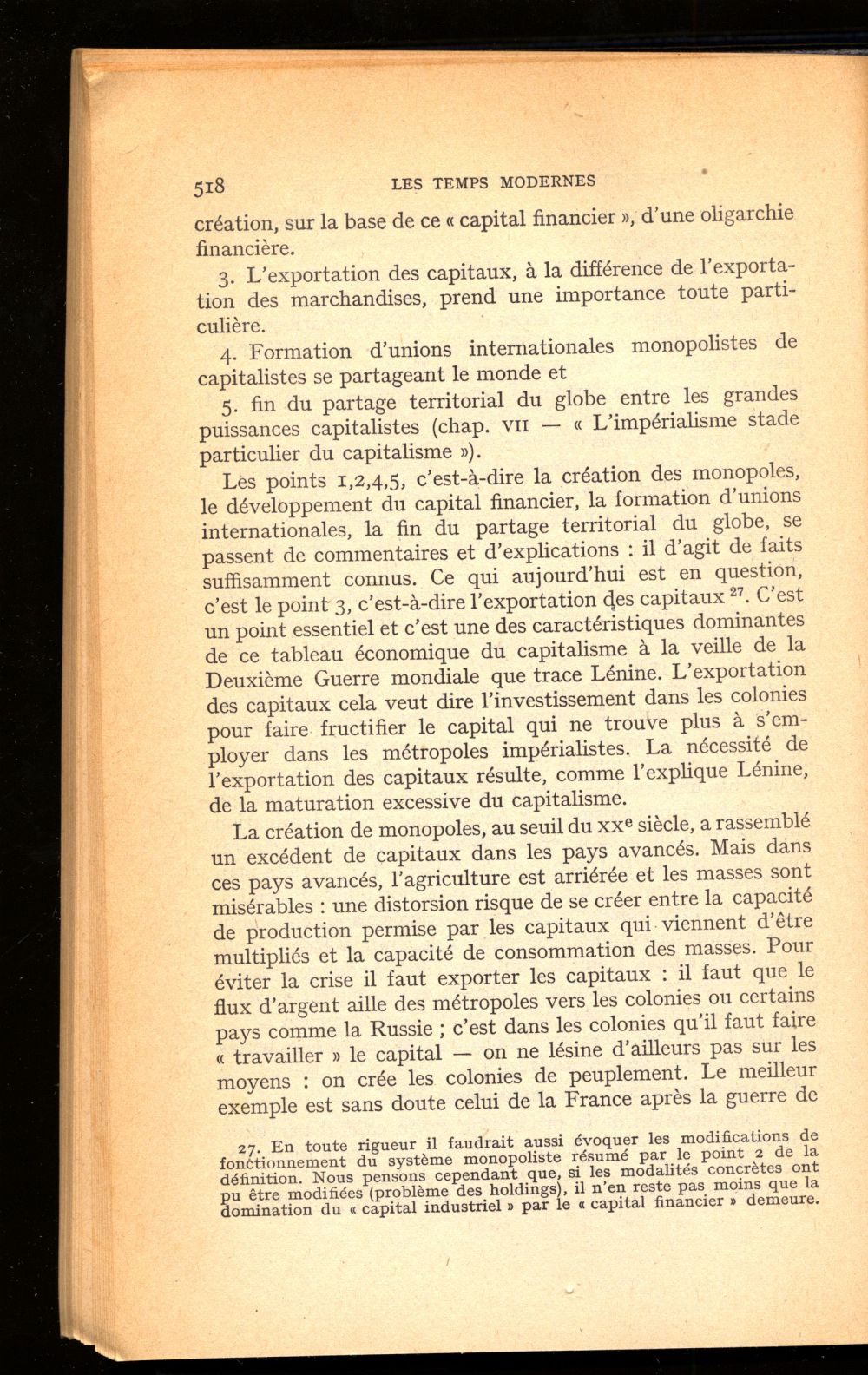

5l8 LES TEMPS MODERNES
création, sur la base de ce « capital financier », d'une oligarchie
financière.
financière.
3. L'exportation des capitaux, à la différence de l'exporta-
tion des marchandises, prend une importance toute parti-
culière.
tion des marchandises, prend une importance toute parti-
culière.
4. Formation d'unions internationales monopolistes de
capitalistes se partageant le monde et
capitalistes se partageant le monde et
5. fin du partage territorial du globe entre les grandes
puissances capitalistes (chap. vu — « L'impérialisme stade
particulier du capitalisme »).
puissances capitalistes (chap. vu — « L'impérialisme stade
particulier du capitalisme »).
Les points 1,2,4,5, c'est-à-dire la création des monopoles,
le développement du capital financier, la formation d'unions
internationales, la fin du partage territorial du globe, se
passent de commentaires et d'explications : il d'agit de faits
suffisamment connus. Ce qui aujourd'hui est en question,
c'est le point 3, c'est-à-dire l'exportation des capitaux21. C'est
un point essentiel et c'est une des caractéristiques dominantes
de ce tableau économique du capitalisme à la veille de la
Deuxième Guerre mondiale que trace Lénine. L'exportation
des capitaux cela veut dire l'investissement dans les colonies
pour faire fructifier le capital qui ne trouve plus à s'em-
ployer dans les métropoles impérialistes. La nécessité de
l'exportation des capitaux résulte, comme l'explique Lénine,
de la maturation excessive du capitalisme.
le développement du capital financier, la formation d'unions
internationales, la fin du partage territorial du globe, se
passent de commentaires et d'explications : il d'agit de faits
suffisamment connus. Ce qui aujourd'hui est en question,
c'est le point 3, c'est-à-dire l'exportation des capitaux21. C'est
un point essentiel et c'est une des caractéristiques dominantes
de ce tableau économique du capitalisme à la veille de la
Deuxième Guerre mondiale que trace Lénine. L'exportation
des capitaux cela veut dire l'investissement dans les colonies
pour faire fructifier le capital qui ne trouve plus à s'em-
ployer dans les métropoles impérialistes. La nécessité de
l'exportation des capitaux résulte, comme l'explique Lénine,
de la maturation excessive du capitalisme.
La création de monopoles, au seuil du xxe siècle, a rassemblé
un excédent de capitaux dans les pays avancés. Mais dans
ces pays avancés, l'agriculture est arriérée et les masses sont
misérables : une distorsion risque de se créer entre la capacité
de production permise par les capitaux qui viennent d'être
multipliés et la capacité de consommation des masses. Pour
éviter la crise il faut exporter les capitaux : il faut que le
flux d'argent aille des métropoles vers les colonies ou certains
pays comme la Russie ; c'est dans les colonies qu'il faut faire
« travailler » le capital — on ne lésine d'ailleurs pas sur les
moyens : on crée les colonies de peuplement. Le meilleur
exemple est sans doute celui de la France après la guerre de
un excédent de capitaux dans les pays avancés. Mais dans
ces pays avancés, l'agriculture est arriérée et les masses sont
misérables : une distorsion risque de se créer entre la capacité
de production permise par les capitaux qui viennent d'être
multipliés et la capacité de consommation des masses. Pour
éviter la crise il faut exporter les capitaux : il faut que le
flux d'argent aille des métropoles vers les colonies ou certains
pays comme la Russie ; c'est dans les colonies qu'il faut faire
« travailler » le capital — on ne lésine d'ailleurs pas sur les
moyens : on crée les colonies de peuplement. Le meilleur
exemple est sans doute celui de la France après la guerre de
27. En toute rigueur il faudrait aussi évoquer les modifications de
fonctionnement du système monopoliste résumé par le point 2 de la
définition. Nous pensons cependant que, si les modalités concrètes ont
pu être modifiées (problème des holdings), il n'en reste pas moins que la
domination du « capital industriel » par le « capital financier » demeure.
fonctionnement du système monopoliste résumé par le point 2 de la
définition. Nous pensons cependant que, si les modalités concrètes ont
pu être modifiées (problème des holdings), il n'en reste pas moins que la
domination du « capital industriel » par le « capital financier » demeure.
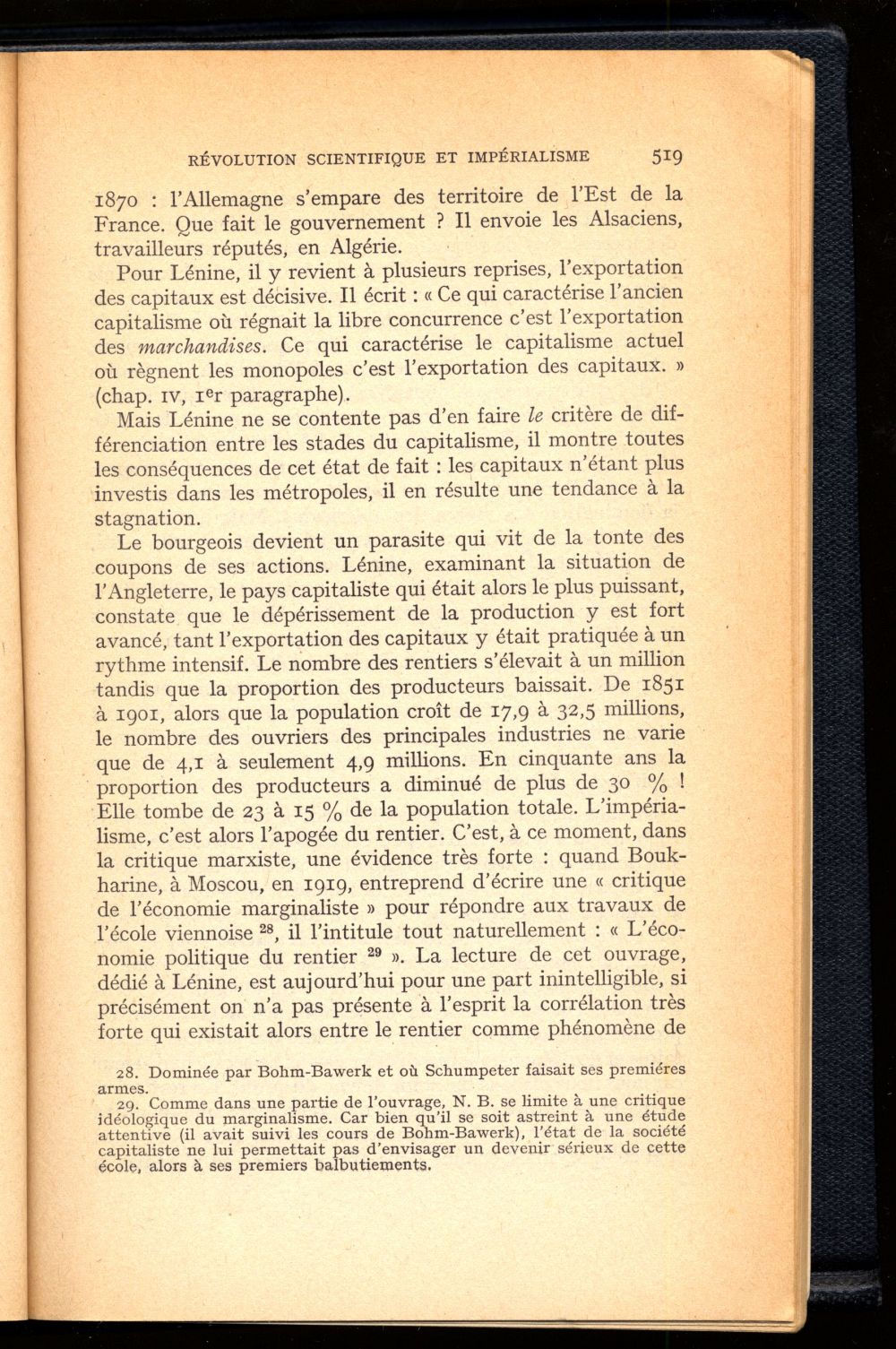

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
519
1870 : l'Allemagne s'empare des territoire de l'Est de la
France. Que fait le gouvernement ? Il envoie les Alsaciens,
travailleurs réputés, en Algérie.
France. Que fait le gouvernement ? Il envoie les Alsaciens,
travailleurs réputés, en Algérie.
Pour Lénine, il y revient à plusieurs reprises, l'exportation
des capitaux est décisive. Il écrit : « Ce qui caractérise l'ancien
capitalisme où régnait la libre concurrence c'est l'exportation
des marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme actuel
ou régnent les monopoles c'est l'exportation des capitaux. »
(chap. iv, ier paragraphe).
des capitaux est décisive. Il écrit : « Ce qui caractérise l'ancien
capitalisme où régnait la libre concurrence c'est l'exportation
des marchandises. Ce qui caractérise le capitalisme actuel
ou régnent les monopoles c'est l'exportation des capitaux. »
(chap. iv, ier paragraphe).
Mais Lénine ne se contente pas d'en faire le critère de dif-
férenciation entre les stades du capitalisme, il montre toutes
les conséquences de cet état de fait : les capitaux n'étant plus
investis dans les métropoles, il en résulte une tendance à la
stagnation.
férenciation entre les stades du capitalisme, il montre toutes
les conséquences de cet état de fait : les capitaux n'étant plus
investis dans les métropoles, il en résulte une tendance à la
stagnation.
Le bourgeois devient un parasite qui vit de la tonte des
coupons de ses actions. Lénine, examinant la situation de
l'Angleterre, le pays capitaliste qui était alors le plus puissant,
constate que le dépérissement de la production y est fort
avancé, tant l'exportation des capitaux y était pratiquée à un
rythme intensif. Le nombre des rentiers s'élevait à un million
tandis que la proportion des producteurs baissait. De 1851
à 1901, alors que la population croît de 17,9 à 32,5 millions,
le nombre des ouvriers des principales industries ne varie
que de 4,1 à seulement 4,9 millions. En cinquante ans la
proportion des producteurs a diminué de plus de 30 % !
Elle tombe de 23 à 15 % de la population totale. L'impéria-
lisme, c'est alors l'apogée du rentier. C'est, à ce moment, dans
la critique marxiste, une évidence très forte : quand Bouk-
harine, à Moscou, en 1919, entreprend d'écrire une « critique
de l'économie marginaliste » pour répondre aux travaux de
l'école viennoise 28, il l'intitule tout naturellement : « L'éco-
nomie politique du rentier 29 ». La lecture de cet ouvrage,
dédié à Lénine, est aujourd'hui pour une part inintelligible, si
précisément on n'a pas présente à l'esprit la corrélation très
forte qui existait alors entre le rentier comme phénomène de
coupons de ses actions. Lénine, examinant la situation de
l'Angleterre, le pays capitaliste qui était alors le plus puissant,
constate que le dépérissement de la production y est fort
avancé, tant l'exportation des capitaux y était pratiquée à un
rythme intensif. Le nombre des rentiers s'élevait à un million
tandis que la proportion des producteurs baissait. De 1851
à 1901, alors que la population croît de 17,9 à 32,5 millions,
le nombre des ouvriers des principales industries ne varie
que de 4,1 à seulement 4,9 millions. En cinquante ans la
proportion des producteurs a diminué de plus de 30 % !
Elle tombe de 23 à 15 % de la population totale. L'impéria-
lisme, c'est alors l'apogée du rentier. C'est, à ce moment, dans
la critique marxiste, une évidence très forte : quand Bouk-
harine, à Moscou, en 1919, entreprend d'écrire une « critique
de l'économie marginaliste » pour répondre aux travaux de
l'école viennoise 28, il l'intitule tout naturellement : « L'éco-
nomie politique du rentier 29 ». La lecture de cet ouvrage,
dédié à Lénine, est aujourd'hui pour une part inintelligible, si
précisément on n'a pas présente à l'esprit la corrélation très
forte qui existait alors entre le rentier comme phénomène de
28. Dominée par Bohm-Bawerk et où Schumpeter faisait ses premières
armes.
armes.
29. Comme dans une partie de l'ouvrage, N. B. se limite à une critique
idéologique du marginalisme. Car bien qu'il se soit astreint à une étude
attentive (il avait suivi les cours de Bohm-Bawerk), l'état de la société
capitaliste ne lui permettait pas d'envisager un devenir sérieux de cette
école, alors à ses premiers balbutiements.
idéologique du marginalisme. Car bien qu'il se soit astreint à une étude
attentive (il avait suivi les cours de Bohm-Bawerk), l'état de la société
capitaliste ne lui permettait pas d'envisager un devenir sérieux de cette
école, alors à ses premiers balbutiements.
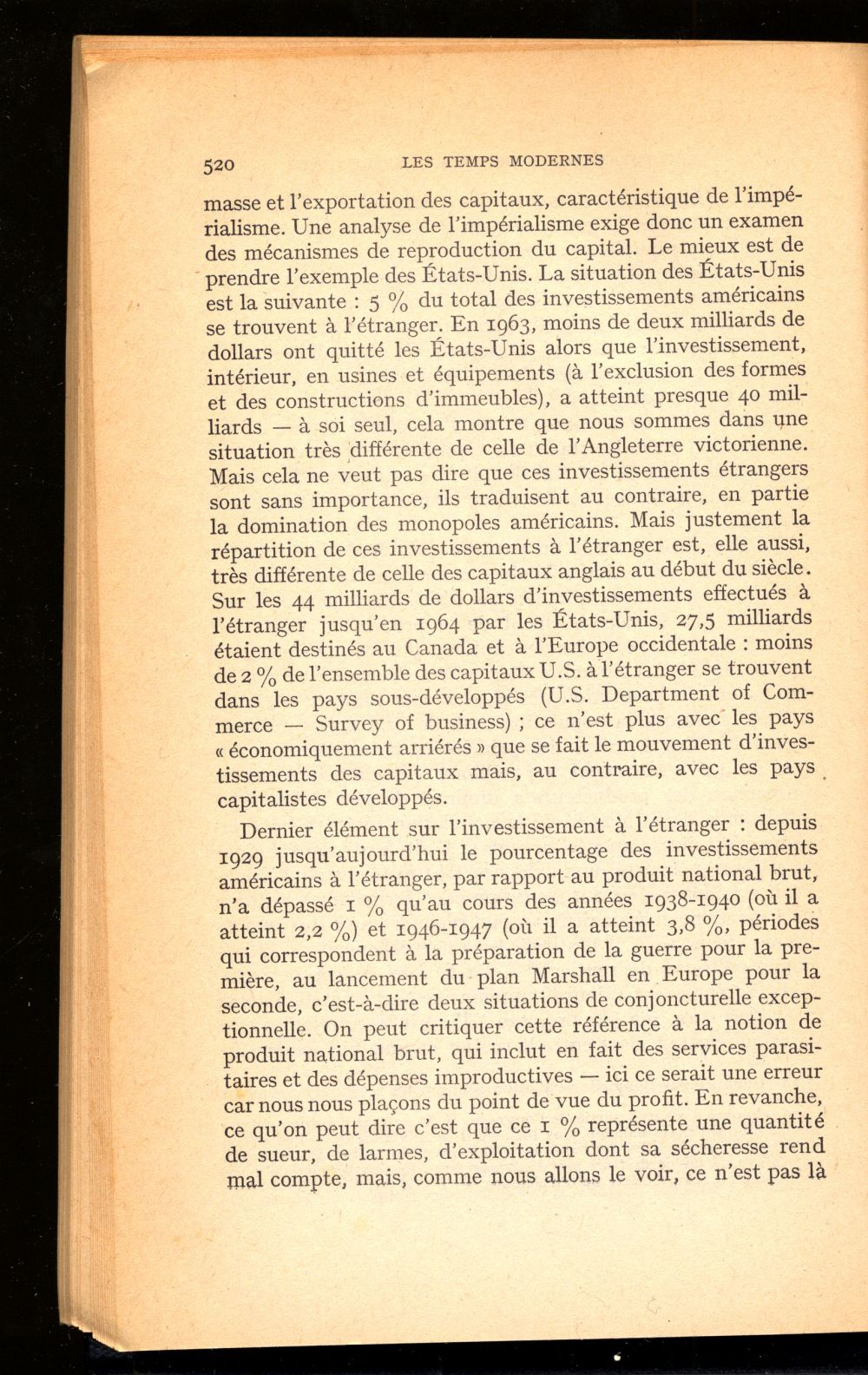

520
LES TEMPS MODERNES
masse et l'exportation clés capitaux, caractéristique de l'impé-
rialisme. Une analyse de l'impérialisme exige donc un examen
des mécanismes de reproduction du capital. Le mieux est de
prendre l'exemple des États-Unis. La situation des États-Unis
est la suivante : 5 % du total des investissements américains
se trouvent à l'étranger. En 1963, moins de deux milliards de
dollars ont quitte les Etats-Unis alors que l'investissement,
intérieur, en usines et équipements (à l'exclusion des formes
et des constructions d'immeubles), a atteint presque 40 mil-
liards — à soi seul, cela montre que nous sommes dans une
situation très différente clé celle de l'Angleterre victorienne.
Mais cela ne veut pas dire que ces investissements étrangers
sont sans importance, ils traduisent au contraire, en partie
la domination des monopoles américains. Mais justement la
répartition de ces investissements à l'étranger est, elle aussi,
très différente de celle des capitaux anglais au début du siècle.
Sur les 44 milliards clc dollars d'investissements effectués à
l'étranger jusqu'en 1964 par les États-Unis, 27,5 milliards
étaient destinés au Canada et à l'Europe occidentale : moins
de 2 % de l'ensemble des capitaux U.S. à l'étranger se trouvent
dans les pays sous-développés (U.S. Department of Com-
merce — Survey of business) ; ce n'est plus avec les pays
« économiquement arriérés » que se fait le mouvement d'inves-
tissements des capitaux mais, au contraire, avec les pays
capitalistes développés.
rialisme. Une analyse de l'impérialisme exige donc un examen
des mécanismes de reproduction du capital. Le mieux est de
prendre l'exemple des États-Unis. La situation des États-Unis
est la suivante : 5 % du total des investissements américains
se trouvent à l'étranger. En 1963, moins de deux milliards de
dollars ont quitte les Etats-Unis alors que l'investissement,
intérieur, en usines et équipements (à l'exclusion des formes
et des constructions d'immeubles), a atteint presque 40 mil-
liards — à soi seul, cela montre que nous sommes dans une
situation très différente clé celle de l'Angleterre victorienne.
Mais cela ne veut pas dire que ces investissements étrangers
sont sans importance, ils traduisent au contraire, en partie
la domination des monopoles américains. Mais justement la
répartition de ces investissements à l'étranger est, elle aussi,
très différente de celle des capitaux anglais au début du siècle.
Sur les 44 milliards clc dollars d'investissements effectués à
l'étranger jusqu'en 1964 par les États-Unis, 27,5 milliards
étaient destinés au Canada et à l'Europe occidentale : moins
de 2 % de l'ensemble des capitaux U.S. à l'étranger se trouvent
dans les pays sous-développés (U.S. Department of Com-
merce — Survey of business) ; ce n'est plus avec les pays
« économiquement arriérés » que se fait le mouvement d'inves-
tissements des capitaux mais, au contraire, avec les pays
capitalistes développés.
Dernier élément sur l'investissement à l'étranger : depuis
1929 jusqu'aujourd'hui le pourcentage des investissements
américains à l'étranger, par rapport au produit national brut,
n'a dépassé i % qu'au cours des années 1938-1940 (où il a
atteint 2,2 %) et 1946-1947 (où il a atteint 3,8 %, périodes
qui correspondent à la préparation de la guerre pour la pre-
mière, au lancement du plan Marshall en Europe pour la
seconde, c'est-à-dire deux situations de conjoncturelle excep-
tionnelle. On peut critiquer cette référence à la notion de
produit national brut, qui inclut en fait des services parasi-
taires et des dépenses improductives — ici ce serait une erreur
car nous nous plaçons du point de vue du profit. En revanche,
ce qu'on peut dire c'est que ce i % représente une quantité
de sueur, de larmes, d'exploitation dont sa sécheresse rend
mal compte, mais, comme nous allons le voir, ce n'est pas là
1929 jusqu'aujourd'hui le pourcentage des investissements
américains à l'étranger, par rapport au produit national brut,
n'a dépassé i % qu'au cours des années 1938-1940 (où il a
atteint 2,2 %) et 1946-1947 (où il a atteint 3,8 %, périodes
qui correspondent à la préparation de la guerre pour la pre-
mière, au lancement du plan Marshall en Europe pour la
seconde, c'est-à-dire deux situations de conjoncturelle excep-
tionnelle. On peut critiquer cette référence à la notion de
produit national brut, qui inclut en fait des services parasi-
taires et des dépenses improductives — ici ce serait une erreur
car nous nous plaçons du point de vue du profit. En revanche,
ce qu'on peut dire c'est que ce i % représente une quantité
de sueur, de larmes, d'exploitation dont sa sécheresse rend
mal compte, mais, comme nous allons le voir, ce n'est pas là
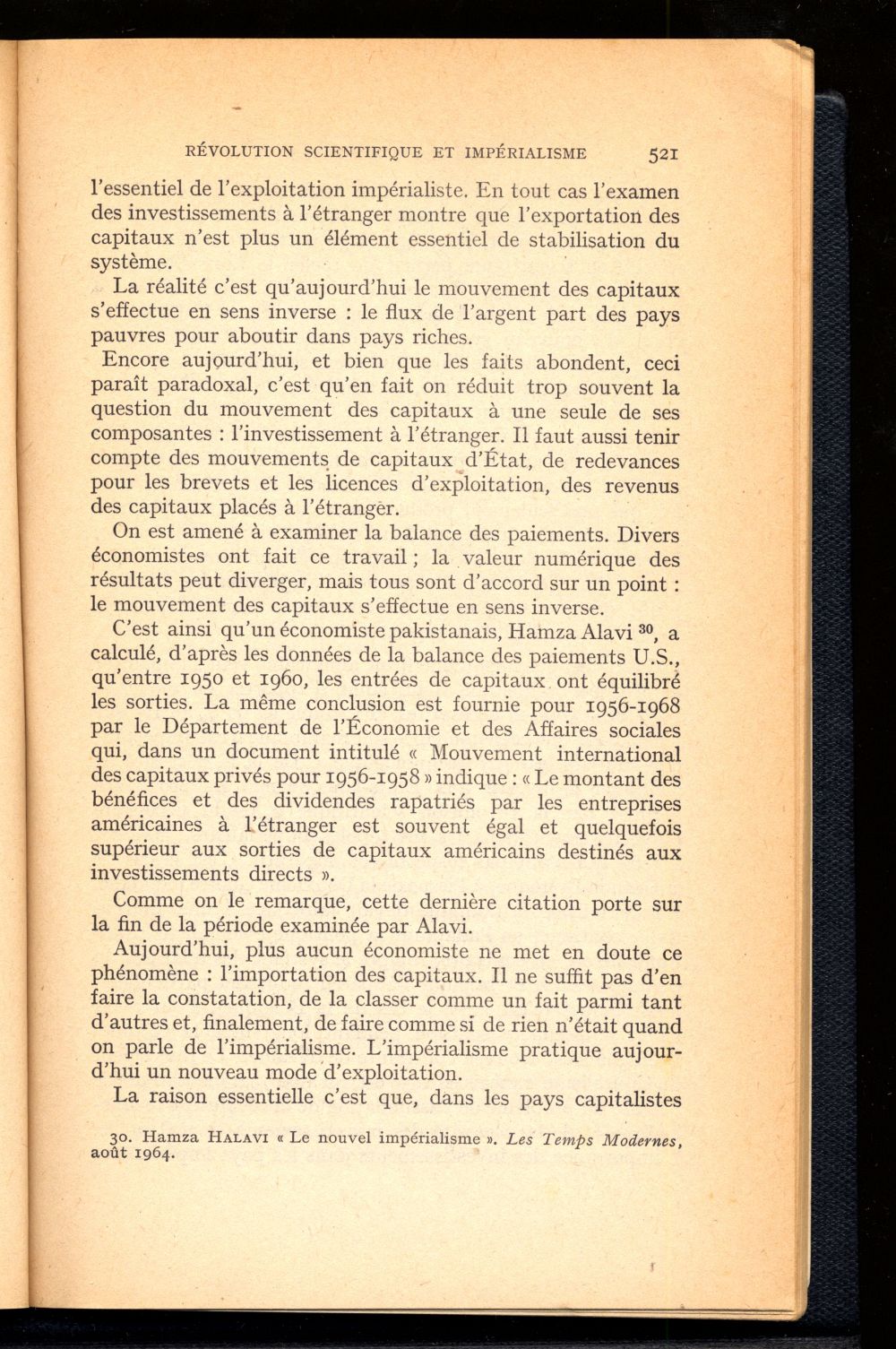

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
521
l'essentiel de l'exploitation impérialiste. En tout cas l'examen
des investissements à l'étranger montre que l'exportation des
capitaux n'est plus un élément essentiel de stabilisation du
système.
des investissements à l'étranger montre que l'exportation des
capitaux n'est plus un élément essentiel de stabilisation du
système.
La réalité c'est qu'aujourd'hui le mouvement des capitaux
s'effectue en sens inverse : le flux de l'argent part des pays
pauvres pour aboutir dans pays riches.
s'effectue en sens inverse : le flux de l'argent part des pays
pauvres pour aboutir dans pays riches.
Encore aujourd'hui, et bien que les faits abondent, ceci
paraît paradoxal, c'est qu'en fait on réduit trop souvent la
question du mouvement des capitaux à une seule de ses
composantes : l'investissement à l'étranger. Il faut aussi tenir
compte des mouvements de capitaux d'Etat, de redevances
pour les brevets et les licences d'exploitation, des revenus
des capitaux placés à l'étranger.
paraît paradoxal, c'est qu'en fait on réduit trop souvent la
question du mouvement des capitaux à une seule de ses
composantes : l'investissement à l'étranger. Il faut aussi tenir
compte des mouvements de capitaux d'Etat, de redevances
pour les brevets et les licences d'exploitation, des revenus
des capitaux placés à l'étranger.
On est amené à examiner la balance des paiements. Divers
économistes ont fait ce travail ; la valeur numérique des
résultats peut diverger, mais tous sont d'accord sur un point :
le mouvement des capitaux s'effectue en sens inverse.
économistes ont fait ce travail ; la valeur numérique des
résultats peut diverger, mais tous sont d'accord sur un point :
le mouvement des capitaux s'effectue en sens inverse.
C'est ainsi qu'un économiste pakistanais, Hamza Alavi30, a
calculé, d'après les données de la balance des paiements U.S.,
qu'entre 1950 et 1960, les entrées de capitaux ont équilibré
les sorties. La même conclusion est fournie pour 1956-1968
par le Département de l'Économie et des Affaires sociales
qui, dans un document intitulé « Mouvement international
des capitaux privés pour 1956-1958 » indique : « Le montant des
bénéfices et des dividendes rapatriés par les entreprises
américaines à l'étranger est souvent égal et quelquefois
supérieur aux sorties de capitaux américains destinés aux
investissements directs ».
calculé, d'après les données de la balance des paiements U.S.,
qu'entre 1950 et 1960, les entrées de capitaux ont équilibré
les sorties. La même conclusion est fournie pour 1956-1968
par le Département de l'Économie et des Affaires sociales
qui, dans un document intitulé « Mouvement international
des capitaux privés pour 1956-1958 » indique : « Le montant des
bénéfices et des dividendes rapatriés par les entreprises
américaines à l'étranger est souvent égal et quelquefois
supérieur aux sorties de capitaux américains destinés aux
investissements directs ».
Comme on le remarque, cette dernière citation porte sur
la fin de la période examinée par Alavi.
la fin de la période examinée par Alavi.
Aujourd'hui, plus aucun économiste ne met en doute ce
phénomène : l'importation des capitaux. Il ne suffit pas d'en
faire la constatation, de la classer comme un fait parmi tant
d'autres et, finalement, de faire comme si de rien n'était quand
on parle de l'impérialisme. L'impérialisme pratique aujour-
d'hui un nouveau mode d'exploitation.
phénomène : l'importation des capitaux. Il ne suffit pas d'en
faire la constatation, de la classer comme un fait parmi tant
d'autres et, finalement, de faire comme si de rien n'était quand
on parle de l'impérialisme. L'impérialisme pratique aujour-
d'hui un nouveau mode d'exploitation.
La raison essentielle c'est que, dans les pays capitalistes
30. Hamza HALAVI « Le nouvel impérialisme ». Les Temps Modernes,
août 1964.
août 1964.
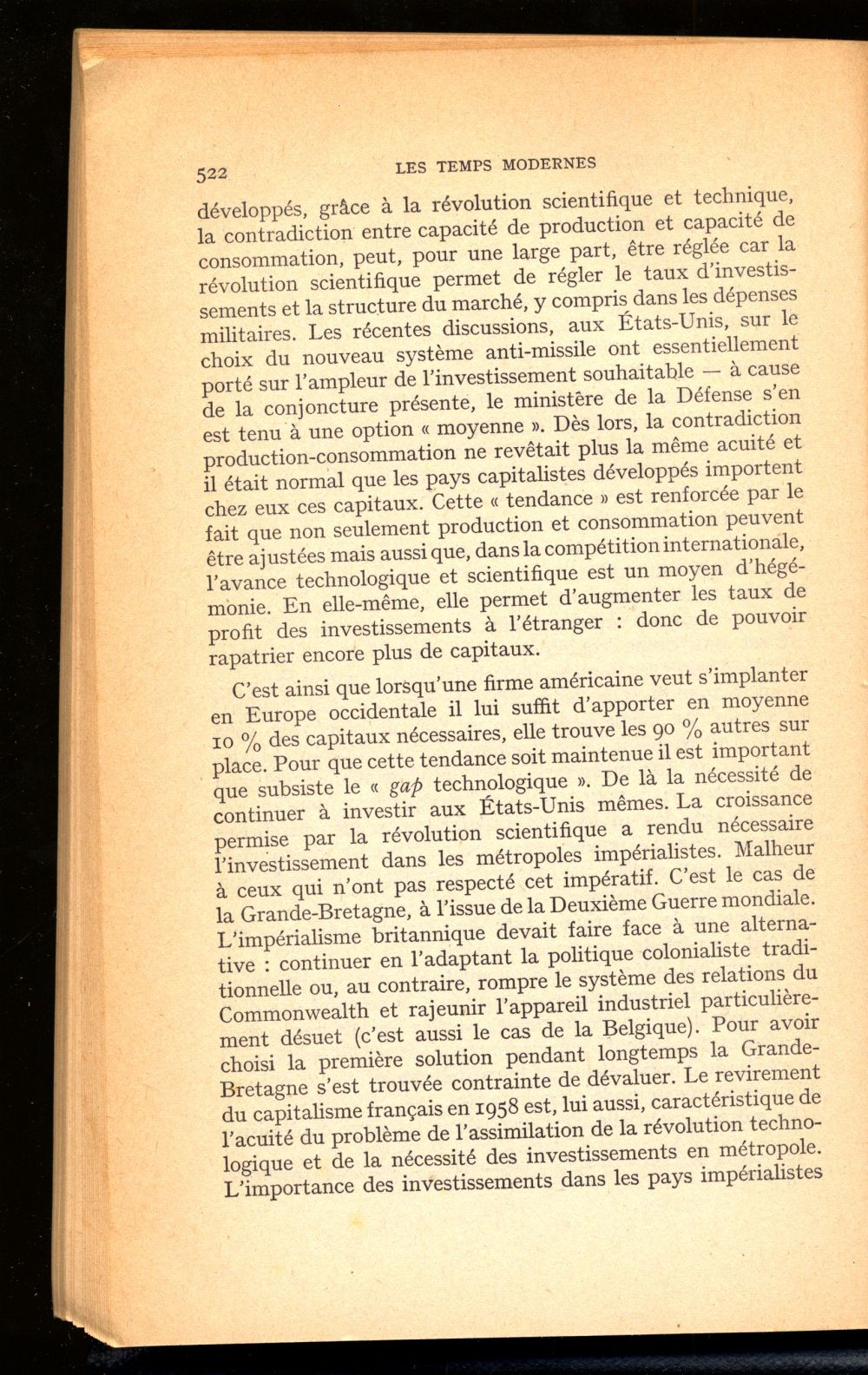

522
LES TEMPS MODERNES
développés, grâce à la révolution scientifique et technique,
la contradiction entre capacité de production et capacité de
consommation, peut, pour une large part, être réglée car la
révolution scientifique permet de régler le taux d'investis-
sements et la structure du marché, y compris dans les dépenses
militaires. Les récentes discussions, aux Etats-Unis, sur le
choix du nouveau système anti-missile ont essentiellement
porté sur l'ampleur de l'investissement souhaitable — à cause
de la conjoncture présente, le ministère de la Défense s'en
est tenu à une option « moyenne ». Dès lors, la contradiction
production-consommation ne revêtait plus la même acuité et
il était normal que les pays capitalistes développés importent
chez eux ces capitaux. Cette « tendance » est renforcée par le
fait que non seulement production et consommation peuvent
être ajustées mais aussi que, dans la compétition internationale,
l'avance technologique et scientifique est un moyen d'hégé-
monie. En elle-même, elle permet d'augmenter les taux de
profit des investissements à l'étranger : donc de pouvoir
rapatrier encore plus de capitaux.
la contradiction entre capacité de production et capacité de
consommation, peut, pour une large part, être réglée car la
révolution scientifique permet de régler le taux d'investis-
sements et la structure du marché, y compris dans les dépenses
militaires. Les récentes discussions, aux Etats-Unis, sur le
choix du nouveau système anti-missile ont essentiellement
porté sur l'ampleur de l'investissement souhaitable — à cause
de la conjoncture présente, le ministère de la Défense s'en
est tenu à une option « moyenne ». Dès lors, la contradiction
production-consommation ne revêtait plus la même acuité et
il était normal que les pays capitalistes développés importent
chez eux ces capitaux. Cette « tendance » est renforcée par le
fait que non seulement production et consommation peuvent
être ajustées mais aussi que, dans la compétition internationale,
l'avance technologique et scientifique est un moyen d'hégé-
monie. En elle-même, elle permet d'augmenter les taux de
profit des investissements à l'étranger : donc de pouvoir
rapatrier encore plus de capitaux.
C'est ainsi que lorsqu'une firme américaine veut s'implanter
en Europe occidentale il lui suffit d'apporter en moyenne
10 % des capitaux nécessaires, elle trouve les 90 % autres sur
place. Pour que cette tendance soit maintenue il est important
que subsiste le « gap technologique ». De là la nécessité de
continuer à investir aux États-Unis mêmes. La croissance
permise par la révolution scientifique a rendu nécessaire
l'investissement dans les métropoles impérialistes. Malheur
à ceux qui n'ont pas respecté cet impératif. C'est le cas de
la Grande-Bretagne, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale.
L'impérialisme britannique devait faire face à une alterna-
tive : continuer en l'adaptant la politique colonialiste tradi-
tionnelle ou, au contraire, rompre le système des relations du
Commonwealth et rajeunir l'appareil industriel particulière-
ment désuet (c'est aussi le cas de la Belgique). Pour avoir
choisi la première solution pendant longtemps la Grande-
Bretagne s'est trouvée contrainte de dévaluer. Le revirement
du capitalisme français en 1958 est, lui aussi, caractéristique de
l'acuité du problème de l'assimilation de la révolution techno-
logique et de la nécessité des investissements en métropole.
L'importance des investissements dans les pays impérialistes
en Europe occidentale il lui suffit d'apporter en moyenne
10 % des capitaux nécessaires, elle trouve les 90 % autres sur
place. Pour que cette tendance soit maintenue il est important
que subsiste le « gap technologique ». De là la nécessité de
continuer à investir aux États-Unis mêmes. La croissance
permise par la révolution scientifique a rendu nécessaire
l'investissement dans les métropoles impérialistes. Malheur
à ceux qui n'ont pas respecté cet impératif. C'est le cas de
la Grande-Bretagne, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale.
L'impérialisme britannique devait faire face à une alterna-
tive : continuer en l'adaptant la politique colonialiste tradi-
tionnelle ou, au contraire, rompre le système des relations du
Commonwealth et rajeunir l'appareil industriel particulière-
ment désuet (c'est aussi le cas de la Belgique). Pour avoir
choisi la première solution pendant longtemps la Grande-
Bretagne s'est trouvée contrainte de dévaluer. Le revirement
du capitalisme français en 1958 est, lui aussi, caractéristique de
l'acuité du problème de l'assimilation de la révolution techno-
logique et de la nécessité des investissements en métropole.
L'importance des investissements dans les pays impérialistes
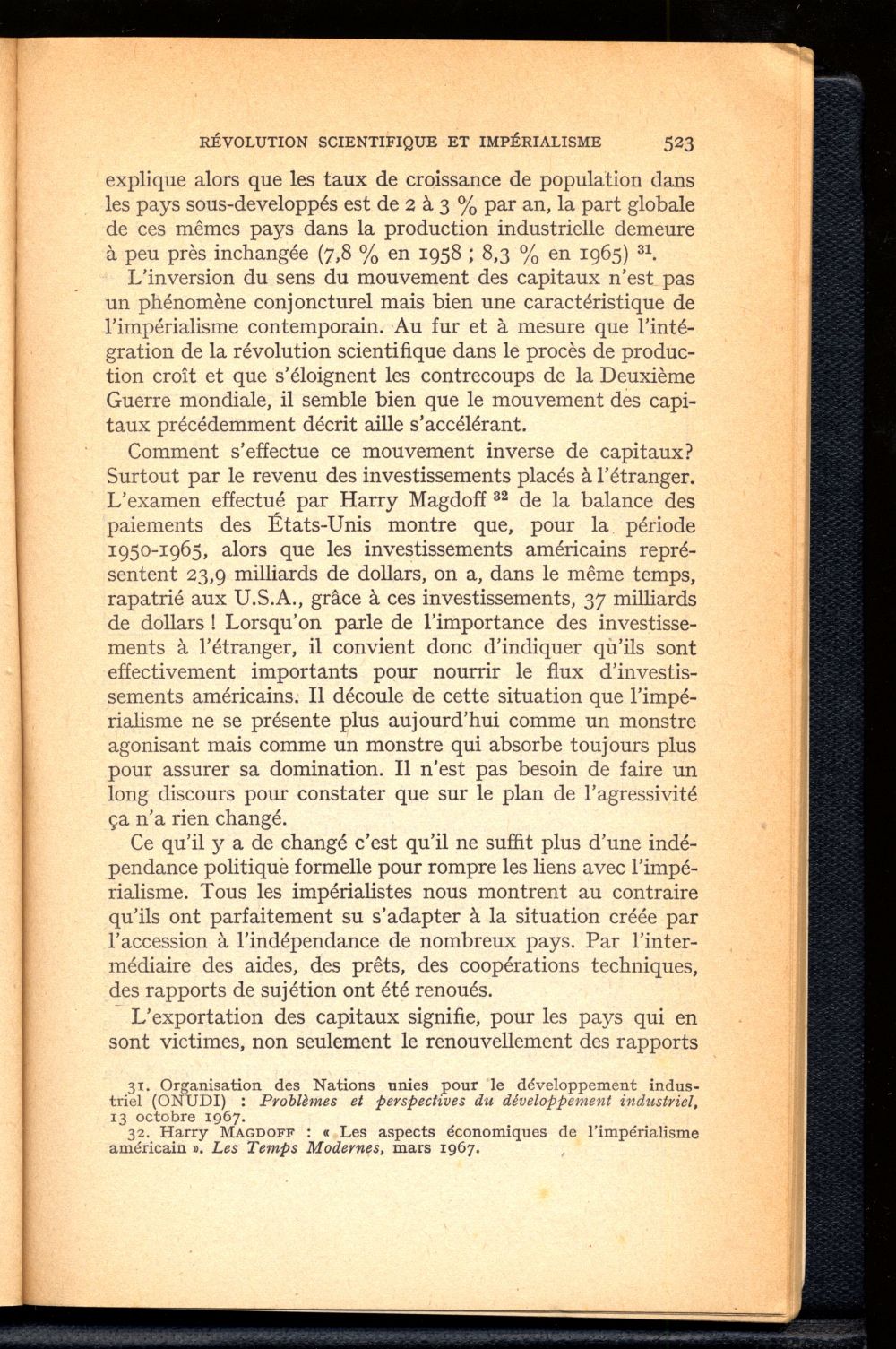

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
523
explique alors que les taux de croissance de population dans
les pays sous-developpés est de 2 à 3 % par an, la part globale
de ces mêmes pays dans la production industrielle demeure
à peu près inchangée (7,8 % en 1958 ; 8,3 % en 1965) 31.
les pays sous-developpés est de 2 à 3 % par an, la part globale
de ces mêmes pays dans la production industrielle demeure
à peu près inchangée (7,8 % en 1958 ; 8,3 % en 1965) 31.
L'inversion du sens du mouvement des capitaux n'est pas
un phénomène conjoncturel mais bien une caractéristique de
l'impérialisme contemporain. Au fur et à mesure que l'inté-
gration de la révolution scientifique dans le procès de produc-
tion croît et que s'éloignent les contrecoups de la Deuxième
Guerre mondiale, il semble bien que le mouvement des capi-
taux précédemment décrit aille s'accélérant.
un phénomène conjoncturel mais bien une caractéristique de
l'impérialisme contemporain. Au fur et à mesure que l'inté-
gration de la révolution scientifique dans le procès de produc-
tion croît et que s'éloignent les contrecoups de la Deuxième
Guerre mondiale, il semble bien que le mouvement des capi-
taux précédemment décrit aille s'accélérant.
Comment s'effectue ce mouvement inverse de capitaux?
Surtout par le revenu des investissements placés à l'étranger.
L'examen effectué par Harry Magdoff32 de la balance des
paiements des États-Unis montre que, pour la période
1950-1965, alors que les investissements américains repré-
sentent 23,9 milliards de dollars, on a, dans le même temps,
rapatrié aux U.S.A., grâce à ces investissements, 37 milliards
de dollars ! Lorsqu'on parle de l'importance des investisse-
ments à l'étranger, il convient donc d'indiquer qu'ils sont
effectivement importants pour nourrir le flux d'investis-
sements américains. Il découle de cette situation que l'impé-
rialisme ne se présente plus aujourd'hui comme un monstre
agonisant mais comme un monstre qui absorbe toujours plus
pour assurer sa domination. Il n'est pas besoin de faire un
long discours pour constater que sur le plan de l'agressivité
ça n'a rien changé.
Surtout par le revenu des investissements placés à l'étranger.
L'examen effectué par Harry Magdoff32 de la balance des
paiements des États-Unis montre que, pour la période
1950-1965, alors que les investissements américains repré-
sentent 23,9 milliards de dollars, on a, dans le même temps,
rapatrié aux U.S.A., grâce à ces investissements, 37 milliards
de dollars ! Lorsqu'on parle de l'importance des investisse-
ments à l'étranger, il convient donc d'indiquer qu'ils sont
effectivement importants pour nourrir le flux d'investis-
sements américains. Il découle de cette situation que l'impé-
rialisme ne se présente plus aujourd'hui comme un monstre
agonisant mais comme un monstre qui absorbe toujours plus
pour assurer sa domination. Il n'est pas besoin de faire un
long discours pour constater que sur le plan de l'agressivité
ça n'a rien changé.
Ce qu'il y a de changé c'est qu'il ne suffit plus d'une indé-
pendance politique formelle pour rompre les liens avec l'impé-
rialisme. Tous les impérialistes nous montrent au contraire
qu'ils ont parfaitement su s'adapter à la situation créée par
l'accession à l'indépendance de nombreux pays. Par l'inter-
médiaire des aides, des prêts, des coopérations techniques,
des rapports de sujétion ont été renoués.
pendance politique formelle pour rompre les liens avec l'impé-
rialisme. Tous les impérialistes nous montrent au contraire
qu'ils ont parfaitement su s'adapter à la situation créée par
l'accession à l'indépendance de nombreux pays. Par l'inter-
médiaire des aides, des prêts, des coopérations techniques,
des rapports de sujétion ont été renoués.
L'exportation des capitaux signifie, pour les pays qui en
sont victimes, non seulement le renouvellement des rapports
sont victimes, non seulement le renouvellement des rapports
3T. Organisation des Nations unies pour le développement indus-
triel (ONU-DI) : Problèmes et perspectives du développement industriel,
13 octobre 1967.
triel (ONU-DI) : Problèmes et perspectives du développement industriel,
13 octobre 1967.
32. Harry MAGDOFF : « Les aspects économiques de l'impérialisme
américain ». Les Temps Modernes, mars 1967.
américain ». Les Temps Modernes, mars 1967.
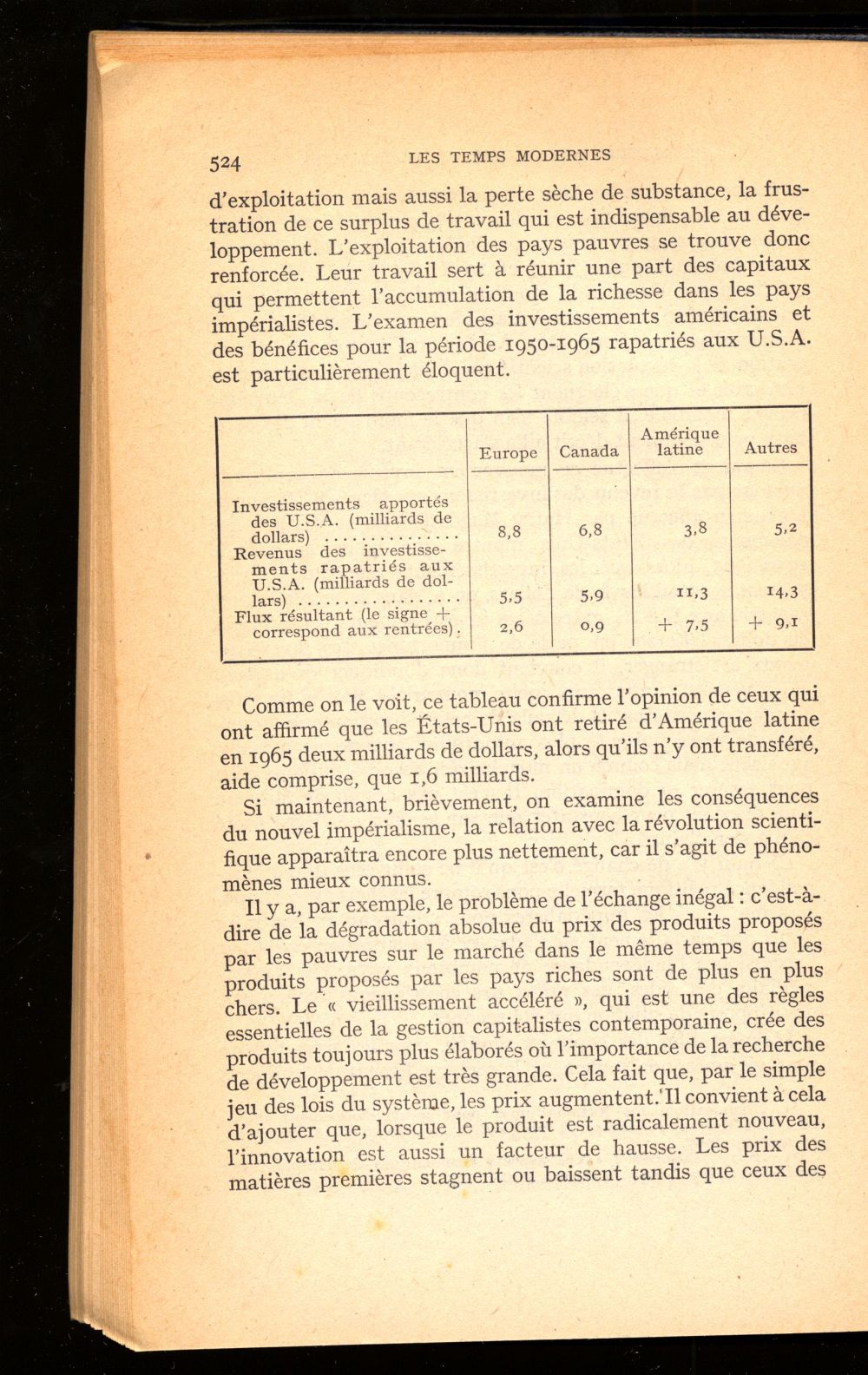

524
LES TEMPS MODERNES
d'exploitation mais aussi la perte sèche de substance, la frus-
tration de ce surplus de travail qui est indispensable au déve-
loppement. L'exploitation des pays pauvres se trouve donc
renforcée. Leur travail sert à réunir une part des capitaux
qui permettent l'accumulation de la richesse dans les pays
impérialistes. L'examen des investissements américains et
des bénéfices pour la période 1950-1965 rapatriés aux U.S.A.
est particulièrement éloquent.
tration de ce surplus de travail qui est indispensable au déve-
loppement. L'exploitation des pays pauvres se trouve donc
renforcée. Leur travail sert à réunir une part des capitaux
qui permettent l'accumulation de la richesse dans les pays
impérialistes. L'examen des investissements américains et
des bénéfices pour la période 1950-1965 rapatriés aux U.S.A.
est particulièrement éloquent.
Amérique
Europe
Canada
latine
Autres
Canada
latine
Autres
Investissements apportes
des U.S. A. (milliards de
dollars)
8 8
6 8
0 S
8 8
6 8
0 S
Revenus des investisse-
ments rapatriés aux
U.S. A. (milliards de clol-
51-
c o
li^
c o
li^
Flux résultant (le signe —
correspond aux rentrées).
2,6
O,Q
~r 7' 5
+ 9,1
2,6
O,Q
~r 7' 5
+ 9,1
Comme on le voit, ce tableau confirme l'opinion de ceux qui
ont affirmé que les Etats-Unis ont retiré d'Amérique latine
en 1965 deux milliards de dollars, alors qu'ils n'y ont transféré,
aide comprise, que 1,6 milliards.
ont affirmé que les Etats-Unis ont retiré d'Amérique latine
en 1965 deux milliards de dollars, alors qu'ils n'y ont transféré,
aide comprise, que 1,6 milliards.
Si maintenant, brièvement, on examine les conséquences
du nouvel impérialisme, la relation avec la révolution scienti-
fique apparaîtra encore plus nettement, car il s'agit de phéno-
mènes mieux connus.
du nouvel impérialisme, la relation avec la révolution scienti-
fique apparaîtra encore plus nettement, car il s'agit de phéno-
mènes mieux connus.
Il y a, par exemple, le problème de l'échange inégal : c'est-à-
dire de la dégradation absolue du prix des produits proposés
par les pauvres sur le marché dans le même temps que les
produits proposés par les pays riches sont de plus en plus
chers. Le « vieillissement accéléré », qui est une des règles
essentielles de la gestion capitalistes contemporaine, crée des
produits toujours plus élaborés où l'importance de la recherche
de développement est très grande. Cela fait que, par le simple
jeu des lois du système, les prix augmentent .'II convient à cela
d'ajouter que, lorsque le produit est radicalement nouveau,
l'innovation est aussi un facteur de hausse. Les prix des
matières premières stagnent ou baissent tandis que ceux des
dire de la dégradation absolue du prix des produits proposés
par les pauvres sur le marché dans le même temps que les
produits proposés par les pays riches sont de plus en plus
chers. Le « vieillissement accéléré », qui est une des règles
essentielles de la gestion capitalistes contemporaine, crée des
produits toujours plus élaborés où l'importance de la recherche
de développement est très grande. Cela fait que, par le simple
jeu des lois du système, les prix augmentent .'II convient à cela
d'ajouter que, lorsque le produit est radicalement nouveau,
l'innovation est aussi un facteur de hausse. Les prix des
matières premières stagnent ou baissent tandis que ceux des
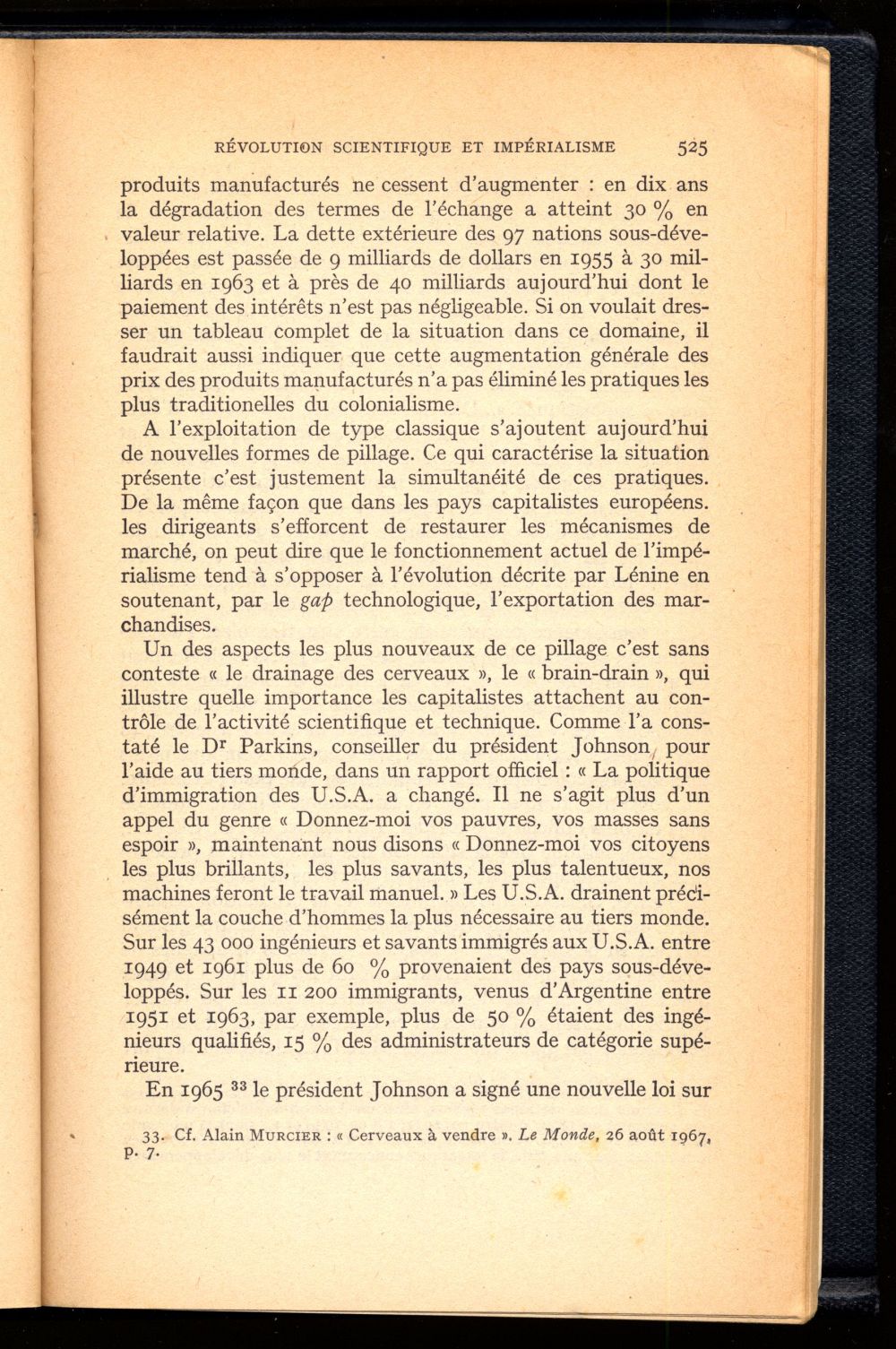

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
525
produits manufacturés ne cessent d'augmenter : en dix ans
la dégradation des termes de l'échange a atteint 30 % en
valeur relative. La dette extérieure des 97 nations sous-déve-
loppées est passée de 9 milliards de dollars en 1955 à 30 mil-
liards en 1963 et à près de 40 milliards aujourd'hui dont le
paiement des intérêts n'est pas négligeable. Si on voulait dres-
ser un tableau complet de la situation dans ce domaine, il
faudrait aussi indiquer que cette augmentation générale des
prix des produits manufacturés n'a pas éliminé les pratiques les
plus traditionelles du colonialisme.
la dégradation des termes de l'échange a atteint 30 % en
valeur relative. La dette extérieure des 97 nations sous-déve-
loppées est passée de 9 milliards de dollars en 1955 à 30 mil-
liards en 1963 et à près de 40 milliards aujourd'hui dont le
paiement des intérêts n'est pas négligeable. Si on voulait dres-
ser un tableau complet de la situation dans ce domaine, il
faudrait aussi indiquer que cette augmentation générale des
prix des produits manufacturés n'a pas éliminé les pratiques les
plus traditionelles du colonialisme.
A l'exploitation de type classique s'ajoutent aujourd'hui
de nouvelles formes de pillage. Ce qui caractérise la situation
présente c'est justement la simultanéité de ces pratiques.
De la même façon que dans les pays capitalistes européens,
les dirigeants s'efforcent de restaurer les mécanismes de
marché, on peut dire que le fonctionnement actuel de l'impé-
rialisme tend à s'opposer à l'évolution décrite par Lénine en
soutenant, par le gap technologique, l'exportation des mar-
chandises.
de nouvelles formes de pillage. Ce qui caractérise la situation
présente c'est justement la simultanéité de ces pratiques.
De la même façon que dans les pays capitalistes européens,
les dirigeants s'efforcent de restaurer les mécanismes de
marché, on peut dire que le fonctionnement actuel de l'impé-
rialisme tend à s'opposer à l'évolution décrite par Lénine en
soutenant, par le gap technologique, l'exportation des mar-
chandises.
Un des aspects les plus nouveaux de ce pillage c'est sans
conteste « le drainage des cerveaux », le « brain-drain », qui
illustre quelle importance les capitalistes attachent au con-
trôle de l'activité scientifique et technique. Comme l'a cons-
taté le Dr Parkins, conseiller du président Johnson pour
l'aide au tiers monde, dans un rapport officiel : « La politique
d'immigration des U.S.A. a changé. Il ne s'agit plus d'un
appel du genre « Donnez-moi vos pauvres, vos masses sans
espoir », maintenant nous disons « Donnez-moi vos citoyens
les plus brillants, les plus savants, les plus talentueux, nos
machines feront le travail manuel. » Les U.S.A. drainent préci-
sément la couche d'hommes la plus nécessaire au tiers monde.
Sur les 43 ooo ingénieurs et savants immigrés aux U.S.A. entre
1949 et 1961 plus de 60 % provenaient des pays sous-déve-
loppés. Sur les n 200 immigrants, venus d'Argentine entre
1951 et 1963, par exemple, plus de 50 % étaient des ingé-
nieurs qualifiés, 15 % des administrateurs de catégorie supé-
rieure.
conteste « le drainage des cerveaux », le « brain-drain », qui
illustre quelle importance les capitalistes attachent au con-
trôle de l'activité scientifique et technique. Comme l'a cons-
taté le Dr Parkins, conseiller du président Johnson pour
l'aide au tiers monde, dans un rapport officiel : « La politique
d'immigration des U.S.A. a changé. Il ne s'agit plus d'un
appel du genre « Donnez-moi vos pauvres, vos masses sans
espoir », maintenant nous disons « Donnez-moi vos citoyens
les plus brillants, les plus savants, les plus talentueux, nos
machines feront le travail manuel. » Les U.S.A. drainent préci-
sément la couche d'hommes la plus nécessaire au tiers monde.
Sur les 43 ooo ingénieurs et savants immigrés aux U.S.A. entre
1949 et 1961 plus de 60 % provenaient des pays sous-déve-
loppés. Sur les n 200 immigrants, venus d'Argentine entre
1951 et 1963, par exemple, plus de 50 % étaient des ingé-
nieurs qualifiés, 15 % des administrateurs de catégorie supé-
rieure.
En 1965 33 le président Johnson a signé une nouvelle loi sur
33. Cf. Alain MURCIER : « Cerveaux à vendre », Le Monde, 26 août 1967,
p. 7.
p. 7.
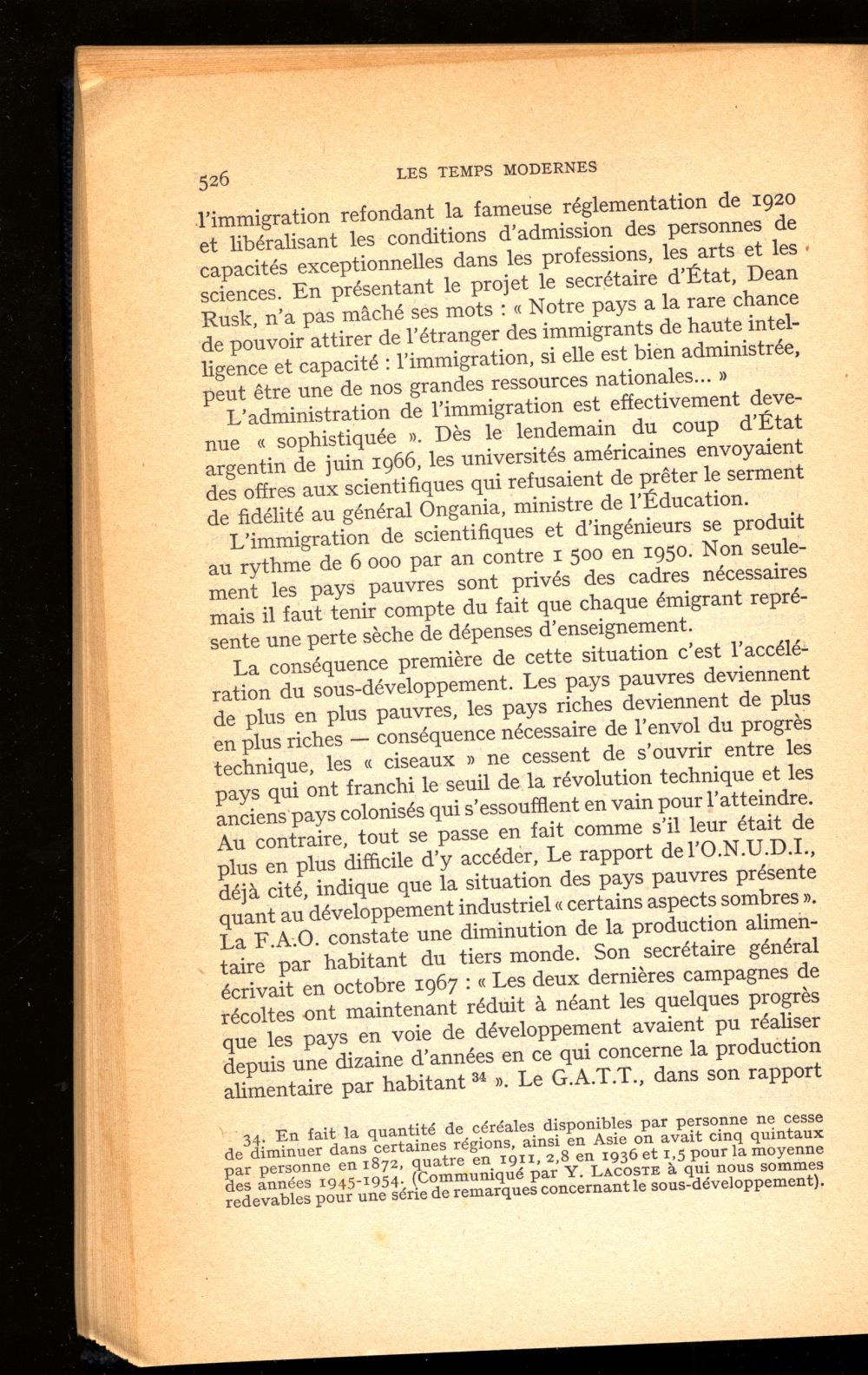

526
LES TEMPS MODERNES
l'immigration refondant la fameuse réglementation de 1920
et libéralisant les conditions d'admission des personnes de
capacités exceptionnelles dans les professions, les arts et les
sciences. En présentant le projet le secrétaire d'État, Dean
Rusk, n'a pas mâché ses mots : « Notre pays a la rare chance
de pouvoir attirer de l'étranger des immigrants de haute intel-
ligence et capacité : l'immigration, si elle est bien administrée,
peut être une de nos grandes ressources nationales... »
et libéralisant les conditions d'admission des personnes de
capacités exceptionnelles dans les professions, les arts et les
sciences. En présentant le projet le secrétaire d'État, Dean
Rusk, n'a pas mâché ses mots : « Notre pays a la rare chance
de pouvoir attirer de l'étranger des immigrants de haute intel-
ligence et capacité : l'immigration, si elle est bien administrée,
peut être une de nos grandes ressources nationales... »
L'administration de l'immigration est effectivement deve-
nue « sophistiquée ». Dès le lendemain du coup d'État
argentin de juin 1966, les universités américaines envoyaient
des offres aux scientifiques qui refusaient de prêter le serment
de fidélité au général Ongania, ministre de l'Éducation.
nue « sophistiquée ». Dès le lendemain du coup d'État
argentin de juin 1966, les universités américaines envoyaient
des offres aux scientifiques qui refusaient de prêter le serment
de fidélité au général Ongania, ministre de l'Éducation.
L'immigration de scientifiques et d'ingénieurs se produit
au rythme de 6 ooo par an contre i 500 en 1950. Non seule-
ment les pays pauvres sont privés des cadres nécessaires
mais il faut tenir compte du fait que chaque émigrant repré-
sente une perte sèche de dépenses d'enseignement.
au rythme de 6 ooo par an contre i 500 en 1950. Non seule-
ment les pays pauvres sont privés des cadres nécessaires
mais il faut tenir compte du fait que chaque émigrant repré-
sente une perte sèche de dépenses d'enseignement.
La conséquence première de cette situation c'est l'accélé-
ration du sous-développement. Les pays pauvres deviennent
de plus en plus pauvres, les pays riches deviennent de plus
en plus riches — conséquence nécessaire de l'envol du progrès
technique, les « ciseaux » ne cessent de s'ouvrir entre les
pays qui ont franchi le seuil de la révolution technique et les
anciens pays colonisés qui s'essoufflent en vain pour l'atteindre.
Au contraire, tout se passe en fait comme s'il leur était de
plus en plus difficile d'y accéder, Le rapport del'O.N.U.D.I.,
déjà cité, indique que la situation des pays pauvres présente
quant au développement industriel « certains aspects sombres ».
La F.A.O. constate une diminution de la production alimen-
taire par habitant du tiers monde. Son secrétaire général
écrivait en octobre 1967 : « Les deux dernières campagnes de
récoltes ont maintenant réduit à néant les quelques progrès
que les pays en voie de développement avaient pu réaliser
depuis une dizaine d'années en ce qui concerne la production
alimentaire par habitant31 ». Le G.A.T.T., dans son rapport
ration du sous-développement. Les pays pauvres deviennent
de plus en plus pauvres, les pays riches deviennent de plus
en plus riches — conséquence nécessaire de l'envol du progrès
technique, les « ciseaux » ne cessent de s'ouvrir entre les
pays qui ont franchi le seuil de la révolution technique et les
anciens pays colonisés qui s'essoufflent en vain pour l'atteindre.
Au contraire, tout se passe en fait comme s'il leur était de
plus en plus difficile d'y accéder, Le rapport del'O.N.U.D.I.,
déjà cité, indique que la situation des pays pauvres présente
quant au développement industriel « certains aspects sombres ».
La F.A.O. constate une diminution de la production alimen-
taire par habitant du tiers monde. Son secrétaire général
écrivait en octobre 1967 : « Les deux dernières campagnes de
récoltes ont maintenant réduit à néant les quelques progrès
que les pays en voie de développement avaient pu réaliser
depuis une dizaine d'années en ce qui concerne la production
alimentaire par habitant31 ». Le G.A.T.T., dans son rapport
34. En fait la quantité de céréales disponibles par personne ne cesse
de diminuer dans certaines régions, ainsi en Asie on avait cinq quintaux
par personne en 1872, quatre en 1911,2,8 en 1936 et 1,5 pour la moyenne
des années 1945-1954. (Communiqué par Y. LACOSTE à qui nous sommes
redevables pour une série de remarques concernant le sous-développement).
de diminuer dans certaines régions, ainsi en Asie on avait cinq quintaux
par personne en 1872, quatre en 1911,2,8 en 1936 et 1,5 pour la moyenne
des années 1945-1954. (Communiqué par Y. LACOSTE à qui nous sommes
redevables pour une série de remarques concernant le sous-développement).
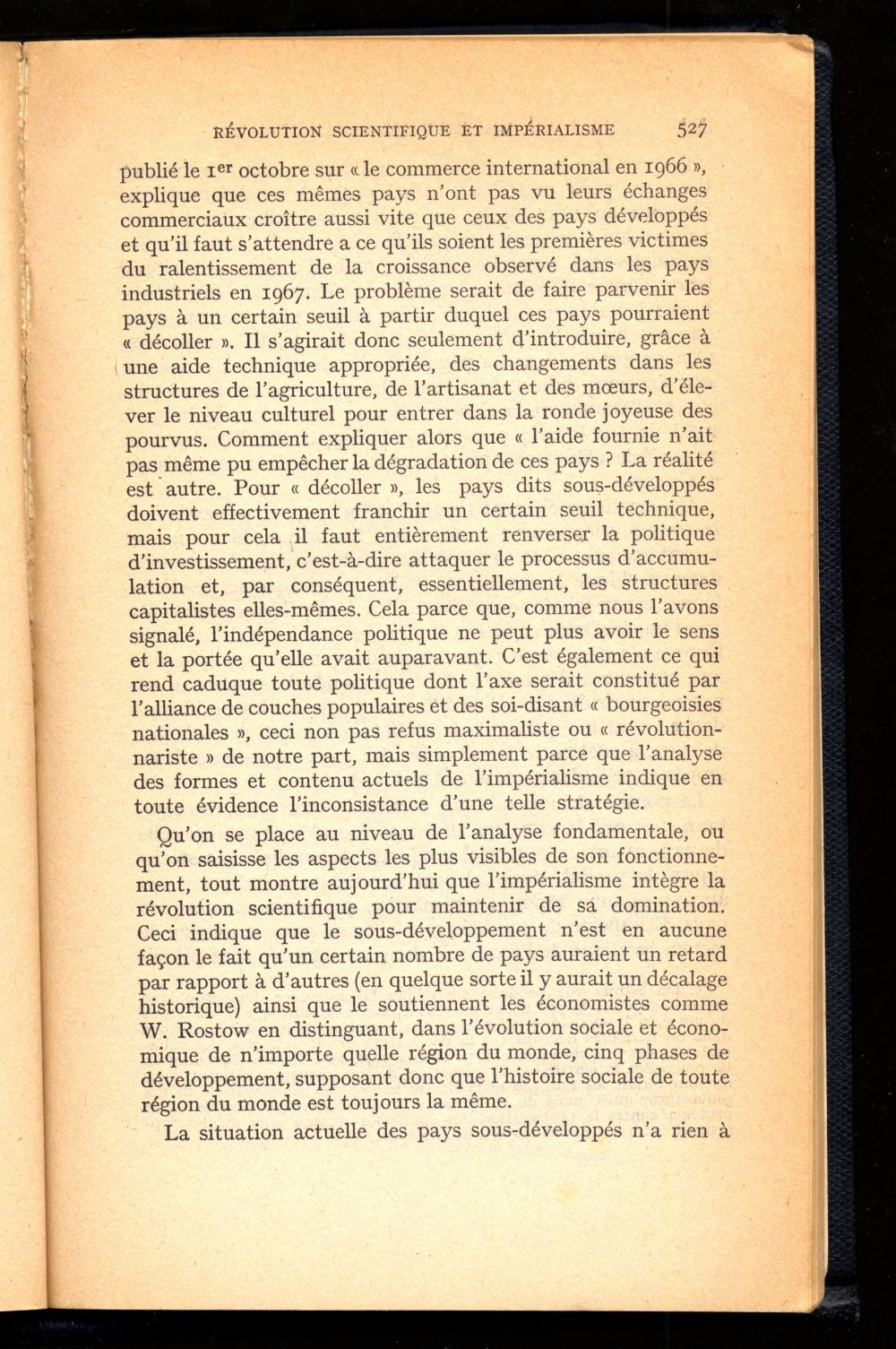

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
527
publié le Ier octobre sur « le commerce international en 1966 »,
explique que ces mêmes pays n'ont pas vu leurs échanges
commerciaux croître aussi vite que ceux des pays développés
et qu'il faut s'attendre a ce qu'ils soient les premières victimes
du ralentissement de la croissance observé dans les pays
industriels en 1967. Le problème serait de faire parvenir les
pays à un certain seuil à partir duquel ces pays pourraient
« décoller ». Il s'agirait donc seulement d'introduire, grâce à
une aide technique appropriée, des changements dans les
structures de l'agriculture, de l'artisanat et des mœurs, d'éle-
ver le niveau culturel pour entrer dans la ronde joyeuse des
pourvus. Comment expliquer alors que « l'aide fourme n'ait
pas même pu empêcher la dégradation de ces pays ? La réalité
est autre. Pour « décoller », les pays dits sous-développés
doivent effectivement franchir un certain seuil technique,
mais pour cela il faut entièrement renverser la politique
d'investissement, c'est-à-dire attaquer le processus d'accumu-
lation et, par conséquent, essentiellement, les structures
capitalistes elles-mêmes. Cela parce que, comme nous l'avons
signalé, l'indépendance politique ne peut plus avoir le sens
et la portée qu'elle avait auparavant. C'est également ce qui
rend caduque toute politique dont l'axe serait constitué par
l'alliance de couches populaires et des soi-disant « bourgeoisies
nationales », ceci non pas refus maximaliste ou « révolution-
nariste » de notre part, mais simplement parce que l'analyse
des formes et contenu actuels de l'impérialisme indique en
toute évidence l'inconsistance d'une telle stratégie.
explique que ces mêmes pays n'ont pas vu leurs échanges
commerciaux croître aussi vite que ceux des pays développés
et qu'il faut s'attendre a ce qu'ils soient les premières victimes
du ralentissement de la croissance observé dans les pays
industriels en 1967. Le problème serait de faire parvenir les
pays à un certain seuil à partir duquel ces pays pourraient
« décoller ». Il s'agirait donc seulement d'introduire, grâce à
une aide technique appropriée, des changements dans les
structures de l'agriculture, de l'artisanat et des mœurs, d'éle-
ver le niveau culturel pour entrer dans la ronde joyeuse des
pourvus. Comment expliquer alors que « l'aide fourme n'ait
pas même pu empêcher la dégradation de ces pays ? La réalité
est autre. Pour « décoller », les pays dits sous-développés
doivent effectivement franchir un certain seuil technique,
mais pour cela il faut entièrement renverser la politique
d'investissement, c'est-à-dire attaquer le processus d'accumu-
lation et, par conséquent, essentiellement, les structures
capitalistes elles-mêmes. Cela parce que, comme nous l'avons
signalé, l'indépendance politique ne peut plus avoir le sens
et la portée qu'elle avait auparavant. C'est également ce qui
rend caduque toute politique dont l'axe serait constitué par
l'alliance de couches populaires et des soi-disant « bourgeoisies
nationales », ceci non pas refus maximaliste ou « révolution-
nariste » de notre part, mais simplement parce que l'analyse
des formes et contenu actuels de l'impérialisme indique en
toute évidence l'inconsistance d'une telle stratégie.
Qu'on se place au niveau de l'analyse fondamentale, ou
qu'on saisisse les aspects les plus visibles de son fonctionne-
ment, tout montre aujourd'hui que l'impérialisme intègre la
révolution scientifique pour maintenir de sa domination.
Ceci indique que le sous-développement n'est en aucune
façon le fait qu'un certain nombre de pays auraient un retard
par rapport à d'autres (en quelque sorte il y aurait un décalage
historique) ainsi que le soutiennent les économistes comme
W. Rostow en distinguant, dans l'évolution sociale et écono-
mique de n'importe quelle région du monde, cinq phases de
développement, supposant donc que l'histoire sociale de toute
région du monde est toujours la même.
qu'on saisisse les aspects les plus visibles de son fonctionne-
ment, tout montre aujourd'hui que l'impérialisme intègre la
révolution scientifique pour maintenir de sa domination.
Ceci indique que le sous-développement n'est en aucune
façon le fait qu'un certain nombre de pays auraient un retard
par rapport à d'autres (en quelque sorte il y aurait un décalage
historique) ainsi que le soutiennent les économistes comme
W. Rostow en distinguant, dans l'évolution sociale et écono-
mique de n'importe quelle région du monde, cinq phases de
développement, supposant donc que l'histoire sociale de toute
région du monde est toujours la même.
La situation actuelle des pays sous-développés n'a rien à
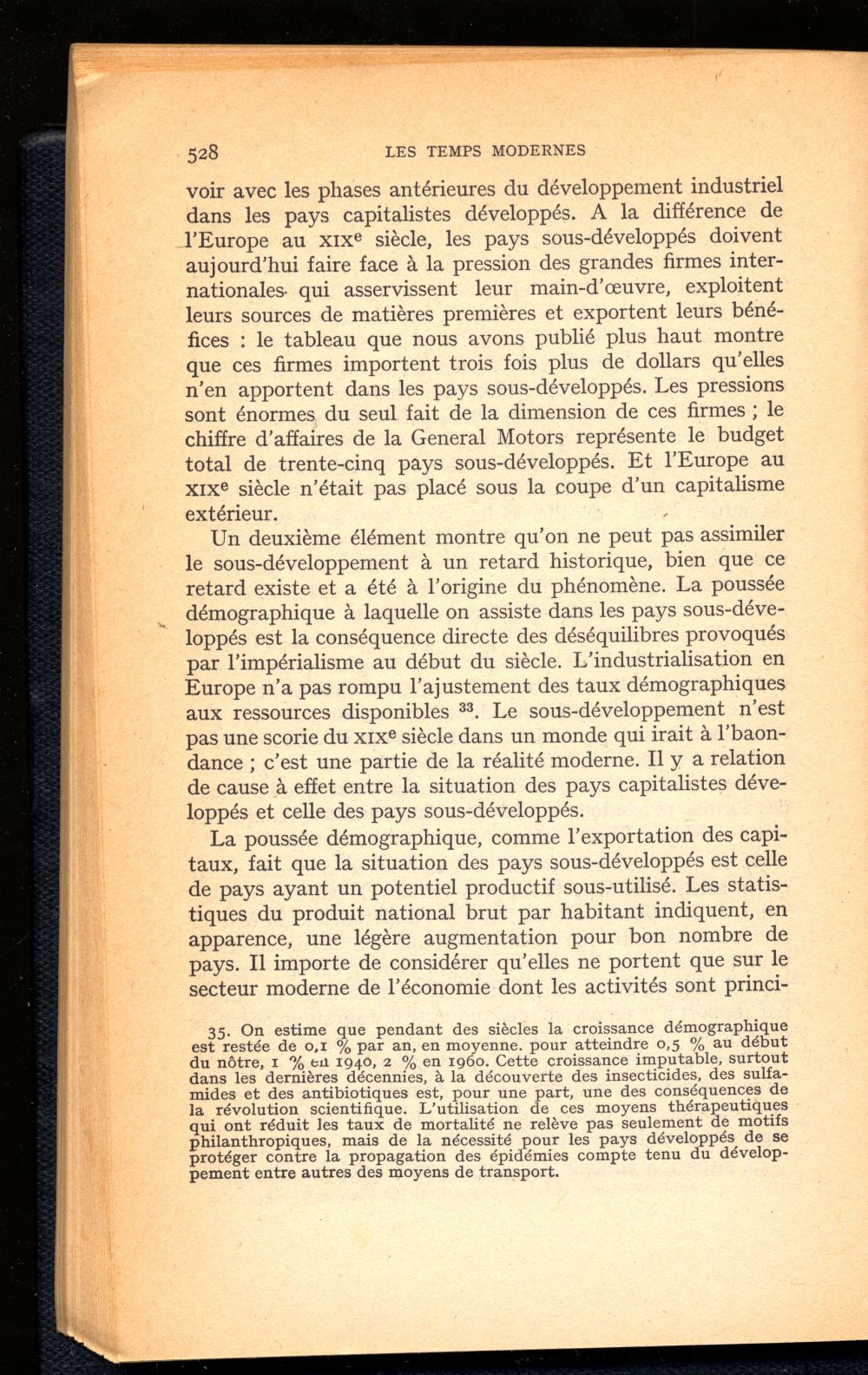

528 LES TEMPS MODERNES
voir avec les phases antérieures du développement industriel
dans les pays capitalistes développés. A la différence de
l'Europe au xixe siècle, les pays sous-développés doivent
aujourd'hui faire face à la pression des grandes firmes inter-
nationales- qui asservissent leur main-d'œuvre, exploitent
leurs sources de matières premières et exportent leurs béné-
fices : le tableau que nous avons publié plus haut montre
que ces firmes importent trois fois plus de dollars qu'elles
n'en apportent dans les pays sous-développés. Les pressions
sont énormes du seul fait de la dimension de ces firmes ; le
chiffre d'affaires de la General Motors représente le budget
total de trente-cinq pays sous-développés. Et l'Europe au
XIXe siècle n'était pas placé sous la coupe d'un capitalisme
extérieur.
dans les pays capitalistes développés. A la différence de
l'Europe au xixe siècle, les pays sous-développés doivent
aujourd'hui faire face à la pression des grandes firmes inter-
nationales- qui asservissent leur main-d'œuvre, exploitent
leurs sources de matières premières et exportent leurs béné-
fices : le tableau que nous avons publié plus haut montre
que ces firmes importent trois fois plus de dollars qu'elles
n'en apportent dans les pays sous-développés. Les pressions
sont énormes du seul fait de la dimension de ces firmes ; le
chiffre d'affaires de la General Motors représente le budget
total de trente-cinq pays sous-développés. Et l'Europe au
XIXe siècle n'était pas placé sous la coupe d'un capitalisme
extérieur.
Un deuxième élément montre qu'on ne peut pas assimiler
le sous-développement à un retard historique, bien que ce
retard existe et a été à l'origine du phénomène. La poussée
démographique à laquelle on assiste dans les pays sous-déve-
loppés est la conséquence directe des déséquilibres provoqués
par l'impérialisme au début du siècle. L'industrialisation en
Europe n'a pas rompu l'ajustement des taux démographiques
aux ressources disponibles 33. Le sous-développement n'est
pas une scorie du xixe siècle dans un monde qui irait à l'baon-
dance ; c'est une partie de la réalité moderne. Il y a relation
de cause à effet entre la situation des pays capitalistes déve-
loppés et celle des pays sous-développés.
le sous-développement à un retard historique, bien que ce
retard existe et a été à l'origine du phénomène. La poussée
démographique à laquelle on assiste dans les pays sous-déve-
loppés est la conséquence directe des déséquilibres provoqués
par l'impérialisme au début du siècle. L'industrialisation en
Europe n'a pas rompu l'ajustement des taux démographiques
aux ressources disponibles 33. Le sous-développement n'est
pas une scorie du xixe siècle dans un monde qui irait à l'baon-
dance ; c'est une partie de la réalité moderne. Il y a relation
de cause à effet entre la situation des pays capitalistes déve-
loppés et celle des pays sous-développés.
La poussée démographique, comme l'exportation des capi-
taux, fait que la situation des pays sous-développés est celle
de pays ayant un potentiel productif sous-utilisé. Les statis-
tiques du produit national brut par habitant indiquent, en
apparence, une légère augmentation pour bon nombre de
pays. Il importe de considérer qu'elles ne portent que sur le
secteur moderne de l'économie dont les activités sont princi-
taux, fait que la situation des pays sous-développés est celle
de pays ayant un potentiel productif sous-utilisé. Les statis-
tiques du produit national brut par habitant indiquent, en
apparence, une légère augmentation pour bon nombre de
pays. Il importe de considérer qu'elles ne portent que sur le
secteur moderne de l'économie dont les activités sont princi-
35. On estime que pendant des siècles la croissance démographique
est restée de 0,1 % par an, en moyenne, pour atteindre 0,5 % au début
du nôtre, i % eii 1940, 2 % en 1960. Cette croissance imputable, surtout
dans les dernières décennies, à la découverte des insecticides, des sulfa-
mides et des antibiotiques est, pour une part, une des conséquences de
la révolution scientifique. L'utilisation de ces moyens thérapeutiques
qui ont réduit les taux de mortalité ne relève pas seulement de motifs
philanthropiques, mais de la nécessité pour les pays développés de se
protéger contre la propagation des épidémies compte tenu du dévelop-
pement entre autres des moyens de transport.
est restée de 0,1 % par an, en moyenne, pour atteindre 0,5 % au début
du nôtre, i % eii 1940, 2 % en 1960. Cette croissance imputable, surtout
dans les dernières décennies, à la découverte des insecticides, des sulfa-
mides et des antibiotiques est, pour une part, une des conséquences de
la révolution scientifique. L'utilisation de ces moyens thérapeutiques
qui ont réduit les taux de mortalité ne relève pas seulement de motifs
philanthropiques, mais de la nécessité pour les pays développés de se
protéger contre la propagation des épidémies compte tenu du dévelop-
pement entre autres des moyens de transport.
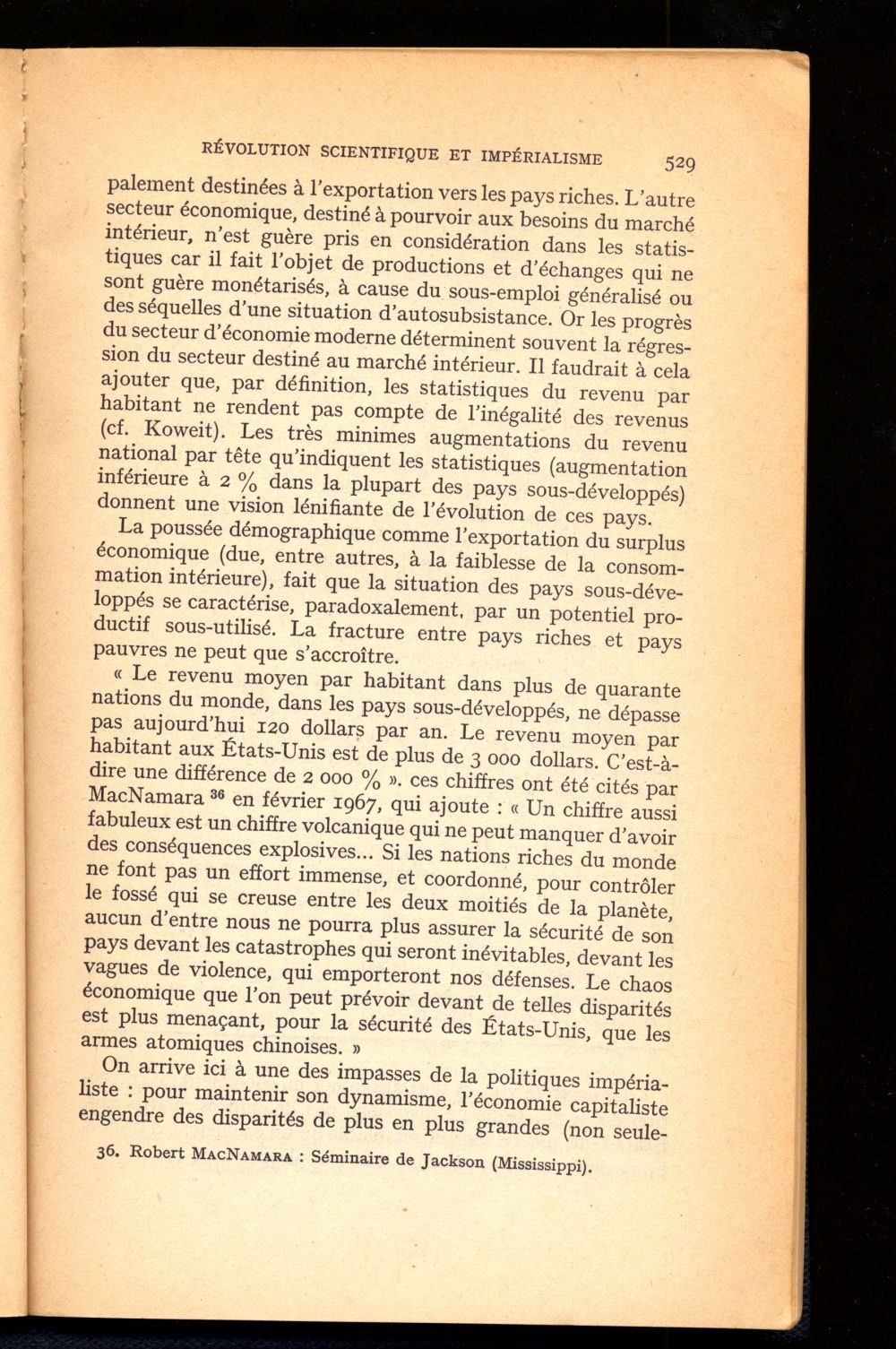

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
529
paiement destinées à l'exportation vers les pays riches. L'autre
secteur économique, destiné à pourvoir aux besoins du marché
intérieur, n'est guère pris en considération dans les statis-
tiques car il fait l'objet de productions et d'échanges qui ne
sont guère monétarisés, à cause du sous-emploi généralisé ou
des séquelles d'une situation d'autosubsistance. Or les progrès
du secteur d'économie moderne déterminent souvent la régres-
sion du secteur destiné au marché intérieur. Il faudrait à cela
ajouter que, par définition, les statistiques du revenu par
habitant ne rendent pas compte de l'inégalité des revenus
(cf. Koweit). Les très minimes augmentations du revenu
national par tête qu'indiquent les statistiques (augmentation
inférieure à 2 % dans la plupart des pays sous-développés)
donnent une vision lénifiante de l'évolution de ces pays.
secteur économique, destiné à pourvoir aux besoins du marché
intérieur, n'est guère pris en considération dans les statis-
tiques car il fait l'objet de productions et d'échanges qui ne
sont guère monétarisés, à cause du sous-emploi généralisé ou
des séquelles d'une situation d'autosubsistance. Or les progrès
du secteur d'économie moderne déterminent souvent la régres-
sion du secteur destiné au marché intérieur. Il faudrait à cela
ajouter que, par définition, les statistiques du revenu par
habitant ne rendent pas compte de l'inégalité des revenus
(cf. Koweit). Les très minimes augmentations du revenu
national par tête qu'indiquent les statistiques (augmentation
inférieure à 2 % dans la plupart des pays sous-développés)
donnent une vision lénifiante de l'évolution de ces pays.
La poussée démographique comme l'exportation du surplus
économique (due, entre autres, à la faiblesse de la consom-
mation intérieure), fait que la situation des pays sous-déve-
loppés se caractérise, paradoxalement, par un potentiel pro-
ductif sous-utilisé. La fracture entre pays riches et pays
pauvres ne peut que s'accroître.
économique (due, entre autres, à la faiblesse de la consom-
mation intérieure), fait que la situation des pays sous-déve-
loppés se caractérise, paradoxalement, par un potentiel pro-
ductif sous-utilisé. La fracture entre pays riches et pays
pauvres ne peut que s'accroître.
« Le revenu moyen par habitant dans plus de quarante
nations du monde, dans les pays sous-développés, ne dépasse
pas aujourd'hui 120 dollars par an. Le revenu moyen par
habitant aux États-Unis est de plus de 3 ooo dollars. C'est-à-
dire une différence de 2 ooo % ». ces chiffres ont été cités par
MacNamara 36 en février 1967, qui ajoute : « Un chiffre aussi
fabuleux est un chiffre volcanique qui ne peut manquer d'avoir
des conséquences explosives... Si les nations riches du monde
ne font pas un effort immense, et coordonné, pour contrôler
le fossé qui se creuse entre les deux moitiés de la planète,
aucun d'entre nous ne pourra plus assurer la sécurité de son
pays devant les catastrophes qui seront inévitables, devant les
vagues de violence, qui emporteront nos défenses. Le chaos
économique que l'on peut prévoir devant de telles disparités
est plus menaçant, pour la sécurité des États-Unis, que les
armes atomiques chinoises. »
nations du monde, dans les pays sous-développés, ne dépasse
pas aujourd'hui 120 dollars par an. Le revenu moyen par
habitant aux États-Unis est de plus de 3 ooo dollars. C'est-à-
dire une différence de 2 ooo % ». ces chiffres ont été cités par
MacNamara 36 en février 1967, qui ajoute : « Un chiffre aussi
fabuleux est un chiffre volcanique qui ne peut manquer d'avoir
des conséquences explosives... Si les nations riches du monde
ne font pas un effort immense, et coordonné, pour contrôler
le fossé qui se creuse entre les deux moitiés de la planète,
aucun d'entre nous ne pourra plus assurer la sécurité de son
pays devant les catastrophes qui seront inévitables, devant les
vagues de violence, qui emporteront nos défenses. Le chaos
économique que l'on peut prévoir devant de telles disparités
est plus menaçant, pour la sécurité des États-Unis, que les
armes atomiques chinoises. »
On arrive ici à une des impasses de la politiques impéria-
liste : pour maintenir son dynamisme, l'économie capitaliste
engendre des disparités de plus en plus grandes (non seule-
liste : pour maintenir son dynamisme, l'économie capitaliste
engendre des disparités de plus en plus grandes (non seule-
36. Robert MACNAMARA : Séminaire de Jackson (Mississippi).
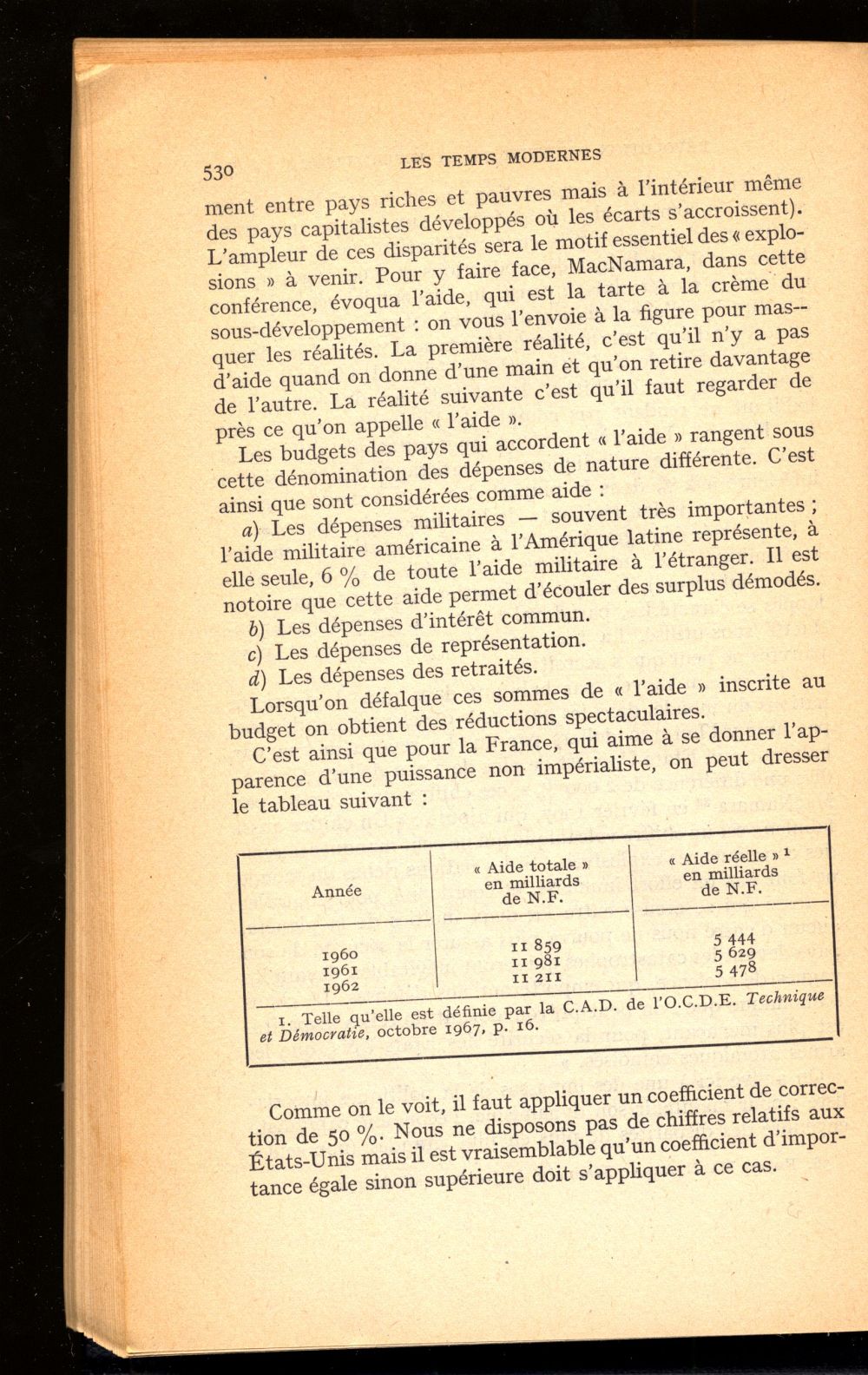

530
LES TEMPS MODERNES
ment entre pays riches et pauvres mais à l'intérieur même
des pays capitalistes développés où les écarts s'accroissent).
L'ampleur de ces disparités sera le motif essentiel des « explo-
sions » à venir. Pour y faire face, MacNamara, dans cette
conférence, évoqua l'aide, qui est la tarte à la crème du
sous-développement : on vous l'envoie à la figure pour mas-
quer les réalités. La première réalité, c'est qu'il n'y a pas
d'aide quand on donne d'une main et qu'on retire davantage
de l'autre. La réalité suivante c'est qu'il faut regarder de
près ce qu'on appelle « l'aide ».
des pays capitalistes développés où les écarts s'accroissent).
L'ampleur de ces disparités sera le motif essentiel des « explo-
sions » à venir. Pour y faire face, MacNamara, dans cette
conférence, évoqua l'aide, qui est la tarte à la crème du
sous-développement : on vous l'envoie à la figure pour mas-
quer les réalités. La première réalité, c'est qu'il n'y a pas
d'aide quand on donne d'une main et qu'on retire davantage
de l'autre. La réalité suivante c'est qu'il faut regarder de
près ce qu'on appelle « l'aide ».
Les budgets des pays qui accordent « l'aide » rangent sous
cette dénomination des dépenses de nature différente. C'est
ainsi que sont considérées comme aide :
cette dénomination des dépenses de nature différente. C'est
ainsi que sont considérées comme aide :
a) Les dépenses militaires — souvent très importantes ;
l'aide militaire américaine à l'Amérique latine représente, à
elle seule, 6 % de toute l'aide militaire à l'étranger. Il est
notoire que cette aide permet d'écouler des surplus démodés.
l'aide militaire américaine à l'Amérique latine représente, à
elle seule, 6 % de toute l'aide militaire à l'étranger. Il est
notoire que cette aide permet d'écouler des surplus démodés.
b) Les dépenses d'intérêt commun.
c) Les dépenses de représentation.
d) Les dépenses des retraités.
Lorsqu'on défalque ces sommes de « l'aide » inscrite au
budget on obtient des réductions spectaculaires.
budget on obtient des réductions spectaculaires.
C'est ainsi que pour la France, qui aime à se donner l'ap-
parence d'une puissance non impérialiste, on peut dresser
le tableau suivant :
parence d'une puissance non impérialiste, on peut dresser
le tableau suivant :
Année
« Aide totale » en milliards de N.F.
« Aide réelle » 1 en milliards de N.F.
« Aide totale » en milliards de N.F.
« Aide réelle » 1 en milliards de N.F.
1960 1961 1962
il 859 il 981
II 211
5 444 5 629 5478
il 859 il 981
II 211
5 444 5 629 5478
i. Telle qu'elle est et Démocratie, octobre
définie par la C.A.D. d 1967, p. 16.
e l'O.C.D.E. Technique
définie par la C.A.D. d 1967, p. 16.
e l'O.C.D.E. Technique
Comme on le voit, il faut appliquer un coefficient de correc-
tion de 50 %. Nous ne disposons pas de chiffres relatifs aux
États-Unis mais il est vraisemblable qu'un coefficient d'impor-
tance égale sinon supérieure doit s'appliquer à ce cas.
tion de 50 %. Nous ne disposons pas de chiffres relatifs aux
États-Unis mais il est vraisemblable qu'un coefficient d'impor-
tance égale sinon supérieure doit s'appliquer à ce cas.
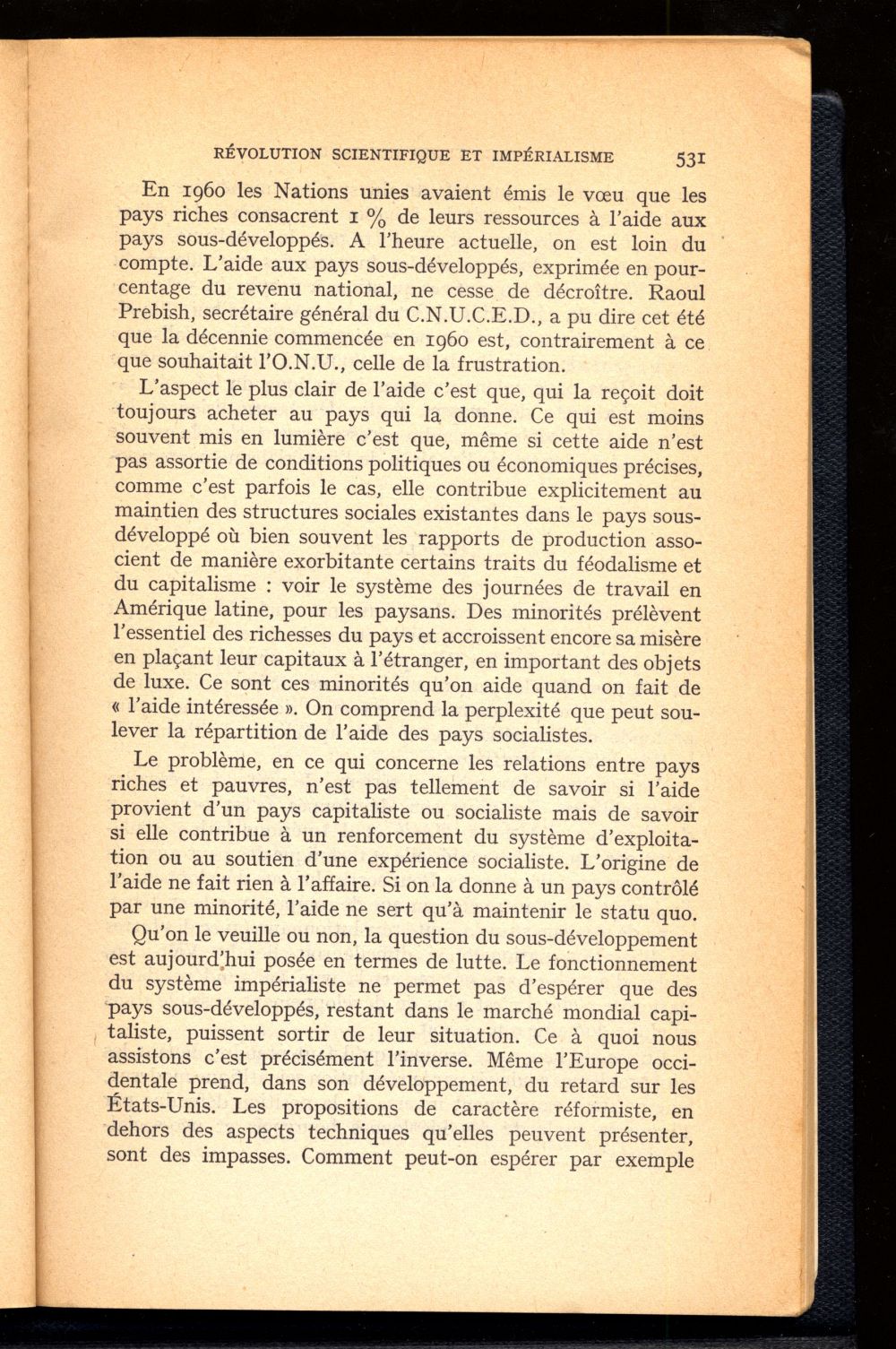

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
531
En 1960 les Nations unies avaient émis le vœu que les
pays riches consacrent i % de leurs ressources à l'aide aux
pays sous-développés. A l'heure actuelle, on est loin du
compte. L'aide aux pays sous-développés, exprimée en pour-
centage du revenu national, ne cesse de décroître. Raoul
Prebish, secrétaire général du C.N.U.C.E.D., a pu dire cet été
que la décennie commencée en 1960 est, contrairement à ce
que souhaitait l'O.N.U., celle de la frustration.
pays riches consacrent i % de leurs ressources à l'aide aux
pays sous-développés. A l'heure actuelle, on est loin du
compte. L'aide aux pays sous-développés, exprimée en pour-
centage du revenu national, ne cesse de décroître. Raoul
Prebish, secrétaire général du C.N.U.C.E.D., a pu dire cet été
que la décennie commencée en 1960 est, contrairement à ce
que souhaitait l'O.N.U., celle de la frustration.
L'aspect le plus clair de l'aide c'est que, qui la reçoit doit
toujours acheter au pays qui la donne. Ce qui est moins
souvent mis en lumière c'est que, même si cette aide n'est
pas assortie de conditions politiques ou économiques précises,
comme c'est parfois le cas, elle contribue explicitement au
maintien des structures sociales existantes dans le pays sous-
développé où bien souvent les rapports de production asso-
cient de manière exorbitante certains traits du féodalisme et
du capitalisme : voir le système des journées de travail en
Amérique latine, pour les paysans. Des minorités prélèvent
l'essentiel des richesses du pays et accroissent encore sa misère
en plaçant leur capitaux à l'étranger, en important des objets
de luxe. Ce sont ces minorités qu'on aide quand on fait de
« l'aide intéressée ». On comprend la perplexité que peut sou-
lever la répartition de l'aide des pays socialistes.
toujours acheter au pays qui la donne. Ce qui est moins
souvent mis en lumière c'est que, même si cette aide n'est
pas assortie de conditions politiques ou économiques précises,
comme c'est parfois le cas, elle contribue explicitement au
maintien des structures sociales existantes dans le pays sous-
développé où bien souvent les rapports de production asso-
cient de manière exorbitante certains traits du féodalisme et
du capitalisme : voir le système des journées de travail en
Amérique latine, pour les paysans. Des minorités prélèvent
l'essentiel des richesses du pays et accroissent encore sa misère
en plaçant leur capitaux à l'étranger, en important des objets
de luxe. Ce sont ces minorités qu'on aide quand on fait de
« l'aide intéressée ». On comprend la perplexité que peut sou-
lever la répartition de l'aide des pays socialistes.
Le problème, en ce qui concerne les relations entre pays
riches et pauvres, n'est pas tellement de savoir si l'aide
provient d'un pays capitaliste ou socialiste mais de savoir
si elle contribue à un renforcement du système d'exploita-
tion ou au soutien d'une expérience socialiste. L'origine de
l'aide ne fait rien à l'affaire. Si on la donne à un pays contrôlé
par une minorité, l'aide ne sert qu'à maintenir le statu quo.
riches et pauvres, n'est pas tellement de savoir si l'aide
provient d'un pays capitaliste ou socialiste mais de savoir
si elle contribue à un renforcement du système d'exploita-
tion ou au soutien d'une expérience socialiste. L'origine de
l'aide ne fait rien à l'affaire. Si on la donne à un pays contrôlé
par une minorité, l'aide ne sert qu'à maintenir le statu quo.
Qu'on le veuille ou non, la question du sous-développement
est aujourd'hui posée en termes de lutte. Le fonctionnement
du système impérialiste ne permet pas d'espérer que des
pays sous-développés, restant dans le marché mondial capi-
taliste, puissent sortir de leur situation. Ce à quoi nous
assistons c'est précisément l'inverse. Même l'Europe occi-
dentale prend, dans son développement, du retard sur les
États-Unis. Les propositions de caractère réformiste, en
dehors des aspects techniques qu'elles peuvent présenter,
sont des impasses. Comment peut-on espérer par exemple
est aujourd'hui posée en termes de lutte. Le fonctionnement
du système impérialiste ne permet pas d'espérer que des
pays sous-développés, restant dans le marché mondial capi-
taliste, puissent sortir de leur situation. Ce à quoi nous
assistons c'est précisément l'inverse. Même l'Europe occi-
dentale prend, dans son développement, du retard sur les
États-Unis. Les propositions de caractère réformiste, en
dehors des aspects techniques qu'elles peuvent présenter,
sont des impasses. Comment peut-on espérer par exemple
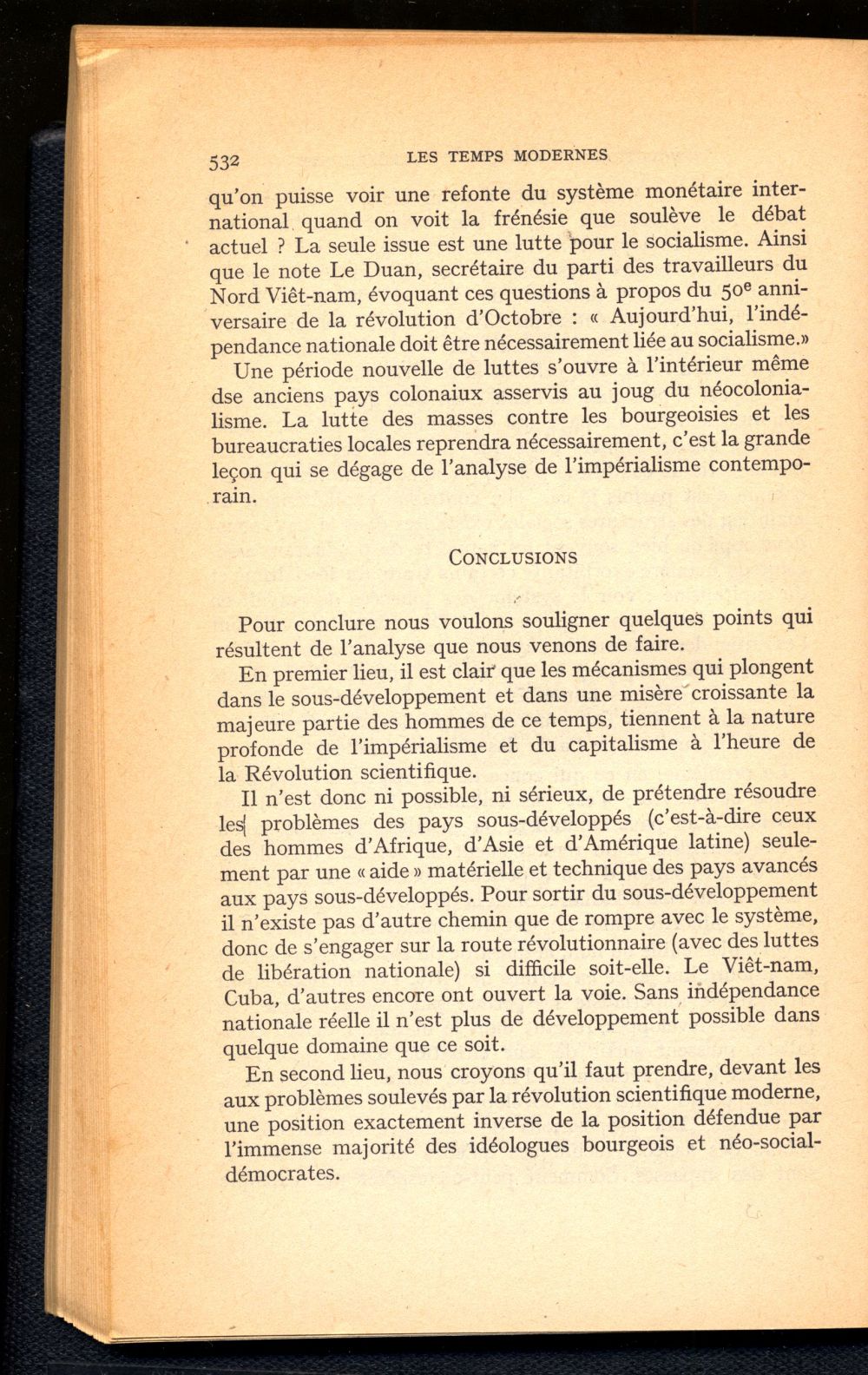

532
LES TEMPS MODERNES
qu'on puisse voir une refonte du système monétaire inter-
national quand on voit la frénésie que soulève le débat
actuel ? La seule issue est une lutte pour le socialisme. Ainsi
que le note Le Duan, secrétaire du parti des travailleurs du
Nord Viêt-nam, évoquant ces questions à propos du 50e anni-
versaire de la révolution d'Octobre : « Aujourd'hui, l'indé-
pendance nationale doit être nécessairement liée au socialisme.»
Une période nouvelle de luttes s'ouvre à l'intérieur même
dse anciens pays colonaiux asservis au joug du néocolonia-
lisme. La lutte des masses contre les bourgeoisies et les
bureaucraties locales reprendra nécessairement, c'est la grande
leçon qui se dégage de l'analyse de l'impérialisme contempo-
national quand on voit la frénésie que soulève le débat
actuel ? La seule issue est une lutte pour le socialisme. Ainsi
que le note Le Duan, secrétaire du parti des travailleurs du
Nord Viêt-nam, évoquant ces questions à propos du 50e anni-
versaire de la révolution d'Octobre : « Aujourd'hui, l'indé-
pendance nationale doit être nécessairement liée au socialisme.»
Une période nouvelle de luttes s'ouvre à l'intérieur même
dse anciens pays colonaiux asservis au joug du néocolonia-
lisme. La lutte des masses contre les bourgeoisies et les
bureaucraties locales reprendra nécessairement, c'est la grande
leçon qui se dégage de l'analyse de l'impérialisme contempo-
rain.
CONCLUSIONS
Pour conclure nous voulons souligner quelques points qui
résultent de l'analyse que nous venons de faire.
résultent de l'analyse que nous venons de faire.
En premier lieu, il est clair que les mécanismes qui plongent
dans le sous-développement et dans une misère croissante la
majeure partie des hommes de ce temps, tiennent à la nature
profonde de l'impérialisme et du capitalisme à l'heure de
la Révolution scientifique.
dans le sous-développement et dans une misère croissante la
majeure partie des hommes de ce temps, tiennent à la nature
profonde de l'impérialisme et du capitalisme à l'heure de
la Révolution scientifique.
Il n'est donc ni possible, ni sérieux, de prétendre résoudre
lesj problèmes des pays sous-développés (c'est-à-dire ceux
des hommes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine) seule-
ment par une « aide » matérielle et technique des pays avancés
aux pays sous-développés. Pour sortir du sous-développement
il n'existe pas d'autre chemin que de rompre avec le système,
donc de s'engager sur la route révolutionnaire (avec des luttes
de libération nationale) si difficile soit-elle. Le Viêt-nam,
Cuba, d'autres encore ont ouvert la voie. Sans indépendance
nationale réelle il n'est plus de développement possible dans
quelque domaine que ce soit.
lesj problèmes des pays sous-développés (c'est-à-dire ceux
des hommes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine) seule-
ment par une « aide » matérielle et technique des pays avancés
aux pays sous-développés. Pour sortir du sous-développement
il n'existe pas d'autre chemin que de rompre avec le système,
donc de s'engager sur la route révolutionnaire (avec des luttes
de libération nationale) si difficile soit-elle. Le Viêt-nam,
Cuba, d'autres encore ont ouvert la voie. Sans indépendance
nationale réelle il n'est plus de développement possible dans
quelque domaine que ce soit.
En second lieu, nous croyons qu'il faut prendre, devant les
aux problèmes soulevés par la révolution scientifique moderne,
une position exactement inverse de la position défendue par
l'immense majorité des idéologues bourgeois et néo-social-
démocrates.
aux problèmes soulevés par la révolution scientifique moderne,
une position exactement inverse de la position défendue par
l'immense majorité des idéologues bourgeois et néo-social-
démocrates.
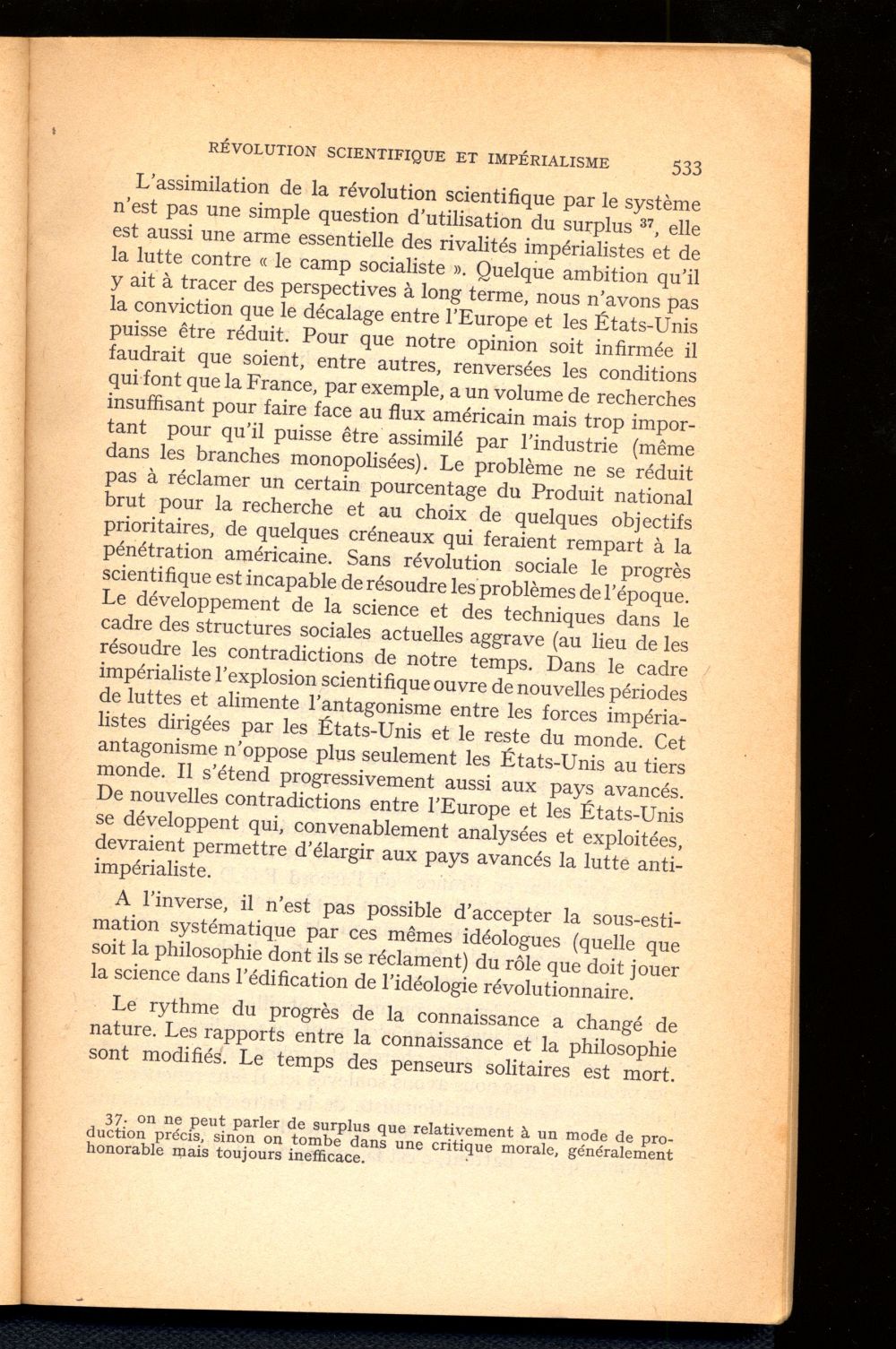

REVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPERIALISME
533
L'assimilation de la révolution scientifique par le système
n'est pas une simple question d'utilisation du surplus 37, elle
est aussi une arme essentielle des rivalités impérialistes et de
la lutte contre « le camp socialiste ». Quelque ambition qu'il
y ait à tracer des perspectives à long terme, nous n'avons pas
la conviction que le décalage entre l'Europe et les États-Unis
puisse être réduit. Pour que notre opinion soit infirmée il
faudrait que soient, entre autres, renversées les conditions
qui font que la France, par exemple, a un volume de recherches
insuffisant pour faire face au flux américain mais trop impor-
tant pour qu'il puisse être assimilé par l'industrie (même
dans les branches monopolisées). Le problème ne se réduit
pas à réclamer un certain pourcentage du Produit national
brut pour la recherche et au choix de quelques objectifs
prioritaires, de quelques créneaux qui feraient rempart à la
pénétration américaine. Sans révolution sociale le progrès
scientifique est incapable de résoudre les problèmes de l'époque.
Le développement de la science et des techniques dans le
cadre des structures sociales actuelles aggrave (au lieu de les
résoudre les contradictions de notre temps. Dans le cadre
impérialiste l'explosion scientifique ouvre de nouvelles périodes
de luttes et alimente l'antagonisme entre les forces impéria-
listes dirigées par les États-Unis et le reste du monde. Cet
antagonisme n'oppose plus seulement les États-Unis au tiers
monde. Il s'étend progressivement aussi aux pays avancés.
De nouvelles contradictions entre l'Europe et les États-Unis
se développent qui, convenablement analysées et exploitées,
devraient permettre d'élargir aux pays avancés la lutte anti-
impérialiste.
n'est pas une simple question d'utilisation du surplus 37, elle
est aussi une arme essentielle des rivalités impérialistes et de
la lutte contre « le camp socialiste ». Quelque ambition qu'il
y ait à tracer des perspectives à long terme, nous n'avons pas
la conviction que le décalage entre l'Europe et les États-Unis
puisse être réduit. Pour que notre opinion soit infirmée il
faudrait que soient, entre autres, renversées les conditions
qui font que la France, par exemple, a un volume de recherches
insuffisant pour faire face au flux américain mais trop impor-
tant pour qu'il puisse être assimilé par l'industrie (même
dans les branches monopolisées). Le problème ne se réduit
pas à réclamer un certain pourcentage du Produit national
brut pour la recherche et au choix de quelques objectifs
prioritaires, de quelques créneaux qui feraient rempart à la
pénétration américaine. Sans révolution sociale le progrès
scientifique est incapable de résoudre les problèmes de l'époque.
Le développement de la science et des techniques dans le
cadre des structures sociales actuelles aggrave (au lieu de les
résoudre les contradictions de notre temps. Dans le cadre
impérialiste l'explosion scientifique ouvre de nouvelles périodes
de luttes et alimente l'antagonisme entre les forces impéria-
listes dirigées par les États-Unis et le reste du monde. Cet
antagonisme n'oppose plus seulement les États-Unis au tiers
monde. Il s'étend progressivement aussi aux pays avancés.
De nouvelles contradictions entre l'Europe et les États-Unis
se développent qui, convenablement analysées et exploitées,
devraient permettre d'élargir aux pays avancés la lutte anti-
impérialiste.
A l'inverse, il n'est pas possible d'accepter la sous-esti-
mation systématique par ces mêmes idéologues (quelle que
soit la philosophie dont ils se réclament) du rôle que doit jouer
la science dans l'édification de l'idéologie révolutionnaire.
mation systématique par ces mêmes idéologues (quelle que
soit la philosophie dont ils se réclament) du rôle que doit jouer
la science dans l'édification de l'idéologie révolutionnaire.
Le rythme du progrès de la connaissance a changé de
nature. Les rapports entre la connaissance et la philosophie
sont modifiés. Le temps des penseurs solitaires est mort.
nature. Les rapports entre la connaissance et la philosophie
sont modifiés. Le temps des penseurs solitaires est mort.
37. on ne peut parler de surplus que relativement à un mode de pro-
duction précis, sinon on tombe dans une critique morale, généralement
honorable mais toujours inefficace.
duction précis, sinon on tombe dans une critique morale, généralement
honorable mais toujours inefficace.
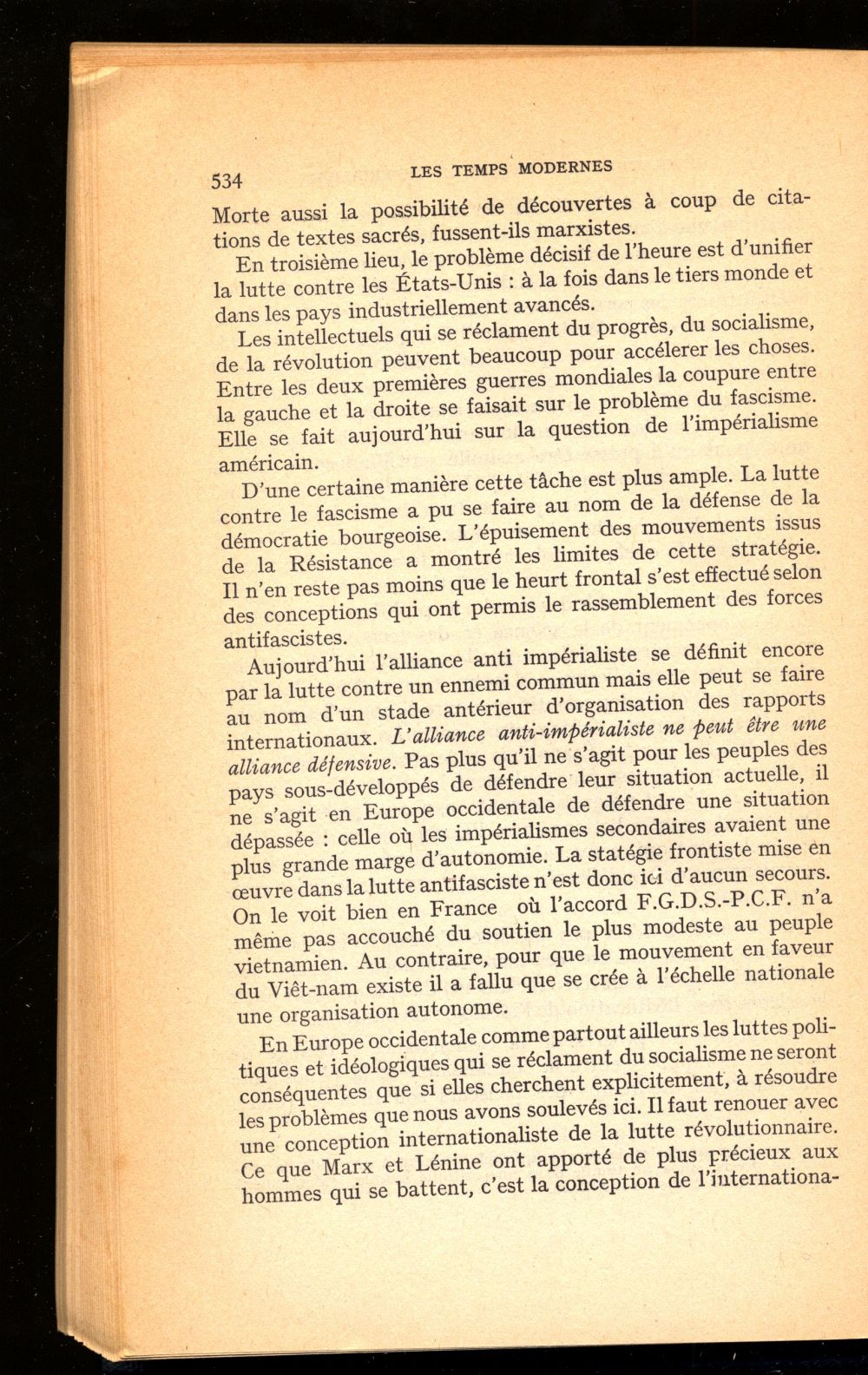

534
LES TEMPS MODERNES
Morte aussi la possibilité de découvertes à coup de cita-
tions de textes sacrés, fussent-ils marxistes.
tions de textes sacrés, fussent-ils marxistes.
En troisième lieu, le problème décisif de l'heure est d'unifier
la lutte contre les États-Unis : à la fois dans le tiers monde et
dans les pays industriellement avancés.
la lutte contre les États-Unis : à la fois dans le tiers monde et
dans les pays industriellement avancés.
Les intellectuels qui se réclament du progrès, du socialisme,
de la révolution peuvent beaucoup pour accélérer les choses.
Entre les deux premières guerres mondiales la coupure entre
la gauche et la droite se faisait sur le problème du fascisme.
Elle se fait aujourd'hui sur la question de l'impérialisme
américain.
de la révolution peuvent beaucoup pour accélérer les choses.
Entre les deux premières guerres mondiales la coupure entre
la gauche et la droite se faisait sur le problème du fascisme.
Elle se fait aujourd'hui sur la question de l'impérialisme
américain.
D'une certaine manière cette tâche est plus ample. La lutte
contre le fascisme a pu se faire au nom de la défense de la
démocratie bourgeoise. L'épuisement des mouvements issus
de la Résistance a montré les limites de cette stratégie.
Il n'en reste pas moins que le heurt frontal s'est effectué selon
des conceptions qui ont permis le rassemblement des forces
antifascistes.
contre le fascisme a pu se faire au nom de la défense de la
démocratie bourgeoise. L'épuisement des mouvements issus
de la Résistance a montré les limites de cette stratégie.
Il n'en reste pas moins que le heurt frontal s'est effectué selon
des conceptions qui ont permis le rassemblement des forces
antifascistes.
Aujourd'hui l'alliance anti impérialiste se définit encore
par la lutte contre un ennemi commun mais elle peut se faire
au nom d'un stade antérieur d'organisation des rapports
internationaux. L'alliance anti-impérialiste ne peut être une
alliance défensive. Pas plus qu'il ne s'agit pour les peuples des
pays sous-développés de défendre leur situation actuelle, il
ne s'agit en Europe occidentale de défendre une situation
dépassée : celle où les impérialismes secondaires avaient une
plus grande marge d'autonomie. La statégie frontiste mise en
œuvre dans la lutte antifasciste n'est donc ici d'aucun secours.
On le voit bien en France où l'accord F.G.D.S.-P.C.F. n'a
même pas accouché du soutien le plus modeste au peuple
vietnamien. Au contraire, pour que le mouvement en faveur
du Viêt-nam existe il a fallu que se crée à l'échelle nationale
une organisation autonome.
par la lutte contre un ennemi commun mais elle peut se faire
au nom d'un stade antérieur d'organisation des rapports
internationaux. L'alliance anti-impérialiste ne peut être une
alliance défensive. Pas plus qu'il ne s'agit pour les peuples des
pays sous-développés de défendre leur situation actuelle, il
ne s'agit en Europe occidentale de défendre une situation
dépassée : celle où les impérialismes secondaires avaient une
plus grande marge d'autonomie. La statégie frontiste mise en
œuvre dans la lutte antifasciste n'est donc ici d'aucun secours.
On le voit bien en France où l'accord F.G.D.S.-P.C.F. n'a
même pas accouché du soutien le plus modeste au peuple
vietnamien. Au contraire, pour que le mouvement en faveur
du Viêt-nam existe il a fallu que se crée à l'échelle nationale
une organisation autonome.
En Europe occidentale comme partout ailleurs les luttes poli-
tiques et idéologiques qui se réclament du socialisme ne seront
conséquentes que si elles cherchent explicitement, à résoudre
les problèmes que nous avons soulevés ici. Il faut renouer avec
une conception internationaliste de la lutte révolutionnaire.
Ce que Marx et Lénine ont apporté de plus précieux aux
hommes qui se battent, c'est la conception de l'internationa-
tiques et idéologiques qui se réclament du socialisme ne seront
conséquentes que si elles cherchent explicitement, à résoudre
les problèmes que nous avons soulevés ici. Il faut renouer avec
une conception internationaliste de la lutte révolutionnaire.
Ce que Marx et Lénine ont apporté de plus précieux aux
hommes qui se battent, c'est la conception de l'internationa-
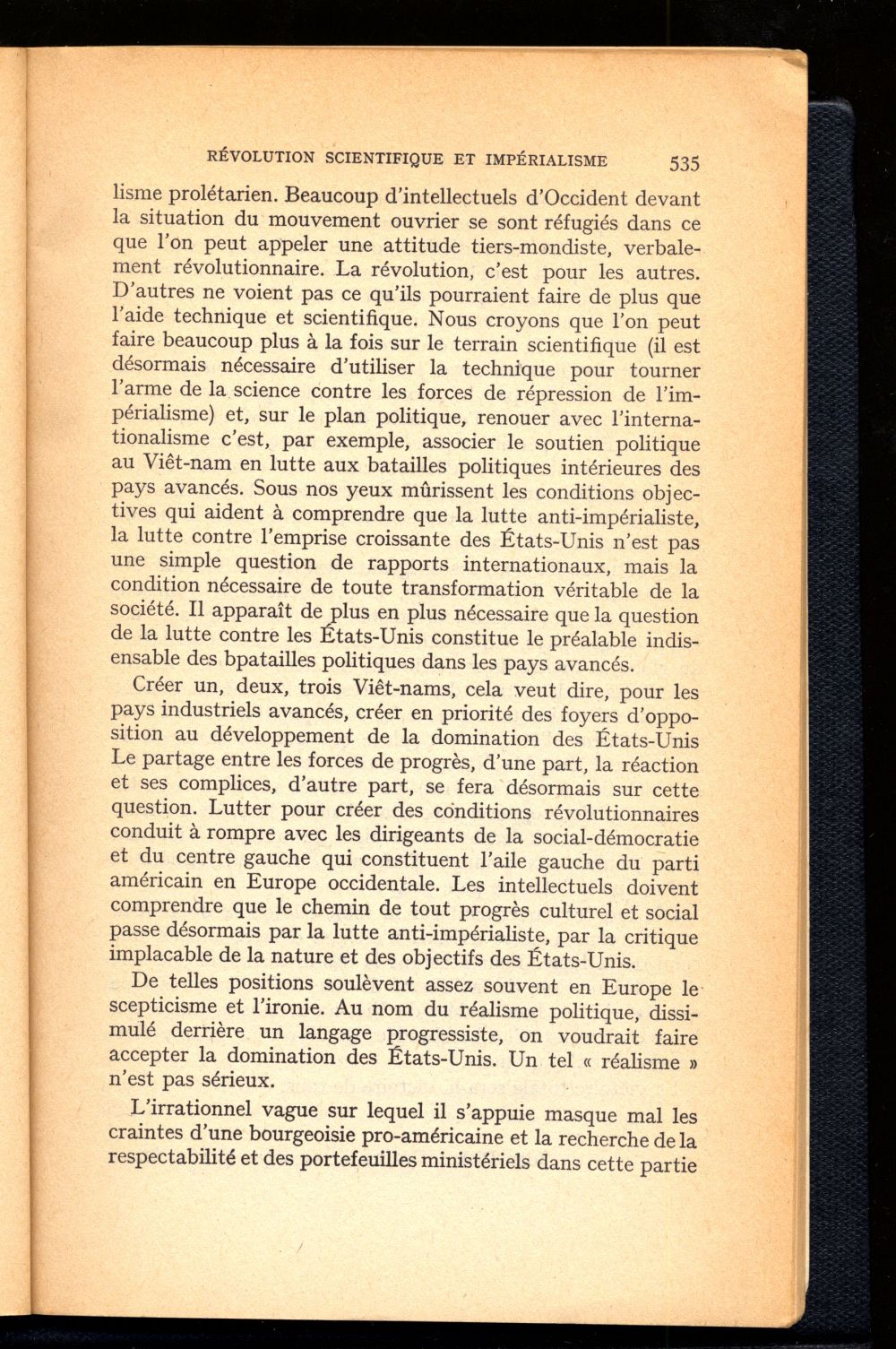

RÉVOLUTION SCIENTIFIQUE ET IMPÉRIALISME
535
lisme prolétarien. Beaucoup d'intellectuels d'Occident devant
la situation du mouvement ouvrier se sont réfugiés dans ce
que l'on peut appeler une attitude tiers-mondiste, verbale-
ment révolutionnaire. La révolution, c'est pour les autres.
D'autres ne voient pas ce qu'ils pourraient faire de plus que
l'aide technique et scientifique. Nous croyons que l'on peut
faire beaucoup plus à la fois sur le terrain scientifique (il est
désormais nécessaire d'utiliser la technique pour tourner
l'arme de la science contre les forces de répression de l'im-
périalisme) et, sur le plan politique, renouer avec l'interna-
tionalisme c'est, par exemple, associer le soutien politique
au Viêt-nam en lutte aux batailles politiques intérieures des
pays avancés. Sous nos yeux mûrissent les conditions objec-
tives qui aident à comprendre que la lutte anti-impérialiste,
la lutte contre l'emprise croissante des États-Unis n'est pas
une simple question de rapports internationaux, mais la
condition nécessaire de toute transformation véritable de la
société. Il apparaît de plus en plus nécessaire que la question
de la lutte contre les États-Unis constitue le préalable indis-
ensable des bpatailles politiques dans les pays avancés.
la situation du mouvement ouvrier se sont réfugiés dans ce
que l'on peut appeler une attitude tiers-mondiste, verbale-
ment révolutionnaire. La révolution, c'est pour les autres.
D'autres ne voient pas ce qu'ils pourraient faire de plus que
l'aide technique et scientifique. Nous croyons que l'on peut
faire beaucoup plus à la fois sur le terrain scientifique (il est
désormais nécessaire d'utiliser la technique pour tourner
l'arme de la science contre les forces de répression de l'im-
périalisme) et, sur le plan politique, renouer avec l'interna-
tionalisme c'est, par exemple, associer le soutien politique
au Viêt-nam en lutte aux batailles politiques intérieures des
pays avancés. Sous nos yeux mûrissent les conditions objec-
tives qui aident à comprendre que la lutte anti-impérialiste,
la lutte contre l'emprise croissante des États-Unis n'est pas
une simple question de rapports internationaux, mais la
condition nécessaire de toute transformation véritable de la
société. Il apparaît de plus en plus nécessaire que la question
de la lutte contre les États-Unis constitue le préalable indis-
ensable des bpatailles politiques dans les pays avancés.
Créer un, deux, trois Viêt-nams, cela veut dire, pour les
pays industriels avancés, créer en priorité des foyers d'oppo-
sition au développement de la domination des États-Unis
Le partage entre les forces de progrès, d'une part, la réaction
et ses complices, d'autre part, se fera désormais sur cette
question. Lutter pour créer des conditions révolutionnaires
conduit à rompre avec les dirigeants de la social-démocratie
et du centre gauche qui constituent l'aile gauche du parti
américain en Europe occidentale. Les intellectuels doivent
comprendre que le chemin de tout progrès culturel et social
passe désormais par la lutte anti-impérialiste, par la critique
implacable de la nature et des objectifs des États-Unis.
pays industriels avancés, créer en priorité des foyers d'oppo-
sition au développement de la domination des États-Unis
Le partage entre les forces de progrès, d'une part, la réaction
et ses complices, d'autre part, se fera désormais sur cette
question. Lutter pour créer des conditions révolutionnaires
conduit à rompre avec les dirigeants de la social-démocratie
et du centre gauche qui constituent l'aile gauche du parti
américain en Europe occidentale. Les intellectuels doivent
comprendre que le chemin de tout progrès culturel et social
passe désormais par la lutte anti-impérialiste, par la critique
implacable de la nature et des objectifs des États-Unis.
De telles positions soulèvent assez souvent en Europe le
scepticisme et l'ironie. Au nom du réalisme politique, dissi-
mulé derrière un langage progressiste, on voudrait faire
accepter la domination des États-Unis. Un tel « réalisme »
n'est pas sérieux.
scepticisme et l'ironie. Au nom du réalisme politique, dissi-
mulé derrière un langage progressiste, on voudrait faire
accepter la domination des États-Unis. Un tel « réalisme »
n'est pas sérieux.
L'irrationnel vague sur lequel il s'appuie masque mal les
craintes d'une bourgeoisie pro-américaine et la recherche de la
respectabilité et des portefeuilles ministériels dans cette partie
craintes d'une bourgeoisie pro-américaine et la recherche de la
respectabilité et des portefeuilles ministériels dans cette partie
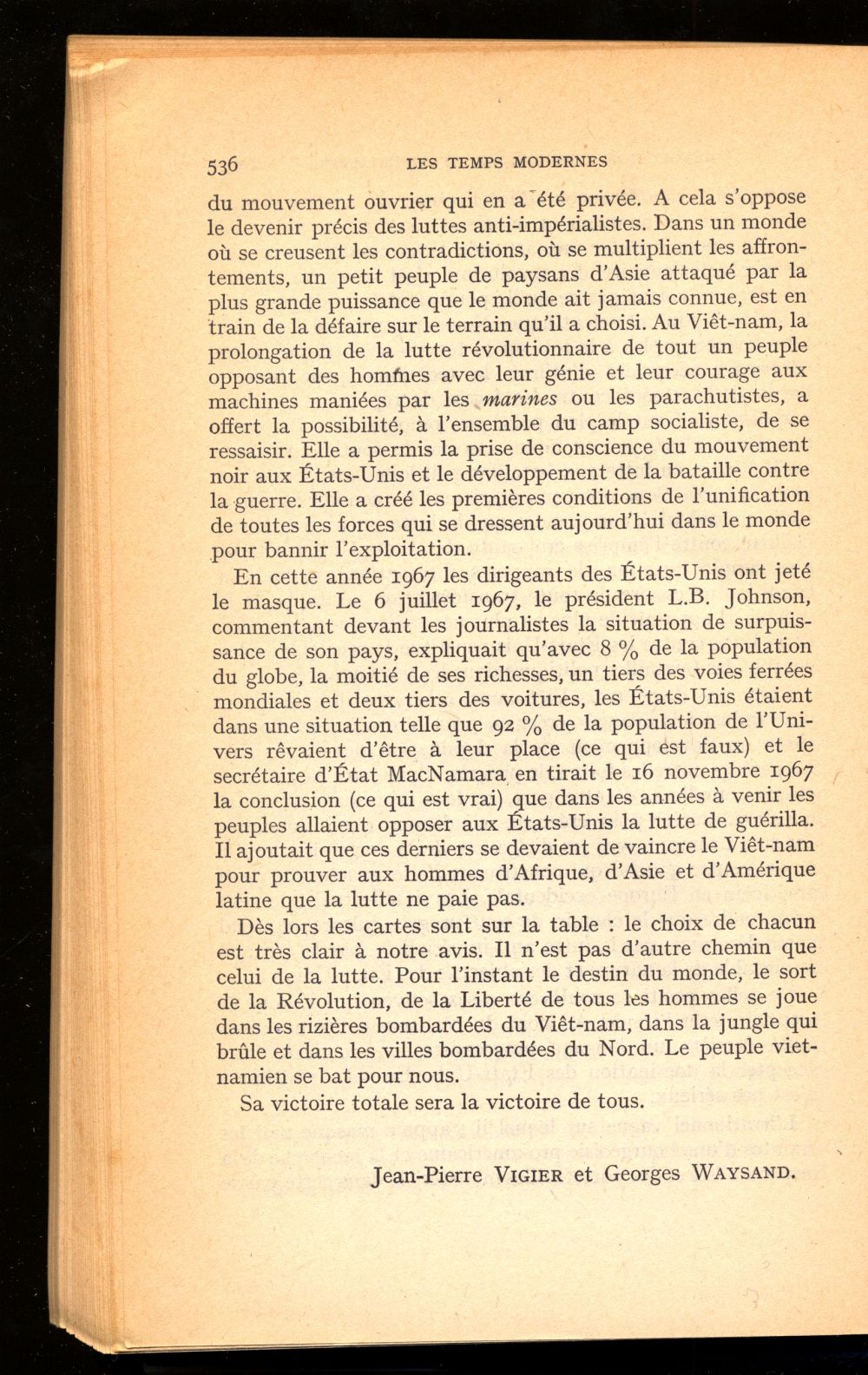

536
LES TEMPS MODERNES
du mouvement ouvrier qui en a été privée. A cela s'oppose
le devenir précis des luttes anti-impérialistes. Dans un monde
où se creusent les contradictions, où se multiplient les affron-
tements, un petit peuple de paysans d'Asie attaqué par la
plus grande puissance que le monde ait jamais connue, est en
train de la défaire sur le terrain qu'il a choisi. Au Viêt-nam, la
prolongation de la lutte révolutionnaire de tout un peuple
opposant des homfnes avec leur génie et leur courage aux
machines maniées par les mannes ou les parachutistes, a
offert la possibilité, à l'ensemble du camp socialiste, de se
ressaisir. Elle a permis la prise de conscience du mouvement
noir aux États-Unis et le développement de la bataille contre
la guerre. Elle a créé les premières conditions de l'unification
de toutes les forces qui se dressent aujourd'hui dans le monde
pour bannir l'exploitation.
le devenir précis des luttes anti-impérialistes. Dans un monde
où se creusent les contradictions, où se multiplient les affron-
tements, un petit peuple de paysans d'Asie attaqué par la
plus grande puissance que le monde ait jamais connue, est en
train de la défaire sur le terrain qu'il a choisi. Au Viêt-nam, la
prolongation de la lutte révolutionnaire de tout un peuple
opposant des homfnes avec leur génie et leur courage aux
machines maniées par les mannes ou les parachutistes, a
offert la possibilité, à l'ensemble du camp socialiste, de se
ressaisir. Elle a permis la prise de conscience du mouvement
noir aux États-Unis et le développement de la bataille contre
la guerre. Elle a créé les premières conditions de l'unification
de toutes les forces qui se dressent aujourd'hui dans le monde
pour bannir l'exploitation.
En cette année 1967 les dirigeants des États-Unis ont jeté
le masque. Le 6 juillet 1967, le président L.B. Johnson,
commentant devant les journalistes la situation de surpuis-
sance de son pays, expliquait qu'avec 8 % de la population
du globe, la moitié de ses richesses, un tiers des voies ferrées
mondiales et deux tiers des voitures, les États-Unis étaient
dans une situation telle que 92 % de la population de l'Uni-
vers rêvaient d'être à leur place (ce qui est faux) et le
secrétaire d'État MacNamara en tirait le 16 novembre 1967
la conclusion (ce qui est vrai) que dans les années à venir les
peuples allaient opposer aux États-Unis la lutte de guérilla.
Il ajoutait que ces derniers se devaient de vaincre le Viêt-nam
pour prouver aux hommes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine que la lutte ne paie pas.
le masque. Le 6 juillet 1967, le président L.B. Johnson,
commentant devant les journalistes la situation de surpuis-
sance de son pays, expliquait qu'avec 8 % de la population
du globe, la moitié de ses richesses, un tiers des voies ferrées
mondiales et deux tiers des voitures, les États-Unis étaient
dans une situation telle que 92 % de la population de l'Uni-
vers rêvaient d'être à leur place (ce qui est faux) et le
secrétaire d'État MacNamara en tirait le 16 novembre 1967
la conclusion (ce qui est vrai) que dans les années à venir les
peuples allaient opposer aux États-Unis la lutte de guérilla.
Il ajoutait que ces derniers se devaient de vaincre le Viêt-nam
pour prouver aux hommes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine que la lutte ne paie pas.
Dès lors les cartes sont sur la table : le choix de chacun
est très clair à notre avis. Il n'est pas d'autre chemin que
celui de la lutte. Pour l'instant le destin du monde, le sort
de la Révolution, de la Liberté de tous les hommes se joue
dans les rizières bombardées du Viêt-nam, dans la jungle qui
brûle et dans les villes bombardées du Nord. Le peuple viet-
namien se bat pour nous.
est très clair à notre avis. Il n'est pas d'autre chemin que
celui de la lutte. Pour l'instant le destin du monde, le sort
de la Révolution, de la Liberté de tous les hommes se joue
dans les rizières bombardées du Viêt-nam, dans la jungle qui
brûle et dans les villes bombardées du Nord. Le peuple viet-
namien se bat pour nous.
Sa victoire totale sera la victoire de tous.
Jean-Pierre VICIER et Georges WAYSAND.
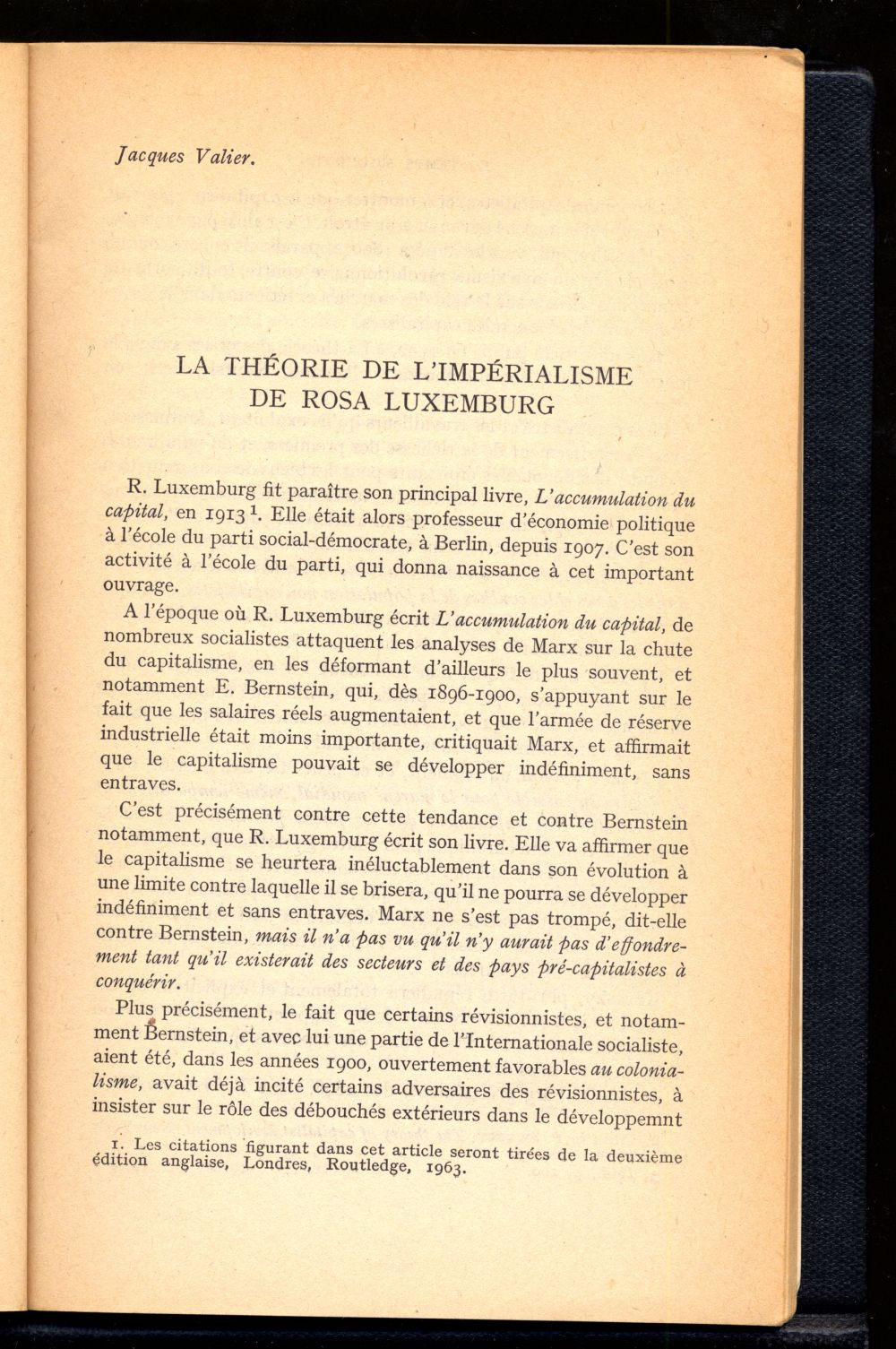

Jacques Valier.
LA THÉORIE DE L'IMPÉRIALISME
DE ROSA LUXEMBURG
DE ROSA LUXEMBURG
R. Luxemburg fit paraître son principal livre, L'accumulation du
capital, en 1913 1. Elle était alors professeur d'économie politique
à l'école du parti social-démocrate, à Berlin, depuis 1907. C'est son
activité à l'école du parti, qui donna naissance à cet important
ouvrage.
capital, en 1913 1. Elle était alors professeur d'économie politique
à l'école du parti social-démocrate, à Berlin, depuis 1907. C'est son
activité à l'école du parti, qui donna naissance à cet important
ouvrage.
A l'époque où R. Luxemburg écrit L'accumulation du capital, de
nombreux socialistes attaquent les analyses de Marx sur la chute
du capitalisme, en les déformant d'ailleurs le plus souvent, et
notamment E. Bernstein, qui, dès 1896-1900, s'appuyant sur le
fait que les salaires réels augmentaient, et que l'armée de réserve
industrielle était moins importante, critiquait Marx, et affirmait
que le capitalisme pouvait se développer indéfiniment, sans
entraves.
nombreux socialistes attaquent les analyses de Marx sur la chute
du capitalisme, en les déformant d'ailleurs le plus souvent, et
notamment E. Bernstein, qui, dès 1896-1900, s'appuyant sur le
fait que les salaires réels augmentaient, et que l'armée de réserve
industrielle était moins importante, critiquait Marx, et affirmait
que le capitalisme pouvait se développer indéfiniment, sans
entraves.
C'est précisément contre cette tendance et contre Bernstein
notamment, que R. Luxemburg écrit son livre. Elle va affirmer que
le capitalisme se heurtera inéluctablement dans son évolution à
une limite contre laquelle il se brisera, qu'il ne pourra se développer
indéfiniment et sans entraves. Marx ne s'est pas trompé, dit-elle
contre Bernstein, mais il n'a pas vu qu'il n'y aurait pas A'effondre-
ment tant qu'il existerait des secteurs et des pays pré-capitalistes à
conquérir.
notamment, que R. Luxemburg écrit son livre. Elle va affirmer que
le capitalisme se heurtera inéluctablement dans son évolution à
une limite contre laquelle il se brisera, qu'il ne pourra se développer
indéfiniment et sans entraves. Marx ne s'est pas trompé, dit-elle
contre Bernstein, mais il n'a pas vu qu'il n'y aurait pas A'effondre-
ment tant qu'il existerait des secteurs et des pays pré-capitalistes à
conquérir.
Plus précisément, le fait que certains révisionnistes, et notam-
ment Bernstein, et avec lui une partie de l'Internationale socialiste,
aient été, dans les années 1900, ouvertement favorables au colonia-
lisme, avait déjà incité certains adversaires des révisionnistes, à
insister sur le rôle des débouchés extérieurs dans le développemnt
ment Bernstein, et avec lui une partie de l'Internationale socialiste,
aient été, dans les années 1900, ouvertement favorables au colonia-
lisme, avait déjà incité certains adversaires des révisionnistes, à
insister sur le rôle des débouchés extérieurs dans le développemnt
i. Les citations figurant dans cet article seront tirées de la deuxième
édition anglaise, Londres, Routledge, 1963.
édition anglaise, Londres, Routledge, 1963.
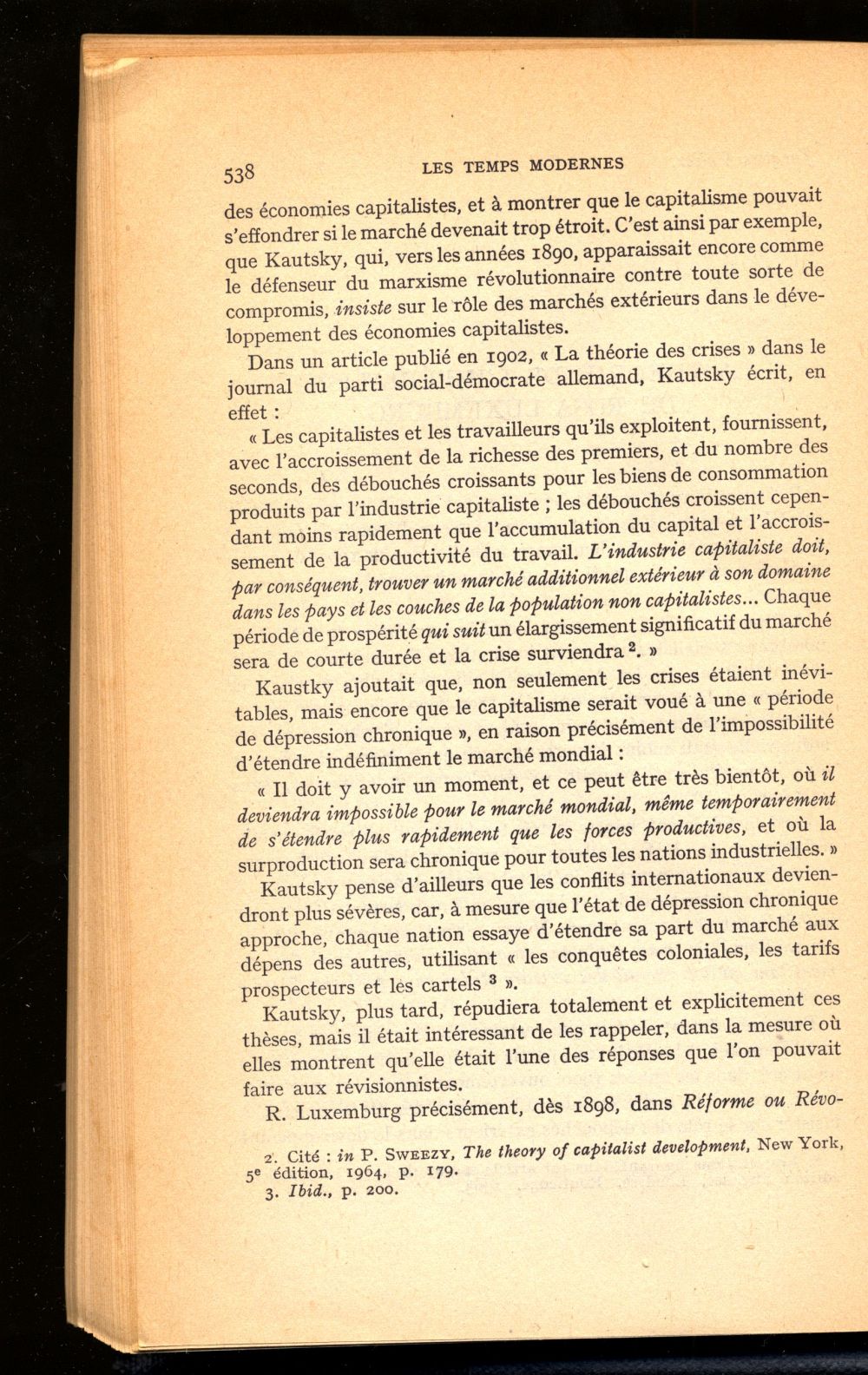

538
LES TEMPS MODERNES
des économies capitalistes, et à montrer que le capitalisme pouvait
s'effondrer si le marché devenait trop étroit. C'est ainsi par exemple,
que Kautsky, qui, vers les années 1890, apparaissait encore comme
le défenseur du marxisme révolutionnaire contre toute sorte de
compromis, insiste sur le rôle des marchés extérieurs dans le déve-
loppement des économies capitalistes.
s'effondrer si le marché devenait trop étroit. C'est ainsi par exemple,
que Kautsky, qui, vers les années 1890, apparaissait encore comme
le défenseur du marxisme révolutionnaire contre toute sorte de
compromis, insiste sur le rôle des marchés extérieurs dans le déve-
loppement des économies capitalistes.
Dans un article publié en 1902, « La théorie des crises » dans le
journal du parti social-démocrate allemand, Kautsky écrit, en
effet:
journal du parti social-démocrate allemand, Kautsky écrit, en
effet:
« Les capitalistes et les travailleurs qu'ils exploitent, fournissent,
avec l'accroissement de la richesse des premiers, et du nombre des
seconds, des débouchés croissants pour les biens de consommation
produits par l'industrie capitaliste ; les débouchés croissent cepen-
dant moins rapidement que l'accumulation du capital et l'accrois-
sement de la productivité du travail. L'industrie capitaliste doit,
par conséquent, trouver un marché additionnel extérieur à son domaine
dans les pays et les couches de la population non capitalistes... Chaque
période de prospérité qui suit un élargissement significatif du marché
sera de courte durée et la crise surviendra2. »
avec l'accroissement de la richesse des premiers, et du nombre des
seconds, des débouchés croissants pour les biens de consommation
produits par l'industrie capitaliste ; les débouchés croissent cepen-
dant moins rapidement que l'accumulation du capital et l'accrois-
sement de la productivité du travail. L'industrie capitaliste doit,
par conséquent, trouver un marché additionnel extérieur à son domaine
dans les pays et les couches de la population non capitalistes... Chaque
période de prospérité qui suit un élargissement significatif du marché
sera de courte durée et la crise surviendra2. »
Kaustky ajoutait que, non seulement les crises étaient inévi-
tables, mais encore que le capitalisme serait voué à une « période
de dépression chronique », en raison précisément de l'impossibilité
d'étendre indéfiniment le marché mondial :
tables, mais encore que le capitalisme serait voué à une « période
de dépression chronique », en raison précisément de l'impossibilité
d'étendre indéfiniment le marché mondial :
« II doit y avoir un moment, et ce peut être très bientôt, où il
deviendra impossible pour le marché mondial, même temporairement
de s'étendre plus rapidement que les forces productives, et où la
surproduction sera chronique pour toutes les nations industrielles. »
deviendra impossible pour le marché mondial, même temporairement
de s'étendre plus rapidement que les forces productives, et où la
surproduction sera chronique pour toutes les nations industrielles. »
Kautsky pense d'ailleurs que les conflits internationaux devien-
dront plus sévères, car, à mesure que l'état de dépression chronique
approche, chaque nation essaye d'étendre sa part du marché aux
dépens des autres, utilisant « les conquêtes coloniales, les tarifs
prospecteurs et les cartels 3 ».
dront plus sévères, car, à mesure que l'état de dépression chronique
approche, chaque nation essaye d'étendre sa part du marché aux
dépens des autres, utilisant « les conquêtes coloniales, les tarifs
prospecteurs et les cartels 3 ».
Kautsky, plus tard, répudiera totalement et explicitement ces
thèses, mais il était intéressant de les rappeler, dans la mesure où
elles montrent qu'elle était l'une des réponses que l'on pouvait
faire aux révisionnistes.
thèses, mais il était intéressant de les rappeler, dans la mesure où
elles montrent qu'elle était l'une des réponses que l'on pouvait
faire aux révisionnistes.
R. Luxemburg précisément, dès 1898, dans Réforme ou Révo-
2. Cité : in P. SWEEZY, The theory of capitalist development, New York,
5e édition, 1964, p. 179.
5e édition, 1964, p. 179.
3. Ibid., p. 200.
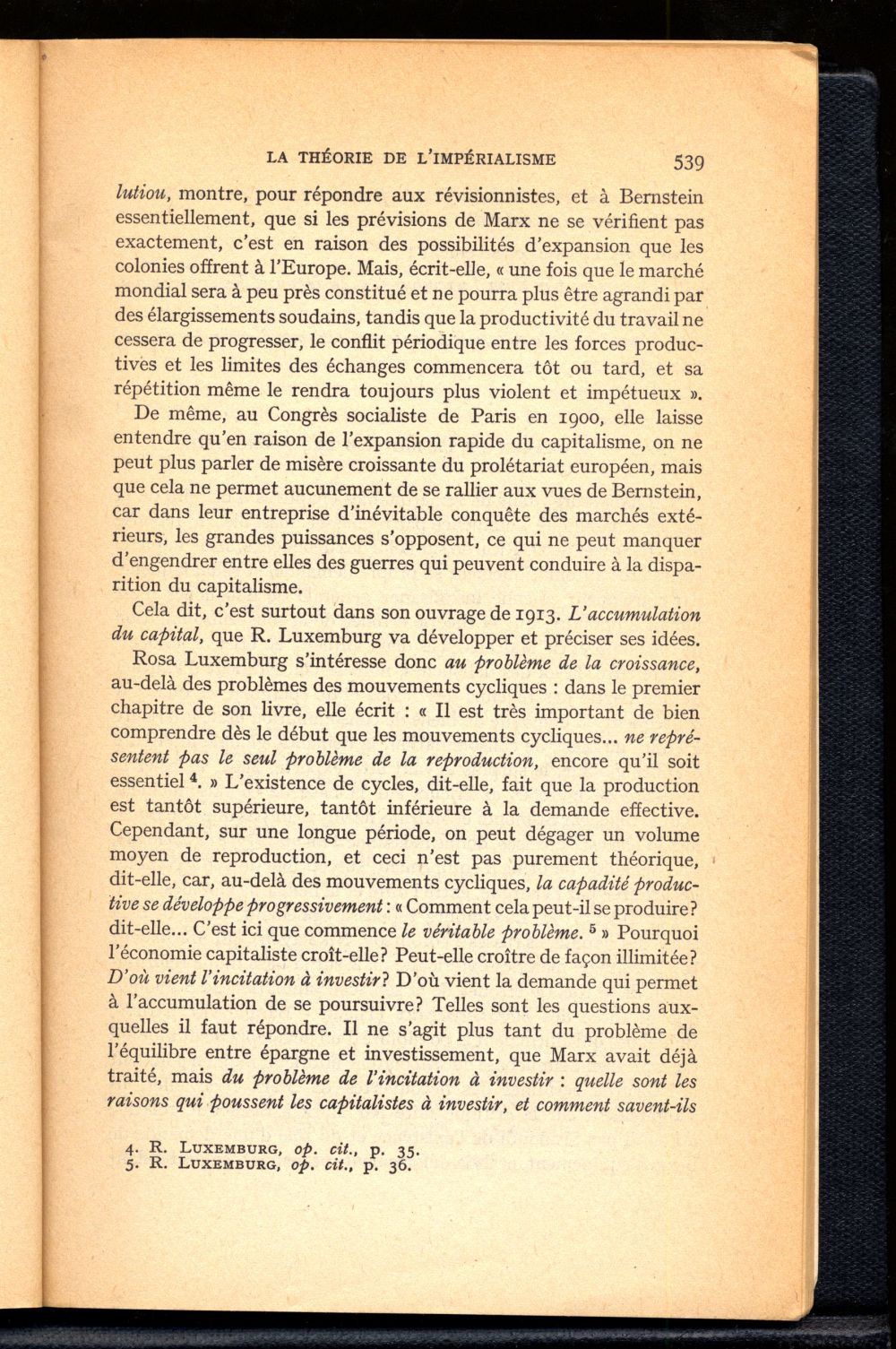

LA THÉORIE DE L'IMPÉRIALISME
539
lutiou, montre, pour répondre aux révisionnistes, et à Bernstein
essentiellement, que si les prévisions de Marx ne se vérifient pas
exactement, c'est en raison des possibilités d'expansion que les
colonies offrent à l'Europe. Mais, écrit-elle, « une fois que le marché
mondial sera à peu près constitué et ne pourra plus être agrandi par
des élargissements soudains, tandis que la productivité du travail ne
cessera de progresser, le conflit périodique entre les forces produc-
tives et les limites des échanges commencera tôt ou tard, et sa
répétition même le rendra toujours plus violent et impétueux ».
essentiellement, que si les prévisions de Marx ne se vérifient pas
exactement, c'est en raison des possibilités d'expansion que les
colonies offrent à l'Europe. Mais, écrit-elle, « une fois que le marché
mondial sera à peu près constitué et ne pourra plus être agrandi par
des élargissements soudains, tandis que la productivité du travail ne
cessera de progresser, le conflit périodique entre les forces produc-
tives et les limites des échanges commencera tôt ou tard, et sa
répétition même le rendra toujours plus violent et impétueux ».
De même, au Congrès socialiste de Paris en 1900, elle laisse
entendre qu'en raison de l'expansion rapide du capitalisme, on ne
peut plus parler de misère croissante du prolétariat européen, mais
que cela ne permet aucunement de se rallier aux vues de Bernstein,
car dans leur entreprise d'inévitable conquête des marchés exté-
rieurs, les grandes puissances s'opposent, ce qui ne peut manquer
d'engendrer entre elles des guerres qui peuvent conduire à la dispa-
rition du capitalisme.
entendre qu'en raison de l'expansion rapide du capitalisme, on ne
peut plus parler de misère croissante du prolétariat européen, mais
que cela ne permet aucunement de se rallier aux vues de Bernstein,
car dans leur entreprise d'inévitable conquête des marchés exté-
rieurs, les grandes puissances s'opposent, ce qui ne peut manquer
d'engendrer entre elles des guerres qui peuvent conduire à la dispa-
rition du capitalisme.
Cela dit, c'est surtout dans son ouvrage de 1913. L'accumulation
du capital, que R. Luxemburg va développer et préciser ses idées.
du capital, que R. Luxemburg va développer et préciser ses idées.
Rosa Luxemburg s'intéresse donc au problème de la croissance,
au-delà des problèmes des mouvements cycliques : dans le premier
chapitre de son livre, elle écrit : « II est très important de bien
comprendre dès le début que les mouvements cycliques... ne repré-
sentent pas le seul problème de la reproduction, encore qu'il soit
essentiel4. » L'existence de cycles, dit-elle, fait que la production
est tantôt supérieure, tantôt inférieure à la demande effective.
Cependant, sur une longue période, on peut dégager un volume
moyen de reproduction, et ceci n'est pas purement théorique,
dit-elle, car, au-delà des mouvements cycliques, la capadité produc-
tive se développe progressivement : « Comment cela peut-il se produire ?
dit-elle... C'est ici que commence le véritable problème. 5 » Pourquoi
l'économie capitaliste croît-elle? Peut-elle croître de façon illimitée?
D'où vient l'incitation à investir! D'où vient la demande qui permet
à l'accumulation de se poursuivre? Telles sont les questions aux-
quelles il faut répondre. Il ne s'agit plus tant du problème de
l'équilibre entre épargne et investissement, que Marx avait déjà
traité, mais du problème de l'incitation à investir : quelle sont les
raisons qui poussent les capitalistes à investir, et comment savent-ils
au-delà des problèmes des mouvements cycliques : dans le premier
chapitre de son livre, elle écrit : « II est très important de bien
comprendre dès le début que les mouvements cycliques... ne repré-
sentent pas le seul problème de la reproduction, encore qu'il soit
essentiel4. » L'existence de cycles, dit-elle, fait que la production
est tantôt supérieure, tantôt inférieure à la demande effective.
Cependant, sur une longue période, on peut dégager un volume
moyen de reproduction, et ceci n'est pas purement théorique,
dit-elle, car, au-delà des mouvements cycliques, la capadité produc-
tive se développe progressivement : « Comment cela peut-il se produire ?
dit-elle... C'est ici que commence le véritable problème. 5 » Pourquoi
l'économie capitaliste croît-elle? Peut-elle croître de façon illimitée?
D'où vient l'incitation à investir! D'où vient la demande qui permet
à l'accumulation de se poursuivre? Telles sont les questions aux-
quelles il faut répondre. Il ne s'agit plus tant du problème de
l'équilibre entre épargne et investissement, que Marx avait déjà
traité, mais du problème de l'incitation à investir : quelle sont les
raisons qui poussent les capitalistes à investir, et comment savent-ils
4. R. LUXEMBURG, op. cit., p. 35.
5. R. LUXEMBURG, op. cit., p. 36.
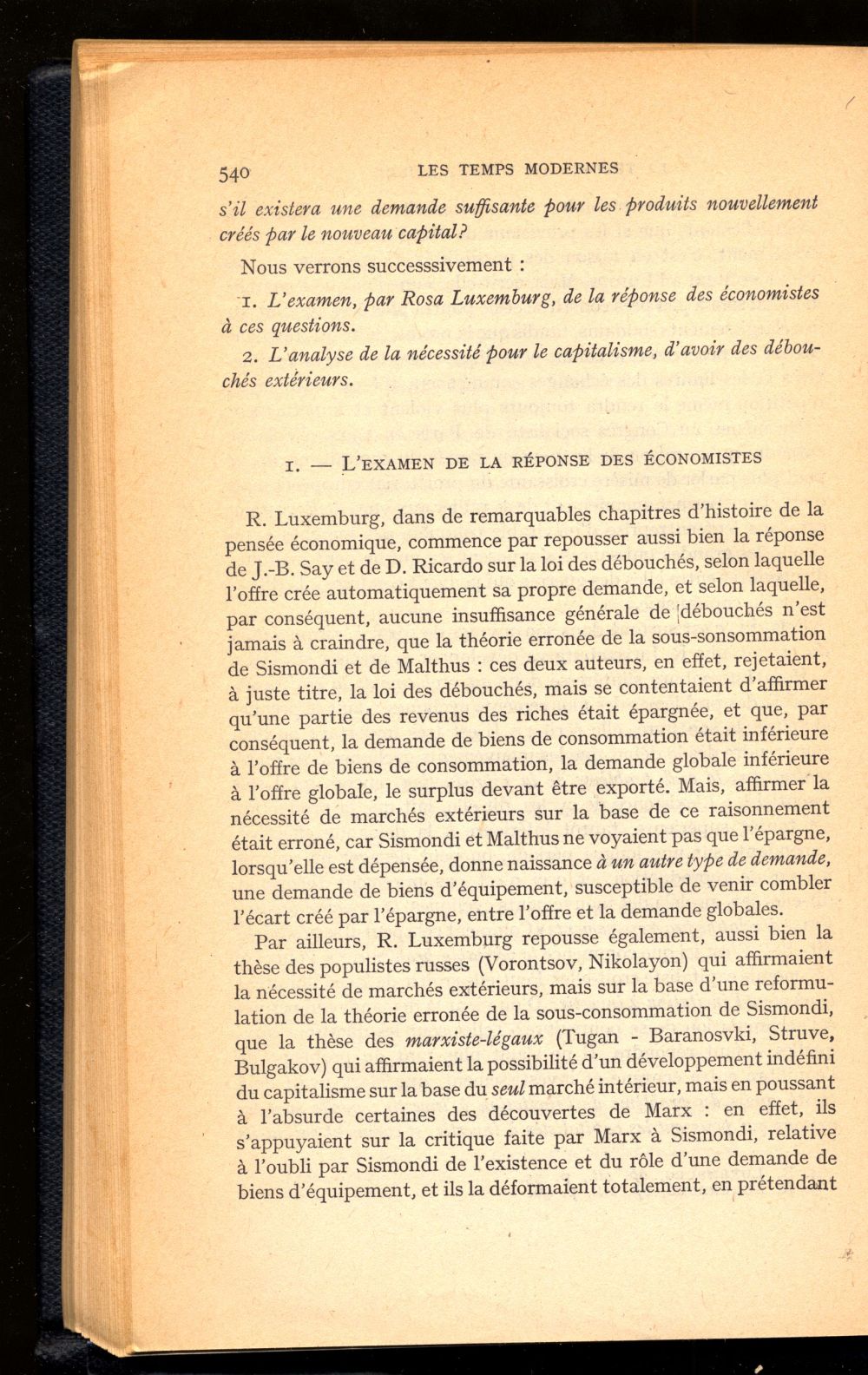

540
LES TEMPS MODERNES
s'il existera une demande suffisante pour les produits nouvellement
créés par le nouveau capital?
créés par le nouveau capital?
Nous verrons successsivement :
1. L'examen, par Rosa Luxemburg, de la réponse des économistes
à ces questions.
à ces questions.
2. L'analyse de la nécessité pour le capitalisme, d'avoir des débou-
chés extérieurs.
chés extérieurs.
i.
L'EXAMEN DE LA RÉPONSE DES ÉCONOMISTES
R. Luxemburg, dans de remarquables chapitres d'histoire de la
pensée économique, commence par repousser aussi bien la réponse
de J.-B. Say et de D. Ricardo sur la loi des débouchés, selon laquelle
l'offre crée automatiquement sa propre demande, et selon laquelle,
par conséquent, aucune insuffisance générale de ;débouchés n'est
jamais à craindre, que la théorie erronée de la sous-sonsommation
de Sismondi et de Malthus : ces deux auteurs, en effet, rejetaient,
à juste titre, la loi des débouchés, mais se contentaient d'affirmer
qu'une partie des revenus des riches était épargnée, et que, par
conséquent, la demande de biens de consommation était inférieure
à l'offre de biens de consommation, la demande globale inférieure
à l'offre globale, le surplus devant être exporté. Mais, affirmer la
nécessité de marchés extérieurs sur la base de ce raisonnement
était erroné, car Sismondi et Malthus ne voyaient pas que l'épargne,
lorsqu'elle est dépensée, donne naissance à un autre type de demande,
une demande de biens d'équipement, susceptible de venir combler
l'écart créé par l'épargne, entre l'offre et la demande globales.
pensée économique, commence par repousser aussi bien la réponse
de J.-B. Say et de D. Ricardo sur la loi des débouchés, selon laquelle
l'offre crée automatiquement sa propre demande, et selon laquelle,
par conséquent, aucune insuffisance générale de ;débouchés n'est
jamais à craindre, que la théorie erronée de la sous-sonsommation
de Sismondi et de Malthus : ces deux auteurs, en effet, rejetaient,
à juste titre, la loi des débouchés, mais se contentaient d'affirmer
qu'une partie des revenus des riches était épargnée, et que, par
conséquent, la demande de biens de consommation était inférieure
à l'offre de biens de consommation, la demande globale inférieure
à l'offre globale, le surplus devant être exporté. Mais, affirmer la
nécessité de marchés extérieurs sur la base de ce raisonnement
était erroné, car Sismondi et Malthus ne voyaient pas que l'épargne,
lorsqu'elle est dépensée, donne naissance à un autre type de demande,
une demande de biens d'équipement, susceptible de venir combler
l'écart créé par l'épargne, entre l'offre et la demande globales.
Par ailleurs, R. Luxemburg repousse également, aussi bien la
thèse des populistes russes (Vorontsov, Nikolayon) qui affirmaient
la nécessité de marchés extérieurs, mais sur la base d'une reformu-
lation de la théorie erronée de la sous-consommation de Sismondi,
que la thèse des marxiste-légaux (Tugan - Baranosvki, Struve,
Bulgakov) qui affirmaient la possibilité d'un développement indéfini
du capitalisme sur la base du seul marché intérieur, mais en poussant
à l'absurde certaines des découvertes de Marx : en effet, ils
s'appuyaient sur la critique faite par Marx à Sismondi, relative
à l'oubli par Sismondi de l'existence et du rôle d'une demande de
biens d'équipement, et ils la déformaient totalement, en prétendant
thèse des populistes russes (Vorontsov, Nikolayon) qui affirmaient
la nécessité de marchés extérieurs, mais sur la base d'une reformu-
lation de la théorie erronée de la sous-consommation de Sismondi,
que la thèse des marxiste-légaux (Tugan - Baranosvki, Struve,
Bulgakov) qui affirmaient la possibilité d'un développement indéfini
du capitalisme sur la base du seul marché intérieur, mais en poussant
à l'absurde certaines des découvertes de Marx : en effet, ils
s'appuyaient sur la critique faite par Marx à Sismondi, relative
à l'oubli par Sismondi de l'existence et du rôle d'une demande de
biens d'équipement, et ils la déformaient totalement, en prétendant
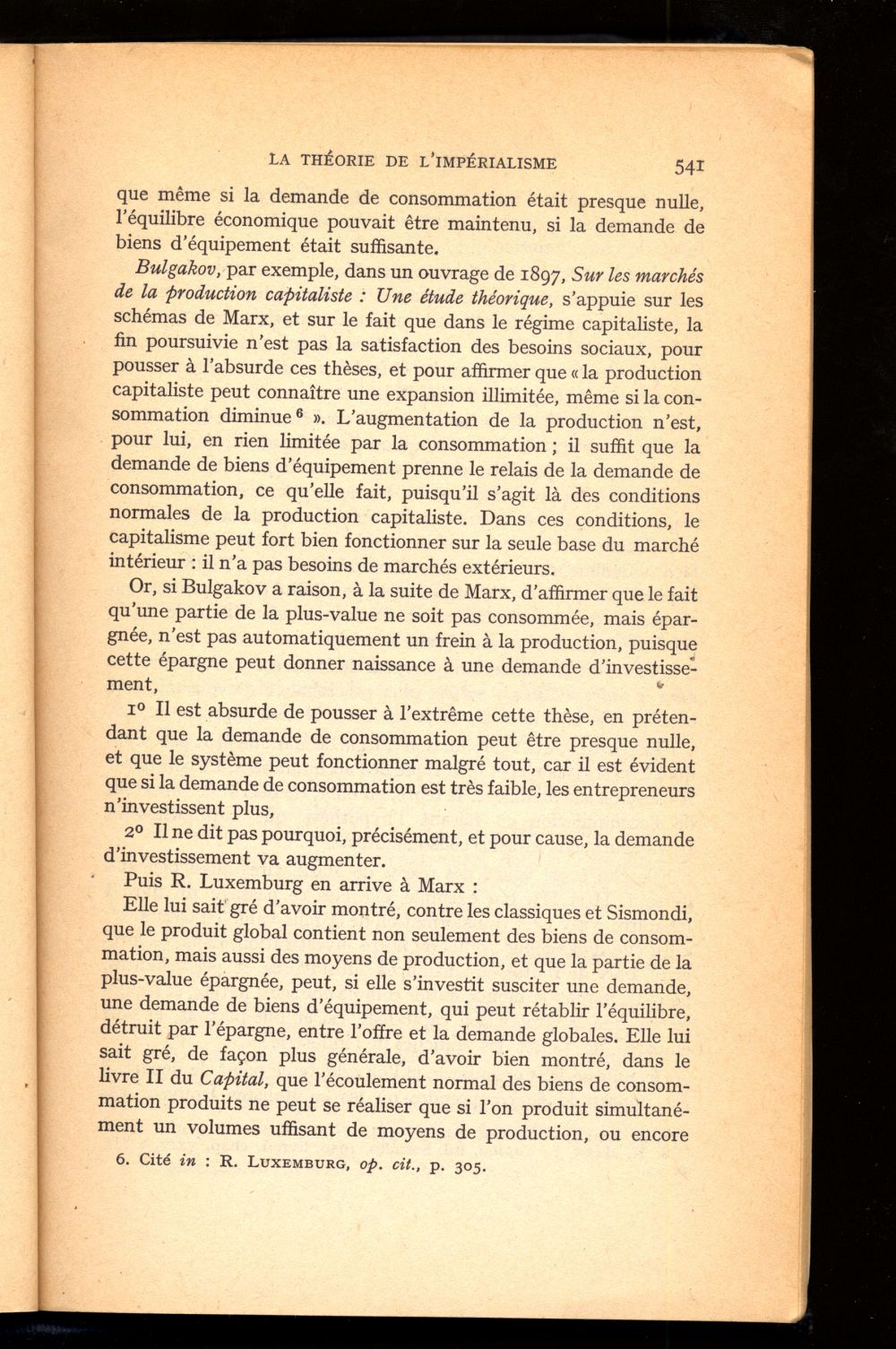

LA THÉORIE DE L'iMPÉRIALISME
541
que même si la demande de consommation était presque nulle,
l'équilibre économique pouvait être maintenu, si la demande de
biens d'équipement était suffisante.
l'équilibre économique pouvait être maintenu, si la demande de
biens d'équipement était suffisante.
Bulgakov, par exemple, dans un ouvrage de 1897, Sur les marchés
de la production capitaliste : Une étude théorique, s'appuie sur les
schémas de Marx, et sur le fait que dans le régime capitaliste, la
fin poursuivie n'est pas la satisfaction des besoins sociaux, pour
pousser à l'absurde ces thèses, et pour affirmer que « la production
capitaliste peut connaître une expansion illimitée, même si la con-
sommation diminue 6 ». L'augmentation de la production n'est,
pour lui, en rien limitée par la consommation ; il suffit que la
demande de biens d'équipement prenne le relais de la demande de
consommation, ce qu'elle fait, puisqu'il s'agit là des conditions
normales de la production capitaliste. Dans ces conditions, le
capitalisme peut fort bien fonctionner sur la seule base du marché
intérieur : il n'a pas besoins de marchés extérieurs.
de la production capitaliste : Une étude théorique, s'appuie sur les
schémas de Marx, et sur le fait que dans le régime capitaliste, la
fin poursuivie n'est pas la satisfaction des besoins sociaux, pour
pousser à l'absurde ces thèses, et pour affirmer que « la production
capitaliste peut connaître une expansion illimitée, même si la con-
sommation diminue 6 ». L'augmentation de la production n'est,
pour lui, en rien limitée par la consommation ; il suffit que la
demande de biens d'équipement prenne le relais de la demande de
consommation, ce qu'elle fait, puisqu'il s'agit là des conditions
normales de la production capitaliste. Dans ces conditions, le
capitalisme peut fort bien fonctionner sur la seule base du marché
intérieur : il n'a pas besoins de marchés extérieurs.
Or, si Bulgakov a raison, à la suite de Marx, d'affirmer que le fait
qu'une partie de la plus-value ne soit pas consommée, mais épar-
gnée, n'est pas automatiquement un frein à la production, puisque
cette épargne peut donner naissance à une demande d'investisse-
ment,
qu'une partie de la plus-value ne soit pas consommée, mais épar-
gnée, n'est pas automatiquement un frein à la production, puisque
cette épargne peut donner naissance à une demande d'investisse-
ment,
i° II est absurde de pousser à l'extrême cette thèse, en préten-
dant que la demande de consommation peut être presque nulle,
et que le système peut fonctionner malgré tout, car il est évident
que si la demande de consommation est très faible, les entrepreneurs
n'investissent plus,
dant que la demande de consommation peut être presque nulle,
et que le système peut fonctionner malgré tout, car il est évident
que si la demande de consommation est très faible, les entrepreneurs
n'investissent plus,
2° II ne dit pas pourquoi, précisément, et pour cause, la demande
d'investissement va augmenter.
d'investissement va augmenter.
Puis R. Luxemburg en arrive à Marx :
Elle lui sait gré d'avoir montré, contre les classiques et Sismondi,
que le produit global contient non seulement des biens de consom-
mation, mais aussi des moyens de production, et que la partie de la
plus-value épargnée, peut, si elle s'investit susciter une demande,
une demande de biens d'équipement, qui peut rétablir l'équilibre,
détruit par l'épargne, entre l'offre et la demande globales. Elle lui
sait gré, de façon plus générale, d'avoir bien montré, dans le
livre II du Capital, que l'écoulement normal des biens de consom-
mation produits ne peut se réaliser que si l'on produit simultané-
ment un volumes uffisant de moyens de production, ou encore
que le produit global contient non seulement des biens de consom-
mation, mais aussi des moyens de production, et que la partie de la
plus-value épargnée, peut, si elle s'investit susciter une demande,
une demande de biens d'équipement, qui peut rétablir l'équilibre,
détruit par l'épargne, entre l'offre et la demande globales. Elle lui
sait gré, de façon plus générale, d'avoir bien montré, dans le
livre II du Capital, que l'écoulement normal des biens de consom-
mation produits ne peut se réaliser que si l'on produit simultané-
ment un volumes uffisant de moyens de production, ou encore
6. Cité in : R. LUXEMBURG, op. cit., p. 305.
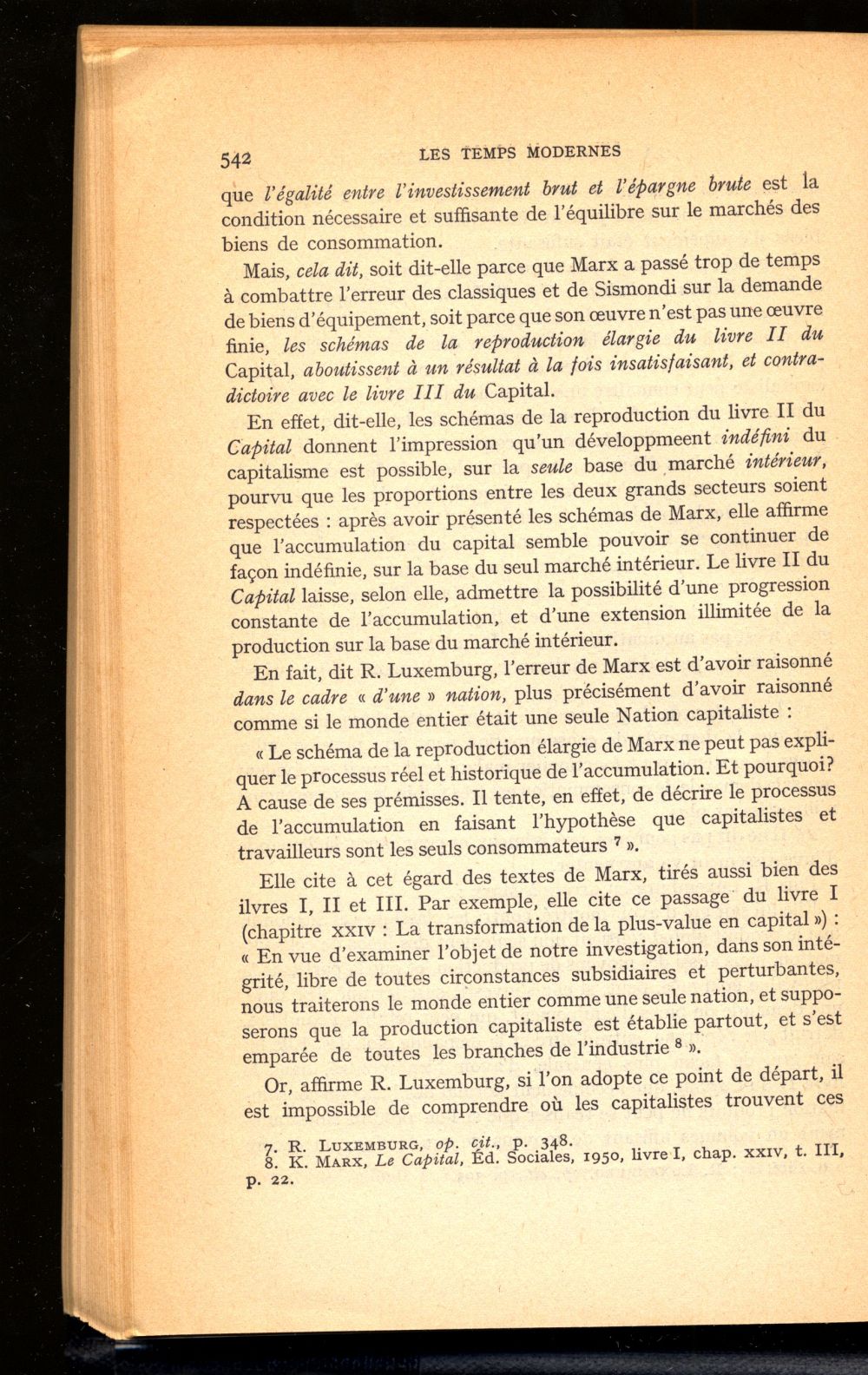

542 LES TEMPS MODERNES
que l'égalité entre l'investissement brut et l'épargne brute est la
condition nécessaire et suffisante de l'équilibre sur le marchés des
biens de consommation.
condition nécessaire et suffisante de l'équilibre sur le marchés des
biens de consommation.
Mais, cela dit, soit dit-elle parce que Marx a passé trop de temps
à combattre l'erreur des classiques et de Sismondi sur la demande
de biens d'équipement, soit parce que son oeuvre n'est pas une œuvre
finie, les schémas de la reproduction élargie du livre II du
Capital, aboutissent à un résultat à la fois insatisfaisant, et contra-
dictoire avec le livre III du Capital.
à combattre l'erreur des classiques et de Sismondi sur la demande
de biens d'équipement, soit parce que son oeuvre n'est pas une œuvre
finie, les schémas de la reproduction élargie du livre II du
Capital, aboutissent à un résultat à la fois insatisfaisant, et contra-
dictoire avec le livre III du Capital.
En effet, dit-elle, les schémas de la reproduction du livre II du
Capital donnent l'impression qu'un développmeent indéfini du
capitalisme est possible, sur la seule base du marché intérieur,
pourvu que les proportions entre les deux grands secteurs soient
respectées : après avoir présenté les schémas de Marx, elle affirme
que l'accumulation du capital semble pouvoir se continuer de
façon indéfinie, sur la base du seul marché intérieur. Le livre II du
Capital laisse, selon elle, admettre la possibilité d'une progression
constante de l'accumulation, et d'une extension illimitée de la
production sur la base du marché intérieur.
Capital donnent l'impression qu'un développmeent indéfini du
capitalisme est possible, sur la seule base du marché intérieur,
pourvu que les proportions entre les deux grands secteurs soient
respectées : après avoir présenté les schémas de Marx, elle affirme
que l'accumulation du capital semble pouvoir se continuer de
façon indéfinie, sur la base du seul marché intérieur. Le livre II du
Capital laisse, selon elle, admettre la possibilité d'une progression
constante de l'accumulation, et d'une extension illimitée de la
production sur la base du marché intérieur.
En fait, dit R. Luxemburg, l'erreur de Marx est d'avoir raisonné
dans le cadre « d'une » nation, plus précisément d'avoir raisonné
comme si le monde entier était une seule Nation capitaliste :
dans le cadre « d'une » nation, plus précisément d'avoir raisonné
comme si le monde entier était une seule Nation capitaliste :
« Le schéma de la reproduction élargie de Marx ne peut pas expli-
quer le processus réel et historique de l'accumulation. Et pourquoi?
A cause de ses prémisses. Il tente, en effet, de décrire le processus
de l'accumulation en faisant l'hypothèse que capitalistes et
travailleurs sont les seuls consommateurs 7 ».
quer le processus réel et historique de l'accumulation. Et pourquoi?
A cause de ses prémisses. Il tente, en effet, de décrire le processus
de l'accumulation en faisant l'hypothèse que capitalistes et
travailleurs sont les seuls consommateurs 7 ».
Elle cite à cet égard des textes de Marx, tirés aussi bien des
livres I, II et III. Par exemple, elle cite ce passage du livre I
(chapitre xxiv : La transformation de la plus-value en capital ») :
« En vue d'examiner l'objet de notre investigation, dans son inté-
grité, libre de toutes circonstances subsidiaires et perturbantes,
nous traiterons le monde entier comme une seule nation, et suppo-
serons que la production capitaliste est établie partout, et s'est
emparée de toutes les branches de l'industrie 8 ».
livres I, II et III. Par exemple, elle cite ce passage du livre I
(chapitre xxiv : La transformation de la plus-value en capital ») :
« En vue d'examiner l'objet de notre investigation, dans son inté-
grité, libre de toutes circonstances subsidiaires et perturbantes,
nous traiterons le monde entier comme une seule nation, et suppo-
serons que la production capitaliste est établie partout, et s'est
emparée de toutes les branches de l'industrie 8 ».
Or, affirme R. Luxemburg, si l'on adopte ce point de départ, il
est impossible de comprendre où les capitalistes trouvent ces
est impossible de comprendre où les capitalistes trouvent ces
7. R. LUXEMBURG, op. cit., p. 348.
8. K. MARX, Le Capital, Éd. Sociales, 1950, livre I, chap. xxiv, t. III,
p. 22.
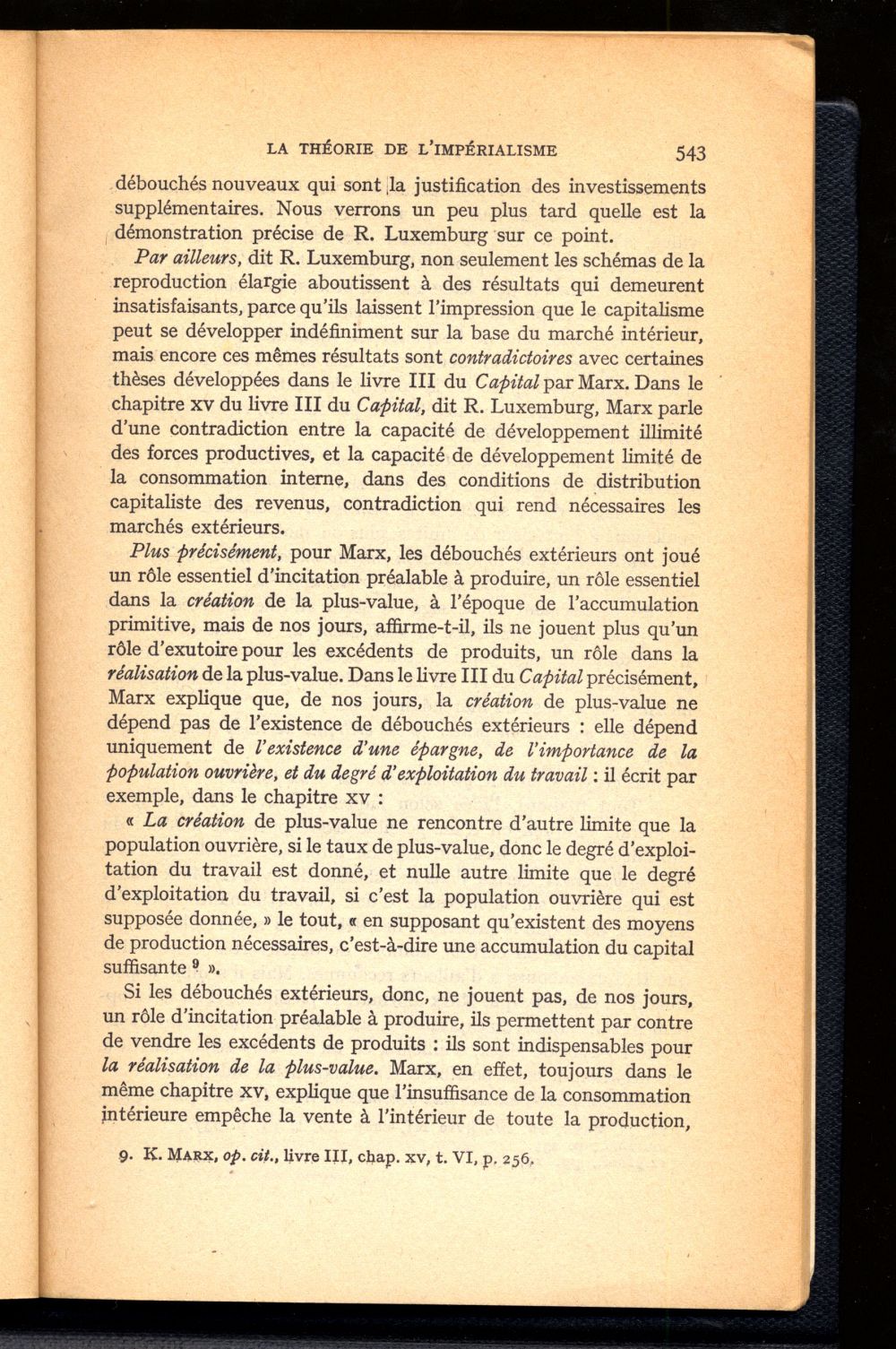

LA THÉORIE DE L'IMPÉRIALISME
543
débouchés nouveaux qui sont ,la justification des investissements
supplémentaires. Nous verrons un peu plus tard quelle est la
démonstration précise de R. Luxemburg sur ce point.
supplémentaires. Nous verrons un peu plus tard quelle est la
démonstration précise de R. Luxemburg sur ce point.
Par ailleurs, dit R. Luxemburg, non seulement les schémas de la
reproduction élargie aboutissent à des résultats qui demeurent
insatisfaisants, parce qu'ils laissent l'impression que le capitalisme
peut se développer indéfiniment sur la base du marché intérieur,
mais encore ces mêmes résultats sont contradictoires avec certaines
thèses développées dans le livre III du Capital par Marx. Dans le
chapitre xv du livre III du Capital, dit R. Luxemburg, Marx parle
d'une contradiction entre la capacité de développement illimité
des forces productives, et la capacité de développement limité de
la consommation interne, dans des conditions de distribution
capitaliste des revenus, contradiction qui rend nécessaires les
marchés extérieurs.
reproduction élargie aboutissent à des résultats qui demeurent
insatisfaisants, parce qu'ils laissent l'impression que le capitalisme
peut se développer indéfiniment sur la base du marché intérieur,
mais encore ces mêmes résultats sont contradictoires avec certaines
thèses développées dans le livre III du Capital par Marx. Dans le
chapitre xv du livre III du Capital, dit R. Luxemburg, Marx parle
d'une contradiction entre la capacité de développement illimité
des forces productives, et la capacité de développement limité de
la consommation interne, dans des conditions de distribution
capitaliste des revenus, contradiction qui rend nécessaires les
marchés extérieurs.
Plus précisément, pour Marx, les débouchés extérieurs ont joué
un rôle essentiel d'incitation préalable à produire, un rôle essentiel
dans la création de la plus-value, à l'époque de l'accumulation
primitive, mais de nos jours, affirme-t-il, ils ne jouent plus qu'un
rôle d'exutoire pour les excédents de produits, un rôle dans la
réalisation de la plus-value. Dans le livre III du Capital précisément,
Marx explique que, de nos jours, la création de plus-value ne
dépend pas de l'existence de débouchés extérieurs : elle dépend
uniquement de l'existence d'une épargne, de l'importance de la
population ouvrière, et du degré d'exploitation du travail : il écrit par
exemple, dans le chapitre xv :
un rôle essentiel d'incitation préalable à produire, un rôle essentiel
dans la création de la plus-value, à l'époque de l'accumulation
primitive, mais de nos jours, affirme-t-il, ils ne jouent plus qu'un
rôle d'exutoire pour les excédents de produits, un rôle dans la
réalisation de la plus-value. Dans le livre III du Capital précisément,
Marx explique que, de nos jours, la création de plus-value ne
dépend pas de l'existence de débouchés extérieurs : elle dépend
uniquement de l'existence d'une épargne, de l'importance de la
population ouvrière, et du degré d'exploitation du travail : il écrit par
exemple, dans le chapitre xv :
<c La création de plus-value ne rencontre d'autre limite que la
population ouvrière, si le taux de plus-value, donc le degré d'exploi-
tation du travail est donné, et nulle autre limite que le degré
d'exploitation du travail, si c'est la population ouvrière qui est
supposée donnée, » le tout, « en supposant qu'existent des moyens
de production nécessaires, c'est-à-dire une accumulation du capital
suffisante 9 ».
population ouvrière, si le taux de plus-value, donc le degré d'exploi-
tation du travail est donné, et nulle autre limite que le degré
d'exploitation du travail, si c'est la population ouvrière qui est
supposée donnée, » le tout, « en supposant qu'existent des moyens
de production nécessaires, c'est-à-dire une accumulation du capital
suffisante 9 ».
Si les débouchés extérieurs, donc, ne jouent pas, de nos jours,
un rôle d'incitation préalable à produire, ils permettent par contre
de vendre les excédents de produits : ils sont indispensables pour
la réalisation de la plus-value. Marx, en effet, toujours dans le
même chapitre xv, explique que l'insuffisance de la consommation
intérieure empêche la vente à l'intérieur de toute la production,
un rôle d'incitation préalable à produire, ils permettent par contre
de vendre les excédents de produits : ils sont indispensables pour
la réalisation de la plus-value. Marx, en effet, toujours dans le
même chapitre xv, explique que l'insuffisance de la consommation
intérieure empêche la vente à l'intérieur de toute la production,
9. K. MARX, op. cit., livre III, chap. xv, t. VI, p. 256,
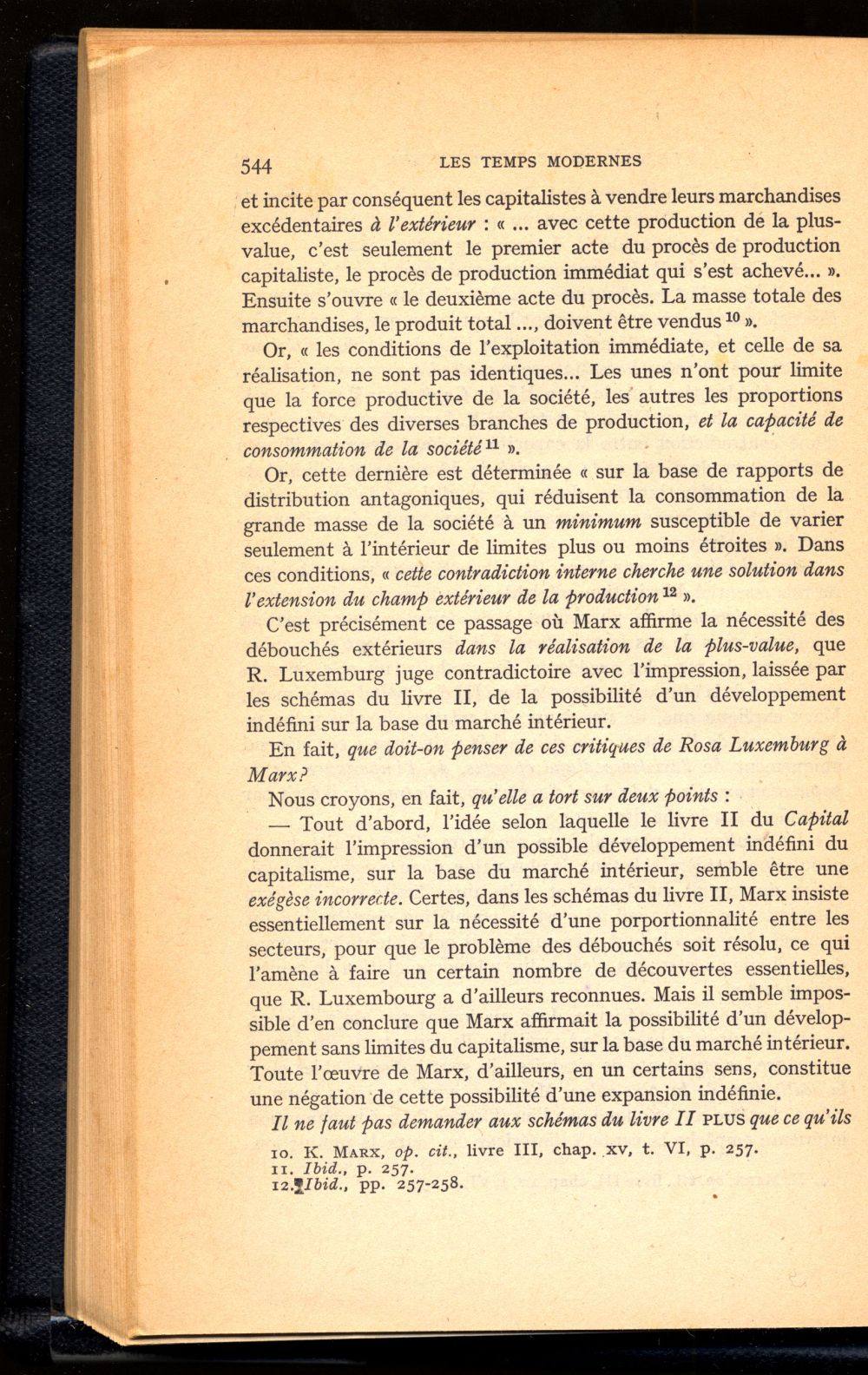

544
LES TEMPS MODERNES
et incite par conséquent les capitalistes à vendre leurs marchandises
excédentaires à l'extérieur : « ... avec cette production de la plus-
value, c'est seulement le premier acte du procès de production
capitaliste, le procès de production immédiat qui s'est achevé... ».
Ensuite s'ouvre « le deuxième acte du procès. La masse totale des
marchandises, le produit total..., doivent être vendus10 ».
excédentaires à l'extérieur : « ... avec cette production de la plus-
value, c'est seulement le premier acte du procès de production
capitaliste, le procès de production immédiat qui s'est achevé... ».
Ensuite s'ouvre « le deuxième acte du procès. La masse totale des
marchandises, le produit total..., doivent être vendus10 ».
Or, « les conditions de l'exploitation immédiate, et celle de sa
réalisation, ne sont pas identiques... Les unes n'ont pour limite
que la force productive de la société, les autres les proportions
respectives des diverses branches de production, et la capacité de
consommation de la société11 ».
réalisation, ne sont pas identiques... Les unes n'ont pour limite
que la force productive de la société, les autres les proportions
respectives des diverses branches de production, et la capacité de
consommation de la société11 ».
Or, cette dernière est déterminée « sur la base de rapports de
distribution antagoniques, qui réduisent la consommation de la
grande masse de la société à un minimum susceptible de varier
seulement à l'intérieur de limites plus ou moins étroites ». Dans
ces conditions, « cette contradiction interne cherche une solution dans
l'extension du champ extérieur de la production1Z ».
distribution antagoniques, qui réduisent la consommation de la
grande masse de la société à un minimum susceptible de varier
seulement à l'intérieur de limites plus ou moins étroites ». Dans
ces conditions, « cette contradiction interne cherche une solution dans
l'extension du champ extérieur de la production1Z ».
C'est précisément ce passage où Marx affirme la nécessité des
débouchés extérieurs dans la réalisation de la plus-value, que
R. Luxemburg juge contradictoire avec l'impression, laissée par
les schémas du livre II, de la possibilité d'un développement
indéfini sur la base du marché intérieur.
débouchés extérieurs dans la réalisation de la plus-value, que
R. Luxemburg juge contradictoire avec l'impression, laissée par
les schémas du livre II, de la possibilité d'un développement
indéfini sur la base du marché intérieur.
En fait, que doit-on penser de ces critiques de Rosa Luxemburg à
Marx?
Marx?
Nous croyons, en fait, qu'elle a tort sur deux points :
— Tout d'abord, l'idée selon laquelle le livre II du Capital
donnerait l'impression d'un possible développement indéfini du
capitalisme, sur la base du marché intérieur, semble être une
exégèse incorrecte. Certes, dans les schémas du livre II, Marx insiste
essentiellement sur la nécessité d'une porportionnalité entre les
secteurs, pour que le problème des débouchés soit résolu, ce qui
l'amène à faire un certain nombre de découvertes essentielles,
qvie R. Luxembourg a d'ailleurs reconnues. Mais il semble impos-
sible d'en conclure que Marx affirmait la possibilité d'un dévelop-
pement sans limites du capitalisme, sur la base du marché intérieur.
Toute l'œuvre de Marx, d'ailleurs, en un certains sens, constitue
une négation de cette possibilité d'une expansion indéfinie.
donnerait l'impression d'un possible développement indéfini du
capitalisme, sur la base du marché intérieur, semble être une
exégèse incorrecte. Certes, dans les schémas du livre II, Marx insiste
essentiellement sur la nécessité d'une porportionnalité entre les
secteurs, pour que le problème des débouchés soit résolu, ce qui
l'amène à faire un certain nombre de découvertes essentielles,
qvie R. Luxembourg a d'ailleurs reconnues. Mais il semble impos-
sible d'en conclure que Marx affirmait la possibilité d'un dévelop-
pement sans limites du capitalisme, sur la base du marché intérieur.
Toute l'œuvre de Marx, d'ailleurs, en un certains sens, constitue
une négation de cette possibilité d'une expansion indéfinie.
// ne faut pas demander aux schémas du livre II PLUS que ce qu'ils
10. K. MARX, op. cit., livre III, chap. .xv, t. VI, p. 257.
11. Jbid., p. 257.
ï2%Ibid., pp. 257-258.
ï2%Ibid., pp. 257-258.
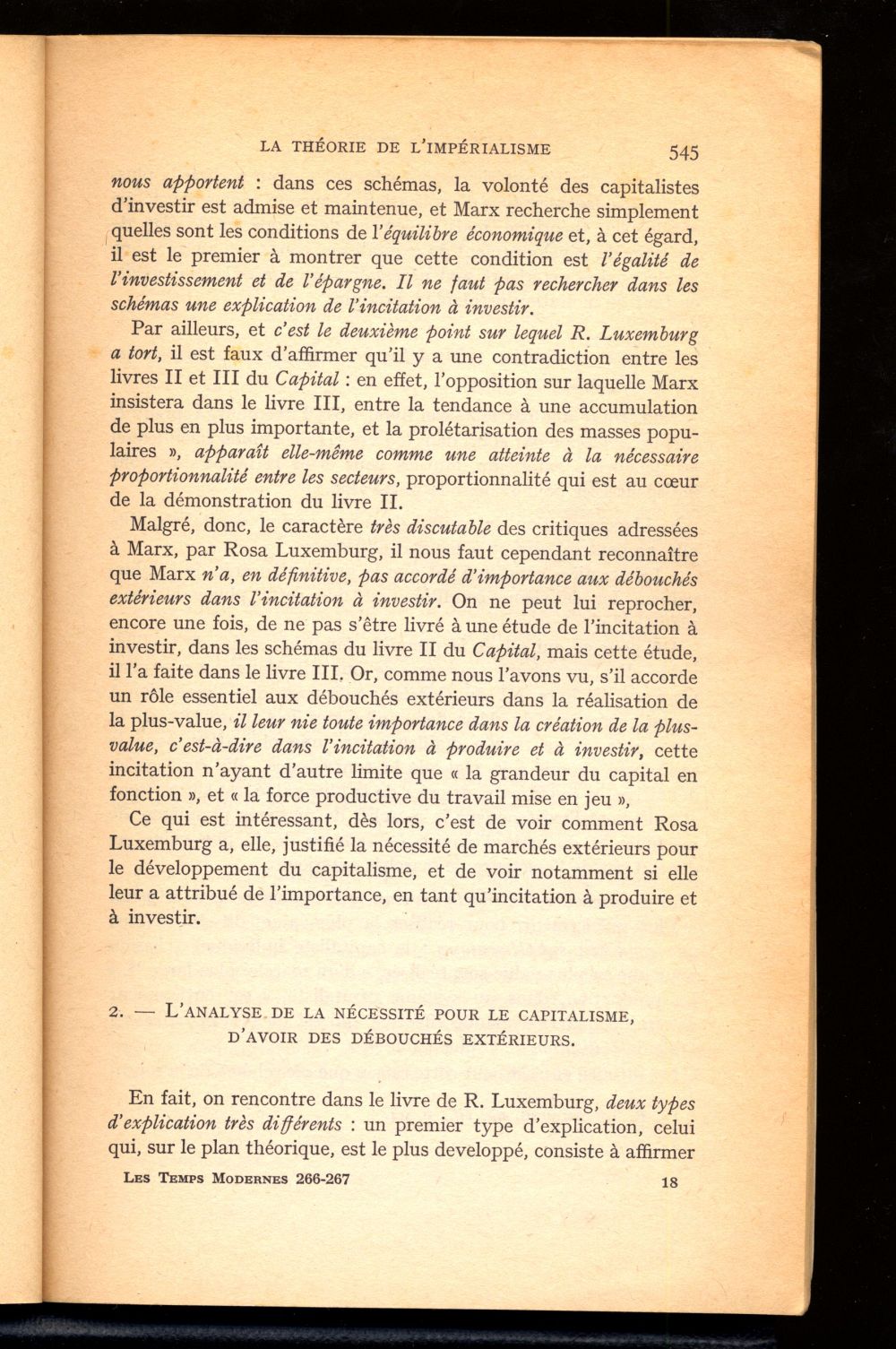

LA THEORIE DE L IMPERIALISME
545
nous apportent : dans ces schémas, la volonté des capitalistes
d'investir est admise et maintenue, et Marx recherche simplement
quelles sont les conditions de l'équilibre économique et, à cet égard,
il est le premier à montrer que cette condition est l'égalité de
l'investissement et de l'épargne. Il ne faut pas rechercher dans les
schémas une explication de l'incitation à investir.
d'investir est admise et maintenue, et Marx recherche simplement
quelles sont les conditions de l'équilibre économique et, à cet égard,
il est le premier à montrer que cette condition est l'égalité de
l'investissement et de l'épargne. Il ne faut pas rechercher dans les
schémas une explication de l'incitation à investir.
Par ailleurs, et c'est le deuxième point sur lequel R. Luxemburg
a tort, il est faux d'affirmer qu'il y a une contradiction entre les
livres II et III du Capital : en effet, l'opposition sur laquelle Marx
insistera dans le livre III, entre la tendance à une accumulation
de plus en plus importante, et la prolétarisation des masses popu-
laires », apparaît elle-même comme une atteinte à la nécessaire
proportionnalité entre les secteurs, proportionnalité qui est au cœur
de la démonstration du livre II.
a tort, il est faux d'affirmer qu'il y a une contradiction entre les
livres II et III du Capital : en effet, l'opposition sur laquelle Marx
insistera dans le livre III, entre la tendance à une accumulation
de plus en plus importante, et la prolétarisation des masses popu-
laires », apparaît elle-même comme une atteinte à la nécessaire
proportionnalité entre les secteurs, proportionnalité qui est au cœur
de la démonstration du livre II.
Malgré, donc, le caractère très discutable des critiques adressées
à Marx, par Rosa Luxemburg, il nous faut cependant reconnaître
que Marx n'a, en définitive, pas accordé d'importance aux débouchés
extérieurs dans l'incitation à investir. On ne peut lui reprocher,
encore une fois, de ne pas s'être livré à une étude de l'incitation à
investir, dans les schémas du livre II du Capital, mais cette étude,
il l'a faite dans le livre III. Or, comme nous l'avons vu, s'il accorde
un rôle essentiel aux débouchés extérieurs dans la réalisation de
la plus-value, il leur nie toute importance dans la création de la plus-
value, c'est-à-dire dans l'incitation à produire et à investir, cette
incitation n'ayant d'autre limite que « la grandeur du capital en
fonction », et « la force productive du travail mise en jeu »,
à Marx, par Rosa Luxemburg, il nous faut cependant reconnaître
que Marx n'a, en définitive, pas accordé d'importance aux débouchés
extérieurs dans l'incitation à investir. On ne peut lui reprocher,
encore une fois, de ne pas s'être livré à une étude de l'incitation à
investir, dans les schémas du livre II du Capital, mais cette étude,
il l'a faite dans le livre III. Or, comme nous l'avons vu, s'il accorde
un rôle essentiel aux débouchés extérieurs dans la réalisation de
la plus-value, il leur nie toute importance dans la création de la plus-
value, c'est-à-dire dans l'incitation à produire et à investir, cette
incitation n'ayant d'autre limite que « la grandeur du capital en
fonction », et « la force productive du travail mise en jeu »,
Ce qui est intéressant, dès lors, c'est de voir comment Rosa
Luxemburg a, elle, justifié la nécessité de marchés extérieurs pour
le développement du capitalisme, et de voir notamment si elle
leur a attribué de l'importance, en tant qu'incitation à produire et
à investir.
Luxemburg a, elle, justifié la nécessité de marchés extérieurs pour
le développement du capitalisme, et de voir notamment si elle
leur a attribué de l'importance, en tant qu'incitation à produire et
à investir.
2. — L'ANALYSE DE LA NÉCESSITÉ POUR LE CAPITALISME,
D'AVOIR DES DÉBOUCHÉS EXTÉRIEURS.
D'AVOIR DES DÉBOUCHÉS EXTÉRIEURS.
En fait, on rencontre dans le livre de R. Luxemburg, deux types
d'explication très différents : un premier type d'explication, celui
qui, sur le plan théorique, est le plus développé, consiste à affirmer
d'explication très différents : un premier type d'explication, celui
qui, sur le plan théorique, est le plus développé, consiste à affirmer
LES TEMPS MODERNES 266-267 18
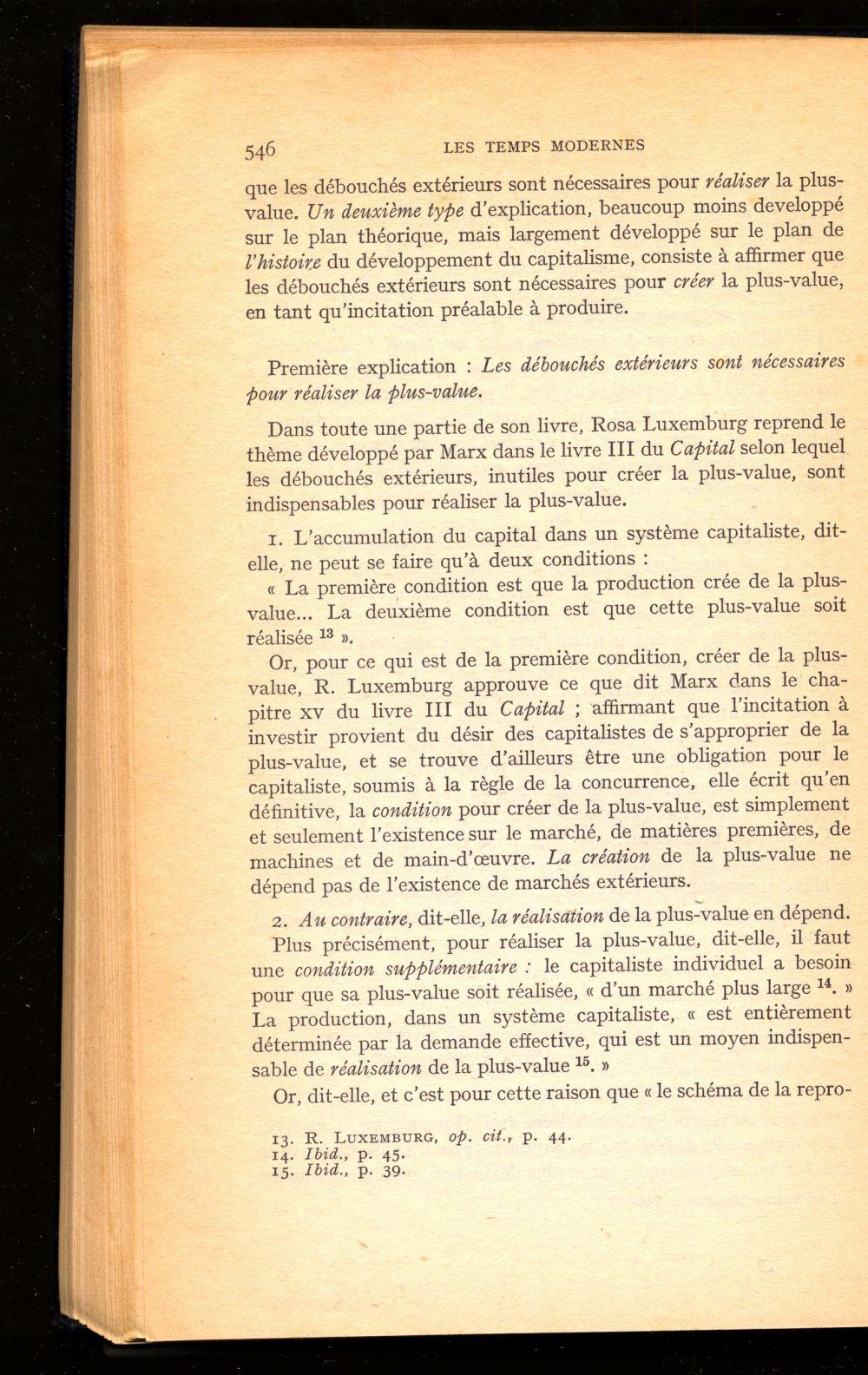

546
LES TEMPS MODERNES
que les débouchés extérieurs sont nécessaires pour réaliser la plus-
value. Un deuxième type d'explication, beaucoup moins développé
sur le plan théorique, mais largement développé sur le plan de
l'histoire du développement du capitalisme, consiste à affirmer que
les débouchés extérieurs sont nécessaires pour créer la plus-value,
en tant qu'incitation préalable à produire.
value. Un deuxième type d'explication, beaucoup moins développé
sur le plan théorique, mais largement développé sur le plan de
l'histoire du développement du capitalisme, consiste à affirmer que
les débouchés extérieurs sont nécessaires pour créer la plus-value,
en tant qu'incitation préalable à produire.
Première explication : Les débouchés extérieurs sont nécessaires
pour réaliser la plus-value.
pour réaliser la plus-value.
Dans toute une partie de son livre, Rosa Luxemburg reprend le
thème développé par Marx dans le livre III du Capital selon lequel
les débouchés extérieurs, inutiles pour créer la plus-value, sont
indispensables pour réaliser la plus-value.
thème développé par Marx dans le livre III du Capital selon lequel
les débouchés extérieurs, inutiles pour créer la plus-value, sont
indispensables pour réaliser la plus-value.
1. L'accumulation du capital dans un système capitaliste, dit-
elle, ne peut se faire qu'à deux conditions :
elle, ne peut se faire qu'à deux conditions :
« La première condition est que la production crée de la plus-
value... La deuxième condition est que cette plus-value soit
réalisée 13 ».
value... La deuxième condition est que cette plus-value soit
réalisée 13 ».
Or, pour ce qui est de la première condition, créer de la plus-
value, R. Luxemburg approuve ce que dit Marx dans le cha-
pitre xv du livre III du Capital ; affirmant que l'incitation à
investir provient du désir des capitalistes de s'approprier de la
plus-value, et se trouve d'ailleurs être une obligation pour le
capitaliste, soumis à la règle de la concurrence, elle écrit qu'en
définitive, la condition pour créer de la plus-value, est simplement
et seulement l'existence sur le marché, de matières premières, de
machines et de main-d'œuvre. La création de la plus-value ne
dépend pas de l'existence de marchés extérieurs.
value, R. Luxemburg approuve ce que dit Marx dans le cha-
pitre xv du livre III du Capital ; affirmant que l'incitation à
investir provient du désir des capitalistes de s'approprier de la
plus-value, et se trouve d'ailleurs être une obligation pour le
capitaliste, soumis à la règle de la concurrence, elle écrit qu'en
définitive, la condition pour créer de la plus-value, est simplement
et seulement l'existence sur le marché, de matières premières, de
machines et de main-d'œuvre. La création de la plus-value ne
dépend pas de l'existence de marchés extérieurs.
2. Au contraire, dit-elle, la réalisation de la plus-value en dépend.
Plus précisément, pour réaliser la plus-value, dit-elle, il faut
Plus précisément, pour réaliser la plus-value, dit-elle, il faut
une condition supplémentaire : le capitaliste individuel a besoin
pour que sa plus-value soit réalisée, « d'un marché plus large 14. »
La production, dans un système capitaliste, « est entièrement
déterminée par la demande effective, qui est un moyen indispen-
sable de réalisation de la plus-value 15. »
pour que sa plus-value soit réalisée, « d'un marché plus large 14. »
La production, dans un système capitaliste, « est entièrement
déterminée par la demande effective, qui est un moyen indispen-
sable de réalisation de la plus-value 15. »
Or, dit-elle, et c'est pour cette raison que « le schéma de la repro-
13. R. LUXEMBURG, op. cit., p. 44.
14. nid., p. 45.
15. Ibid., p. 39.
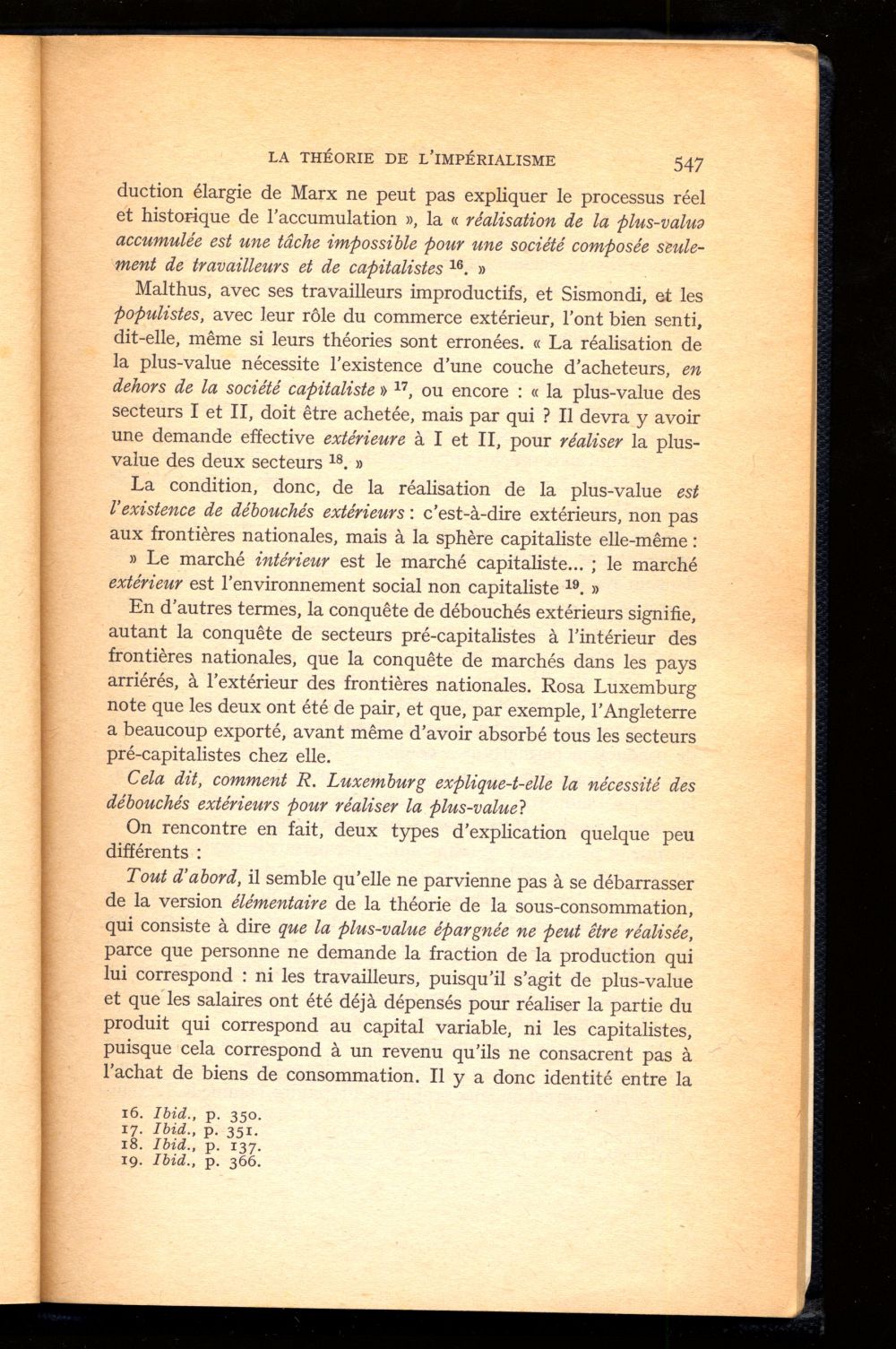

LA THEORIE DE L IMPERIALISME
547
duction élargie de Marx ne peut pas expliquer le processus réel
et historique de l'accumulation », la « réalisation de la plus-valuy
accumulée est une tâche impossible pour une société composée seule-
ment de travailleurs et de capitalistes 16. »
et historique de l'accumulation », la « réalisation de la plus-valuy
accumulée est une tâche impossible pour une société composée seule-
ment de travailleurs et de capitalistes 16. »
Malthus, avec ses travailleurs improductifs, et Sismondi, et les
populistes, avec leur rôle du commerce extérieur, l'ont bien senti,
dit-elle, même si leurs théories sont erronées. « La réalisation de
la plus-value nécessite l'existence d'une couche d'acheteurs, en
dehors de la société capitaliste » 17, ou encore : « la plus-value des
secteurs I et II, doit être achetée, mais par qui ? Il devra y avoir
une demande effective extérieure à I et II, pour réaliser la plus-
value des deux secteurs ls. »
populistes, avec leur rôle du commerce extérieur, l'ont bien senti,
dit-elle, même si leurs théories sont erronées. « La réalisation de
la plus-value nécessite l'existence d'une couche d'acheteurs, en
dehors de la société capitaliste » 17, ou encore : « la plus-value des
secteurs I et II, doit être achetée, mais par qui ? Il devra y avoir
une demande effective extérieure à I et II, pour réaliser la plus-
value des deux secteurs ls. »
La condition, donc, de la réalisation de la plus-value est
l'existence de débouchés extérieurs : c'est-à-dire extérieurs, non pas
aux frontières nationales, mais à la sphère capitaliste elle-même :
l'existence de débouchés extérieurs : c'est-à-dire extérieurs, non pas
aux frontières nationales, mais à la sphère capitaliste elle-même :
» Le marché intérieur est le marché capitaliste... ; le marché
extérieur est l'environnement social non capitaliste 19. »
extérieur est l'environnement social non capitaliste 19. »
En d'autres termes, la conquête de débouchés extérieurs signifie,
autant la conquête de secteurs pré-capitalistes à l'intérieur des
frontières nationales, que la conquête de marchés dans les pays
arriérés, à l'extérieur des frontières nationales. Rosa Luxemburg
note que les deux ont été de pair, et que, par exemple, l'Angleterre
a beaucoup exporté, avant même d'avoir absorbé tous les secteurs
pré-capitalistes chez elle.
autant la conquête de secteurs pré-capitalistes à l'intérieur des
frontières nationales, que la conquête de marchés dans les pays
arriérés, à l'extérieur des frontières nationales. Rosa Luxemburg
note que les deux ont été de pair, et que, par exemple, l'Angleterre
a beaucoup exporté, avant même d'avoir absorbé tous les secteurs
pré-capitalistes chez elle.
Cela dit, comment R. Ltixemburg explique-t-elle la nécessité des
débouchés extérieurs pour réaliser la plus-value?
débouchés extérieurs pour réaliser la plus-value?
On rencontre en fait, deux types d'explication quelque peu
différents :
différents :
Tout d'abord, il semble qu'elle ne parvienne pas à se débarrasser
de la version élémentaire de la théorie de la sous-consommation,
qui consiste à dire que la plus-value épargnée ne peut être réalisée,
parce que personne ne demande la fraction de la production qui
lui correspond : ni les travailleurs, puisqu'il s'agit de plus-value
et que les salaires ont été déjà dépensés pour réaliser la partie du
produit qui correspond au capital variable, ni les capitalistes,
puisque cela correspond à un revenu qu'ils ne consacrent pas à
l'achat de biens de consommation. Il y a donc identité entre la
de la version élémentaire de la théorie de la sous-consommation,
qui consiste à dire que la plus-value épargnée ne peut être réalisée,
parce que personne ne demande la fraction de la production qui
lui correspond : ni les travailleurs, puisqu'il s'agit de plus-value
et que les salaires ont été déjà dépensés pour réaliser la partie du
produit qui correspond au capital variable, ni les capitalistes,
puisque cela correspond à un revenu qu'ils ne consacrent pas à
l'achat de biens de consommation. Il y a donc identité entre la
16. ibîd., p. 350.
17. Ibid., p. 351.
18. Ibid., p. 137.
19. Ibid., p. 366.
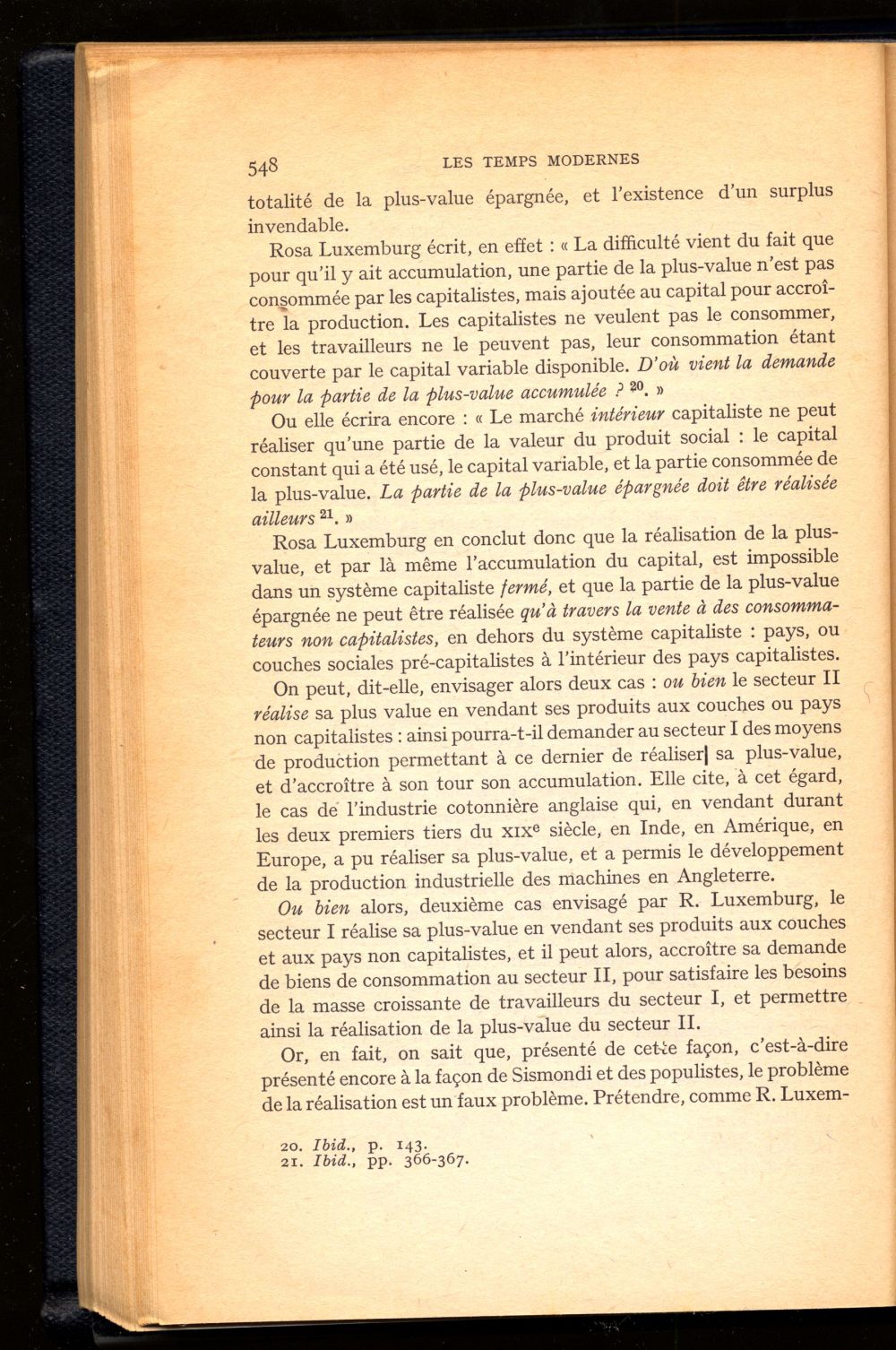

548 LES TEMPS MODERNES
totalité de la plus-value épargnée, et l'existence d'un surplus
invendable.
invendable.
Rosa Luxemburg écrit, en effet : « La difficulté vient du fait que
pour qu'il y ait accumulation, une partie de la plus-value n'est pas
consommée par les capitalistes, mais ajoutée au capital pour accroî-
tre la production. Les capitalistes ne veulent pas le consommer,
et les travailleurs ne le peuvent pas, leur consommation étant
couverte par le capital variable disponible. D'où vient la demande
pour la partie de la plus-value accumulée P 20. »
pour qu'il y ait accumulation, une partie de la plus-value n'est pas
consommée par les capitalistes, mais ajoutée au capital pour accroî-
tre la production. Les capitalistes ne veulent pas le consommer,
et les travailleurs ne le peuvent pas, leur consommation étant
couverte par le capital variable disponible. D'où vient la demande
pour la partie de la plus-value accumulée P 20. »
Ou elle écrira encore : « Le marché intérieur capitaliste ne peut
réaliser qu'une partie de la valeur du produit social : le capital
constant qui a été usé, le capital variable, et la partie consommée de
la plus-value. La partie de la plus-value épargnée doit être réalisée
ailleurs 21. »
réaliser qu'une partie de la valeur du produit social : le capital
constant qui a été usé, le capital variable, et la partie consommée de
la plus-value. La partie de la plus-value épargnée doit être réalisée
ailleurs 21. »
Rosa Luxemburg en conclut donc que la réalisation de la plus-
value, et par là même l'accumulation du capital, est impossible
dans un système capitaliste fermé, et que la partie de la plus-value
épargnée ne peut être réalisée qu'à travers la vente à des consomma-
teurs non capitalistes, en dehors du système capitaliste : pays, ou
couches sociales pré-capitalistes à l'intérieur des pays capitalistes.
value, et par là même l'accumulation du capital, est impossible
dans un système capitaliste fermé, et que la partie de la plus-value
épargnée ne peut être réalisée qu'à travers la vente à des consomma-
teurs non capitalistes, en dehors du système capitaliste : pays, ou
couches sociales pré-capitalistes à l'intérieur des pays capitalistes.
On peut, dit-elle, envisager alors deux cas : ou bien le secteur II
réalise sa plus value en vendant ses produits aux couches ou pays
non capitalistes : ainsi pourra-t-il demander au secteur I des moyens
de production permettant à ce dernier de réaliser) sa plus-value,
et d'accroître à son tour son accumulation. Elle cite, à cet égard,
le cas de l'industrie cotonnière anglaise qui, en vendant durant
les deux premiers tiers du xix° siècle, en Inde, en Amérique, en
Europe, a pu réaliser sa plus-value, et a permis le développement
de la production industrielle des machines en Angleterre.
réalise sa plus value en vendant ses produits aux couches ou pays
non capitalistes : ainsi pourra-t-il demander au secteur I des moyens
de production permettant à ce dernier de réaliser) sa plus-value,
et d'accroître à son tour son accumulation. Elle cite, à cet égard,
le cas de l'industrie cotonnière anglaise qui, en vendant durant
les deux premiers tiers du xix° siècle, en Inde, en Amérique, en
Europe, a pu réaliser sa plus-value, et a permis le développement
de la production industrielle des machines en Angleterre.
Ou bien alors, deuxième cas envisagé par R. Luxemburg, le
secteur I réalise sa plus-value en vendant ses produits aux couches
et aux pays non capitalistes, et il peut alors, accroître sa demande
de biens de consommation au secteur II, pour satisfaire les besoins
de la masse croissante de travailleurs du secteur I, et permettre
ainsi la réalisation de la plus-value du secteur IL
secteur I réalise sa plus-value en vendant ses produits aux couches
et aux pays non capitalistes, et il peut alors, accroître sa demande
de biens de consommation au secteur II, pour satisfaire les besoins
de la masse croissante de travailleurs du secteur I, et permettre
ainsi la réalisation de la plus-value du secteur IL
Or, en fait, on sait que, présenté de cet-ce façon, c'est-à-dire
présenté encore à la façon de Sismondi et des populistes, le problème
de la réalisation est un faux problème. Prétendre, comme R. Luxem-
présenté encore à la façon de Sismondi et des populistes, le problème
de la réalisation est un faux problème. Prétendre, comme R. Luxem-
20. Ibid., p. 143.
21. Ibid., pp. 366-367.
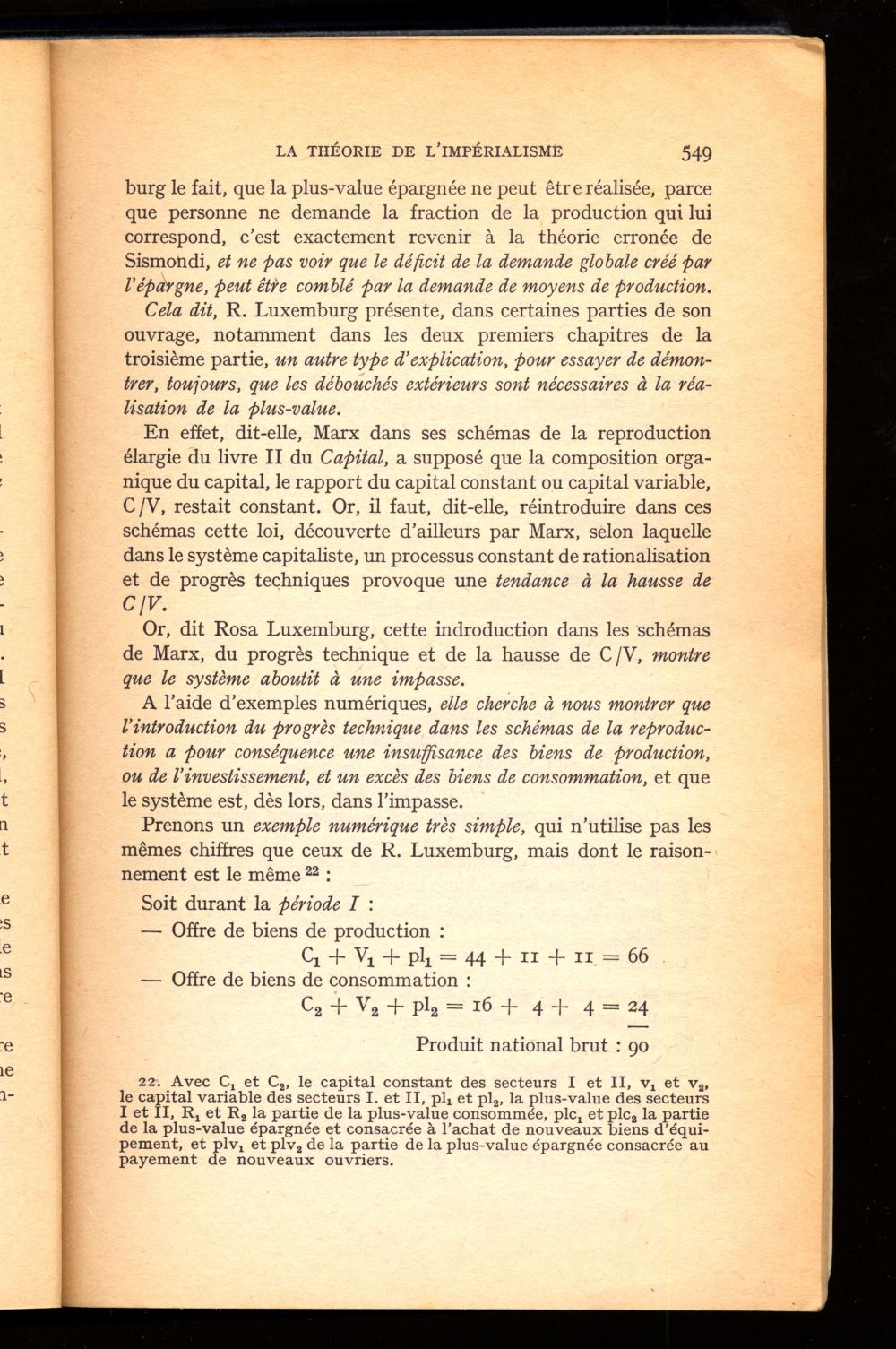

LA THÉORIE DE I/IMPÉRIALISME
549
burg le fait, que la plus-value épargnée ne peut être réalisée, parce
que personne ne demande la fraction de la production qui lui
correspond, c'est exactement revenir à la théorie erronée de
Sismondi, et ne pas voir que le déficit de la demande globale créé par
l'épargne, peut être comblé par la demande de moyens de production.
que personne ne demande la fraction de la production qui lui
correspond, c'est exactement revenir à la théorie erronée de
Sismondi, et ne pas voir que le déficit de la demande globale créé par
l'épargne, peut être comblé par la demande de moyens de production.
Cela dit, R. Luxemburg présente, dans certaines parties de son
ouvrage, notamment dans les deux premiers chapitres de la
troisième partie, un autre type d'explication, pour essayer de démon-
trer, toujours, que les débouchés extérieurs sont nécessaires à la réa-
lisation de la plus-value.
ouvrage, notamment dans les deux premiers chapitres de la
troisième partie, un autre type d'explication, pour essayer de démon-
trer, toujours, que les débouchés extérieurs sont nécessaires à la réa-
lisation de la plus-value.
En effet, dit-elle, Marx dans ses schémas de la reproduction
élargie du livre II du Capital, a supposé que la composition orga-
nique du capital, le rapport du capital constant ou capital variable,
C/V, restait constant. Or, il faut, dit-elle, réintroduire dans ces
schémas cette loi, découverte d'ailleurs par Marx, selon laquelle
dans le système capitaliste, un processus constant de rationalisation
et de progrès techniques provoque une tendance à la hausse de
C\V.
élargie du livre II du Capital, a supposé que la composition orga-
nique du capital, le rapport du capital constant ou capital variable,
C/V, restait constant. Or, il faut, dit-elle, réintroduire dans ces
schémas cette loi, découverte d'ailleurs par Marx, selon laquelle
dans le système capitaliste, un processus constant de rationalisation
et de progrès techniques provoque une tendance à la hausse de
C\V.
Or, dit Rosa Luxemburg, cette indroduction dans les schémas
de Marx, du progrès technique et de la hausse de C/V, montre
que le système aboutit à une impasse.
de Marx, du progrès technique et de la hausse de C/V, montre
que le système aboutit à une impasse.
A l'aide d'exemples numériques, elle cherche à nous montrer que
l'introduction du progrès technique dans les schémas de la reproduc-
tion a pour conséquence une insuffisance des biens de production,
ou de l'investissement, et un excès des biens de consommation, et que
le système est, dès lors, dans l'impasse.
l'introduction du progrès technique dans les schémas de la reproduc-
tion a pour conséquence une insuffisance des biens de production,
ou de l'investissement, et un excès des biens de consommation, et que
le système est, dès lors, dans l'impasse.
Prenons un exemple numérique très simple, qui n'utilise pas les
mêmes chiffres que ceux de R. Luxemburg, mais dont le raison-
nement est le même22 :
mêmes chiffres que ceux de R. Luxemburg, mais dont le raison-
nement est le même22 :
Soit durant la période I :
— Offre de biens de production :
ci + vi + P1! = 44 + il + il = 66
— Offre de biens de consommation :
C3 + Va + P12 = 16 + 4 + 4 = 24
Produit national brut
90
22. Avec Cj et C2, le capital constant des secteurs I et II, Vj et v2,
le capital variable des secteurs I. et II, pli et p!2, la plus-value des secteurs
I et II, R, et R2 la partie de la plus-value consommée, pic, et plc2 la partie
de la plus-value épargnée et consacrée à l'achat de nouveaux biens d'équi-
pement, et plv, et plv2 de la partie de la plus-value épargnée consacrée au
payement de nouveaux ouvriers.
le capital variable des secteurs I. et II, pli et p!2, la plus-value des secteurs
I et II, R, et R2 la partie de la plus-value consommée, pic, et plc2 la partie
de la plus-value épargnée et consacrée à l'achat de nouveaux biens d'équi-
pement, et plv, et plv2 de la partie de la plus-value épargnée consacrée au
payement de nouveaux ouvriers.


550 LES TEMPS MODERNES
On a donc :
— C/V = 4
pi
— taux de plus-value : — = 100 % ;
v
supposons que la moitié dé la plus value dans les deux secteurs
soit épargnée, et que cette moitié de plus value épargnée qui va
servir à acheter des biens d'équipement et à payer de nouveaux
ouvriers, qui va donc se diviser de nouveau en C et V, se divise
dans la même proportion de 4 : On suppose donc que C \V est constant,
ce qui est l'hypothèse de Marx dans les schémas de la reproduction :
soit épargnée, et que cette moitié de plus value épargnée qui va
servir à acheter des biens d'équipement et à payer de nouveaux
ouvriers, qui va donc se diviser de nouveau en C et V, se divise
dans la même proportion de 4 : On suppose donc que C \V est constant,
ce qui est l'hypothèse de Marx dans les schémas de la reproduction :
On a donc : plx épargnée : 5,5 =
pL épargnée: 2 = \ Ti6 C + °',4 V
( plc2 + plv2
On va donc avoir :
( plc2 + plv2
On va donc avoir :
— Investissements = 66
— Épargne = Cj -f C2 + plcx + plc2
= 44 + 16 + 4,4 -- 1,6 = 66
donc : INVESTISSEMENT = ÉPARGNE
de même, on a :
de même, on a :
— Offre de biens de consommation = 24
— Demande de biens de consommation =
V
R
p!Vl + plva +
= ii + 4 + 1,1 + 0,4 + 5,5 + 2 = 24
donc OFFRE BIENS CONSOMMATIONS = DEMANDE BIENS CONSOM-
MATION.
MATION.
Mais maintenant, introduisons dans le schéma l'effet du progrès
technique, sous la forme d'une hausse de C /V : et supposons que
C /V passe de 4 à 7 : la plus-value va donc se partager de façon
différente :
technique, sous la forme d'une hausse de C /V : et supposons que
C /V passe de 4 à 7 : la plus-value va donc se partager de façon
différente :
On aura :
— plt épargnée : 5,5 = 4,8 C + 0,7 V
— p!2 épargnée : 2 = 1,75 C -f 0,25 V
On va donc avoir :
— • Investissements = 66
— Épargne = Cx + C2 -f- plcx + plc2
= 44 + 16 + 4,8 + 1,75 = 66,55
On a donc : ÉPARGNE > INVESTISSEMENT
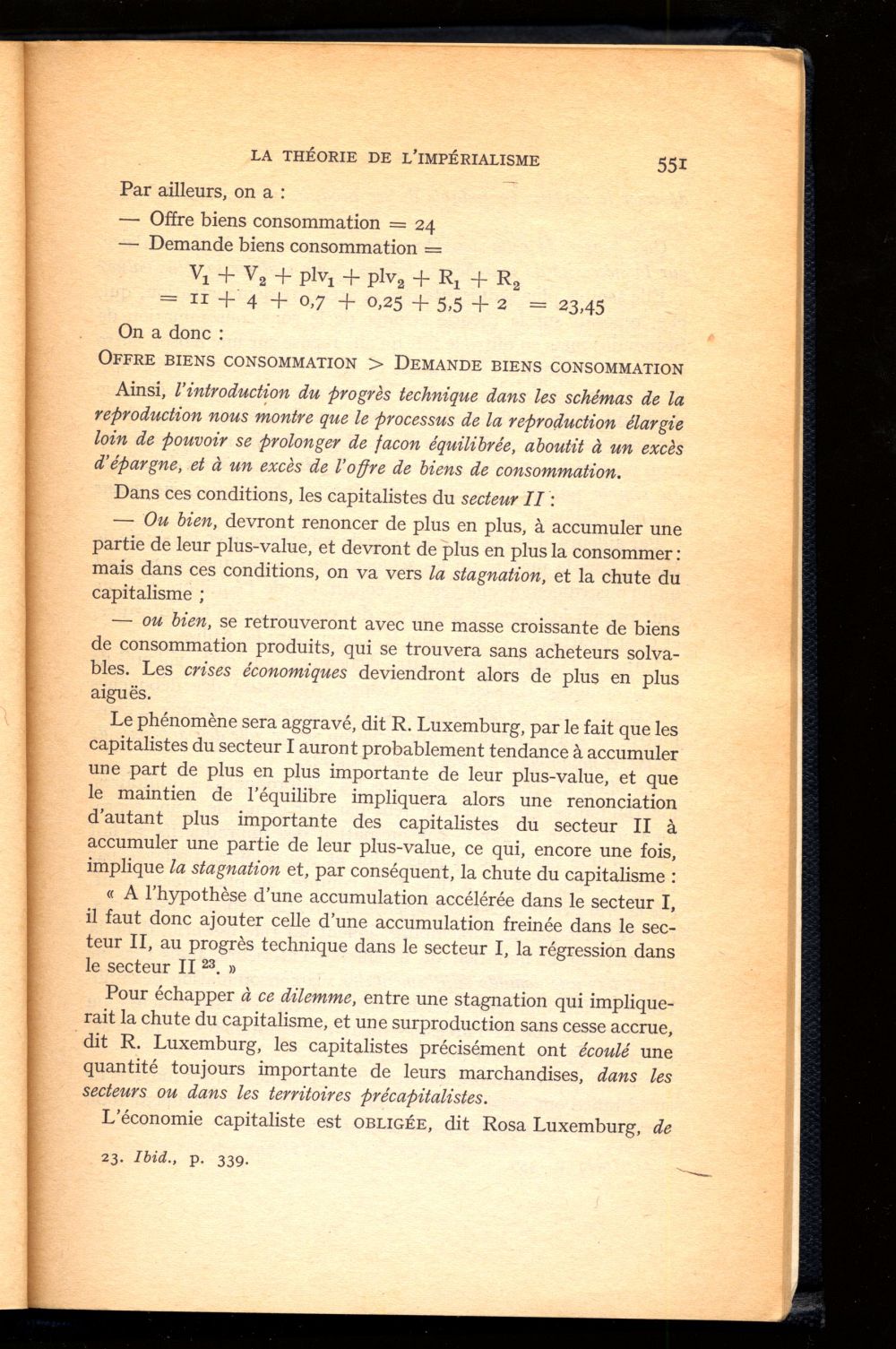

LA THÉORIE DE L'IMPÉRIALISME 551
Par ailleurs, on a :
— Offre biens consommation = 24
—• Demande biens consommation =
—• Demande biens consommation =
Vi + V2 + p!Vl + plv2 + R1 + R2
= n +' 4 + 0,7 + 0,25 + 5-5 + 2 = 23,45
= n +' 4 + 0,7 + 0,25 + 5-5 + 2 = 23,45
On a donc :
OFFRE BIENS CONSOMMATION > DEMANDE BIENS CONSOMMATION
OFFRE BIENS CONSOMMATION > DEMANDE BIENS CONSOMMATION
Ainsi, l'introduction du progrès technique dans les schémas de la
reproduction nous montre que le processus de la reproduction élargie
loin de pouvoir se prolonger de façon équilibrée, aboutit à un excès
d'épargne, et à un excès de l'offre de biens de consommation.
reproduction nous montre que le processus de la reproduction élargie
loin de pouvoir se prolonger de façon équilibrée, aboutit à un excès
d'épargne, et à un excès de l'offre de biens de consommation.
Dans ces conditions, les capitalistes du secteur II :
— Ou bien, devront renoncer de plus en plus, à accumuler une
partie de leur plus-value, et devront de plus en plus la consommer :
mais dans ces conditions, on va vers la stagnation, et la chute du
capitalisme ;
partie de leur plus-value, et devront de plus en plus la consommer :
mais dans ces conditions, on va vers la stagnation, et la chute du
capitalisme ;
— ou bien, se retrouveront avec une masse croissante de biens
de consommation produits, qui se trouvera sans acheteurs solva-
bles. Les crises économiques deviendront alors de plus en plus
aiguës.
de consommation produits, qui se trouvera sans acheteurs solva-
bles. Les crises économiques deviendront alors de plus en plus
aiguës.
Le phénomène sera aggravé, dit R. Luxemburg, par le fait que les
capitalistes du secteur I auront probablement tendance à accumuler
une part de plus en plus importante de leur plus-value, et que
le maintien de l'équilibre impliquera alors une renonciation
d'autant plus importante des capitalistes du secteur II à
accumuler une partie de leur plus-value, ce qui, encore une fois,
implique la stagnation et, par conséquent, la chute du capitalisme :
capitalistes du secteur I auront probablement tendance à accumuler
une part de plus en plus importante de leur plus-value, et que
le maintien de l'équilibre impliquera alors une renonciation
d'autant plus importante des capitalistes du secteur II à
accumuler une partie de leur plus-value, ce qui, encore une fois,
implique la stagnation et, par conséquent, la chute du capitalisme :
« A l'hypothèse d'une accumulation accélérée dans le secteur I,
il faut donc ajouter celle d'une accumulation freinée dans le sec-
teur II, au progrès technique dans le secteur I, la régression dans
le secteur II23. »
il faut donc ajouter celle d'une accumulation freinée dans le sec-
teur II, au progrès technique dans le secteur I, la régression dans
le secteur II23. »
Pour échapper à ce dilemme, entre une stagnation qui implique-
rait la chute du capitalisme, et une surproduction sans cesse accrue,
dit R. Luxemburg, les capitalistes précisément ont écoulé une
quantité toujours importante de leurs marchandises, dans les
secteurs ou dans les territoires précapitalistes.
rait la chute du capitalisme, et une surproduction sans cesse accrue,
dit R. Luxemburg, les capitalistes précisément ont écoulé une
quantité toujours importante de leurs marchandises, dans les
secteurs ou dans les territoires précapitalistes.
L'économie capitaliste est OBLIGÉE, dit Rosa Luxemburg, de
23. Ibid., p. 339.
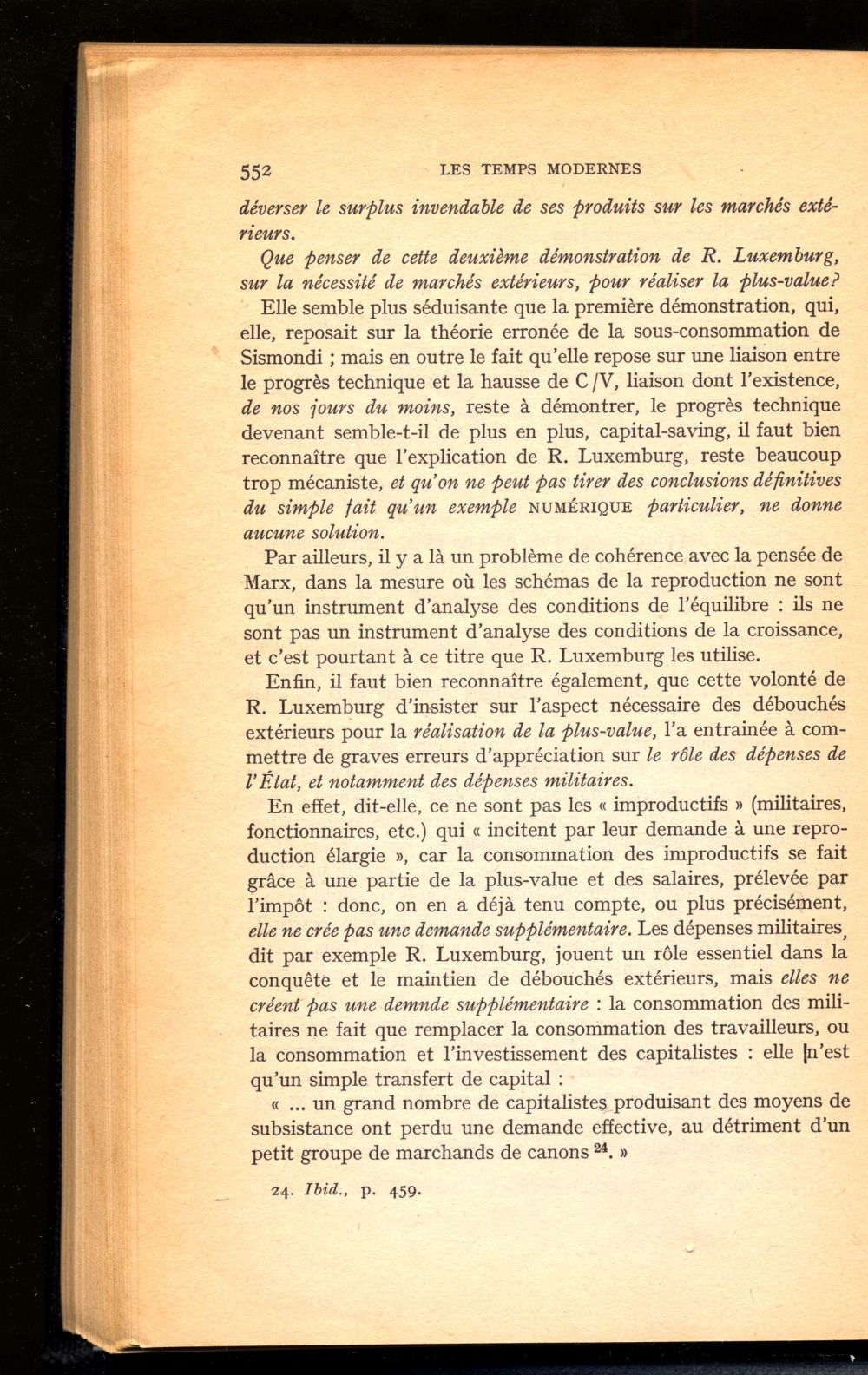

552
LES TEMPS MODERNES
déverser le surplus invendable de ses produits sur les marchés exté-
rieurs.
rieurs.
Que penser de cette deuxième démonstration de R. Luxemburg,
sur la nécessité de marchés extérieurs, pour réaliser la plus-value?
sur la nécessité de marchés extérieurs, pour réaliser la plus-value?
Elle semble plus séduisante que la première démonstration, qui,
elle, reposait sur la théorie erronée de la sous-consommation de
Sismondi ; mais en outre le fait qu'elle repose sur une liaison entre
le progrès technique et la hausse de C /V, liaison dont l'existence,
de nos jours du moins, reste à démontrer, le progrès technique
devenant semble-t-il de plus en plus, capital-saving, il faut bien
reconnaître que l'explication de R. Luxemburg, reste beaucoup
trop mécaniste, et qu'on ne peut pas tirer des conclusions définitives
du simple fait qu'un exemple NUMÉRIQUE particulier, ne donne
aucune solution.
elle, reposait sur la théorie erronée de la sous-consommation de
Sismondi ; mais en outre le fait qu'elle repose sur une liaison entre
le progrès technique et la hausse de C /V, liaison dont l'existence,
de nos jours du moins, reste à démontrer, le progrès technique
devenant semble-t-il de plus en plus, capital-saving, il faut bien
reconnaître que l'explication de R. Luxemburg, reste beaucoup
trop mécaniste, et qu'on ne peut pas tirer des conclusions définitives
du simple fait qu'un exemple NUMÉRIQUE particulier, ne donne
aucune solution.
Par ailleurs, il y a là un problème de cohérence avec la pensée de
Marx, dans la mesure où les schémas de la reproduction ne sont
qu'un instrument d'analyse des conditions de l'équilibre : ils ne
sont pas un instrument d'analyse des conditions de la croissance,
et c'est pourtant à ce titre que R. Luxemburg les utilise.
Marx, dans la mesure où les schémas de la reproduction ne sont
qu'un instrument d'analyse des conditions de l'équilibre : ils ne
sont pas un instrument d'analyse des conditions de la croissance,
et c'est pourtant à ce titre que R. Luxemburg les utilise.
Enfin, il faut bien reconnaître également, que cette volonté de
R. Luxemburg d'insister sur l'aspect nécessaire des débouchés
extérieurs pour la réalisation de la plus-value, l'a entraînée à com-
mettre de graves erreurs d'appréciation sur le rôle des dépenses de
l'État, et notamment des dépenses militaires.
R. Luxemburg d'insister sur l'aspect nécessaire des débouchés
extérieurs pour la réalisation de la plus-value, l'a entraînée à com-
mettre de graves erreurs d'appréciation sur le rôle des dépenses de
l'État, et notamment des dépenses militaires.
En effet, dit-elle, ce ne sont pas les « improductifs » (militaires,
fonctionnaires, etc.) qui « incitent par leur demande à une repro-
duction élargie », car la consommation des improductifs se fait
grâce à une partie de la plus-value et des salaires, prélevée par
l'impôt : donc, on en a déjà tenu compte, ou plus précisément,
elle ne crée pas une demande supplémentaire. Les dépenses militairesj
dit par exemple R. Luxemburg, jouent un rôle essentiel dans la
conquête et le maintien de débouchés extérieurs, mais elles ne
créent pas une demnde supplémentaire : la consommation des mili-
taires ne fait que remplacer la consommation des travailleurs, ou
la consommation et l'investissement des capitalistes : elle [n'est
qu'un simple transfert de capital :
fonctionnaires, etc.) qui « incitent par leur demande à une repro-
duction élargie », car la consommation des improductifs se fait
grâce à une partie de la plus-value et des salaires, prélevée par
l'impôt : donc, on en a déjà tenu compte, ou plus précisément,
elle ne crée pas une demande supplémentaire. Les dépenses militairesj
dit par exemple R. Luxemburg, jouent un rôle essentiel dans la
conquête et le maintien de débouchés extérieurs, mais elles ne
créent pas une demnde supplémentaire : la consommation des mili-
taires ne fait que remplacer la consommation des travailleurs, ou
la consommation et l'investissement des capitalistes : elle [n'est
qu'un simple transfert de capital :
« ... un grand nombre de capitalistes produisant des moyens de
subsistance ont perdu une demande effective, au détriment d'un
petit groupe de marchands de canons 24. »
subsistance ont perdu une demande effective, au détriment d'un
petit groupe de marchands de canons 24. »
24. Ibid., p. 459.
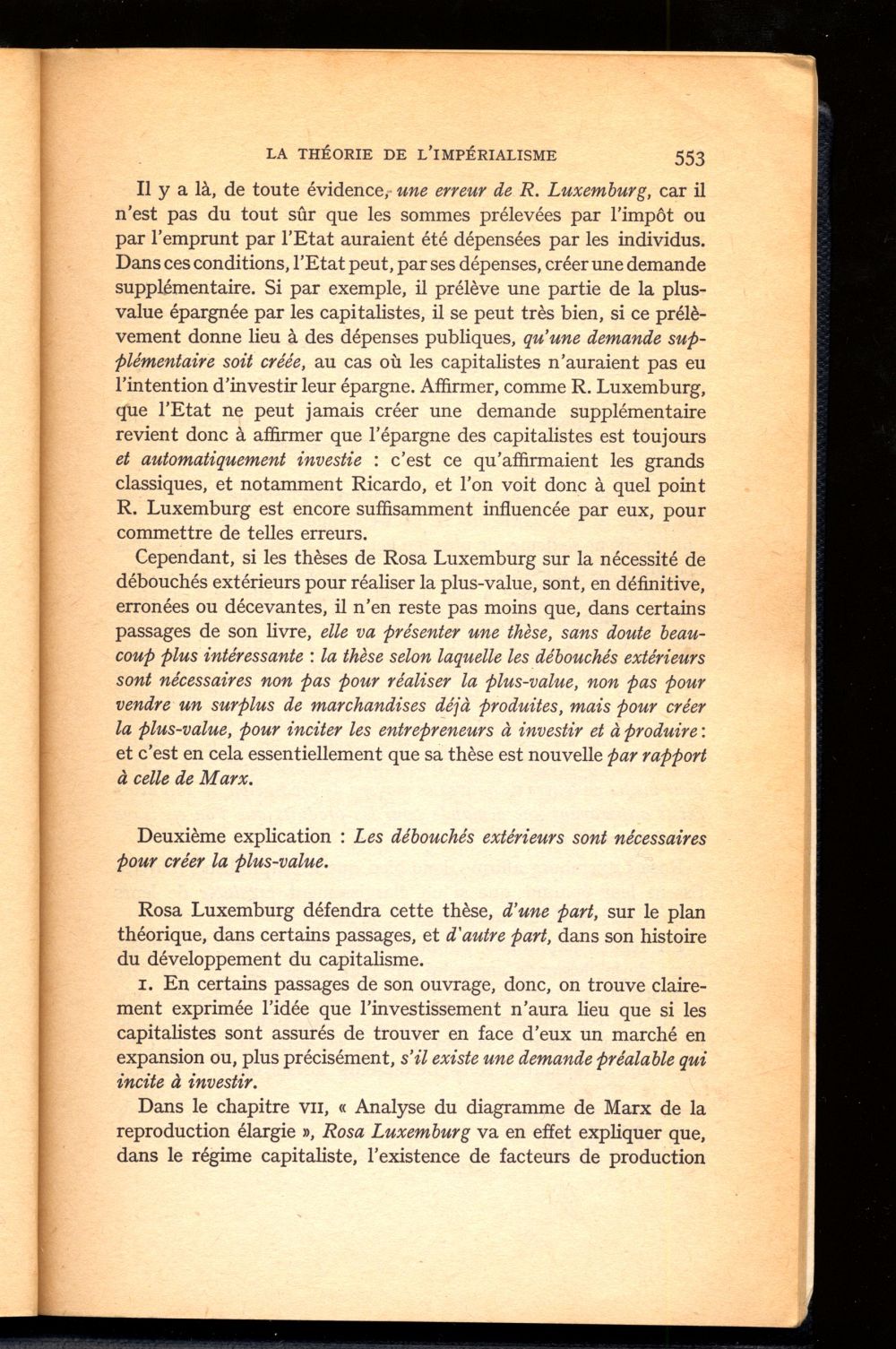

LA THÉORIE DE L'IMPÉRIALISME
553
II y a là, de toute évidence, une erreur de R. Luxemburg, car il
n'est pas du tout sûr que les sommes prélevées par l'impôt ou
par l'emprunt par l'Etat auraient été dépensées par les individus.
Dans ces conditions, l'Etat peut, par ses dépenses, créer une demande
supplémentaire. Si par exemple, il prélève une partie de la plus-
value épargnée par les capitalistes, il se peut très bien, si ce prélè-
vement donne lieu à des dépenses publiques, qu'une demande sup-
plémentaire soit créée, au cas où les capitalistes n'auraient pas eu
l'intention d'investir leur épargne. Affirmer, comme R. Luxemburg,
que l'Etat ne peut jamais créer une demande supplémentaire
revient donc à affirmer que l'épargne des capitalistes est toujours
et automatiquement investie : c'est ce qu'affirmaient les grands
classiques, et notamment Ricardo, et l'on voit donc à quel point
R. Luxemburg est encore suffisamment influencée par eux, pour
commettre de telles erreurs.
n'est pas du tout sûr que les sommes prélevées par l'impôt ou
par l'emprunt par l'Etat auraient été dépensées par les individus.
Dans ces conditions, l'Etat peut, par ses dépenses, créer une demande
supplémentaire. Si par exemple, il prélève une partie de la plus-
value épargnée par les capitalistes, il se peut très bien, si ce prélè-
vement donne lieu à des dépenses publiques, qu'une demande sup-
plémentaire soit créée, au cas où les capitalistes n'auraient pas eu
l'intention d'investir leur épargne. Affirmer, comme R. Luxemburg,
que l'Etat ne peut jamais créer une demande supplémentaire
revient donc à affirmer que l'épargne des capitalistes est toujours
et automatiquement investie : c'est ce qu'affirmaient les grands
classiques, et notamment Ricardo, et l'on voit donc à quel point
R. Luxemburg est encore suffisamment influencée par eux, pour
commettre de telles erreurs.
Cependant, si les thèses de Rosa Luxemburg sur la nécessité de
débouchés extérieurs pour réaliser la plus-value, sont, en définitive,
erronées ou décevantes, il n'en reste pas moins que, dans certains
passages de son livre, elle va présenter une thèse, sans doute beau-
coup plus intéressante : la thèse selon laquelle les débouchés extérieurs
sont nécessaires non pas pour réaliser la plus-value, non pas pour
vendre un surplus de marchandises déjà produites, mais pour créer
la plus-value, pour inciter les entrepreneurs à investir et à produire :
et c'est en cela essentiellement que sa thèse est nouvelle par rapport
à cette de Marx,
débouchés extérieurs pour réaliser la plus-value, sont, en définitive,
erronées ou décevantes, il n'en reste pas moins que, dans certains
passages de son livre, elle va présenter une thèse, sans doute beau-
coup plus intéressante : la thèse selon laquelle les débouchés extérieurs
sont nécessaires non pas pour réaliser la plus-value, non pas pour
vendre un surplus de marchandises déjà produites, mais pour créer
la plus-value, pour inciter les entrepreneurs à investir et à produire :
et c'est en cela essentiellement que sa thèse est nouvelle par rapport
à cette de Marx,
Deuxième explication
pour créer la plus-value.
pour créer la plus-value.
Les débouchés extérieurs sont nécessaires
Rosa Luxemburg défendra cette thèse, d'une part, sur le plan
théorique, dans certains passages, et d'autre part, dans son histoire
du développement du capitalisme.
théorique, dans certains passages, et d'autre part, dans son histoire
du développement du capitalisme.
i. En certains passages de son ouvrage, donc, on trouve claire-
ment exprimée l'idée que l'investissement n'aura lieu que si les
capitalistes sont assurés de trouver en face d'eux un marché en
expansion ou, plus précisément, s'il existe une demande préalable qui
incite à investir.
ment exprimée l'idée que l'investissement n'aura lieu que si les
capitalistes sont assurés de trouver en face d'eux un marché en
expansion ou, plus précisément, s'il existe une demande préalable qui
incite à investir.
Dans le chapitre vu, « Analyse du diagramme de Marx de la
reproduction élargie », Rosa Luxemburg va en effet expliquer que,
dans le régime capitaliste, l'existence de facteurs de production
reproduction élargie », Rosa Luxemburg va en effet expliquer que,
dans le régime capitaliste, l'existence de facteurs de production
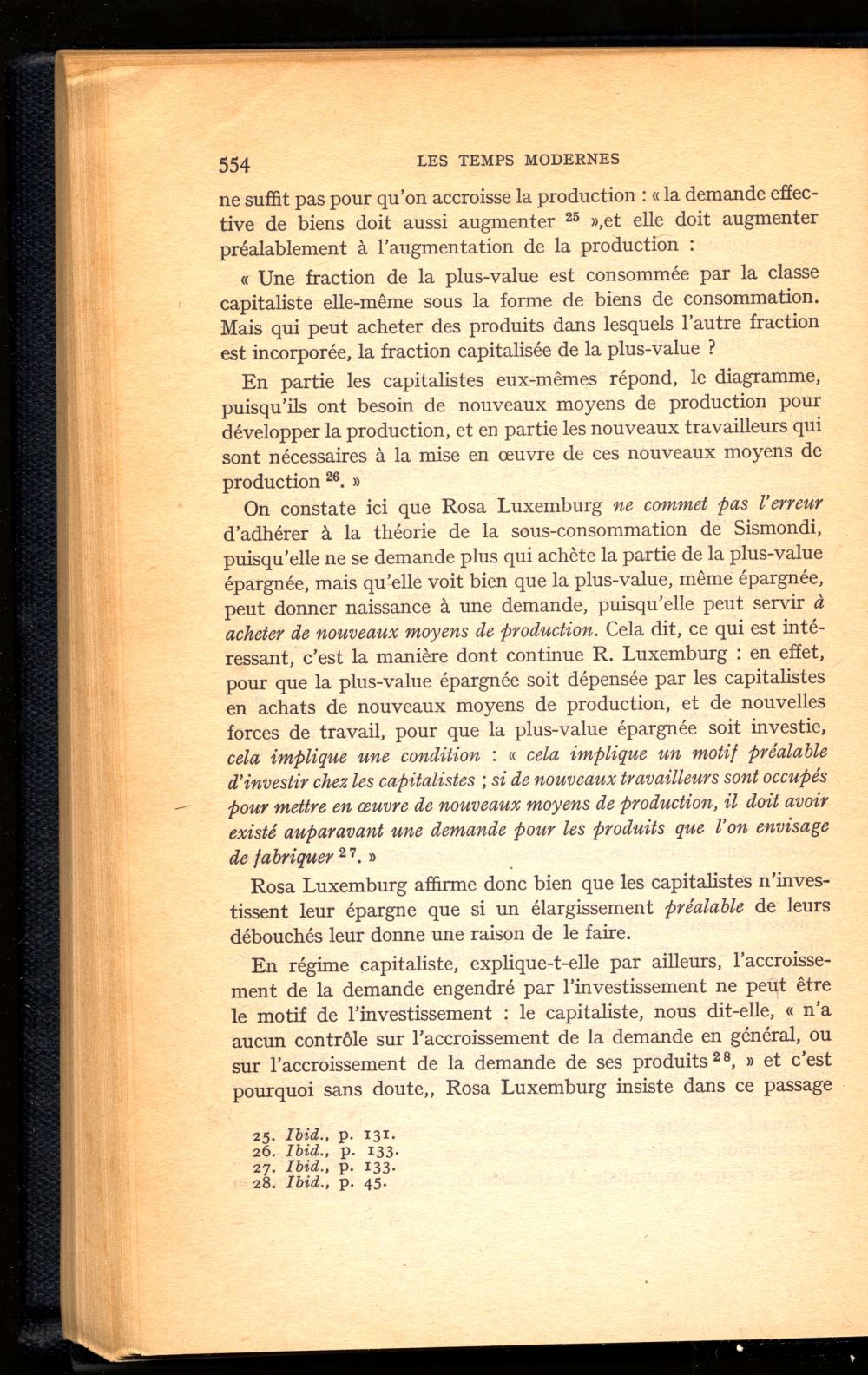

554
LES TEMPS MODERNES
ne suffit pas pour qu'on accroisse la production : « la demande effec-
tive de biens doit aussi augmenter 25 »,et elle doit augmenter
préalablement à l'augmentation de la production :
tive de biens doit aussi augmenter 25 »,et elle doit augmenter
préalablement à l'augmentation de la production :
« Une fraction de la plus-value est consommée par la classe
capitaliste elle-même sous la forme de biens de consommation.
Mais qui peut acheter des produits dans lesquels l'autre fraction
est incorporée, la fraction capitalisée de la plus-value ?
capitaliste elle-même sous la forme de biens de consommation.
Mais qui peut acheter des produits dans lesquels l'autre fraction
est incorporée, la fraction capitalisée de la plus-value ?
En partie les capitalistes eux-mêmes répond, le diagramme,
puisqu'ils ont besoin de nouveaux moyens de production pour
développer la production, et en partie les nouveaux travailleurs qui
sont nécessaires à la mise en œuvre de ces nouveaux moyens de
production 26. »
puisqu'ils ont besoin de nouveaux moyens de production pour
développer la production, et en partie les nouveaux travailleurs qui
sont nécessaires à la mise en œuvre de ces nouveaux moyens de
production 26. »
On constate ici que Rosa Luxemburg ne commet pas Veneur
d'adhérer à la théorie de la sous-consommation de Sismondi,
puisqu'elle ne se demande plus qui achète la partie de la plus-value
épargnée, mais qu'elle voit bien que la plus-value, même épargnée,
peut donner naissance à une demande, puisqu'elle peut servir à
acheter de nouveaux moyens de production. Cela dit, ce qui est inté-
ressant, c'est la manière dont continue R. Luxemburg : en effet,
pour que la plus-value épargnée soit dépensée par les capitalistes
en achats de nouveaux moyens de production, et de nouvelles
forces de travail, pour que la plus-value épargnée soit investie,
cela implique une condition : « cela implique un motif préalable
d'investir chez les capitalistes ; si de nouveaux travailleurs sont occupés
pour mettre en œuvre de nouveaux moyens de production, il doit avoir
existé auparavant une demande pour les produits que l'on envisage
de fabriquer 27. »
d'adhérer à la théorie de la sous-consommation de Sismondi,
puisqu'elle ne se demande plus qui achète la partie de la plus-value
épargnée, mais qu'elle voit bien que la plus-value, même épargnée,
peut donner naissance à une demande, puisqu'elle peut servir à
acheter de nouveaux moyens de production. Cela dit, ce qui est inté-
ressant, c'est la manière dont continue R. Luxemburg : en effet,
pour que la plus-value épargnée soit dépensée par les capitalistes
en achats de nouveaux moyens de production, et de nouvelles
forces de travail, pour que la plus-value épargnée soit investie,
cela implique une condition : « cela implique un motif préalable
d'investir chez les capitalistes ; si de nouveaux travailleurs sont occupés
pour mettre en œuvre de nouveaux moyens de production, il doit avoir
existé auparavant une demande pour les produits que l'on envisage
de fabriquer 27. »
Rosa Luxemburg affirme donc bien que les capitalistes n'inves-
tissent leur épargne que si un élargissement préalable de leurs
débouchés leur donne une raison de le faire.
tissent leur épargne que si un élargissement préalable de leurs
débouchés leur donne une raison de le faire.
En régime capitaliste, explique-t-elle par ailleurs, l'accroisse-
ment de la demande engendré par l'investissement ne peut être
le motif de l'investissement : le capitaliste, nous dit-elle, « n'a
aucun contrôle sur l'accroissement de la demande en général, ou
sur l'accroissement de la demande de ses produits2 8, » et c'est
pourquoi sans doute,, Rosa Luxemburg insiste dans ce passage
ment de la demande engendré par l'investissement ne peut être
le motif de l'investissement : le capitaliste, nous dit-elle, « n'a
aucun contrôle sur l'accroissement de la demande en général, ou
sur l'accroissement de la demande de ses produits2 8, » et c'est
pourquoi sans doute,, Rosa Luxemburg insiste dans ce passage
25. Ibid., p. 131.
26. Ibid., p. 133.
27. Ibid., p. 133.
28. Ibid., p. 45.
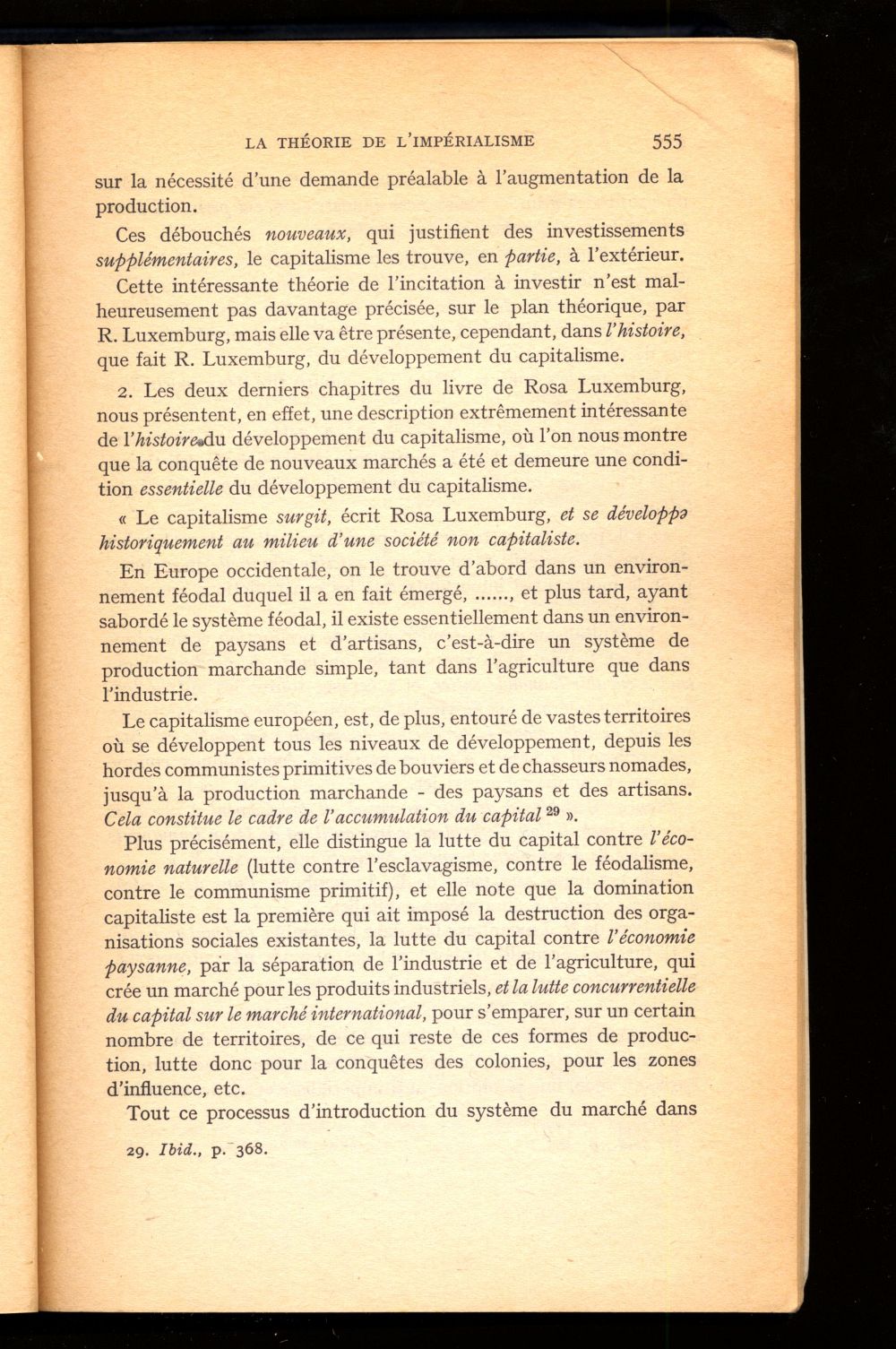

LA THEORIE DE L IMPERIALISME
555
sur la nécessité d'une demande préalable à l'augmentation de la
production.
production.
Ces débouchés nouveaux, qui justifient des investissements
supplémentaires, le capitalisme les trouve, en partie, à l'extérieur.
supplémentaires, le capitalisme les trouve, en partie, à l'extérieur.
Cette intéressante théorie de l'incitation à investir n'est mal-
heureusement pas davantage précisée, sur le plan théorique, par
R. Luxemburg, mais elle va être présente, cependant, dans l'histoire,
que fait R. Luxemburg, du développement du capitalisme.
heureusement pas davantage précisée, sur le plan théorique, par
R. Luxemburg, mais elle va être présente, cependant, dans l'histoire,
que fait R. Luxemburg, du développement du capitalisme.
2. Les deux derniers chapitres du livre de Rosa Luxemburg,
nous présentent, en effet, une description extrêmement intéressante
de l'histoireAu développement du capitalisme, où l'on nous montre
que la conquête de nouveaux marchés a été et demeure une condi-
tion essentielle du développement du capitalisme.
nous présentent, en effet, une description extrêmement intéressante
de l'histoireAu développement du capitalisme, où l'on nous montre
que la conquête de nouveaux marchés a été et demeure une condi-
tion essentielle du développement du capitalisme.
« Le capitalisme surgit, écrit Rosa Luxemburg, et se développa
historiquement au milieu d'une société non capitaliste.
historiquement au milieu d'une société non capitaliste.
En Europe occidentale, on le trouve d'abord dans un environ-
nement féodal duquel il a en fait émergé, ......, et plus tard, ayant
nement féodal duquel il a en fait émergé, ......, et plus tard, ayant
sabordé le système féodal, il existe essentiellement dans un environ-
nement de paysans et d'artisans, c'est-à-dire un système de
production marchande simple, tant dans l'agriculture que dans
l'industrie.
nement de paysans et d'artisans, c'est-à-dire un système de
production marchande simple, tant dans l'agriculture que dans
l'industrie.
Le capitalisme européen, est, de plus, entouré de vastes territoires
où se développent tous les niveaux de développement, depuis les
hordes communistes primitives de bouviers et de chasseurs nomades,
jusqu'à la production marchande - des paysans et des artisans.
Cela constitue le cadre de l'accumulation du capital w ».
où se développent tous les niveaux de développement, depuis les
hordes communistes primitives de bouviers et de chasseurs nomades,
jusqu'à la production marchande - des paysans et des artisans.
Cela constitue le cadre de l'accumulation du capital w ».
Plus précisément, elle distingue la lutte du capital contre l'éco-
nomie naturelle (lutte contre l'esclavagisme, contre le féodalisme,
contre le communisme primitif), et elle note que la domination
capitaliste est la première qui ait imposé la destruction des orga-
nisations sociales existantes, la lutte du capital contre l'économie
paysanne, par la séparation de l'industrie et de l'agriculture, qui
crée un marché pour les produits industriels, et la lutte concurrentielle
du capital sur le marché international, pour s'emparer, sur un certain
nombre de territoires, de ce qui reste de ces formes de produc-
tion, lutte donc pour la conquêtes des colonies, pour les zones
d'influence, etc.
nomie naturelle (lutte contre l'esclavagisme, contre le féodalisme,
contre le communisme primitif), et elle note que la domination
capitaliste est la première qui ait imposé la destruction des orga-
nisations sociales existantes, la lutte du capital contre l'économie
paysanne, par la séparation de l'industrie et de l'agriculture, qui
crée un marché pour les produits industriels, et la lutte concurrentielle
du capital sur le marché international, pour s'emparer, sur un certain
nombre de territoires, de ce qui reste de ces formes de produc-
tion, lutte donc pour la conquêtes des colonies, pour les zones
d'influence, etc.
Tout ce processus d'introduction du système du marché dans
29. Ibid., p. 368.
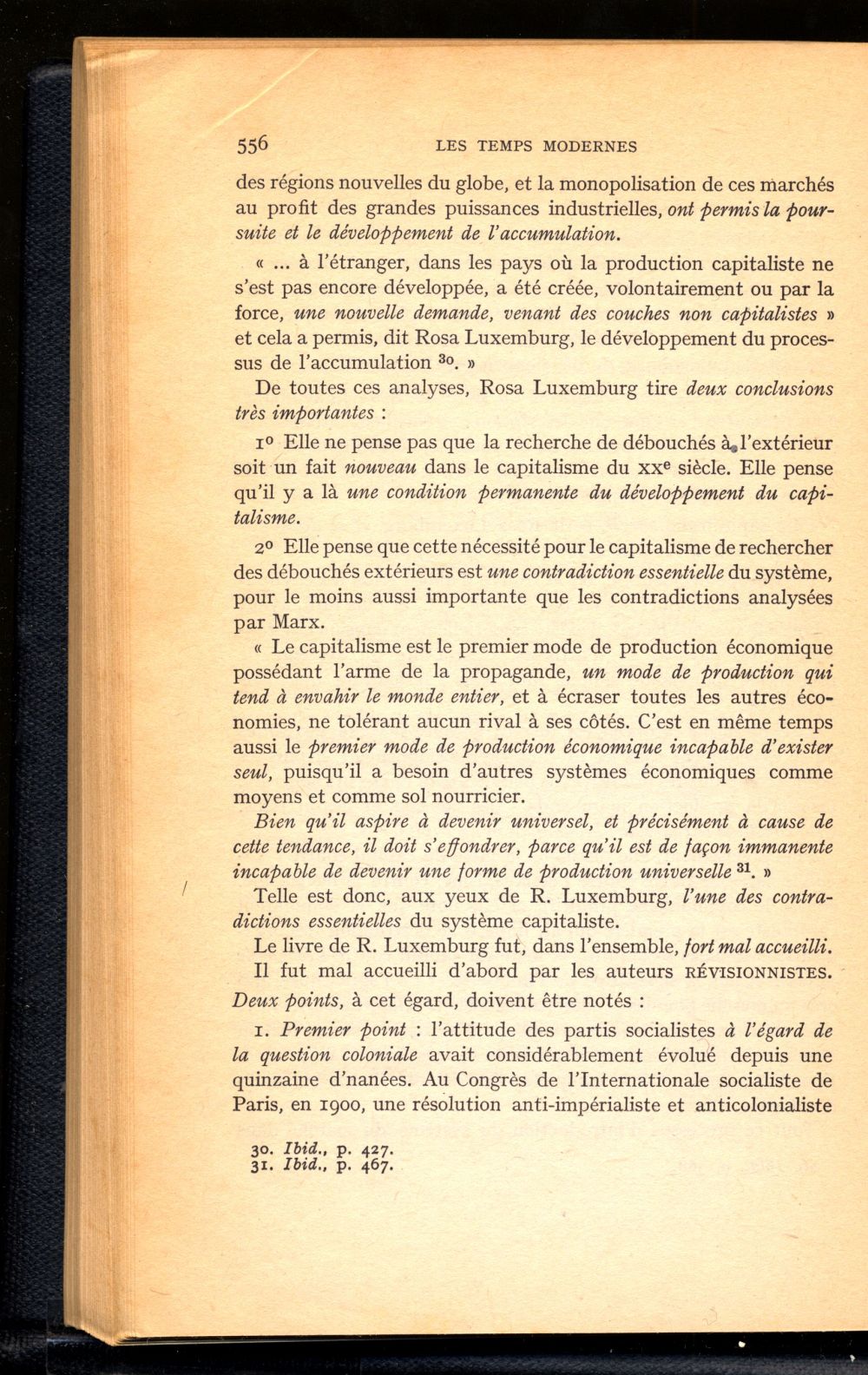

556
LES TEMPS MODERNES
des régions nouvelles du globe, et la monopolisation de ces marchés
au profit des grandes puissances industrielles, ont permis la pour-
suite et le développement de l'accumulation.
au profit des grandes puissances industrielles, ont permis la pour-
suite et le développement de l'accumulation.
« ... à l'étranger, dans les pays où la production capitaliste ne
s'est pas encore développée, a été créée, volontairement ou par la
force, une nouvelle demande, venant des couches non capitalistes »
et cela a permis, dit Rosa Luxemburg, le développement du proces-
sus de l'accumulation 3o. »
s'est pas encore développée, a été créée, volontairement ou par la
force, une nouvelle demande, venant des couches non capitalistes »
et cela a permis, dit Rosa Luxemburg, le développement du proces-
sus de l'accumulation 3o. »
De toutes ces analyses, Rosa Luxemburg tire deux conclusions
très importantes :
très importantes :
i° Elle ne pense pas que la recherche de débouchés à.l'extérieur
soit un fait nouveau dans le capitalisme du xxe siècle. Elle pense
qu'il y a là une condition permanente du développement du capi-
talisme.
soit un fait nouveau dans le capitalisme du xxe siècle. Elle pense
qu'il y a là une condition permanente du développement du capi-
talisme.
2° Elle pense que cette nécessité pour le capitalisme de rechercher
des débouchés extérieurs est une contradiction essentielle du système,
pour le moins aussi importante que les contradictions analysées
par Marx.
des débouchés extérieurs est une contradiction essentielle du système,
pour le moins aussi importante que les contradictions analysées
par Marx.
« Le capitalisme est le premier mode de production économique
possédant l'arme de la propagande, un mode de production qui
tend à envahir le monde entier, et à écraser toutes les autres éco-
nomies, ne tolérant aucun rival à ses côtés. C'est en même temps
aussi le premier mode de production économique incapable d'exister
seul, puisqu'il a besoin d'autres systèmes économiques comme
moyens et comme sol nourricier.
possédant l'arme de la propagande, un mode de production qui
tend à envahir le monde entier, et à écraser toutes les autres éco-
nomies, ne tolérant aucun rival à ses côtés. C'est en même temps
aussi le premier mode de production économique incapable d'exister
seul, puisqu'il a besoin d'autres systèmes économiques comme
moyens et comme sol nourricier.
Bien qu'il aspire à devenir universel, et précisément à cause de
cette tendance, il doit s'effondrer, parce qu'il est de façon immanente
incapable de devenir une forme de -production universelle 31. »
cette tendance, il doit s'effondrer, parce qu'il est de façon immanente
incapable de devenir une forme de -production universelle 31. »
Telle est donc, aux yeux de R. Luxemburg, l'une des contra-
dictions essentielles du système capitaliste.
dictions essentielles du système capitaliste.
Le livre de R. Luxemburg fut, dans l'ensemble, fort mal accueilli.
Il fut mal accueilli d'abord par les auteurs RÉVISIONNISTES.
Deux points, à cet égard, doivent être notés :
Deux points, à cet égard, doivent être notés :
i. Premier point : l'attitude des partis socialistes à l'égard de
la question coloniale avait considérablement évolué depuis une
quinzaine d'nanées. Au Congrès de l'Internationale socialiste de
Paris, en 1900, une résolution anti-impérialiste et anticolonialiste
la question coloniale avait considérablement évolué depuis une
quinzaine d'nanées. Au Congrès de l'Internationale socialiste de
Paris, en 1900, une résolution anti-impérialiste et anticolonialiste
30. Ibid., p. 427.
31. Ibid., p. 467.
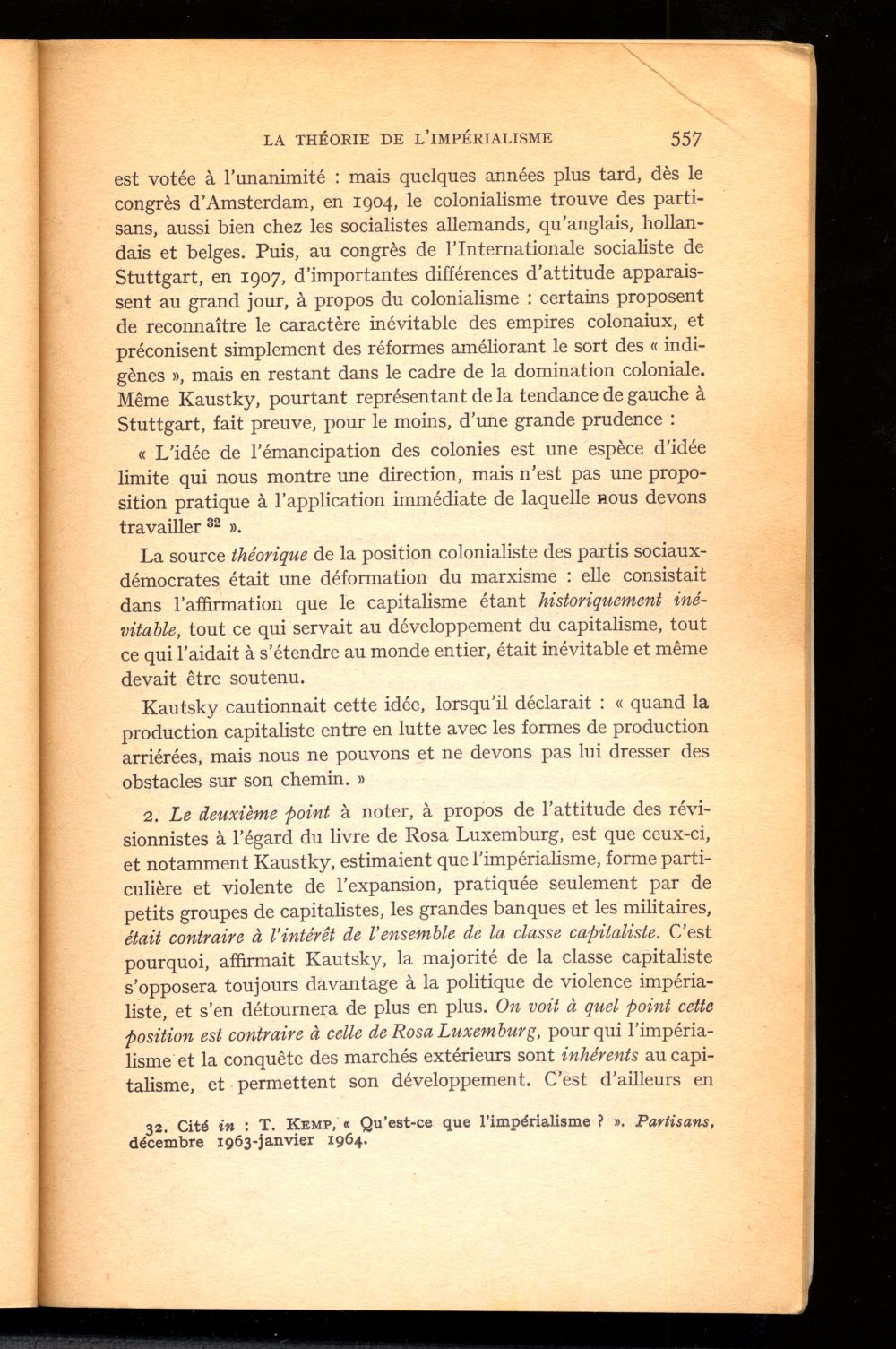

LA THÉORIE DE I/IMPÉRIALISME
557
est votée à l'unanimité : mais quelques années plus tard, dès le
congrès d'Amsterdam, en 1904, le colonialisme trouve des parti-
sans, aussi bien chez les socialistes allemands, qu'anglais, hollan-
dais et belges. Puis, au congrès de l'Internationale socialiste de
Stuttgart, en 1907, d'importantes différences d'attitude apparais-
sent au grand jour, à propos du colonialisme : certains proposent
de reconnaître le caractère inévitable des empires colonaiux, et
préconisent simplement des réformes améliorant le sort des « indi-
gènes », mais en restant dans le cadre de la domination coloniale.
Même Kaustky, pourtant représentant de la tendance de gauche à
Stuttgart, fait preuve, pour le moins, d'une grande prudence :
congrès d'Amsterdam, en 1904, le colonialisme trouve des parti-
sans, aussi bien chez les socialistes allemands, qu'anglais, hollan-
dais et belges. Puis, au congrès de l'Internationale socialiste de
Stuttgart, en 1907, d'importantes différences d'attitude apparais-
sent au grand jour, à propos du colonialisme : certains proposent
de reconnaître le caractère inévitable des empires colonaiux, et
préconisent simplement des réformes améliorant le sort des « indi-
gènes », mais en restant dans le cadre de la domination coloniale.
Même Kaustky, pourtant représentant de la tendance de gauche à
Stuttgart, fait preuve, pour le moins, d'une grande prudence :
« L'idée de l'émancipation des colonies est une espèce d'idée
limite qui nous montre une direction, mais n'est pas une propo-
sition pratique à l'application immédiate de laquelle HOUS devons
travailler 32 ».
limite qui nous montre une direction, mais n'est pas une propo-
sition pratique à l'application immédiate de laquelle HOUS devons
travailler 32 ».
La source théorique de la position colonialiste des partis sociaux-
démocrates était une déformation du marxisme : elle consistait
dans l'affirmation que le capitalisme étant historiquement iné-
vitable, tout ce qui servait au développement du capitalisme, tout
ce qui l'aidait à s'étendre au monde entier, était inévitable et même
devait être soutenu.
démocrates était une déformation du marxisme : elle consistait
dans l'affirmation que le capitalisme étant historiquement iné-
vitable, tout ce qui servait au développement du capitalisme, tout
ce qui l'aidait à s'étendre au monde entier, était inévitable et même
devait être soutenu.
Kautsky cautionnait cette idée, lorsqu'il déclarait : « quand la
production capitaliste entre en lutte avec les formes de production
arriérées, mais nous ne pouvons et ne devons pas lui dresser des
obstacles sur son chemin. »
production capitaliste entre en lutte avec les formes de production
arriérées, mais nous ne pouvons et ne devons pas lui dresser des
obstacles sur son chemin. »
2. Le deuxième point à noter, à propos de l'attitude des révi-
sionnistes à l'égard du livre de Rosa Luxemburg, est que ceux-ci,
et notamment Kaustky, estimaient que l'impérialisme, forme parti-
culière et violente de l'expansion, pratiquée seulement par de
petits groupes de capitalistes, les grandes banques et les militaires,
était contraire à l'intérêt de l'ensemble de la classe capitaliste. C'est
pourquoi, affirmait Kautsky, la majorité de la classe capitaliste
s'opposera toujours davantage à la politique de violence impéria-
liste, et s'en détournera de plus en plus. On voit à quel point cette
position est contraire à celle de Rosa Luxemburg, pour qui l'impéria-
lisme et la conquête des marchés extérieurs sont inhérents au capi-
talisme, et permettent son développement. C'est d'ailleurs en
sionnistes à l'égard du livre de Rosa Luxemburg, est que ceux-ci,
et notamment Kaustky, estimaient que l'impérialisme, forme parti-
culière et violente de l'expansion, pratiquée seulement par de
petits groupes de capitalistes, les grandes banques et les militaires,
était contraire à l'intérêt de l'ensemble de la classe capitaliste. C'est
pourquoi, affirmait Kautsky, la majorité de la classe capitaliste
s'opposera toujours davantage à la politique de violence impéria-
liste, et s'en détournera de plus en plus. On voit à quel point cette
position est contraire à celle de Rosa Luxemburg, pour qui l'impéria-
lisme et la conquête des marchés extérieurs sont inhérents au capi-
talisme, et permettent son développement. C'est d'ailleurs en
32. Cité in : T. KEMP, « Qu'est-ce que l'impérialisme ? ». Partisans,
décembre igôs-janvier 1964.
décembre igôs-janvier 1964.
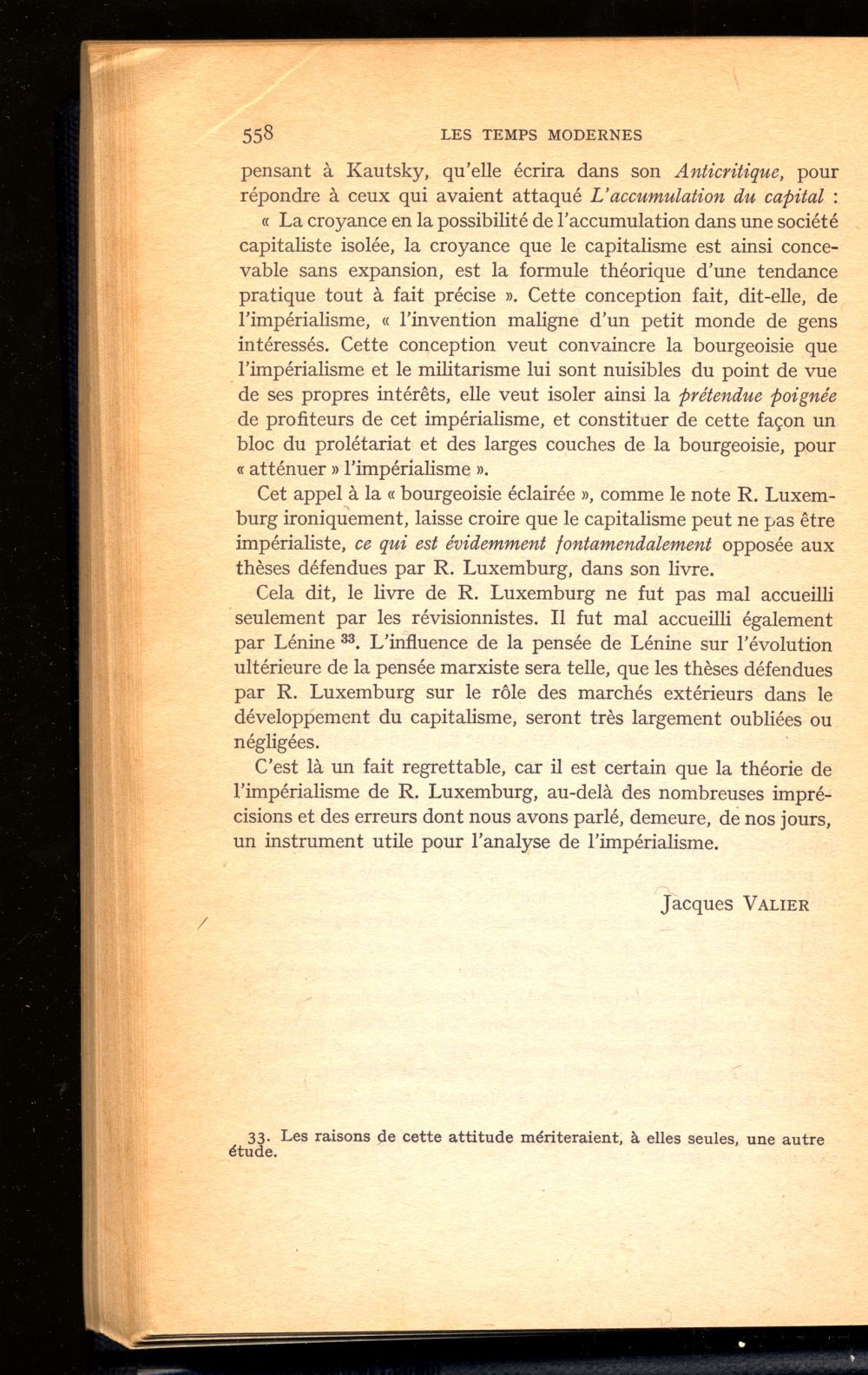

558 LES TEMPS MODERNES
pensant à Kautsky, qu'elle écrira dans son Anticritique, pour
répondre à ceux qui avaient attaqué L'accumulation du capital :
répondre à ceux qui avaient attaqué L'accumulation du capital :
« La croyance en la possibilité de l'accumulation dans une société
capitaliste isolée, la croyance que le capitalisme est ainsi conce-
vable sans expansion, est la formule théorique d'une tendance
pratique tout à fait précise ». Cette conception fait, dit-elle, de
l'impérialisme, « l'invention maligne d'un petit monde de gens
intéressés. Cette conception veut convaincre la bourgeoisie que
l'impérialisme et le militarisme lui sont nuisibles du point de vue
de ses propres intérêts, elle veut isoler ainsi la prétendue poignée
de profiteurs de cet impérialisme, et constituer de cette façon un
bloc du prolétariat et des larges couches de la bourgeoisie, pour
« atténuer » l'impérialisme ».
capitaliste isolée, la croyance que le capitalisme est ainsi conce-
vable sans expansion, est la formule théorique d'une tendance
pratique tout à fait précise ». Cette conception fait, dit-elle, de
l'impérialisme, « l'invention maligne d'un petit monde de gens
intéressés. Cette conception veut convaincre la bourgeoisie que
l'impérialisme et le militarisme lui sont nuisibles du point de vue
de ses propres intérêts, elle veut isoler ainsi la prétendue poignée
de profiteurs de cet impérialisme, et constituer de cette façon un
bloc du prolétariat et des larges couches de la bourgeoisie, pour
« atténuer » l'impérialisme ».
Cet appel à la « bourgeoisie éclairée », comme le note R. Luxem-
burg ironiquement, laisse croire que le capitalisme peut ne pas être
impérialiste, ce qui est évidemment fontamendalement opposée aux
thèses défendues par R. Luxemburg, dans son livre.
burg ironiquement, laisse croire que le capitalisme peut ne pas être
impérialiste, ce qui est évidemment fontamendalement opposée aux
thèses défendues par R. Luxemburg, dans son livre.
Cela dit, le livre de R. Luxemburg ne fut pas mal accueilli
seulement par les révisionnistes. Il fut mal accueilli également
par Lénine 33. L'influence de la pensée de Lénine sur l'évolution
ultérieure de la pensée marxiste sera telle, que les thèses défendues
par R. Luxemburg sur le rôle des marchés extérieurs dans le
développement du capitalisme, seront très largement oubliées ou
négligées.
seulement par les révisionnistes. Il fut mal accueilli également
par Lénine 33. L'influence de la pensée de Lénine sur l'évolution
ultérieure de la pensée marxiste sera telle, que les thèses défendues
par R. Luxemburg sur le rôle des marchés extérieurs dans le
développement du capitalisme, seront très largement oubliées ou
négligées.
C'est là un fait regrettable, car il est certain que la théorie de
l'impérialisme de R. Luxemburg, au-delà des nombreuses impré-
cisions et des erreurs dont nous avons parlé, demeure, de nos jours,
un instrument utile pour l'analyse de l'impérialisme.
l'impérialisme de R. Luxemburg, au-delà des nombreuses impré-
cisions et des erreurs dont nous avons parlé, demeure, de nos jours,
un instrument utile pour l'analyse de l'impérialisme.
Jacques VALIER
33. Les raisons de cette attitude mériteraient, à elles seules, une autre
étude.
étude.
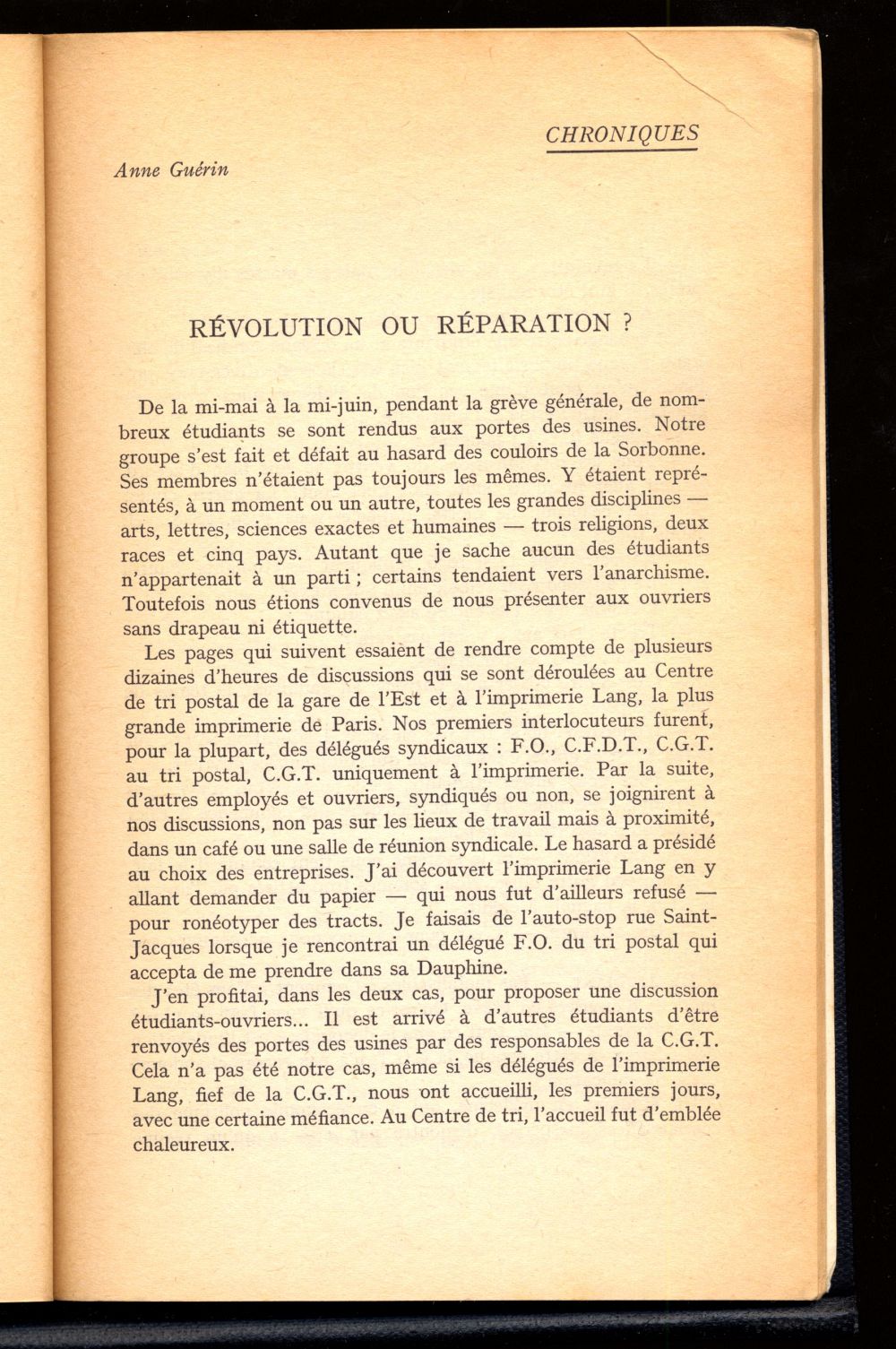

CHRONIQUES
Anne Guérin
RÉVOLUTION OU RÉPARATION ?
De la mi-mai à la mi-juin, pendant la grève générale, de nom-
breux étudiants se sont rendus aux portes des usines. Notre
groupe s'est fait et défait au hasard des couloirs de la Sorbonne.
Ses membres n'étaient pas toujours les mêmes. Y étaient repré-
sentés, à un moment ou un autre, toutes les grandes disciplines —
arts, lettres, sciences exactes et humaines — trois religions, deux
races et cinq pays. Autant que je sache aucun des étudiants
n'appartenait à un parti ; certains tendaient vers l'anarchisme.
Toutefois nous étions convenus de nous présenter aux ouvriers
sans drapeau ni étiquette.
breux étudiants se sont rendus aux portes des usines. Notre
groupe s'est fait et défait au hasard des couloirs de la Sorbonne.
Ses membres n'étaient pas toujours les mêmes. Y étaient repré-
sentés, à un moment ou un autre, toutes les grandes disciplines —
arts, lettres, sciences exactes et humaines — trois religions, deux
races et cinq pays. Autant que je sache aucun des étudiants
n'appartenait à un parti ; certains tendaient vers l'anarchisme.
Toutefois nous étions convenus de nous présenter aux ouvriers
sans drapeau ni étiquette.
Les pages qui suivent essaient de rendre compte de plusieurs
dizaines d'heures de discussions qui se sont déroulées au Centre
de tri postal de la gare de l'Est et à l'imprimerie Lang, la plus
grande imprimerie de Paris. Nos premiers interlocuteurs furent,
pour la plupart, des délégués syndicaux : F.O., C.F.D.T., C.G.T.
au tri postal, C.G.T. uniquement à l'imprimerie. Par la suite,
d'autres employés et ouvriers, syndiqués ou non, se joignirent à
nos discussions, non pas sur les lieux de travail mais à proximité,
dans un café ou une salle de réunion syndicale. Le hasard a présidé
au choix des entreprises. J'ai découvert l'imprimerie Lang en y
allant demander du papier —• qui nous fut d'ailleurs refusé —
pour ronéotyper des tracts. Je faisais de l'auto-stop rue Saint-
Jacques lorsque je rencontrai un délégué F.O. du tri postal qui
accepta de me prendre dans sa Dauphine.
dizaines d'heures de discussions qui se sont déroulées au Centre
de tri postal de la gare de l'Est et à l'imprimerie Lang, la plus
grande imprimerie de Paris. Nos premiers interlocuteurs furent,
pour la plupart, des délégués syndicaux : F.O., C.F.D.T., C.G.T.
au tri postal, C.G.T. uniquement à l'imprimerie. Par la suite,
d'autres employés et ouvriers, syndiqués ou non, se joignirent à
nos discussions, non pas sur les lieux de travail mais à proximité,
dans un café ou une salle de réunion syndicale. Le hasard a présidé
au choix des entreprises. J'ai découvert l'imprimerie Lang en y
allant demander du papier —• qui nous fut d'ailleurs refusé —
pour ronéotyper des tracts. Je faisais de l'auto-stop rue Saint-
Jacques lorsque je rencontrai un délégué F.O. du tri postal qui
accepta de me prendre dans sa Dauphine.
J'en profitai, dans les deux cas, pour proposer une discussion
étudiants-ouvriers... Il est arrivé à d'autres étudiants d'être
renvoyés des portes des usines par des responsables de la C.G.T.
Cela n'a pas été notre cas, même si les délégués de l'imprimerie
Lang, fief de la C.G.T., nous ont accueilli, les premiers jours,
avec une certaine méfiance. Au Centre de tri, l'accueil fut d'emblée
chaleureux.
étudiants-ouvriers... Il est arrivé à d'autres étudiants d'être
renvoyés des portes des usines par des responsables de la C.G.T.
Cela n'a pas été notre cas, même si les délégués de l'imprimerie
Lang, fief de la C.G.T., nous ont accueilli, les premiers jours,
avec une certaine méfiance. Au Centre de tri, l'accueil fut d'emblée
chaleureux.
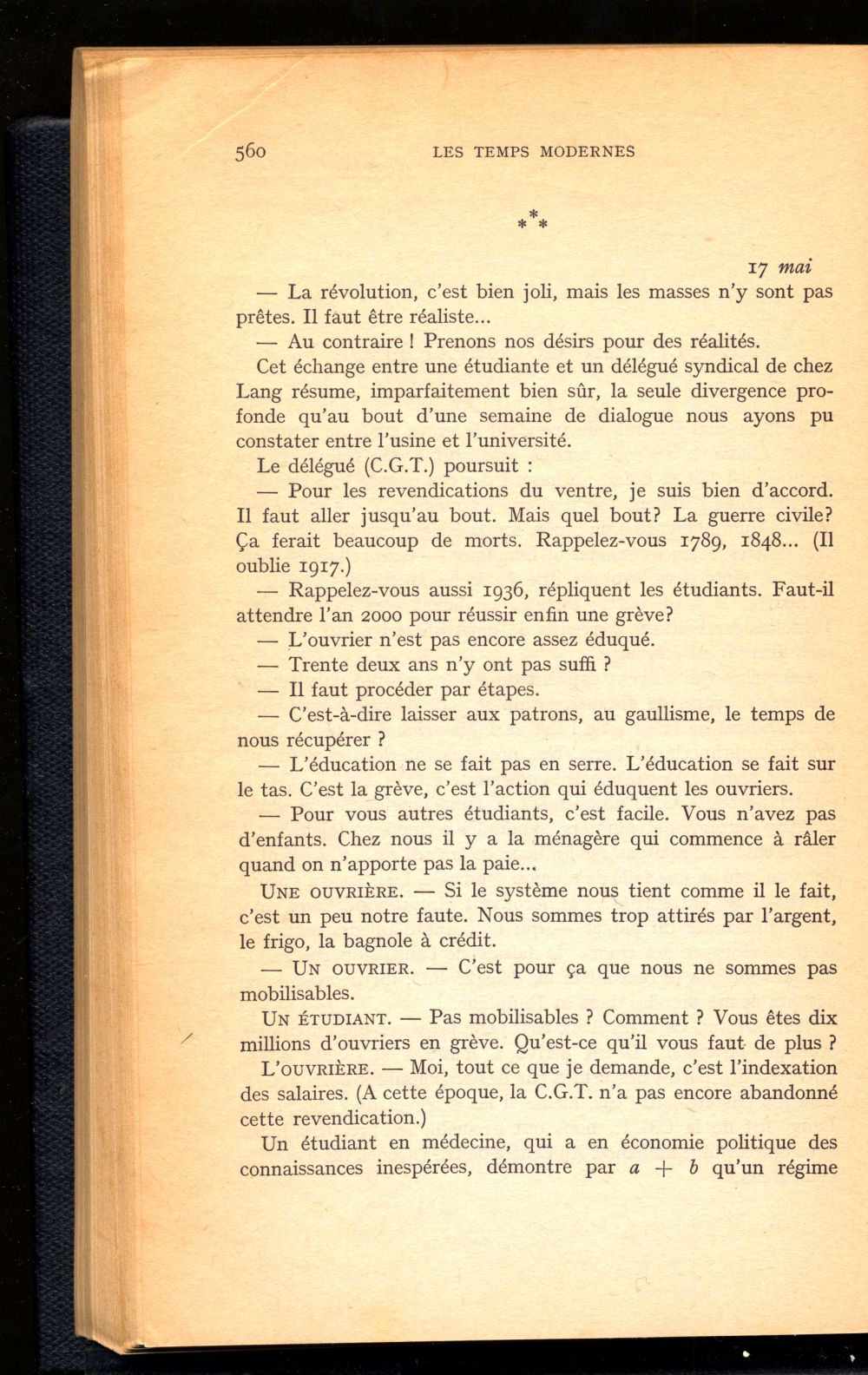

560
LES TEMPS MODERNES
*
* #
* #
17 mai
— La révolution, c'est bien joli, mais les masses n'y sont pas
prêtes. Il faut être réaliste...
prêtes. Il faut être réaliste...
— Au contraire ! Prenons nos désirs pour des réalités.
Cet échange entre une étudiante et un délégué syndical de chez
Lang résume, imparfaitement bien sûr, la seule divergence pro-
fonde qu'au bout d'une semaine de dialogue nous ayons pu
constater entre l'usine et l'université.
Lang résume, imparfaitement bien sûr, la seule divergence pro-
fonde qu'au bout d'une semaine de dialogue nous ayons pu
constater entre l'usine et l'université.
Le délégué (C.G.T.) poursuit :
— Pour les revendications du ventre, je suis bien d'accord.
Il faut aller jusqu'au bout. Mais quel bout? La guerre civile?
Ça ferait beaucoup de morts. Rappelez-vous 1789, 1848... (Il
oublie 1917.)
Il faut aller jusqu'au bout. Mais quel bout? La guerre civile?
Ça ferait beaucoup de morts. Rappelez-vous 1789, 1848... (Il
oublie 1917.)
— Rappelez-vous aussi 1936, répliquent les étudiants. Faut-il
attendre l'an 2000 pour réussir enfin une grève?
attendre l'an 2000 pour réussir enfin une grève?
— L'ouvrier n'est pas encore assez éduqué.
— Trente deux ans n'y ont pas suffi ?
•— II faut procéder par étapes.
•— II faut procéder par étapes.
— C'est-à-dire laisser aux patrons, au gaullisme, le temps de
nous récupérer ?
nous récupérer ?
— L'éducation ne se fait pas en serre. L'éducation se fait sur
le tas. C'est la grève, c'est l'action qui éduquent les ouvriers.
le tas. C'est la grève, c'est l'action qui éduquent les ouvriers.
— Pour vous autres étudiants, c'est facile. Vous n'avez pas
d'enfants. Chez nous il y a la ménagère qui commence à râler
quand on n'apporte pas la paie...
d'enfants. Chez nous il y a la ménagère qui commence à râler
quand on n'apporte pas la paie...
UNE OUVRIÈRE. •— Si le système nous tient comme il le fait,
c'est un peu notre faute. Nous sommes trop attirés par l'argent,
le frigo, la bagnole à crédit.
c'est un peu notre faute. Nous sommes trop attirés par l'argent,
le frigo, la bagnole à crédit.
— UN OUVRIER. — C'est pour ça que nous ne sommes pas
mobilisables.
mobilisables.
UN ÉTUDIANT. — Pas mobilisables ? Comment ? Vous êtes dix
millions d'ouvriers en grève. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
millions d'ouvriers en grève. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ?
L'OUVRIÈRE. — Moi, tout ce que je demande, c'est l'indexation
des salaires. (A cette époque, la C.G.T. n'a pas encore abandonné
cette revendication.)
des salaires. (A cette époque, la C.G.T. n'a pas encore abandonné
cette revendication.)
Un étudiant en médecine, qui a en économie politique des
connaissances inespérées, démontre par a -J- b qu'un régime
connaissances inespérées, démontre par a -J- b qu'un régime
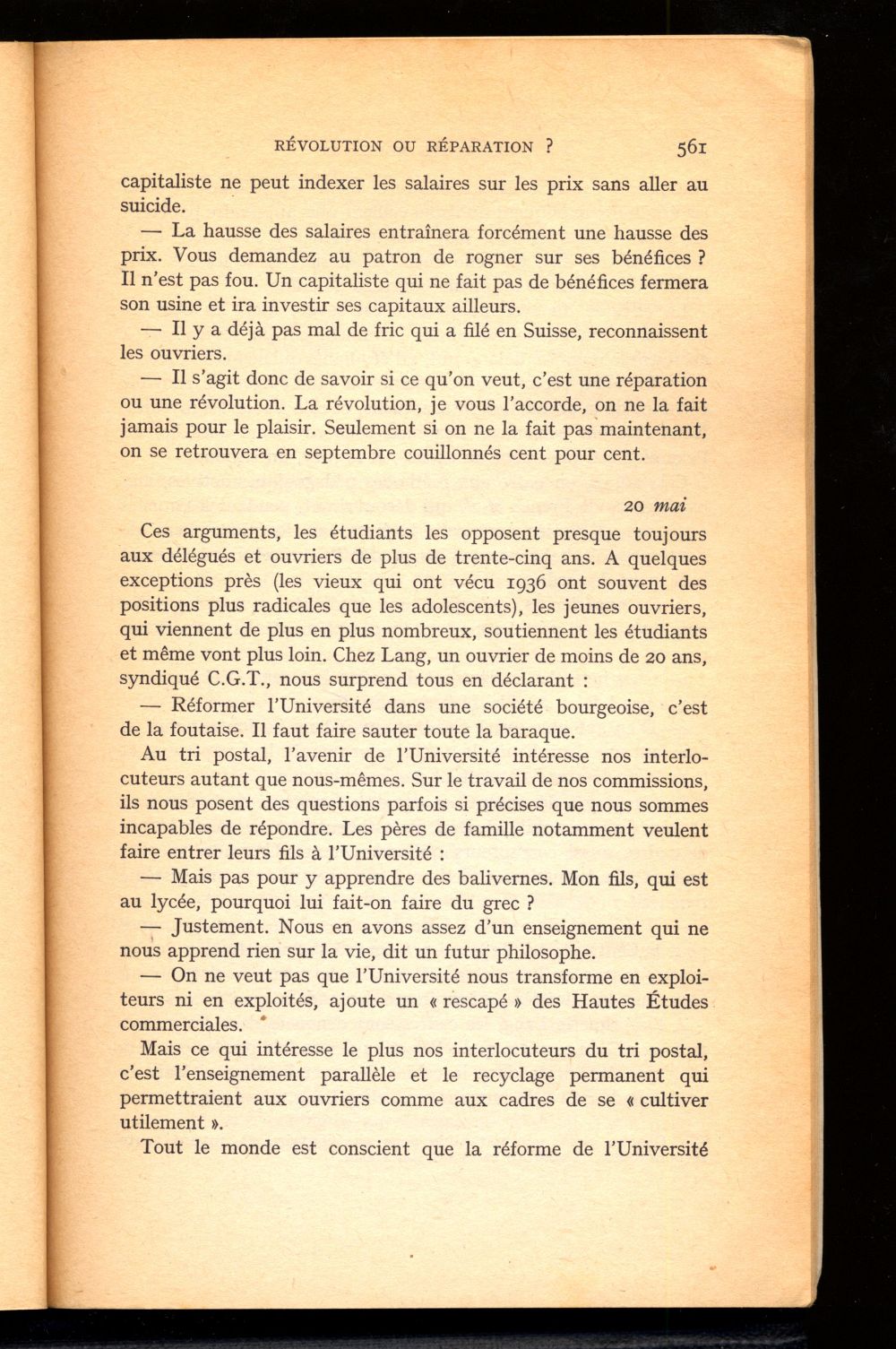

RÉVOLUTION OU RÉPARATION ?
56i
capitaliste ne peut indexer les salaires sur les prix sans aller au
suicide.
suicide.
— La hausse des salaires entraînera forcément une hausse des
prix. Vous demandez au patron de rogner sur ses bénéfices ?
Il n'est pas fou. Un capitaliste qui ne fait pas de bénéfices fermera
son usine et ira investir ses capitaux ailleurs.
prix. Vous demandez au patron de rogner sur ses bénéfices ?
Il n'est pas fou. Un capitaliste qui ne fait pas de bénéfices fermera
son usine et ira investir ses capitaux ailleurs.
— Il y a déjà pas mal de fric qui a filé en Suisse, reconnaissent
les ouvriers.
les ouvriers.
— Il s'agit donc de savoir si ce qu'on veut, c'est une réparation
ou une révolution. La révolution, je vous l'accorde, on ne la fait
jamais pour le plaisir. Seulement si on ne la fait pas maintenant,
on se retrouvera en septembre couillonnés cent pour cent.
ou une révolution. La révolution, je vous l'accorde, on ne la fait
jamais pour le plaisir. Seulement si on ne la fait pas maintenant,
on se retrouvera en septembre couillonnés cent pour cent.
20 mai
Ces arguments, les étudiants les opposent presque toujours
aux délégués et ouvriers de plus de trente-cinq ans. A quelques
exceptions près (les vieux qui ont vécu 1936 ont souvent des
positions plus radicales que les adolescents), les jeunes ouvriers,
qui viennent de plus en plus nombreux, soutiennent les étudiants
et même vont plus loin. Chez Lang, un ouvrier de moins de 20 ans,
syndiqué C.G.T., nous surprend tous en déclarant :
aux délégués et ouvriers de plus de trente-cinq ans. A quelques
exceptions près (les vieux qui ont vécu 1936 ont souvent des
positions plus radicales que les adolescents), les jeunes ouvriers,
qui viennent de plus en plus nombreux, soutiennent les étudiants
et même vont plus loin. Chez Lang, un ouvrier de moins de 20 ans,
syndiqué C.G.T., nous surprend tous en déclarant :
— Réformer l'Université dans une société bourgeoise, c'est
de la foutaise. Il faut faire sauter toute la baraque.
de la foutaise. Il faut faire sauter toute la baraque.
Au tri postal, l'avenir de l'Université intéresse nos interlo-
cuteurs autant que nous-mêmes. Sur le travail de nos commissions,
ils nous posent des questions parfois si précises que nous sommes
incapables de répondre. Les pères de famille notamment veulent
faire entrer leurs fils à l'Université :
cuteurs autant que nous-mêmes. Sur le travail de nos commissions,
ils nous posent des questions parfois si précises que nous sommes
incapables de répondre. Les pères de famille notamment veulent
faire entrer leurs fils à l'Université :
— Mais pas pour y apprendre des balivernes. Mon fils, qui est
au lycée, pourquoi lui fait-on faire du grec ?
au lycée, pourquoi lui fait-on faire du grec ?
— Justement. Nous en avons assez d'un enseignement qui ne
nous apprend rien sur la vie, dit un futur philosophe.
nous apprend rien sur la vie, dit un futur philosophe.
— On ne veut pas que l'Université nous transforme en exploi-
teurs ni en exploités, ajoute un « rescapé » des Hautes Études
commerciales.
teurs ni en exploités, ajoute un « rescapé » des Hautes Études
commerciales.
Mais ce qui intéresse le plus nos interlocuteurs du tri postal,
c'est l'enseignement parallèle et le recyclage permanent qui
permettraient aux ouvriers comme aux cadres de se « cultiver
utilement ».
c'est l'enseignement parallèle et le recyclage permanent qui
permettraient aux ouvriers comme aux cadres de se « cultiver
utilement ».
Tout le monde est conscient que la réforme de l'Université
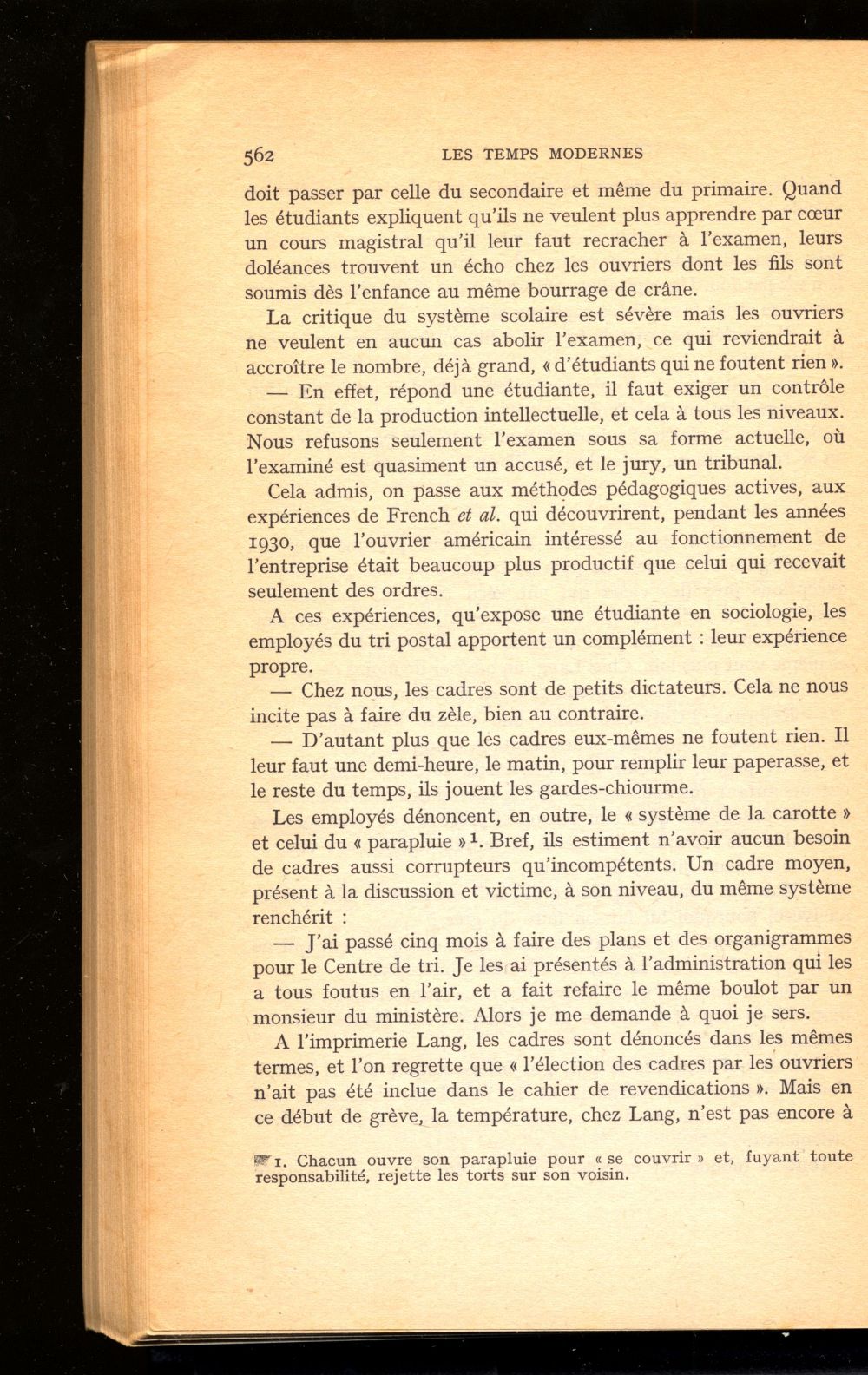

502
LES TEMPS MODERNES
doit passer par celle du secondaire et même du primaire. Quand
les étudiants expliquent qu'ils ne veulent plus apprendre par cœur
un cours magistral qu'il leur faut recracher à l'examen, leurs
doléances trouvent un écho chez les ouvriers dont les fils sont
soumis dès l'enfance au même bourrage de crâne.
les étudiants expliquent qu'ils ne veulent plus apprendre par cœur
un cours magistral qu'il leur faut recracher à l'examen, leurs
doléances trouvent un écho chez les ouvriers dont les fils sont
soumis dès l'enfance au même bourrage de crâne.
La critique du système scolaire est sévère mais les ouvriers
ne veulent en aucun cas abolir l'examen, ce qui reviendrait à
accroître le nombre, déjà grand, « d'étudiants qui ne foutent rien ».
ne veulent en aucun cas abolir l'examen, ce qui reviendrait à
accroître le nombre, déjà grand, « d'étudiants qui ne foutent rien ».
— En effet, répond une étudiante, il faut exiger un contrôle
constant de la production intellectuelle, et cela à tous les niveaux.
Nous refusons seulement l'examen sous sa forme actuelle, où
l'examiné est quasiment un accusé, et le jury, un tribunal.
constant de la production intellectuelle, et cela à tous les niveaux.
Nous refusons seulement l'examen sous sa forme actuelle, où
l'examiné est quasiment un accusé, et le jury, un tribunal.
Cela admis, on passe aux méthodes pédagogiques actives, aux
expériences de French et al. qui découvrirent, pendant les années
1930, que l'ouvrier américain intéressé au fonctionnement de
l'entreprise était beaucoup plus productif que celui qui recevait
seulement des ordres.
expériences de French et al. qui découvrirent, pendant les années
1930, que l'ouvrier américain intéressé au fonctionnement de
l'entreprise était beaucoup plus productif que celui qui recevait
seulement des ordres.
A ces expériences, qu'exposé une étudiante en sociologie, les
employés du tri postal apportent un complément : leur expérience
propre.
employés du tri postal apportent un complément : leur expérience
propre.
— Chez nous, les cadres sont de petits dictateurs. Cela ne nous
incite pas à faire du zèle, bien au contraire.
incite pas à faire du zèle, bien au contraire.
— D'autant plus que les cadres eux-mêmes ne foutent rien. Il
leur faut une demi-heure, le matin, pour remplir leur paperasse, et
le reste du temps, ils jouent les gardes-chiourme.
leur faut une demi-heure, le matin, pour remplir leur paperasse, et
le reste du temps, ils jouent les gardes-chiourme.
Les employés dénoncent, en outre, le « système de la carotte »
et celui du « parapluie »1. Bref, ils estiment n'avoir aucun besoin
de cadres aussi corrupteurs qu'incompétents. Un cadre moyen,
présent à la discussion et victime, à son niveau, du même système
renchérit :
et celui du « parapluie »1. Bref, ils estiment n'avoir aucun besoin
de cadres aussi corrupteurs qu'incompétents. Un cadre moyen,
présent à la discussion et victime, à son niveau, du même système
renchérit :
— J'ai passé cinq mois à faire des plans et des organigrammes
pour le Centre de tri. Je les ai présentés à l'administration qui les
a tous foutus en l'air, et a fait refaire le même boulot par un
monsieur du ministère. Alors je me demande à quoi je sers.
pour le Centre de tri. Je les ai présentés à l'administration qui les
a tous foutus en l'air, et a fait refaire le même boulot par un
monsieur du ministère. Alors je me demande à quoi je sers.
A l'imprimerie Lang, les cadres sont dénoncés dans les mêmes
termes, et l'on regrette que « l'élection des cadres par les ouvriers
n'ait pas été inclue dans le cahier de revendications ». Mais en
ce début de grève, la température, chez Lang, n'est pas encore à
termes, et l'on regrette que « l'élection des cadres par les ouvriers
n'ait pas été inclue dans le cahier de revendications ». Mais en
ce début de grève, la température, chez Lang, n'est pas encore à
>3ri. Chacun ouvre son parapluie pour «se couvrir:
responsabilité, rejette les torts sur son voisin.
responsabilité, rejette les torts sur son voisin.
et, fuyant toute


RÉVOLUTION OU RÉPARATION ?
563
l'ébullition et les étudiants, cernés par les délégués C.G.T., n'osent
pas lancer dans la mare le pavé de l'autogestion. Au tri postal,
par contre, et dès le premier jour, l'exposé sur Freynet (fait par
une future psychologue) et le réquisitoire des cadres (fait par les
employés) débouchent tout naturellement sur l'idée 'd'auto-gestion.
Les étudiants. — Si l'on admet que l'élève apprend mieux et
plus vite quand il se sent concerné par ce qu'il apprend, on peut
admettre que les ouvriers peuvent faire marcher la boîte au moins
aussi bien que le patron et ses cadres s'ils décident d'en prendre la
responsabilité.
pas lancer dans la mare le pavé de l'autogestion. Au tri postal,
par contre, et dès le premier jour, l'exposé sur Freynet (fait par
une future psychologue) et le réquisitoire des cadres (fait par les
employés) débouchent tout naturellement sur l'idée 'd'auto-gestion.
Les étudiants. — Si l'on admet que l'élève apprend mieux et
plus vite quand il se sent concerné par ce qu'il apprend, on peut
admettre que les ouvriers peuvent faire marcher la boîte au moins
aussi bien que le patron et ses cadres s'ils décident d'en prendre la
responsabilité.
25 mai
L'idée d'autogestion se heurte moins à l'hostilité des employés
qu'à une ignorance générale. Au tri postal, un jeune cheminot,
militant C.G.T., qui se trouve là « par solidarité avec les postiers »,
raconte qu'il connaît une usine « où l'autogestion a été instituée
par le patron ». C'est pourquoi, dit-il, « l'autogestion ne défend
pas les ouvriers ».
qu'à une ignorance générale. Au tri postal, un jeune cheminot,
militant C.G.T., qui se trouve là « par solidarité avec les postiers »,
raconte qu'il connaît une usine « où l'autogestion a été instituée
par le patron ». C'est pourquoi, dit-il, « l'autogestion ne défend
pas les ouvriers ».
Quelqu'un d'autre assimile l'autogestion à la participation
gaulliste ; un troisième croit qu'il y a opposition entre la « gestion
directe » qu'il réclame et l'autogestion dont parlent les étudiants.
Ceux-ci réclament, en outre, « des élus révocables » et « la fin des
hiérarchies ». Le délégué F.O. vitupère : « tout ça, c'est de l'anar-
chie ».
gaulliste ; un troisième croit qu'il y a opposition entre la « gestion
directe » qu'il réclame et l'autogestion dont parlent les étudiants.
Ceux-ci réclament, en outre, « des élus révocables » et « la fin des
hiérarchies ». Le délégué F.O. vitupère : « tout ça, c'est de l'anar-
chie ».
— Pas du tout, c'est de la discipline librement consentie.
A l'exception d'un étudiant-poète qui se met en devoir d'expli-
quer « comment l'autogestion fonctionne à Cuba » (où précisé-
ment elle ne fonctionne pas), notre équipe s'avère, en gros, capable
d'exposer les grands principes de l'autogestion. Cependant les
points de repère historiques font défaut, et les définitions restent
floues.
quer « comment l'autogestion fonctionne à Cuba » (où précisé-
ment elle ne fonctionne pas), notre équipe s'avère, en gros, capable
d'exposer les grands principes de l'autogestion. Cependant les
points de repère historiques font défaut, et les définitions restent
floues.
Les employés, eux, font des réserves qui portent cette fois moins
sur le principe que sur la viabilité de l'autogestion. L'autogestion
« par ilôts » au sein d'une société capitaliste paraît utopique, mais
une société « entièrement autogérée » ne le paraît pas moins.
Cependant l'idée fait son chemin dans l'esprit des plus jeunes, et
cela pour deux raisons :
sur le principe que sur la viabilité de l'autogestion. L'autogestion
« par ilôts » au sein d'une société capitaliste paraît utopique, mais
une société « entièrement autogérée » ne le paraît pas moins.
Cependant l'idée fait son chemin dans l'esprit des plus jeunes, et
cela pour deux raisons :
Au tri postal comme chez Lang, nombreux sont les travailleurs
qui ne font plus confiance au réformisme syndical d'une part,
aux nationalisations d'autre part :
qui ne font plus confiance au réformisme syndical d'une part,
aux nationalisations d'autre part :
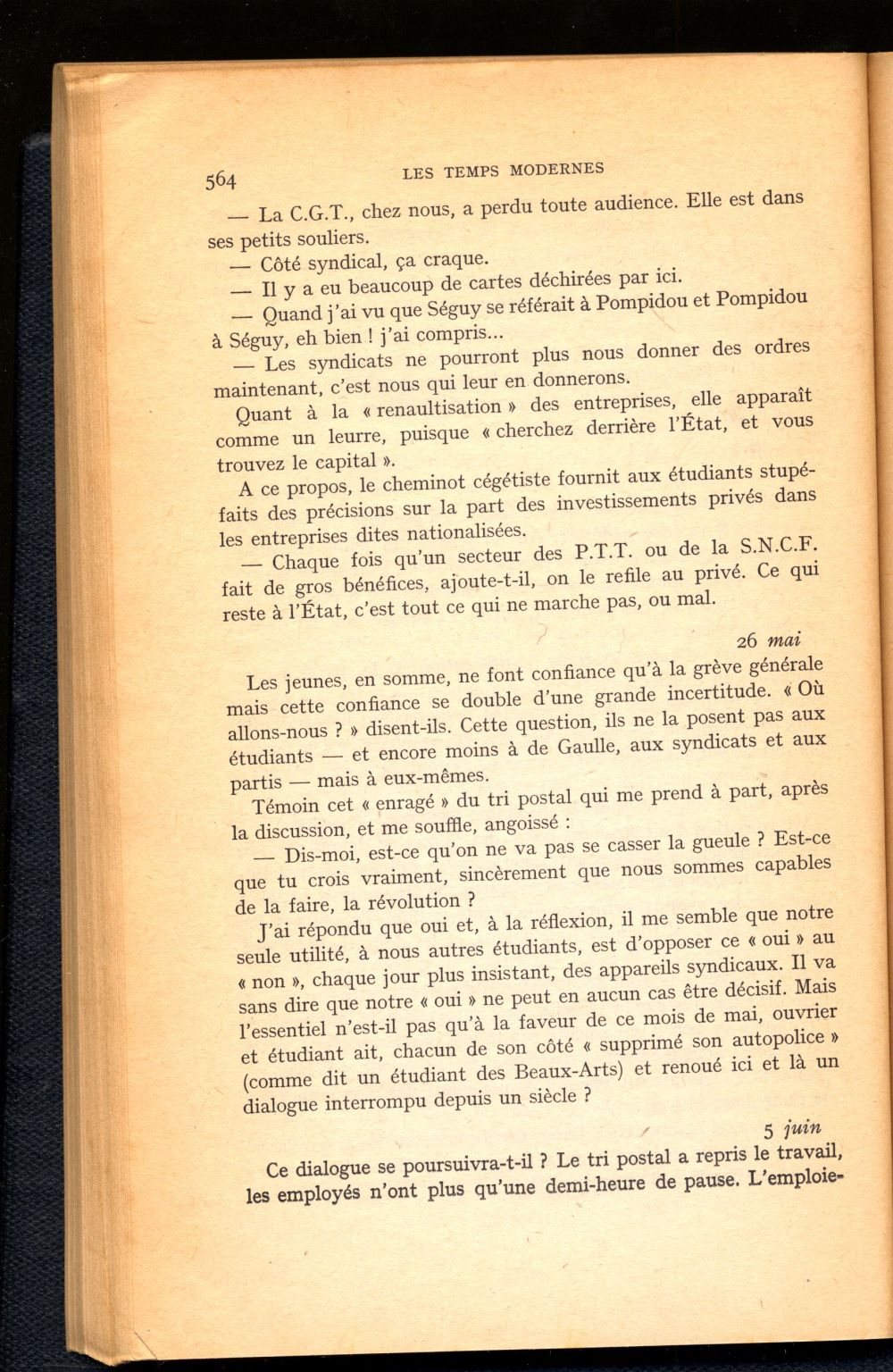

564
LES TEMPS MODERNES
— La C.G.T., chez nous, a perdu toute audience. Elle est dans
ses petits souliers.
ses petits souliers.
— Côté syndical, ça craque.
— Il y a eu beaucoup de cartes déchirées par ici.
— Quand j'ai vu que Séguy se référait à Pompidou et Pompidou
à Séguy, eh bien ! j'ai compris...
à Séguy, eh bien ! j'ai compris...
— Les syndicats ne pourront plus nous donner des ordres
maintenant, c'est nous qui leur en donnerons.
maintenant, c'est nous qui leur en donnerons.
Quant à la « renaultisation » des entreprises, elle apparaît
comme un leurre, puisque « cherchez derrière l'État, et vous
trouvez le capital ».
comme un leurre, puisque « cherchez derrière l'État, et vous
trouvez le capital ».
A ce propos, le cheminot cégétiste fournit aux étudiants stupé-
faits des précisions sur la part des investissements privés dans
les entreprises dites nationalisées.
faits des précisions sur la part des investissements privés dans
les entreprises dites nationalisées.
— Chaque fois qu'un secteur des P.T.T. ou de la S.N.C.F.
fait de gros bénéfices, ajoute-t-il, on le refile au privé. Ce qui
reste à l'État, c'est tout ce qui ne marche pas, ou mal.
fait de gros bénéfices, ajoute-t-il, on le refile au privé. Ce qui
reste à l'État, c'est tout ce qui ne marche pas, ou mal.
26 mai
Les jeunes, en somme, ne font confiance qu'à la grève générale
mais cette confiance se double d'une grande incertitude. « Où
allons-nous ? » disent-ils. Cette question, ils ne la posent pas aux
étudiants — et encore moins à de Gaulle, aux syndicats et aux
partis — mais à eux-mêmes.
mais cette confiance se double d'une grande incertitude. « Où
allons-nous ? » disent-ils. Cette question, ils ne la posent pas aux
étudiants — et encore moins à de Gaulle, aux syndicats et aux
partis — mais à eux-mêmes.
Témoin cet « enragé » du tri postal qui me prend à part, après
la discussion, et me souffle, angoissé :
la discussion, et me souffle, angoissé :
— Dis-moi, est-ce qu'on ne va pas se casser la gueule ? Est-ce
que tu crois vraiment, sincèrement que nous sommes capables
de la faire, la révolution ?
que tu crois vraiment, sincèrement que nous sommes capables
de la faire, la révolution ?
J'ai répondu que oui et, à la réflexion, il me semble que notre
seule utilité, à nous autres étudiants, est d'opposer ce « oui » au
« non », chaque jour plus insistant, des appareils syndicaux. Il va
sans dire que notre « oui » ne peut en aucun cas être décisif. Mais
l'essentiel n'est-il pas qu'à la faveur de ce mois de mai, ouvrier
et étudiant ait, chacun de son côté « supprimé son autopolice »
(comme dit un étudiant des Beaux-Arts) et renoué ici et là un
dialogue interrompu depuis un siècle ?
seule utilité, à nous autres étudiants, est d'opposer ce « oui » au
« non », chaque jour plus insistant, des appareils syndicaux. Il va
sans dire que notre « oui » ne peut en aucun cas être décisif. Mais
l'essentiel n'est-il pas qu'à la faveur de ce mois de mai, ouvrier
et étudiant ait, chacun de son côté « supprimé son autopolice »
(comme dit un étudiant des Beaux-Arts) et renoué ici et là un
dialogue interrompu depuis un siècle ?
5 juin
Ce dialogue se poursuivra-t-il ? Le tri postal a repris le travail,
les employés n'ont plus qu'une demi-heure de pause. L'emploie-
les employés n'ont plus qu'une demi-heure de pause. L'emploie-
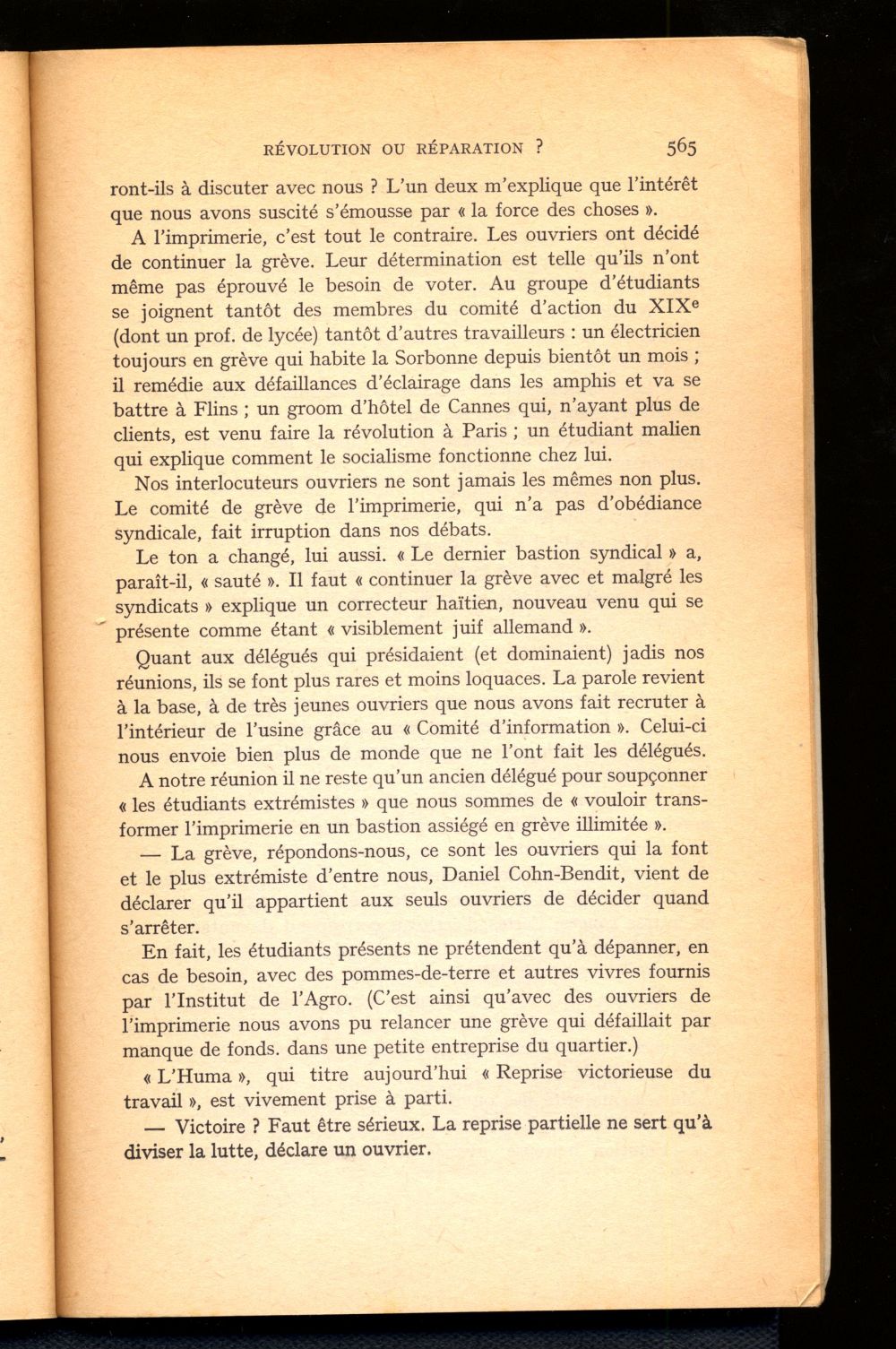

RÉVOLUTION OU RÉPARATION ?
565
ront-ils à discuter avec nous ? L'un deux m'explique que l'intérêt
que nous avons suscité s'émousse par « la force des choses ».
que nous avons suscité s'émousse par « la force des choses ».
A l'imprimerie, c'est tout le contraire. Les ouvriers ont décidé
de continuer la grève. Leur détermination est telle qu'ils n'ont
même pas éprouvé le besoin de voter. Au groupe d'étudiants
se joignent tantôt des membres du comité d'action du XIXe
(dont un prof, de lycée) tantôt d'autres travailleurs : un électricien
toujours en grève qui habite la Sorbonne depuis bientôt un mois ;
il remédie aux défaillances d'éclairage dans les amphis et va se
battre à Flins ; un groom d'hôtel de Cannes qui, n'ayant plus de
clients, est venu faire la révolution à Paris ; un étudiant malien
qui explique comment le socialisme fonctionne chez lui.
de continuer la grève. Leur détermination est telle qu'ils n'ont
même pas éprouvé le besoin de voter. Au groupe d'étudiants
se joignent tantôt des membres du comité d'action du XIXe
(dont un prof, de lycée) tantôt d'autres travailleurs : un électricien
toujours en grève qui habite la Sorbonne depuis bientôt un mois ;
il remédie aux défaillances d'éclairage dans les amphis et va se
battre à Flins ; un groom d'hôtel de Cannes qui, n'ayant plus de
clients, est venu faire la révolution à Paris ; un étudiant malien
qui explique comment le socialisme fonctionne chez lui.
Nos interlocuteurs ouvriers ne sont jamais les mêmes non plus.
Le comité de grève de l'imprimerie, qui n'a pas d'obédiance
syndicale, fait irruption dans nos débats.
Le comité de grève de l'imprimerie, qui n'a pas d'obédiance
syndicale, fait irruption dans nos débats.
Le ton a changé, lui aussi. « Le dernier bastion syndical » a,
paraît-il, « sauté ». Il faut « continuer la grève avec et malgré les
syndicats » explique un correcteur haïtien, nouveau venu qui se
présente comme étant « visiblement juif allemand ».
paraît-il, « sauté ». Il faut « continuer la grève avec et malgré les
syndicats » explique un correcteur haïtien, nouveau venu qui se
présente comme étant « visiblement juif allemand ».
Quant aux délégués qui présidaient (et dominaient) jadis nos
réunions, ils se font plus rares et moins loquaces. La parole revient
à la base, à de très jeunes ouvriers que nous avons fait recruter à
l'intérieur de l'usine grâce au « Comité d'information ». Celui-ci
nous envoie bien plus de monde que ne l'ont fait les délégués.
réunions, ils se font plus rares et moins loquaces. La parole revient
à la base, à de très jeunes ouvriers que nous avons fait recruter à
l'intérieur de l'usine grâce au « Comité d'information ». Celui-ci
nous envoie bien plus de monde que ne l'ont fait les délégués.
A notre réunion il ne reste qu'un ancien délégué pour soupçonner
« les étudiants extrémistes » que nous sommes de « vouloir trans-
former l'imprimerie en un bastion assiégé en grève illimitée ».
« les étudiants extrémistes » que nous sommes de « vouloir trans-
former l'imprimerie en un bastion assiégé en grève illimitée ».
— La grève, répondons-nous, ce sont les ouvriers qui la font
et le plus extrémiste d'entre nous, Daniel Cohn-Bendit, vient de
déclarer qu'il appartient aux seuls ouvriers de décider quand
s'arrêter.
et le plus extrémiste d'entre nous, Daniel Cohn-Bendit, vient de
déclarer qu'il appartient aux seuls ouvriers de décider quand
s'arrêter.
En fait, les étudiants présents ne prétendent qu'à dépanner, en
cas de besoin, avec des pommes-de-terre et autres vivres fournis
par l'Institut de l'Agro. (C'est ainsi qu'avec des ouvriers de
l'imprimerie nous avons pu relancer une grève qui défaillait par
manque de fonds, dans une petite entreprise du quartier.)
cas de besoin, avec des pommes-de-terre et autres vivres fournis
par l'Institut de l'Agro. (C'est ainsi qu'avec des ouvriers de
l'imprimerie nous avons pu relancer une grève qui défaillait par
manque de fonds, dans une petite entreprise du quartier.)
« L'Huma », qui titre aujourd'hui « Reprise victorieuse du
travail », est vivement prise à parti.
travail », est vivement prise à parti.
— Victoire ? Faut être sérieux. La reprise partielle ne sert qu'à
diviser la lutte, déclare un ouvrier.
diviser la lutte, déclare un ouvrier.
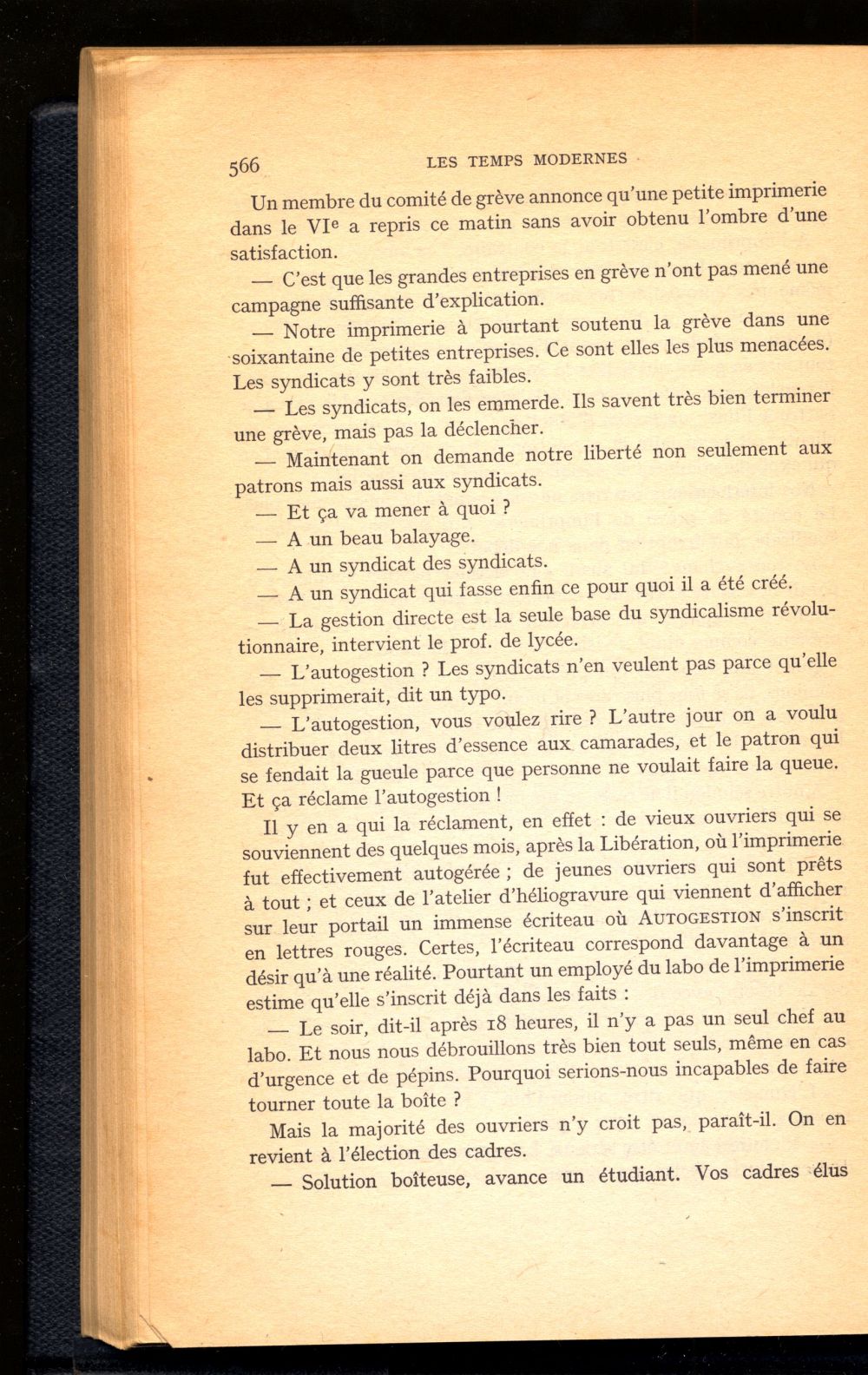

566
LES TEMPS MODERNES
Un membre du comité de grève annonce qu'une petite imprimerie
dans le VIe a repris ce matin sans avoir obtenu l'ombre d'une
satisfaction.
dans le VIe a repris ce matin sans avoir obtenu l'ombre d'une
satisfaction.
— C'est que les grandes entreprises en grève n'ont pas mené une
campagne suffisante d'explication.
campagne suffisante d'explication.
— Notre imprimerie à pourtant soutenu la grève dans une
soixantaine de petites entreprises. Ce sont elles les plus menacées.
Les syndicats y sont très faibles.
soixantaine de petites entreprises. Ce sont elles les plus menacées.
Les syndicats y sont très faibles.
— Les syndicats, on les emmerde. Ils savent très bien terminer
une grève, mais pas la déclencher.
une grève, mais pas la déclencher.
— Maintenant on demande notre liberté non seulement aux
patrons mais aussi aux syndicats.
patrons mais aussi aux syndicats.
— Et ça va mener à quoi ?
— A un beau balayage.
— A un syndicat des syndicats.
— A un syndicat qui fasse enfin ce pour quoi il a été créé.
— La gestion directe est la seule base du syndicalisme révolu-
tionnaire, intervient le prof, de lycée.
tionnaire, intervient le prof, de lycée.
— L'autogestion ? Les syndicats n'en veulent pas parce qu'elle
les supprimerait, dit un typo.
les supprimerait, dit un typo.
— L'autogestion, vous voulez rire ? L'autre jour on a voulu
distribuer deux litres d'essence aux camarades, et le patron qui
se fendait la gueule parce que personne ne voulait faire la queue.
Et ça réclame l'autogestion !
distribuer deux litres d'essence aux camarades, et le patron qui
se fendait la gueule parce que personne ne voulait faire la queue.
Et ça réclame l'autogestion !
Il y en a qui la réclament, en effet : de vieux ouvriers qui se
souviennent des quelques mois, après la Libération, où l'imprimerie
fut effectivement autogérée ; de jeunes ouvriers qui sont prêts
à tout ; et ceux de l'atelier d'héliogravure qui viennent d'afficher
sur leur portail un immense écriteau où AUTOGESTION s'inscrit
en lettres rouges. Certes, l'écriteau correspond davantage à un
désir qu'à une réalité. Pourtant un employé du labo de l'imprimerie
estime qu'elle s'inscrit déjà dans les faits :
souviennent des quelques mois, après la Libération, où l'imprimerie
fut effectivement autogérée ; de jeunes ouvriers qui sont prêts
à tout ; et ceux de l'atelier d'héliogravure qui viennent d'afficher
sur leur portail un immense écriteau où AUTOGESTION s'inscrit
en lettres rouges. Certes, l'écriteau correspond davantage à un
désir qu'à une réalité. Pourtant un employé du labo de l'imprimerie
estime qu'elle s'inscrit déjà dans les faits :
— Le soir, dit-il après 18 heures, il n'y a pas un seul chef au
labo. Et nous nous débrouillons très bien tout seuls, même en cas
d'urgence et de pépins. Pourquoi serions-nous incapables de faire
tourner toute la boîte ?
labo. Et nous nous débrouillons très bien tout seuls, même en cas
d'urgence et de pépins. Pourquoi serions-nous incapables de faire
tourner toute la boîte ?
Mais la majorité des ouvriers n'y croit pas, paraît-il. On en
revient à l'élection des cadres.
revient à l'élection des cadres.
— Solution boiteuse, avance un étudiant. Vos cadres élus
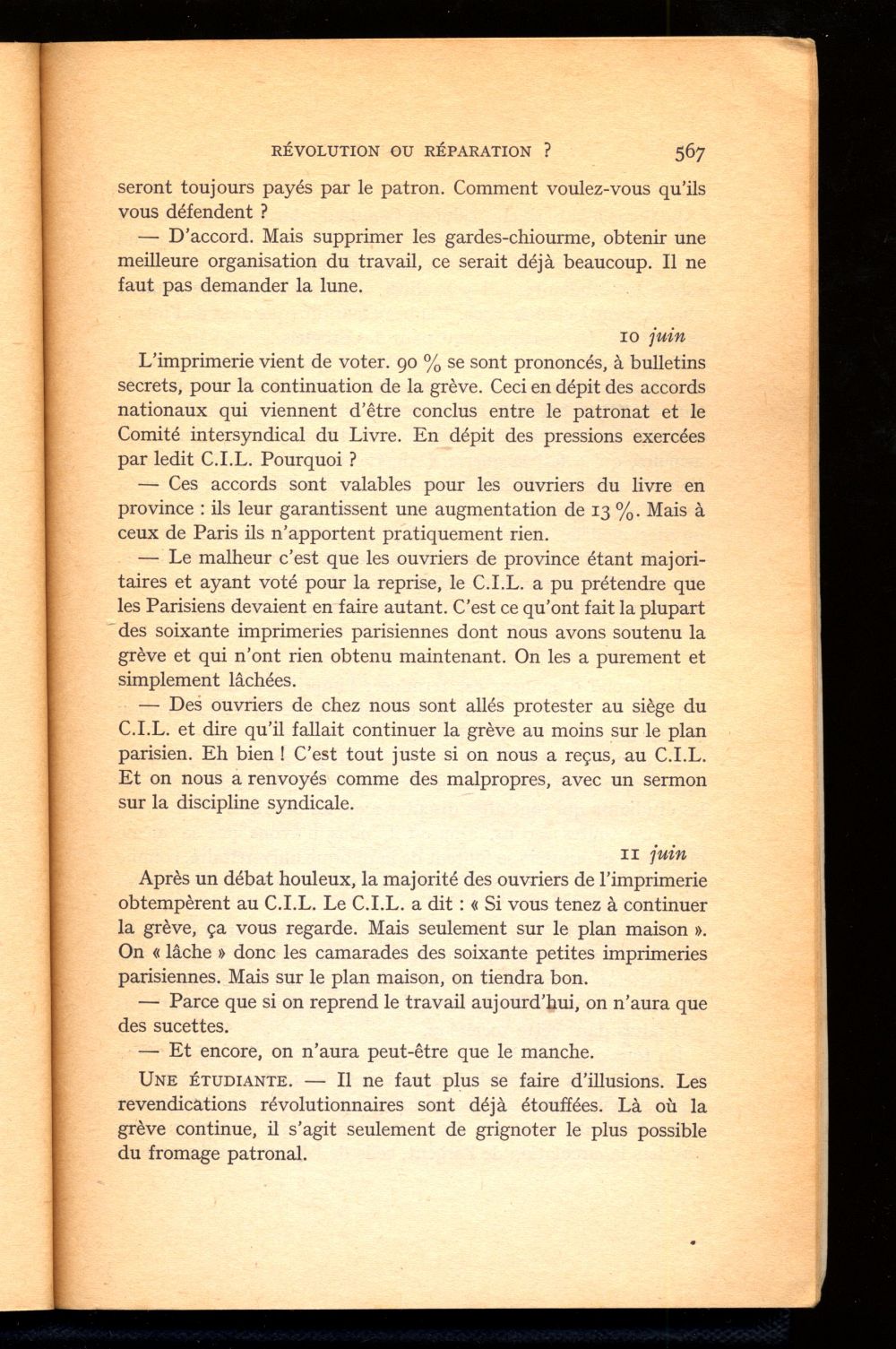

RÉVOLUTION OU RÉPARATION ?
567
seront toujours payés par le patron. Comment voulez-vous qu'ils
vous défendent ?
vous défendent ?
— D'accord. Mais supprimer les gardes-chiourme, obtenir une
meilleure organisation du travail, ce serait déjà beaucoup. Il ne
faut pas demander la lune.
meilleure organisation du travail, ce serait déjà beaucoup. Il ne
faut pas demander la lune.
10 juin
L'imprimerie vient de voter. 90 % se sont prononcés, à bulletins
L'imprimerie vient de voter. 90 % se sont prononcés, à bulletins
secrets, pour la continuation de la grève. Ceci en dépit des accords
nationaux qui viennent d'être conclus entre le patronat et le
Comité intersyndical du Livre. En dépit des pressions exercées
par ledit C.I.L. Pourquoi ?
nationaux qui viennent d'être conclus entre le patronat et le
Comité intersyndical du Livre. En dépit des pressions exercées
par ledit C.I.L. Pourquoi ?
—• Ces accords sont valables pour les ouvriers du livre en
province : ils leur garantissent une augmentation de 13 %. Mais à
ceux de Paris ils n'apportent pratiquement rien.
province : ils leur garantissent une augmentation de 13 %. Mais à
ceux de Paris ils n'apportent pratiquement rien.
— Le malheur c'est que les ouvriers de province étant majori-
taires et ayant voté pour la reprise, le C.I.L. a pu prétendre que
les Parisiens devaient en faire autant. C'est ce qu'ont fait la plupart
des soixante imprimeries parisiennes dont nous avons soutenu la
grève et qui n'ont rien obtenu maintenant. On les a purement et
simplement lâchées.
taires et ayant voté pour la reprise, le C.I.L. a pu prétendre que
les Parisiens devaient en faire autant. C'est ce qu'ont fait la plupart
des soixante imprimeries parisiennes dont nous avons soutenu la
grève et qui n'ont rien obtenu maintenant. On les a purement et
simplement lâchées.
— Des ouvriers de chez nous sont allés protester au siège du
C.I.L. et dire qu'il fallait continuer la grève au moins sur le plan
parisien. Eh bien ! C'est tout juste si on nous a reçus, au C.I.L.
Et on nous a renvoyés comme des malpropres, avec un sermon
sur la discipline syndicale.
C.I.L. et dire qu'il fallait continuer la grève au moins sur le plan
parisien. Eh bien ! C'est tout juste si on nous a reçus, au C.I.L.
Et on nous a renvoyés comme des malpropres, avec un sermon
sur la discipline syndicale.
11 juin
Après un débat houleux, la majorité des ouvriers de l'imprimerie
Après un débat houleux, la majorité des ouvriers de l'imprimerie
obtempèrent au C.I.L. Le C.I.L. a dit : « Si vous tenez à continuer
la grève, ça vous regarde. Mais seulement sur le plan maison ».
On « lâche » donc les camarades des soixante petites imprimeries
parisiennes. Mais sur le plan maison, on tiendra bon.
la grève, ça vous regarde. Mais seulement sur le plan maison ».
On « lâche » donc les camarades des soixante petites imprimeries
parisiennes. Mais sur le plan maison, on tiendra bon.
— Parce que si on reprend le travail aujourd'hui, on n'aura que
des sucettes.
des sucettes.
— Et encore, on n'aura peut-être que le manche.
UNE ÉTUDIANTE. — II ne faut plus se faire d'illusions. Les
revendications révolutionnaires sont déjà étouffées. Là où la
grève continue, il s'agit seulement de grignoter le plus possible
du fromage patronal.
revendications révolutionnaires sont déjà étouffées. Là où la
grève continue, il s'agit seulement de grignoter le plus possible
du fromage patronal.
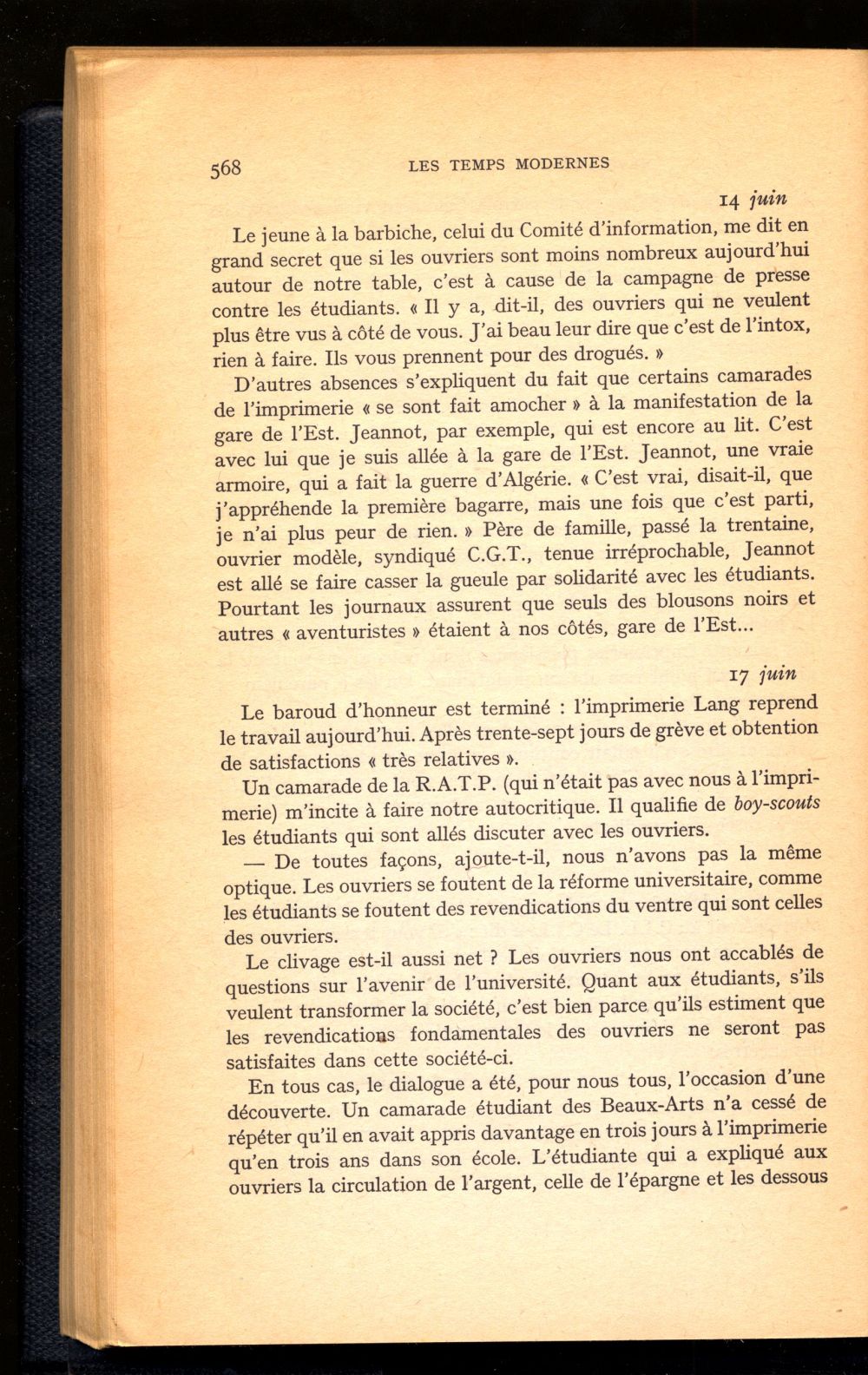

568
LES TEMPS MODERNES
14 'juin
Le jeune à la barbiche, celui du Comité d'information, me dit en
grand secret que si les ouvriers sont moins nombreux aujourd'hui
autour de notre table, c'est à cause de la campagne de presse
contre les étudiants. « II y a, dit-il, des ouvriers qui ne veulent
plus être vus à côté de vous. J'ai beau leur dire que c'est de l'intox,
rien à faire. Ils vous prennent pour des drogués. »
grand secret que si les ouvriers sont moins nombreux aujourd'hui
autour de notre table, c'est à cause de la campagne de presse
contre les étudiants. « II y a, dit-il, des ouvriers qui ne veulent
plus être vus à côté de vous. J'ai beau leur dire que c'est de l'intox,
rien à faire. Ils vous prennent pour des drogués. »
D'autres absences s'expliquent du fait que certains camarades
de l'imprimerie « se sont fait amocher » à la manifestation de la
gare de l'Est. Jeannot, par exemple, qui est encore au lit. C'est
avec lui que je suis allée à la gare de l'Est. Jeannot, une vraie
armoire, qui a fait la guerre d'Algérie. « C'est vrai, disait-il, que
j'appréhende la première bagarre, mais une fois que c'est parti,
je n'ai plus peur de rien. » Père de famille, passé la trentaine,
ouvrier modèle, syndiqué C.G.T., tenue irréprochable, Jeannot
est allé se faire casser la gueule par solidarité avec les étudiants.
Pourtant les journaux assurent que seuls des blousons noirs et
autres « aventuristes » étaient à nos côtés, gare de l'Est...
de l'imprimerie « se sont fait amocher » à la manifestation de la
gare de l'Est. Jeannot, par exemple, qui est encore au lit. C'est
avec lui que je suis allée à la gare de l'Est. Jeannot, une vraie
armoire, qui a fait la guerre d'Algérie. « C'est vrai, disait-il, que
j'appréhende la première bagarre, mais une fois que c'est parti,
je n'ai plus peur de rien. » Père de famille, passé la trentaine,
ouvrier modèle, syndiqué C.G.T., tenue irréprochable, Jeannot
est allé se faire casser la gueule par solidarité avec les étudiants.
Pourtant les journaux assurent que seuls des blousons noirs et
autres « aventuristes » étaient à nos côtés, gare de l'Est...
17 juin
Le baroud d'honneur est terminé : l'imprimerie Lang reprend
le travail aujourd'hui. Après trente-sept jours de grève et obtention
de satisfactions « très relatives ».
le travail aujourd'hui. Après trente-sept jours de grève et obtention
de satisfactions « très relatives ».
Un camarade de la R.A.T.P. (qui n'était pas avec nous à l'impri-
merie) m'incite à faire notre autocritique. Il qualifie de boy-scouts
les étudiants qui sont allés discuter avec les ouvriers.
merie) m'incite à faire notre autocritique. Il qualifie de boy-scouts
les étudiants qui sont allés discuter avec les ouvriers.
— De toutes façons, ajoute-t-il, nous n'avons pas la même
optique. Les ouvriers se foutent de la réforme universitaire, comme
les étudiants se foutent des revendications du ventre qui sont celles
des ouvriers.
optique. Les ouvriers se foutent de la réforme universitaire, comme
les étudiants se foutent des revendications du ventre qui sont celles
des ouvriers.
Le clivage est-il aussi net ? Les ouvriers nous ont accablés de
questions sur l'avenir de l'université. Quant aux étudiants, s'ils
veulent transformer la société, c'est bien parce qu'ils estiment que
les revendications fondamentales des ouvriers ne seront pas
satisfaites dans cette société-ci.
questions sur l'avenir de l'université. Quant aux étudiants, s'ils
veulent transformer la société, c'est bien parce qu'ils estiment que
les revendications fondamentales des ouvriers ne seront pas
satisfaites dans cette société-ci.
En tous cas, le dialogue a été, pour nous tous, l'occasion d'une
découverte. Un camarade étudiant des Beaux-Arts n'a cessé de
répéter qu'il en avait appris davantage en trois jours à l'imprimerie
qu'en trois ans dans son école. L'étudiante qui a expliqué aux
ouvriers la circulation de l'argent, celle de l'épargne et les dessous
découverte. Un camarade étudiant des Beaux-Arts n'a cessé de
répéter qu'il en avait appris davantage en trois jours à l'imprimerie
qu'en trois ans dans son école. L'étudiante qui a expliqué aux
ouvriers la circulation de l'argent, celle de l'épargne et les dessous
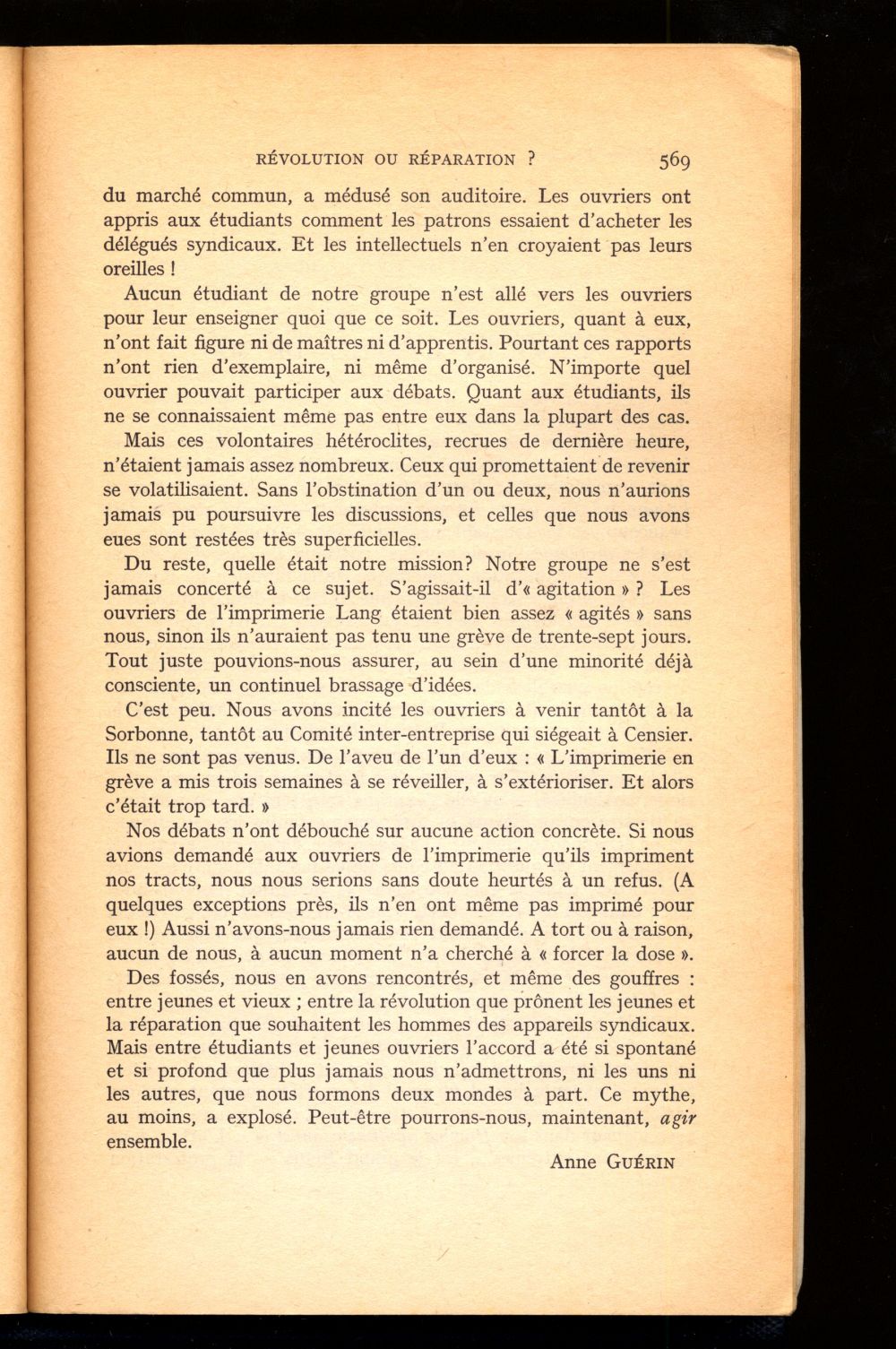

RÉVOLUTION OU RÉPARATION ?
569
du marché commun, a médusé son auditoire. Les ouvriers ont
appris aux étudiants comment les patrons essaient d'acheter les
délégués syndicaux. Et les intellectuels n'en croyaient pas leurs
oreilles !
appris aux étudiants comment les patrons essaient d'acheter les
délégués syndicaux. Et les intellectuels n'en croyaient pas leurs
oreilles !
Aucun étudiant de notre groupe n'est allé vers les ouvriers
pour leur enseigner quoi que ce soit. Les ouvriers, quant à eux,
n'ont fait figure ni de maîtres ni d'apprentis. Pourtant ces rapports
n'ont rien d'exemplaire, ni même d'organisé. N'importe quel
ouvrier pouvait participer aux débats. Quant aux étudiants, ils
ne se connaissaient même pas entre eux dans la plupart des cas.
pour leur enseigner quoi que ce soit. Les ouvriers, quant à eux,
n'ont fait figure ni de maîtres ni d'apprentis. Pourtant ces rapports
n'ont rien d'exemplaire, ni même d'organisé. N'importe quel
ouvrier pouvait participer aux débats. Quant aux étudiants, ils
ne se connaissaient même pas entre eux dans la plupart des cas.
Mais ces volontaires hétéroclites, recrues de dernière heure,
n'étaient jamais assez nombreux. Ceux qui promettaient de revenir
se volatilisaient. Sans l'obstination d'un ou deux, nous n'aurions
jamais pu poursuivre les discussions, et celles que nous avons
eues sont restées très superficielles.
n'étaient jamais assez nombreux. Ceux qui promettaient de revenir
se volatilisaient. Sans l'obstination d'un ou deux, nous n'aurions
jamais pu poursuivre les discussions, et celles que nous avons
eues sont restées très superficielles.
Du reste, quelle était notre mission? Notre groupe ne s'est
jamais concerté à ce sujet. S'agissait-il d'« agitation » ? Les
ouvriers de l'imprimerie Lang étaient bien assez « agités » sans
nous, sinon ils n'auraient pas tenu une grève de trente-sept jours.
Tout juste pouvions-nous assurer, au sein d'une minorité déjà
consciente, un continuel brassage d'idées.
jamais concerté à ce sujet. S'agissait-il d'« agitation » ? Les
ouvriers de l'imprimerie Lang étaient bien assez « agités » sans
nous, sinon ils n'auraient pas tenu une grève de trente-sept jours.
Tout juste pouvions-nous assurer, au sein d'une minorité déjà
consciente, un continuel brassage d'idées.
C'est peu. Nous avons incité les ouvriers à venir tantôt à la
Sorbonne, tantôt au Comité inter-entreprise qui siégeait à Censier.
Ils ne sont pas venus. De l'aveu de l'un d'eux : « L'imprimerie en
grève a mis trois semaines à se réveiller, à s'extérioriser. Et alors
c'était trop tard. »
Sorbonne, tantôt au Comité inter-entreprise qui siégeait à Censier.
Ils ne sont pas venus. De l'aveu de l'un d'eux : « L'imprimerie en
grève a mis trois semaines à se réveiller, à s'extérioriser. Et alors
c'était trop tard. »
Nos débats n'ont débouché sur aucune action concrète. Si nous
avions demandé aux ouvriers de l'imprimerie qu'ils impriment
nos tracts, nous nous serions sans doute heurtés à un refus. (A
quelques exceptions près, ils n'en ont même pas imprimé pour
eux !) Aussi n'avons-nous jamais rien demandé. A tort ou à raison,
aucun de nous, à aucun moment n'a cherché à « forcer la dose ».
avions demandé aux ouvriers de l'imprimerie qu'ils impriment
nos tracts, nous nous serions sans doute heurtés à un refus. (A
quelques exceptions près, ils n'en ont même pas imprimé pour
eux !) Aussi n'avons-nous jamais rien demandé. A tort ou à raison,
aucun de nous, à aucun moment n'a cherché à « forcer la dose ».
Des fossés, nous en avons rencontrés, et même des gouffres :
entre jeunes et vieux ; entre la révolution que prônent les jeunes et
la réparation que souhaitent les hommes des appareils syndicaux.
Mais entre étudiants et jeunes ouvriers l'accord a été si spontané
et si profond que plus jamais nous n'admettrons, ni les uns ni
les autres, que nous formons deux mondes à part. Ce mythe,
au moins, a explosé. Peut-être pourrons-nous, maintenant, agir
ensemble.
entre jeunes et vieux ; entre la révolution que prônent les jeunes et
la réparation que souhaitent les hommes des appareils syndicaux.
Mais entre étudiants et jeunes ouvriers l'accord a été si spontané
et si profond que plus jamais nous n'admettrons, ni les uns ni
les autres, que nous formons deux mondes à part. Ce mythe,
au moins, a explosé. Peut-être pourrons-nous, maintenant, agir
ensemble.
Anne GUÉRIN
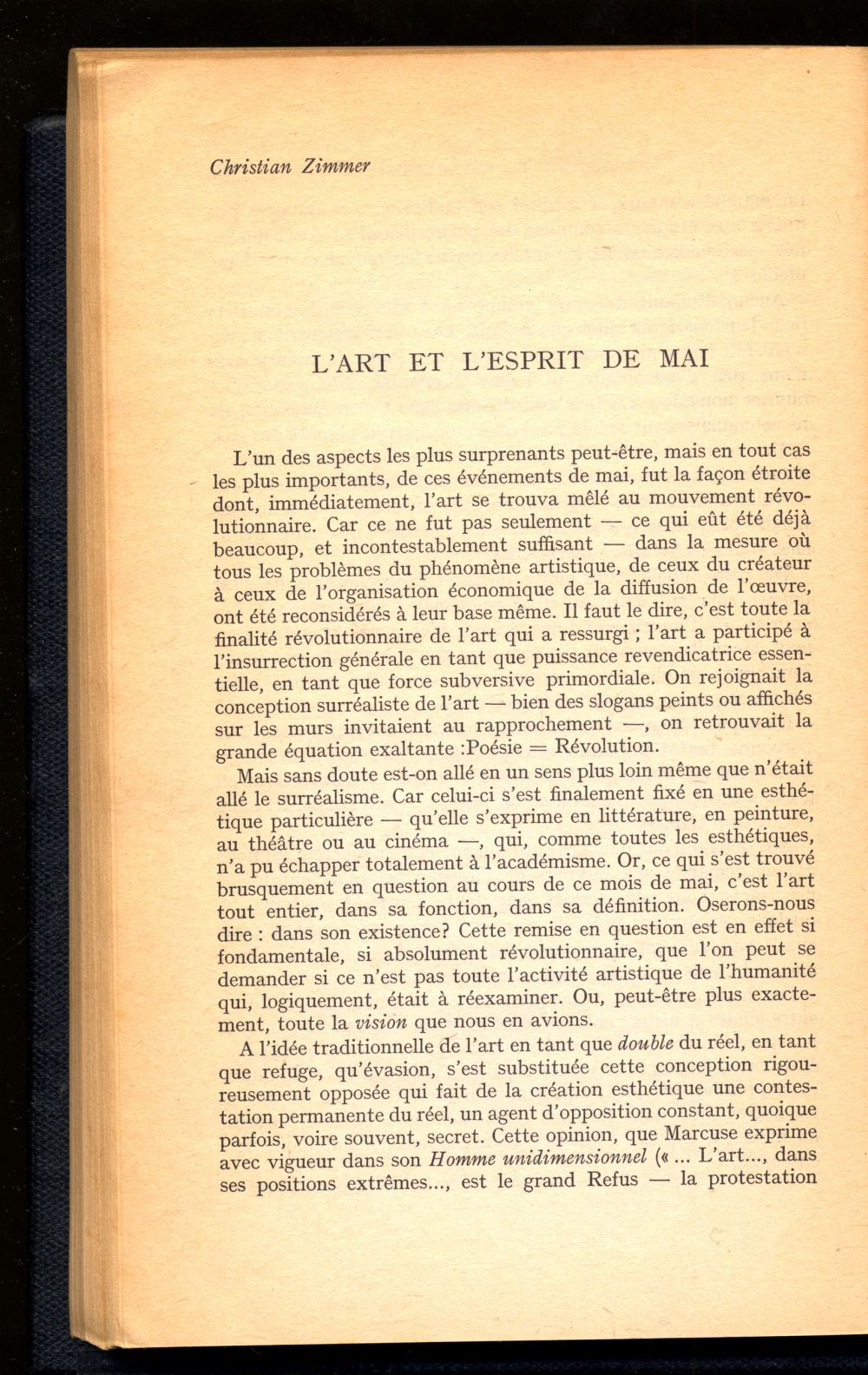

Christian Zimmer
L'ART ET L'ESPRIT DE MAI
L'un des aspects les plus surprenants peut-être, mais en tout cas
les plus importants, de ces événements de mai, fut la façon étroite
dont, immédiatement, l'art se trouva mêlé au mouvement révo-
lutionnaire. Car ce ne fut pas seulement — ce qui eût été déjà
beaucoup, et incontestablement suffisant — dans la mesure où
tous les problèmes du phénomène artistique, de ceux du créateur
à ceux de l'organisation économique de la diffusion de l'œuvre,
ont été reconsidérés à leur base même. Il faut le dire, c'est toute la
finalité révolutionnaire de l'art qui a ressurgi ; l'art a participé à
l'insurrection générale en tant que puissance revendicatrice essen-
tielle, en tant que force subversive primordiale. On rejoignait la
conception surréaliste de l'art — bien des slogans peints ou affichés
sur les murs invitaient au rapprochement —, on retrouvait la
grande équation exaltante :Poésie = Révolution.
les plus importants, de ces événements de mai, fut la façon étroite
dont, immédiatement, l'art se trouva mêlé au mouvement révo-
lutionnaire. Car ce ne fut pas seulement — ce qui eût été déjà
beaucoup, et incontestablement suffisant — dans la mesure où
tous les problèmes du phénomène artistique, de ceux du créateur
à ceux de l'organisation économique de la diffusion de l'œuvre,
ont été reconsidérés à leur base même. Il faut le dire, c'est toute la
finalité révolutionnaire de l'art qui a ressurgi ; l'art a participé à
l'insurrection générale en tant que puissance revendicatrice essen-
tielle, en tant que force subversive primordiale. On rejoignait la
conception surréaliste de l'art — bien des slogans peints ou affichés
sur les murs invitaient au rapprochement —, on retrouvait la
grande équation exaltante :Poésie = Révolution.
Mais sans doute est-on allé en un sens plus loin même que n'était
allé le surréalisme. Car celui-ci s'est finalement fixé en une esthé-
tique particulière — qu'elle s'exprime en littérature, en peinture,
au théâtre ou au cinéma —, qui, comme toutes les esthétiques,
n'a pu échapper totalement à l'académisme. Or, ce qui s'est trouvé
brusquement en question au cours de ce mois de mai, c'est l'art
tout entier, dans sa fonction, dans sa définition. Oserons-nous
dire : dans son existence? Cette remise en question est en effet si
fondamentale, si absolument révolutionnaire, que l'on peut se
demander si ce n'est pas toute l'activité artistique de l'humanité
qui, logiquement, était à réexaminer. Ou, peut-être plus exacte-
ment, toute la vision que nous en avions.
allé le surréalisme. Car celui-ci s'est finalement fixé en une esthé-
tique particulière — qu'elle s'exprime en littérature, en peinture,
au théâtre ou au cinéma —, qui, comme toutes les esthétiques,
n'a pu échapper totalement à l'académisme. Or, ce qui s'est trouvé
brusquement en question au cours de ce mois de mai, c'est l'art
tout entier, dans sa fonction, dans sa définition. Oserons-nous
dire : dans son existence? Cette remise en question est en effet si
fondamentale, si absolument révolutionnaire, que l'on peut se
demander si ce n'est pas toute l'activité artistique de l'humanité
qui, logiquement, était à réexaminer. Ou, peut-être plus exacte-
ment, toute la vision que nous en avions.
A l'idée traditionnelle de l'art en tant que double du réel, en tant
que refuge, qu'évasion, s'est substituée cette conception rigou-
reusement opposée qui fait de la création esthétique une contes-
tation permanente du réel, un agent d'opposition constant, quoique
parfois, voire souvent, secret. Cette opinion, que Marcuse exprime
avec vigueur dans son Homme unidimensionnel (« ... L'art..., dans
ses positions extrêmes..., est le grand Refus — la protestation
que refuge, qu'évasion, s'est substituée cette conception rigou-
reusement opposée qui fait de la création esthétique une contes-
tation permanente du réel, un agent d'opposition constant, quoique
parfois, voire souvent, secret. Cette opinion, que Marcuse exprime
avec vigueur dans son Homme unidimensionnel (« ... L'art..., dans
ses positions extrêmes..., est le grand Refus — la protestation
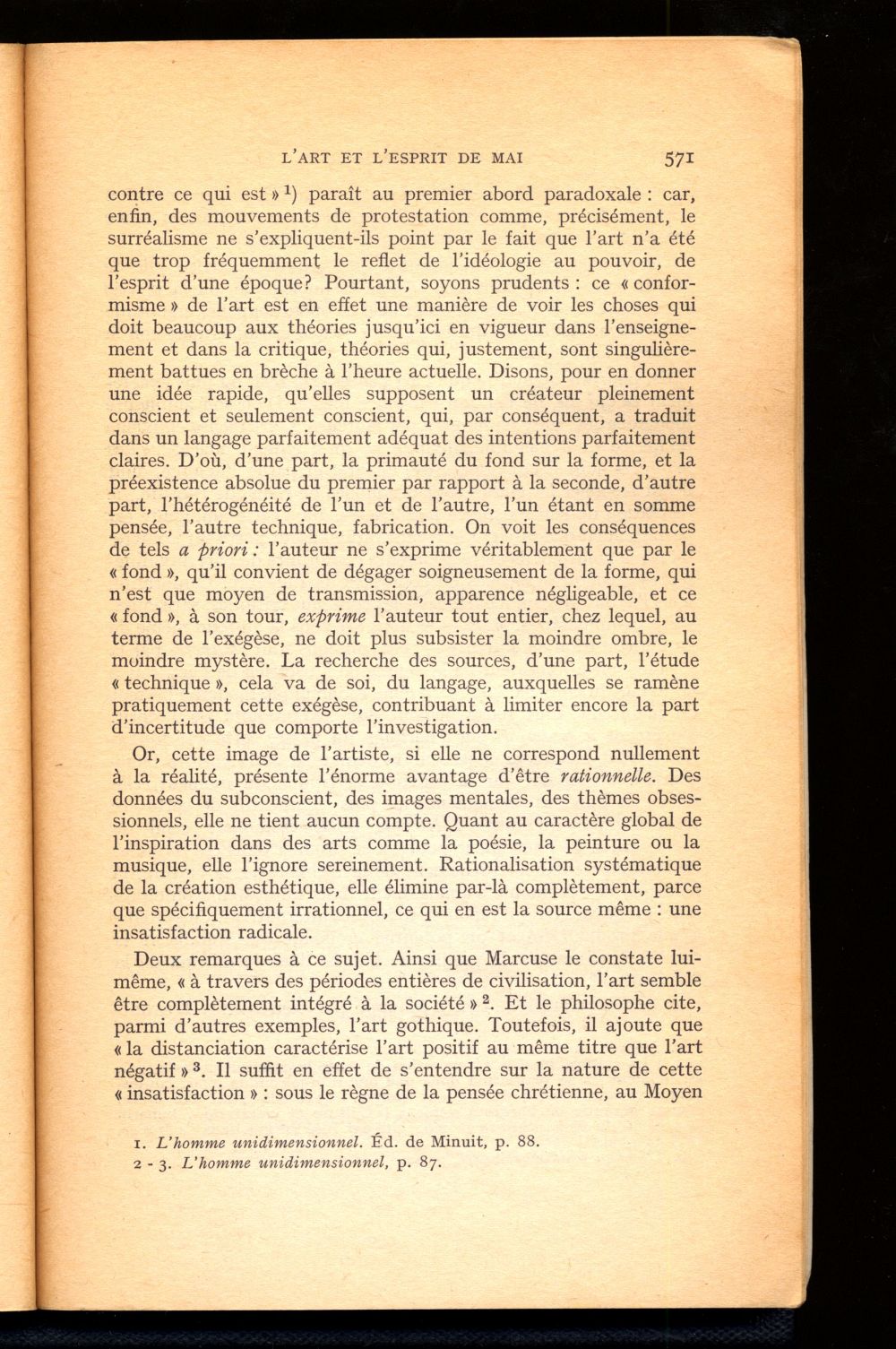

L ART ET L ESPRIT DE MAI
571
contre ce qui est » x) paraît au premier abord paradoxale : car,
enfin, des mouvements de protestation comme, précisément, le
surréalisme ne s'expliquent-ils point par le fait que l'art n'a été
que trop fréquemment le reflet de l'idéologie au pouvoir, de
l'esprit d'une époque? Pourtant, soyons prudents: ce «confor-
misme » de l'art est en effet une manière de voir les choses qui
doit beaucoup aux théories jusqu'ici en vigueur dans l'enseigne-
ment et dans la critique, théories qui, justement, sont singulière-
ment battues en brèche à l'heure actuelle. Disons, pour en donner
une idée rapide, qu'elles supposent un créateur pleinement
conscient et seulement conscient, qui, par conséquent, a traduit
dans un langage parfaitement adéquat des intentions parfaitement
claires. D'où, d'une part, la primauté du fond sur la forme, et la
préexistence absolue du premier par rapport à la seconde, d'autre
part, l'hétérogénéité de l'un et de l'autre, l'un étant en somme
pensée, l'autre technique, fabrication. On voit les conséquences
de tels a -priori : l'auteur ne s'exprime véritablement que par le
« fond », qu'il convient de dégager soigneusement de la forme, qui
n'est que moyen de transmission, apparence négligeable, et ce
« fond », à son tour, exprime l'auteur tout entier, chez lequel, au
terme de l'exégèse, ne doit plus subsister la moindre ombre, le
moindre mystère. La recherche des sources, d'une part, l'étude
« technique », cela va de soi, du langage, auxquelles se ramène
pratiquement cette exégèse, contribuant à limiter encore la part
d'incertitude que comporte l'investigation.
enfin, des mouvements de protestation comme, précisément, le
surréalisme ne s'expliquent-ils point par le fait que l'art n'a été
que trop fréquemment le reflet de l'idéologie au pouvoir, de
l'esprit d'une époque? Pourtant, soyons prudents: ce «confor-
misme » de l'art est en effet une manière de voir les choses qui
doit beaucoup aux théories jusqu'ici en vigueur dans l'enseigne-
ment et dans la critique, théories qui, justement, sont singulière-
ment battues en brèche à l'heure actuelle. Disons, pour en donner
une idée rapide, qu'elles supposent un créateur pleinement
conscient et seulement conscient, qui, par conséquent, a traduit
dans un langage parfaitement adéquat des intentions parfaitement
claires. D'où, d'une part, la primauté du fond sur la forme, et la
préexistence absolue du premier par rapport à la seconde, d'autre
part, l'hétérogénéité de l'un et de l'autre, l'un étant en somme
pensée, l'autre technique, fabrication. On voit les conséquences
de tels a -priori : l'auteur ne s'exprime véritablement que par le
« fond », qu'il convient de dégager soigneusement de la forme, qui
n'est que moyen de transmission, apparence négligeable, et ce
« fond », à son tour, exprime l'auteur tout entier, chez lequel, au
terme de l'exégèse, ne doit plus subsister la moindre ombre, le
moindre mystère. La recherche des sources, d'une part, l'étude
« technique », cela va de soi, du langage, auxquelles se ramène
pratiquement cette exégèse, contribuant à limiter encore la part
d'incertitude que comporte l'investigation.
Or, cette image de l'artiste, si elle ne correspond nullement
à la réalité, présente l'énorme avantage d'être rationnelle. Des
données du subconscient, des images mentales, des thèmes obses-
sionnels, elle ne tient aucun compte. Quant au caractère global de
l'inspiration dans des arts comme la poésie, la peinture ou la
musique, elle l'ignore sereinement. Rationalisation systématique
de la création esthétique, elle élimine par-là complètement, parce
que spécifiquement irrationnel, ce qui en est la source même : une
insatisfaction radicale.
à la réalité, présente l'énorme avantage d'être rationnelle. Des
données du subconscient, des images mentales, des thèmes obses-
sionnels, elle ne tient aucun compte. Quant au caractère global de
l'inspiration dans des arts comme la poésie, la peinture ou la
musique, elle l'ignore sereinement. Rationalisation systématique
de la création esthétique, elle élimine par-là complètement, parce
que spécifiquement irrationnel, ce qui en est la source même : une
insatisfaction radicale.
Deux remarques à ce sujet. Ainsi que Marcuse le constate lui-
même, « à travers des périodes entières de civilisation, l'art semble
être complètement intégré à la société » 2. Et le philosophe cite,
parmi d'autres exemples, l'art gothique. Toutefois, il ajoute que
« la distanciation caractérise l'art positif au même titre que l'art
négatif » 3. Il suffit en effet de s'entendre sur la nature de cette
« insatisfaction » : sous le règne de la pensée chrétienne, au Moyen
même, « à travers des périodes entières de civilisation, l'art semble
être complètement intégré à la société » 2. Et le philosophe cite,
parmi d'autres exemples, l'art gothique. Toutefois, il ajoute que
« la distanciation caractérise l'art positif au même titre que l'art
négatif » 3. Il suffit en effet de s'entendre sur la nature de cette
« insatisfaction » : sous le règne de la pensée chrétienne, au Moyen
i. L'homme unidimensionnel. Éd. de Minuit, p. 88.
2-3. L'homme unidimensionnel, p. 87.
2-3. L'homme unidimensionnel, p. 87.
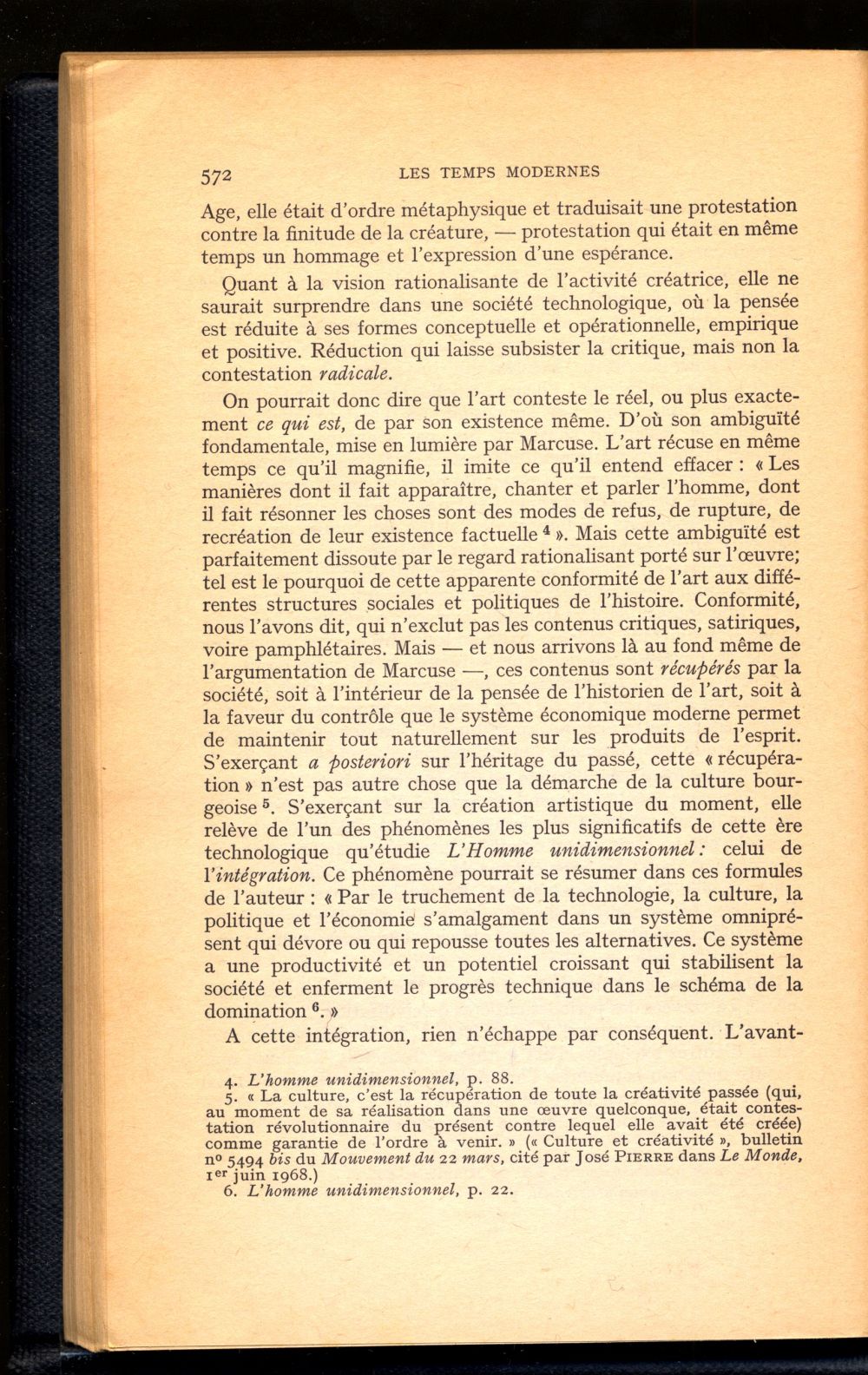

572 LES TEMPS MODERNES
Age, elle était d'ordre métaphysique et traduisait une protestation
contre la finitude de la créature, — protestation qui était en même
temps un hommage et l'expression d'une espérance.
contre la finitude de la créature, — protestation qui était en même
temps un hommage et l'expression d'une espérance.
Quant à la vision rationalisante de l'activité créatrice, elle ne
saurait surprendre dans une société technologique, où la pensée
est réduite à ses formes conceptuelle et opérationnelle, empirique
et positive. Réduction qui laisse subsister la critique, mais non la
contestation radicale.
saurait surprendre dans une société technologique, où la pensée
est réduite à ses formes conceptuelle et opérationnelle, empirique
et positive. Réduction qui laisse subsister la critique, mais non la
contestation radicale.
On pourrait donc dire que l'art conteste le réel, ou plus exacte-
ment ce qui est, de par son existence même. D'où son ambiguïté
fondamentale, mise en lumière par Marcuse. L'art récuse en même
temps ce qu'il magnifie, il imite ce qu'il entend effacer : « Les
manières dont il fait apparaître, chanter et parler l'homme, dont
il fait résonner les choses sont des modes de refus, de rupture, de
recréation de leur existence factuelle 4 ». Mais cette ambiguïté est
parfaitement dissoute par le regard rationalisant porté sur l'œuvre;
tel est le pourquoi de cette apparente conformité de l'art aux diffé-
rentes structures sociales et politiques de l'histoire. Conformité,
nous l'avons dit, qui n'exclut pas les contenus critiques, satiriques,
voire pamphlétaires. Mais — et nous arrivons là au fond même de
l'argumentation de Marcuse —, ces contenus sont récupérés par la
société, soit à l'intérieur de la pensée de l'historien de l'art, soit à
la faveur du contrôle que le système économique moderne permet
de maintenir tout naturellement sur les produits de l'esprit.
S'exerçant a posteriori sur l'héritage du passé, cette « récupéra-
tion » n'est pas autre chose que la démarche de la culture bour-
geoise 5. S'exerçant sur la création artistique du moment, elle
relève de l'un des phénomènes les plus significatifs de cette ère
technologique qu'étudié L'Homme unidimensionnel : celui de
l'intégration. Ce phénomène pourrait se résumer dans ces formules
de l'auteur : « Par le truchement de la technologie, la culture, la
politique et l'économie s'amalgament dans un système omnipré-
sent qui dévore ou qui repousse toutes les alternatives. Ce système
a une productivité et un potentiel croissant qui stabilisent la
société et enferment le progrès technique dans le schéma de la
domination °. »
ment ce qui est, de par son existence même. D'où son ambiguïté
fondamentale, mise en lumière par Marcuse. L'art récuse en même
temps ce qu'il magnifie, il imite ce qu'il entend effacer : « Les
manières dont il fait apparaître, chanter et parler l'homme, dont
il fait résonner les choses sont des modes de refus, de rupture, de
recréation de leur existence factuelle 4 ». Mais cette ambiguïté est
parfaitement dissoute par le regard rationalisant porté sur l'œuvre;
tel est le pourquoi de cette apparente conformité de l'art aux diffé-
rentes structures sociales et politiques de l'histoire. Conformité,
nous l'avons dit, qui n'exclut pas les contenus critiques, satiriques,
voire pamphlétaires. Mais — et nous arrivons là au fond même de
l'argumentation de Marcuse —, ces contenus sont récupérés par la
société, soit à l'intérieur de la pensée de l'historien de l'art, soit à
la faveur du contrôle que le système économique moderne permet
de maintenir tout naturellement sur les produits de l'esprit.
S'exerçant a posteriori sur l'héritage du passé, cette « récupéra-
tion » n'est pas autre chose que la démarche de la culture bour-
geoise 5. S'exerçant sur la création artistique du moment, elle
relève de l'un des phénomènes les plus significatifs de cette ère
technologique qu'étudié L'Homme unidimensionnel : celui de
l'intégration. Ce phénomène pourrait se résumer dans ces formules
de l'auteur : « Par le truchement de la technologie, la culture, la
politique et l'économie s'amalgament dans un système omnipré-
sent qui dévore ou qui repousse toutes les alternatives. Ce système
a une productivité et un potentiel croissant qui stabilisent la
société et enferment le progrès technique dans le schéma de la
domination °. »
A cette intégration, rien n'échappe par conséquent. L'avant-
4. L'homme unidimensionnel, p. 88.
5. « La culture, c'est la récupération de toute la créativité passée (qui,
au moment de sa réalisation dans une œuvre quelconque, était contes-
tation révolutionnaire du présent contre lequel elle avait été créée)
comme garantie de l'ordre à venir. » (« Culture et créativité », bulletin
n° 5494 bis du Mouvement du 22 mars, cité par José PIERRE dans Le Monde,
Ier juin 1968.)
au moment de sa réalisation dans une œuvre quelconque, était contes-
tation révolutionnaire du présent contre lequel elle avait été créée)
comme garantie de l'ordre à venir. » (« Culture et créativité », bulletin
n° 5494 bis du Mouvement du 22 mars, cité par José PIERRE dans Le Monde,
Ier juin 1968.)
6. L'homme unidimensionnel, p. 22.
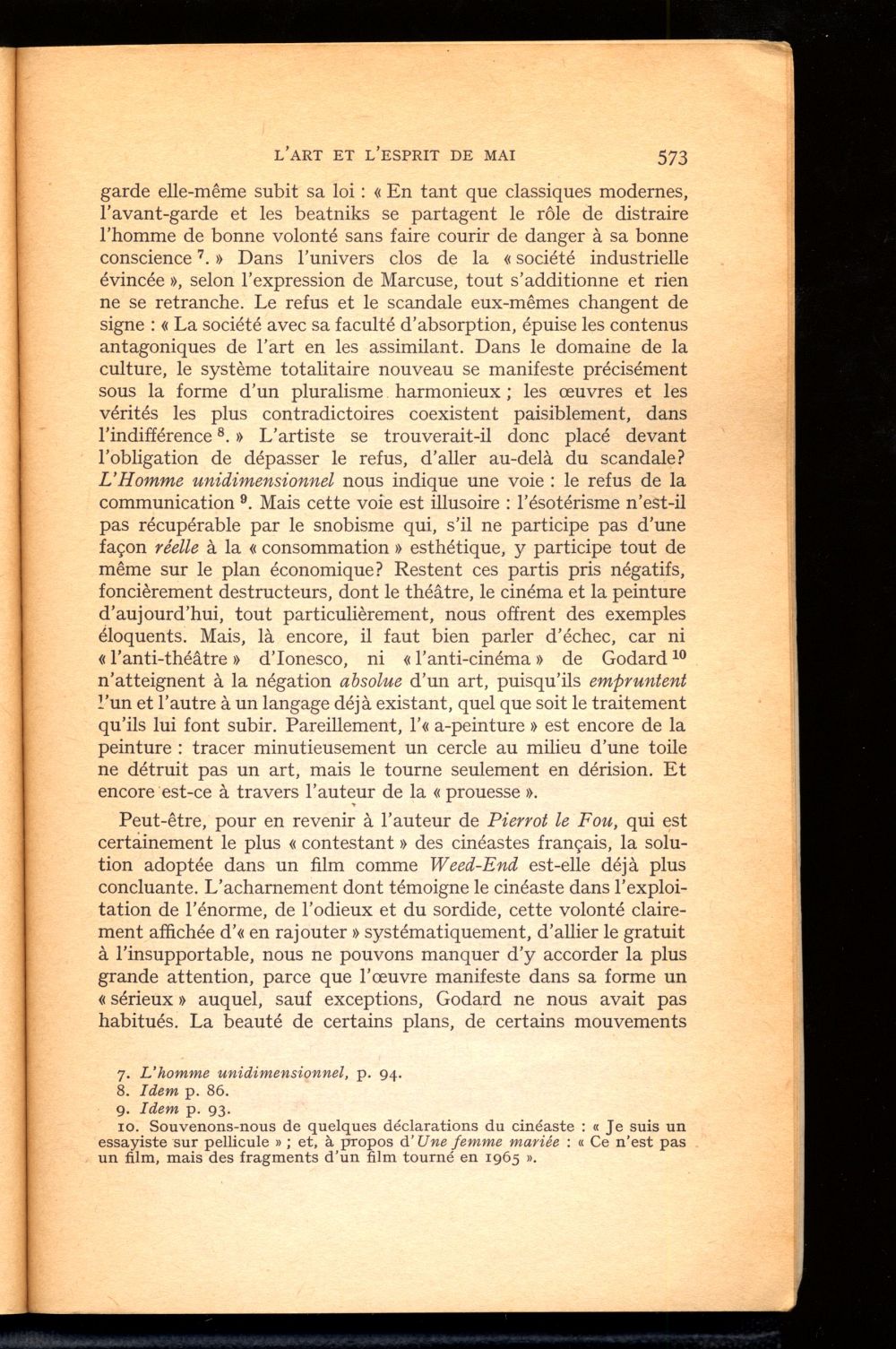

L ART ET L ESPRIT DE MAI
573
garde elle-même subit sa loi : « En tant que classiques modernes,
l'avant-garde et les beatniks se partagent le rôle de distraire
l'homme de bonne volonté sans faire courir de danger à sa bonne
conscience7. » Dans l'univers clos de la « société industrielle
évincée », selon l'expression de Marcuse, tout s'additionne et rien
ne se retranche. Le refus et le scandale eux-mêmes changent de
signe : « La société avec sa faculté d'absorption, épuise les contenus
antagoniques de l'art en les assimilant. Dans le domaine de la
culture, le système totalitaire nouveau se manifeste précisément
sous la forme d'un pluralisme harmonieux ; les œuvres et les
vérités les plus contradictoires coexistent paisiblement, dans
l'indifférence8. » L'artiste se trouverait-il donc placé devant
l'obligation de dépasser le refus, d'aller au-delà du scandale?
L'Homme unidimensionnel nous indique une voie : le refus de la
communication 9. Mais cette voie est illusoire : l'ésotérisme n'est-il
pas récupérable par le snobisme qui, s'il ne participe pas d'une
façon réelle à la « consommation » esthétique, y participe tout de
même sur le plan économique? Restent ces partis pris négatifs,
foncièrement destructeurs, dont le théâtre, le cinéma et la peinture
d'aujourd'hui, tout particulièrement, nous offrent des exemples
éloquents. Mais, là encore, il faut bien parler d'échec, car ni
« l'anti-théâtre » d'Ionesco, ni « l'anti-cinéma » de Godard10
n'atteignent à la négation absolue d'un art, puisqu'ils empruntent
l'un et l'autre à un langage déjà existant, quel que soit le traitement
qu'ils lui font subir. Pareillement, l'« a-peinture » est encore de la
peinture : tracer minutieusement un cercle au milieu d'une toile
ne détruit pas un art, mais le tourne seulement en dérision. Et
encore est-ce à travers l'auteur de la « prouesse ».
l'avant-garde et les beatniks se partagent le rôle de distraire
l'homme de bonne volonté sans faire courir de danger à sa bonne
conscience7. » Dans l'univers clos de la « société industrielle
évincée », selon l'expression de Marcuse, tout s'additionne et rien
ne se retranche. Le refus et le scandale eux-mêmes changent de
signe : « La société avec sa faculté d'absorption, épuise les contenus
antagoniques de l'art en les assimilant. Dans le domaine de la
culture, le système totalitaire nouveau se manifeste précisément
sous la forme d'un pluralisme harmonieux ; les œuvres et les
vérités les plus contradictoires coexistent paisiblement, dans
l'indifférence8. » L'artiste se trouverait-il donc placé devant
l'obligation de dépasser le refus, d'aller au-delà du scandale?
L'Homme unidimensionnel nous indique une voie : le refus de la
communication 9. Mais cette voie est illusoire : l'ésotérisme n'est-il
pas récupérable par le snobisme qui, s'il ne participe pas d'une
façon réelle à la « consommation » esthétique, y participe tout de
même sur le plan économique? Restent ces partis pris négatifs,
foncièrement destructeurs, dont le théâtre, le cinéma et la peinture
d'aujourd'hui, tout particulièrement, nous offrent des exemples
éloquents. Mais, là encore, il faut bien parler d'échec, car ni
« l'anti-théâtre » d'Ionesco, ni « l'anti-cinéma » de Godard10
n'atteignent à la négation absolue d'un art, puisqu'ils empruntent
l'un et l'autre à un langage déjà existant, quel que soit le traitement
qu'ils lui font subir. Pareillement, l'« a-peinture » est encore de la
peinture : tracer minutieusement un cercle au milieu d'une toile
ne détruit pas un art, mais le tourne seulement en dérision. Et
encore est-ce à travers l'auteur de la « prouesse ».
Peut-être, pour en revenir à l'auteur de Pierrot le Fou, qui est
certainement le plus « contestant » des cinéastes français, la solu-
tion adoptée dans un film comme Weed-End est-elle déjà plus
concluante. L'acharnement dont témoigne le cinéaste dans l'exploi-
tation de l'énorme, de l'odieux et du sordide, cette volonté claire-
ment affichée d'« en rajouter » systématiquement, d'allier le gratuit
à l'insupportable, nous ne pouvons manquer d'y accorder la plus
grande attention, parce que l'œuvre manifeste dans sa forme un
« sérieux » auquel, sauf exceptions, Godard ne nous avait pas
habitués. La beauté de certains plans, de certains mouvements
certainement le plus « contestant » des cinéastes français, la solu-
tion adoptée dans un film comme Weed-End est-elle déjà plus
concluante. L'acharnement dont témoigne le cinéaste dans l'exploi-
tation de l'énorme, de l'odieux et du sordide, cette volonté claire-
ment affichée d'« en rajouter » systématiquement, d'allier le gratuit
à l'insupportable, nous ne pouvons manquer d'y accorder la plus
grande attention, parce que l'œuvre manifeste dans sa forme un
« sérieux » auquel, sauf exceptions, Godard ne nous avait pas
habitués. La beauté de certains plans, de certains mouvements
7. L'homme unidimensionnel, p. 94.
8. Idem p. 86.
g. Idem p. 93.
g. Idem p. 93.
10. Souvenons-nous de quelques déclarations du cinéaste : « Je suis un
essayiste sur pellicule » ; et, à propos A'Une femme 'mariée : « Ce n'est pas
un film, mais des fragments d'un film tourné en 1965 ».
essayiste sur pellicule » ; et, à propos A'Une femme 'mariée : « Ce n'est pas
un film, mais des fragments d'un film tourné en 1965 ».
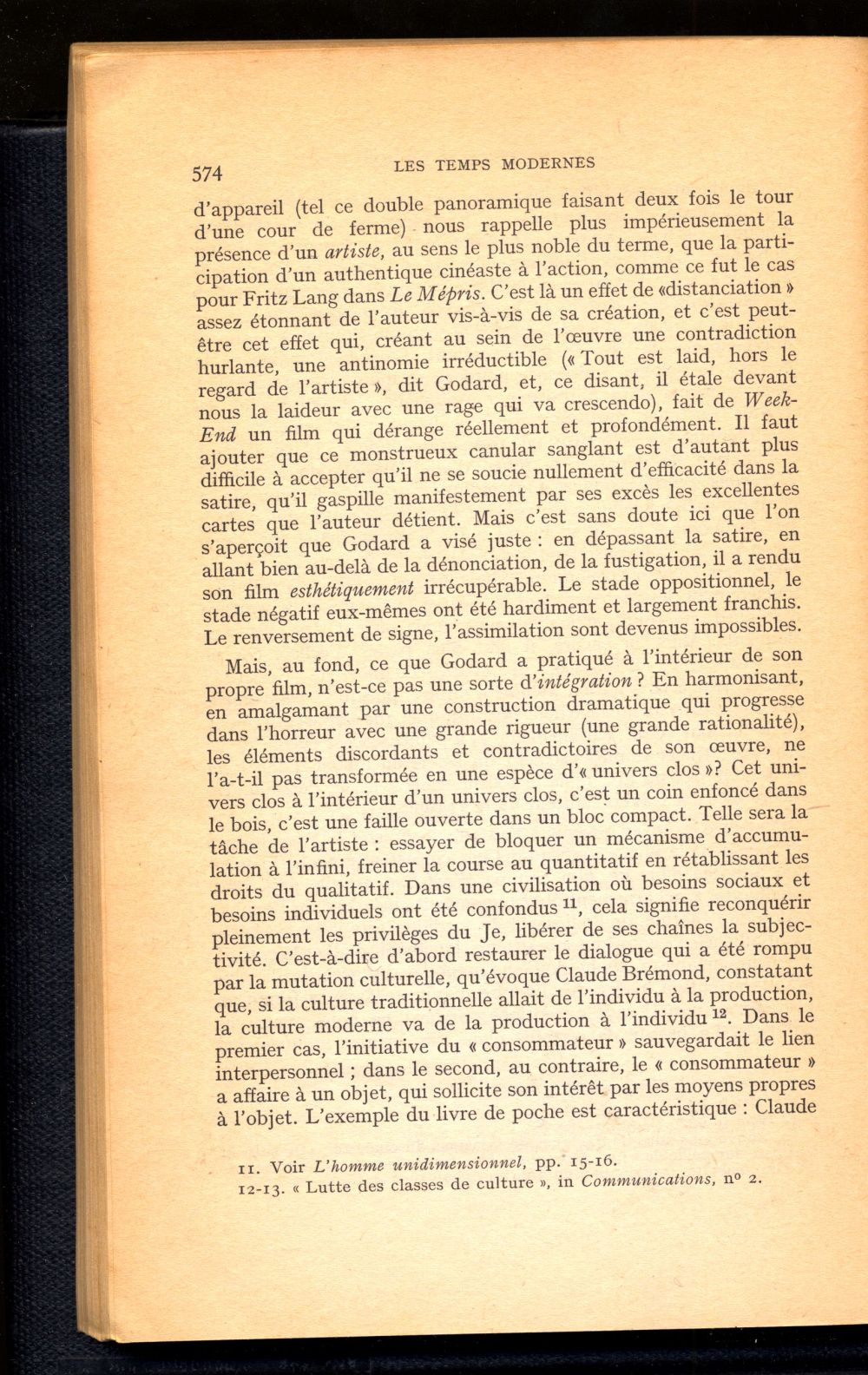

574
LES TEMPS MODERNES
d'appareil (tel ce double panoramique faisant deux fois le tour
d'une cour de ferme) nous rappelle plus impérieusement la
présence d'un artiste, au sens le plus noble du terme, que la parti-
cipation d'un authentique cinéaste à l'action, comme ce fut le cas
pour Fritz Lang dans Le Mépris. C'est là un effet de «distanciation »
assez étonnant de l'auteur vis-à-vis de sa création, et c'est peut-
être cet effet qui, créant au sein de l'œuvre une contradiction
hurlante, une antinomie irréductible (« Tout est laid, hors le
regard de l'artiste », dit Godard, et, ce disant, il étale devant
nous la laideur avec une rage qui va crescendo), fait de Week-
End un film qui dérange réellement et profondément. Il faut
ajouter que ce monstrueux canular sanglant est d'autant plus
difficile à accepter qu'il ne se soucie nullement d'efficacité dans la
satire, qu'il gaspille manifestement par ses excès les excellentes
cartes que l'auteur détient. Mais c'est sans doute ici que l'on
s'aperçoit que Godard a visé juste : en dépassant la satire, en
allant bien au-delà de la dénonciation, de la fustigation, il a rendu
son film esthétiquement irrécupérable. Le stade oppositionnel, le
stade négatif eux-mêmes ont été hardiment et largement franchis.
Le renversement de signe, l'assimilation sont devenus impossibles.
d'une cour de ferme) nous rappelle plus impérieusement la
présence d'un artiste, au sens le plus noble du terme, que la parti-
cipation d'un authentique cinéaste à l'action, comme ce fut le cas
pour Fritz Lang dans Le Mépris. C'est là un effet de «distanciation »
assez étonnant de l'auteur vis-à-vis de sa création, et c'est peut-
être cet effet qui, créant au sein de l'œuvre une contradiction
hurlante, une antinomie irréductible (« Tout est laid, hors le
regard de l'artiste », dit Godard, et, ce disant, il étale devant
nous la laideur avec une rage qui va crescendo), fait de Week-
End un film qui dérange réellement et profondément. Il faut
ajouter que ce monstrueux canular sanglant est d'autant plus
difficile à accepter qu'il ne se soucie nullement d'efficacité dans la
satire, qu'il gaspille manifestement par ses excès les excellentes
cartes que l'auteur détient. Mais c'est sans doute ici que l'on
s'aperçoit que Godard a visé juste : en dépassant la satire, en
allant bien au-delà de la dénonciation, de la fustigation, il a rendu
son film esthétiquement irrécupérable. Le stade oppositionnel, le
stade négatif eux-mêmes ont été hardiment et largement franchis.
Le renversement de signe, l'assimilation sont devenus impossibles.
Mais, au fond, ce que Godard a pratiqué à l'intérieur de son
propre film, n'est-ce pas une sorte d'intégration ? En harmonisant,
en amalgamant par une construction dramatique qui progresse
dans l'horreur avec une grande rigueur (une grande rationalité),
les éléments discordants et contradictoires de son œuvre, ne
l'a-t-il pas transformée en une espèce d'« univers clos »? Cet uni-
vers clos à l'intérieur d'un univers clos, c'est un coin enfoncé dans
le bois, c'est une faille ouverte dans un bloc compact. Telle sera la
tâche de l'artiste : essayer de bloquer un mécanisme d'accumu-
lation à l'infini, freiner la course au quantitatif en rétablissant les
droits du qualitatif. Dans une civilisation où besoins sociaux et
besoins individuels ont été confondus u, cela signifie reconquérir
pleinement les privilèges du Je, libérer de ses chaînes la subjec-
tivité. C'est-à-dire d'abord restaurer le dialogue qui a été rompu
par la mutation culturelle, qu'évoqué Claude Brémond, constatant
que, si la culture traditionnelle allait de l'individu à la production,
la culture moderne va de la production à l'individu12. Dans le
premier cas, l'initiative du « consommateur » sauvegardait le lien
interpersonnel ; dans le second, au contraire, le « consommateur »
a affaire à un objet, qui sollicite son intérêt par les moyens propres
à l'objet. L'exemple du livre de poche est caractéristique : Claude
propre film, n'est-ce pas une sorte d'intégration ? En harmonisant,
en amalgamant par une construction dramatique qui progresse
dans l'horreur avec une grande rigueur (une grande rationalité),
les éléments discordants et contradictoires de son œuvre, ne
l'a-t-il pas transformée en une espèce d'« univers clos »? Cet uni-
vers clos à l'intérieur d'un univers clos, c'est un coin enfoncé dans
le bois, c'est une faille ouverte dans un bloc compact. Telle sera la
tâche de l'artiste : essayer de bloquer un mécanisme d'accumu-
lation à l'infini, freiner la course au quantitatif en rétablissant les
droits du qualitatif. Dans une civilisation où besoins sociaux et
besoins individuels ont été confondus u, cela signifie reconquérir
pleinement les privilèges du Je, libérer de ses chaînes la subjec-
tivité. C'est-à-dire d'abord restaurer le dialogue qui a été rompu
par la mutation culturelle, qu'évoqué Claude Brémond, constatant
que, si la culture traditionnelle allait de l'individu à la production,
la culture moderne va de la production à l'individu12. Dans le
premier cas, l'initiative du « consommateur » sauvegardait le lien
interpersonnel ; dans le second, au contraire, le « consommateur »
a affaire à un objet, qui sollicite son intérêt par les moyens propres
à l'objet. L'exemple du livre de poche est caractéristique : Claude
II. Voir L'homme unidimensionnel, pp. 15-16.
12-13. (< Lutte des classes de culture », in Communications, n° 2.
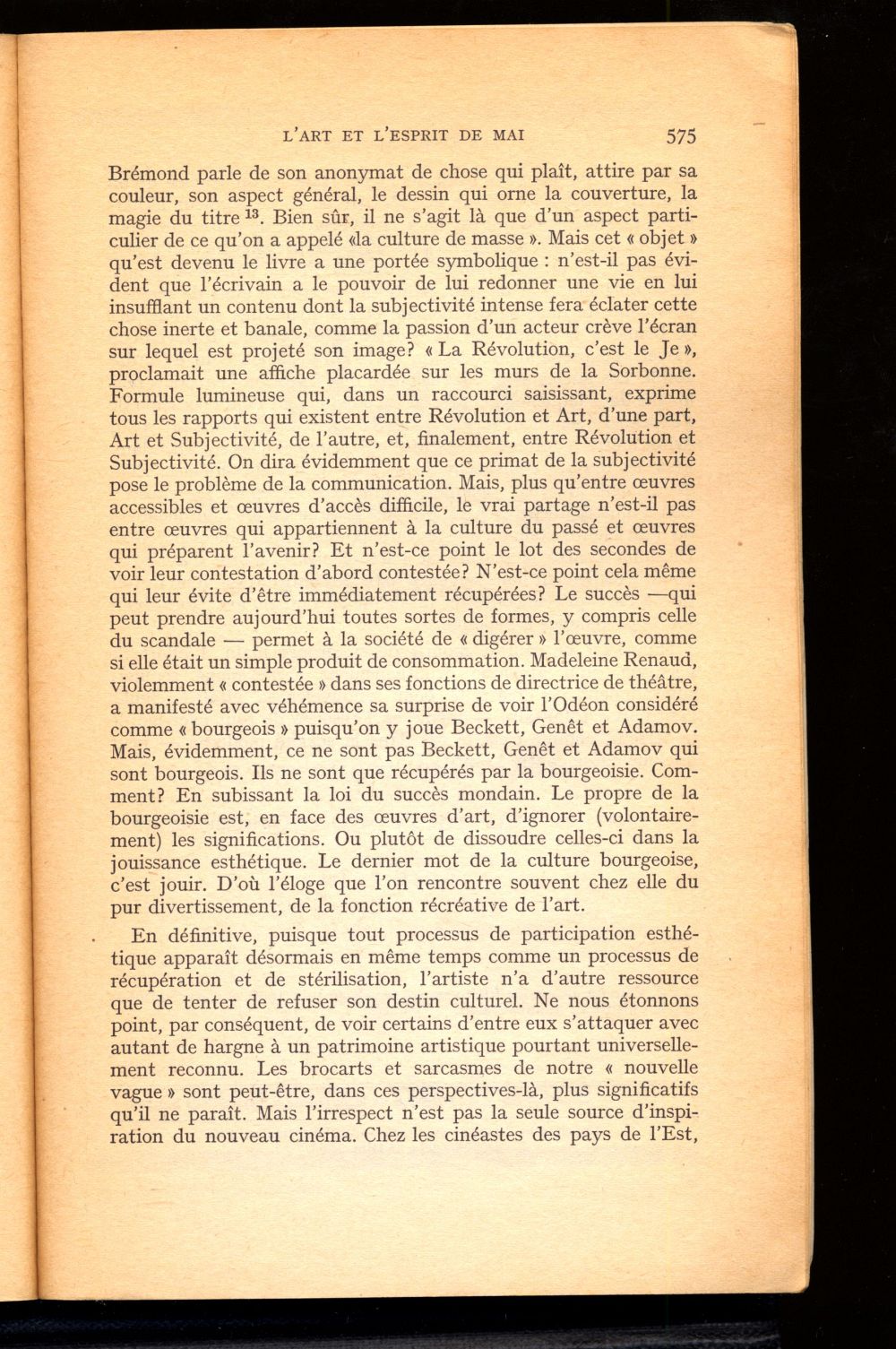

L'ART ET L'ESPRIT DE MAI
575
Brémond parle de son anonymat de chose qui plaît, attire par sa
couleur, son aspect général, le dessin qui orne la couverture, la
magie du titre ls. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un aspect parti-
culier de ce qu'on a appelé «la culture de masse ». Mais cet « objet »
qu'est devenu le livre a une portée symbolique : n'est-il pas évi-
dent que l'écrivain a le pouvoir de lui redonner une vie en lui
insufflant un contenu dont la subjectivité intense fera éclater cette
chose inerte et banale, comme la passion d'un acteur crève l'écran
sur lequel est projeté son image? « La Révolution, c'est le Je »,
proclamait une affiche placardée sur les murs de la Sorbonne.
Formule lumineuse qui, dans un raccourci saisissant, exprime
tous les rapports qui existent entre Révolution et Art, d'une part,
Art et Subjectivité, de l'autre, et, finalement, entre Révolution et
Subjectivité. On dira évidemment que ce primat de la subjectivité
pose le problème de la communication. Mais, plus qu'entre œuvres
accessibles et oeuvres d'accès difficile, le vrai partage n'est-il pas
entre œuvres qui appartiennent à la culture du passé et œuvres
qui préparent l'avenir? Et n'est-ce point le lot des secondes de
voir leur contestation d'abord contestée? N'est-ce point cela même
qui leur évite d'être immédiatement récupérées? Le succès —qui
peut prendre aujourd'hui toutes sortes de formes, y compris celle
du scandale — permet à la société de « digérer » l'œuvre, comme
si elle était un simple produit de consommation. Madeleine Renaud,
violemment « contestée » dans ses fonctions de directrice de théâtre,
a manifesté avec véhémence sa surprise de voir l'Odéon considéré
comme « bourgeois » puisqu'on y joue Beckett, Genêt et Adamov.
Mais, évidemment, ce ne sont pas Beckett, Genêt et Adamov qui
sont bourgeois. Ils ne sont que récupérés par la bourgeoisie. Com-
ment? En subissant la loi du succès mondain. Le propre de la
bourgeoisie est, en face des œuvres d'art, d'ignorer (volontaire-
ment) les significations. Ou plutôt de dissoudre celles-ci dans la
jouissance esthétique. Le dernier mot de la culture bourgeoise,
c'est jouir. D'où l'éloge que l'on rencontre souvent chez elle du
pur divertissement, de la fonction récréative de l'art.
couleur, son aspect général, le dessin qui orne la couverture, la
magie du titre ls. Bien sûr, il ne s'agit là que d'un aspect parti-
culier de ce qu'on a appelé «la culture de masse ». Mais cet « objet »
qu'est devenu le livre a une portée symbolique : n'est-il pas évi-
dent que l'écrivain a le pouvoir de lui redonner une vie en lui
insufflant un contenu dont la subjectivité intense fera éclater cette
chose inerte et banale, comme la passion d'un acteur crève l'écran
sur lequel est projeté son image? « La Révolution, c'est le Je »,
proclamait une affiche placardée sur les murs de la Sorbonne.
Formule lumineuse qui, dans un raccourci saisissant, exprime
tous les rapports qui existent entre Révolution et Art, d'une part,
Art et Subjectivité, de l'autre, et, finalement, entre Révolution et
Subjectivité. On dira évidemment que ce primat de la subjectivité
pose le problème de la communication. Mais, plus qu'entre œuvres
accessibles et oeuvres d'accès difficile, le vrai partage n'est-il pas
entre œuvres qui appartiennent à la culture du passé et œuvres
qui préparent l'avenir? Et n'est-ce point le lot des secondes de
voir leur contestation d'abord contestée? N'est-ce point cela même
qui leur évite d'être immédiatement récupérées? Le succès —qui
peut prendre aujourd'hui toutes sortes de formes, y compris celle
du scandale — permet à la société de « digérer » l'œuvre, comme
si elle était un simple produit de consommation. Madeleine Renaud,
violemment « contestée » dans ses fonctions de directrice de théâtre,
a manifesté avec véhémence sa surprise de voir l'Odéon considéré
comme « bourgeois » puisqu'on y joue Beckett, Genêt et Adamov.
Mais, évidemment, ce ne sont pas Beckett, Genêt et Adamov qui
sont bourgeois. Ils ne sont que récupérés par la bourgeoisie. Com-
ment? En subissant la loi du succès mondain. Le propre de la
bourgeoisie est, en face des œuvres d'art, d'ignorer (volontaire-
ment) les significations. Ou plutôt de dissoudre celles-ci dans la
jouissance esthétique. Le dernier mot de la culture bourgeoise,
c'est jouir. D'où l'éloge que l'on rencontre souvent chez elle du
pur divertissement, de la fonction récréative de l'art.
En définitive, puisque tout processus de participation esthé-
tique apparaît désormais en même temps comme un processus de
récupération et de stérilisation, l'artiste n'a d'autre ressource
que de tenter de refuser son destin culturel. Ne nous étonnons
point, par conséquent, de voir certains d'entre eux s'attaquer avec
autant de hargne à un patrimoine artistique pourtant universelle-
ment reconnu. Les brocarts et sarcasmes de notre « nouvelle
vague » sont peut-être, dans ces perspectives-là, plus significatifs
qu'il ne paraît. Mais l'irrespect n'est pas la seule source d'inspi-
ration du nouveau cinéma. Chez les cinéastes des pays de l'Est,
tique apparaît désormais en même temps comme un processus de
récupération et de stérilisation, l'artiste n'a d'autre ressource
que de tenter de refuser son destin culturel. Ne nous étonnons
point, par conséquent, de voir certains d'entre eux s'attaquer avec
autant de hargne à un patrimoine artistique pourtant universelle-
ment reconnu. Les brocarts et sarcasmes de notre « nouvelle
vague » sont peut-être, dans ces perspectives-là, plus significatifs
qu'il ne paraît. Mais l'irrespect n'est pas la seule source d'inspi-
ration du nouveau cinéma. Chez les cinéastes des pays de l'Est,
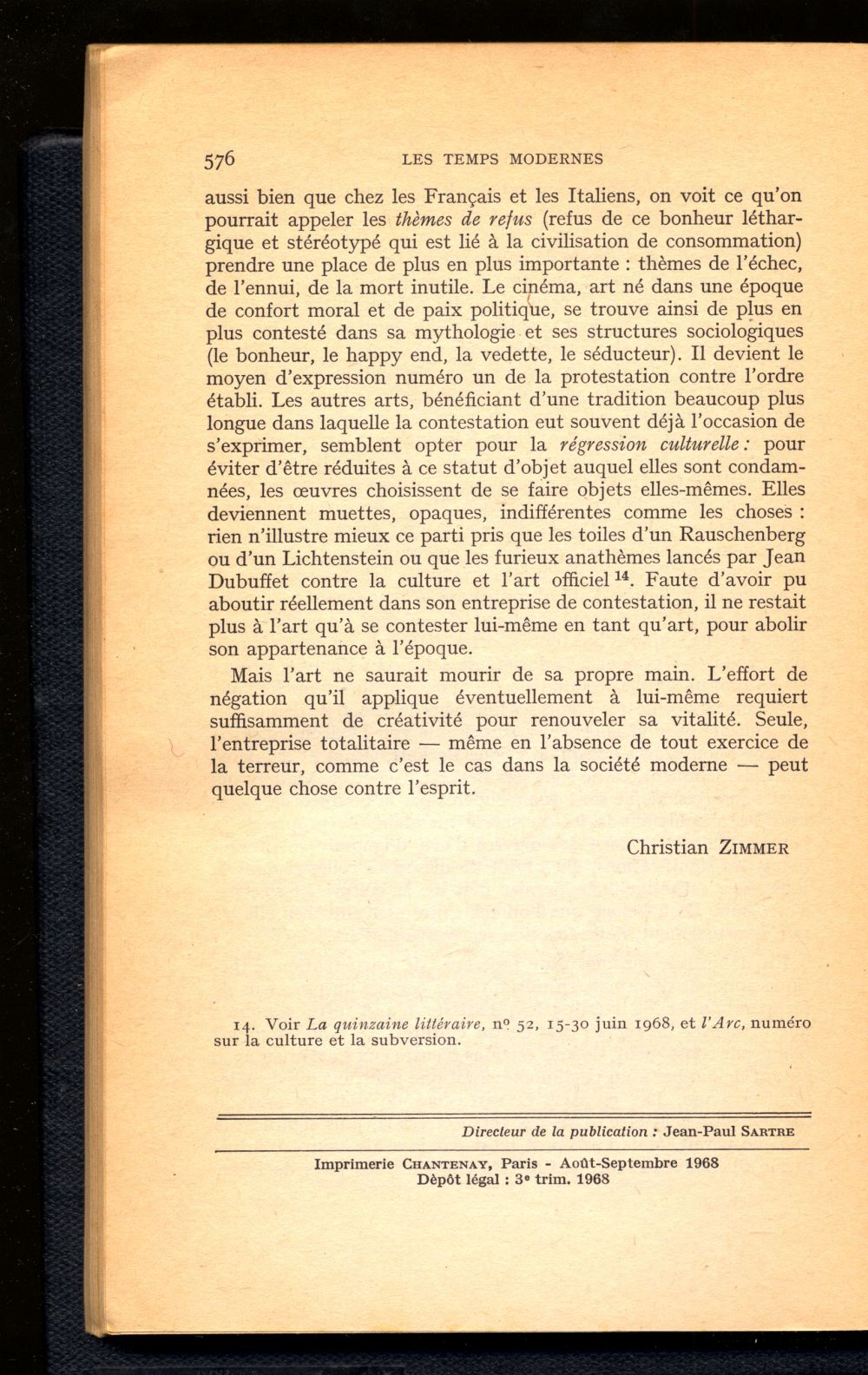

576
LES TEMPS MODERNES
aussi bien que chez les Français et les Italiens, on voit ce qu'on
pourrait appeler les thèmes de refus (refus de ce bonheur léthar-
gique et stéréotypé qui est lié à la civilisation de consommation)
prendre une place de plus en plus importante : thèmes de l'échec,
de l'ennui, de la mort inutile. Le cinéma, art né dans une époque
de confort moral et de paix politique, se trouve ainsi de plus en
plus contesté dans sa mythologie et ses structures sociologiques
(le bonheur, le happy end, la vedette, le séducteur). Il devient le
moyen d'expression numéro un de la protestation contre l'ordre
établi. Les autres arts, bénéficiant d'une tradition beaucoup plus
longue dans laquelle la contestation eut souvent déjà l'occasion de
s'exprimer, semblent opter pour la régression culturelle : pour
éviter d'être réduites à ce statut d'objet auquel elles sont condam-
nées, les œuvres choisissent de se faire objets elles-mêmes. Elles
deviennent muettes, opaques, indifférentes comme les choses :
rien n'illustre mieux ce parti pris que les toiles d'un Rauschenberg
ou d'un Lichtenstein ou que les furieux anathèmes lancés par Jean
Dubuffet contre la culture et l'art officielw. Faute d'avoir pu
aboutir réellement dans son entreprise de contestation, il ne restait
plus à l'art qu'à se contester lui-même en tant qu'art, pour abolir
son appartenance à l'époque.
pourrait appeler les thèmes de refus (refus de ce bonheur léthar-
gique et stéréotypé qui est lié à la civilisation de consommation)
prendre une place de plus en plus importante : thèmes de l'échec,
de l'ennui, de la mort inutile. Le cinéma, art né dans une époque
de confort moral et de paix politique, se trouve ainsi de plus en
plus contesté dans sa mythologie et ses structures sociologiques
(le bonheur, le happy end, la vedette, le séducteur). Il devient le
moyen d'expression numéro un de la protestation contre l'ordre
établi. Les autres arts, bénéficiant d'une tradition beaucoup plus
longue dans laquelle la contestation eut souvent déjà l'occasion de
s'exprimer, semblent opter pour la régression culturelle : pour
éviter d'être réduites à ce statut d'objet auquel elles sont condam-
nées, les œuvres choisissent de se faire objets elles-mêmes. Elles
deviennent muettes, opaques, indifférentes comme les choses :
rien n'illustre mieux ce parti pris que les toiles d'un Rauschenberg
ou d'un Lichtenstein ou que les furieux anathèmes lancés par Jean
Dubuffet contre la culture et l'art officielw. Faute d'avoir pu
aboutir réellement dans son entreprise de contestation, il ne restait
plus à l'art qu'à se contester lui-même en tant qu'art, pour abolir
son appartenance à l'époque.
Mais l'art ne saurait mourir de sa propre main. L'effort de
négation qu'il applique éventuellement à lui-même requiert
suffisamment de créativité pour renouveler sa vitalité. Seule,
l'entreprise totalitaire — même en l'absence de tout exercice de
la terreur, comme c'est le cas dans la société moderne •— peut
quelque chose contre l'esprit.
négation qu'il applique éventuellement à lui-même requiert
suffisamment de créativité pour renouveler sa vitalité. Seule,
l'entreprise totalitaire — même en l'absence de tout exercice de
la terreur, comme c'est le cas dans la société moderne •— peut
quelque chose contre l'esprit.
Christian ZIMMER
14. Voir La quinzaine littéraire, n" 52, 15-30 juin 1968, et l'Ave, numéro
sur la culture et la subversion.
sur la culture et la subversion.
Directeur de la publication : Jean-Paul SARTRE
Imprimerie CHANTENAY, Paris - Août-Septembre 1968
Dépôt légal : 3° trim. 1968
Dépôt légal : 3° trim. 1968
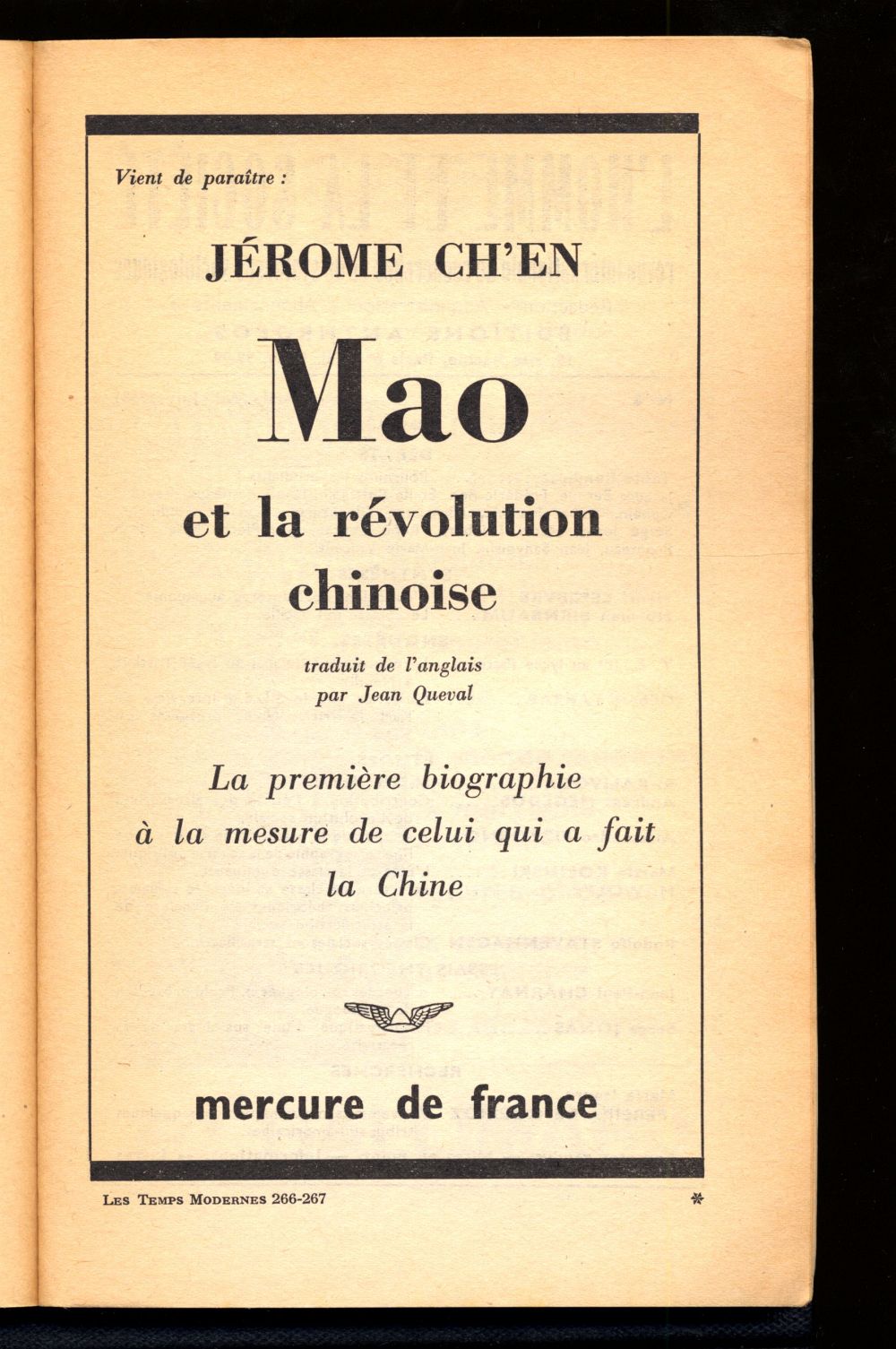

Vient de paraître :
JÉRÔME CH'EN
Mao
et la révolution
chinoise
chinoise
traduit de l'anglais
par Jean Queval
par Jean Queval
La première biographie
à la mesure de celui qui a fait
la Chine
mercure de france
LES TEMPS MODERNES 266-267
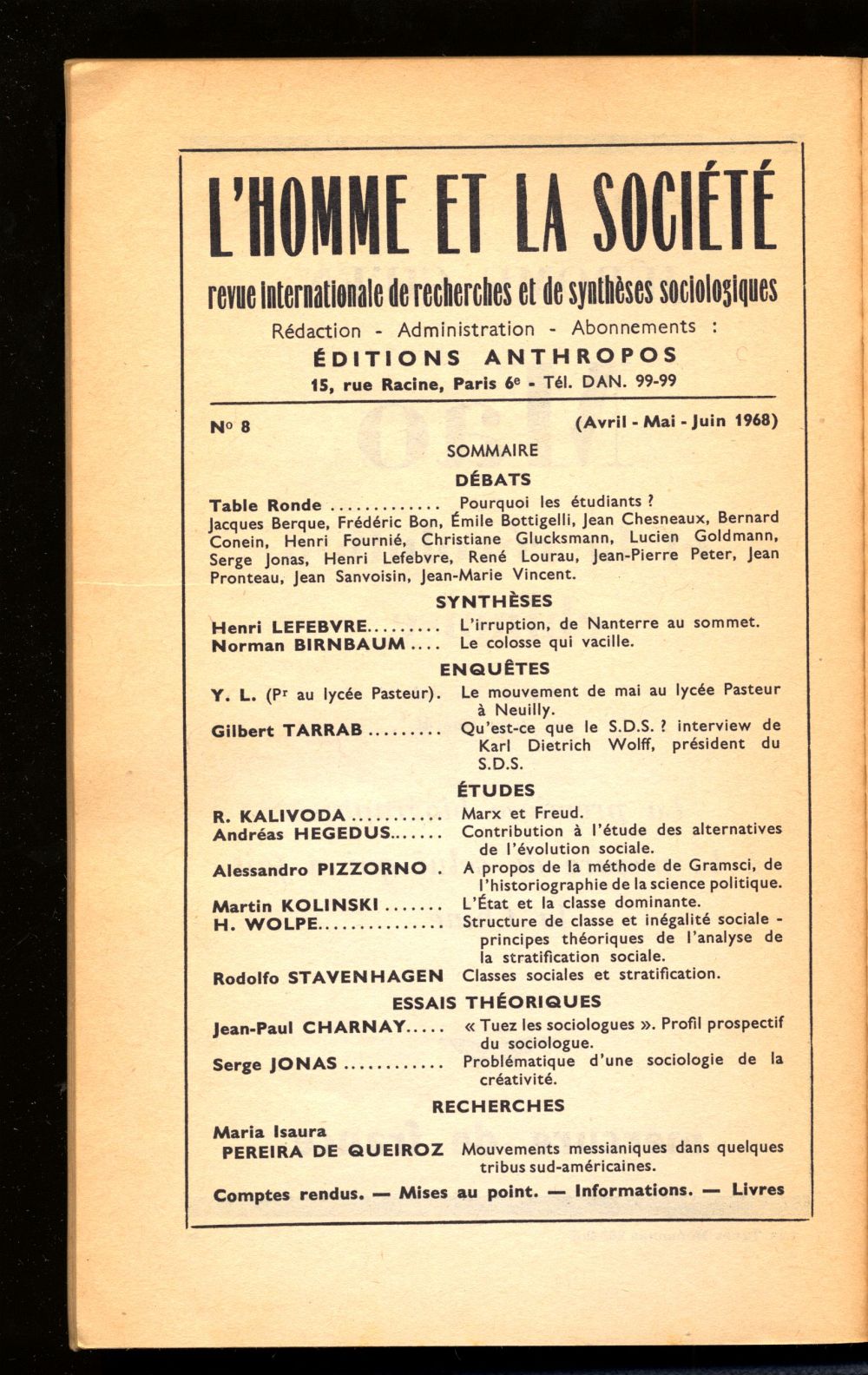

[ [1U SKjfjf
revue internationale de recherches et de synthèses sociologues
Rédaction - Administration - Abonnements :
ÉDITIONS ANTHROPOS
15, rue Racine, Paris 6e - Tél. DAN. 99-99
ÉDITIONS ANTHROPOS
15, rue Racine, Paris 6e - Tél. DAN. 99-99
N° 8
(Avril-Mai-Juin 1968)
SOMMAIRE
DÉBATS
Table Ronde............. Pourquoi les étudiants ?
Jacques Berque, Frédéric Bon, Emile Bottigelli, Jean Chesneaux, Bernard
Conein, Henri Fournie, Christiane Glucksmann, Lucien Goldmann,
Serge Jonas, Henri Lefebvre, René Lourau, Jean-Pierre Peter, Jean
Pronteau, Jean Sanvoisin, Jean-Marie Vincent.
Conein, Henri Fournie, Christiane Glucksmann, Lucien Goldmann,
Serge Jonas, Henri Lefebvre, René Lourau, Jean-Pierre Peter, Jean
Pronteau, Jean Sanvoisin, Jean-Marie Vincent.
SYNTHÈSES
Henri LEFEBVRE.......
Norman BIRNBAUM ..
L'irruption, de Nanterre au sommet.
Le colosse qui vacille.
Le colosse qui vacille.
ENQUÊTES
R. KAL1VODA..........
Andréas HEGEDUS......
Alessandro PIZZORNO
Y. L. (Pr au lycée Pasteur). Le mouvement de mai au lycée Pasteur
à Neuilly.
Gilbert TARRAB......... Qu'est-ce que le S.O.S. ? interview de
Gilbert TARRAB......... Qu'est-ce que le S.O.S. ? interview de
Karl Dietrich Wolff, président du
S.O.S.
ÉTUDES
Marx et Freud.
Contribution à l'étude des alternatives
de l'évolution sociale.
A propos de la méthode de Gramsci, de
l'historiographie de la science politique.
A propos de la méthode de Gramsci, de
l'historiographie de la science politique.
Martin KOLINSKI....... L'État et la classe dominante.
H. WOLPE............... Structure de classe et inégalité sociale -
principes théoriques de l'analyse de
la stratification sociale.
Rodolfo STAVENHAGEN Classes sociales et stratification.
la stratification sociale.
Rodolfo STAVENHAGEN Classes sociales et stratification.
ESSAIS THÉORIQUES
Jean-Paul CHARNAY..... « Tuez les sociologues ». Profil prospectif
du sociologue.
Serge JONAS............ Problématique d'une sociologie de la
créativité.
RECHERCHES
Maria Isaura
Maria Isaura
PEREIRA DE QUEIROZ Mouvements messianiques dans quelques
tribus sud-américaines.
Comptes rendus. — Mises au point. — Informations. — Livres
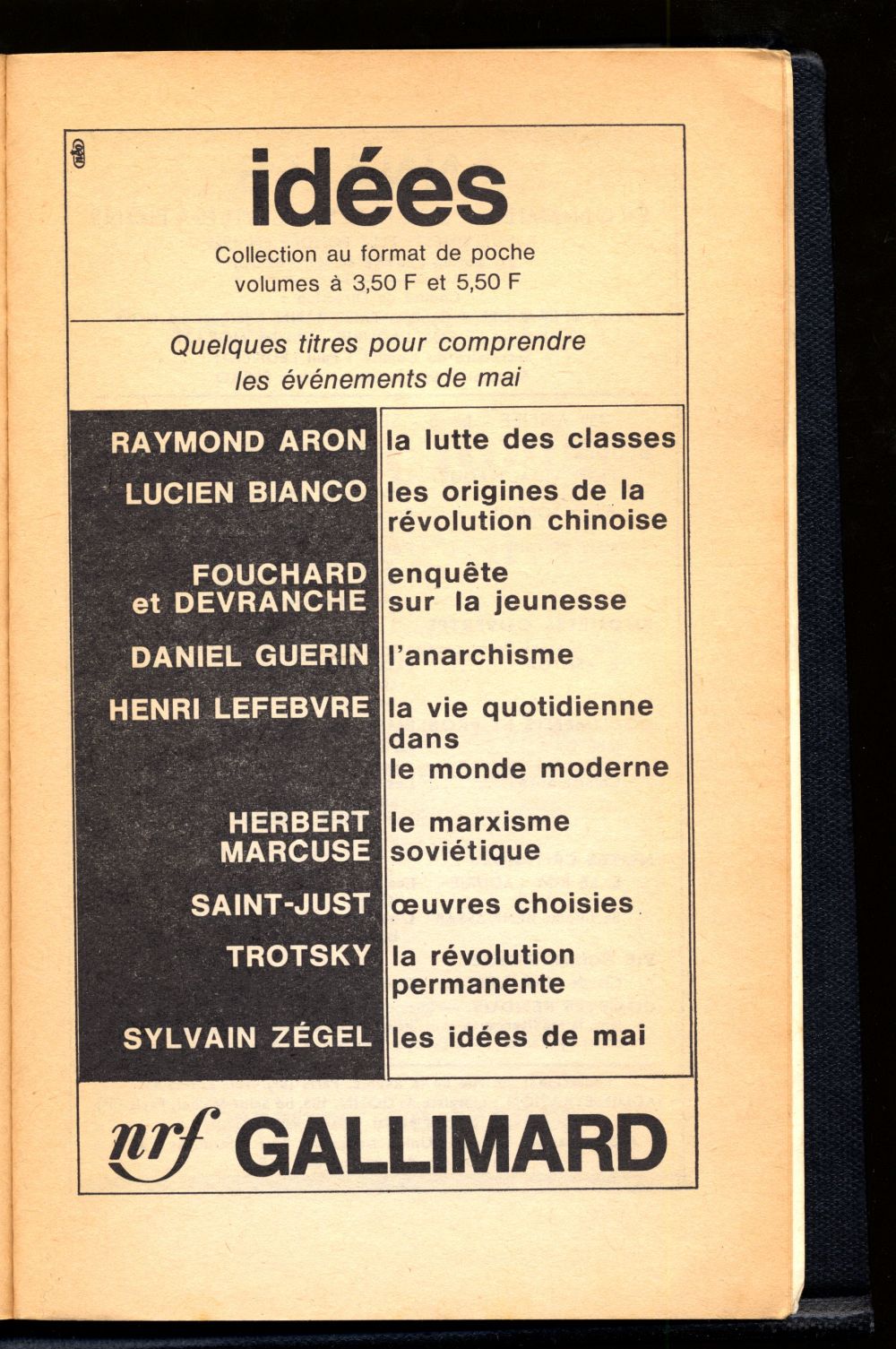

idées
Collection au format de poche
volumes à 3,50 F et 5,50 F
volumes à 3,50 F et 5,50 F
Quelques titres pour comprendre
les événements de mai
les événements de mai
RAYMOND ARON
LUCIEN BIANCO
LUCIEN BIANCO
FOUCHARD
et DEVRANCHE
et DEVRANCHE
DANIEL GUERIN
HENRI LEFEBVRE
HENRI LEFEBVRE
HERBERT
MARCUSE
MARCUSE
la lutte des classes
les origines de la
révolution chinoise
révolution chinoise
enquête
sur la jeunesse
l'anarchisme
la vie quotidienne
dans
le monde moderne
le marxisme
soviétique
soviétique
SAINT-JUST |C
uvres choisies
TROTSKY
SYLVAIN ZÉGEL
la révolution
permanente
permanente
les idées de mai
(///' GALLIMARD
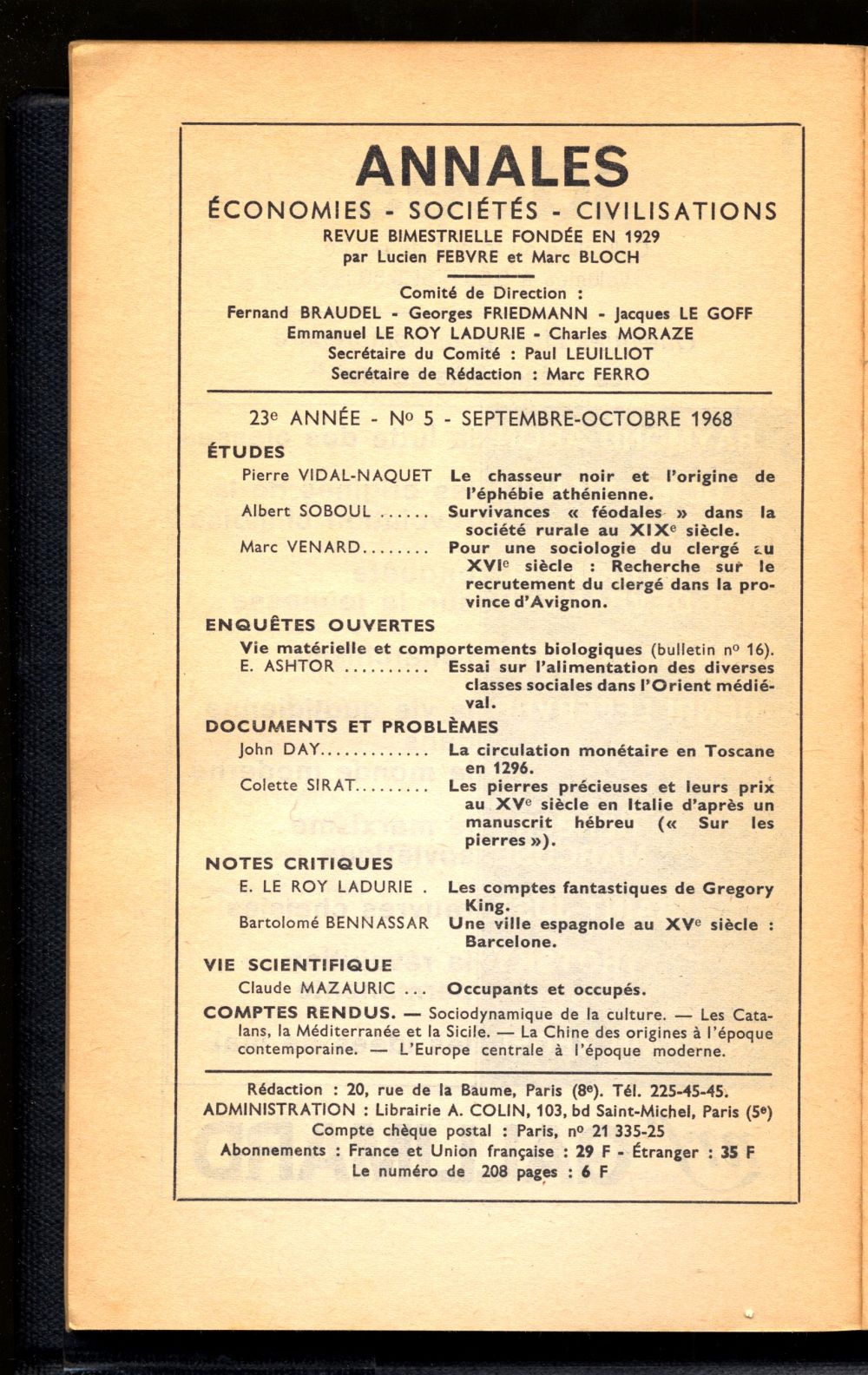

ANNALES
ÉCONOMIES - SOCIÉTÉS - CIVILISATIONS
REVUE BIMESTRIELLE FONDÉE EN 1929
par Lucien FEBVRE et Marc BLOCH
par Lucien FEBVRE et Marc BLOCH
Comité de Direction :
Fernand BRAUDEL - Georges FRIEDMANN - Jacques LE GOFF
Emmanuel LE ROY LADURIE - Charles MORAZE
Secrétaire du Comité : Paul LEUILLIOT
Secrétaire de Rédaction : Marc FERRO
23e ANNÉE - N° 5 - SEPTEMBRE-OCTOBRE 1968
ÉTUDES
Pierre VIDAL-NAQUET Le chasseur noir et l'origine de
l'éphébie athénienne.
l'éphébie athénienne.
Albert SOBOUL...... Survivances « féodales » dans la
société rurale au XIXe siècle.
Marc VENARD........ Pour une sociologie du clergé £.u
XVI siècle : Recherche sur le
recrutement du clergé dans la pro-
vince d'Avignon.
recrutement du clergé dans la pro-
vince d'Avignon.
ENQUÊTES OUVERTES
Vie matérielle et comportements biologiques (bulletin n° 16).
E. ASHTOR .......... Essai sur l'alimentation des diverses
classes sociales dans l'Orient médié-
val.
val.
DOCUMENTS ET PROBLÈMES
John DAY............. La circulation monétaire en Toscane
en 1296.
Colette SIRAT......... Les pierres précieuses et leurs prix
Colette SIRAT......... Les pierres précieuses et leurs prix
au XVe siècle en Italie d'après un
manuscrit hébreu (« Sur les
pierres »).
Les comptes fantastiques de Gregory
King.
Une ville espagnole au XVe siècle :
Une ville espagnole au XVe siècle :
Barcelone.
Occupants et occupés.
NOTES CRITIQUES
E. LE ROY LADURIE .
Bartolomé BENNASSAR
VIE SCIENTIFIQUE
Claude MAZAURIC ...
COMPTES RENDUS. — Sociodynamique de la culture. — Les Cata-
lans, la Méditerranée et la Sicile. — La Chine des origines à l'époque
contemporaine. — L'Europe centrale à l'époque moderne.
lans, la Méditerranée et la Sicile. — La Chine des origines à l'époque
contemporaine. — L'Europe centrale à l'époque moderne.
Rédaction : 20, rue de la Baume, Paris (8«). Tél. 225-45-45.
ADMINISTRATION : Librairie A. COLIN, 103, bd Saint-Michel, Paris (5«)
ADMINISTRATION : Librairie A. COLIN, 103, bd Saint-Michel, Paris (5«)
Compte chèque postal : Paris, n° 21 335-25
Abonnements : France et Union française : 29 F - Étranger : 35 F
Le numéro de 208 pages : 6 F
Le numéro de 208 pages : 6 F
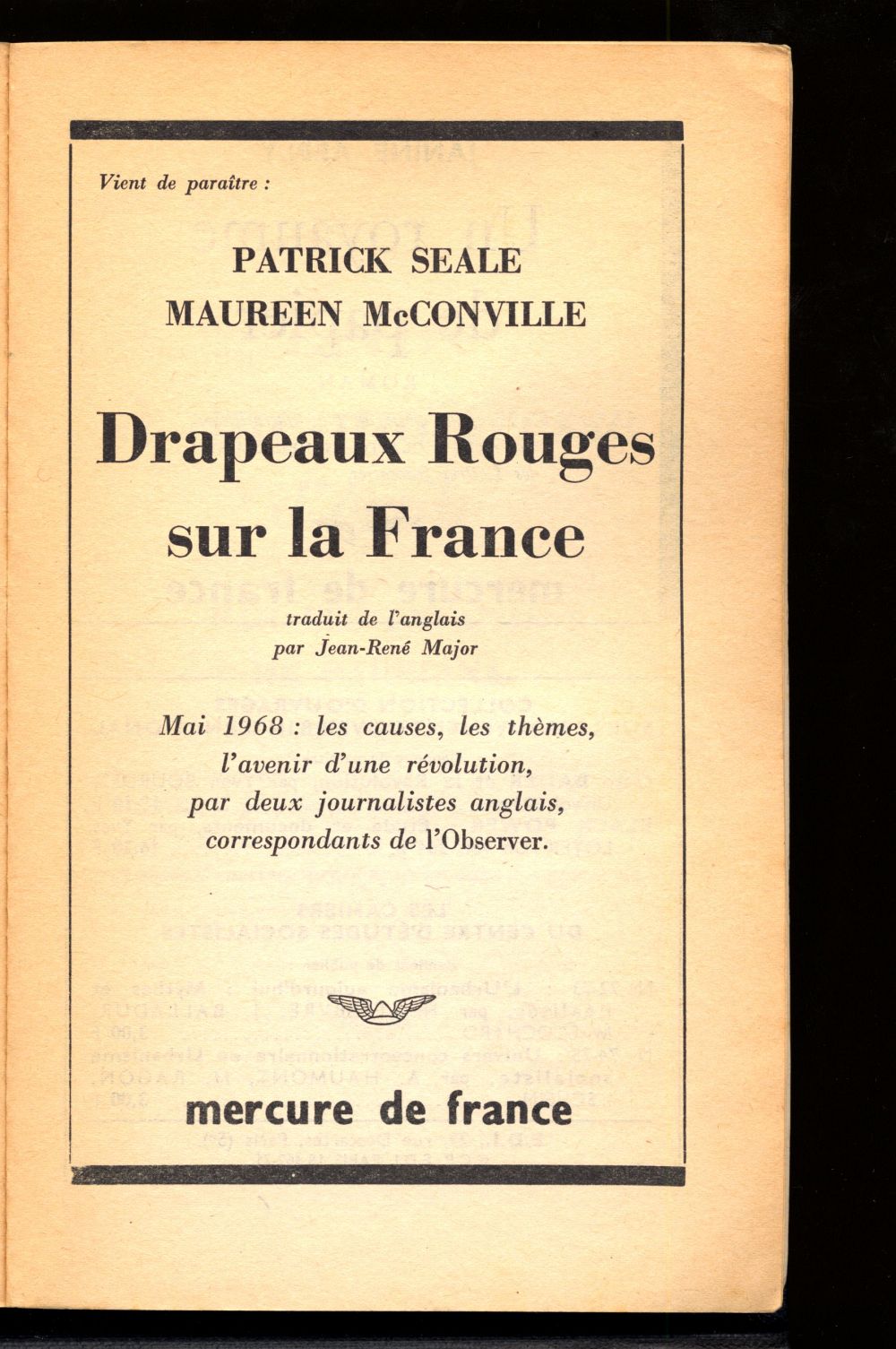

Vient de paraître :
PATRICK SEALE
MAUREEN McCONWLLE
MAUREEN McCONWLLE
Drapeaux Rouges
sur la France
sur la France
traduit de Vanglais
par Jean-René Major
par Jean-René Major
Mai 1968 : les causes, les thèmes,
l'avenir d'une révolution,
par deux journalistes anglais,
correspondants de l'Observer.
mercure de france


JANINE AEPLY
Un royaume
de papier
de papier
ROMAN
« L'enfance prise au piège merveilleux
des mots. » CLAUDE-MICHEL CLUNY,
les Lettres françaises.
des mots. » CLAUDE-MICHEL CLUNY,
les Lettres françaises.
mercure de france
COLLECTION D'OUVRAGES
SUR LE MOUVEMENT OUVRIER INTERNATION AL
SUR LE MOUVEMENT OUVRIER INTERNATION AL
viennent de paraître :
Otto BAUER et la Révolution, par Yvon BOURDET.
Otto BAUER et la Révolution, par Yvon BOURDET.
Un vol. 304 p............................... 18,10 F
BLACK POWER : Étude et documents, par Yves
LOYER. Un vol. 264 p..................... 16,20 F
*
* *
* *
LES CAHIERS
DU CENTRE D'ÉTUDES SOCIALISTES
DU CENTRE D'ÉTUDES SOCIALISTES
viennent de publier :
N° 72-73 : L'Urbanisme aujourd'hui : Mythes et
Réalités, par H. LEFEBVRE, J. BALLADUR,
M. ÉCOCHARD........................... 3,00 F
Réalités, par H. LEFEBVRE, J. BALLADUR,
M. ÉCOCHARD........................... 3,00 F
N° 74-75 : Univers concentrationnaire ou Urbanisme
socialiste, par A. HAUMONT, M. RAGON,
I. SCHEIN................................. 3,00 F
socialiste, par A. HAUMONT, M. RAGON,
I. SCHEIN................................. 3,00 F
E.D.I., 29, rue Descartes, Paris (5e).
C.C.P. E.D.I. PARIS 18.462-71
C.C.P. E.D.I. PARIS 18.462-71
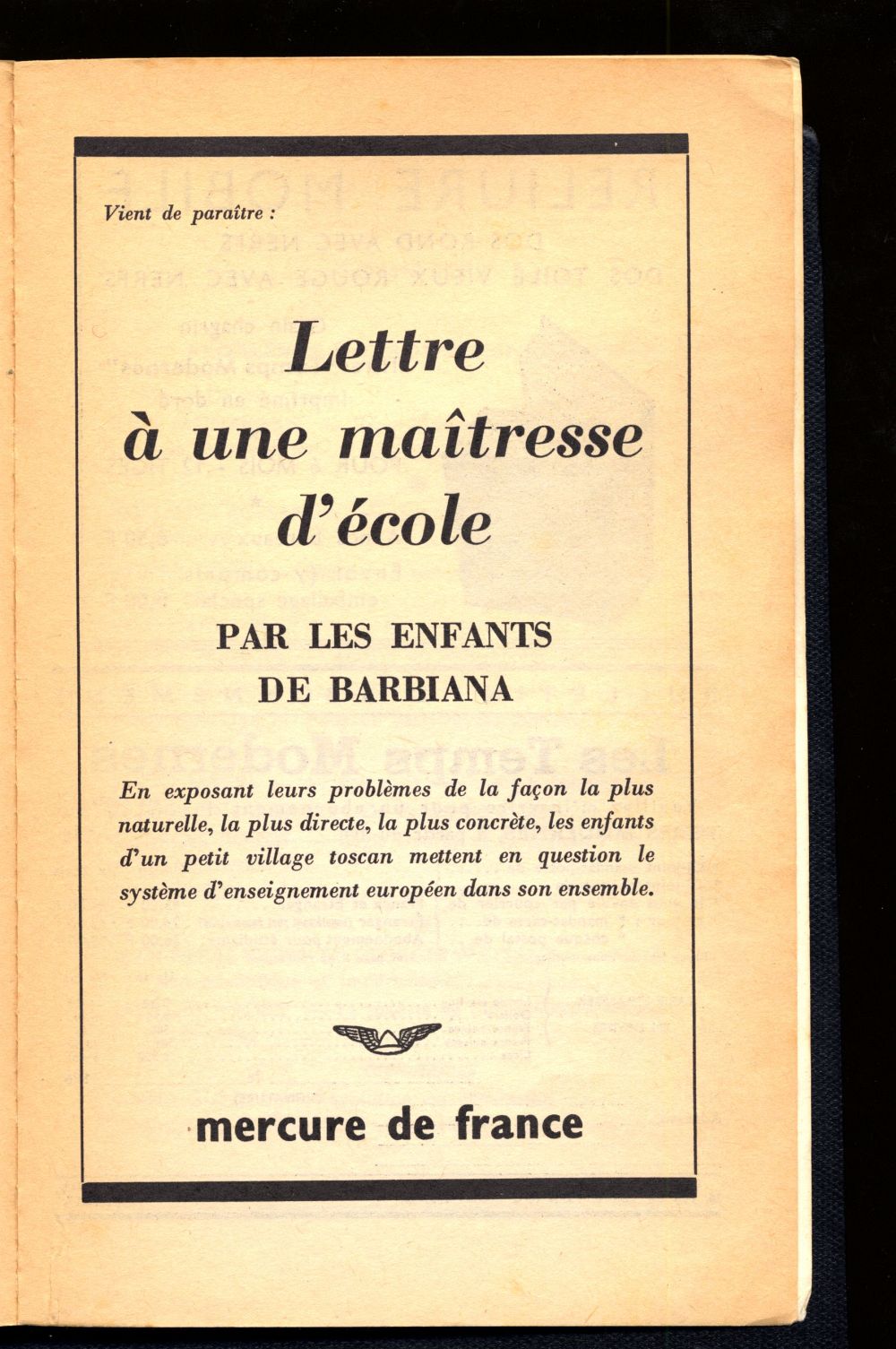

Vient de paraître :
Lettre
à une maîtresse
d'école
d'école
PAR LES ENFANTS
DE BARBIANA
DE BARBIANA
En exposant leurs problèmes de la façon la plus
naturelle, la plus directe, la plus concrète, les enfants
d'un petit village toscan mettent en question le
système d'enseignement européen dans son ensemble.
naturelle, la plus directe, la plus concrète, les enfants
d'un petit village toscan mettent en question le
système d'enseignement européen dans son ensemble.
mercure de france


RELIURE MOBILE
DOS ROND AVEC NERFS
DOS TOILE VIEUX ROUGE AVEC NERFS
DOS TOILE VIEUX ROUGE AVEC NERFS
Grain chagrin
Titre "Temps Modernes"
Imprimé en doré
*
POUR 6 MOIS - 12 TIGES
*
*
A nos bureaux .... 6,50 F
Envoi (y compris
emballage spécial. 8,00F
emballage spécial. 8,00F
BULLETIN
D'ABONNEMENT
Les Temps Modernes
Veuillez m'inscrire pour un abonnement de j * UN AN'S
TEMPS MODERNES, à partir du 1er._._......._......._._......._...................___ 196_
TEMPS MODERNES, à partir du 1er._._......._......._._......._...................___ 196_
Un an Six mois
* Ci-joint mandat-poste de
* Ci-joint chèque de
* Je vous envoie par courrier de
ce jour : * mandat-carte de....
* chèque postal de...
ce jour : * mandat-carte de....
* chèque postal de...
Rayer les mentions inutiles.
France et Étranger......... 45,00 F 24.00 F
Étranger (supplément port recommandé) 24,00F 12,00F
Abonnement pour étudiants. 36,00 F 18,00 F
voir page II de couvertuae
TARIF ÉTRANGER
Un an ........................ 3/12
Six moi 1/19
Six moi 1/19
Dollar .............
........................ 9 75
5,20
........................ 9 75
5,20
EN DEVISES
....... 500
265
265
...................... 44
23 50
23 50
................ 6 350
3 400
3 400
, le
196
196
Nom
(SIGNATURE)
Adresse
Détacher le bulletin ci-joint et l'adresser à M. le Directeur des TEMPS MODERNES,
2i, rue de Condé, Paris (6«). C.C.P. «979-04. (266-267)
2i, rue de Condé, Paris (6«). C.C.P. «979-04. (266-267)
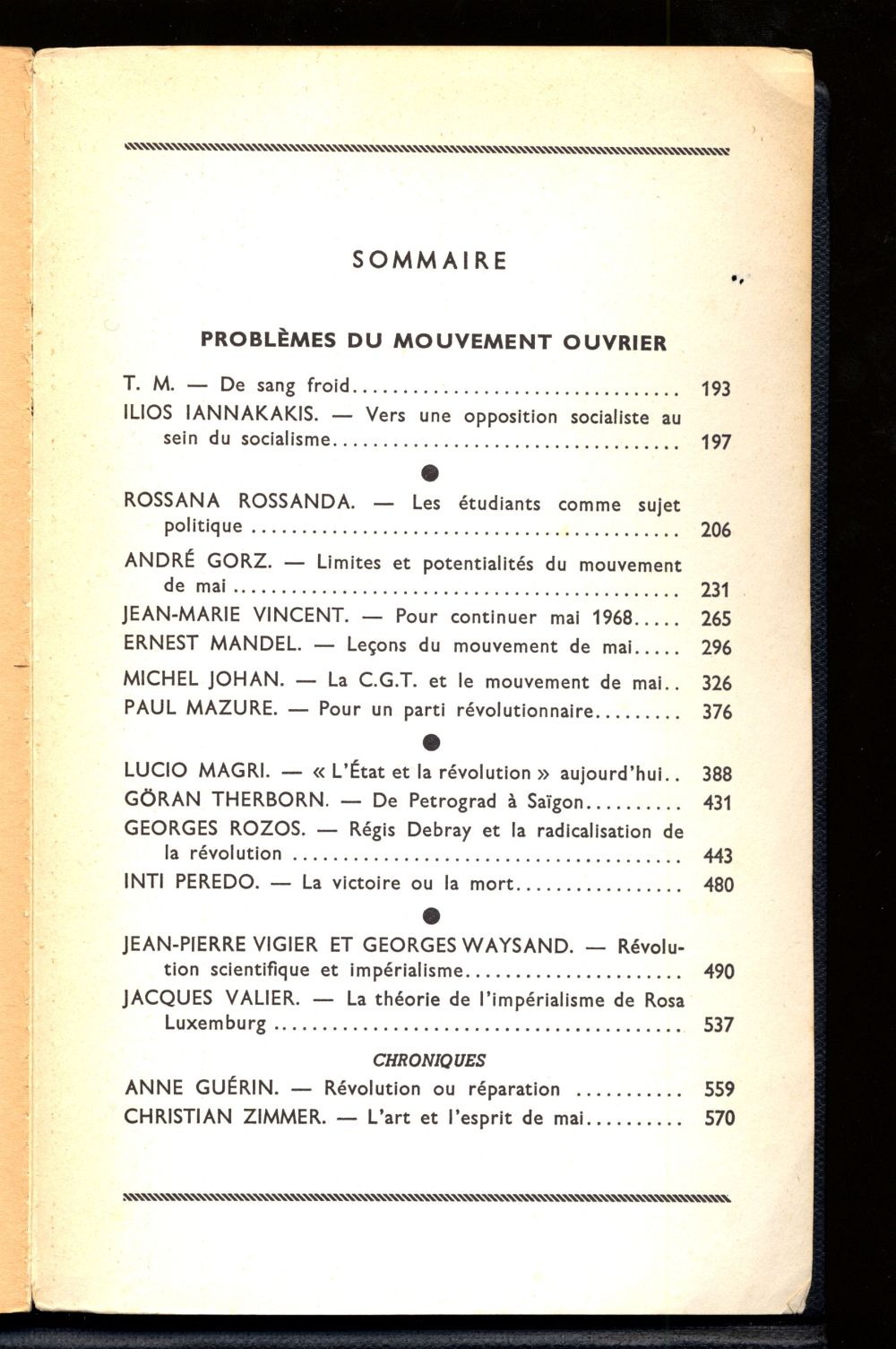

.XXV\\.V\.XXXV\VC^XXV>^\.X>^WV
SOMMAIRE
• ,
PROBLÈMES DU MOUVEMENT OUVRIER
T. M. — De sang froid................................. 193
ILIOS IANNAKAKIS. — Vers une opposition socialiste au
sein du socialisme................................... 197
•
ROSSANA ROSSANDA. — Les étudiants comme sujet
ROSSANA ROSSANDA. — Les étudiants comme sujet
politique........................................... 206
ANDRÉ GORZ. — Limites et potentialités du mouvement
de mai............................................. 231
JEAN-MARIE VINCENT. — Pour continuer mai 1968..... 265
ERNEST MANDEL. — Leçons du mouvement de mai..... 296
MICHEL JOHAN. — La C.G.T. et le mouvement de mai.. 326
PAUL MAZURE. — Pour un parti révolutionnaire......... 376
PAUL MAZURE. — Pour un parti révolutionnaire......... 376
LUCIO MAGRI. — « L'État et la révolution » aujourd'hui.. 388
GÔRAN THERBORN. — De Petrograd à Saïgon.......... 431
GEORGES ROZOS. — Régis Debray et la radicalisation de
la révolution ....................................... 443
INTI PEREDO. — La victoire ou la mort................. 480
JEAN-PIERRE VICIER ET GEORGES WAYSAND. — Révolu-
tion scientifique et impérialisme...................... 490
tion scientifique et impérialisme...................... 490
JACQUES VALIER. — La théorie de l'impérialisme de Rosa
Luxemburg......................................... 537
CHRONIQUES
ANNE GUÉRIN. — Révolution ou réparation ........... 559
CHRISTIAN ZIMMER. — L'art et l'esprit de mai.......... 570
MNC«^
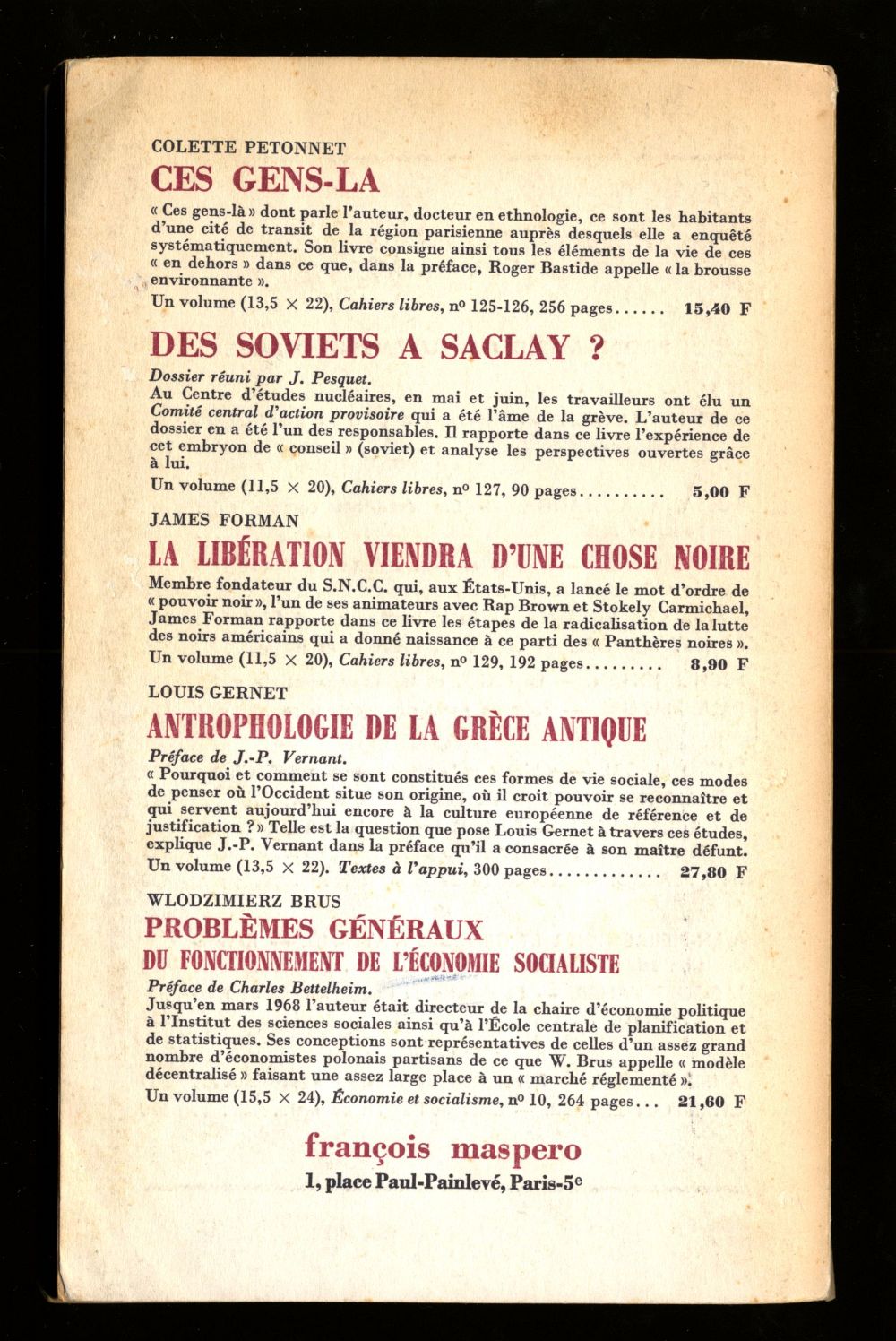

COLETTE PETONNET
CES GENS-LA
« Ces gens-là » dont parle l'auteur, docteur en ethnologie, ce sont les habitants
d'une cité de transit de la région parisienne auprès desquels elle a enquêté
systématiquement. Sou livre consigne ainsi tous les éléments de la vie de ces
« en dehors » dans ce que, dans la préface, Roger Bastide appelle « la brousse
environnante ».
Un volume (13,5 X 22), Cahiers libres, n° 125-126, 256 pages...... 15,40 F
d'une cité de transit de la région parisienne auprès desquels elle a enquêté
systématiquement. Sou livre consigne ainsi tous les éléments de la vie de ces
« en dehors » dans ce que, dans la préface, Roger Bastide appelle « la brousse
environnante ».
Un volume (13,5 X 22), Cahiers libres, n° 125-126, 256 pages...... 15,40 F
DES SOVIETS A SACLAY ?
Dossier réuni par J. Pesquet.
Au Centre d'études nucléaires, en mai et juin, les travailleurs ont élu un
Comité central d'action provisoire qui a été l'âme de la grève. L'auteur de ce
dossier en a été l'un des responsables. II rapporte dans ce livre l'expérience de
cet embryon de « conseil » (soviet) et analyse les perspectives ouvertes grâce
à lui.
Un volume (11,5 X 20), Cahiers libres, u° 127, 90 pages.......... 5,00 F
JAMES FORMAN
LA LIBÉRATION VIENDRA D'UNE CHOSE NOIRE
Membre fondateur du S.N.C.C. qui, aux États-Unis, a lancé le mot d'ordre de
« pouvoir noir», l'un de ses animateurs avec Rap Brown et Stokely Carmichael,
James Forman rapporte dans ce livre les étapes de la radicalisation de la lutte
des noirs américains qui a donné naissance à ce parti des « Panthères noires ».
Un volume (11,5 X 20), Cahiers libres, n° 129, 192 pages......... 8,90 F
« pouvoir noir», l'un de ses animateurs avec Rap Brown et Stokely Carmichael,
James Forman rapporte dans ce livre les étapes de la radicalisation de la lutte
des noirs américains qui a donné naissance à ce parti des « Panthères noires ».
Un volume (11,5 X 20), Cahiers libres, n° 129, 192 pages......... 8,90 F
LOUIS GERNET
ANTROPHOLOGIE DE LA GRÈCE ANTIQUE
Préface de J.-P. Vernant.
« Pourquoi et comment se sont constitués ces formes de vie sociale, ces modes
de penser où l'Occident situe sou origine, où il croit pouvoir se reconnaître et
qui servent aujourd'hui encore à la culture européenne de référence et de
justification ? » Telle est la question que pose Louis Gernet à travers ces études,
explique J.-P. Vernant dans la préface qu'il a consacrée à son maître défunt.
Un volume (13,5 X 22). Textes à l'appui, 300 pages............. 27,80 F
de penser où l'Occident situe sou origine, où il croit pouvoir se reconnaître et
qui servent aujourd'hui encore à la culture européenne de référence et de
justification ? » Telle est la question que pose Louis Gernet à travers ces études,
explique J.-P. Vernant dans la préface qu'il a consacrée à son maître défunt.
Un volume (13,5 X 22). Textes à l'appui, 300 pages............. 27,80 F
WLODZIMIERZ BRUS
PROBLÈMES GÉNÉRAUX
DU FONCTIONNEMENT DE L'ÉCONOMIE SOCIALISTE
Préface de Charles Bettelheim.
Jusqu'en mars 1968 l'auteur était directeur de la chaire d'économie politique
à l'Institut des sciences sociales ainsi qu'à l'École centrale de planification et
de statistiques. Ses conceptions sont représentatives de celles d'un assez grand
nombre d'économistes polonais partisans de ce que W. Brus appelle « modèle
décentralisé » faisant une assez large place à nu « marché réglementé ».
Un volume (15,5 X 24), Économie et socialisme, n° 10, 264 pages... 21,60 F
françois maspero
1, place Paul-Painlevé, Paris-5e
Category
Title
Les temps modernes
Issue
no.266-267
Date
08/1968;09/1968
Keywords
Publication information
no.266-267