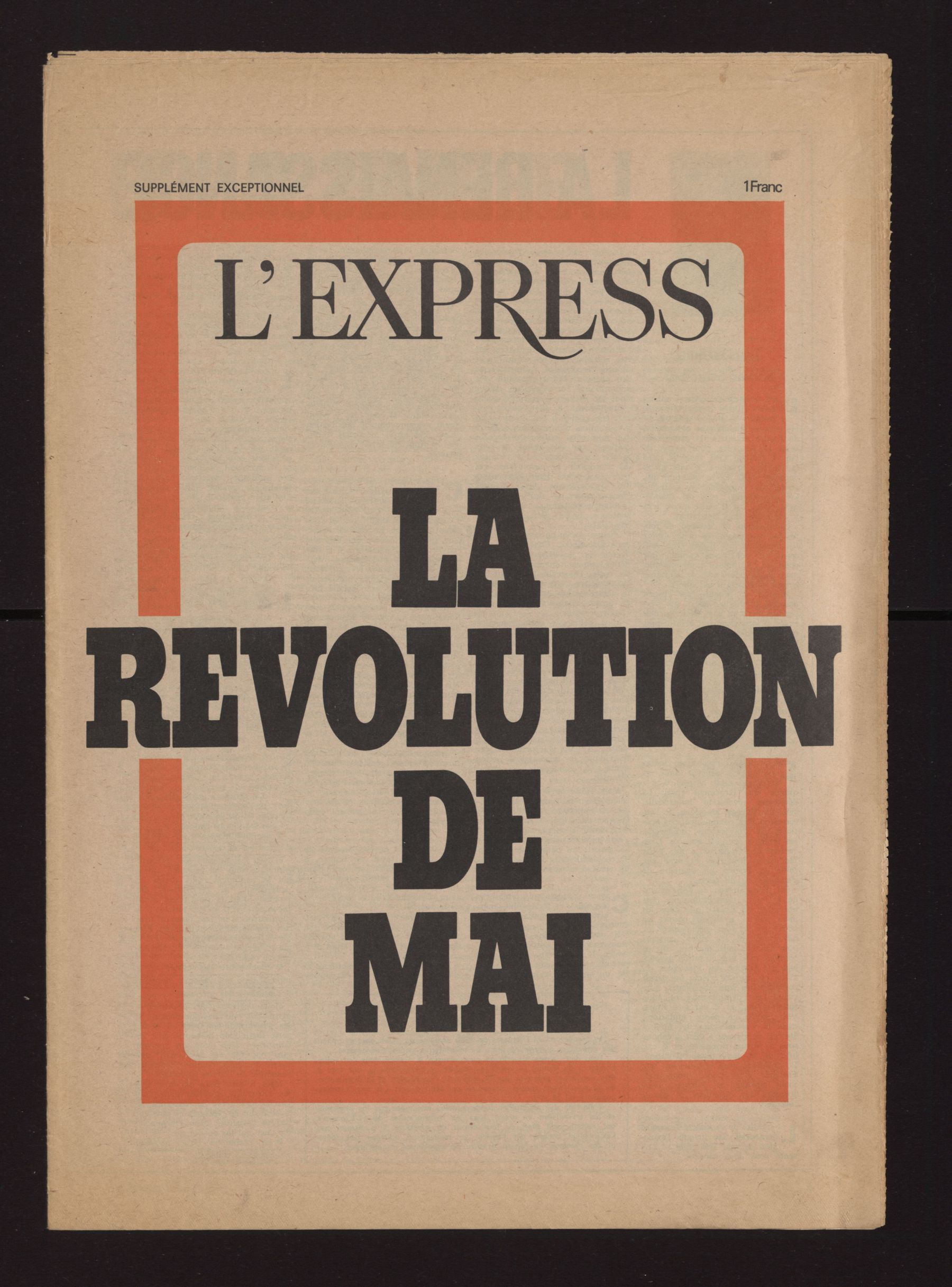L'Express
Thumbnail
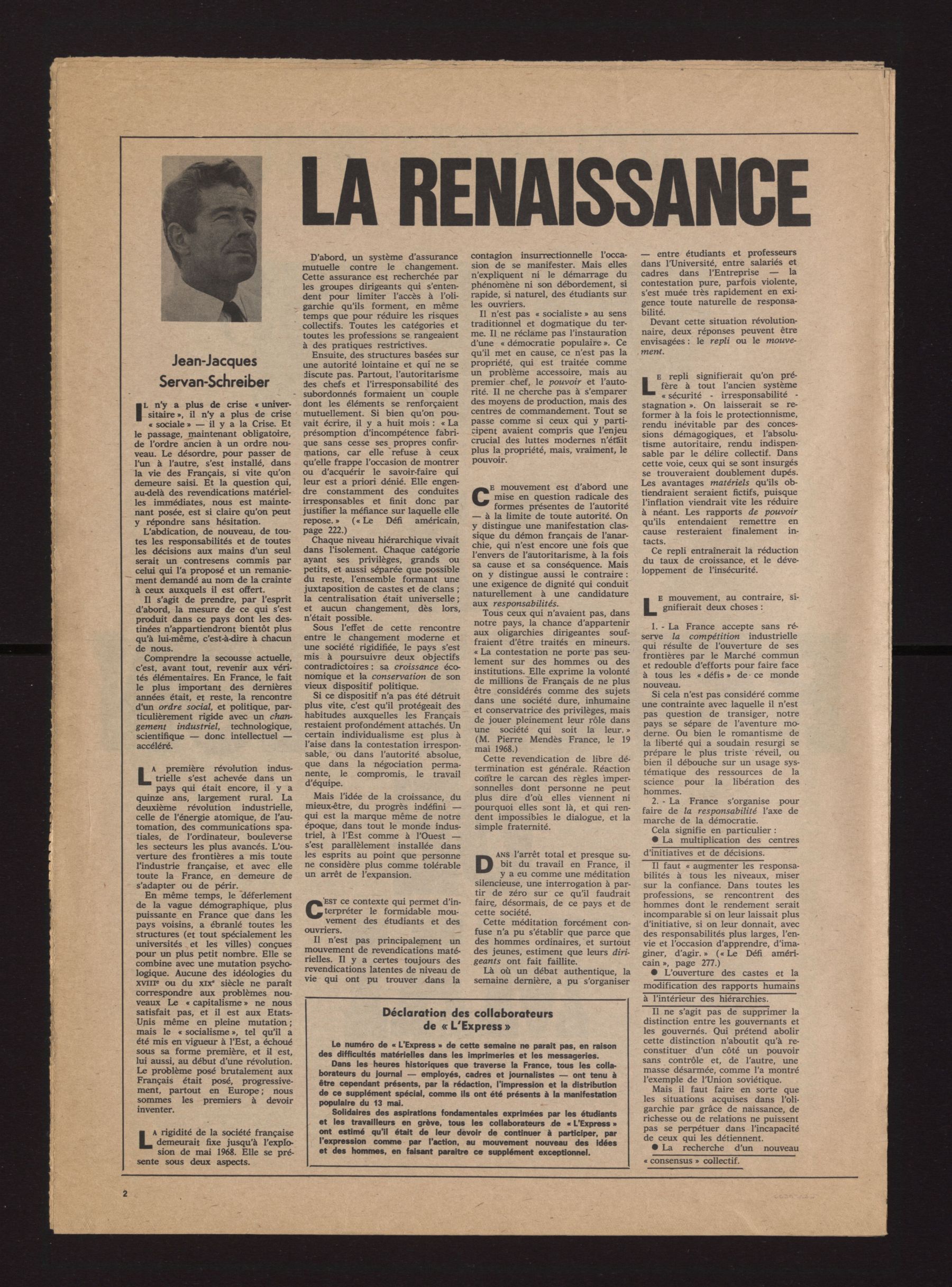

LA RENAISSANCE
Jean-Jacques
Servan-Schreiber
Servan-Schreiber
IL n'y a plus de crise « univer-
sitaire », il n'y a plus de crise
« sociale » — il y a la Crise. Et
le passage, maintenant obligatoire,
de l'ordre ancien à un ordre nou-
veau. Le désordre, pour passer de
l'un à l'autre, s'est installé, dans
la vie des Français, si vite qu'on
demeure saisi. Et la question qui,
au-delà des revendications matériel-
les immédiates, nous est mainte-
nant posée, est si claire qu'on peut
y répondre sans hésitation.
sitaire », il n'y a plus de crise
« sociale » — il y a la Crise. Et
le passage, maintenant obligatoire,
de l'ordre ancien à un ordre nou-
veau. Le désordre, pour passer de
l'un à l'autre, s'est installé, dans
la vie des Français, si vite qu'on
demeure saisi. Et la question qui,
au-delà des revendications matériel-
les immédiates, nous est mainte-
nant posée, est si claire qu'on peut
y répondre sans hésitation.
L'abdication, de nouveau, de tou-
tes les responsabilités et de toutes
les décisions aux mains d'un seul
serait un contresens commis par
celui qui l'a proposé et un remanie-
ment demandé au nom de la crainte
à ceux auxquels il est offert.
tes les responsabilités et de toutes
les décisions aux mains d'un seul
serait un contresens commis par
celui qui l'a proposé et un remanie-
ment demandé au nom de la crainte
à ceux auxquels il est offert.
Il s'agit de prendre, par l'esprit
d'abord, la mesure de ce qui s'est
produit dans ce pays dont les des-
tinées n'appartiendront bientôt plus
qu'à lui-même, c'est-à-dire à chacun
de nous.
d'abord, la mesure de ce qui s'est
produit dans ce pays dont les des-
tinées n'appartiendront bientôt plus
qu'à lui-même, c'est-à-dire à chacun
de nous.
Comprendre la secousse actuelle,
c'est, avant tout, revenir aux véri-
tés élémentaires. En France, le fait
le plus important des dernières
années était, et reste, la rencontre
d'un ordre social, et politique, par-
ticulièrement rigide avec un chan-
gement industriel, technologique,
scientifique — donc intellectuel —
accéléré.
c'est, avant tout, revenir aux véri-
tés élémentaires. En France, le fait
le plus important des dernières
années était, et reste, la rencontre
d'un ordre social, et politique, par-
ticulièrement rigide avec un chan-
gement industriel, technologique,
scientifique — donc intellectuel —
accéléré.
LA première révolution indus-
trielle s'est achevée dans un
pays qui était encore, il y a
quinze ans, largement rural. La
deuxième révolution industrielle,
celle de l'énergie atomique, de l'au-
tomation, des communications spa-
tiales, de l'ordinateur, bouleverse
les secteurs les plus avancés. L'ou-
verture des frontières a mis toute
l'industrie française, et avec elle
toute la France, en demeure de
s'adapter ou de périr.
trielle s'est achevée dans un
pays qui était encore, il y a
quinze ans, largement rural. La
deuxième révolution industrielle,
celle de l'énergie atomique, de l'au-
tomation, des communications spa-
tiales, de l'ordinateur, bouleverse
les secteurs les plus avancés. L'ou-
verture des frontières a mis toute
l'industrie française, et avec elle
toute la France, en demeure de
s'adapter ou de périr.
En même temps, le déferlement
de la vague démographique, plus
puissante en France que dans les
pays voisins, a ébranlé toutes les
structures (et tout spécialement les
universités et les villes) conçues
pour un plus petit nombre. Elle se
combine avec une mutation psycho-
logique. Aucune des idéologies du
XVIIIe ou du xix' siècle ne paraît
correspondre aux problèmes nou-
veaux Le « capitalisme » ne nous
satisfait pas, et il est aux Etats-
Unis même en pleine mutation ;
mais le « socialisme », tel qu'il a
été mis en vigueur à l'Est, a échoué
sous sa forme première, et il est,
lui aussi, au début d'une révolution.
Le problème posé brutalement aux
Français était posé, progressive-
ment, partout en Europe ; nous
sommes les premiers à devoir
inventer.
de la vague démographique, plus
puissante en France que dans les
pays voisins, a ébranlé toutes les
structures (et tout spécialement les
universités et les villes) conçues
pour un plus petit nombre. Elle se
combine avec une mutation psycho-
logique. Aucune des idéologies du
XVIIIe ou du xix' siècle ne paraît
correspondre aux problèmes nou-
veaux Le « capitalisme » ne nous
satisfait pas, et il est aux Etats-
Unis même en pleine mutation ;
mais le « socialisme », tel qu'il a
été mis en vigueur à l'Est, a échoué
sous sa forme première, et il est,
lui aussi, au début d'une révolution.
Le problème posé brutalement aux
Français était posé, progressive-
ment, partout en Europe ; nous
sommes les premiers à devoir
inventer.
LA rigidité de la société française
demeurait fixe jusqu'à l'explo-
sion de mai 1968. Elle se pré-
sente sous deux aspects.
demeurait fixe jusqu'à l'explo-
sion de mai 1968. Elle se pré-
sente sous deux aspects.
D'abord, un système d'assurance
mutuelle contre le changement.
Cette assurance est recherchée par
les groupes dirigeants qui s'enten-
dent pour limiter l'accès à l'oli-
garchie qu'ils forment, en même
temps que pour réduire les risques
collectifs. Toutes les catégories et
toutes les professions se rangeaient
à des pratiques restrictives.
mutuelle contre le changement.
Cette assurance est recherchée par
les groupes dirigeants qui s'enten-
dent pour limiter l'accès à l'oli-
garchie qu'ils forment, en même
temps que pour réduire les risques
collectifs. Toutes les catégories et
toutes les professions se rangeaient
à des pratiques restrictives.
Ensuite, des structures basées sur
une autorité lointaine et qui ne se
discute pas. Partout, l'autoritarisme
des chefs et l'irresponsabilité des
subordonnés formaient un couple
dont les éléments se renforçaient
mutuellement. Si bien qu'on pou-
vait écrire, il y a huit mois : « La
présomption d'incompétence fabri-
que sans cesse ses propres confir-
mations, car elle refuse à ceux
qu'elle frappe l'occasion de montrer
ou d'acquérir le savoir-faire qui
leur est a priori dénié. Elle engen-
dre constamment des conduites
irresponsables et finit donc par
justifier la méfiance sur laquelle elle
repose.» («Le Défi américain,
page 222.)
une autorité lointaine et qui ne se
discute pas. Partout, l'autoritarisme
des chefs et l'irresponsabilité des
subordonnés formaient un couple
dont les éléments se renforçaient
mutuellement. Si bien qu'on pou-
vait écrire, il y a huit mois : « La
présomption d'incompétence fabri-
que sans cesse ses propres confir-
mations, car elle refuse à ceux
qu'elle frappe l'occasion de montrer
ou d'acquérir le savoir-faire qui
leur est a priori dénié. Elle engen-
dre constamment des conduites
irresponsables et finit donc par
justifier la méfiance sur laquelle elle
repose.» («Le Défi américain,
page 222.)
Chaque niveau hiérarchique vivait
dans l'isolement. Chaque catégorie
ayant ses privilèges, grands ou
petits, et aussi séparée que possible
du reste, l'ensemble formant une
juxtaposition de castes et de clans ;
la centralisation était universelle ;
et aucun changement, dès lors,
n'était possible.
dans l'isolement. Chaque catégorie
ayant ses privilèges, grands ou
petits, et aussi séparée que possible
du reste, l'ensemble formant une
juxtaposition de castes et de clans ;
la centralisation était universelle ;
et aucun changement, dès lors,
n'était possible.
Sous l'effet de cette rencontre
entre le changement moderne et
une société rigidifiée, le pays s'est
mis à poursuivre deux objectifs
contradictoires : sa croissance éco-
nomique et la conservation de son
vieux dispositif politique.
entre le changement moderne et
une société rigidifiée, le pays s'est
mis à poursuivre deux objectifs
contradictoires : sa croissance éco-
nomique et la conservation de son
vieux dispositif politique.
Si ce dispositif n'a pas été détruit
plus vite, c'est qu'il protégeait des
habitudes auxquelles les Français
restaient profondément attachés. Un
certain individualisme est plus à
l'aise dans la contestation irrespon-
sable, ou dans l'autorité absolue,
que dans la négociation perma-
nente, le compromis, le travail
d'équipe.
plus vite, c'est qu'il protégeait des
habitudes auxquelles les Français
restaient profondément attachés. Un
certain individualisme est plus à
l'aise dans la contestation irrespon-
sable, ou dans l'autorité absolue,
que dans la négociation perma-
nente, le compromis, le travail
d'équipe.
Mais l'idée de la croissance, du
mieux-être, du progrès indéfini —
qui est la marque même de notre
époque, dans tout le monde indus-
triel, à l'Est comme à l'Ouest —
s'est parallèlement installée dans
les esprits au point que personne
ne considère plus comme tolérable
un arrêt de l'expansion.
mieux-être, du progrès indéfini —
qui est la marque même de notre
époque, dans tout le monde indus-
triel, à l'Est comme à l'Ouest —
s'est parallèlement installée dans
les esprits au point que personne
ne considère plus comme tolérable
un arrêt de l'expansion.
C'EST ce contexte qui permet d'in-
terpréter le formidable mou-
vement des étudiants et des
ouvriers.
terpréter le formidable mou-
vement des étudiants et des
ouvriers.
Il n'est pas principalement un
mouvement de revendications maté-
rielles. Il y a certes toujours des
revendications latentes de niveau de
vie qui ont pu trouver dans la
mouvement de revendications maté-
rielles. Il y a certes toujours des
revendications latentes de niveau de
vie qui ont pu trouver dans la
contagion insurrectionnelle l'occa-
sion de se manifester. Mais elles
n'expliquent ni le démarrage du
phénomène ni son débordement, si
rapide, si naturel, des étudiants sur
les ouvriers.
sion de se manifester. Mais elles
n'expliquent ni le démarrage du
phénomène ni son débordement, si
rapide, si naturel, des étudiants sur
les ouvriers.
Il n'est pas « socialiste » au sens
traditionnel et dogmatique du ter-
me. Il ne réclame pas l'instauration
d'une « démocratie populaire ». Ce
qu'il met en cause, ce n'est pas la
propriété, qui est traitée comme
un problème accessoire, mais au
premier chef, le pouvoir et l'auto-
rité. Il ne cherche pas à s'emparer
des moyens de production, mais des
centres de commandement. Tout se
passe comme si ceux qui y parti-
cipent avaient compris que l'enjeu
crucial des luttes modernes n'était
plus la propriété, mais, vraiment, le
pouvoir.
traditionnel et dogmatique du ter-
me. Il ne réclame pas l'instauration
d'une « démocratie populaire ». Ce
qu'il met en cause, ce n'est pas la
propriété, qui est traitée comme
un problème accessoire, mais au
premier chef, le pouvoir et l'auto-
rité. Il ne cherche pas à s'emparer
des moyens de production, mais des
centres de commandement. Tout se
passe comme si ceux qui y parti-
cipent avaient compris que l'enjeu
crucial des luttes modernes n'était
plus la propriété, mais, vraiment, le
pouvoir.
CE mouvement est d'abord une
mise en question radicale des
formes présentes de l'autorité
— à la limite de toute autorité. On
y distingue une manifestation clas-
sique du démon français de l'anar-
chie, qui n'est encore une fois que
l'envers de l'autoritarisme, à la fois
sa cause et sa conséquence. Mais
on y distingue aussi le contraire :
une exigence de dignité qui conduit
naturellement à une candidature
aux responsabilités.
mise en question radicale des
formes présentes de l'autorité
— à la limite de toute autorité. On
y distingue une manifestation clas-
sique du démon français de l'anar-
chie, qui n'est encore une fois que
l'envers de l'autoritarisme, à la fois
sa cause et sa conséquence. Mais
on y distingue aussi le contraire :
une exigence de dignité qui conduit
naturellement à une candidature
aux responsabilités.
Tous ceux qui n'avaient pas, dans
notre pays, la chance d'appartenir
aux oligarchies dirigeantes souf-
fraient d'être traités en mineurs.
« La contestation ne porte pas seu-
lement sur des hommes ou des
institutions. Elle exprime la volonté
de millions de Français de ne plus
être considérés comme des sujets
dans une société dure, inhumaine
et conservatrice des privilèges, mais
de jouer pleinement leur rôle dans
une société qui soit la leur. »
(M. Pierre Mendès France, le 19
mai 1968.)
notre pays, la chance d'appartenir
aux oligarchies dirigeantes souf-
fraient d'être traités en mineurs.
« La contestation ne porte pas seu-
lement sur des hommes ou des
institutions. Elle exprime la volonté
de millions de Français de ne plus
être considérés comme des sujets
dans une société dure, inhumaine
et conservatrice des privilèges, mais
de jouer pleinement leur rôle dans
une société qui soit la leur. »
(M. Pierre Mendès France, le 19
mai 1968.)
Cette revendication de libre dé-
termination est générale. Réaction
contre le carcan des règles imper-
sonnelles dont personne ne peut
plus dire d'où elles viennent ni
pourquoi elles sont là, et qui ren-
dent impossibles le dialogue, et la
simple fraternité.
termination est générale. Réaction
contre le carcan des règles imper-
sonnelles dont personne ne peut
plus dire d'où elles viennent ni
pourquoi elles sont là, et qui ren-
dent impossibles le dialogue, et la
simple fraternité.
ANS l'arrêt total et presque su-
bit du travail en France, il
y a eu comme une méditation
silencieuse, une interrogation à par-
tir de zéro sur ce qu'il faudrait
faire, désormais, de ce pays et de
cette société.
bit du travail en France, il
y a eu comme une méditation
silencieuse, une interrogation à par-
tir de zéro sur ce qu'il faudrait
faire, désormais, de ce pays et de
cette société.
Cette méditation forcément con-
fuse n'a pu s'établir que parce que
des hommes ordinaires, et surtout
des jeunes, estiment que leurs diri-
geants ont fait faillite.
fuse n'a pu s'établir que parce que
des hommes ordinaires, et surtout
des jeunes, estiment que leurs diri-
geants ont fait faillite.
Là où un débat authentique, la
semaine dernière, a pu s'organiser
semaine dernière, a pu s'organiser
Déclaration des collaborateurs
de <c L'Express »
de <c L'Express »
Le numéro de « L'Express » de cette semaine ne paraît pas, en raison
des difficultés matérielles dans les imprimeries et les messageries.
des difficultés matérielles dans les imprimeries et les messageries.
Dans les heures historiques que traverse la France, tous les colla-
borateurs du journal — employés, cadres et journalistes — ont tenu à
être cependant présents, par la rédaction, l'impression et la distribution
de ce supplément spécial, comme ils ont été présents à la manifestation
populaire du 13 mai.
borateurs du journal — employés, cadres et journalistes — ont tenu à
être cependant présents, par la rédaction, l'impression et la distribution
de ce supplément spécial, comme ils ont été présents à la manifestation
populaire du 13 mai.
Solidaires des aspirations fondamentales exprimées par les étudiants
et les travailleurs en grève, tous les collaborateurs de « L'Express »
ont estimé qu'il était de leur devoir de continuer à participer, par
l'expression comme par l'action, au mouvement nouveau des idées
et des hommes, en faisant paraître ce supplément exceptionnel.
et les travailleurs en grève, tous les collaborateurs de « L'Express »
ont estimé qu'il était de leur devoir de continuer à participer, par
l'expression comme par l'action, au mouvement nouveau des idées
et des hommes, en faisant paraître ce supplément exceptionnel.
— entre étudiants et professeurs
dans l'Université, entre salariés et
cadres dans l'Entreprise — la
contestation pure, parfois violente,
s'est muée très rapidement en exi-
gence toute naturelle de responsa-
bilité.
dans l'Université, entre salariés et
cadres dans l'Entreprise — la
contestation pure, parfois violente,
s'est muée très rapidement en exi-
gence toute naturelle de responsa-
bilité.
Devant cette situation révolution-
naire, deux réponses peuvent être
envisagées : le repli ou le mouve-
ment.
naire, deux réponses peuvent être
envisagées : le repli ou le mouve-
ment.
E repli signifierait qu'on pré-
fère à tout l'ancien système
« sécurité - irresponsabilité -
stagnation ». On laisserait se re-
former à la fois le protectionnisme,
rendu inévitable par des conces-
sions démagogiques, et l'absolu-
tisme autoritaire, rendu indispen-
sable par le délire collectif. Dans
cette voie, ceux qui se sont insurgés
se trouveraient doublement dupés.
Les avantages matériels qu'ils ob-
tiendraient seraient fictifs, puisque
l'inflation viendrait vite les réduire
à néant. Les rapports de pouvoir
qu'ils entendaient remettre en
cause resteraient finalement in-
tacts.
fère à tout l'ancien système
« sécurité - irresponsabilité -
stagnation ». On laisserait se re-
former à la fois le protectionnisme,
rendu inévitable par des conces-
sions démagogiques, et l'absolu-
tisme autoritaire, rendu indispen-
sable par le délire collectif. Dans
cette voie, ceux qui se sont insurgés
se trouveraient doublement dupés.
Les avantages matériels qu'ils ob-
tiendraient seraient fictifs, puisque
l'inflation viendrait vite les réduire
à néant. Les rapports de pouvoir
qu'ils entendaient remettre en
cause resteraient finalement in-
tacts.
Ce repli entraînerait la réduction
du taux de croissance, et le déve-
loppement de l'insécurité.
du taux de croissance, et le déve-
loppement de l'insécurité.
LE mouvement, au contraire, si-
gnifierait deux choses :
gnifierait deux choses :
1. - La France accepte sans ré-
serve la compétition industrielle
qui résulte de l'ouverture de ses
frontières par le Marché commun
et redouble d'efforts pour faire face
à tous les « défis » de ce monde
nouveau.
serve la compétition industrielle
qui résulte de l'ouverture de ses
frontières par le Marché commun
et redouble d'efforts pour faire face
à tous les « défis » de ce monde
nouveau.
Si cela n'est pas considéré comme
une contrainte avec laquelle il n'est
pas question de transiger, notre
pays se sépare de l'aventure mo-
derne. Ou bien le romantisme de
la liberté qui a soudain resurgi se
prépare le plus triste réveil, ou
bien il débouche sur un usage sys-
tématique des ressources de la
science pour la libération des
hommes.
une contrainte avec laquelle il n'est
pas question de transiger, notre
pays se sépare de l'aventure mo-
derne. Ou bien le romantisme de
la liberté qui a soudain resurgi se
prépare le plus triste réveil, ou
bien il débouche sur un usage sys-
tématique des ressources de la
science pour la libération des
hommes.
2. - La France s'organise pour
faire de la responsabilité l'axe de
marche de la démocratie.
faire de la responsabilité l'axe de
marche de la démocratie.
Cela signifie en particulier :
• La multiplication des centres
d'initiatives et de décisions.
Il faut « augmenter les responsa-
bilités à tous les niveaux, miser
sur la confiance. Dans toutes les
professions, se rencontrent des
hommes dont le rendement serait
incomparable si on leur laissait plus
d'initiative, si on leur donnait, avec
des responsabilités plus larges, l'en-
vie et l'occasion d'apprendre, d'ima-
giner, d'agir. » ( « Le Défi améri-
cain », page 277.)
bilités à tous les niveaux, miser
sur la confiance. Dans toutes les
professions, se rencontrent des
hommes dont le rendement serait
incomparable si on leur laissait plus
d'initiative, si on leur donnait, avec
des responsabilités plus larges, l'en-
vie et l'occasion d'apprendre, d'ima-
giner, d'agir. » ( « Le Défi améri-
cain », page 277.)
• L'ouverture des castes et la
modification des rapports humains
à l'intérieur des hiérarchies.
modification des rapports humains
à l'intérieur des hiérarchies.
Il ne s'agit pas de supprimer la
distinction entre les gouvernants et
les gouvernés. Qui prétend abolir
cette distinction n'aboutit qu'à re-
constituer d'un côté un pouvoir
sans contrôle et, de l'autre, une
masse désarmée, comme l'a montré
l'exemple de l'Union soviétique.
distinction entre les gouvernants et
les gouvernés. Qui prétend abolir
cette distinction n'aboutit qu'à re-
constituer d'un côté un pouvoir
sans contrôle et, de l'autre, une
masse désarmée, comme l'a montré
l'exemple de l'Union soviétique.
Mais il faut faire en sorte que
les situations acquises dans l'oli-
garchie par grâce de naissance, de
richesse ou de relations ne puissent
pas se perpétuer dans l'incapacité
de ceux qui les détiennent.
les situations acquises dans l'oli-
garchie par grâce de naissance, de
richesse ou de relations ne puissent
pas se perpétuer dans l'incapacité
de ceux qui les détiennent.
• La recherche d'un nouveau
« consensus » collectif.
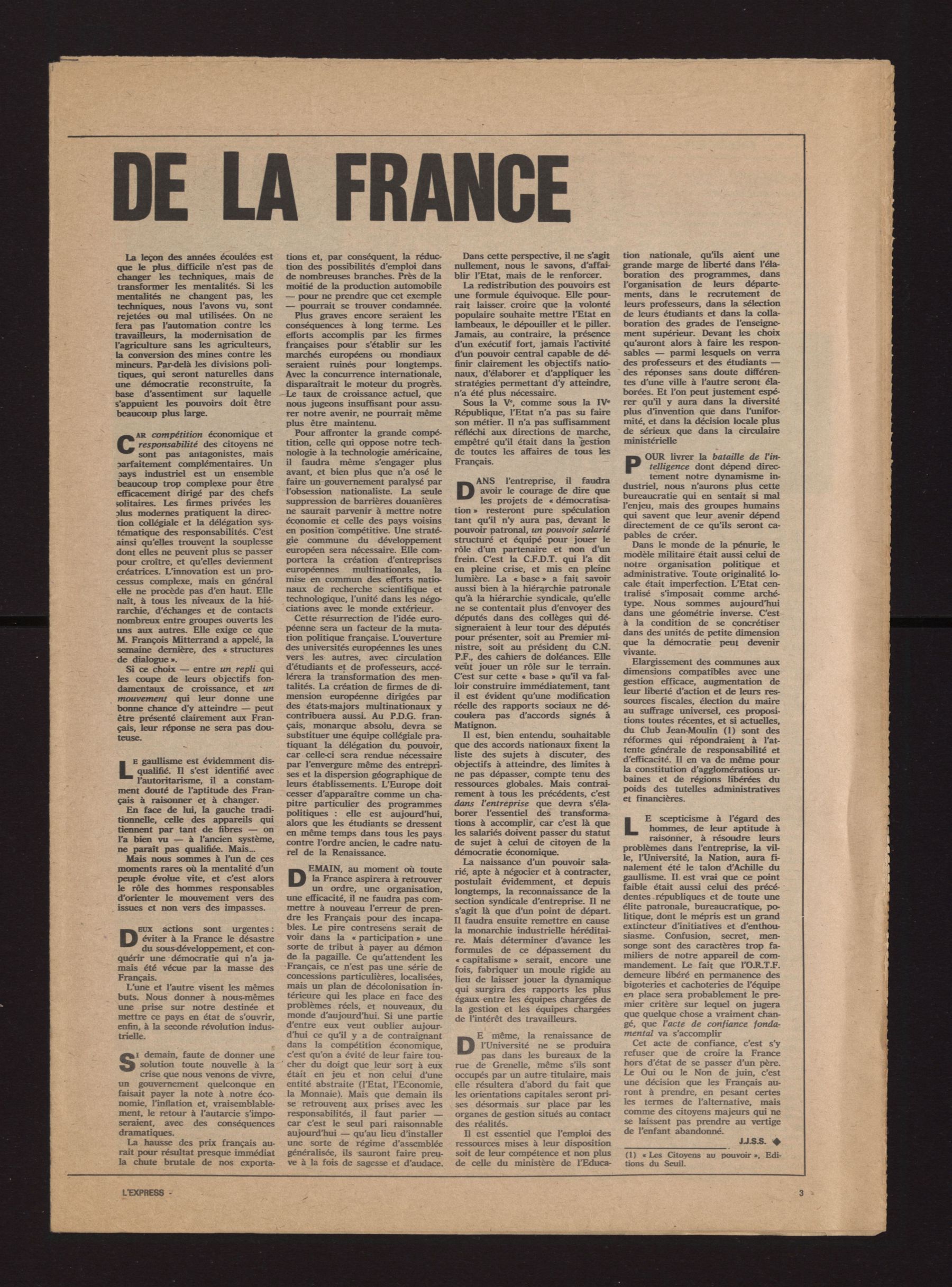

DE LA FRANCE
La leçon des années écoulées est
que le plus difficile n'est pas de
changer les techniques, mais de
transformer les mentalités. Si les
mentalités ne changent pas, les
techniques, nous l'avons vu, sont
rejetées ou mal utilisées. On ne
fera pas l'automation contre les
travailleurs, la modernisation de
l'agriculture sans les agriculteurs,
la conversion des mines contre les
mineurs. Par-delà les divisions poli-
tiques, qui seront naturelles dans
une démocratie reconstruite, la
base d'assentiment sur laquelle
s'appuient les pouvoirs doit être
beaucoup plus large.
que le plus difficile n'est pas de
changer les techniques, mais de
transformer les mentalités. Si les
mentalités ne changent pas, les
techniques, nous l'avons vu, sont
rejetées ou mal utilisées. On ne
fera pas l'automation contre les
travailleurs, la modernisation de
l'agriculture sans les agriculteurs,
la conversion des mines contre les
mineurs. Par-delà les divisions poli-
tiques, qui seront naturelles dans
une démocratie reconstruite, la
base d'assentiment sur laquelle
s'appuient les pouvoirs doit être
beaucoup plus large.
CAR compétition économique et
responsabilité des citoyens ne
sont pas antagonistes, mais
Darfaitement complémentaires. Un
pays industriel est un ensemble
beaucoup trop complexe pour être
efficacement dirigé par des chefs
solitaires. Les firmes privées les
plus modernes pratiquent la direc-
tion collégiale et la délégation sys-
tématique des responsabilités. C'est
ainsi qu'elles trouvent la souplesse
dont elles ne peuvent plus se passer
pour croître, et qu'elles deviennent
créatrices. L'innovation est un pro-
cessus complexe, mais en général
elle ne procède pas d'en haut. Elle
naît, à tous les niveaux de la hié-
rarchie, d'échanges et de contacts
nombreux entre groupes ouverts les
uns aux autres. Elle exige ce que
M. François Mitterrand a appelé, la
semaine dernière, des < structures
de dialogue».
responsabilité des citoyens ne
sont pas antagonistes, mais
Darfaitement complémentaires. Un
pays industriel est un ensemble
beaucoup trop complexe pour être
efficacement dirigé par des chefs
solitaires. Les firmes privées les
plus modernes pratiquent la direc-
tion collégiale et la délégation sys-
tématique des responsabilités. C'est
ainsi qu'elles trouvent la souplesse
dont elles ne peuvent plus se passer
pour croître, et qu'elles deviennent
créatrices. L'innovation est un pro-
cessus complexe, mais en général
elle ne procède pas d'en haut. Elle
naît, à tous les niveaux de la hié-
rarchie, d'échanges et de contacts
nombreux entre groupes ouverts les
uns aux autres. Elle exige ce que
M. François Mitterrand a appelé, la
semaine dernière, des < structures
de dialogue».
Si ce choix — entre un repli qui
les coupe de leurs objectifs fon-
damentaux de croissance, et un
mouvement qui leur donne une
bonne chance d'y atteindre — peut
être présenté clairement aux Fran-
çais, leur réponse ne sera pas dou-
teuse.
les coupe de leurs objectifs fon-
damentaux de croissance, et un
mouvement qui leur donne une
bonne chance d'y atteindre — peut
être présenté clairement aux Fran-
çais, leur réponse ne sera pas dou-
teuse.
LE gaullisme est évidemment dis-
qualifié. Il s'est identifié avec
l'autoritarisme, il a constam-
ment douté de l'aptitude des Fran-
çais à raisonner et à changer.
qualifié. Il s'est identifié avec
l'autoritarisme, il a constam-
ment douté de l'aptitude des Fran-
çais à raisonner et à changer.
En face de lui, la gauche tradi-
tionnelle, celle des appareils qui
tiennent par tant de fibres — on
l'a bien vu — à l'ancien système,
ne paraît pas qualifiée. Mais...
tionnelle, celle des appareils qui
tiennent par tant de fibres — on
l'a bien vu — à l'ancien système,
ne paraît pas qualifiée. Mais...
Mais nous sommes à l'un de ces
moments rares où la mentalité d'un
peuple évolue vite, et c'est alors
le rôle des hommes responsables
d'orienter le mouvement vers des
issues et non vers des impasses.
moments rares où la mentalité d'un
peuple évolue vite, et c'est alors
le rôle des hommes responsables
d'orienter le mouvement vers des
issues et non vers des impasses.
DEUX actions sont urgentes :
éviter à la France le désastre
du sous-développement, et con-
quérir une démocratie qui n'a ja-
mais été vécue par la masse des
Français.
éviter à la France le désastre
du sous-développement, et con-
quérir une démocratie qui n'a ja-
mais été vécue par la masse des
Français.
L'une et l'autre visent les mêmes
buts. Nous donner à nous-mêmes
une prise sur notre destinée et
mettre ce pays en état de s'ouvrir,
enfin, à la seconde révolution indus-
trielle.
buts. Nous donner à nous-mêmes
une prise sur notre destinée et
mettre ce pays en état de s'ouvrir,
enfin, à la seconde révolution indus-
trielle.
Si demain, faute de donner une
solution toute nouvelle à la
crise que nous venons de vivre,
un gouvernement quelconque en
faisait payer la note à notre éco-
nomie, l'inflation et, vraisemblable-
ment, le retour à l'autarcie s'impo-
seraient, avec des conséquences
dramatiques.
solution toute nouvelle à la
crise que nous venons de vivre,
un gouvernement quelconque en
faisait payer la note à notre éco-
nomie, l'inflation et, vraisemblable-
ment, le retour à l'autarcie s'impo-
seraient, avec des conséquences
dramatiques.
La hausse des prix français au-
rait pour résultat presque immédiat
la chute brutale de nos exporta-
rait pour résultat presque immédiat
la chute brutale de nos exporta-
tions et, par conséquent, la réduc-
tion des possibilités d'emploi dans
de nombreuses branches. Près de la
moitié de la production automobile
tion des possibilités d'emploi dans
de nombreuses branches. Près de la
moitié de la production automobile
— pour ne prendre que cet exemple
— pourrait se trouver condamnée.
Plus graves encore seraient les
Plus graves encore seraient les
conséquences à long ternie. Les
efforts accomplis par les firmes
françaises pour s'établir sur les
marchés européens ou mondiaux
seraient ruinés pour longtemps.
Avec la concurrence internationale,
disparaîtrait le moteur du progrès.
Le taux de croissance actuel, que
nous jugeons insuffisant pour assu-
rer notre avenir, ne pourrait même
plus être maintenu.
efforts accomplis par les firmes
françaises pour s'établir sur les
marchés européens ou mondiaux
seraient ruinés pour longtemps.
Avec la concurrence internationale,
disparaîtrait le moteur du progrès.
Le taux de croissance actuel, que
nous jugeons insuffisant pour assu-
rer notre avenir, ne pourrait même
plus être maintenu.
Pour affronter la grande compé-
tition, celle qui oppose notre tech-
nologie à la technologie américaine,
il faudra même s'engager plus
avant, et bien plus que n'a osé le
faire un gouvernement paralysé par
l'obsession nationaliste. La seule
suppression de barrières douanières
ne saurait parvenir à mettre notre
économie et celle des pays voisins
en position compétitive. Une straté-
gie commune du développement
européen sera nécessaire. Elle com-
portera la création d'entreprises
européennes multinationales, la
mise en commun des efforts natio-
naux de recherche scientifique et
technologique, l'unité dans les négo-
ciations avec le monde extérieur.
tition, celle qui oppose notre tech-
nologie à la technologie américaine,
il faudra même s'engager plus
avant, et bien plus que n'a osé le
faire un gouvernement paralysé par
l'obsession nationaliste. La seule
suppression de barrières douanières
ne saurait parvenir à mettre notre
économie et celle des pays voisins
en position compétitive. Une straté-
gie commune du développement
européen sera nécessaire. Elle com-
portera la création d'entreprises
européennes multinationales, la
mise en commun des efforts natio-
naux de recherche scientifique et
technologique, l'unité dans les négo-
ciations avec le monde extérieur.
Cette résurrection de l'idée euro-
péenne sera un facteur de la muta-
tion politique française. L'ouverture
des universités européennes les unes
vers les autres, avec circulation
d'étudiants et de professeurs, accé-
lérera la transformation des men-
talités. La création de firmes de di-
mension européenne dirigées par
des états-majors multinationaux y
contribuera aussi. Au P.D.G. fran-
çais, monarque absolu, devra se
substituer une équipe collégiale pra-
tiquant la délégation du pouvoir,
car celle-ci sera rendue nécessaire
par l'envergure même des entrepri-
ses et la dispersion géographique de
leurs établissements. L'Europe doit
cesser d'apparaître comme un cha-
pitre particulier des programmes
politiques : elle est aujourd'hui,
alors que les étudiants se dressent
en même temps dans tous les pays
contre l'ordre ancien, le cadre natu-
rel de la Renaissance.
péenne sera un facteur de la muta-
tion politique française. L'ouverture
des universités européennes les unes
vers les autres, avec circulation
d'étudiants et de professeurs, accé-
lérera la transformation des men-
talités. La création de firmes de di-
mension européenne dirigées par
des états-majors multinationaux y
contribuera aussi. Au P.D.G. fran-
çais, monarque absolu, devra se
substituer une équipe collégiale pra-
tiquant la délégation du pouvoir,
car celle-ci sera rendue nécessaire
par l'envergure même des entrepri-
ses et la dispersion géographique de
leurs établissements. L'Europe doit
cesser d'apparaître comme un cha-
pitre particulier des programmes
politiques : elle est aujourd'hui,
alors que les étudiants se dressent
en même temps dans tous les pays
contre l'ordre ancien, le cadre natu-
rel de la Renaissance.
DEMAIN, au moment où toute
la France aspirera à retrouver
un ordre, une organisation,
une efficacité, il ne faudra pas com-
mettre à nouveau l'erreur de pren-
dre les Français pour des incapa-
bles. Le pire contresens serait de
voir dans la « participation » une
sorte de tribut à payer au démon
de la pagaille. Ce qu'attendant les
Français, ce n'est pas une série de
concessions particulières, localisées,
mais un plan de décolonisation in-
térieure qui les place en face des
problèmes réels, et nouveaux, du
monde d'aujourd'hui. Si une partie
d'entre eux veut oublier aujour-
d'hui ce qu'il y a de contraignant
dans la compétition économique,
c'est qu'on a évité de leur faire tou-
cher du doigt que leur sort à eux
était en jeu et non celui d'une
entité abstraite (l'Etat, l'Economie,
la Monnaie). Mais que demain ils
se retrouvent aux prises avec les
responsabilités, il faut parier —
car c'est le seul pari raisonnable
aujourd'hui — qu'au lieu d'installer
une sorte de régime d'assemblée
généralisée, ils sauront faire preu-
ve à la fois de sagesse et d'audace.
la France aspirera à retrouver
un ordre, une organisation,
une efficacité, il ne faudra pas com-
mettre à nouveau l'erreur de pren-
dre les Français pour des incapa-
bles. Le pire contresens serait de
voir dans la « participation » une
sorte de tribut à payer au démon
de la pagaille. Ce qu'attendant les
Français, ce n'est pas une série de
concessions particulières, localisées,
mais un plan de décolonisation in-
térieure qui les place en face des
problèmes réels, et nouveaux, du
monde d'aujourd'hui. Si une partie
d'entre eux veut oublier aujour-
d'hui ce qu'il y a de contraignant
dans la compétition économique,
c'est qu'on a évité de leur faire tou-
cher du doigt que leur sort à eux
était en jeu et non celui d'une
entité abstraite (l'Etat, l'Economie,
la Monnaie). Mais que demain ils
se retrouvent aux prises avec les
responsabilités, il faut parier —
car c'est le seul pari raisonnable
aujourd'hui — qu'au lieu d'installer
une sorte de régime d'assemblée
généralisée, ils sauront faire preu-
ve à la fois de sagesse et d'audace.
Dans cette perspective, il ne s'agit
nullement, nous le savons, d'affai-
blir l'Etat, mais de le renforcer.
nullement, nous le savons, d'affai-
blir l'Etat, mais de le renforcer.
La redistribution des pouvoirs est
une formule équivoque. Elle pour-
rait laisser, croire que la volonté
populaire souhaite mettre l'Etat en
lambeaux, le dépouiller et le piller.
Jamais, au contraire, la présence
d'un exécutif fort, jamais l'activité
d'un pouvoir central capable de dé-
finir clairement les objectifs natio-
naux, d'élaborer et d'appliquer les
stratégies permettant d'y atteindre,
n'a été plus nécessaire.
une formule équivoque. Elle pour-
rait laisser, croire que la volonté
populaire souhaite mettre l'Etat en
lambeaux, le dépouiller et le piller.
Jamais, au contraire, la présence
d'un exécutif fort, jamais l'activité
d'un pouvoir central capable de dé-
finir clairement les objectifs natio-
naux, d'élaborer et d'appliquer les
stratégies permettant d'y atteindre,
n'a été plus nécessaire.
Sous la Ve, comme sous la IVe
République, l'Etat n'a pas su faire
son métier. Il n'a pas suffisamment
réfléchi aux directions de marche,
empêtré qu'il était dans la gestion
de toutes les affaires de tous les
Français.
République, l'Etat n'a pas su faire
son métier. Il n'a pas suffisamment
réfléchi aux directions de marche,
empêtré qu'il était dans la gestion
de toutes les affaires de tous les
Français.
l'entreprise, il faudra
avoir le courage de dire que
les projets de « démocratisa-
tion » resteront pure spéculation
tant qu'il n'y aura pas, devant le
pouvoir patronal, un pouvoir salarié
structuré et équipé pour jouer le
rôle d'un partenaire et non d'un
frein. C'est la C.F.D.T. qui l'a dit
en pleine crise, et mis en pleine
lumière. La « base » a fait savoir
aussi bien à la hiérarchie patronale
qu'à la hiérarchie syndicale, qu'elle
ne se contentait plus d'envoyer des
députés dans des collèges qui dé-
signeraient à leur tour des députés
pour présenter, soit au Premier mi-
nistre, soit au président du C.N.
P.F., des cahiers de doléances. Elle
veut jouer un rôle sur le terrain.
C'est sur cette « base » qu'il va fal-
loir construire immédiatement, tant
il est évident qu'une modification
réelle des rapports sociaux ne dé-
coulera pas d'accords signés à
Matignon.
avoir le courage de dire que
les projets de « démocratisa-
tion » resteront pure spéculation
tant qu'il n'y aura pas, devant le
pouvoir patronal, un pouvoir salarié
structuré et équipé pour jouer le
rôle d'un partenaire et non d'un
frein. C'est la C.F.D.T. qui l'a dit
en pleine crise, et mis en pleine
lumière. La « base » a fait savoir
aussi bien à la hiérarchie patronale
qu'à la hiérarchie syndicale, qu'elle
ne se contentait plus d'envoyer des
députés dans des collèges qui dé-
signeraient à leur tour des députés
pour présenter, soit au Premier mi-
nistre, soit au président du C.N.
P.F., des cahiers de doléances. Elle
veut jouer un rôle sur le terrain.
C'est sur cette « base » qu'il va fal-
loir construire immédiatement, tant
il est évident qu'une modification
réelle des rapports sociaux ne dé-
coulera pas d'accords signés à
Matignon.
Il est, bien entendu, souhaitable
que des accords nationaux fixent la
liste des sujets à discuter, des
objectifs à atteindre, des limites à
ne pas dépasser, compte tenu des
ressources globales. Mais contrai-
rement à tous les précédents, c'est
dans l'entreprise que devra s'éla-
borer l'essentiel des transforma-
tions à accomplir, car c'est là que
les salariés doivent passer du statut
de sujet à celui de citoyen de la
démocratie économique.
que des accords nationaux fixent la
liste des sujets à discuter, des
objectifs à atteindre, des limites à
ne pas dépasser, compte tenu des
ressources globales. Mais contrai-
rement à tous les précédents, c'est
dans l'entreprise que devra s'éla-
borer l'essentiel des transforma-
tions à accomplir, car c'est là que
les salariés doivent passer du statut
de sujet à celui de citoyen de la
démocratie économique.
La naissance d'un pouvoir sala-
rié, apte à négocier et à contracter,
postulait évidemment, et depuis
longtemps, la reconnaissance de la
section syndicale d'entreprise. Il ne
s'agit là que d'un point de départ.
Il faudra ensuite remettre en cause
la monarchie industrielle héréditai-
re. Mais déterminer d'avance les
formules de ce dépassement du
« capitalisme » serait, encore une
fois, fabriquer un moule rigide au
lieu de laisser jouer la dynamique
qui surgira des rapports les plus
égaux entre les équipes chargées de
la gestion et les équipes chargées
de l'intérêt des travailleurs.
rié, apte à négocier et à contracter,
postulait évidemment, et depuis
longtemps, la reconnaissance de la
section syndicale d'entreprise. Il ne
s'agit là que d'un point de départ.
Il faudra ensuite remettre en cause
la monarchie industrielle héréditai-
re. Mais déterminer d'avance les
formules de ce dépassement du
« capitalisme » serait, encore une
fois, fabriquer un moule rigide au
lieu de laisser jouer la dynamique
qui surgira des rapports les plus
égaux entre les équipes chargées de
la gestion et les équipes chargées
de l'intérêt des travailleurs.
DE même, la renaissance de
l'Université ne se produira
pas dans les bureaux de la
rue de Grenelle, même s'ils sont
occupés par un autre titulaire, mais
elle résultera d'abord du fait que
les orientations capitales seront pri-
ses désormais sur place par les
organes de gestion situés au contact
des réalités.
l'Université ne se produira
pas dans les bureaux de la
rue de Grenelle, même s'ils sont
occupés par un autre titulaire, mais
elle résultera d'abord du fait que
les orientations capitales seront pri-
ses désormais sur place par les
organes de gestion situés au contact
des réalités.
Il est essentiel que l'emploi des
ressources mises à leur disposition
soit de leur compétence et non plus
de celle du ministère de l'Educa-
ressources mises à leur disposition
soit de leur compétence et non plus
de celle du ministère de l'Educa-
tion nationale, qu'ils aient une
grande marge de liberté dans l'éla-
boration des programmes, dans
l'organisation de leurs départe-
ments, dans le recrutement de
leurs professeurs, dans la sélection
de leurs étudiants et dans la colla-
boration des grades de l'enseigne-
ment supérieur. Devant les choix
qu'auront alors à faire les respon-
sables — parmi lesquels on verra
des professeurs et des étudiants —
des réponses sans doute différen-
tes d'une ville à l'autre seront éla-
borées. Et l'on peut justement espé-
rer qu'il y aura dans la diversité
plus d'invention que dans l'unifor-
mité, et dans la décision locale plus
de sérieux que dans la circulaire
ministérielle
grande marge de liberté dans l'éla-
boration des programmes, dans
l'organisation de leurs départe-
ments, dans le recrutement de
leurs professeurs, dans la sélection
de leurs étudiants et dans la colla-
boration des grades de l'enseigne-
ment supérieur. Devant les choix
qu'auront alors à faire les respon-
sables — parmi lesquels on verra
des professeurs et des étudiants —
des réponses sans doute différen-
tes d'une ville à l'autre seront éla-
borées. Et l'on peut justement espé-
rer qu'il y aura dans la diversité
plus d'invention que dans l'unifor-
mité, et dans la décision locale plus
de sérieux que dans la circulaire
ministérielle
POUR livrer la bataille de l'in-
telligence dont dépend direc-
tement notre dynamisme in-
dustriel, nous n'aurons plus cette
bureaucratie qui en sentait si mal
l'enjeu, mais des groupes humains
qui savent que leur avenir dépend
directement de ce qu'ils seront ca-
pables de créer.
telligence dont dépend direc-
tement notre dynamisme in-
dustriel, nous n'aurons plus cette
bureaucratie qui en sentait si mal
l'enjeu, mais des groupes humains
qui savent que leur avenir dépend
directement de ce qu'ils seront ca-
pables de créer.
Dans le monde de la pénurie, le
modèle militaire était aussi celui de
notre organisation politique et
administrative. Toute originalité lo-
cale était imperfection. L'Etat cen-
tralisé s'imposait comme arché-
type. Nous sommes aujourd'hui
dans une géométrie inverse. C'est
à la condition de se concrétiser
dans des unités de petite dimension
que la démocratie peut devenir
vivante.
modèle militaire était aussi celui de
notre organisation politique et
administrative. Toute originalité lo-
cale était imperfection. L'Etat cen-
tralisé s'imposait comme arché-
type. Nous sommes aujourd'hui
dans une géométrie inverse. C'est
à la condition de se concrétiser
dans des unités de petite dimension
que la démocratie peut devenir
vivante.
Elargissement des communes aux
dimensions compatibles avec une
gestion efficace, augmentation de
leur liberté d'action et de leurs res-
sources fiscales, élection du maire
au suffrage universel, ces proposi-
tions toutes récentes, et si actuelles,
du Club Jean-Moulin (1) sont des
réformes qui répondraient à l'at-
tente générale de responsabilité et
d'efficacité. Il en va de même pour
la constitution d'agglomérations ur-
baines et de régions libérées du
poids des tutelles administratives
et financières.
dimensions compatibles avec une
gestion efficace, augmentation de
leur liberté d'action et de leurs res-
sources fiscales, élection du maire
au suffrage universel, ces proposi-
tions toutes récentes, et si actuelles,
du Club Jean-Moulin (1) sont des
réformes qui répondraient à l'at-
tente générale de responsabilité et
d'efficacité. Il en va de même pour
la constitution d'agglomérations ur-
baines et de régions libérées du
poids des tutelles administratives
et financières.
LE scepticisme à l'égard des
hommes, de leur aptitude à
raisonner, à résoudre leurs
problèmes dans l'entreprise, la vil-
le, l'Université, la Nation, aura fi-
nalement été le talon d'Achille du
gaullisme. Il est vrai que ce point
faible était aussi celui des précé-
dentes républiques et de toute une
élite patronale, bureaucratique, po-
litique, dont le mépris est un grand
extincteur d'initiatives et d'enthou-
siasme. Confusion, secret, men-
songe sont des caractères trop fa-
miliers de notre appareil de com-
mandement. Le fait que l'OJR.T.F.
demeure libéré en permanence des
bigoteries et cachoteries de l'équipe
en place sera probablement le pre-
mier critère sur lequel on jugera
que quelque chose a vraiment chan-
gé, que l'acte de confiance fonda-
mental va s'accomplir
hommes, de leur aptitude à
raisonner, à résoudre leurs
problèmes dans l'entreprise, la vil-
le, l'Université, la Nation, aura fi-
nalement été le talon d'Achille du
gaullisme. Il est vrai que ce point
faible était aussi celui des précé-
dentes républiques et de toute une
élite patronale, bureaucratique, po-
litique, dont le mépris est un grand
extincteur d'initiatives et d'enthou-
siasme. Confusion, secret, men-
songe sont des caractères trop fa-
miliers de notre appareil de com-
mandement. Le fait que l'OJR.T.F.
demeure libéré en permanence des
bigoteries et cachoteries de l'équipe
en place sera probablement le pre-
mier critère sur lequel on jugera
que quelque chose a vraiment chan-
gé, que l'acte de confiance fonda-
mental va s'accomplir
Cet acte de confiance, c'est s'y
refuser que de croire la France
hors d'état de se passer d'un père.
Le Oui ou le Non de juin, c'est
une décision que les Français au-
ront à prendre, en pesant certes
les termes de l'alternative, mais
comme des citoyens majeurs qui ne
se laissent pas prendre au vertige
de l'enfant abandonné.
____________________ JJ.S.S. •
refuser que de croire la France
hors d'état de se passer d'un père.
Le Oui ou le Non de juin, c'est
une décision que les Français au-
ront à prendre, en pesant certes
les termes de l'alternative, mais
comme des citoyens majeurs qui ne
se laissent pas prendre au vertige
de l'enfant abandonné.
____________________ JJ.S.S. •
(1) «Les Citoyens au pouvoir». Edi-
tions du Seuil.
tions du Seuil.
L'EXPRESS -


PRÉSIDENCE
Epitophe
pour une société
Les Français attendaient du pathé-
tique : le général de Gaulle ne leur
en a pas donné. Les intellectuels
guettaient les mots archaïques qui
font mouche et dont on décrypte la
signification dans le Littré : il n'y
en a pas eu un seul. Le « parti de la
crainte », qui déborde largement le
Centre et le Marais, mais se love,
dans les temps de grande crise, au
cœur de tous, espérait, sans trop y
croire, que le chef de l'Etat, une fois
tique : le général de Gaulle ne leur
en a pas donné. Les intellectuels
guettaient les mots archaïques qui
font mouche et dont on décrypte la
signification dans le Littré : il n'y
en a pas eu un seul. Le « parti de la
crainte », qui déborde largement le
Centre et le Marais, mais se love,
dans les temps de grande crise, au
cœur de tous, espérait, sans trop y
croire, que le chef de l'Etat, une fois
dépêches et les coups de téléphone
ne peuvent rendre. Une fièvre, une
angoisse, un espoir. M. Georges Pom-
pidou se charge de le mettre en face
de la réalité. Dans son bureau, les
ministres défilent. Il les écoute. Tous
sont anxieux, parlent du temps qui
passe. De toute part, on le presse
de parler dès lundi soir. Le général
de Gaulle hésite. Le Premier ministre
se bat à contre-courant : il faut
d'abord savoir ce que va faire le
Parlement. Se précipiter, c'est ris-
quer de gâcher la seule arme abso-
lue avec laquelle le Général a gou-
verné la France depuis trente ans :
le verbe.
ne peuvent rendre. Une fièvre, une
angoisse, un espoir. M. Georges Pom-
pidou se charge de le mettre en face
de la réalité. Dans son bureau, les
ministres défilent. Il les écoute. Tous
sont anxieux, parlent du temps qui
passe. De toute part, on le presse
de parler dès lundi soir. Le général
de Gaulle hésite. Le Premier ministre
se bat à contre-courant : il faut
d'abord savoir ce que va faire le
Parlement. Se précipiter, c'est ris-
quer de gâcher la seule arme abso-
lue avec laquelle le Général a gou-
verné la France depuis trente ans :
le verbe.
Le président de la République se
rend aux raisons du Premier mi-
rend aux raisons du Premier mi-
meurt qui ne méritait plus de vivre :
l'Université d'autrefois, les médecins
féodaux et les avocats de Daumier,
le syndicalisme d'il y a cinquante
ans. Le Général écoute, approuve,
pose des questions, interrompt. Ce
n'est plus le père qui va trancher
à la fin du débat, mais un homme
comme les autres qui tente de per-
cer, à travers les propos, le mystère
des temps nouveaux.
l'Université d'autrefois, les médecins
féodaux et les avocats de Daumier,
le syndicalisme d'il y a cinquante
ans. Le Général écoute, approuve,
pose des questions, interrompt. Ce
n'est plus le père qui va trancher
à la fin du débat, mais un homme
comme les autres qui tente de per-
cer, à travers les propos, le mystère
des temps nouveaux.
A la fin du Conseil, il tente de
faire la synthèse entre ses vieilles
hantises et ce qui monte de la rue.
Il a toujours su que le Patronat
français, les professeurs, les notables
étaient les représentants d'un monde
fini. Lorsque, en 1944, il arrivait à
Lyon fraîchement libéré, Yves Farge,
faire la synthèse entre ses vieilles
hantises et ce qui monte de la rue.
Il a toujours su que le Patronat
français, les professeurs, les notables
étaient les représentants d'un monde
fini. Lorsque, en 1944, il arrivait à
Lyon fraîchement libéré, Yves Farge,
de Gaulle rédige son discours. Il
pourrait s'expliquer longuement. Il
ne le veut pas. Il a pris la France,
il y a dix ans, au bord d'une guerre
civile, et l'a amenée aux portes d'une
autre guerre civile. On ne justifie pas
un tel échec. On en prend acte.
Donc, le discours sera bref. Il visera
l'essentiel, c'est-à-dire la paix civile
et la sauvegarde d'institutions dont
le Général continue à penser qu'elles
sont supérieures à celles que la
nation s'était données autrefois.
pourrait s'expliquer longuement. Il
ne le veut pas. Il a pris la France,
il y a dix ans, au bord d'une guerre
civile, et l'a amenée aux portes d'une
autre guerre civile. On ne justifie pas
un tel échec. On en prend acte.
Donc, le discours sera bref. Il visera
l'essentiel, c'est-à-dire la paix civile
et la sauvegarde d'institutions dont
le Général continue à penser qu'elles
sont supérieures à celles que la
nation s'était données autrefois.
Lo'rsque le vieux visage disparaît
des écrans de télévision, la Bourse,
symbole d'une époque, flambe aux
mains des étudiants. La bataille fait
rage des deux côtés de la Seine.
Le Général et ses ministres pensent
des écrans de télévision, la Bourse,
symbole d'une époque, flambe aux
mains des étudiants. La bataille fait
rage des deux côtés de la Seine.
Le Général et ses ministres pensent
LE GÉNÉRAL DE GAULLE X LA TÉLÉVISION, VENDREDI DERNIER.
« J'ai peur que la France ne soit pas faite pour moi. »
de plus, ferait surgir du chaos l'idée-
miracle qui, dans les moments gra-
ves, soude une « nation légère et
dure » : il n'y a pas eu de potion
magique.
miracle qui, dans les moments gra-
ves, soude une « nation légère et
dure » : il n'y a pas eu de potion
magique.
A 20 h 10, les étudiants de la Sor-
bonne, les ouvriers de la Régie Re-
nault, les étudiants gaullistes étaient
interloqués et déçus : le Général avait
parlé un langage que personne n'at-
tendait.
bonne, les ouvriers de la Régie Re-
nault, les étudiants gaullistes étaient
interloqués et déçus : le Général avait
parlé un langage que personne n'at-
tendait.
Celui d'un homme qui perçoit sou-
dain le sens .d'une révolte qu'il n'a
ni pressentie ni conjurée. Davantage
même : qui en comprend obscuré-
dain le sens .d'une révolte qu'il n'a
ni pressentie ni conjurée. Davantage
même : qui en comprend obscuré-
nistre. D'ailleurs, il préfère attendre.
Une fois le plan établi, il ne faudra
plus s'en écarter d'un iota, quoi qu'il
arrive.
Une fois le plan établi, il ne faudra
plus s'en écarter d'un iota, quoi qu'il
arrive.
Les suggestions les plus étranges
arrivent jusqu'à l'Elysée : il faut,
dit-on, contribuer à faire tomber le
gouvernement pour sauver le régime,
sacrifier Pompidou pour sauver de
Gaulle. Mardi dans l'après-midi, cette
thèse menace de l'emporter. Mercredi
matin, le Général commence à y voir
plus clair. Le ton change. Il se fait
moins attentif et plus militaire : le
Parlement est le représentant de la
arrivent jusqu'à l'Elysée : il faut,
dit-on, contribuer à faire tomber le
gouvernement pour sauver le régime,
sacrifier Pompidou pour sauver de
Gaulle. Mardi dans l'après-midi, cette
thèse menace de l'emporter. Mercredi
matin, le Général commence à y voir
plus clair. Le ton change. Il se fait
moins attentif et plus militaire : le
Parlement est le représentant de la
ment la signification. Mais qui, en volonté nationale. C'est à lui de tran-
même temps, constate qu'un monde
nouveau se dresse et que ce n'est
plus le sien.
nouveau se dresse et que ce n'est
plus le sien.
Même l'annonce de son départ
dans le cas où le référendum-plébis-
cite qui va se dérouler à la mi-juin
lui serait défavorable est restée
exempte de romantisme. Historien de
sa piopre histoire, le général de
Gaulle a admis implicitement que le
peuple pouvait lui signifier son
échec. Simple constat d'une défaite
dans la longue histoire d'une nation
qui n'en a pas fini avec les sauveurs,
les guerres civiles, voire la « Renais-
sance ».
dans le cas où le référendum-plébis-
cite qui va se dérouler à la mi-juin
lui serait défavorable est restée
exempte de romantisme. Historien de
sa piopre histoire, le général de
Gaulle a admis implicitement que le
peuple pouvait lui signifier son
échec. Simple constat d'une défaite
dans la longue histoire d'une nation
qui n'en a pas fini avec les sauveurs,
les guerres civiles, voire la « Renais-
sance ».
Simplement, devant le risque de la
bataille intérieure d'un peuple qui
n'est pas encore divisé par la haine,
il se propose, une dernière fois, pour
aider à franchir l'étape de réconci-
liation provisoire. Rien de plus.
bataille intérieure d'un peuple qui
n'est pas encore divisé par la haine,
il se propose, une dernière fois, pour
aider à franchir l'étape de réconci-
liation provisoire. Rien de plus.
Réaction de M. Pierre Mendès
France : « Je suis consterné, j'atten-
dais des propositions et, bien que
dans l'opposition, j'espérais que nous
étions en présence de quelque chose
de nouveau qui offrirait au pays un
moyen de sortir de la grande crise
dans laquelle il se trouve.
France : « Je suis consterné, j'atten-
dais des propositions et, bien que
dans l'opposition, j'espérais que nous
étions en présence de quelque chose
de nouveau qui offrirait au pays un
moyen de sortir de la grande crise
dans laquelle il se trouve.
« En fait, nous avons trouvé à la
place l'annonce d'un nouveau plébis-
cite. Dans cette crise, le pouvoir, une
fois de plus, se contente de deman-
der un blanc-seing. Un plébiscité,
cela ne se discute pas, cela se
combat. »
place l'annonce d'un nouveau plébis-
cite. Dans cette crise, le pouvoir, une
fois de plus, se contente de deman-
der un blanc-seing. Un plébiscité,
cela ne se discute pas, cela se
combat. »
Ce discours, sept minutes de si-
lence au milieu du bruit des grenades
lacrymogènes et des clameurs de la
foule, était aussi le déclenchement
d'une opération stratégique dont
l'issue est incertaine. Le Général l'a
mise au point en six jours.
lence au milieu du bruit des grenades
lacrymogènes et des clameurs de la
foule, était aussi le déclenchement
d'une opération stratégique dont
l'issue est incertaine. Le Général l'a
mise au point en six jours.
A contre-courant. Lorsque, le sa
medi 18 mai, il revient de Roumanie,
il est au courant de tout, mais il ne
medi 18 mai, il revient de Roumanie,
il est au courant de tout, mais il ne
cher. Il faut se battre. Georges Pom-
pidou se battra donc.
pidou se battra donc.
Le débat de censure se déroule,
fenêtre ouverte devant la nation.
Chaque nuit, le Quartier latin ex-
plose. Le nombre des grévistes frôle
les 9 millions. Tout le redressement
économique français, sans compter le
prestige international de la France,
est désormais en question.
fenêtre ouverte devant la nation.
Chaque nuit, le Quartier latin ex-
plose. Le nombre des grévistes frôle
les 9 millions. Tout le redressement
économique français, sans compter le
prestige international de la France,
est désormais en question.
Le chef de l'Etat suit le débat
sur la censure à la télévision comme
tout le monde. Il constate que le
Premier ministre ne sort vainqueur
qu'en apparence des joutes parlemen-
taires.
sur la censure à la télévision comme
tout le monde. Il constate que le
Premier ministre ne sort vainqueur
qu'en apparence des joutes parlemen-
taires.
Le chef de l'Etat comprend que
cette victoire n'a pas de signification.
Elle est celle du parti parlementaire
de la crainte.
cette victoire n'a pas de signification.
Elle est celle du parti parlementaire
de la crainte.
Tour de table. Les députés de
l'U.D. Ve République ont écouté
M. Edgard Pisani avec passion parce
que sa démission les fascinait. Mer-
credi dans la nuit, M. Pompidou est
encore Premier ministre, mais le
dauphin du Général est probable-
ment mort. Le travail de six années
pour éviter l'obstacle historique clas-
sique des régimes monarchiques, ce-
lui de la succession, s'était effondré
par la conjonction des étudiants de
Nanterre et de la Sorbonne, des fau-
tes du pouvoir, et de l'incapacité du
Général et de ses ministres à com-
prendre que les innombrables en-
fants de l'après-guerre étaient désor-
mais devenus des hommes.
l'U.D. Ve République ont écouté
M. Edgard Pisani avec passion parce
que sa démission les fascinait. Mer-
credi dans la nuit, M. Pompidou est
encore Premier ministre, mais le
dauphin du Général est probable-
ment mort. Le travail de six années
pour éviter l'obstacle historique clas-
sique des régimes monarchiques, ce-
lui de la succession, s'était effondré
par la conjonction des étudiants de
Nanterre et de la Sorbonne, des fau-
tes du pouvoir, et de l'incapacité du
Général et de ses ministres à com-
prendre que les innombrables en-
fants de l'après-guerre étaient désor-
mais devenus des hommes.
Au Conseil des ministres de jeudi
matin, le Général est calme. Une fois
de plus, il fait procéder au tradi-
tionnel tour de table : chaque mi-
nistre est prié de donner son avis.
D'ordinaire, le débat est rapide. Cette
fois, il dure quatre heures. Comme
si les miasmes de la Sorbonne
avaient traversé la Seine. Chacun
matin, le Général est calme. Une fois
de plus, il fait procéder au tradi-
tionnel tour de table : chaque mi-
nistre est prié de donner son avis.
D'ordinaire, le débat est rapide. Cette
fois, il dure quatre heures. Comme
si les miasmes de la Sorbonne
avaient traversé la Seine. Chacun
« sent » pas ce qui fut son pays, s'exprime longuement. Les analyses
Quelque chose lui manque que les sont convergentes ; une société
Quelque chose lui manque que les sont convergentes ; une société
commissaire de la République, l'avait
reçu par ces mots : « Mon général,
le peuple est là, mais pas les nota-
bles. » Le Général avait rétorqué :
« Je les connais, Farge, et je sais
ce qu'ils valent. »
reçu par ces mots : « Mon général,
le peuple est là, mais pas les nota-
bles. » Le Général avait rétorqué :
« Je les connais, Farge, et je sais
ce qu'ils valent. »
II le savait, il n'a pas réussi à les
abattre. Il les a contraints, violés, il
a vingt fois sauté par-dessus leur
tête. Mais il a composé avec eux et
oublié^ qu'un jour la rue ne compo-
serait pas.
abattre. Il les a contraints, violés, il
a vingt fois sauté par-dessus leur
tête. Mais il a composé avec eux et
oublié^ qu'un jour la rue ne compo-
serait pas.
Le mot-clé. H faut parer au plus
pressé. Le mot-clé pour le Général
est celui de « participation ». Aux
anciens corps intermédiaires défail-
lants, il faut en substituer de nou-
veaux, représentant cette génération
nouvelle.
pressé. Le mot-clé pour le Général
est celui de « participation ». Aux
anciens corps intermédiaires défail-
lants, il faut en substituer de nou-
veaux, représentant cette génération
nouvelle.
La bataille se déroulera donc en
quatre étapes :
quatre étapes :
— Le gouvernement, confirmé par
l'Assemblée, reste en place jusqu'à
lundi matin. Ce jour-là, le projet de
loi soumis au référendum sera rendu
public.
l'Assemblée, reste en place jusqu'à
lundi matin. Ce jour-là, le projet de
loi soumis au référendum sera rendu
public.
— Le remaniement ministériel pourra
à la rigueur intervenir d'une manière
limitée dans les jours qui viennent.
à la rigueur intervenir d'une manière
limitée dans les jours qui viennent.
— De toute manière, le gouverne-
ment est désormais un gouverne-
ment provisoire qui a pour tâche de
négocier avec les syndicats et d'obte-
nir la reprise du travail. Subsidiaire-
ment, d'expédier jusqu'au référen-
dum les affaires courantes et d'assu-
rer l'ordre dans la rue. En 1944, le
Général a ressuscité la République; il
entend en laisser une derrière lui,
et non pas le chaos.
ment est désormais un gouverne-
ment provisoire qui a pour tâche de
négocier avec les syndicats et d'obte-
nir la reprise du travail. Subsidiaire-
ment, d'expédier jusqu'au référen-
dum les affaires courantes et d'assu-
rer l'ordre dans la rue. En 1944, le
Général a ressuscité la République; il
entend en laisser une derrière lui,
et non pas le chaos.
— Au lendemain du référendum, de
Gaulle, s'il sort vainqueur, entamera
une transformation profonde dont
il ne sait pas précisément ce qu'elle
peut être. Ou bien s'il est défait, il
partira.
Gaulle, s'il sort vainqueur, entamera
une transformation profonde dont
il ne sait pas précisément ce qu'elle
peut être. Ou bien s'il est défait, il
partira.
Chacun, au Conseil, approuve. Mais
la confiance est malade. Pour la pre-
mière fois, il n'a pas parlé comme
un père. Il a compris que le don
charismatique que le peuple lui avait
donné, le peuple le lui avait retiré.
Car désormais, c'est la jeunesse qui
capte l'imagination.
la confiance est malade. Pour la pre-
mière fois, il n'a pas parlé comme
un père. Il a compris que le don
charismatique que le peuple lui avait
donné, le peuple le lui avait retiré.
Car désormais, c'est la jeunesse qui
capte l'imagination.
N'importe. L'essentiel de la stra-
tégie tient en une phrase. II faut
tenter, avec l'appui de la C.G.T. et du
Parti Communiste, seuls représen-
tants désormais d'un autre ordre pos-
sible, de franchir le cap des négo-
ciations salariales et de détourner les
combats de rue en combats d'urne.
De faire passer la révolte sociale en
débat politique.
tégie tient en une phrase. II faut
tenter, avec l'appui de la C.G.T. et du
Parti Communiste, seuls représen-
tants désormais d'un autre ordre pos-
sible, de franchir le cap des négo-
ciations salariales et de détourner les
combats de rue en combats d'urne.
De faire passer la révolte sociale en
débat politique.
Jeudi, dans l'après-midi, le général
tous, à cette heure-là — et s'ils en
ont encore l'humeur — à ce qu'il
aurait fallu faire :
ont encore l'humeur — à ce qu'il
aurait fallu faire :
— Liquider la vieille structure napo-
léonienne de l'Etat, et, très précisé-
ment, la dictature du ministère des
Finances. Edifié par les monarchies,
confirmé par les révolutions, le vieil
Etat napoléonien n'est plus à la
mesure de ce que peut être aujour-
d'hui une démocratie. Il fallait l'abat-
tre.
léonienne de l'Etat, et, très précisé-
ment, la dictature du ministère des
Finances. Edifié par les monarchies,
confirmé par les révolutions, le vieil
Etat napoléonien n'est plus à la
mesure de ce que peut être aujour-
d'hui une démocratie. Il fallait l'abat-
tre.
— Transformer l'entreprise de telle
manière qu'il n'y ait plus, face à
face, un monarque et ses sujets.
Lorsque ceux-ci ont dépassé le stade
de la contestation, ce qu'ils deman-
dent, c'est bien davantage que de
simples augmentations de salaires,
mêmes s'ils n'en ont pas eux-mêmes
conscience.
manière qu'il n'y ait plus, face à
face, un monarque et ses sujets.
Lorsque ceux-ci ont dépassé le stade
de la contestation, ce qu'ils deman-
dent, c'est bien davantage que de
simples augmentations de salaires,
mêmes s'ils n'en ont pas eux-mêmes
conscience.
— Donner aux régions et aux com-
munes cette autonomie de gestion
qui permet à chaque homme d'être
effectivement présent devant les déci-
sions qui, jour après jour, modifient
le paysage dans lequel se déroule sa
vie.
munes cette autonomie de gestion
qui permet à chaque homme d'être
effectivement présent devant les déci-
sions qui, jour après jour, modifient
le paysage dans lequel se déroule sa
vie.
Il est trop tard. Fasciné par le
problème de la grandeur de son pays
et de son rang dans le monde, le
Général a, pendant dix ans, négligé
ce qui se passait à l'intérieur d'un
hexagone qui lui paraissait assagi.
problème de la grandeur de son pays
et de son rang dans le monde, le
Général a, pendant dix ans, négligé
ce qui se passait à l'intérieur d'un
hexagone qui lui paraissait assagi.
Il a laissé faire. Lorsqu'on le pres-
sait de résoudre tel ou tel problème
qui lui semblait mineur, il parlait
d'intendance.
sait de résoudre tel ou tel problème
qui lui semblait mineur, il parlait
d'intendance.
Pour une fois, il s'était trompé de
mot. Ce qu'il recouvrait sous ce
terme méprisant, c'était peut-être une
nouvelle démocratie qui cherchait à
naître.
mot. Ce qu'il recouvrait sous ce
terme méprisant, c'était peut-être une
nouvelle démocratie qui cherchait à
naître.
Bruits et fureurs. H n'est pas sûr
que ce qu'il a manqué, et qui était
peut-être la chance d'un modèle
français de civilisation industrielle à
la mesure du xxi« siècle, d'autres
puisssent le réussir dans le désordre.
que ce qu'il a manqué, et qui était
peut-être la chance d'un modèle
français de civilisation industrielle à
la mesure du xxi« siècle, d'autres
puisssent le réussir dans le désordre.
Au crépuscule d'un règne qui
s'achève en bruits et fureurs, le
général de Gaulle comprend que le
drame national croise son propre
drame : celui d'avoir désormais pour
adversaires la jeunesse et la gauche
dont vainement il rechercha les fa-
veurs. Et d'avoir pour alliés naturels,
dans le référendum plébiscitaire qui,
dans trois semaines, décidera de sa
survie, la bourgeoisie, la peur des
émeutes et la répugnance à l'acces-
sion du communisme au pouvoir.
s'achève en bruits et fureurs, le
général de Gaulle comprend que le
drame national croise son propre
drame : celui d'avoir désormais pour
adversaires la jeunesse et la gauche
dont vainement il rechercha les fa-
veurs. Et d'avoir pour alliés naturels,
dans le référendum plébiscitaire qui,
dans trois semaines, décidera de sa
survie, la bourgeoisie, la peur des
émeutes et la répugnance à l'acces-
sion du communisme au pouvoir.
Devant l'un de ses intimes, le chef
de l'Etat lançait, ces jours-ci : « J'ai
peur que la France ne soit pas faite
pour moi. » GEORGES SUFFERT *
de l'Etat lançait, ces jours-ci : « J'ai
peur que la France ne soit pas faite
pour moi. » GEORGES SUFFERT *


André Thèves
La longue patience de M. Séguy
A 15 ans, sous l'Occupation, M. Georges Séguy
est entré en communisme comme on entre
en religion : avec une foi nourrie depuis l'enfance
par des parents militants de longue date, et la
volonté d'y rester perpétuellement fidèle. Deux ans
plus tard, il payera cher cène fidélité : typographe
au service de la presse clandestine à Toulouse, il
est arrêté par la Gestapo et déporté à Mauthau-
sen.
est entré en communisme comme on entre
en religion : avec une foi nourrie depuis l'enfance
par des parents militants de longue date, et la
volonté d'y rester perpétuellement fidèle. Deux ans
plus tard, il payera cher cène fidélité : typographe
au service de la presse clandestine à Toulouse, il
est arrêté par la Gestapo et déporté à Mauthau-
sen.
A son retour, il entre à la S.N.C.F. Le Parti
Communiste l'affecte au syndicalisme. A 22 ans,
il est secrétaire de la Fédération des cheminots
C.G.T. En 1961, il entre au Bureau confédéral. Au
sein du Parti Communiste, son ascension n'a pas
été moins brillante : il est devenu membre du
Comité central à 27 ans, du Bureau politique à
Communiste l'affecte au syndicalisme. A 22 ans,
il est secrétaire de la Fédération des cheminots
C.G.T. En 1961, il entre au Bureau confédéral. Au
sein du Parti Communiste, son ascension n'a pas
été moins brillante : il est devenu membre du
Comité central à 27 ans, du Bureau politique à
29 ans. On apprécie sa souplesse tactique, son
sens de l'organisation, sa bonhomie familière, et
l'accent de la Garonne qu'il n'est pas parvenu à
gommer entièrement. Les téléspectateurs français
ne sont pas seuls à l'avoir découvert en l'écoutant :
il vient d'accorder une interview à la télévision
américaine.
sens de l'organisation, sa bonhomie familière, et
l'accent de la Garonne qu'il n'est pas parvenu à
gommer entièrement. Les téléspectateurs français
ne sont pas seuls à l'avoir découvert en l'écoutant :
il vient d'accorder une interview à la télévision
américaine.
Nourri dans le sérail, Georges Séguy en connaît
les détours. Assez pour succéder, l'an dernier, à
40 ans, à M. Benoît Frachon au secrétariat général
de la C.G.T. Sa formation est achevée : il a
appris dans l'action et dans les écoles de cadres
du Parti que la révolution n'est ni une fête ni
un coup de poker. Mais le fruit d'une organisation
précise greffée sur une longue patience.
les détours. Assez pour succéder, l'an dernier, à
40 ans, à M. Benoît Frachon au secrétariat général
de la C.G.T. Sa formation est achevée : il a
appris dans l'action et dans les écoles de cadres
du Parti que la révolution n'est ni une fête ni
un coup de poker. Mais le fruit d'une organisation
précise greffée sur une longue patience.
GAUCHE
Les communistes
ont joué le jeu
ont joué le jeu
Un homme a, la semaine dernière,
partagé le pouvoir de fait avec le
général de Gaulle: M. Georges Sé-
guy, secrétaire général de la C.G.T.
Les étudiants avaient, à coups de pa-
vés et de barricades, ébranlé le
régime. Mais c'est le secrétaire
général de la C.G.T., qui, en étendant
à 9 millions de travailleurs une grève
née dans une usine normande, a
peut-être porté au gaullisme un coup
décisif. Sans préméditation.
partagé le pouvoir de fait avec le
général de Gaulle: M. Georges Sé-
guy, secrétaire général de la C.G.T.
Les étudiants avaient, à coups de pa-
vés et de barricades, ébranlé le
régime. Mais c'est le secrétaire
général de la C.G.T., qui, en étendant
à 9 millions de travailleurs une grève
née dans une usine normande, a
peut-être porté au gaullisme un coup
décisif. Sans préméditation.
A l'origine, M. Séguy était même
opposé à ceux qu'il dénonçait dans
une conférence de presse, le 7 mai,
comme des « éléments troubles et
provocateurs de l'Université ». A 41
ans, il a des luttes ouvrières une
expérience acquise sur le tas en 1947
et dans les états-majors en 1953. Il
se méfie des aventures, mais il flaire
l'événement et les situations nouvel-
les ne le prennent pas au dépourvu.
Lorsque, à Cléon, 200 jeunes ouvriers
incontrôlés occupent par surprise
leur usine, il déclenche sur l'heure
le plus vaste mouvement revendicatif
que la France ait jamais connu. (Il
y avait 30 °/o de travailleurs en grève,
selon les chiffres de la C.G.T., en
1936. Il y en avait 50 % la semaine
dernière.) Le mouvement ouvrier a
rarement pesé — depuis 1936 —
aussi lourd sur la vie nationale.
opposé à ceux qu'il dénonçait dans
une conférence de presse, le 7 mai,
comme des « éléments troubles et
provocateurs de l'Université ». A 41
ans, il a des luttes ouvrières une
expérience acquise sur le tas en 1947
et dans les états-majors en 1953. Il
se méfie des aventures, mais il flaire
l'événement et les situations nouvel-
les ne le prennent pas au dépourvu.
Lorsque, à Cléon, 200 jeunes ouvriers
incontrôlés occupent par surprise
leur usine, il déclenche sur l'heure
le plus vaste mouvement revendicatif
que la France ait jamais connu. (Il
y avait 30 °/o de travailleurs en grève,
selon les chiffres de la C.G.T., en
1936. Il y en avait 50 % la semaine
dernière.) Le mouvement ouvrier a
rarement pesé — depuis 1936 —
aussi lourd sur la vie nationale.
Deux objectifs guident le secrétaire
général de la C.G.T. En ordonnant
l'occupation des usines, il veut
d'abord éviter que celles-ci ne tom-
bent par surprise aux mains de jeu-
nes « enragés ». Les jeunes, il le sait,
ont suivi le mouvement avec plus
d'entrain que les grognards du syn-
dicalisme. « Tout est parti de la base,
explique un ouvrier de l'usine Peu-
geot de Courbevoie ; notre force est
là. » M. Séguy veut dissocier la lutte
ouvrière de la révolte étudiante. L'of-
fensive obstinée des occupants de la
Sorbonne en direction des usines sus-
cite en lui une froide colère. La
construction, ça et là, de comités
étudiants-travailleurs l'exaspère. « No-
tre but n'est pas seulement d'exécu-
ter les ordres des syndicats, mais
aussi d'en comprendre le sens », dé-
clare à « L'Express » un des membres
de ces comités.
général de la C.G.T. En ordonnant
l'occupation des usines, il veut
d'abord éviter que celles-ci ne tom-
bent par surprise aux mains de jeu-
nes « enragés ». Les jeunes, il le sait,
ont suivi le mouvement avec plus
d'entrain que les grognards du syn-
dicalisme. « Tout est parti de la base,
explique un ouvrier de l'usine Peu-
geot de Courbevoie ; notre force est
là. » M. Séguy veut dissocier la lutte
ouvrière de la révolte étudiante. L'of-
fensive obstinée des occupants de la
Sorbonne en direction des usines sus-
cite en lui une froide colère. La
construction, ça et là, de comités
étudiants-travailleurs l'exaspère. « No-
tre but n'est pas seulement d'exécu-
ter les ordres des syndicats, mais
aussi d'en comprendre le sens », dé-
clare à « L'Express » un des membres
de ces comités.
Au gré des vents. M. Séguy, et les
dirigeants communistes avec lui,
craint que des éléments étrangers au
monde ouvrier n'en prennent la di-
rection. Et l'orientent dans un sens
« gauchiste » et « irresponsable », qui
pourrait rapidement entraîner sa
désagrégation.
dirigeants communistes avec lui,
craint que des éléments étrangers au
monde ouvrier n'en prennent la di-
rection. Et l'orientent dans un sens
« gauchiste » et « irresponsable », qui
pourrait rapidement entraîner sa
désagrégation.
D'où son irritation contre les jeu-
nes dirigeants universitaires, MM.
Alain Geismar et Jacques Sauvageot,
et surtout M. Daniel Cohn-Bendit.
Cette hostilité latente au mouvement
étudiant, un militant C.G.T. l'a ré-
sumée brutalement, à l'usage des
élèves de l'Institut d'études poli-
tiques qui l'avaient aimablement con-
vié à un dialogue : « La classe
ouvrière fera elle-même la révolution.
Vous le savez bien, vous, fils de
bourgeois. » La direction de la C.G.T.
nes dirigeants universitaires, MM.
Alain Geismar et Jacques Sauvageot,
et surtout M. Daniel Cohn-Bendit.
Cette hostilité latente au mouvement
étudiant, un militant C.G.T. l'a ré-
sumée brutalement, à l'usage des
élèves de l'Institut d'études poli-
tiques qui l'avaient aimablement con-
vié à un dialogue : « La classe
ouvrière fera elle-même la révolution.
Vous le savez bien, vous, fils de
bourgeois. » La direction de la C.G.T.
L'EXPRESS
adopte donc une attitude obligatoi-
rement ambiguë, naviguant, au gré
des vents, entre les sarcasmes adres-
sés à l'Unef et l'antique « main ten-
due », cette fois aux étudiants.
rement ambiguë, naviguant, au gré
des vents, entre les sarcasmes adres-
sés à l'Unef et l'antique « main ten-
due », cette fois aux étudiants.
Deuxième objectif de M. Séguy :
rester dans la légalité. Et d'abord ras-
surer une population que les priva-
tions et les contraintes d'une grève
démoralisent vite. Les experts de la
C.G.T. mettent en œuvre un plan
d'urgence pour rendre la grève sup-
portable : maintien de la distribution
d'eau, de gaz et d'électricité, malgré
l'occupation des usines par les
ouvriers. Dans la région parisienne,
une chaîne d'approvisionnement en
lait, farine, fruits et légumes est
créée par M. Mario Livi, secrétaire
général de la Fédération de l'alimen-
tation.
rester dans la légalité. Et d'abord ras-
surer une population que les priva-
tions et les contraintes d'une grève
démoralisent vite. Les experts de la
C.G.T. mettent en œuvre un plan
d'urgence pour rendre la grève sup-
portable : maintien de la distribution
d'eau, de gaz et d'électricité, malgré
l'occupation des usines par les
ouvriers. Dans la région parisienne,
une chaîne d'approvisionnement en
lait, farine, fruits et légumes est
créée par M. Mario Livi, secrétaire
général de la Fédération de l'alimen-
tation.
ment à grands cris, vendredi 24 mai,
les manifestants de la C.G.T. Après
que les trois porte-parole du Parti
Communiste en ont, au Palais-
Bourbon, affirmé la nécessité.
les manifestants de la C.G.T. Après
que les trois porte-parole du Parti
Communiste en ont, au Palais-
Bourbon, affirmé la nécessité.
La C.G.T. entend exploiter sa posi-
tion de force, mais aussi éviter la
dégénérescence du mouvement.
M. Benoît Frachon, président de la
Confédération, paraphrase donc
Maurice Thorez : « II faudra bien
en finir. Une grève n'est pas éter-
nelle. » Situation paradoxale : la
C.G.T., dont le but affirmé est depuis
dix ans d'abattre le régime, pousse à
l'accélération des négociations. A plu-
sieurs reprises, M. Séguy reproche
au gouvernement le temps gaspillé
dans l'attente du discours du général
de Gaulle.
tion de force, mais aussi éviter la
dégénérescence du mouvement.
M. Benoît Frachon, président de la
Confédération, paraphrase donc
Maurice Thorez : « II faudra bien
en finir. Une grève n'est pas éter-
nelle. » Situation paradoxale : la
C.G.T., dont le but affirmé est depuis
dix ans d'abattre le régime, pousse à
l'accélération des négociations. A plu-
sieurs reprises, M. Séguy reproche
au gouvernement le temps gaspillé
dans l'attente du discours du général
de Gaulle.
Cette position d'ensemble est par-
A.P.
Au PARLEMENT : MM. CLAUDE ESTIER, FRANÇOIS MITTERRAND,
PIERRE MENDÈS FRANCE ET GASTON DEFFERRE.
PIERRE MENDÈS FRANCE ET GASTON DEFFERRE.
Manuel Bidermanas
DEVANT LA GARE DE LYON,
VENDREDI DERNIER.
VENDREDI DERNIER.
A grands cris. Cette volonté de
rassurer traduit un sentiment pro-
fond : la grève insurrectionnelle, qui
renverserait les institutions par la
force, n'est ni possible ni souhaitable.
Mieux vaut, aux yeux de la C.G.T. et
du Parti Communiste, laisser se dé-
velopper le jeu normal des institu-
tions qui devrait, à son terme —
mais à son terme légal et électoral
seulement — permettre d'instituer le
gouvernement populaire que récla-
rassurer traduit un sentiment pro-
fond : la grève insurrectionnelle, qui
renverserait les institutions par la
force, n'est ni possible ni souhaitable.
Mieux vaut, aux yeux de la C.G.T. et
du Parti Communiste, laisser se dé-
velopper le jeu normal des institu-
tions qui devrait, à son terme —
mais à son terme légal et électoral
seulement — permettre d'instituer le
gouvernement populaire que récla-
tagée, au Parti Communiste, par la
majorité des dirigeants. Si le climat
est parfois tendu au Comité central,
la définition de la stratégie n'y joue
qu'un rôle mineur. Ses conséquences
à l'égard du mouvement étudiant
— dont MM. Louis Aragon et Roland
Leroy sont les avocats, depuis le
11 mai, auprès des membres du Bu-
reau politique — sont plus critiques
et critiquées.
majorité des dirigeants. Si le climat
est parfois tendu au Comité central,
la définition de la stratégie n'y joue
qu'un rôle mineur. Ses conséquences
à l'égard du mouvement étudiant
— dont MM. Louis Aragon et Roland
Leroy sont les avocats, depuis le
11 mai, auprès des membres du Bu-
reau politique — sont plus critiques
et critiquées.
Au départ, cette stratégie modérée
a même paru légèrement suspecte au
leader de la Fédération de la gauche.
Reçu le 20 mai à la C.G.T., M Fran-
çois Mitterrand s'enquiert prudem-
ment : « N'allez-vous pas négocier
derrière notre dos ? » Mais il trouve,
dans ses discussions avec les com-
munistes, des interlocuteurs rassu-
rants. Décidés, comme lui, à jouer,
pour un renversement du pouvoir,
le jeu de la légalité. Peu confiants
dans les chances de survie d'un ré-
gime qui serait instauré sous la pres-
sion de la rue. Et hostiles à l'éven-
tualité d'un 13 Mai à l'envers. Pas
un instant, les chefs de la Fédération
ne redouteront d'être débordés par
le Parti Communiste et la C.G.T. Ils
ne craindront pas la remise en cause
de l'accord P.C.-Fédération.
Le retour au calme. M. Mitterrand,
qui se considère plus que jamais
comme le « candidat unique de la
gauche », formule seul, vendredi
a même paru légèrement suspecte au
leader de la Fédération de la gauche.
Reçu le 20 mai à la C.G.T., M Fran-
çois Mitterrand s'enquiert prudem-
ment : « N'allez-vous pas négocier
derrière notre dos ? » Mais il trouve,
dans ses discussions avec les com-
munistes, des interlocuteurs rassu-
rants. Décidés, comme lui, à jouer,
pour un renversement du pouvoir,
le jeu de la légalité. Peu confiants
dans les chances de survie d'un ré-
gime qui serait instauré sous la pres-
sion de la rue. Et hostiles à l'éven-
tualité d'un 13 Mai à l'envers. Pas
un instant, les chefs de la Fédération
ne redouteront d'être débordés par
le Parti Communiste et la C.G.T. Ils
ne craindront pas la remise en cause
de l'accord P.C.-Fédération.
Le retour au calme. M. Mitterrand,
qui se considère plus que jamais
comme le « candidat unique de la
gauche », formule seul, vendredi
après-midi, l'ultimatum politique au
régime gaulliste : « A l'heure où tout
doit être fait pour l'apaisement né-
cessaire, il appartient au Premier
ministre de montrer l'exemple : qu'il
démissionne ! »
régime gaulliste : « A l'heure où tout
doit être fait pour l'apaisement né-
cessaire, il appartient au Premier
ministre de montrer l'exemple : qu'il
démissionne ! »
Alors s'engagera « le nouveau pro-
cessus au terme duquel pleine ré-
ponse -sera donnée aux volontés
qu'exprimé l'immense élan de notre
peuple ».
cessus au terme duquel pleine ré-
ponse -sera donnée aux volontés
qu'exprimé l'immense élan de notre
peuple ».
La réussite d'un éventuel gouver-
nement de gauche passe d'abord par
le retour au calme. M. Guy Mollet,
rencontrant les leaders de la C.F.D.T.,
leur demande, inquiet : « Si nous
sommes amenés à former un gouver-
nement, n'allez-vous pas nous gêner
trop avec vos revendications ? ».
nement de gauche passe d'abord par
le retour au calme. M. Guy Mollet,
rencontrant les leaders de la C.F.D.T.,
leur demande, inquiet : « Si nous
sommes amenés à former un gouver-
nement, n'allez-vous pas nous gêner
trop avec vos revendications ? ».
Pour la C.F.D.T., une crise de ré-
gime est ouverte : elle veut l'exploi-
ter à fond. Et sans tarder. M. Eugène
Descamps juge bon de soutenir le
mouvement étudiant, sans toutefois
aller avec lui jusqu'à l'unité d'action.
Divergence d'appréciation avec la
C.G.T., qui élargit le fossé toujours
existant, malgré un accord de façade
entre les deux confédérations Autre
point de désaccord : le contenu du
cahier de revendications, dans lequel
la C.F.D.T. fait entrer les réformes
des structures et la cogestion de
l'entreprise qui, pour la C.G.T., sont
des « idées creuses ».
gime est ouverte : elle veut l'exploi-
ter à fond. Et sans tarder. M. Eugène
Descamps juge bon de soutenir le
mouvement étudiant, sans toutefois
aller avec lui jusqu'à l'unité d'action.
Divergence d'appréciation avec la
C.G.T., qui élargit le fossé toujours
existant, malgré un accord de façade
entre les deux confédérations Autre
point de désaccord : le contenu du
cahier de revendications, dans lequel
la C.F.D.T. fait entrer les réformes
des structures et la cogestion de
l'entreprise qui, pour la C.G.T., sont
des « idées creuses ».
Aux yeux de la C.F.D.T., qui re-
prochait jusque-là à la C.G.T. de dé-
pendre trop étroitement d'un parti
« révolutionnaire », cette attitude pa-
raît inconcevable De même, pour
quelques dirigeants C.G.T. : M. André
Barjonet, membre du Conseil écono-
mique et social, secrétaire du Centre
d'études économiques et sociales,
donne jeudi 23 sa démission de la
C.G.T., à laquelle il appartenait de-
puis vingt-deux ans. « Je crois, ex-
plique-t-il, qu'on aurait pu renverser
le régime gaulliste. On n'a pas voulu
le faire. »
prochait jusque-là à la C.G.T. de dé-
pendre trop étroitement d'un parti
« révolutionnaire », cette attitude pa-
raît inconcevable De même, pour
quelques dirigeants C.G.T. : M. André
Barjonet, membre du Conseil écono-
mique et social, secrétaire du Centre
d'études économiques et sociales,
donne jeudi 23 sa démission de la
C.G.T., à laquelle il appartenait de-
puis vingt-deux ans. « Je crois, ex-
plique-t-il, qu'on aurait pu renverser
le régime gaulliste. On n'a pas voulu
le faire. »
Coup de bélier.- Entraînés au cal-
cul prudent et à l'estimation froide
des rapports de force, les dirigeants
de la C.G.T. pensent qu'il est encore
trop tôt. Ils craignent que les coups
de bélier trop forts portés par les
étudiants, les paysans et les « gau-
chistes » inorganisés, ne débouchent
sur l'anarchie et ne compromettent
pour longtemps l'avenir de tout ré-
gime démocratique et parlementaire.
Cette crainte est fondée. Un ouvrier
de la Snecma, à Argenteuil, confie
à « L'Express » : « Nous avons vu le
débat de l'Assemblée à la télévision.
Notre enthousiasme est un peu re-
tombé. Les dés étaient pipés. Ce n'est
pas au Parlement que la partie se
joue. »
cul prudent et à l'estimation froide
des rapports de force, les dirigeants
de la C.G.T. pensent qu'il est encore
trop tôt. Ils craignent que les coups
de bélier trop forts portés par les
étudiants, les paysans et les « gau-
chistes » inorganisés, ne débouchent
sur l'anarchie et ne compromettent
pour longtemps l'avenir de tout ré-
gime démocratique et parlementaire.
Cette crainte est fondée. Un ouvrier
de la Snecma, à Argenteuil, confie
à « L'Express » : « Nous avons vu le
débat de l'Assemblée à la télévision.
Notre enthousiasme est un peu re-
tombé. Les dés étaient pipés. Ce n'est
pas au Parlement que la partie se
joue. »
Les dirigeants politiques, pour qui
la crise ne fait que commencer, pen-
sent qu'il faut savoir attendre. Mais
aussi compter avec l'impatience et
l'intransigeance des manifestants.
« Grève générale jusqu'à la victoire »,
dit un militant syndical de Courbe-
voie. Et encore : « Les camarades
étudiants l'ont bien montré. Nous,
les jeunes ouvriers, sommes prêts à
nous battre dans la rue. Nous ne
suivrons pas les mots d'ordre des
syndicats s'ils abandonnent la lutte à
mi-chemin... ». HENRI TRINCHET +
la crise ne fait que commencer, pen-
sent qu'il faut savoir attendre. Mais
aussi compter avec l'impatience et
l'intransigeance des manifestants.
« Grève générale jusqu'à la victoire »,
dit un militant syndical de Courbe-
voie. Et encore : « Les camarades
étudiants l'ont bien montré. Nous,
les jeunes ouvriers, sommes prêts à
nous battre dans la rue. Nous ne
suivrons pas les mots d'ordre des
syndicats s'ils abandonnent la lutte à
mi-chemin... ». HENRI TRINCHET +
(Enquête de François Gault
et Hugues Néel.)
et Hugues Néel.)
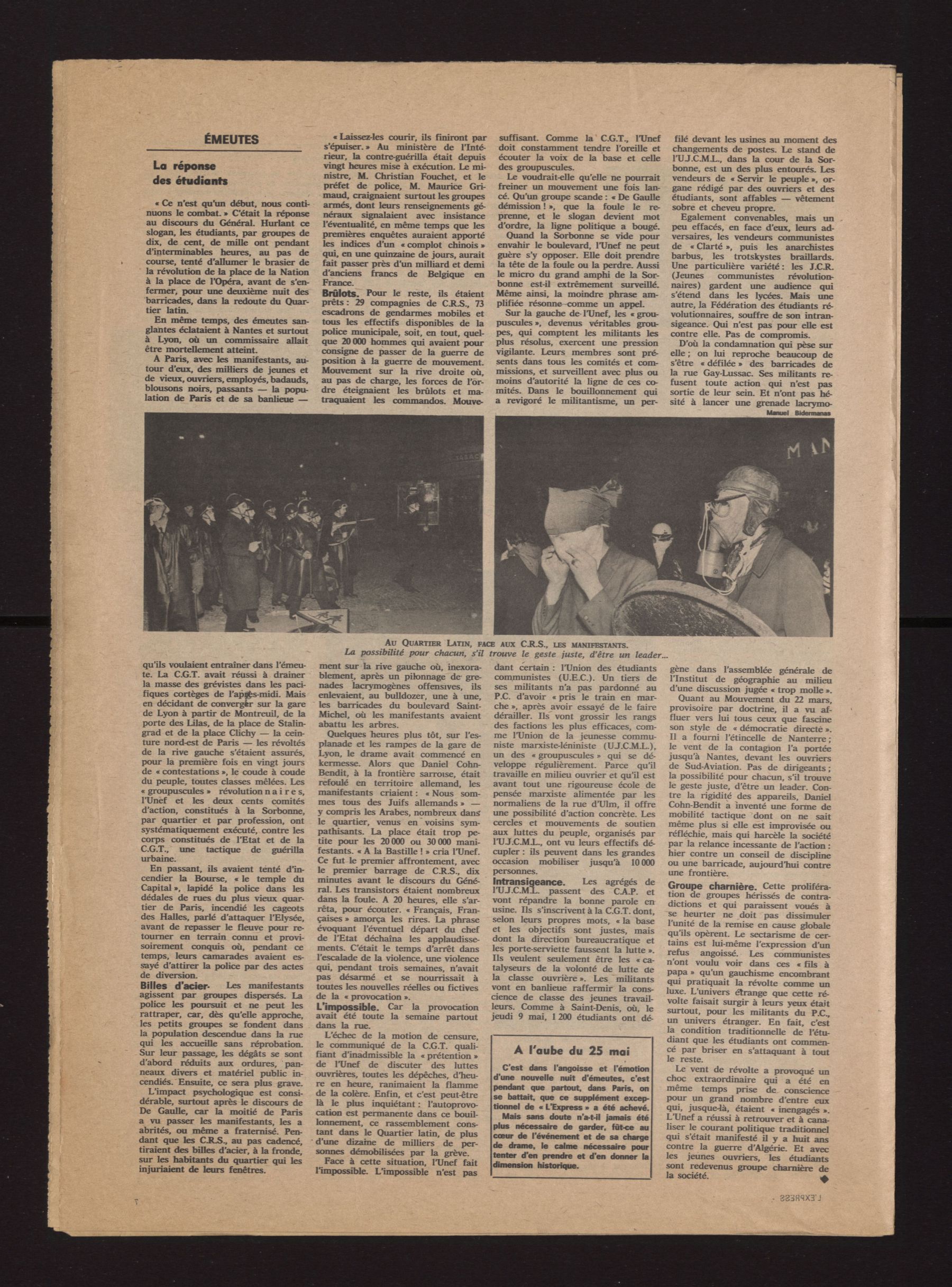

ÉMEUTES
La réponse
des étudiants
des étudiants
« Ce n'est qu'un début, nous conti-
nuons le combat. » C'était la réponse
au discours du Général. Hurlant ce
slogan, les étudiants, par groupes de
dix, de cent, de mille ont pendant
d'interminables heures, au pas de
course, tenté d'allumer le brasier de
la révolution de la place de la Nation
à la place de l'Opéra, avant de s'en-
fermer, pour une deuxième nuit des
barricades, dans la redoute du Quar-
tier latin.
nuons le combat. » C'était la réponse
au discours du Général. Hurlant ce
slogan, les étudiants, par groupes de
dix, de cent, de mille ont pendant
d'interminables heures, au pas de
course, tenté d'allumer le brasier de
la révolution de la place de la Nation
à la place de l'Opéra, avant de s'en-
fermer, pour une deuxième nuit des
barricades, dans la redoute du Quar-
tier latin.
En même temps, des émeutes san-
glantes éclataient à Nantes et surtout
à Lyon, où un commissaire allait
être mortellement atteint.
glantes éclataient à Nantes et surtout
à Lyon, où un commissaire allait
être mortellement atteint.
A Paris, avec les manifestants, au-
tour d'eux, des milliers de jeunes et
de vieux, ouvriers, employés, badauds,
blousons noirs, passants — la popu-
lation de Paris et de sa banlieue —
tour d'eux, des milliers de jeunes et
de vieux, ouvriers, employés, badauds,
blousons noirs, passants — la popu-
lation de Paris et de sa banlieue —
< Laissez-les courir, ils finiront par
s'épuiser. » Au ministère de l'Inté-
rieur, la contre-guérilla était depuis
vingt heures mise à exécution. Le mi-
nistre, M. Christian Fouchet, et le
préfet de police, M. Maurice Gri-
maud, craignaient surtout les groupes
armés, dont leurs renseignements gé-
néraux signalaient avec insistance
l'éventualité, en même temps que les
premières enquêtes auraient apporté
les indices d'un « complot chinois »
qui, en une quinzaine de jours, aurait
fait passer près d'un milliard et demi
d'anciens francs de Belgique en
France.
s'épuiser. » Au ministère de l'Inté-
rieur, la contre-guérilla était depuis
vingt heures mise à exécution. Le mi-
nistre, M. Christian Fouchet, et le
préfet de police, M. Maurice Gri-
maud, craignaient surtout les groupes
armés, dont leurs renseignements gé-
néraux signalaient avec insistance
l'éventualité, en même temps que les
premières enquêtes auraient apporté
les indices d'un « complot chinois »
qui, en une quinzaine de jours, aurait
fait passer près d'un milliard et demi
d'anciens francs de Belgique en
France.
Brûlots. Pour le reste, ils étaient
prêts : 29 compagnies de C.R.S., 73
escadrons de gendarmes mobiles et
tous les effectifs disponibles de la
police municipale, soit, en tout, quel-
que 20 000 hommes qui avaient pour
consigne de passer de la guerre de
position à la guerre de mouvement.
Mouvement sur la rive droite où,
au pas de charge, les forces de l'or-
dre éteignaient les brûlots et ma-
traquaient les commandos. Mouve-
prêts : 29 compagnies de C.R.S., 73
escadrons de gendarmes mobiles et
tous les effectifs disponibles de la
police municipale, soit, en tout, quel-
que 20 000 hommes qui avaient pour
consigne de passer de la guerre de
position à la guerre de mouvement.
Mouvement sur la rive droite où,
au pas de charge, les forces de l'or-
dre éteignaient les brûlots et ma-
traquaient les commandos. Mouve-
suffisant. Comme la C.G.T., l'Unef
doit constamment tendre l'oreille et
écouter la voix de la base et celle
des groupuscules.
doit constamment tendre l'oreille et
écouter la voix de la base et celle
des groupuscules.
Le voudrait-elle qu'elle ne pourrait
freiner un mouvement une fois lan-
cé. Qu'un groupe scande : « De Gaulle
démission ! », que la foule le re-
prenne, et le slogan devient mot
d'ordre, la ligne politique a bougé.
freiner un mouvement une fois lan-
cé. Qu'un groupe scande : « De Gaulle
démission ! », que la foule le re-
prenne, et le slogan devient mot
d'ordre, la ligne politique a bougé.
Quand la Sorbonne se vide pour
envahir le boulevard, ITInef ne peut
guère s'y opposer. Elle doit prendre
la tête de la foule ou la perdre. Aussi
le micro du grand amphi de la Sor-
bonne est-il extrêmement surveillé.
Même ainsi, la moindre phrase am-
plifiée résonne comme un appel.
envahir le boulevard, ITInef ne peut
guère s'y opposer. Elle doit prendre
la tête de la foule ou la perdre. Aussi
le micro du grand amphi de la Sor-
bonne est-il extrêmement surveillé.
Même ainsi, la moindre phrase am-
plifiée résonne comme un appel.
Sur la gauche de l'Unef, les « grou-
puscules », devenus véritables grou-
pes, qui comptent les militants les
plus résolus, exercent une pression
vigilante. Leurs membres sont pré-
sents dans tous les comités et com-
missions, et surveillent avec plus ou
moins d'autorité la ligne de ces co-
mités. Dans le bouillonnement qui
a revigoré le militantisme, un per-
puscules », devenus véritables grou-
pes, qui comptent les militants les
plus résolus, exercent une pression
vigilante. Leurs membres sont pré-
sents dans tous les comités et com-
missions, et surveillent avec plus ou
moins d'autorité la ligne de ces co-
mités. Dans le bouillonnement qui
a revigoré le militantisme, un per-
filé devant les usines au moment des
changements de postes. Le stand de
l'UJ.C.M.L., dans la cour de la Sor-
bonne, est un des plus entourés. Les
vendeurs de « Servir le peuple », or-
gane rédigé par des ouvriers et des
étudiants, sont affables — vêtement
sobre et cheveu propre.
changements de postes. Le stand de
l'UJ.C.M.L., dans la cour de la Sor-
bonne, est un des plus entourés. Les
vendeurs de « Servir le peuple », or-
gane rédigé par des ouvriers et des
étudiants, sont affables — vêtement
sobre et cheveu propre.
Egalement convenables, mais un
peu effacés, en face d'eux, leurs ad-
versaires, les vendeurs communistes
de * Clarté », puis les anarchistes
barbus, les trotskystes braillards.
Une particulière variété : les J.C.R.
(Jeunes communistes révolution-
naires) gardent une audience qui
s'étend dans les lycées. Mais une
autre, la Fédération des étudiants ré-
volutionnaires, souffre de son intran-
sigeance. Qui n'est pas pour elle est
contre elle. Pas de compromis.
peu effacés, en face d'eux, leurs ad-
versaires, les vendeurs communistes
de * Clarté », puis les anarchistes
barbus, les trotskystes braillards.
Une particulière variété : les J.C.R.
(Jeunes communistes révolution-
naires) gardent une audience qui
s'étend dans les lycées. Mais une
autre, la Fédération des étudiants ré-
volutionnaires, souffre de son intran-
sigeance. Qui n'est pas pour elle est
contre elle. Pas de compromis.
D'où la condamnation qui pèse sur
elle ; on lui reproche beaucoup de
s'être « défilée » des barricades de
la rue Gay-Lussac. Ses militants re-
fusent toute action qui n'est pas
sortie de leur sein. Et n'ont pas hé-
sité à lancer une grenade lacrymo-
elle ; on lui reproche beaucoup de
s'être « défilée » des barricades de
la rue Gay-Lussac. Ses militants re-
fusent toute action qui n'est pas
sortie de leur sein. Et n'ont pas hé-
sité à lancer une grenade lacrymo-
Manuel Bidermanas
Au QUARTIER LATIN, FACE AUX C.R.S., LES MANIFESTANTS.
La possibilité pour chacun, s'il trouve le geste juste, d'être un leader..
La possibilité pour chacun, s'il trouve le geste juste, d'être un leader..
qu'ils voulaient entraîner dans l'émeu-
te. La C.G.T. avait réussi à drainer
la masse des grévistes dans les paci-
fiques cortèges de l'apçès-midi. Mais
en décidant de converger sur la gare
de Lyon à partir de Montreuil, de la
porte des Lilas, de la place de Stalin-
grad et de la place Clichy — la cein-
ture nord-est de Paris — les révoltés
de la rive gauche s'étaient assurés,
pour la première fois en vingt jours
de « contestations », le coude à coude
du peuple, toutes classes mêlées. Les
« groupuscules » révolution n a i r e s,
l'Unef et les deux cents comités
d'action, constitués à la Sorbonne,
par quartier et par profession, ont
systématiquement exécuté, contre les
corps constitués de l'Etat et de la
C.G.T., une tactique de guérilla
urbaine.
te. La C.G.T. avait réussi à drainer
la masse des grévistes dans les paci-
fiques cortèges de l'apçès-midi. Mais
en décidant de converger sur la gare
de Lyon à partir de Montreuil, de la
porte des Lilas, de la place de Stalin-
grad et de la place Clichy — la cein-
ture nord-est de Paris — les révoltés
de la rive gauche s'étaient assurés,
pour la première fois en vingt jours
de « contestations », le coude à coude
du peuple, toutes classes mêlées. Les
« groupuscules » révolution n a i r e s,
l'Unef et les deux cents comités
d'action, constitués à la Sorbonne,
par quartier et par profession, ont
systématiquement exécuté, contre les
corps constitués de l'Etat et de la
C.G.T., une tactique de guérilla
urbaine.
En passant, ils avaient tenté d'in-
cendier la Bourse, « le temple du
Capital », lapidé la police dans les
dédales de rues du plus vieux quar-
tier de Paris, incendié les cageots
des Halles, parlé d'attaquer l'Elysée,
avant de repasser le fleuve pour re-
tourner en terrain connu et provi-
soirement conquis où, pendant ce
temps, leurs camarades avaient es-
sayé d'attirer la police par des actes
de diversion.
cendier la Bourse, « le temple du
Capital », lapidé la police dans les
dédales de rues du plus vieux quar-
tier de Paris, incendié les cageots
des Halles, parlé d'attaquer l'Elysée,
avant de repasser le fleuve pour re-
tourner en terrain connu et provi-
soirement conquis où, pendant ce
temps, leurs camarades avaient es-
sayé d'attirer la police par des actes
de diversion.
Billes d'acier- Les manifestants
agissent par groupes dispersés. La
police les poursuit et ne peut les
rattraper, car, dès qu'elle approche,
les petits groupes se fondent dans
la population descendue dans la rue
qui les accueille sans réprobation.
Sur leur passage, les dégâts se sont
d'abord réduits aux ordures, pan-
neaux divers et matériel public in-
cendiés. Ensuite, ce sera plus grave.
agissent par groupes dispersés. La
police les poursuit et ne peut les
rattraper, car, dès qu'elle approche,
les petits groupes se fondent dans
la population descendue dans la rue
qui les accueille sans réprobation.
Sur leur passage, les dégâts se sont
d'abord réduits aux ordures, pan-
neaux divers et matériel public in-
cendiés. Ensuite, ce sera plus grave.
L'impact psychologique est consi-
dérable, surtout après le discours de
De Gaulle, car la moitié de Paris
a vu passer les manifestants, les a
abrités, ou même a fraternisé. Pen-
dant que les CJLS., au pas cadencé,
tiraient des billes d'acier, à la fronde,
sur les habitants du quartier qui les
injuriaient de leurs fenêtres.
dérable, surtout après le discours de
De Gaulle, car la moitié de Paris
a vu passer les manifestants, les a
abrités, ou même a fraternisé. Pen-
dant que les CJLS., au pas cadencé,
tiraient des billes d'acier, à la fronde,
sur les habitants du quartier qui les
injuriaient de leurs fenêtres.
ment sur la rive gauche où, inexora-
blement, après un pilonnage de gre-
nades lacrymogènes offensives, ils
enlevaient, au bulldozer, une à une,
les barricades du boulevard Saint-
Michel, où les manifestants avaient
abattu les arbres.
blement, après un pilonnage de gre-
nades lacrymogènes offensives, ils
enlevaient, au bulldozer, une à une,
les barricades du boulevard Saint-
Michel, où les manifestants avaient
abattu les arbres.
Quelques heures plus tôt, sur l'es-
planade et les rampes de la gare de
Lyon, le drame avait commencé en
kermesse. Alors que Daniel Cohn-
Bendit, à la frontière sarroise, était
refoulé en territoire allemand, les
manifestants criaient : « Nous som-
mes tous des Juifs allemands » —
y compris les Arabes, nombreux dans"
le quartier, venus en voisins sym-
pathisants. La place était trop pe-
tite pour les 20000 ou 30000 mani-
festants. « A la Bastille ! » cria l'Unef.
Ce fut le premier affrontement, avec
le premier barrage de C.R.S., dix
minutes avant le discours du Géné-
ral. Les transistors étaient nombreux
dans la foule. A 20 heures, elle s'ar-
rêta, pour écouter. « Français, Fran-
çaises » amorça les rires. La phrase
évoquant l'éventuel départ du chef
de l'Etat déchaîna les applaudisse-
ments. C'était le temps d'arrêt dans
l'escalade de la violence, une violence
qui, pendant trois semaines, n'avait
pas désarmé et se nourrissait à
toutes les nouvelles réelles ou fictives
de la « provocation ».
L'impossible. Car la provocation
avait été toute la semaine partout
dans la rue.
planade et les rampes de la gare de
Lyon, le drame avait commencé en
kermesse. Alors que Daniel Cohn-
Bendit, à la frontière sarroise, était
refoulé en territoire allemand, les
manifestants criaient : « Nous som-
mes tous des Juifs allemands » —
y compris les Arabes, nombreux dans"
le quartier, venus en voisins sym-
pathisants. La place était trop pe-
tite pour les 20000 ou 30000 mani-
festants. « A la Bastille ! » cria l'Unef.
Ce fut le premier affrontement, avec
le premier barrage de C.R.S., dix
minutes avant le discours du Géné-
ral. Les transistors étaient nombreux
dans la foule. A 20 heures, elle s'ar-
rêta, pour écouter. « Français, Fran-
çaises » amorça les rires. La phrase
évoquant l'éventuel départ du chef
de l'Etat déchaîna les applaudisse-
ments. C'était le temps d'arrêt dans
l'escalade de la violence, une violence
qui, pendant trois semaines, n'avait
pas désarmé et se nourrissait à
toutes les nouvelles réelles ou fictives
de la « provocation ».
L'impossible. Car la provocation
avait été toute la semaine partout
dans la rue.
L'échec de la motion de censure,
le communiqué de la C.G.T. quali-
fiant d'inadmissible la « prétention »
de l'Unef de discuter des luttes
ouvrières, toutes les dépêches, d'heu-
re en heure, ranimaient la flamme
de la colère. Enfin, et c'est peut-être
là le plus inquiétant : l'autoprovo-
cation est permanente dans ce bouil-
lonnement, ce rassemblement cons-
tant dans le Quartier latin, de plus
• d'une dizaine de milliers de per-
sonnes démobilisées par la grève.
le communiqué de la C.G.T. quali-
fiant d'inadmissible la « prétention »
de l'Unef de discuter des luttes
ouvrières, toutes les dépêches, d'heu-
re en heure, ranimaient la flamme
de la colère. Enfin, et c'est peut-être
là le plus inquiétant : l'autoprovo-
cation est permanente dans ce bouil-
lonnement, ce rassemblement cons-
tant dans le Quartier latin, de plus
• d'une dizaine de milliers de per-
sonnes démobilisées par la grève.
Face à cette situation, l'Unef fait
l'impossible. L'impossible n'est pas
l'impossible. L'impossible n'est pas
dant certain : l'Union des étudiants
communistes (U.E.C.). Un tiers de
ses militants n'a pas pardonné au
P.C. d'avoir « pris le train en mar-
che », après avoir essayé de le faire
dérailler. Ils vont grossir les rangs
des factions les plus efficaces, com-
me l'Union de la jeunesse commu-
niste marxiste-léniniste (U.J.C.M.L.),
un des « groupuscules >* qui se dé-
veloppe régulièrement. Parce qu'il
travaille en milieu ouvrier et qu'il est
avant tout une rigoureuse école de
pensée marxiste alimentée par les
normaliens de la rue d'Ulm, il offre
une possibilité d'action concrète. Les
cercles et mouvements de soutien
aux luttes du peuple, organisés par
1TJ.J.C.M.L., ont vu leurs effectifs dé-
cupler : ils peuvent dans les grandes
occasion mobiliser jusqu'à 10 000
personnes.
communistes (U.E.C.). Un tiers de
ses militants n'a pas pardonné au
P.C. d'avoir « pris le train en mar-
che », après avoir essayé de le faire
dérailler. Ils vont grossir les rangs
des factions les plus efficaces, com-
me l'Union de la jeunesse commu-
niste marxiste-léniniste (U.J.C.M.L.),
un des « groupuscules >* qui se dé-
veloppe régulièrement. Parce qu'il
travaille en milieu ouvrier et qu'il est
avant tout une rigoureuse école de
pensée marxiste alimentée par les
normaliens de la rue d'Ulm, il offre
une possibilité d'action concrète. Les
cercles et mouvements de soutien
aux luttes du peuple, organisés par
1TJ.J.C.M.L., ont vu leurs effectifs dé-
cupler : ils peuvent dans les grandes
occasion mobiliser jusqu'à 10 000
personnes.
Intransigeance. Les agrégés de
ITJJ.C.M1. passent des CAP. et
vont répandre la bonne parole en
usine. Ils s'inscrivent à la C.G.T. dont,
selon leurs propres mots, « la base
et les objectifs sont justes, mais
dont la direction bureaucratique et
les porte-serviette faussent la lutte ».
Ils veulent seulement être les « ca-
talyseurs de la volonté de lutte de
la classe ouvrière ». Les militants
vont en banlieue raffermir la cons-
cience de classe des jeunes travail-
leurs. Comme à Saint-Denis, où, le
jeudi 9 mai, 1 200 étudiants ont dé-
ITJJ.C.M1. passent des CAP. et
vont répandre la bonne parole en
usine. Ils s'inscrivent à la C.G.T. dont,
selon leurs propres mots, « la base
et les objectifs sont justes, mais
dont la direction bureaucratique et
les porte-serviette faussent la lutte ».
Ils veulent seulement être les « ca-
talyseurs de la volonté de lutte de
la classe ouvrière ». Les militants
vont en banlieue raffermir la cons-
cience de classe des jeunes travail-
leurs. Comme à Saint-Denis, où, le
jeudi 9 mai, 1 200 étudiants ont dé-
A l'aube du 25 mai
C'est dans l'angoisse et l'émotion
d'une nouvelle nuit d'émeutes, c'est
pendant que partout, dans Paris, on
se battait, que ce supplément excep-
tionnel de « L'Express » a été achevé.
d'une nouvelle nuit d'émeutes, c'est
pendant que partout, dans Paris, on
se battait, que ce supplément excep-
tionnel de « L'Express » a été achevé.
Mais sans doute n'a-t-il jamais été
plus nécessaire de garder, fût-ce au
cœur de l'événement et de sa charge
de drame, le calme nécessaire pour
tenter d'en prendre et d'en donner la
dimension historique.
plus nécessaire de garder, fût-ce au
cœur de l'événement et de sa charge
de drame, le calme nécessaire pour
tenter d'en prendre et d'en donner la
dimension historique.
gène dans l'assemblée générale de
l'Institut de géographie au milieu
d'une discussion jugée « trop molle ».
Quant au Mouvement du 22 mars,
provisoire par doctrine, il a vu af-
fluer vers lui tous ceux que fascine
son style de « démocratie directe ».
Il a fourni l'étincelle de Kanterre ;
le vent de la contagion l'a portée
jusqu'à Nantes, devant les ouvriers
de Sud-Aviation. Pas de dirigeants ;
la possibilité pour chacun, s'il trouve
le geste juste, d'être un leader. Con-
tre la rigidité des appareils, Daniel
Cohn-Bendit a inventé une forme de
mobilité tactique dont on ne sait
même plus si elle est improvisée ou
réfléchie, mais qui harcèle la société
par la relance incessante de l'action :
hier contre un conseil de discipline
ou une barricade, aujourd'hui contre
une frontière.
l'Institut de géographie au milieu
d'une discussion jugée « trop molle ».
Quant au Mouvement du 22 mars,
provisoire par doctrine, il a vu af-
fluer vers lui tous ceux que fascine
son style de « démocratie directe ».
Il a fourni l'étincelle de Kanterre ;
le vent de la contagion l'a portée
jusqu'à Nantes, devant les ouvriers
de Sud-Aviation. Pas de dirigeants ;
la possibilité pour chacun, s'il trouve
le geste juste, d'être un leader. Con-
tre la rigidité des appareils, Daniel
Cohn-Bendit a inventé une forme de
mobilité tactique dont on ne sait
même plus si elle est improvisée ou
réfléchie, mais qui harcèle la société
par la relance incessante de l'action :
hier contre un conseil de discipline
ou une barricade, aujourd'hui contre
une frontière.
Groupe charnière. Cette proliféra-
tion de groupes hérissés de contra-
dictions et qui paraissent voués à
se heurter ne doit pas dissimuler
l'unité de la remise en cause globale
qu'ils opèrent. Le sectarisme de cer-
tains est lui-même l'expression d'un
refus angoissé. Les communistes
n'ont voulu voir dans ces c fils à
papa » qu'un gauchisme encombrant
qui pratiquait la révolte comme un
luxe. L'univers étrange que cette ré-
volte faisait surgir à leurs yeux était
surtout, pour les militants du P.C.,
un univers étranger. En fait, c'est
la condition traditionnelle de l'étu-
diant que les étudiants ont commen-
cé par briser en s'attaquant à tout
le reste.
tion de groupes hérissés de contra-
dictions et qui paraissent voués à
se heurter ne doit pas dissimuler
l'unité de la remise en cause globale
qu'ils opèrent. Le sectarisme de cer-
tains est lui-même l'expression d'un
refus angoissé. Les communistes
n'ont voulu voir dans ces c fils à
papa » qu'un gauchisme encombrant
qui pratiquait la révolte comme un
luxe. L'univers étrange que cette ré-
volte faisait surgir à leurs yeux était
surtout, pour les militants du P.C.,
un univers étranger. En fait, c'est
la condition traditionnelle de l'étu-
diant que les étudiants ont commen-
cé par briser en s'attaquant à tout
le reste.
Le vent de révolte a provoqué un
choc extraordinaire qui a été en
même temps prise de conscience
pour un grand nombre d'entre eux
qui, jusque-là, étaient « inengagés ».
L'Unef a réussi à retrouver et à cana-
liser le courant politique traditionnel
qui s'était manifesté il y a huit ans
contre la guerre d'Algérie. Et avec
les jeunes ouvriers, les étudiants
sont redevenus groupe charnière de
la société.
choc extraordinaire qui a été en
même temps prise de conscience
pour un grand nombre d'entre eux
qui, jusque-là, étaient « inengagés ».
L'Unef a réussi à retrouver et à cana-
liser le courant politique traditionnel
qui s'était manifesté il y a huit ans
contre la guerre d'Algérie. Et avec
les jeunes ouvriers, les étudiants
sont redevenus groupe charnière de
la société.
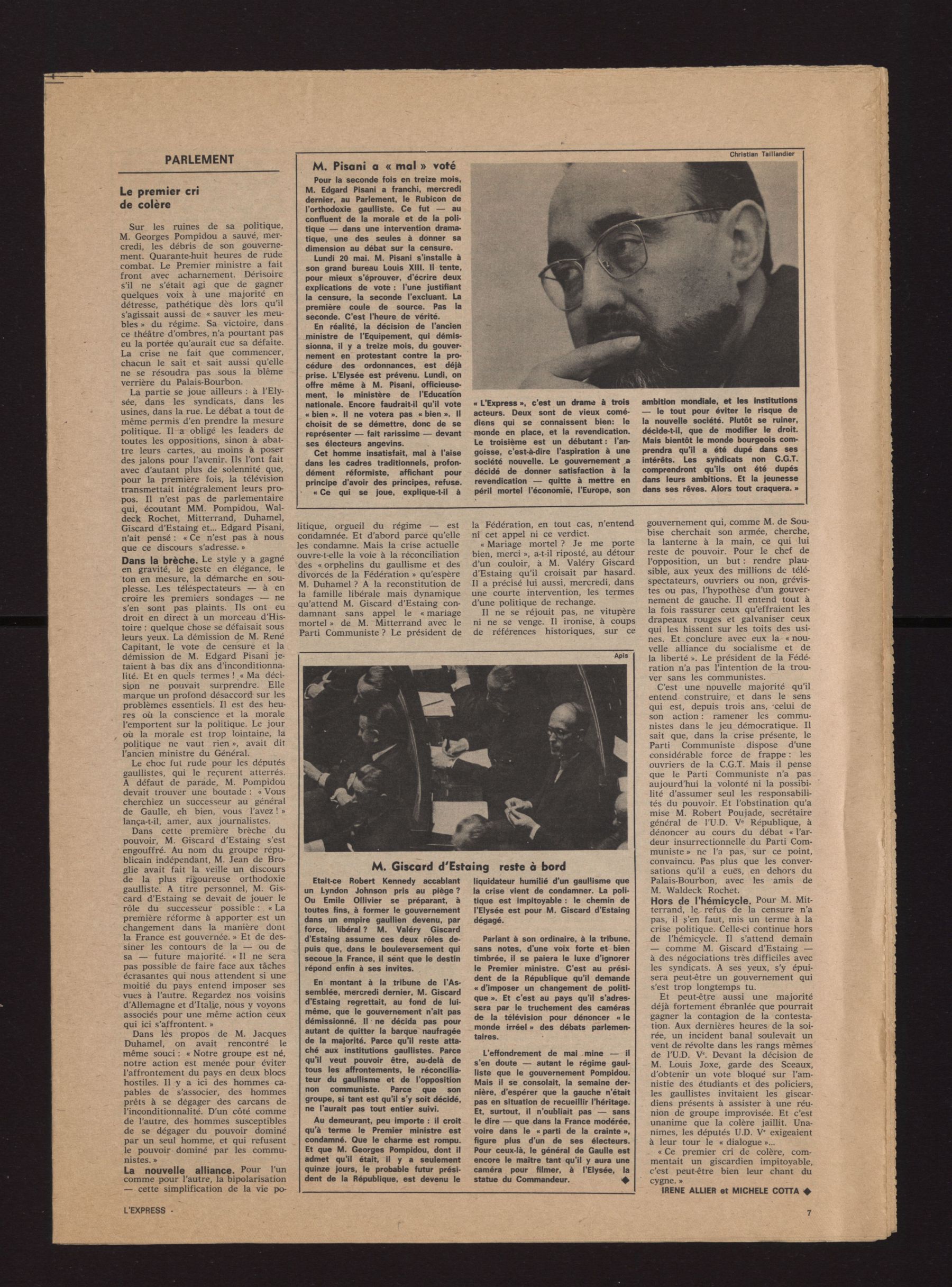

PARLEMENT
Le premier cri
de colère
de colère
Sur les ruines de sa politique,
M. Georges Pompidou a sauvé, mer-
credi, les débris de son gouverne-
ment. Quarante-huit heures de rude
combat. Le Premier ministre a fait
front avec acharnement. Dérisoire
s'il ne s'était agi que de gagner
quelques voix à une majorité en
détresse, pathétique dès lors qu'il
s'agissait aussi de « sauver les meu-
bles » du régime. Sa victoire, dans
ce théâtre d'ombres, n'a pourtant pas
eu la portée qu'aurait eue sa défaite.
La crise ne fait que commencer,
chacun le sait et sait aussi qu'elle
ne se résoudra pas sous la blême
verrière du Palais-Bourbon.
M. Georges Pompidou a sauvé, mer-
credi, les débris de son gouverne-
ment. Quarante-huit heures de rude
combat. Le Premier ministre a fait
front avec acharnement. Dérisoire
s'il ne s'était agi que de gagner
quelques voix à une majorité en
détresse, pathétique dès lors qu'il
s'agissait aussi de « sauver les meu-
bles » du régime. Sa victoire, dans
ce théâtre d'ombres, n'a pourtant pas
eu la portée qu'aurait eue sa défaite.
La crise ne fait que commencer,
chacun le sait et sait aussi qu'elle
ne se résoudra pas sous la blême
verrière du Palais-Bourbon.
La partie se joue ailleurs : à l'Ely-
sée, dans les syndicats, dans les
usines, dans la rue. Le débat a tout de
même permis d'en prendre la mesure
politique. Il a obligé les leaders de
toutes les oppositions, sinon à abat-
tre leurs cartes, au moins à poser
des jalons pour l'avenir. Ils l'ont fait
avec d'autant plus de solennité que,
pour la première fois, la télévision
transmettait intégralement leurs pro-
pos. Il n'est pas de parlementaire
qui, écoutant MM. Pompidou, Wal-
deck Rochet, Mitterrand, Duhamel,
Giscard d'Estaing et... Edgard Pisani,
n'ait pensé : « Ce n'est pas à nous
que ce discours s'adresse. »
sée, dans les syndicats, dans les
usines, dans la rue. Le débat a tout de
même permis d'en prendre la mesure
politique. Il a obligé les leaders de
toutes les oppositions, sinon à abat-
tre leurs cartes, au moins à poser
des jalons pour l'avenir. Ils l'ont fait
avec d'autant plus de solennité que,
pour la première fois, la télévision
transmettait intégralement leurs pro-
pos. Il n'est pas de parlementaire
qui, écoutant MM. Pompidou, Wal-
deck Rochet, Mitterrand, Duhamel,
Giscard d'Estaing et... Edgard Pisani,
n'ait pensé : « Ce n'est pas à nous
que ce discours s'adresse. »
Dans la brèche. Le style y a gagné
en gravité, le geste en élégance, le
ton en mesure, la démarche en sou-
plesse. Les téléspectateurs — à en
croire les premiers sondages — ne
s'en sont pas plaints. Ils ont eu
droit en direct à un morceau d'His-
toire : quelque chose se défaisait sous
leurs yeux. La démission de M. René
Capitant, le vote de censure et la
démission de M. Edgard Pisani je-
taient à bas dix ans d'inconditionna-
lité. Et en quels termes ! « Ma déci-
sion ne pouvait surprendre. Elle
marque un profond désaccord sur les
problèmes essentiels. Il est des heu-
res où la conscience et la morale
l'emportent sur la politique. Le jour
où la morale est trop lointaine, la
politique ne vaut rien », avait dit
l'ancien ministre du Général.
en gravité, le geste en élégance, le
ton en mesure, la démarche en sou-
plesse. Les téléspectateurs — à en
croire les premiers sondages — ne
s'en sont pas plaints. Ils ont eu
droit en direct à un morceau d'His-
toire : quelque chose se défaisait sous
leurs yeux. La démission de M. René
Capitant, le vote de censure et la
démission de M. Edgard Pisani je-
taient à bas dix ans d'inconditionna-
lité. Et en quels termes ! « Ma déci-
sion ne pouvait surprendre. Elle
marque un profond désaccord sur les
problèmes essentiels. Il est des heu-
res où la conscience et la morale
l'emportent sur la politique. Le jour
où la morale est trop lointaine, la
politique ne vaut rien », avait dit
l'ancien ministre du Général.
Le choc fut rude pour les députés
gaullistes, qui le reçurent atterrés.
A défaut de parade, M. Pompidou
devait trouver une boutade : « Vous
cherchiez un successeur au général
de Gaulle, eh bien, vous l'avez ! »
lança-t-il, amer, aux journalistes.
gaullistes, qui le reçurent atterrés.
A défaut de parade, M. Pompidou
devait trouver une boutade : « Vous
cherchiez un successeur au général
de Gaulle, eh bien, vous l'avez ! »
lança-t-il, amer, aux journalistes.
Dans cette première brèche du
pouvoir, M. Giscard d'Estaing s'est
engouffré. Au nom du groupe répu-
blicain indépendant, M. Jean de Bro-
glie avait fait la veille un discours
de la plus rigoureuse orthodoxie
gaulliste. A titre personnel, M. Gis-
card d'Estaing se devait de jouer le
rôle du successeur possible : « La
première réforme à apporter est un
changement dans la manière dont
la France est gouvernée. » Et de des-
siner les contours de la — ou de
sa — future majorité. « II ne sera
pas possible de faire face aux tâches
écrasantes qui nous attendent si une
moitié du pays entend imposer ses
vues à l'autre. Regardez nos voisins
d'Allemagne et d'Itali,e, nous y voyons
associés pour une même action ceux
qui ici s'affrontent. »
pouvoir, M. Giscard d'Estaing s'est
engouffré. Au nom du groupe répu-
blicain indépendant, M. Jean de Bro-
glie avait fait la veille un discours
de la plus rigoureuse orthodoxie
gaulliste. A titre personnel, M. Gis-
card d'Estaing se devait de jouer le
rôle du successeur possible : « La
première réforme à apporter est un
changement dans la manière dont
la France est gouvernée. » Et de des-
siner les contours de la — ou de
sa — future majorité. « II ne sera
pas possible de faire face aux tâches
écrasantes qui nous attendent si une
moitié du pays entend imposer ses
vues à l'autre. Regardez nos voisins
d'Allemagne et d'Itali,e, nous y voyons
associés pour une même action ceux
qui ici s'affrontent. »
Dans les propos de M. Jacques
Duhamel, on avait rencontré le
même souci : « Notre groupe est né,
notre action est menée pour éviter
l'affrontement du pays en deux blocs
hostiles. Il y a ici des hommes ca-
pables de s'associer, des hommes
prêts à se dégager des carcans de
l'inconditionnalité. D'un côté comme
de l'autre, des hommes susceptibles
de se dégager du pouvoir dominé
par un seul homme, et qui refusent
le pouvoir dominé par les commu-
nistes. »
Duhamel, on avait rencontré le
même souci : « Notre groupe est né,
notre action est menée pour éviter
l'affrontement du pays en deux blocs
hostiles. Il y a ici des hommes ca-
pables de s'associer, des hommes
prêts à se dégager des carcans de
l'inconditionnalité. D'un côté comme
de l'autre, des hommes susceptibles
de se dégager du pouvoir dominé
par un seul homme, et qui refusent
le pouvoir dominé par les commu-
nistes. »
La nouvelle alliance. Pour l'un
comme pour l'autre, la bipolarisation
— cette simplification de la vie po-
comme pour l'autre, la bipolarisation
— cette simplification de la vie po-
M. Pisani a « mal » voté
Pour la seconde fois en treize mois,
M. Edgard Pisani a franchi, mercredi
dernier, au Parlement, le Rubicon de
l'orthodoxie gaulliste. Ce fut — au
confluent de la morale et de la poli-
tique — dans une intervention drama-
tique, une des seules à donner sa
dimension au débat sur la censure.
M. Edgard Pisani a franchi, mercredi
dernier, au Parlement, le Rubicon de
l'orthodoxie gaulliste. Ce fut — au
confluent de la morale et de la poli-
tique — dans une intervention drama-
tique, une des seules à donner sa
dimension au débat sur la censure.
Lundi 20 mai. M. Pisani s'installe à
son grand bureau Louis XIII. Il tente,
pour mieux s'éprouver, d'écrire deux
explications de vote : l'une justifiant
la censure, la seconde l'excluant. La
première coule de source. Pas la
seconde. C'est l'heure de vérité.
son grand bureau Louis XIII. Il tente,
pour mieux s'éprouver, d'écrire deux
explications de vote : l'une justifiant
la censure, la seconde l'excluant. La
première coule de source. Pas la
seconde. C'est l'heure de vérité.
En réalité, la décision de l'ancien
ministre de l'Equipement, qui démis-
sionna, il y a treize mois, du gouver-
nement en protestant contre la pro-
cédure des ordonnances, est déjà
prise. L'Elysée est prévenu. Lundi, on
offre même à M. Pisani, officieuse-
ment, le ministère de l'Education
nationale. Encore faudrait-il qu'il vote
« bien ». Il ne votera pas « bien ». Il
choisit de se démettre, donc de se
représenter — fait rarissime — devant
ses électeurs angevins.
ministre de l'Equipement, qui démis-
sionna, il y a treize mois, du gouver-
nement en protestant contre la pro-
cédure des ordonnances, est déjà
prise. L'Elysée est prévenu. Lundi, on
offre même à M. Pisani, officieuse-
ment, le ministère de l'Education
nationale. Encore faudrait-il qu'il vote
« bien ». Il ne votera pas « bien ». Il
choisit de se démettre, donc de se
représenter — fait rarissime — devant
ses électeurs angevins.
Cet homme insatisfait, mal à l'aise
dans les cadres traditionnels, profon-
dément réformiste, affichant pour
principe d'avoir des principes, refuse.
dans les cadres traditionnels, profon-
dément réformiste, affichant pour
principe d'avoir des principes, refuse.
« Ce qui se joue, explique-t-il à
Christian Taillandier
« L'Express », c'est un drame à trois
acteurs. Deux sont de vieux comé-
diens qui se connaissent bien: le
monde en place, et la revendication.
Le troisième est un débutant : l'an-
goisse, c'est-à-dire l'aspiration à une
société nouvelle. Le gouvernement a
décidé de donner satisfaction à la
revendication — quitte à mettre en
péril mortel l'économie, l'Europe, son
acteurs. Deux sont de vieux comé-
diens qui se connaissent bien: le
monde en place, et la revendication.
Le troisième est un débutant : l'an-
goisse, c'est-à-dire l'aspiration à une
société nouvelle. Le gouvernement a
décidé de donner satisfaction à la
revendication — quitte à mettre en
péril mortel l'économie, l'Europe, son
ambition mondiale, et les institutions
— le tout pour éviter le risque de
la nouvelle société. Plutôt se ruiner,
décide-t-il, que de modifier le droit.
Mais bientôt le monde bourgeois com-
prendra qu'il a été dupé dans ses
intérêts. Les syndicats non C.G.T.
comprendront qu'ils ont été dupés
dans leurs ambitions. Et la jeunesse
dans ses rêves. Alors tout craquera. »
— le tout pour éviter le risque de
la nouvelle société. Plutôt se ruiner,
décide-t-il, que de modifier le droit.
Mais bientôt le monde bourgeois com-
prendra qu'il a été dupé dans ses
intérêts. Les syndicats non C.G.T.
comprendront qu'ils ont été dupés
dans leurs ambitions. Et la jeunesse
dans ses rêves. Alors tout craquera. »
litique, orgueil du régime — est
condamnée. Et d'abord parce qu'elle
les condamne. Mais la crise actuelle
ouvre-t-elle la voie à la réconciliation
des « orphelins du gaullisme et des
divorcés de la Fédération » qu'espéré
M. Duhamel ? A la reconstitution de
la famille libérale mais dynamique
qu'attend M. Giscard d'Estaing con-
damnant sans appel le « mariage
mortel » de M. Mitterrand avec le
Parti Communiste ? Le président de
condamnée. Et d'abord parce qu'elle
les condamne. Mais la crise actuelle
ouvre-t-elle la voie à la réconciliation
des « orphelins du gaullisme et des
divorcés de la Fédération » qu'espéré
M. Duhamel ? A la reconstitution de
la famille libérale mais dynamique
qu'attend M. Giscard d'Estaing con-
damnant sans appel le « mariage
mortel » de M. Mitterrand avec le
Parti Communiste ? Le président de
la Fédération, en tout cas, n'entend
ni cet appel ni ce verdict.
ni cet appel ni ce verdict.
« Mariage mortel ? Je me porte
bien, merci », a-t-il riposté, au détour
d'un couloir, à M. Valéry Giscard
d'Estaing qu'il croisait par hasard.
Il a précisé lui aussi, mercredi, dans
une courte intervention, les termes
d'une politique de rechange.
bien, merci », a-t-il riposté, au détour
d'un couloir, à M. Valéry Giscard
d'Estaing qu'il croisait par hasard.
Il a précisé lui aussi, mercredi, dans
une courte intervention, les termes
d'une politique de rechange.
Il ne se réjouit pas, ne vitupère
ni ne se venge. Il ironise, à coups
de références historiques, sur ce
ni ne se venge. Il ironise, à coups
de références historiques, sur ce
Apis
M. Giscard d'Estaing reste à bord
Etait-ce Robert Kennedy accablant
un Lyndon Johnson pris au piège ?
Ou Emile Ollivier se préparant, à
toutes fins, à former le gouvernement
dans un empire gaullien devenu, par
force, libéral ? M. Valéry Giscard
d'Estaing assume ces deux rôles de-
puis que, dans le bouleversement qui
secoue la France, il sent que le destin
répond enfin à ses invites.
un Lyndon Johnson pris au piège ?
Ou Emile Ollivier se préparant, à
toutes fins, à former le gouvernement
dans un empire gaullien devenu, par
force, libéral ? M. Valéry Giscard
d'Estaing assume ces deux rôles de-
puis que, dans le bouleversement qui
secoue la France, il sent que le destin
répond enfin à ses invites.
En montant à la tribune de l'As-
semblée, mercredi dernier, M. Giscard
d'Estaing regrettait, au fond de lui-
même, que le gouvernement n'ait pas
démissionné. Il ne décida pas pour
autant de quitter la barque naufragée
de la majorité. Parce qu'il reste atta-
ché aux institutions gaullistes. Parce
qu'il veut pouvoir être, au-delà de
tous les affrontements, le réconcilia-
teur du gaullisme et de l'opposition
non communiste. Parce que son
groupe, si tant est qu'il s'y soit décidé,
ne l'aurait pas tout entier suivi.
semblée, mercredi dernier, M. Giscard
d'Estaing regrettait, au fond de lui-
même, que le gouvernement n'ait pas
démissionné. Il ne décida pas pour
autant de quitter la barque naufragée
de la majorité. Parce qu'il reste atta-
ché aux institutions gaullistes. Parce
qu'il veut pouvoir être, au-delà de
tous les affrontements, le réconcilia-
teur du gaullisme et de l'opposition
non communiste. Parce que son
groupe, si tant est qu'il s'y soit décidé,
ne l'aurait pas tout entier suivi.
Au demeurant, peu importe : il croit
qu'à terme le Premier ministre est
condamné. Que le charme est rompu.
Et que M. Georges Pompidou, dont il
admet qu'il était, il y a seulement
quinze jours, le probable futur prési-
dent de la République, est devenu le
qu'à terme le Premier ministre est
condamné. Que le charme est rompu.
Et que M. Georges Pompidou, dont il
admet qu'il était, il y a seulement
quinze jours, le probable futur prési-
dent de la République, est devenu le
liquidateur humilié d'un gaullisme que
la crise vient de condamner. La poli-
tique est impitoyable : le chemin de
l'Elysée est pour M. Giscard d'Estaing
dégagé.
la crise vient de condamner. La poli-
tique est impitoyable : le chemin de
l'Elysée est pour M. Giscard d'Estaing
dégagé.
Parlant à son ordinaire, à la tribune,
sans notes, d'une voix forte et bien
timbrée, il se paiera le luxe d'ignorer
le Premier ministre. C'est au prési-
dent de la République qu'il demande
« d'imposer un changement de politi-
que ». Et c'est au pays qu'il s'adres-
sera par le truchement des caméras
de la télévision pour dénoncer « le
monde irréel » des débats parlemen-
taires.
sans notes, d'une voix forte et bien
timbrée, il se paiera le luxe d'ignorer
le Premier ministre. C'est au prési-
dent de la République qu'il demande
« d'imposer un changement de politi-
que ». Et c'est au pays qu'il s'adres-
sera par le truchement des caméras
de la télévision pour dénoncer « le
monde irréel » des débats parlemen-
taires.
L'effondrement de mai mine — il
s'en doute — autant le régime gaul-
liste que le gouvernement Pompidou.
Mais il se consolait, la semaine der-
nière, d'espérer que la gauche n'était
pas en situation de recueillir l'héritage.
Et, surtout, il n'oubliait pas — sans
le dire — que dans la France modérée,
voire dans le « parti de la crainte »,
figure plus d'un de ses électeurs.
Pour ceux-là, le général de Gaulle est
encore le maître tant qu'il y aura une
caméra pour filmer, à l'Elysée, la
statue du Commandeur. +
s'en doute — autant le régime gaul-
liste que le gouvernement Pompidou.
Mais il se consolait, la semaine der-
nière, d'espérer que la gauche n'était
pas en situation de recueillir l'héritage.
Et, surtout, il n'oubliait pas — sans
le dire — que dans la France modérée,
voire dans le « parti de la crainte »,
figure plus d'un de ses électeurs.
Pour ceux-là, le général de Gaulle est
encore le maître tant qu'il y aura une
caméra pour filmer, à l'Elysée, la
statue du Commandeur. +
gouvernement qui, comme M. de Sou-
bise cherchait son armée, cherche,
la lanterne à la main, ce qui lui
reste de pouvoir. Pour le chef de
l'opposition, un but : rendre plau-
sible, aux yeux des millions de télé-
spectateurs, ouvriers ou non, grévis-
tes ou pas, l'hypothèse d'un gouver-
nement de gauche. Il entend tout à
la fois rassurer ceux qu'effraient les
drapeaux rouges et galvaniser ceux
qui les hissent sur les toits des usi-
nes. Et conclure avec eux la « nou-
velle alliance du socialisme et de
la liberté ». Le président de la Fédé-
ration n'a pas l'intention de la trou-
ver sans les communistes.
bise cherchait son armée, cherche,
la lanterne à la main, ce qui lui
reste de pouvoir. Pour le chef de
l'opposition, un but : rendre plau-
sible, aux yeux des millions de télé-
spectateurs, ouvriers ou non, grévis-
tes ou pas, l'hypothèse d'un gouver-
nement de gauche. Il entend tout à
la fois rassurer ceux qu'effraient les
drapeaux rouges et galvaniser ceux
qui les hissent sur les toits des usi-
nes. Et conclure avec eux la « nou-
velle alliance du socialisme et de
la liberté ». Le président de la Fédé-
ration n'a pas l'intention de la trou-
ver sans les communistes.
C'est une nouvelle majorité qu'il
entend construire, et dans le sens
qui est, depuis trois ans, -celui de
son action : ramener les commu-
nistes dans le jeu démocratique. Il
sait que, dans la crise présente, le
Parti Communiste dispose d'une
considérable force de frappe : les
ouvriers de la C.G.T. Mais il pense
que le Parti Communiste n'a pas
aujourd'hui la volonté ni la possibi-
lité d'assumer seul les responsabili-
tés du pouvoir. Et l'obstination qu'a
mise M. Robert Poujade, secrétaire
général de l'U.D. V" République, à
dénoncer au cours du débat « l'ar-
deur insurrectionnelle du Parti Com-
muniste » ne l'a pas, sur ce point,
convaincu. Pas plus que les conver-
sations qu'il a eues, en dehors du
Palais-Bourbon, avec les amis de
M. Waldeck Rochet.
Hors de l'hémicycle. Pour M. Mit-
terrand, le refus de la censure n'a
pas, il s'en faut, mis un terme à la
crise politique. Celle-ci continue hors
de l'hémicycle. Il s'attend demain
— comme M. Giscard d'Estaing —
à des négociations très difficiles avec
les syndicats. A ses yeux, s'y épui-
sera peut-être un gouvernement qui
s'est trop longtemps tu.
entend construire, et dans le sens
qui est, depuis trois ans, -celui de
son action : ramener les commu-
nistes dans le jeu démocratique. Il
sait que, dans la crise présente, le
Parti Communiste dispose d'une
considérable force de frappe : les
ouvriers de la C.G.T. Mais il pense
que le Parti Communiste n'a pas
aujourd'hui la volonté ni la possibi-
lité d'assumer seul les responsabili-
tés du pouvoir. Et l'obstination qu'a
mise M. Robert Poujade, secrétaire
général de l'U.D. V" République, à
dénoncer au cours du débat « l'ar-
deur insurrectionnelle du Parti Com-
muniste » ne l'a pas, sur ce point,
convaincu. Pas plus que les conver-
sations qu'il a eues, en dehors du
Palais-Bourbon, avec les amis de
M. Waldeck Rochet.
Hors de l'hémicycle. Pour M. Mit-
terrand, le refus de la censure n'a
pas, il s'en faut, mis un terme à la
crise politique. Celle-ci continue hors
de l'hémicycle. Il s'attend demain
— comme M. Giscard d'Estaing —
à des négociations très difficiles avec
les syndicats. A ses yeux, s'y épui-
sera peut-être un gouvernement qui
s'est trop longtemps tu.
Et peut-être aussi une majorité
déjà fortement ébranlée que pourrait
gagner la contagion de la contesta-
tion. Aux dernières heures de la soi-
rée, un incident banal soulevait un
vent de révolte dans les rangs mêmes
de l'U.D. Ve. Devant la décision de
M. Louis Joxe, garde des Sceaux,
d'obtenir un vote bloqué sur l'am-
nistie des étudiants et des policiers,
les gaullistes invitaient les giscar-
diens présents à assister à une réu-
nion de groupe improvisée. Et c'est
unanime que la colère jaillit. Una-
nimes, les députés U.D. V* exigeaient
à leur tour le « dialogue »...
déjà fortement ébranlée que pourrait
gagner la contagion de la contesta-
tion. Aux dernières heures de la soi-
rée, un incident banal soulevait un
vent de révolte dans les rangs mêmes
de l'U.D. Ve. Devant la décision de
M. Louis Joxe, garde des Sceaux,
d'obtenir un vote bloqué sur l'am-
nistie des étudiants et des policiers,
les gaullistes invitaient les giscar-
diens présents à assister à une réu-
nion de groupe improvisée. Et c'est
unanime que la colère jaillit. Una-
nimes, les députés U.D. V* exigeaient
à leur tour le « dialogue »...
« Ce premier cri de colère, com-
mentait un giscardien impitoyable,
c'est peut-être bien leur chant du
cygne. »
mentait un giscardien impitoyable,
c'est peut-être bien leur chant du
cygne. »
IRENE ALLIER et MICHELE COTTA +
L'EXPRESS -


1848,1871,
Roger
Priouret
Priouret
DES événements que nous som-
mes en train de vivre, on vous
dit, d'autre part, les possibles
conséquences politiques, économi-
ques et financières. Peut-être peut-
on tenter, avec prudence, de leur
restituer une perspective historique.
mes en train de vivre, on vous
dit, d'autre part, les possibles
conséquences politiques, économi-
ques et financières. Peut-être peut-
on tenter, avec prudence, de leur
restituer une perspective historique.
Depuis cent quatre-vingts ans bien-
tôt, notre pays ne cesse d'osciller,
par secousses brusques, entre deux
formes de gouvernement : le prin-
cipal et la République des députés.
tôt, notre pays ne cesse d'osciller,
par secousses brusques, entre deux
formes de gouvernement : le prin-
cipal et la République des députés.
Le principal — trois rois, deux
empereurs, un maréchal, un général
— c'est la prépondérance d'un
homme. Celui qui probablement
s'achève, aura été le plus libéral
de tous. L'homme qui l'exerce n'a
pas le goût de la dictature. Deux
atouts majeurs l'ont jusqu'ici dis-
pensé de l'emploi de la force. Le
empereurs, un maréchal, un général
— c'est la prépondérance d'un
homme. Celui qui probablement
s'achève, aura été le plus libéral
de tous. L'homme qui l'exerce n'a
pas le goût de la dictature. Deux
atouts majeurs l'ont jusqu'ici dis-
pensé de l'emploi de la force. Le
premier : son prestige; le second :
la lélévision qui, dans celle phase
de son essor, a plus d'impaci que
dix régimenls (comme la radio, en
1933, a servi Roosevelt).
la lélévision qui, dans celle phase
de son essor, a plus d'impaci que
dix régimenls (comme la radio, en
1933, a servi Roosevelt).
La République des députés, c'est
le pouvoir des parlementaires et,
au-delà d'eux, des spécialistes de la
politique. Elle permet de prendre de
façon démocratique cerlaines déci-
sions imporlanles. Mais, dans noire
pays, elle n'a pas changé les poinls
essenliels de l'héritage monarchique.
Elle les a même accenlués, exacte-
ment comme les principats. Inutile
de développer ce qui a été mis en
lumière depuis Tocqueville jusqu'au
Club Jean-Moulin : extrême centra-
lisation, toute-puissance de l'admi-
nistration, mise en lulelle des
maires, effacemenl des vieilles pro-
vinces, réglementation tatillonne de
l'industrie, du commerce et de la
banque, et, dans les entreprises,
pouvoir patronal exercé dans l'abso-
lutisme et le mystère. En un mot
comme en cent, le ciloyen a élé
dépouillé de loute responsabilité,
ne gardant que le droit d'abdiquer
périodiquement de sa souveraineté
politique entre les mains d'un élu.
le pouvoir des parlementaires et,
au-delà d'eux, des spécialistes de la
politique. Elle permet de prendre de
façon démocratique cerlaines déci-
sions imporlanles. Mais, dans noire
pays, elle n'a pas changé les poinls
essenliels de l'héritage monarchique.
Elle les a même accenlués, exacte-
ment comme les principats. Inutile
de développer ce qui a été mis en
lumière depuis Tocqueville jusqu'au
Club Jean-Moulin : extrême centra-
lisation, toute-puissance de l'admi-
nistration, mise en lulelle des
maires, effacemenl des vieilles pro-
vinces, réglementation tatillonne de
l'industrie, du commerce et de la
banque, et, dans les entreprises,
pouvoir patronal exercé dans l'abso-
lutisme et le mystère. En un mot
comme en cent, le ciloyen a élé
dépouillé de loute responsabilité,
ne gardant que le droit d'abdiquer
périodiquement de sa souveraineté
politique entre les mains d'un élu.
IL y a eu, dans la révolte des étu-
diants, du verbiage, de la phra-
séologie sentencieuse, des gestes
d'irresponsables. Derrière tout ce
qui a pu choquer les adultes mais
les contraindre à réfléchir, il reste
quelque chose d'essentiel et de posi-
tif : le refus de l'usager d'admettre
que la vie de l'Université continuât
de dépendre en totalité d'une cen-
Iralisalion uniformisalrice el de la
hiérarchie mandarinale des profes-
seurs; la volonlé des jeunes ciloyens
de dire leur mot dans la vie et le
contenu intellectuel d'une institu-
lion qui doit les façonner. Les étu-
diants ont, avant tout, voulu mettre
un peu de démocratie dans une
partie de notre société française qui
n'était pas du tout démocratique,
même si la majorité des univer-
sitaires se classe à gauche.
diants, du verbiage, de la phra-
séologie sentencieuse, des gestes
d'irresponsables. Derrière tout ce
qui a pu choquer les adultes mais
les contraindre à réfléchir, il reste
quelque chose d'essentiel et de posi-
tif : le refus de l'usager d'admettre
que la vie de l'Université continuât
de dépendre en totalité d'une cen-
Iralisalion uniformisalrice el de la
hiérarchie mandarinale des profes-
seurs; la volonlé des jeunes ciloyens
de dire leur mot dans la vie et le
contenu intellectuel d'une institu-
lion qui doit les façonner. Les étu-
diants ont, avant tout, voulu mettre
un peu de démocratie dans une
partie de notre société française qui
n'était pas du tout démocratique,
même si la majorité des univer-
sitaires se classe à gauche.
La contagion est venue d'une
réaction aussi saine que celle des
réaction aussi saine que celle des
éludianls. Beaucoup de Français ont
conslaté que leur vie était largement
conditionnée par des décisions qu'ils
auraient pu parfois contribuer à
prendre et dont ils auraient dû
toujours être informés d'une façon
explicative.
conslaté que leur vie était largement
conditionnée par des décisions qu'ils
auraient pu parfois contribuer à
prendre et dont ils auraient dû
toujours être informés d'une façon
explicative.
PAR exemple, l'allilude de la
C.G.T. a élé révélalrice. Comme
ses dirigeanls soni de forma-
lion communiste, ils ne croient pas
à une sociélé démocralique, au
moins en régime capitaliste. Ils ont
été hostiles aux étudiants, les ont
rejoinls à contrecœur sans com-
prendre leur succès. Les premières
grèves ont commencé sans eux et
sous l'impulsion des jeunes salariés.
C.G.T. a élé révélalrice. Comme
ses dirigeanls soni de forma-
lion communiste, ils ne croient pas
à une sociélé démocralique, au
moins en régime capitaliste. Ils ont
été hostiles aux étudiants, les ont
rejoinls à contrecœur sans com-
prendre leur succès. Les premières
grèves ont commencé sans eux et
sous l'impulsion des jeunes salariés.
Mais comme la C.G.T. connaît
bien le monde ouvrier, M. Séguy a
adopté la seule tactique que lui
permeltaient les circonslances :
« Aux travailleurs, a-t-il dit, de se
réunir sur les lieux de Iravail,
de décider de leurs revendications,
de choisir les modalités de leur
action. »
bien le monde ouvrier, M. Séguy a
adopté la seule tactique que lui
permeltaient les circonslances :
« Aux travailleurs, a-t-il dit, de se
réunir sur les lieux de Iravail,
de décider de leurs revendications,
de choisir les modalités de leur
action. »
Ce langage était dans la ligne de
la démocratie directe, même si, der-
rière lui, se dissimulait la hâte des
militants à ressaisir le contrôle des
mouvements spontanés de la base.
la démocratie directe, même si, der-
rière lui, se dissimulait la hâte des
militants à ressaisir le contrôle des
mouvements spontanés de la base.
S'agit-il d'une phase sans précé-
dent dans notre histoire ? Cette
• impression déconcertante et privilé-
giée de libération joyeuse, au moins
au départ, on la retrouve trois fois
dans le passé : chez les hommes qui
ont rédigé les cahiers de doléances
pour les états généraux de 1789;
dans les semaines qui ont suivi la
révolution de février 1848; lors des
premiers pas de la Commune de
Paris en 1871.
dent dans notre histoire ? Cette
• impression déconcertante et privilé-
giée de libération joyeuse, au moins
au départ, on la retrouve trois fois
dans le passé : chez les hommes qui
ont rédigé les cahiers de doléances
pour les états généraux de 1789;
dans les semaines qui ont suivi la
révolution de février 1848; lors des
premiers pas de la Commune de
Paris en 1871.
Trois fois, l'euphorie a été courte
et trois fois, l'issue a été
sanglante. Actuellement, nous som-
mes probablement préservés de la
tragédie par le sang-froid des gré-
vistes, étudiants et ouvriers.
et trois fois, l'issue a été
sanglante. Actuellement, nous som-
mes probablement préservés de la
tragédie par le sang-froid des gré-
vistes, étudiants et ouvriers.
Le risque, du côté de l'Université,
est plutôt celui de l'inexpérience.
La liberté, quand elle est trop
jeune, doit éviter la confusion et
l'anarchie. Elle s'y emploie.
est plutôt celui de l'inexpérience.
La liberté, quand elle est trop
jeune, doit éviter la confusion et
l'anarchie. Elle s'y emploie.
LE grand problème esl dans le
monde ouvrier. C. G. T. et
C.F.D.T. cheminent ensemble
avec la volonté de s'entendre. En-
core faut-il dire que leurs buts
profonds sonl dislincls.
monde ouvrier. C. G. T. et
C.F.D.T. cheminent ensemble
avec la volonté de s'entendre. En-
core faut-il dire que leurs buts
profonds sonl dislincls.
M. Eugène Descamps, secrélaire
général de la C.F.D.T., lient comple
des possibilités françaises vis-à-vis
de la concurrence étrangère. Il sup-
pute le retard des salaires horaires
de notre pays sur ceux de l'Alle-
magne, le temps de Iravail hebdo-
madaire moins long chez nos voisins
de l'Esl que chez nous. Ces consi-
dérations l'amèneraient logiquement
à des exigences assez raisonnables.
général de la C.F.D.T., lient comple
des possibilités françaises vis-à-vis
de la concurrence étrangère. Il sup-
pute le retard des salaires horaires
de notre pays sur ceux de l'Alle-
magne, le temps de Iravail hebdo-
madaire moins long chez nos voisins
de l'Esl que chez nous. Ces consi-
dérations l'amèneraient logiquement
à des exigences assez raisonnables.
En revanche, il mettrait au
premier plan la nécessité d'une
transformation fondamentale des
rapports dans l'entreprise. Par com-
paraison avec la Suède et l'Allema-
gne, notre pays reste enfermé dans
une atmosphère de méfiance envers
le travailleur, d'hostilité envers le
syndicaliste, de mystère avec la
complabilité. Dialogue, participa-
tion, information, toul ce que les
étudiants réclament dans l'Univer-
sité peut exister dans l'entreprise
sous des formes différentes et mal-
gré les contraintes de la production
de masse.
premier plan la nécessité d'une
transformation fondamentale des
rapports dans l'entreprise. Par com-
paraison avec la Suède et l'Allema-
gne, notre pays reste enfermé dans
une atmosphère de méfiance envers
le travailleur, d'hostilité envers le
syndicaliste, de mystère avec la
complabilité. Dialogue, participa-
tion, information, toul ce que les
étudiants réclament dans l'Univer-
sité peut exister dans l'entreprise
sous des formes différentes et mal-
gré les contraintes de la production
de masse.
LA C.G.T. n'échappe pas aux
exigences de ce mouvement de
renouveau. Mais nombre de ses
dirigeants préfèrent se retrouver au
plus toi dans le schéma classique :
des revendicalions 1res imporlantes
de salaires qui donneronl lemporai-
remenl l'impression que la grève a
été « payante ».
exigences de ce mouvement de
renouveau. Mais nombre de ses
dirigeants préfèrent se retrouver au
plus toi dans le schéma classique :
des revendicalions 1res imporlantes
de salaires qui donneronl lemporai-
remenl l'impression que la grève a
été « payante ».
La partie n'est pas jouée. Le vent
de renouveau et de démocratisation
est profond, même à la C.G.T.,
même dans le Parti Communiste.
Mais il y a toujours le risque que
la masse des sans-grade de l'indus-
trie, trop souvent dupés, préfère
encore ces satisfaclions malérielles
immédiales à l'avènement qui, sur
le moment, apporterail peu, mais
ferait naître, dans l'avenir, un autre
mode de vie. R. p. +
de renouveau et de démocratisation
est profond, même à la C.G.T.,
même dans le Parti Communiste.
Mais il y a toujours le risque que
la masse des sans-grade de l'indus-
trie, trop souvent dupés, préfère
encore ces satisfaclions malérielles
immédiales à l'avènement qui, sur
le moment, apporterail peu, mais
ferait naître, dans l'avenir, un autre
mode de vie. R. p. +
ÉCONOMIE
Le coût
de la grève
de la grève
Imperturbables, ou feignanl de
l'êlre, les économisles Iravaillenl.
Dans les syndicats, au palronal, dans
les minislères, on se penche sur des
graphiques, on calcule des pourcen-
lages, on échafaude des hypolhèses.
Sujet unique de ces études souvenl
divergenles : les conséquences écono-
miques du mouvemenl de grève géné-
rale et, plus encore, de l'éventuelle
satisfaction des revendications des
salariés en lulle.
l'êlre, les économisles Iravaillenl.
Dans les syndicats, au palronal, dans
les minislères, on se penche sur des
graphiques, on calcule des pourcen-
lages, on échafaude des hypolhèses.
Sujet unique de ces études souvenl
divergenles : les conséquences écono-
miques du mouvemenl de grève géné-
rale et, plus encore, de l'éventuelle
satisfaction des revendications des
salariés en lulle.
Le calcul du coût de la grève est
simple. Une journée de production
tolale de « l'affaire France » représen-
le 0,4 % du produil national annuel.
Une semaine :• 2,3 %. Toule la France
ne s'est cependant pas arrêtée de
produire, la semaine dernière : cer-
tains secteurs industriels ont continué
à tourner tani bien que mal; les
vaches ont continué à donner du lait.
Au lotal, les experts eslimeni à 1 %
de la production annuelle la perte de
la France jusqu'à la fin de la se-
maine dernière : soil 5 Milliards de
Francs actuels.
simple. Une journée de production
tolale de « l'affaire France » représen-
le 0,4 % du produil national annuel.
Une semaine :• 2,3 %. Toule la France
ne s'est cependant pas arrêtée de
produire, la semaine dernière : cer-
tains secteurs industriels ont continué
à tourner tani bien que mal; les
vaches ont continué à donner du lait.
Au lotal, les experts eslimeni à 1 %
de la production annuelle la perte de
la France jusqu'à la fin de la se-
maine dernière : soil 5 Milliards de
Francs actuels.
Ce n'est pas une perte sèche, tola-
lement irrémédiable. Tout dépendra
de la durée totale de l'arrêt de
l'activité nationale. Si celle-ci reprend
au bout de quelque huit ou dix jours,
les experts estiment qu'une partie du
manque à gagner de la nalion pourra
être rattrapée : on produira un peu
plus, on vendra ce qui était resté sur
le carreau durant les journées de
grève. Si la maison France reste plus
longtemps fermée, les conséquences
lement irrémédiable. Tout dépendra
de la durée totale de l'arrêt de
l'activité nationale. Si celle-ci reprend
au bout de quelque huit ou dix jours,
les experts estiment qu'une partie du
manque à gagner de la nalion pourra
être rattrapée : on produira un peu
plus, on vendra ce qui était resté sur
le carreau durant les journées de
grève. Si la maison France reste plus
longtemps fermée, les conséquences
seront, en fait, beaucoup plus sé-
rieuses.
rieuses.
Par contagion. Déjà, dans cette
hypothèse, certains économistes révi-
sent en baisse leurs prévisions pour
l'ensemble de l'année 1968. Il y a
encore quinze jours, ils élaient unani-
mement oplimisles. Le laux d'expan-
sion prévu par le Ve Plan — 5 %
l'an — sera dépassé, disaienl-ils, la
France réalisani sans doule une per-
formance de 5,5 %. Si la grève dure,
une expansion de 4,5 % sera déjà un
exploit, affirmenl-ils aujourd'hui.
hypothèse, certains économistes révi-
sent en baisse leurs prévisions pour
l'ensemble de l'année 1968. Il y a
encore quinze jours, ils élaient unani-
mement oplimisles. Le laux d'expan-
sion prévu par le Ve Plan — 5 %
l'an — sera dépassé, disaienl-ils, la
France réalisani sans doule une per-
formance de 5,5 %. Si la grève dure,
une expansion de 4,5 % sera déjà un
exploit, affirmenl-ils aujourd'hui.
D'aulanl qu'au coûl économique de
la grève, ils ajoutent celui, hypothé-
lique, de la salisfaction des revendi-
cations proprement matérielles des.
salariés. Celles-ci porlenl sur :
la grève, ils ajoutent celui, hypothé-
lique, de la salisfaction des revendi-
cations proprement matérielles des.
salariés. Celles-ci porlenl sur :
— la fixalion à 600 Francs du salaire
minimum mensuel;
minimum mensuel;
— la réduction progressive de la
durée du travail sans diminulion
de salaire ;
durée du travail sans diminulion
de salaire ;
— la garanlie de l'emploi el des
ressources.
ressources.
Plus de 3 millions de salariés fran-
çais — sur un lolal de 15 millions —
gagnenl actuellement moins de 600
Francs par mois. Un peu plus de
200 000 d'entre eux, les « smigards »,
ne gagnent que 400 Francs par mois
environ. L'augmentalion de lous
représente une masse salariale sup-
plémentaire de 5 Milliards de Francs.
Sans compter l'augmentalion inévi-
lable, par conlagion, de millions
d'aulres salariés gagnanl plus de
600 Francs.
çais — sur un lolal de 15 millions —
gagnenl actuellement moins de 600
Francs par mois. Un peu plus de
200 000 d'entre eux, les « smigards »,
ne gagnent que 400 Francs par mois
environ. L'augmentalion de lous
représente une masse salariale sup-
plémentaire de 5 Milliards de Francs.
Sans compter l'augmentalion inévi-
lable, par conlagion, de millions
d'aulres salariés gagnanl plus de
600 Francs.
La durée moyenne du travail dans
l'industrie française est actuellemenl
un peu supérieure à quaranle-cinq
heures avec d'assez grandes varia-
lions selon les secleurs, les régions
et les entreprises. La diminution de
la durée du travail entraînerait, si
l'industrie française est actuellemenl
un peu supérieure à quaranle-cinq
heures avec d'assez grandes varia-
lions selon les secleurs, les régions
et les entreprises. La diminution de
la durée du travail entraînerait, si
elle étail générale, une baisse propor-
lionnelle de la produclion. Elle
pourrail loulefois être négociée dans
certains cas précis.
lionnelle de la produclion. Elle
pourrail loulefois être négociée dans
certains cas précis.
« Aucune économie ne supporterail
un lel surcroîl de charges, el une
crise inflalionniste grave serait la
fin pour la France de lous les espoirs
européens », déclarait, mercredi der-
nier, le Club Jean-Moulin. Certains
Français, redoulant ces perspeclives,
ont fait passer clandeslinemenl des
capilaux en Suisse. Des élrangers se
sont débarassés de leurs Francs.
Mouvement pouriani limilé : la Ban-
que de France n'a dû inlervenir qu'à
New York pour soulenir le franc.
un lel surcroîl de charges, el une
crise inflalionniste grave serait la
fin pour la France de lous les espoirs
européens », déclarait, mercredi der-
nier, le Club Jean-Moulin. Certains
Français, redoulant ces perspeclives,
ont fait passer clandeslinemenl des
capilaux en Suisse. Des élrangers se
sont débarassés de leurs Francs.
Mouvement pouriani limilé : la Ban-
que de France n'a dû inlervenir qu'à
New York pour soulenir le franc.
Vlro
M. MICHEL DEBRË.
Ce n'est pas une perte sèche.
Ce n'est pas une perte sèche.
Sous réserve. La garanlie de l'em-
ploi inquièle, d'aulre pari, ceux qui
esliment que, dans une économie
ouverte sur le monde extérieur, les
slructures des enlreprises doivenl
ploi inquièle, d'aulre pari, ceux qui
esliment que, dans une économie
ouverte sur le monde extérieur, les
slructures des enlreprises doivenl
s'adapter continuellemenl pour de-
meurer compélilives. La mobililé
de l'emploi leur paraîl une consé-
quence inévilable de celle adaplalion.
meurer compélilives. La mobililé
de l'emploi leur paraîl une consé-
quence inévilable de celle adaplalion.
Patronat et experts gouvernemen-
taux étaienl cependant convaincus, à
la fin de la semaine dernière, que
l'intelligence des problèmes et le sens
des responsabilités des leaders syn-
dicaux permettraient d'éviter que
soient prises des décisions qui place-
raienl l'économie française en déficit
vis-à-vis de l'étranger, ou qui aggra-
veraient le chômage. « Pas question
de repousser l'échéance du 1er juil-
let; la France ne sortira pas du
Marché commun », disait-on encore
au gouvernement. Un « matelas » de
près de 30 Milliards de Francs d'or
et de devises procurerait de toule
façon à la France un cerlain répil
avant d'en arriver à une dévaluation
du Franc ou à des mesures de pro-
leclion.
taux étaienl cependant convaincus, à
la fin de la semaine dernière, que
l'intelligence des problèmes et le sens
des responsabilités des leaders syn-
dicaux permettraient d'éviter que
soient prises des décisions qui place-
raienl l'économie française en déficit
vis-à-vis de l'étranger, ou qui aggra-
veraient le chômage. « Pas question
de repousser l'échéance du 1er juil-
let; la France ne sortira pas du
Marché commun », disait-on encore
au gouvernement. Un « matelas » de
près de 30 Milliards de Francs d'or
et de devises procurerait de toule
façon à la France un cerlain répil
avant d'en arriver à une dévaluation
du Franc ou à des mesures de pro-
leclion.
Sous réserve, cependanl, que le
général de Gaulle acceple de faire
servir celle réserve au bien-êlre des
Français plulôl qu'à sa slralégie
mondiale. MAURICE ROY •+
général de Gaulle acceple de faire
servir celle réserve au bien-êlre des
Français plulôl qu'à sa slralégie
mondiale. MAURICE ROY •+
PATRONS
Les plus forts
ont peur
ont peur
Derrière un grand calme de façade,
les palrons français ne dissimulaienl
pas, vendredi matin, leur inquiétude.
Inquiétude qui n'a pas la même ori-
gine pour tous : les uns avaient peur
des syndicats et de leurs revendi-
cations. Les autres avaient peur du
général de Gaulle el de ses idées en
malière. d'association capital-iravail.
les palrons français ne dissimulaienl
pas, vendredi matin, leur inquiétude.
Inquiétude qui n'a pas la même ori-
gine pour tous : les uns avaient peur
des syndicats et de leurs revendi-
cations. Les autres avaient peur du
général de Gaulle el de ses idées en
malière. d'association capital-iravail.
8
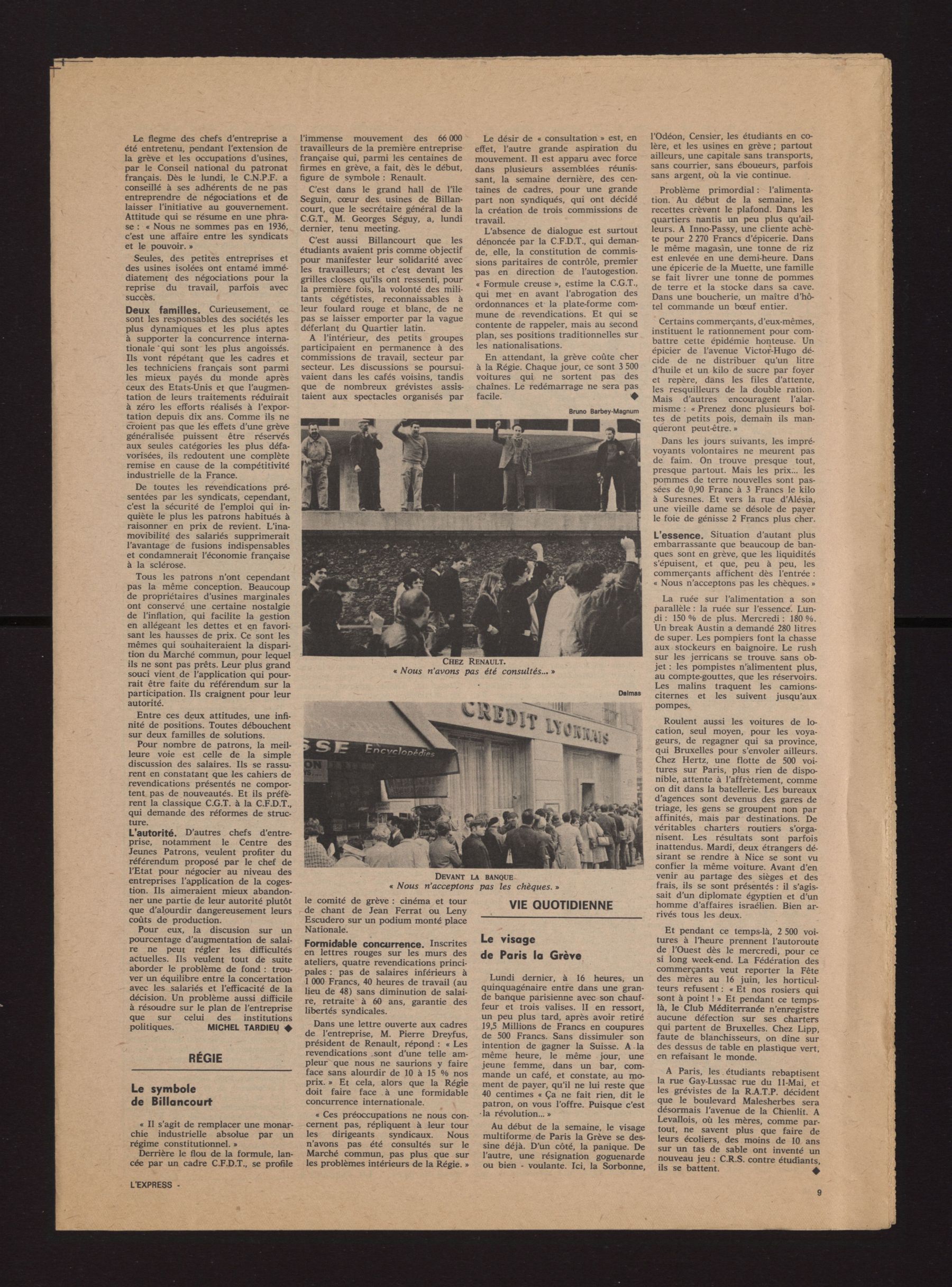

Le flegme des chefs d'entreprise a
été entretenu, pendant l'extension de
la grève et les occupations d'usines,
par le Conseil national du patronat
français. Dès le lundi, le C.N.P.F. a
conseillé à ses adhérents de ne pas
entreprendre de négociations et de
laisser l'initiative au gouvernement.
Attitude qui se résume en une phra-
se : « Nous ne sommes pas en 1936,
c'est une affaire entre les syndicats
et le pouvoir. »
été entretenu, pendant l'extension de
la grève et les occupations d'usines,
par le Conseil national du patronat
français. Dès le lundi, le C.N.P.F. a
conseillé à ses adhérents de ne pas
entreprendre de négociations et de
laisser l'initiative au gouvernement.
Attitude qui se résume en une phra-
se : « Nous ne sommes pas en 1936,
c'est une affaire entre les syndicats
et le pouvoir. »
Seules, des petites entreprises et
des usines isolées ont entamé immé-
diatement des négociations pour la
reprise du travail, parfois avec
succès.
des usines isolées ont entamé immé-
diatement des négociations pour la
reprise du travail, parfois avec
succès.
Deux familles. Curieusement, ce
sont les responsables des sociétés les
plus dynamiques et les plus aptes
à supporter la concurrence interna-
tionale "qui sont les plus angoissés.
Ils vont répétant que les cadres et
les techniciens français sont parmi
les mieux payés du monde après
ceux des Etats-Unis et que l'augmen-
tation de leurs traitements réduirait
à zéro les efforts réalisés à l'expor-
tation depuis dix ans. Comme ils ne
croient pas que les effets d'une grève
généralisée puissent être réservés
aux seules catégories les plus défa-
vorisées, ils redoutent une complète
remise en cause de la compétitivité
industrielle de la France.
sont les responsables des sociétés les
plus dynamiques et les plus aptes
à supporter la concurrence interna-
tionale "qui sont les plus angoissés.
Ils vont répétant que les cadres et
les techniciens français sont parmi
les mieux payés du monde après
ceux des Etats-Unis et que l'augmen-
tation de leurs traitements réduirait
à zéro les efforts réalisés à l'expor-
tation depuis dix ans. Comme ils ne
croient pas que les effets d'une grève
généralisée puissent être réservés
aux seules catégories les plus défa-
vorisées, ils redoutent une complète
remise en cause de la compétitivité
industrielle de la France.
De toutes les revendications pré-
sentées par les syndicats, cependant,
c'est la sécurité de l'emploi qui in-
quiète le plus les patrons habitués à
raisonner en prix de revient. L'ina-
movibilité des salariés supprimerait
l'avantage de fusions indispensables
et condamnerait l'économie française
à la sclérose.
sentées par les syndicats, cependant,
c'est la sécurité de l'emploi qui in-
quiète le plus les patrons habitués à
raisonner en prix de revient. L'ina-
movibilité des salariés supprimerait
l'avantage de fusions indispensables
et condamnerait l'économie française
à la sclérose.
Tous les patrons n'ont cependant
pas la même conception. Beaucoup
de propriétaires d'usines marginales
ont conservé une certaine nostalgie
de l'inflation, qui facilite la gestion
en allégeant les dettes et en favori-
sant les hausses de prix. Ce sont les
mêmes qui souhaiteraient la dispari-
tion du Marché commun, pour lequel
ils ne sont pas prêts. Leur plus grand
souci vient de l'application qui pour-
rait être faite du référendum sur la
participation. Ils craignent pour leur
autorité.
pas la même conception. Beaucoup
de propriétaires d'usines marginales
ont conservé une certaine nostalgie
de l'inflation, qui facilite la gestion
en allégeant les dettes et en favori-
sant les hausses de prix. Ce sont les
mêmes qui souhaiteraient la dispari-
tion du Marché commun, pour lequel
ils ne sont pas prêts. Leur plus grand
souci vient de l'application qui pour-
rait être faite du référendum sur la
participation. Ils craignent pour leur
autorité.
Entre ces deux attitudes, une infi-
nité de positions. Toutes débouchent
sur deux familles de solutions.
nité de positions. Toutes débouchent
sur deux familles de solutions.
Pour nombre de patrons, la meil-
leure voie est celle de la simple
discussion des salaires. Ils se rassu-
rent en constatant que les cahiers de
revendications présentés ne compor-
tent pas de nouveautés. Et ils préfè-
rent la classique C.G.T. à la C.F.D.T.,
qui demande des réformes de struc-
ture.
leure voie est celle de la simple
discussion des salaires. Ils se rassu-
rent en constatant que les cahiers de
revendications présentés ne compor-
tent pas de nouveautés. Et ils préfè-
rent la classique C.G.T. à la C.F.D.T.,
qui demande des réformes de struc-
ture.
L'autorité. D'autres chefs d'entre-
prise, notamment le Centre des
Jeunes Patrons, veulent profiter du
référendum proposé par le chef de
l'Etat pour négocier au niveau des
entreprises l'application de la coges-
tion. Ils aimeraient mieux abandon-
ner une partie de leur autorité plutôt
que d'alourdir dangereusement leurs
coûts de production.
prise, notamment le Centre des
Jeunes Patrons, veulent profiter du
référendum proposé par le chef de
l'Etat pour négocier au niveau des
entreprises l'application de la coges-
tion. Ils aimeraient mieux abandon-
ner une partie de leur autorité plutôt
que d'alourdir dangereusement leurs
coûts de production.
Pour eux, la discusion sur un
pourcentage d'augmentation de salai-
re ne peut régler les difficultés
actuelles. Ils veulent tout de suite
aborder le problème de fond : trou-
ver un équilibre entre la concertation
avec les salariés et l'efficacité de la
décision. Un problème aussi difficile
à résoudre sur le plan de l'entreprise
que sur celui des institutions
politiques. MICHEL TARDIEU +
pourcentage d'augmentation de salai-
re ne peut régler les difficultés
actuelles. Ils veulent tout de suite
aborder le problème de fond : trou-
ver un équilibre entre la concertation
avec les salariés et l'efficacité de la
décision. Un problème aussi difficile
à résoudre sur le plan de l'entreprise
que sur celui des institutions
politiques. MICHEL TARDIEU +
RÉGIE
Le symbole
de Billancourt
de Billancourt
« II s'agit de remplacer une monar-
chie industrielle absolue par un
régime constitutionnel. »
chie industrielle absolue par un
régime constitutionnel. »
Derrière le flou de la formule, lan-
cée par un cadre C.F.D.T., se profile
cée par un cadre C.F.D.T., se profile
l'immense mouvement des 66 000
travailleurs de la première entreprise
française qui, parmi les centaines de
firmes en grève, a fait, dès le début,
figure de symbole : Renault.
travailleurs de la première entreprise
française qui, parmi les centaines de
firmes en grève, a fait, dès le début,
figure de symbole : Renault.
C'est dans le grand hall de l'île
Seguin, cœur des usines de Billan-
court, que le secrétaire général de la
C.G.T., M. Georges Séguy, a, lundi
dernier, tenu meeting.
Seguin, cœur des usines de Billan-
court, que le secrétaire général de la
C.G.T., M. Georges Séguy, a, lundi
dernier, tenu meeting.
C'est aussi Billancourt que les
étudiants avaient pris comme objectif
pour manifester leur solidarité avec
les travailleurs; et c'est devant les
grilles closes qu'ils ont ressenti, pour
la première fois, la volonté des mili-
tants cégétistes, reconnaissables à
leur foulard rouge et blanc, de ne
pas se laisser emporter par la vague
déferlant du Quartier latin.
étudiants avaient pris comme objectif
pour manifester leur solidarité avec
les travailleurs; et c'est devant les
grilles closes qu'ils ont ressenti, pour
la première fois, la volonté des mili-
tants cégétistes, reconnaissables à
leur foulard rouge et blanc, de ne
pas se laisser emporter par la vague
déferlant du Quartier latin.
A l'intérieur, des petits groupes
participaient en permanence à des
commissions de travail, secteur par
secteur. Les discussions se poursui-
vaient dans les cafés voisins, tandis
que de nombreux grévistes assis-
taient aux spectacles organisés par
participaient en permanence à des
commissions de travail, secteur par
secteur. Les discussions se poursui-
vaient dans les cafés voisins, tandis
que de nombreux grévistes assis-
taient aux spectacles organisés par
Le désir de « consultation » est, en
effet, l'autre grande aspiration du
mouvement. Il est apparu avec force
dans plusieurs assemblées réunis-
sant, la semaine dernière, des cen-
taines de cadres, pour une grande
part non syndiqués, qui ont décidé
la création de trois commissions de
travail.
effet, l'autre grande aspiration du
mouvement. Il est apparu avec force
dans plusieurs assemblées réunis-
sant, la semaine dernière, des cen-
taines de cadres, pour une grande
part non syndiqués, qui ont décidé
la création de trois commissions de
travail.
L'absence de dialogue est surtout
dénoncée par la C.F.D.T., qui deman-
de, elle, la constitution de commis-
sions paritaires de contrôle, premier
pas en direction de l'autogestion.
« Formule creuse », estime la C.G.T.,
qui met en avant l'abrogation des
ordonnances et la plate-forme com-
mune de revendications. Et qui se
contente de rappeler, mais au second
plan, ses positions traditionnelles sur
les nationalisations.
dénoncée par la C.F.D.T., qui deman-
de, elle, la constitution de commis-
sions paritaires de contrôle, premier
pas en direction de l'autogestion.
« Formule creuse », estime la C.G.T.,
qui met en avant l'abrogation des
ordonnances et la plate-forme com-
mune de revendications. Et qui se
contente de rappeler, mais au second
plan, ses positions traditionnelles sur
les nationalisations.
En attendant, la grève coûte cher
à la Régie. Chaque jour, ce sont 3 500
voitures qui ne sortent pas des
chaînes. Le redémarrage ne sera pas
facile. ^
à la Régie. Chaque jour, ce sont 3 500
voitures qui ne sortent pas des
chaînes. Le redémarrage ne sera pas
facile. ^
Bruno Barbey-Magnum
CHEZ RENAULT.
« Nous n'avons pas été consultés... »
« Nous n'avons pas été consultés... »
Dalmas
DEVANT LA BANQUE
Nous n'acceptons pas les chèques. »
Nous n'acceptons pas les chèques. »
le comité de grève : cinéma et tour
de chant de Jean Ferrât ou Leny
Escudero sur un podium monté place
Nationale.
de chant de Jean Ferrât ou Leny
Escudero sur un podium monté place
Nationale.
Formidable concurrence. Inscrites
en lettres rouges sur les murs des
ateliers, quatre revendications princi-
pales : pas de salaires inférieurs à
1 000 Francs, 40 heures de travail (au
lieu de 48) sans diminution de salai-
re, retraite à 60 ans, garantie des
libertés syndicales.
en lettres rouges sur les murs des
ateliers, quatre revendications princi-
pales : pas de salaires inférieurs à
1 000 Francs, 40 heures de travail (au
lieu de 48) sans diminution de salai-
re, retraite à 60 ans, garantie des
libertés syndicales.
Dans une lettre ouverte aux cadres
de l'entreprise, M. Pierre Dreyfus,
président de Renault, répond : « Les
revendications sont d'une telle am-
pleur que nous ne saurions y faire
face sans alourdir de 10 à 15 % nos
prix. » Et cela, alors que la Régie
doit faire face à une formidable
concurrence internationale.
de l'entreprise, M. Pierre Dreyfus,
président de Renault, répond : « Les
revendications sont d'une telle am-
pleur que nous ne saurions y faire
face sans alourdir de 10 à 15 % nos
prix. » Et cela, alors que la Régie
doit faire face à une formidable
concurrence internationale.
« Ces préoccupations ne nous con-
cernent pas, répliquent à leur tour
les dirigeants syndicaux. Nous
n'avons pas été consultés sur le
Marché commun, pas plus que sur
les problèmes intérieurs de la Régie. »
cernent pas, répliquent à leur tour
les dirigeants syndicaux. Nous
n'avons pas été consultés sur le
Marché commun, pas plus que sur
les problèmes intérieurs de la Régie. »
VIE QUOTIDIENNE
Le visage
de Paris la Grève
Lundi dernier, à 16 heures, un
quinquagénaire entre dans une gran-
de banque parisienne avec son chauf-
feur et trois valises. II en ressort,
un peu plus tard, après avoir retiré
19,5 Millions de Francs en coupures
de 500 Francs. Sans dissimuler son
intention de gagner la Suisse. A la
même heure, le même jour, une
jeune femme, dans un bar, com-
mande un café, et constate, au mo-
ment de payer, qu'il ne lui reste que
40 centimes « Ça ne fait rien, dit le
patron, on vous l'offre. Puisque c'est
•la révolution... »
quinquagénaire entre dans une gran-
de banque parisienne avec son chauf-
feur et trois valises. II en ressort,
un peu plus tard, après avoir retiré
19,5 Millions de Francs en coupures
de 500 Francs. Sans dissimuler son
intention de gagner la Suisse. A la
même heure, le même jour, une
jeune femme, dans un bar, com-
mande un café, et constate, au mo-
ment de payer, qu'il ne lui reste que
40 centimes « Ça ne fait rien, dit le
patron, on vous l'offre. Puisque c'est
•la révolution... »
Au début de la semaine, le visage
multiforme de Paris la Grève se des-
sine déjà. D'un côté, la panique. De
l'autre, une résignation goguenarde
ou bien - voulante. Ici, la Sorbonne,
multiforme de Paris la Grève se des-
sine déjà. D'un côté, la panique. De
l'autre, une résignation goguenarde
ou bien - voulante. Ici, la Sorbonne,
l'Odéon, Censier, les étudiants en co-
lère, et les usines en grève ; partout
ailleurs, une capitale sans transports,
sans courrier, sans éboueurs, parfois
sans argent, où la vie continue.
lère, et les usines en grève ; partout
ailleurs, une capitale sans transports,
sans courrier, sans éboueurs, parfois
sans argent, où la vie continue.
Problème primordial : l'alimenta-
tion. Au début de la semaine, les
recettes crèvent le plafond. Dans les
quartiers nantis un peu plus qu'ail-
leurs. A Inno-Passy, une cliente achè-
te pour 2 270 Francs d'épicerie. Dans
le même magasin, une tonne de riz
est enlevée en une demi-heure. Dans
une épicerie de la Muette, une famille
se fait livrer une tonne de pommes
de terre et la stocke dans sa cave.
Dans une boucherie, un maître d'hô-
tel commande un bœuf entier.
tion. Au début de la semaine, les
recettes crèvent le plafond. Dans les
quartiers nantis un peu plus qu'ail-
leurs. A Inno-Passy, une cliente achè-
te pour 2 270 Francs d'épicerie. Dans
le même magasin, une tonne de riz
est enlevée en une demi-heure. Dans
une épicerie de la Muette, une famille
se fait livrer une tonne de pommes
de terre et la stocke dans sa cave.
Dans une boucherie, un maître d'hô-
tel commande un bœuf entier.
Certains commerçants, d'eux-mêmes,
instituent le rationnement pour com-
battre cette épidémie honteuse. Un
épicier de l'avenue Victor-Hugo dé-
cide de ne distribuer qu'un litre
d'huile et un kilo de sucre par foyer
et repère, dans les files d'attente,
les resquilleurs de la double ration.
Mais d'autres encouragent l'alar-
misme : « Prenez donc plusieurs boî-
tes de petits pois, demain ils man-
queront peut-être. »
instituent le rationnement pour com-
battre cette épidémie honteuse. Un
épicier de l'avenue Victor-Hugo dé-
cide de ne distribuer qu'un litre
d'huile et un kilo de sucre par foyer
et repère, dans les files d'attente,
les resquilleurs de la double ration.
Mais d'autres encouragent l'alar-
misme : « Prenez donc plusieurs boî-
tes de petits pois, demain ils man-
queront peut-être. »
Dans les jours suivants, les impré-
voyants volontaires ne meurent pas
de faim. On trouve presque tout,
presque partout. Mais les prix... les
pommes de terre nouvelles sont pas-
sées de 0,90 Franc à 3 Francs le kilo
à Suresnes. Et vers la rue d'Alésia,
une vieille dame se désole de payer
le foie de génisse 2 Francs plus cher.
voyants volontaires ne meurent pas
de faim. On trouve presque tout,
presque partout. Mais les prix... les
pommes de terre nouvelles sont pas-
sées de 0,90 Franc à 3 Francs le kilo
à Suresnes. Et vers la rue d'Alésia,
une vieille dame se désole de payer
le foie de génisse 2 Francs plus cher.
L'essence. Situation d'autant plus
embarrassante que beaucoup de ban-
ques sont en grève, que les liquidités
s'épuisent, et que, peu à peu, les
commerçants affichent dès l'entrée :
« Nous n'acceptons pas les chèques. »
embarrassante que beaucoup de ban-
ques sont en grève, que les liquidités
s'épuisent, et que, peu à peu, les
commerçants affichent dès l'entrée :
« Nous n'acceptons pas les chèques. »
La ruée sur l'alimentation a son
parallèle : la ruée sur l'essence. Lun-
di : 150 % de plus. Mercredi : 180 %.
Un break Austin a demandé 280 litres
de super. Les pompiers font la chasse
aux stockeurs en baignoire. Le rush
sur les jerricans se trouve sans ob-
jet : les pompistes n'alimentent plus,
au compte-gouttes, que les réservoirs.
Les malins traquent les camions-
citernes et les suivent jusqu'aux
pompes.
parallèle : la ruée sur l'essence. Lun-
di : 150 % de plus. Mercredi : 180 %.
Un break Austin a demandé 280 litres
de super. Les pompiers font la chasse
aux stockeurs en baignoire. Le rush
sur les jerricans se trouve sans ob-
jet : les pompistes n'alimentent plus,
au compte-gouttes, que les réservoirs.
Les malins traquent les camions-
citernes et les suivent jusqu'aux
pompes.
Roulent aussi les voitures de lo-
cation, seul moyen, pour les voya-
geurs, de regagner qui sa province,
qui Bruxelles pour s'envoler ailleurs.
Chez Hertz, une flotte de 500 voi-
tures sur Paris, plus rien de dispo-
nible, attente à l'affrètement, comme
on dit dans la batellerie. Les bureaux
d'agences sont devenus des gares de
triage, les gens se groupent non par
affinités, mais par destinations. De
véritables charters routiers s'orga-
nisent. Les résultats sont parfois
inattendus. Mardi, deux étrangers dé-
sirant se rendre à Nice se sont vu
confier la même voiture. Avant d'en
venir au partage des sièges et des
frais, ils se sont présentés : il s'agis-
sait d'un diplomate égyptien et d'un
homme d'affaires israélien. Bien ar-
rivés tous les deux.
cation, seul moyen, pour les voya-
geurs, de regagner qui sa province,
qui Bruxelles pour s'envoler ailleurs.
Chez Hertz, une flotte de 500 voi-
tures sur Paris, plus rien de dispo-
nible, attente à l'affrètement, comme
on dit dans la batellerie. Les bureaux
d'agences sont devenus des gares de
triage, les gens se groupent non par
affinités, mais par destinations. De
véritables charters routiers s'orga-
nisent. Les résultats sont parfois
inattendus. Mardi, deux étrangers dé-
sirant se rendre à Nice se sont vu
confier la même voiture. Avant d'en
venir au partage des sièges et des
frais, ils se sont présentés : il s'agis-
sait d'un diplomate égyptien et d'un
homme d'affaires israélien. Bien ar-
rivés tous les deux.
Et pendant ce temps-là, 2 500 voi-
tures à l'heure prennent l'autoroute
de l'Ouest dès le mercredi, pour ce
si long week-end. La Fédération des
commerçants veut reporter la Fête
des mères au 16 juin, les horticul-
teurs refusent : « Et nos rosiers qui
sont à point ! » Et pendant ce temps-
là, le Club Méditerranée n'enregistre
aucune défection sur ses charters
qui partent de Bruxelles. Chez Lipp,
faute de blanchisseurs, on dîne sur
des dessus de table en plastique vert,
en refaisant le monde.
tures à l'heure prennent l'autoroute
de l'Ouest dès le mercredi, pour ce
si long week-end. La Fédération des
commerçants veut reporter la Fête
des mères au 16 juin, les horticul-
teurs refusent : « Et nos rosiers qui
sont à point ! » Et pendant ce temps-
là, le Club Méditerranée n'enregistre
aucune défection sur ses charters
qui partent de Bruxelles. Chez Lipp,
faute de blanchisseurs, on dîne sur
des dessus de table en plastique vert,
en refaisant le monde.
A Paris, les étudiants rebaptisent
la rue Gay-Lussac rue du 11-Mai, et
les grévistes de la R.A.T.P. décident
que le boulevard Malesherbes sera
désormais l'avenue de la Chienlit. A
Levallois, où les mères, comme par-
tout, ne savent plus que faire de
leurs écoliers, des moins de 10 ans
sur un tas de sable ont inventé un
nouveau jeu : C.R.S. contre étudiants,
ils se battent.
la rue Gay-Lussac rue du 11-Mai, et
les grévistes de la R.A.T.P. décident
que le boulevard Malesherbes sera
désormais l'avenue de la Chienlit. A
Levallois, où les mères, comme par-
tout, ne savent plus que faire de
leurs écoliers, des moins de 10 ans
sur un tas de sable ont inventé un
nouveau jeu : C.R.S. contre étudiants,
ils se battent.
L'EXPRESS -
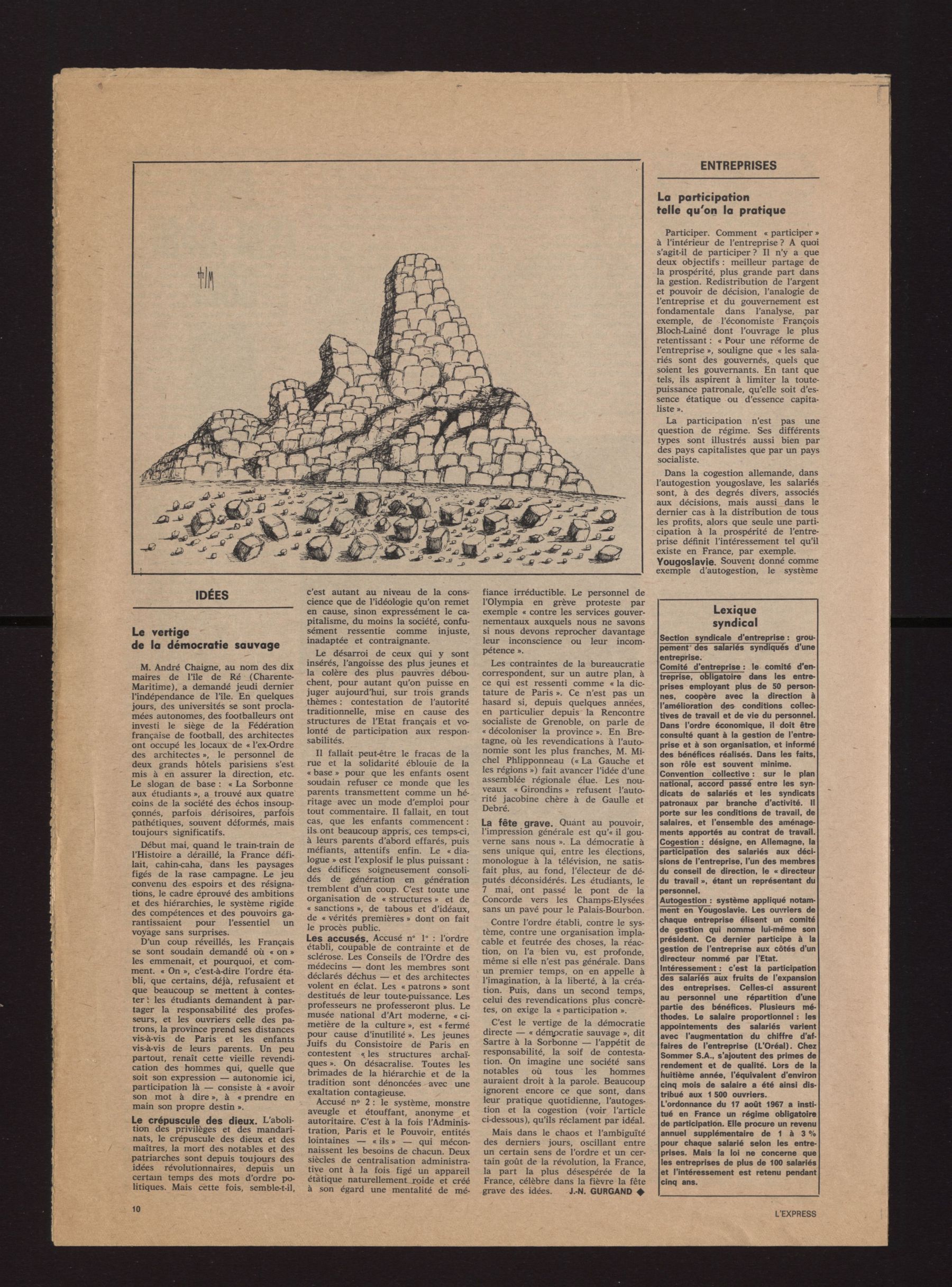

ENTREPRISES
IDÉES
Le vertige
de la démocratie sauvage
M. André Chaigne, au nom des dix
maires de l'île de Ré (Charente-
Maritime), a demandé jeudi dernier
l'indépendance de l'île. En quelques
jours, des universités se sont procla-
mées autonomes, des footballeurs ont
investi le siège de la Fédération
française de football, des architectes
ont occupé les locaux de « l'ex-Ordre
des architectes », le personnel de
deux grands hôtels parisiens s'est
mis à en assurer la direction, etc.
Le slogan de base : « La Sorbonne
aux étudiants », a trouvé aux quatre
coins de la société des échos insoup-
çonnés, parfois dérisoires, parfois
pathétiques, souvent déformés, mais
toujours significatifs.
maires de l'île de Ré (Charente-
Maritime), a demandé jeudi dernier
l'indépendance de l'île. En quelques
jours, des universités se sont procla-
mées autonomes, des footballeurs ont
investi le siège de la Fédération
française de football, des architectes
ont occupé les locaux de « l'ex-Ordre
des architectes », le personnel de
deux grands hôtels parisiens s'est
mis à en assurer la direction, etc.
Le slogan de base : « La Sorbonne
aux étudiants », a trouvé aux quatre
coins de la société des échos insoup-
çonnés, parfois dérisoires, parfois
pathétiques, souvent déformés, mais
toujours significatifs.
Début mai, quand le train-train de
l'Histoire a déraillé, la France défi-
lait, cahin-caha, dans les paysages
figés de la rase campagne. Le jeu
convenu des espoirs et des résigna-
tions, le cadre éprouvé des ambitions
et des hiérarchies, le système rigide
des compétences et des pouvoirs ga-
rantissaient pour l'essentiel un
voyage sans surprises.
l'Histoire a déraillé, la France défi-
lait, cahin-caha, dans les paysages
figés de la rase campagne. Le jeu
convenu des espoirs et des résigna-
tions, le cadre éprouvé des ambitions
et des hiérarchies, le système rigide
des compétences et des pouvoirs ga-
rantissaient pour l'essentiel un
voyage sans surprises.
D'un coup réveillés, les Français
se sont soudain demandé où « on »
les emmenait, et pourquoi, et com-
ment. « On », c'est-à-dire l'ordre éta-
bli, que certains, déjà, refusaient et
que beaucoup se mettent à contes-
ter : les étudiants demandent à par-
tager la responsabilité des profes-
seurs, et les ouvriers celle des pa-
trons, la province prend ses distances
vis-à-vis de Paris et les enfants
vis-à-vis de leurs parents. Un peu
partout, renaît cette vieille revendi-
cation des hommes qui, quelle que
soit son expression — autonomie ici,
participation là — consiste à « avoir
son mot à dire », à « prendre en
main son propre destin ».
se sont soudain demandé où « on »
les emmenait, et pourquoi, et com-
ment. « On », c'est-à-dire l'ordre éta-
bli, que certains, déjà, refusaient et
que beaucoup se mettent à contes-
ter : les étudiants demandent à par-
tager la responsabilité des profes-
seurs, et les ouvriers celle des pa-
trons, la province prend ses distances
vis-à-vis de Paris et les enfants
vis-à-vis de leurs parents. Un peu
partout, renaît cette vieille revendi-
cation des hommes qui, quelle que
soit son expression — autonomie ici,
participation là — consiste à « avoir
son mot à dire », à « prendre en
main son propre destin ».
Le crépuscule des dieux. L'aboli-
tion des privilèges et des mandari-
nats, le crépuscule des dieux et des
maîtres, la mort des notables et des
patriarches sont depuis toujours des
idées révolutionnaires, depuis un
certain temps des mots d'ordre po-
litiques. Mais cette fois, semble-t-il,
tion des privilèges et des mandari-
nats, le crépuscule des dieux et des
maîtres, la mort des notables et des
patriarches sont depuis toujours des
idées révolutionnaires, depuis un
certain temps des mots d'ordre po-
litiques. Mais cette fois, semble-t-il,
c'est autant au niveau de la cons-
cience que de l'idéologie qu'on remet
en cause, sinon expressément le ca-
pitalisme, du moins la société, confu-
sément ressentie comme injuste,
inadaptée et contraignante.
cience que de l'idéologie qu'on remet
en cause, sinon expressément le ca-
pitalisme, du moins la société, confu-
sément ressentie comme injuste,
inadaptée et contraignante.
Le désarroi de ceux qui y sont
insérés, l'angoisse des plus jeunes et
la colère des plus pauvres débou-
chent, pour autant qu'on puisse en
juger aujourd'hui, sur trois grands
thèmes : contestation de l'autorité
traditionnelle, mise en cause des
structures de l'Etat français et vo-
lonté de participation aux respon-
sabilités.
insérés, l'angoisse des plus jeunes et
la colère des plus pauvres débou-
chent, pour autant qu'on puisse en
juger aujourd'hui, sur trois grands
thèmes : contestation de l'autorité
traditionnelle, mise en cause des
structures de l'Etat français et vo-
lonté de participation aux respon-
sabilités.
Il fallait peut-être le fracas de la
rue et la solidarité éblouie de la
« base » pour que les enfants osent
soudain refuser ce monde que les
parents transmettent comme un hé-
ritage avec un mode d'emploi pour
tout commentaire. Il fallait, en tout
cas, que les enfants commencent :
ils ont beaucoup appris, ces temps-ci,
à leurs parents d'abord effarés, puis
méfiants, attentifs enfin. Le « dia-
logue » est l'explosif le plus puissant :
des édifices soigneusement consoli-
dés de génération en génération
tremblent d'un coup. C'est toute une
organisation de « structures » et de
« sanctions », de tabous et d'idéaux,
de « vérités premières » dont on fait
le procès public.
rue et la solidarité éblouie de la
« base » pour que les enfants osent
soudain refuser ce monde que les
parents transmettent comme un hé-
ritage avec un mode d'emploi pour
tout commentaire. Il fallait, en tout
cas, que les enfants commencent :
ils ont beaucoup appris, ces temps-ci,
à leurs parents d'abord effarés, puis
méfiants, attentifs enfin. Le « dia-
logue » est l'explosif le plus puissant :
des édifices soigneusement consoli-
dés de génération en génération
tremblent d'un coup. C'est toute une
organisation de « structures » et de
« sanctions », de tabous et d'idéaux,
de « vérités premières » dont on fait
le procès public.
Les accusés. Accusé n° 1° : l'ordre
établi, coupable de contrainte et de
sclérose. Les Conseils de l'Ordre des
médecins — dont les membres sont
déclarés déchus — et des architectes
volent en éclat. Les « patrons » sont
destitués de leur toute-puissance. Les
professeurs ne professeront plus. Le
musée national d'Art moderne, « ci-
metière de la culture », est « fermé
pour cause d'inutilité ». Les jeunes
Juifs du Consistoire de Paris en
contestent « les structures archaï-
ques ». On désacralise. Toutes les
brimades de la hiérarchie et de la
tradition sont dénoncées avec une
exaltation contagieuse.
établi, coupable de contrainte et de
sclérose. Les Conseils de l'Ordre des
médecins — dont les membres sont
déclarés déchus — et des architectes
volent en éclat. Les « patrons » sont
destitués de leur toute-puissance. Les
professeurs ne professeront plus. Le
musée national d'Art moderne, « ci-
metière de la culture », est « fermé
pour cause d'inutilité ». Les jeunes
Juifs du Consistoire de Paris en
contestent « les structures archaï-
ques ». On désacralise. Toutes les
brimades de la hiérarchie et de la
tradition sont dénoncées avec une
exaltation contagieuse.
Accusé n° 2 : le système, monstre
aveugle et étouffant, anonyme et
autoritaire. C'est à la fois l'Adminis-
tration, Paris et le Pouvoir, entités
lointaines — « ils » — qui mécon-
naissent les besoins de chacun. Deux
siècles de centralisation administra-
tive ont à la fois figé un appareil
étatique naturellement joide et créé
à son égard une mentalité de mé-
aveugle et étouffant, anonyme et
autoritaire. C'est à la fois l'Adminis-
tration, Paris et le Pouvoir, entités
lointaines — « ils » — qui mécon-
naissent les besoins de chacun. Deux
siècles de centralisation administra-
tive ont à la fois figé un appareil
étatique naturellement joide et créé
à son égard une mentalité de mé-
fiance irréductible. Le personnel de
l'Olympia en grève proteste par
exemple « contre les services gouver-
nementaux auxquels nous ne savons
si nous devons reprocher davantage
leur inconscience ou leur incom-
pétence ».
l'Olympia en grève proteste par
exemple « contre les services gouver-
nementaux auxquels nous ne savons
si nous devons reprocher davantage
leur inconscience ou leur incom-
pétence ».
Les contraintes de la bureaucratie
correspondent, sur un autre plan, à
ce qui est ressenti comme « la dic-
tature de Paris ». Ce n'est pas un
hasard si, depuis quelques années,
en particulier depuis la Rencontre
socialiste de Grenoble, on parle de
« décoloniser la province ». En Bre-
tagne, où les revendications à l'auto-
nomie sont les plus franches, M. Mi-
chel Phlipponneau (« La Gauche et
les régions ») fait avancer l'idée d'une
assemblée régionale élue. Les nou-
veaux « Girondins » refusent l'auto-
rité jacobine chère à de Gaulle et
Debré.
correspondent, sur un autre plan, à
ce qui est ressenti comme « la dic-
tature de Paris ». Ce n'est pas un
hasard si, depuis quelques années,
en particulier depuis la Rencontre
socialiste de Grenoble, on parle de
« décoloniser la province ». En Bre-
tagne, où les revendications à l'auto-
nomie sont les plus franches, M. Mi-
chel Phlipponneau (« La Gauche et
les régions ») fait avancer l'idée d'une
assemblée régionale élue. Les nou-
veaux « Girondins » refusent l'auto-
rité jacobine chère à de Gaulle et
Debré.
La fête grave. Quant au pouvoir,
l'impression générale est qu'« il gou-
verne sans nous ». La démocratie à
sens unique qui, entre les élections,
monologue à la télévision, ne satis-
fait plus, au fond, l'électeur de dé-
putés déconsidérés. Les étudiants, le
7 mai, ont passé le pont de la
Concorde vers les Champs-Elysées
sans un pavé pour le Palais-Bourbon.
l'impression générale est qu'« il gou-
verne sans nous ». La démocratie à
sens unique qui, entre les élections,
monologue à la télévision, ne satis-
fait plus, au fond, l'électeur de dé-
putés déconsidérés. Les étudiants, le
7 mai, ont passé le pont de la
Concorde vers les Champs-Elysées
sans un pavé pour le Palais-Bourbon.
Contre l'ordre établi, contre le sys-
tème, contre une organisation impla-
cable et feutrée des choses, la réac-
tion, on l'a bien vu, est profonde,
même si elle n'est pas générale. Dans
un premier temps, on en appelle à
l'imagination, à la liberté, à la créa-
tion. Puis, dans un second temps,
celui des revendications plus concrè-
tes, on exige la « participation ».
tème, contre une organisation impla-
cable et feutrée des choses, la réac-
tion, on l'a bien vu, est profonde,
même si elle n'est pas générale. Dans
un premier temps, on en appelle à
l'imagination, à la liberté, à la créa-
tion. Puis, dans un second temps,
celui des revendications plus concrè-
tes, on exige la « participation ».
C'est le vertige de la démocratie
directe — « dérnpcratie sauvage », dit
Sartre à la Sorbonne — l'appétit de
responsabilité, la soif de contesta-
tion. On imagine une société sans
notables où tous les hommes
auraient droit à la parole. Beaucoup
ignorent encore ce que sont, dans
leur pratique quotidienne, l'autoges-
tion et la cogestion (voir l'article
ci-dessous), qu'ils réclament par idéal.
directe — « dérnpcratie sauvage », dit
Sartre à la Sorbonne — l'appétit de
responsabilité, la soif de contesta-
tion. On imagine une société sans
notables où tous les hommes
auraient droit à la parole. Beaucoup
ignorent encore ce que sont, dans
leur pratique quotidienne, l'autoges-
tion et la cogestion (voir l'article
ci-dessous), qu'ils réclament par idéal.
Mais dans le chaos et l'ambiguïté
des derniers jours, oscillant entre
un certain sens de l'ordre et un cer-
tain goût de la révolution, la France,
la part la plus désespérée de la
France, célèbre dans la fièvre la fête
grave des idées. J.-N. GURGAND •
des derniers jours, oscillant entre
un certain sens de l'ordre et un cer-
tain goût de la révolution, la France,
la part la plus désespérée de la
France, célèbre dans la fièvre la fête
grave des idées. J.-N. GURGAND •
La participation
telle qu'on la pratique
Participer. Comment « participer »
à l'intérieur de l'entreprise ? A quoi
s'agit-il de participer ? Il n'y a que
deux objectifs : meilleur partage de
la prospérité, plus grande part dans
la gestion. Redistribution de l'argent
et pouvoir de décision, l'analogie de
l'entreprise et du gouvernement est
fondamentale dans l'analyse, par
exemple, de l'économiste François
Bloch-Lainé dont l'ouvrage le plus
retentissant : « Pour une réforme de
l'entreprise », souligne que « les sala-
riés sont des gouvernés, quels que
soient les gouvernants. En tant que
tels, ils aspirent à limiter la toute-
puissance patronale, qu'elle soit d'es-
sence étatique ou d'essence capita-
liste ».
à l'intérieur de l'entreprise ? A quoi
s'agit-il de participer ? Il n'y a que
deux objectifs : meilleur partage de
la prospérité, plus grande part dans
la gestion. Redistribution de l'argent
et pouvoir de décision, l'analogie de
l'entreprise et du gouvernement est
fondamentale dans l'analyse, par
exemple, de l'économiste François
Bloch-Lainé dont l'ouvrage le plus
retentissant : « Pour une réforme de
l'entreprise », souligne que « les sala-
riés sont des gouvernés, quels que
soient les gouvernants. En tant que
tels, ils aspirent à limiter la toute-
puissance patronale, qu'elle soit d'es-
sence étatique ou d'essence capita-
liste ».
La participation n'est pas une
question de régime. Ses différents
types sont illustrés aussi bien par
des pays capitalistes que par un pays
socialiste.
question de régime. Ses différents
types sont illustrés aussi bien par
des pays capitalistes que par un pays
socialiste.
Dans la cogestion allemande, dans
l'autogestion yougoslave, les salariés
sont, à des degrés divers, associés
aux décisions, mais aussi dans le
dernier cas à la distribution de tous
les profits, alors que seule une parti-
cipation à la prospérité de l'entre-
prise définit l'intéressement tel qu'il
existe en France, par exemple.
Yougoslavie. Souvent donné comme
exemple d'autogestion, le système
l'autogestion yougoslave, les salariés
sont, à des degrés divers, associés
aux décisions, mais aussi dans le
dernier cas à la distribution de tous
les profits, alors que seule une parti-
cipation à la prospérité de l'entre-
prise définit l'intéressement tel qu'il
existe en France, par exemple.
Yougoslavie. Souvent donné comme
exemple d'autogestion, le système
Lexique
syndical
syndical
Section syndicale d'entreprise : grou-
pement des salariés syndiqués d'une
entreprise.
Comité d'entreprise : le comité d'en-
treprise, obligatoire dans les entre-
prises employant plus de 50 person-
nes, coopère avec la direction à
l'amélioration des conditions collec-
tives de travail et de vie du personnel.
Dans l'ordre économique, il doit être
consulté quant à la gestion de l'entre-
prise et à son organisation, et informé
des bénéfices réalisés. Dans les faits,
son rôle est souvent minime.
Convention collective : sur le plan
prises employant plus de 50 person-
nes, coopère avec la direction à
l'amélioration des conditions collec-
tives de travail et de vie du personnel.
Dans l'ordre économique, il doit être
consulté quant à la gestion de l'entre-
prise et à son organisation, et informé
des bénéfices réalisés. Dans les faits,
son rôle est souvent minime.
Convention collective : sur le plan
national, accord passé entre les syn-
dicats de salariés et les syndicats
patronaux par branche d'activité. Il
porte sur les conditions de travail, de
salaires, et l'ensemble des aménage-
ments apportés au contrat de travail.
Cogestion : désigne, en Allemagne, la
dicats de salariés et les syndicats
patronaux par branche d'activité. Il
porte sur les conditions de travail, de
salaires, et l'ensemble des aménage-
ments apportés au contrat de travail.
Cogestion : désigne, en Allemagne, la
participation des salariés aux déci-
sions de l'entreprise, l'un des membres
du conseil de direction, le « directeur
du travail », étant un représentant du
personnel.
Autogestion : système appliqué notam
sions de l'entreprise, l'un des membres
du conseil de direction, le « directeur
du travail », étant un représentant du
personnel.
Autogestion : système appliqué notam
ment en Yougoslavie. Les ouvriers de
chaque entreprise élisent un comité
de gestion qui nomme lui-même son
président. Ce dernier participe à la
gestion de l'entreprise aux côtés d'un
directeur nommé par l'Etat.
Intéressement : c'est la participation
chaque entreprise élisent un comité
de gestion qui nomme lui-même son
président. Ce dernier participe à la
gestion de l'entreprise aux côtés d'un
directeur nommé par l'Etat.
Intéressement : c'est la participation
des salariés aux fruits de l'expansion
des entreprises. Celles-ci assurent
au personnel une répartition d'une
partie des bénéfices. Plusieurs mé-
thodes. Le salaire proportionnel : les
appointements des salariés varient
avec l'augmentation du chiffre d'af-
faires de l'entreprise (L'Oréal). Chez
Sommer S.A., s'ajoutent des primes de
rendement et de qualité. Lors de la
huitième année, l'équivalent d'environ
cinq mois de salaire a été ainsi dis-
tribué aux 1 500 ouvriers.
L'ordonnance du 17 août 1967 a insti-
tué en France un régime obligatoire
de participation. Elle procure un revenu
annuel supplémentaire de 1 à 3 %
pour chaque salarié selon les entre-
prises. Mais la loi ne concerne que
les entreprises de plus de 100 salariés
et l'intéressement est retenu pendant
cinq ans
des entreprises. Celles-ci assurent
au personnel une répartition d'une
partie des bénéfices. Plusieurs mé-
thodes. Le salaire proportionnel : les
appointements des salariés varient
avec l'augmentation du chiffre d'af-
faires de l'entreprise (L'Oréal). Chez
Sommer S.A., s'ajoutent des primes de
rendement et de qualité. Lors de la
huitième année, l'équivalent d'environ
cinq mois de salaire a été ainsi dis-
tribué aux 1 500 ouvriers.
L'ordonnance du 17 août 1967 a insti-
tué en France un régime obligatoire
de participation. Elle procure un revenu
annuel supplémentaire de 1 à 3 %
pour chaque salarié selon les entre-
prises. Mais la loi ne concerne que
les entreprises de plus de 100 salariés
et l'intéressement est retenu pendant
cinq ans
10
L'EXPRESS
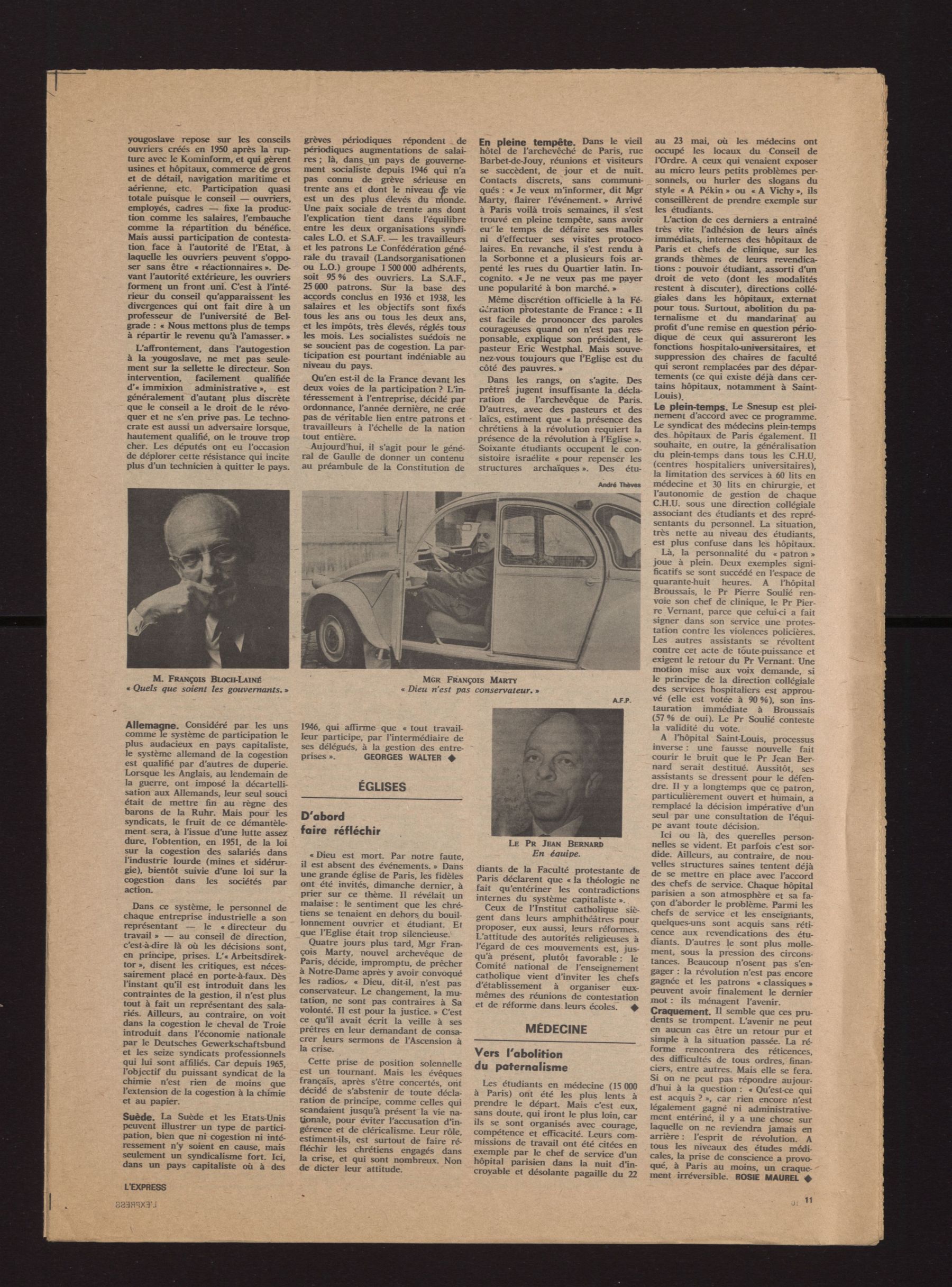

yougoslave repose sur les conseils
ouvriers créés en 1950 après la rup-
ture avec le Kominform. et qui gèrent
usines et hôpitaux, commerce de gros
et de détail, navigation maritime et
aérienne, etc. Participation quasi
totale puisque le conseil — ouvriers,
employés, cadres — fixe la produc-
tion comme les salaires, l'embauche
comme la répartition du bénéfice.
Mais aussi participation de contesta-
tion face à l'autorité de l'Etat, à
laquelle les ouvriers peuvent s'oppo-
ser sans être « réactionnaires ». De-
vant l'autorité extérieure, les ouvriers
forment un front uni. C'est à l'inté-
rieur du conseil qu'apparaissent les
divergences qui ont fait dire à un
professeur de l'université de Bel-
grade : « Nous mettons plus de temps
à répartir le revenu qu'à l'amasser. »
ouvriers créés en 1950 après la rup-
ture avec le Kominform. et qui gèrent
usines et hôpitaux, commerce de gros
et de détail, navigation maritime et
aérienne, etc. Participation quasi
totale puisque le conseil — ouvriers,
employés, cadres — fixe la produc-
tion comme les salaires, l'embauche
comme la répartition du bénéfice.
Mais aussi participation de contesta-
tion face à l'autorité de l'Etat, à
laquelle les ouvriers peuvent s'oppo-
ser sans être « réactionnaires ». De-
vant l'autorité extérieure, les ouvriers
forment un front uni. C'est à l'inté-
rieur du conseil qu'apparaissent les
divergences qui ont fait dire à un
professeur de l'université de Bel-
grade : « Nous mettons plus de temps
à répartir le revenu qu'à l'amasser. »
L'affrontement, dans l'autogestion
à la yougoslave, ne met pas seule-
ment sur la sellette le directeur. Son
intervention, facilement qualifiée
d'« immixion administrative », est
généralement d'autant plus discrète
que le conseil a le droit de le révo-
quer et ne s'en prive pas. Le techno-
crate est aussi un adversaire lorsque,
hautement qualifié, on le trouve trop
cher. Les députés ont eu l'occasion
de déplorer cette résistance qui incite
plus d'un technicien à quitter le pays.
à la yougoslave, ne met pas seule-
ment sur la sellette le directeur. Son
intervention, facilement qualifiée
d'« immixion administrative », est
généralement d'autant plus discrète
que le conseil a le droit de le révo-
quer et ne s'en prive pas. Le techno-
crate est aussi un adversaire lorsque,
hautement qualifié, on le trouve trop
cher. Les députés ont eu l'occasion
de déplorer cette résistance qui incite
plus d'un technicien à quitter le pays.
grèves périodiques répondent de
périodiques augmentations de salai-
res ; là, dans un pays de gouverne-
ment socialiste depuis 1946 qui n'a
pas connu de grève sérieuse en
trente ans et dont le niveau dp vie
est un des plus élevés du monde.
Une paix sociale de trente ans dont
l'explication tient dans l'équilibre
entre les deux organisations syndi-
cales L.O. et SA.F. — les travailleurs
et les patrons Le Confédération géné-
rale du travail (Landsorganisationen
ou L.O.) groupe 1 500 000 adhérents,
soit 95 % des ouvriers. La S.A.F.,
25 000 patrons. Sur la base des
accords conclus en 1936 et 1938, les
salaires et les objectifs sont fixés
tous les ans ou tous les deux ans,
et les impôts, très élevés, réglés tous
les mois. Les socialistes suédois ne
se soucient pas de cogestion. La par-
ticipation est pourtant indéniable au
niveau du pays.
périodiques augmentations de salai-
res ; là, dans un pays de gouverne-
ment socialiste depuis 1946 qui n'a
pas connu de grève sérieuse en
trente ans et dont le niveau dp vie
est un des plus élevés du monde.
Une paix sociale de trente ans dont
l'explication tient dans l'équilibre
entre les deux organisations syndi-
cales L.O. et SA.F. — les travailleurs
et les patrons Le Confédération géné-
rale du travail (Landsorganisationen
ou L.O.) groupe 1 500 000 adhérents,
soit 95 % des ouvriers. La S.A.F.,
25 000 patrons. Sur la base des
accords conclus en 1936 et 1938, les
salaires et les objectifs sont fixés
tous les ans ou tous les deux ans,
et les impôts, très élevés, réglés tous
les mois. Les socialistes suédois ne
se soucient pas de cogestion. La par-
ticipation est pourtant indéniable au
niveau du pays.
Qu'en est-il de la France devant les
deux voies de la participation ? L'in-
téressement à l'entreprise, décidé par
ordonnance, l'année dernière, ne crée
pas de véritable lien entre patrons et
travailleurs à l'échelle de la nation
tout entière.
deux voies de la participation ? L'in-
téressement à l'entreprise, décidé par
ordonnance, l'année dernière, ne crée
pas de véritable lien entre patrons et
travailleurs à l'échelle de la nation
tout entière.
Aujourd'hui, il s'agit pour le géné-
ral de Gaulle de donner un contenu
au préambule de la Constitution de
ral de Gaulle de donner un contenu
au préambule de la Constitution de
En pleine tempête. Dans le vieil
hôtel de l'archevêché de Paris, rue
Barbet-de-Jouy, réunions et visiteurs
se succèdent, de jour et de nuit.
Contacts discrets, sans communi-
qués : « Je veux m'informer, dit Mgr
Marty, flairer l'événement. » Arrivé
à Paris voilà trois semaines, il s'est
trouvé en pleine tempête, sans avoir
eu' le temps de défaire ses malles
ni d'effectuer ses visites protoco-
laires. En revanche, il s'est rendu à
la Sorbonne et a plusieurs fois ar-
penté les rues du Quartier latin. In-
cognito. « Je ne veux pas me payer
une popularité à bon marché. »
hôtel de l'archevêché de Paris, rue
Barbet-de-Jouy, réunions et visiteurs
se succèdent, de jour et de nuit.
Contacts discrets, sans communi-
qués : « Je veux m'informer, dit Mgr
Marty, flairer l'événement. » Arrivé
à Paris voilà trois semaines, il s'est
trouvé en pleine tempête, sans avoir
eu' le temps de défaire ses malles
ni d'effectuer ses visites protoco-
laires. En revanche, il s'est rendu à
la Sorbonne et a plusieurs fois ar-
penté les rues du Quartier latin. In-
cognito. « Je ne veux pas me payer
une popularité à bon marché. »
Même discrétion officielle à la Fé-
ùviration protestante de France : « II
est facile de prononcer des paroles
courageuses quand on n'est pas res-
ponsable, explique son président, le
pasteur Eric Westphal. Mais souve-
nez-vous toujours que l'Eglise est du
côté des pauvres. »
ùviration protestante de France : « II
est facile de prononcer des paroles
courageuses quand on n'est pas res-
ponsable, explique son président, le
pasteur Eric Westphal. Mais souve-
nez-vous toujours que l'Eglise est du
côté des pauvres. »
Dans les rangs, on s'agite. Des
prêtres jugent insuffisante la décla-
ration de l'archevêque de Paris.
D'autres, avec des pasteurs et des
laïcs, estiment que « la présence des
chrétiens à la révolution requiert la
présence de la révolution à l'Eglise ».
Soixante étudiants occupent le con-
sistoire Israélite « pour repenser les
structures archaïques ». Des étu-
prêtres jugent insuffisante la décla-
ration de l'archevêque de Paris.
D'autres, avec des pasteurs et des
laïcs, estiment que « la présence des
chrétiens à la révolution requiert la
présence de la révolution à l'Eglise ».
Soixante étudiants occupent le con-
sistoire Israélite « pour repenser les
structures archaïques ». Des étu-
André Thèves
M. FRANÇOIS BLOCH-LAINÉ
Quels que soient les gouvernants. >
Allemagne. Considéré par les uns
comme Te système de participation le
plus audacieux en pays capitaliste,
le système allemand de la cogestion
est qualifié par d'autres de duperie.
Lorsque les Anglais, au lendemain de
la guerre, ont imposé la décartelli-
sation aux Allemands, leur seul souci
était de mettre fin au règne des
barons de la Ruhr. Mais pour les
syndicats, le fruit de ce démantèle-
ment sera, à l'issue d'une lutte assez
dure, l'obtention, en 1951, de la loi
sur la cogestion des salariés dans
l'industrie lourde (mines et sidérur-
gie), bientôt suivie d'une loi sur la
cogestion dans les sociétés par
action.
comme Te système de participation le
plus audacieux en pays capitaliste,
le système allemand de la cogestion
est qualifié par d'autres de duperie.
Lorsque les Anglais, au lendemain de
la guerre, ont imposé la décartelli-
sation aux Allemands, leur seul souci
était de mettre fin au règne des
barons de la Ruhr. Mais pour les
syndicats, le fruit de ce démantèle-
ment sera, à l'issue d'une lutte assez
dure, l'obtention, en 1951, de la loi
sur la cogestion des salariés dans
l'industrie lourde (mines et sidérur-
gie), bientôt suivie d'une loi sur la
cogestion dans les sociétés par
action.
Dans ce système, le personnel de
chaque entreprise industrielle a son
représentant — le « directeur du
travail » — au conseil de direction,
c'est-à-dire là où les décisions sont,
en principe, prises. L'« Arbeitsdirek-
tor », disent les critiques, est néces-
sairement placé en porte-à-faux. Dès
l'instant qu'il est introduit dans les
contraintes de la gestion, il n'est plus
tout à fait un représentant des sala-
riés. Ailleurs, au contraire, on voit
dans la cogestion le cheval de Troie
introduit dans l'économie nationale
par le Deutsches Gewerkschaftsbund
et les seize syndicats professionnels
qui lui sont affiliés. Car depuis 1965,
l'objectif du puissant syndicat de la
chimie n'est rien de moins que
l'extension de la cogestion à la chimie
et au papier.
chaque entreprise industrielle a son
représentant — le « directeur du
travail » — au conseil de direction,
c'est-à-dire là où les décisions sont,
en principe, prises. L'« Arbeitsdirek-
tor », disent les critiques, est néces-
sairement placé en porte-à-faux. Dès
l'instant qu'il est introduit dans les
contraintes de la gestion, il n'est plus
tout à fait un représentant des sala-
riés. Ailleurs, au contraire, on voit
dans la cogestion le cheval de Troie
introduit dans l'économie nationale
par le Deutsches Gewerkschaftsbund
et les seize syndicats professionnels
qui lui sont affiliés. Car depuis 1965,
l'objectif du puissant syndicat de la
chimie n'est rien de moins que
l'extension de la cogestion à la chimie
et au papier.
Suède. La Suède et les Etats-Unis
peuvent illustrer un type de partici-
pation, bien que ni cogestion ni inté-
ressement n'y soient en cause, mais
seulement un syndicalisme fort. Ici,
dans un pays capitaliste où à des
peuvent illustrer un type de partici-
pation, bien que ni cogestion ni inté-
ressement n'y soient en cause, mais
seulement un syndicalisme fort. Ici,
dans un pays capitaliste où à des
L'EXPRESS
MGR FRANÇOIS MARTY
« Dieu n'est pas conservateur, i
A.F.P.
1946, qui affirme que « tout travail-
leur participe, par l'intermédiaire de
ses délégués, à la gestion des entre-
prises ». GEORGES WALTER •
leur participe, par l'intermédiaire de
ses délégués, à la gestion des entre-
prises ». GEORGES WALTER •
ÉGLISES
D'abord
faire réfléchir
faire réfléchir
« Dieu est mort. Par notre faute,
il est absent des événements. » Dans
une grande église de Paris, les fidèles
ont été invités, dimanche dernier, à
prier sur ce thème. Il révélait un
malaise : le sentiment que les chré-
tiens se tenaient en dehors du bouil-
lonnement ouvrier et étudiant. Et
que l'Eglise était trop silencieuse.
il est absent des événements. » Dans
une grande église de Paris, les fidèles
ont été invités, dimanche dernier, à
prier sur ce thème. Il révélait un
malaise : le sentiment que les chré-
tiens se tenaient en dehors du bouil-
lonnement ouvrier et étudiant. Et
que l'Eglise était trop silencieuse.
Quatre jours plus tard, Mgr Fran-
çois Marty, nouvel archevêque de
Paris, décide, impromptu, de prêcher
à Notre-Dame après y avoir convoqué
les radios, « Dieu, dit-il, n'est pas
conservateur. Le changement, la mu-
tation, ne sont pas contraires à Sa
volonté. Il est pour la justice. » C'est
ce qu'il avait écrit la veille à ses
prêtres en leur demandant de consa-
crer leurs sermons de l'Ascension à
la crise.
çois Marty, nouvel archevêque de
Paris, décide, impromptu, de prêcher
à Notre-Dame après y avoir convoqué
les radios, « Dieu, dit-il, n'est pas
conservateur. Le changement, la mu-
tation, ne sont pas contraires à Sa
volonté. Il est pour la justice. » C'est
ce qu'il avait écrit la veille à ses
prêtres en leur demandant de consa-
crer leurs sermons de l'Ascension à
la crise.
Cette prise de position solennelle
est un tournant. Mais les évêques
français, après s'être concertés, ont
décidé de s'abstenir de toute décla-
ration de principe, comme celles qui
scandaient jusqu'à présent la vie na-
tionale, pour éviter l'accusation d'in-
gérence et de cléricalisme. Leur rôle,
estiment-ils, est surtout de faire ré-
fléchir les chrétiens engagés dans
la crise, et qui sont nombreux. Non
de dicter leur attitude.
est un tournant. Mais les évêques
français, après s'être concertés, ont
décidé de s'abstenir de toute décla-
ration de principe, comme celles qui
scandaient jusqu'à présent la vie na-
tionale, pour éviter l'accusation d'in-
gérence et de cléricalisme. Leur rôle,
estiment-ils, est surtout de faire ré-
fléchir les chrétiens engagés dans
la crise, et qui sont nombreux. Non
de dicter leur attitude.
LE PR JEAN BERNARD
En éauipe.
En éauipe.
diants de la Faculté protestante de
Paris déclarent que « la théologie ne
fait qu'entériner les contradictions
internes du système capitaliste ».
Paris déclarent que « la théologie ne
fait qu'entériner les contradictions
internes du système capitaliste ».
Ceux de l'Institut catholique siè-
gent dans leurs amphithéâtres pour
proposer, eux aussi, leurs réformes.
L'attitude des autorités religieuses à
l'égard de ces mouvements est, jus-
qu'à présent, plutôt favorable : le
Comité national de l'enseignement
catholique vient d'inviter les chefs
d'établissement à organiser eux-
mêmes des réunions de contestation
et de réforme dans leurs écoles. •
gent dans leurs amphithéâtres pour
proposer, eux aussi, leurs réformes.
L'attitude des autorités religieuses à
l'égard de ces mouvements est, jus-
qu'à présent, plutôt favorable : le
Comité national de l'enseignement
catholique vient d'inviter les chefs
d'établissement à organiser eux-
mêmes des réunions de contestation
et de réforme dans leurs écoles. •
MÉDECINE
Vers l'abolition
du paternalisme
du paternalisme
Les étudiants en médecine (15000
à Paris) ont été les plus lents à
prendre le départ. Mais c'est eux,
sans doute, qui iront le plus loin, car
ils se sont organisés avec courage,
compétence et efficacité. Leurs com-
missions de travail ont été citées en
exemple par le chef de service d'un
hôpital parisien dans la nuit d'in-
croyable et désolante pagaille du 22
à Paris) ont été les plus lents à
prendre le départ. Mais c'est eux,
sans doute, qui iront le plus loin, car
ils se sont organisés avec courage,
compétence et efficacité. Leurs com-
missions de travail ont été citées en
exemple par le chef de service d'un
hôpital parisien dans la nuit d'in-
croyable et désolante pagaille du 22
au 23 mai, où les médecins ont
occupé les locaux du Conseil de
l'Ordre. A ceux qui venaient exposer
au micro leurs petits problèmes per-
sonnels, ou hurler des slogans du
style « A Pékin » ou « A Vichy », ils
conseillèrent de prendre exemple sur
les étudiants.
occupé les locaux du Conseil de
l'Ordre. A ceux qui venaient exposer
au micro leurs petits problèmes per-
sonnels, ou hurler des slogans du
style « A Pékin » ou « A Vichy », ils
conseillèrent de prendre exemple sur
les étudiants.
L'action de ces derniers a entraîné
très vite l'adhésion de leurs aînés
immédiats, internes des hôpitaux de
Paris et chefs de clinique, sur les
grands thèmes de leurs revendica-
tions : pouvoir étudiant, assorti d'un
droit de veto (dont les modalités
restent à discuter), directions collé-
giales dans les hôpitaux, externat
pour tous. Surtout, abolition du pa-
ternalisme et du mandarinat au
profit d'une remise en question pério-
dique de ceux qui assureront les
fonctions hospitalo-universitaires, et
suppression des chaires de faculté
qui seront remplacées par des dépar-
tements (ce qui existe déjà dans cer-
tains hôpitaux, notamment à Saint-
Louis).
très vite l'adhésion de leurs aînés
immédiats, internes des hôpitaux de
Paris et chefs de clinique, sur les
grands thèmes de leurs revendica-
tions : pouvoir étudiant, assorti d'un
droit de veto (dont les modalités
restent à discuter), directions collé-
giales dans les hôpitaux, externat
pour tous. Surtout, abolition du pa-
ternalisme et du mandarinat au
profit d'une remise en question pério-
dique de ceux qui assureront les
fonctions hospitalo-universitaires, et
suppression des chaires de faculté
qui seront remplacées par des dépar-
tements (ce qui existe déjà dans cer-
tains hôpitaux, notamment à Saint-
Louis).
Le plein-temps. Le Snesup est plei-
nement d'accord avec ce programme.
Le syndicat des médecins plein-temps
des hôpitaux de Paris également. Il
souhaite, en outre, la généralisation
du plein-temps dans tous les C.H.U..
(centres hospitaliers universitaires),
la limitation des services à 60 lits en
médecine et 30 lits en chirurgie, et
l'autonomie de gestion de chaque
C.H.U. sous une direction collégiale
associant des étudiants et des repré-
sentants du personnel. La situation,
très nette au niveau des étudiants,
est plus confuse dans les hôpitaux.
Là, la personnalité du « patron »
joue à plein. Deux exemples signi-
ficatifs se sont succédé en l'espace de
quarante-huit heures. A l'hôpital
Broussais, le Pr Pierre Soulié ren-
voie son chef de clinique, le Pr Pier-
re Vernant, parce que celui-ci a fait
signer dans son service une protes-
tation contre les violences policières.
Les autres assistants se révoltent
contre cet acte de toute-puissance et
exigent le retour du Pr Vernant. Une
motion mise aux voix demande, si
le principe de la direction collégiale
des services hospitaliers est approu-
vé (elle est votée à 90%), son ins-
tauration immédiate à Broussais
(57 °6 de oui). Le Pr Soulié conteste
la validité du vote.
nement d'accord avec ce programme.
Le syndicat des médecins plein-temps
des hôpitaux de Paris également. Il
souhaite, en outre, la généralisation
du plein-temps dans tous les C.H.U..
(centres hospitaliers universitaires),
la limitation des services à 60 lits en
médecine et 30 lits en chirurgie, et
l'autonomie de gestion de chaque
C.H.U. sous une direction collégiale
associant des étudiants et des repré-
sentants du personnel. La situation,
très nette au niveau des étudiants,
est plus confuse dans les hôpitaux.
Là, la personnalité du « patron »
joue à plein. Deux exemples signi-
ficatifs se sont succédé en l'espace de
quarante-huit heures. A l'hôpital
Broussais, le Pr Pierre Soulié ren-
voie son chef de clinique, le Pr Pier-
re Vernant, parce que celui-ci a fait
signer dans son service une protes-
tation contre les violences policières.
Les autres assistants se révoltent
contre cet acte de toute-puissance et
exigent le retour du Pr Vernant. Une
motion mise aux voix demande, si
le principe de la direction collégiale
des services hospitaliers est approu-
vé (elle est votée à 90%), son ins-
tauration immédiate à Broussais
(57 °6 de oui). Le Pr Soulié conteste
la validité du vote.
A l'hôpital Saint-Louis, processus
inverse : une fausse nouvelle fait
courir le bruit que le Pr Jean Ber-
nard serait destitué. Aussitôt, ses
assistants se dressent pour le défen-
dre. Il y a longtemps que ce patron,
particulièrement ouvert et humain, a
remplacé la décision impérative d'un
seul par une consultation de l'équi-
pe avant toute décision.
inverse : une fausse nouvelle fait
courir le bruit que le Pr Jean Ber-
nard serait destitué. Aussitôt, ses
assistants se dressent pour le défen-
dre. Il y a longtemps que ce patron,
particulièrement ouvert et humain, a
remplacé la décision impérative d'un
seul par une consultation de l'équi-
pe avant toute décision.
Ici ou là, des querelles person-
nelles se vident. Et parfois c'est sor-
dide. Ailleurs, au contraire, de nou-
velles structures saines tentent déjà
de se mettre en place avec l'accord
des chefs de service. Chaque hôpital
parisien a son atmosphère et sa fa-
çon d'aborder le problème. Parmi les
chefs de service et les enseignants,
quelques-uns sont acquis sans réti-
cence aux revendications des étu-
diants. D'autres le sont plus molle-
ment, sous la pression des circons-
tances. Beaucoup n'osent pas s'en-
gager : la révolution n'est pas encore
gagnée et les patrons « classiques »
peuvent avoir finalement le dernier
mot : ils ménagent l'avenir.
Craquement. H semble que ces pru-
dents se trompent. L'avenir ne peut
en aucun cas être un retour pur et
simple à la situation passée. La ré-
forme rencontrera des réticences,
des difficultés de tous ordres, finan-
ciers, entre autres. Mais elle se fera.
Si on ne peut pas répondre aujour-
d'hui à la question : « Qu'est-ce qui
est acquis ? », car rien encore n'est
légalement gagné ni administrative-
ment entériné, il y a une chose sur
laquelle on ne reviendra jamais en
arrière : l'esprit de révolution. A
tous les niveaux des études médi-
cales, la prise de conscience a provo-
qué, à Paris au moins, un craque-
ment irréversible. ROSIE MAURE! +
nelles se vident. Et parfois c'est sor-
dide. Ailleurs, au contraire, de nou-
velles structures saines tentent déjà
de se mettre en place avec l'accord
des chefs de service. Chaque hôpital
parisien a son atmosphère et sa fa-
çon d'aborder le problème. Parmi les
chefs de service et les enseignants,
quelques-uns sont acquis sans réti-
cence aux revendications des étu-
diants. D'autres le sont plus molle-
ment, sous la pression des circons-
tances. Beaucoup n'osent pas s'en-
gager : la révolution n'est pas encore
gagnée et les patrons « classiques »
peuvent avoir finalement le dernier
mot : ils ménagent l'avenir.
Craquement. H semble que ces pru-
dents se trompent. L'avenir ne peut
en aucun cas être un retour pur et
simple à la situation passée. La ré-
forme rencontrera des réticences,
des difficultés de tous ordres, finan-
ciers, entre autres. Mais elle se fera.
Si on ne peut pas répondre aujour-
d'hui à la question : « Qu'est-ce qui
est acquis ? », car rien encore n'est
légalement gagné ni administrative-
ment entériné, il y a une chose sur
laquelle on ne reviendra jamais en
arrière : l'esprit de révolution. A
tous les niveaux des études médi-
cales, la prise de conscience a provo-
qué, à Paris au moins, un craque-
ment irréversible. ROSIE MAURE! +
11
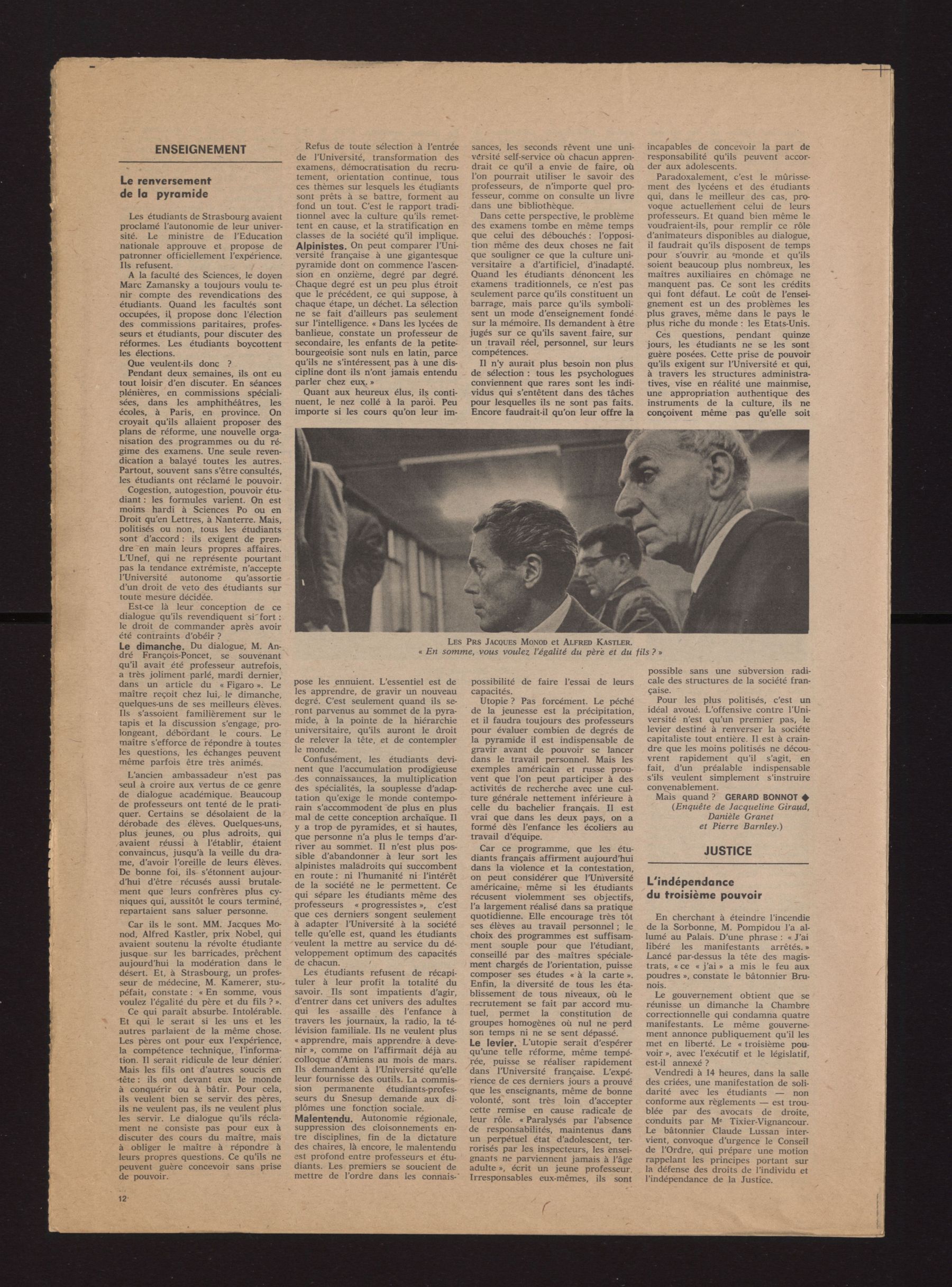

ENSEIGNEMENT
Le renversement
de la pyramide
de la pyramide
Les étudiants de Strasbourg avaient
proclamé l'autonomie de leur univer-
sité. Le ministre de l'Education
nationale approuve et propose de
patronner officiellement l'expérience.
Ils refusent.
proclamé l'autonomie de leur univer-
sité. Le ministre de l'Education
nationale approuve et propose de
patronner officiellement l'expérience.
Ils refusent.
A la faculté des Sciences, le doyen
Marc Zamansky a toujours voulu te-
nir compte des revendications des
étudiants. Quand les facultés sont
occupées, il propose donc l'élection
des commissions paritaires, profes-
seurs et étudiants, pour discuter des
réformes. Les étudiants boycottent
les élections.
Marc Zamansky a toujours voulu te-
nir compte des revendications des
étudiants. Quand les facultés sont
occupées, il propose donc l'élection
des commissions paritaires, profes-
seurs et étudiants, pour discuter des
réformes. Les étudiants boycottent
les élections.
Que veulent-ils donc ?
Pendant deux semaines, ils ont eu
tout loisir d'en discuter. En séances
plénières, en commissions spéciali-
sées, dans les amphithéâtres, les
écoles, à Paris, en province. On
croyait qu'ils allaient proposer des
plans de réforme, une nouvelle orga-
nisation des programmes ou du ré-
gime des examens. Une seule reven-
dication a balayé toutes les autres.
Partout, souvent sans s'être consultés,
les étudiants ont réclamé le pouvoir.
tout loisir d'en discuter. En séances
plénières, en commissions spéciali-
sées, dans les amphithéâtres, les
écoles, à Paris, en province. On
croyait qu'ils allaient proposer des
plans de réforme, une nouvelle orga-
nisation des programmes ou du ré-
gime des examens. Une seule reven-
dication a balayé toutes les autres.
Partout, souvent sans s'être consultés,
les étudiants ont réclamé le pouvoir.
Cogestion, autogestion, pouvoir étu-
diant : les formules varient. On est
moins hardi à Sciences Pô ou en
Droit qu'en Lettres, à Nanterre. Mais,
politisés ou non, tous les étudiants
sont d'accord : ils exigent de pren-
dre en main leurs propres affaires.
L'Unef, qui ne représente pourtant
pas la tendance extrémiste, n'accepte
l'Université autonome qu'assortie
d'un droit de veto des étudiants sur
toute mesure décidée.
diant : les formules varient. On est
moins hardi à Sciences Pô ou en
Droit qu'en Lettres, à Nanterre. Mais,
politisés ou non, tous les étudiants
sont d'accord : ils exigent de pren-
dre en main leurs propres affaires.
L'Unef, qui ne représente pourtant
pas la tendance extrémiste, n'accepte
l'Université autonome qu'assortie
d'un droit de veto des étudiants sur
toute mesure décidée.
Est-ce là leur conception de ce
dialogue qu'ils revendiquent si'fort :
le droit de commander après avoir
été contraints d'obéir ?
Le dimanche. Du dialogue, M. An-
dré François-Poncet, se souvenant
qu'il avait été professeur autrefois,
a très joliment parlé, mardi dernier,
dans un article du « Figaro ». Le
maître reçoit chez lui, le dimanche,
quelques-uns de ses meilleurs élèves.
Ils s'assoient familièrement sur le
tapis et la discussion s'engage, pro-
longeant, débordant le cours. Le
maître s'efforce de répondre à toutes
les questions, les échanges peuvent
même parfois être très animés.
dialogue qu'ils revendiquent si'fort :
le droit de commander après avoir
été contraints d'obéir ?
Le dimanche. Du dialogue, M. An-
dré François-Poncet, se souvenant
qu'il avait été professeur autrefois,
a très joliment parlé, mardi dernier,
dans un article du « Figaro ». Le
maître reçoit chez lui, le dimanche,
quelques-uns de ses meilleurs élèves.
Ils s'assoient familièrement sur le
tapis et la discussion s'engage, pro-
longeant, débordant le cours. Le
maître s'efforce de répondre à toutes
les questions, les échanges peuvent
même parfois être très animés.
L'ancien ambassadeur n'est pas
seul à croire aux vertus de ce genre
de dialogue académique. Beaucoup
de professeurs ont tenté de le prati-
quer. Certains se désolaient de la
dérobade des élèves. Quelques-uns,
plus jeunes, ou plus adroits, qui
avaient réussi à l'établir, étaient
convaincus, jusqu'à la veille du dra-
me, d'avoir l'oreille de leurs élèves.
De bonne foi, ils s'étonnent aujour-
d'hui d'être récusés aussi brutale-
ment que leurs confrères plus cy-
niques qui, aussitôt le cours terminé,
repartaient sans saluer personne.
seul à croire aux vertus de ce genre
de dialogue académique. Beaucoup
de professeurs ont tenté de le prati-
quer. Certains se désolaient de la
dérobade des élèves. Quelques-uns,
plus jeunes, ou plus adroits, qui
avaient réussi à l'établir, étaient
convaincus, jusqu'à la veille du dra-
me, d'avoir l'oreille de leurs élèves.
De bonne foi, ils s'étonnent aujour-
d'hui d'être récusés aussi brutale-
ment que leurs confrères plus cy-
niques qui, aussitôt le cours terminé,
repartaient sans saluer personne.
Car ils le sont. MM. Jacques Mo-
nod, Alfred Kastler, prix Nobel, qui
avaient soutenu la révolte étudiante
jusque sur les barricades, prêchent
aujourd'hui la modération dans le
désert. Et, à Strasbourg, un profes-
seur de médecine, M. Kamerer, stu-
péfait/ constate : « En somme, vous
voulez l'égalité du père et du fils ? ».
nod, Alfred Kastler, prix Nobel, qui
avaient soutenu la révolte étudiante
jusque sur les barricades, prêchent
aujourd'hui la modération dans le
désert. Et, à Strasbourg, un profes-
seur de médecine, M. Kamerer, stu-
péfait/ constate : « En somme, vous
voulez l'égalité du père et du fils ? ».
Ce qui paraît absurbe. Intolérable.
Et qui le serait si les uns et les
autres parlaient de la même chose.
Les pères ont pour eux l'expérience,
la compétence technique, l'informa-
tion. Il serait ridicule de leur dénier:
Mais les fils ont d'autres soucis en
tête : ils ont devant eux le monde
à conquérir ou à bâtir. Pour cela,
ils veulent bien se servir des pères,
ils ne veulent pas, ils ne veulent plus
les servir. Le dialogue qu'ils récla-
ment ne consiste pas pour eux à
discuter des cours du maître, mais
à obliger le maître à répondre à
leurs propres questions. Ce qu'ils ne
peuvent guère concevoir sans prise
de pouvoir.
Et qui le serait si les uns et les
autres parlaient de la même chose.
Les pères ont pour eux l'expérience,
la compétence technique, l'informa-
tion. Il serait ridicule de leur dénier:
Mais les fils ont d'autres soucis en
tête : ils ont devant eux le monde
à conquérir ou à bâtir. Pour cela,
ils veulent bien se servir des pères,
ils ne veulent pas, ils ne veulent plus
les servir. Le dialogue qu'ils récla-
ment ne consiste pas pour eux à
discuter des cours du maître, mais
à obliger le maître à répondre à
leurs propres questions. Ce qu'ils ne
peuvent guère concevoir sans prise
de pouvoir.
Refus de toute sélection à l'entrée
de l'Université, transformation des
examens, démocratisation du recru-
tement, orientation continue, tous
ces thèmes sur lesquels les étudiants
sont prêts à se battre, forment au
fond un tout. C'est le rapport tradi-
tionnel avec la culture qu'ils remet-
tent en cause, et la stratification en
classes de la société qu'il implique.
Alpinistes. On peut comparer l'Uni-
versité française à une gigantesque
pyramide dont on commence l'ascen-
sion en onzième, degré par degré.
Chaque degré est un peu plus étroit
que le précédent, ce qui suppose, à
chaque étape, un déchet. La sélection
ne se fait d'ailleurs pas seulement
sur l'intelligence. « Dans les lycées de
banlieue, constate un professeur de
secondaire, les enfants de la petite-
bourgeoisie sont nuls en latin, parce
qu'ils ne s'intéressent, pas à une dis-
cipline dont ils n'ont jamais entendu
parler chez eux. »
de l'Université, transformation des
examens, démocratisation du recru-
tement, orientation continue, tous
ces thèmes sur lesquels les étudiants
sont prêts à se battre, forment au
fond un tout. C'est le rapport tradi-
tionnel avec la culture qu'ils remet-
tent en cause, et la stratification en
classes de la société qu'il implique.
Alpinistes. On peut comparer l'Uni-
versité française à une gigantesque
pyramide dont on commence l'ascen-
sion en onzième, degré par degré.
Chaque degré est un peu plus étroit
que le précédent, ce qui suppose, à
chaque étape, un déchet. La sélection
ne se fait d'ailleurs pas seulement
sur l'intelligence. « Dans les lycées de
banlieue, constate un professeur de
secondaire, les enfants de la petite-
bourgeoisie sont nuls en latin, parce
qu'ils ne s'intéressent, pas à une dis-
cipline dont ils n'ont jamais entendu
parler chez eux. »
Quant aux heureux élus, ils conti-
nuent, le nez collé à la paroi. Peu
importe si les cours qu'on leur im-
nuent, le nez collé à la paroi. Peu
importe si les cours qu'on leur im-
sances, les seconds rêvent une uni-
versité self-service où chacun appren-
drait ce qu'il a envie de faire, où
l'on pourrait utiliser le savoir des
professeurs, de n'importe quel pro-
fesseur, comme on consulte un livre
dans une bibliothèque.
versité self-service où chacun appren-
drait ce qu'il a envie de faire, où
l'on pourrait utiliser le savoir des
professeurs, de n'importe quel pro-
fesseur, comme on consulte un livre
dans une bibliothèque.
Dans cette perspective, le problème
des examens tombe en même temps
que celui des débouchés : l'opposi-
tion même des deux choses ne fait
que souligner ce que la culture uni-
versitaire a d'artificiel, d'inadapté.
Quand les étudiants dénoncent les
examens traditionnels, ce n'est pas
seulement parce qu'ils constituent un
barrage, mais parce qu'ils symboli-
sent un mode d'enseignement fondé
sur la mémoire. Ils demandent à être
jugés sur ce qu'ils savent faire, sur
un travail réel, personnel, sur leurs
compétences.
des examens tombe en même temps
que celui des débouchés : l'opposi-
tion même des deux choses ne fait
que souligner ce que la culture uni-
versitaire a d'artificiel, d'inadapté.
Quand les étudiants dénoncent les
examens traditionnels, ce n'est pas
seulement parce qu'ils constituent un
barrage, mais parce qu'ils symboli-
sent un mode d'enseignement fondé
sur la mémoire. Ils demandent à être
jugés sur ce qu'ils savent faire, sur
un travail réel, personnel, sur leurs
compétences.
Il n'y aurait plus besoin non plus
de sélection : tous les psychologues
conviennent que rares sont les indi-
vidus qui s'entêtent dans des tâches
pour lesquelles ils ne sont pas faits.
Encore faudrait-il qu'on leur offre la
de sélection : tous les psychologues
conviennent que rares sont les indi-
vidus qui s'entêtent dans des tâches
pour lesquelles ils ne sont pas faits.
Encore faudrait-il qu'on leur offre la
incapables de concevoir la part de
responsabilité qu'ils peuvent accor-
der aux adolescents.
responsabilité qu'ils peuvent accor-
der aux adolescents.
Paradoxalement, c'est le mûrisse-
ment des lycéens et des étudiants
qui, dans le meilleur des cas, pro-
voque actuellement celui de leurs
professeurs. Et quand bien même le
voudraient-ils, pour remplir ce rôle
d'animateurs disponibles au dialogue,
il faudrait qu'ils disposent de temps
pour s'ouvrir au emonde et qu'ils
soient beaucoup plus nombreux, les
maîtres auxiliaires en chômage ne
manquent pas. Ce sont les crédits
qui font défaut. Le coût de l'ensei-
gnement est un des problèmes les
plus graves, même dans le pays le
plus riche du monde : les Etats-Unis.
ment des lycéens et des étudiants
qui, dans le meilleur des cas, pro-
voque actuellement celui de leurs
professeurs. Et quand bien même le
voudraient-ils, pour remplir ce rôle
d'animateurs disponibles au dialogue,
il faudrait qu'ils disposent de temps
pour s'ouvrir au emonde et qu'ils
soient beaucoup plus nombreux, les
maîtres auxiliaires en chômage ne
manquent pas. Ce sont les crédits
qui font défaut. Le coût de l'ensei-
gnement est un des problèmes les
plus graves, même dans le pays le
plus riche du monde : les Etats-Unis.
Ces questions, pendant quinze
jours, les étudiants ne se les sont
guère posées. Cette prise de pouvoir
qu'ils exigent sur l'Université et qui,
à travers les structures administra-
tives, vise en réalité une mainmise,
une appropriation authentique des
instruments de la culture, ils ne
conçoivent même pas qu'elle soit
jours, les étudiants ne se les sont
guère posées. Cette prise de pouvoir
qu'ils exigent sur l'Université et qui,
à travers les structures administra-
tives, vise en réalité une mainmise,
une appropriation authentique des
instruments de la culture, ils ne
conçoivent même pas qu'elle soit
LES PRS JACQUES MONOD et ALFRED KASTLER.
« En somme, vous voulez l'égalité du père et du fils ? »
« En somme, vous voulez l'égalité du père et du fils ? »
pose les ennuient. L'essentiel est de
les apprendre, de gravir un nouveau
degré. C'est seulement quand ils se-
ront parvenus au sommet de la pyra-
mide, à la pointe de la hiérarchie
universitaire, qu'ils auront le droit
de relever la tête, et de contempler
le monde.
les apprendre, de gravir un nouveau
degré. C'est seulement quand ils se-
ront parvenus au sommet de la pyra-
mide, à la pointe de la hiérarchie
universitaire, qu'ils auront le droit
de relever la tête, et de contempler
le monde.
Confusément, les étudiants devi-
nent que l'accumulation prodigieuse
des connaissances, la multiplication
des spécialités, la souplesse d'adap-
tation qu'exigé le monde contempo-
rain s'accommodent de plus en plus
mal de cette conception archaïque. Il
y a trop de pyramides, et si hautes,
que personne n'a plus le temps d'ar-
river au sommet. Il n'est plus pos-
sible d'abandonner à leur sort les
alpinistes maladroits qui succombent
en route : ni l'humanité ni l'intérêt
de la société ne le permettent. Ce
qui sépare les étudiants même des
professeurs « progressistes », c'est
que ces derniers songent seulement
à adapter l'Université à la société
telle qu'elle est, quand les étudiants
veulent la mettre au service du dé-
veloppement optimum des capacités
de chacun.
nent que l'accumulation prodigieuse
des connaissances, la multiplication
des spécialités, la souplesse d'adap-
tation qu'exigé le monde contempo-
rain s'accommodent de plus en plus
mal de cette conception archaïque. Il
y a trop de pyramides, et si hautes,
que personne n'a plus le temps d'ar-
river au sommet. Il n'est plus pos-
sible d'abandonner à leur sort les
alpinistes maladroits qui succombent
en route : ni l'humanité ni l'intérêt
de la société ne le permettent. Ce
qui sépare les étudiants même des
professeurs « progressistes », c'est
que ces derniers songent seulement
à adapter l'Université à la société
telle qu'elle est, quand les étudiants
veulent la mettre au service du dé-
veloppement optimum des capacités
de chacun.
Les étudiants refusent de récapi-
tuler à leur profit la totalité du
savoir. Ils sont impatients d'agir,
d'entrer dans cet univers des adultes
qui les assaille dès l'enfance à
travers les journaux, la radio, la té-
lévision familiale. Ils ne veulent plus
« apprendre, mais apprendre à deve-
nir », comme on l'affirmait déjà au
colloque d'Amiens au mois de mars.
Ils demandent à l'Université qu'elle
leur fournisse des outils. La commis-
sion permanente étudiants-profes-
seurs du Snesup demande aux di-
plômes une fonction sociale.
Malentendu. Autonomie régionale,
suppression des cloisonnements en-
tre disciplines, fin de la dictature
des chaires, là encore, le malentendu
est profond entre professeurs et étu-
diants. Les premiers se soucient de
mettre de l'ordre dans les connais-'
tuler à leur profit la totalité du
savoir. Ils sont impatients d'agir,
d'entrer dans cet univers des adultes
qui les assaille dès l'enfance à
travers les journaux, la radio, la té-
lévision familiale. Ils ne veulent plus
« apprendre, mais apprendre à deve-
nir », comme on l'affirmait déjà au
colloque d'Amiens au mois de mars.
Ils demandent à l'Université qu'elle
leur fournisse des outils. La commis-
sion permanente étudiants-profes-
seurs du Snesup demande aux di-
plômes une fonction sociale.
Malentendu. Autonomie régionale,
suppression des cloisonnements en-
tre disciplines, fin de la dictature
des chaires, là encore, le malentendu
est profond entre professeurs et étu-
diants. Les premiers se soucient de
mettre de l'ordre dans les connais-'
possibilité de faire l'essai de leurs
capacités.
capacités.
Utopie ? Pas forcément. Le péché
de la jeunesse est la précipitation,
et il faudra toujours des professeurs
pour évaluer combien de degrés de
la pyramide il est indispensable de
gravir avant de pouvoir se lancer
dans le travail personnel. Mais les
exemples américain et russe prou-
vent que l'on peut participer à des
activités de recherche avec une cul-
ture générale nettement inférieure à
celle du bachelier français. Il est
vrai que dans les deux pays, on a
formé dès l'enfance les écoliers au
travail d'équipe.
de la jeunesse est la précipitation,
et il faudra toujours des professeurs
pour évaluer combien de degrés de
la pyramide il est indispensable de
gravir avant de pouvoir se lancer
dans le travail personnel. Mais les
exemples américain et russe prou-
vent que l'on peut participer à des
activités de recherche avec une cul-
ture générale nettement inférieure à
celle du bachelier français. Il est
vrai que dans les deux pays, on a
formé dès l'enfance les écoliers au
travail d'équipe.
Car ce programme, que les étu-
diants français affirment aujourd'hui
dans la violence et la contestation,
on peut considérer que l'Université
américaine, même si les étudiants
récusent violemment ses objectifs,
l'a largement réalisé dans sa pratique
quotidienne. Elle encourage très tôt
ses élèves au travail personnel ; le
choix des programmes est suffisam-
ment souple pour que l'étudiant,
conseillé par des maîtres spéciale-
ment chargés de l'orientation, puisse
composer ses études « à la carte ».
Enfin, la diversité de tous les éta-
blissement de tous niveaux, où le
recrutement se fait par accord mu-
tuel, permet la constitution de
groupes homogènes où nul ne perd
son temps ni ne se sent dépassé.
Le levier. L'utopie serait d'espérer
qu'une telle réforme, même tempé-
rée, puisse se réaliser rapidement
dans l'Université française. L'expé-
rience de ces derniers jours a prouvé
que les enseignants, même de bonne
volonté, sont très loin d'accepter
cette remise en cause radicale de
leur rôle. « Paralysés par l'absence
de responsabilités, maintenus dans
un perpétuel état d'adolescent, ter-
rorisés par les inspecteurs, les ensei-
gnants ne parviennent jamais à l'âge
adulte », écrit un jeune professeur.
Irresponsables eux-mêmes, ils sont
diants français affirment aujourd'hui
dans la violence et la contestation,
on peut considérer que l'Université
américaine, même si les étudiants
récusent violemment ses objectifs,
l'a largement réalisé dans sa pratique
quotidienne. Elle encourage très tôt
ses élèves au travail personnel ; le
choix des programmes est suffisam-
ment souple pour que l'étudiant,
conseillé par des maîtres spéciale-
ment chargés de l'orientation, puisse
composer ses études « à la carte ».
Enfin, la diversité de tous les éta-
blissement de tous niveaux, où le
recrutement se fait par accord mu-
tuel, permet la constitution de
groupes homogènes où nul ne perd
son temps ni ne se sent dépassé.
Le levier. L'utopie serait d'espérer
qu'une telle réforme, même tempé-
rée, puisse se réaliser rapidement
dans l'Université française. L'expé-
rience de ces derniers jours a prouvé
que les enseignants, même de bonne
volonté, sont très loin d'accepter
cette remise en cause radicale de
leur rôle. « Paralysés par l'absence
de responsabilités, maintenus dans
un perpétuel état d'adolescent, ter-
rorisés par les inspecteurs, les ensei-
gnants ne parviennent jamais à l'âge
adulte », écrit un jeune professeur.
Irresponsables eux-mêmes, ils sont
possible sans une subversion radi-
cale des structures de la société fran-
çaise.
cale des structures de la société fran-
çaise.
Pour les plus politisés, c'est un
idéal avoué. L'offensive contre l'Uni-
versité n'est qu'un premier pas, le
levier destiné à renverser la société
capitaliste tout entière. Il est à crain-
dre que les moins politisés ne décou-
vrent rapidement qu'il s'agit, en
fait, d'un préalable indispensable
s'ils veulent simplement s'instruire
convenablement.
idéal avoué. L'offensive contre l'Uni-
versité n'est qu'un premier pas, le
levier destiné à renverser la société
capitaliste tout entière. Il est à crain-
dre que les moins politisés ne décou-
vrent rapidement qu'il s'agit, en
fait, d'un préalable indispensable
s'ils veulent simplement s'instruire
convenablement.
Mais quand ? GERARD BONNOT •
(Enquête de Jacqueline Giraud,
(Enquête de Jacqueline Giraud,
Danièle Granet
et Pierre Barnley.)
et Pierre Barnley.)
JUSTICE
L'indépendance
du troisième pouvoir
En cherchant à éteindre l'incendie
de la Sorbonne, M. Pompidou l'a al-
lumé au Palais. D'une phrase : « J'ai
libéré les manifestants arrêtés. »
Lancé par-dessus la tête des magis-
trats, «ce «j'ai» a mis le feu aux
poudres », constate le bâtonnier Bru-
nois.
de la Sorbonne, M. Pompidou l'a al-
lumé au Palais. D'une phrase : « J'ai
libéré les manifestants arrêtés. »
Lancé par-dessus la tête des magis-
trats, «ce «j'ai» a mis le feu aux
poudres », constate le bâtonnier Bru-
nois.
Le gouvernement obtient que se
réunisse un dimanche la Chambre
correctionnelle qui condamna quatre
manifestants. Le même gouverne-
ment annonce publiquement qu'il les
met en liberté. Le « troisième pou-
voir », avec l'exécutif et le législatif,
est-il annexé ?
réunisse un dimanche la Chambre
correctionnelle qui condamna quatre
manifestants. Le même gouverne-
ment annonce publiquement qu'il les
met en liberté. Le « troisième pou-
voir », avec l'exécutif et le législatif,
est-il annexé ?
Vendredi à 14 heures, dans la salle
des criées, une manifestation de soli-
darité avec les étudiants — non
conforme aux règlements — est trou-
blée par des avocats de droite,
conduits par Me Tixier-Vignancour.
Le bâtonnier Claude Lussan inter-
vient, convoque d'urgence le Conseil
de l'Ordre, qui prépare une motion
rappelant les principes portant sur
la défense des droits de l'individu et
l'indépendance de la Justice.
des criées, une manifestation de soli-
darité avec les étudiants — non
conforme aux règlements — est trou-
blée par des avocats de droite,
conduits par Me Tixier-Vignancour.
Le bâtonnier Claude Lussan inter-
vient, convoque d'urgence le Conseil
de l'Ordre, qui prépare une motion
rappelant les principes portant sur
la défense des droits de l'individu et
l'indépendance de la Justice.
12
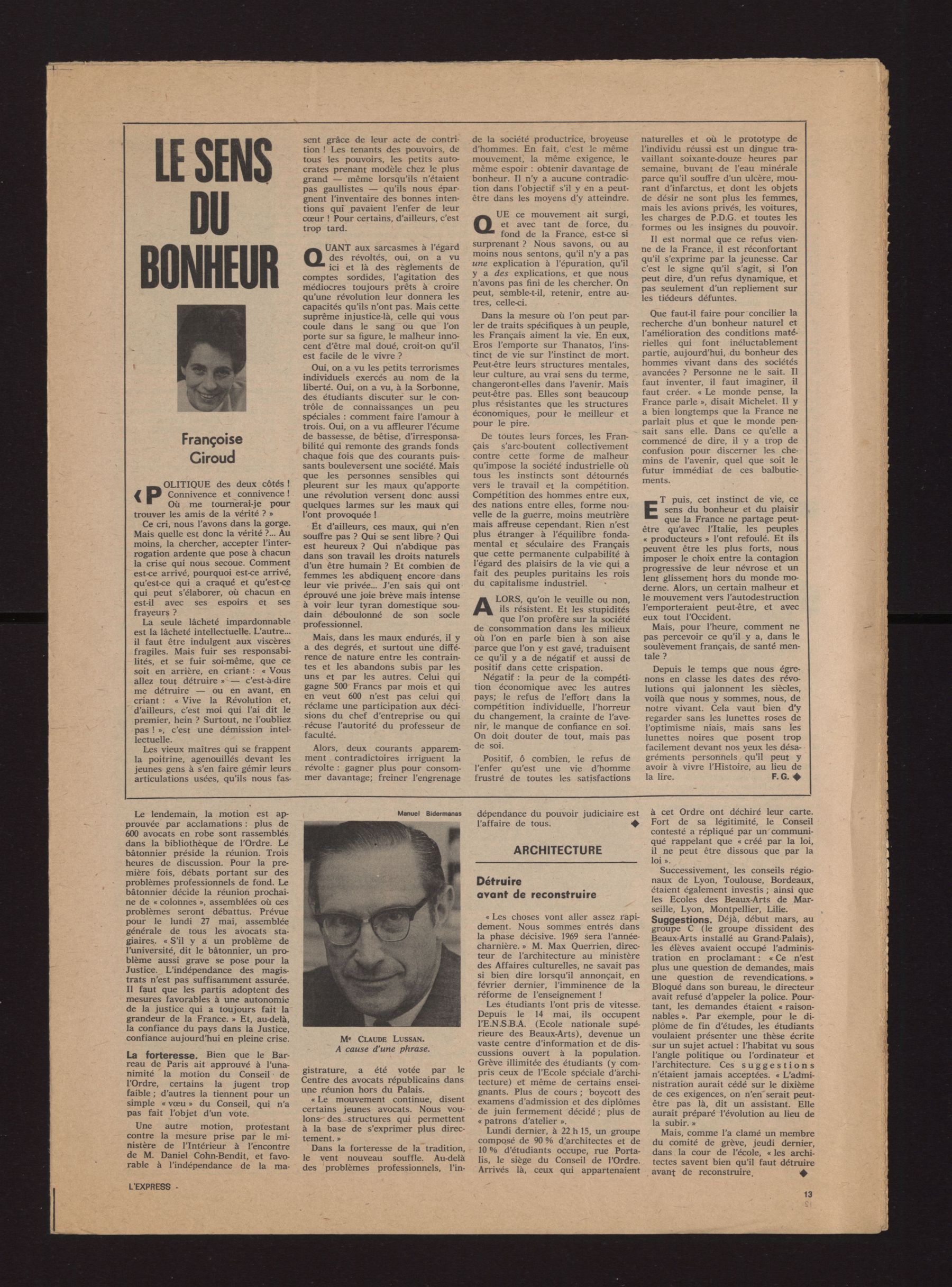

LE SENS
BONHEUR
Françoise
Ciroud
Ciroud
OUTIQUE des deux côtés !
Connivence et connivence !
Où me tournerai-je pour
trouver les amis de la vérité ? »
Connivence et connivence !
Où me tournerai-je pour
trouver les amis de la vérité ? »
Ce cri, nous l'avons dans la gorge.
Mais quelle est donc la vérité ?... Au
moins, la chercher, accepter l'inter-
rogation ardente que pose à chacun
la crise qui nous secoue. Comment
est-ce arrivé, pourquoi est-ce arrivé,
qu'est-ce qui a craqué et qu'est-ce
qui peut s'élaborer, où chacun en
est-il avec ses espoirs et ses
frayeurs ?
Mais quelle est donc la vérité ?... Au
moins, la chercher, accepter l'inter-
rogation ardente que pose à chacun
la crise qui nous secoue. Comment
est-ce arrivé, pourquoi est-ce arrivé,
qu'est-ce qui a craqué et qu'est-ce
qui peut s'élaborer, où chacun en
est-il avec ses espoirs et ses
frayeurs ?
La seule lâcheté impardonnable
est la lâcheté intellectuelle. L'autre...
il faut être indulgent aux viscères
fragiles. Mais fuir ses responsabi-
lités, et se fuir soi-même, que ce
soit en arrière, en criant : « Vous
allez tout détruire » — c'est-à-dire
me détruire — ou en avant, en
criant : « Vive la Révolution et,
d'ailleurs, c'est moi qui l'ai dit le
premier, hein ? Surtout, ne l'oubliez
pas ! », c'est une démission intel-
lectuelle.
est la lâcheté intellectuelle. L'autre...
il faut être indulgent aux viscères
fragiles. Mais fuir ses responsabi-
lités, et se fuir soi-même, que ce
soit en arrière, en criant : « Vous
allez tout détruire » — c'est-à-dire
me détruire — ou en avant, en
criant : « Vive la Révolution et,
d'ailleurs, c'est moi qui l'ai dit le
premier, hein ? Surtout, ne l'oubliez
pas ! », c'est une démission intel-
lectuelle.
Les vieux maîtres qui se frappent
la poitrine, agenouillés devant les
jeunes gens à s'en faire gémir leurs
articulations usées, qu'ils nous fas-
la poitrine, agenouillés devant les
jeunes gens à s'en faire gémir leurs
articulations usées, qu'ils nous fas-
sent grâce de leur acte de contri-
tion ! Les tenants des pouvoirs, de
tous les pouvoirs, les petits auto-
crates prenant modèle chez le plus
grand — même lorsqu'ils n'étaient
pas gaullistes — qu'ils nous épar-
gnent l'inventaire des bonnes inten-
tions qui pavaient l'enfer de leur
cœur ! Pour certains, d'ailleurs, c'est
trop tard.
tion ! Les tenants des pouvoirs, de
tous les pouvoirs, les petits auto-
crates prenant modèle chez le plus
grand — même lorsqu'ils n'étaient
pas gaullistes — qu'ils nous épar-
gnent l'inventaire des bonnes inten-
tions qui pavaient l'enfer de leur
cœur ! Pour certains, d'ailleurs, c'est
trop tard.
QUANT aux sarcasmes à l'égard
des révoltés, oui, on a vu
ici et là des règlements de
comptes sordides, l'agitation des
médiocres toujours prêts à croire
qu'une révolution leur donnera les
capacités qu'ils n'ont pas. Mais cette
suprême injustice-là, celle qui vous
coule dans le sang ou que l'on
porte sur sa figure, le malheur inno-
cent d'être mal doué, croit-on qu'il
est facile de le vivre ?
des révoltés, oui, on a vu
ici et là des règlements de
comptes sordides, l'agitation des
médiocres toujours prêts à croire
qu'une révolution leur donnera les
capacités qu'ils n'ont pas. Mais cette
suprême injustice-là, celle qui vous
coule dans le sang ou que l'on
porte sur sa figure, le malheur inno-
cent d'être mal doué, croit-on qu'il
est facile de le vivre ?
Oui, on a vu les petits terrorismes
individuels exercés au nom de la
liberté. Oui, on a vu, à la Sorbonne,
des étudiants discuter sur le con-
trôle de connaissances un peu
spéciales : comment faire l'amour à
trois. Oui, on a vu affleurer l'écume
de bassesse, de bêtise, d'irresponsa-
bilité qui remonte des grands fonds
chaque fois que des courants puis-
sants bouleversent une société. Mais
que les personnes sensibles qui
pleurent sur les maux qu'apporté
une révolution versent donc aussi
quelques larmes sur les maux qui
l'ont provoquée !
individuels exercés au nom de la
liberté. Oui, on a vu, à la Sorbonne,
des étudiants discuter sur le con-
trôle de connaissances un peu
spéciales : comment faire l'amour à
trois. Oui, on a vu affleurer l'écume
de bassesse, de bêtise, d'irresponsa-
bilité qui remonte des grands fonds
chaque fois que des courants puis-
sants bouleversent une société. Mais
que les personnes sensibles qui
pleurent sur les maux qu'apporté
une révolution versent donc aussi
quelques larmes sur les maux qui
l'ont provoquée !
Et d'ailleurs, ces maux, qui n'en
souffre pas ? Qui se sent libre ? Qui
est heureux ? Qui n'abdique pas
dans son travail les droits naturels
d'un être humain ? Et combien de
femmes les abdiquent encore dans
leur vie privée... J'en sais qui ont
éprouvé une joie brève mais intense
à voir leur tyran domestique sou-
dain déboulonné de son socle
professionnel.
souffre pas ? Qui se sent libre ? Qui
est heureux ? Qui n'abdique pas
dans son travail les droits naturels
d'un être humain ? Et combien de
femmes les abdiquent encore dans
leur vie privée... J'en sais qui ont
éprouvé une joie brève mais intense
à voir leur tyran domestique sou-
dain déboulonné de son socle
professionnel.
Mais, dans les maux endurés, il y
a des degrés, et surtout une diffé-
rence de nature entre les contrain-
tes et les abandons subis par les
uns et par les autres. Celui qui
gagne 500 Francs par mois et qui
en veut 600 n'est pas celui qui
réclame une participation aux déci-
sions du chef d'entreprise ou qui
récuse l'autorité du professeur de
faculté.
a des degrés, et surtout une diffé-
rence de nature entre les contrain-
tes et les abandons subis par les
uns et par les autres. Celui qui
gagne 500 Francs par mois et qui
en veut 600 n'est pas celui qui
réclame une participation aux déci-
sions du chef d'entreprise ou qui
récuse l'autorité du professeur de
faculté.
Alors, deux courants apparem-
ment contradictoires irriguent la
révolte : gagner plus pour consom-
mer davantage; freiner l'engrenage
ment contradictoires irriguent la
révolte : gagner plus pour consom-
mer davantage; freiner l'engrenage
de la société productrice, broyeuse
d'hommes. En fait, c'est le même
mouvement, la même exigence, le
même espoir : obtenir davantage de
bonheur. Il n'y a aucune contradic-
tion dans l'objectif s'il y en a peut-
être dans les moyens d'y atteindre.
d'hommes. En fait, c'est le même
mouvement, la même exigence, le
même espoir : obtenir davantage de
bonheur. Il n'y a aucune contradic-
tion dans l'objectif s'il y en a peut-
être dans les moyens d'y atteindre.
QUE ce mouvement ait surgi,
et avec tant de force, du
fond de la France, est-ce si
surprenant ? Nous savons, ou au
moins nous sentons, qu'il n'y a pas
une explication à l'épuration, qu'il
y a des explications, et que nous
n'avons pas fini de les chercher. On
peut, semble-t-il, retenir, entre au-
tres, celle-ci.
et avec tant de force, du
fond de la France, est-ce si
surprenant ? Nous savons, ou au
moins nous sentons, qu'il n'y a pas
une explication à l'épuration, qu'il
y a des explications, et que nous
n'avons pas fini de les chercher. On
peut, semble-t-il, retenir, entre au-
tres, celle-ci.
Dans la mesure où l'on peut par-
ler de traits spécifiques à un peuple,
les Français aiment la vie. En eux,
Eros l'emporte sur Thanatos, l'ins-
tinct de vie sur l'instinct de mort.
Peut-être leurs structures mentales,
leur culture, au vrai sens du terme,
changeront-elles dans l'avenir. Mais
peut-être pas. Elles sont beaucoup
plus résistantes que les structures
économiques, pour le meilleur et
pour le pire.
ler de traits spécifiques à un peuple,
les Français aiment la vie. En eux,
Eros l'emporte sur Thanatos, l'ins-
tinct de vie sur l'instinct de mort.
Peut-être leurs structures mentales,
leur culture, au vrai sens du terme,
changeront-elles dans l'avenir. Mais
peut-être pas. Elles sont beaucoup
plus résistantes que les structures
économiques, pour le meilleur et
pour le pire.
De toutes leurs forces, les Fran-
çais s'arc-boutent collectivement
contre cette forme de malheur
qu'imposé la société industrielle où
tous les instincts sont détournés
vers le travail et la compétition.
Compétition des hommes entre eux,
des nations entre elles, forme nou-
velle de la guerre, moins meutrière
mais affreuse cependant. Rien n'est
plus étranger à l'équilibre fonda-
mental et séculaire des Français
que cette permanente culpabilité à
l'égard des plaisirs de la vie qui a
fait des peuples puritains les rois
du capitalisme industriel.
çais s'arc-boutent collectivement
contre cette forme de malheur
qu'imposé la société industrielle où
tous les instincts sont détournés
vers le travail et la compétition.
Compétition des hommes entre eux,
des nations entre elles, forme nou-
velle de la guerre, moins meutrière
mais affreuse cependant. Rien n'est
plus étranger à l'équilibre fonda-
mental et séculaire des Français
que cette permanente culpabilité à
l'égard des plaisirs de la vie qui a
fait des peuples puritains les rois
du capitalisme industriel.
ALORS, qu'on le veuille ou non,
ils résistent. Et les stupidités
que l'on profère sur la société
de consommation dans les milieux
où l'on en parle bien à son aise
parce que l'on y est gavé, traduisent
ce qu'il y a de négatif et aussi de
positif dans cette crispation.
ils résistent. Et les stupidités
que l'on profère sur la société
de consommation dans les milieux
où l'on en parle bien à son aise
parce que l'on y est gavé, traduisent
ce qu'il y a de négatif et aussi de
positif dans cette crispation.
Négatif : la peur de la compéti-
tion économique avec les autres
pays; le refus de l'effort dans la
compétition individuelle, l'horreur
du changement, la crainte de l'ave-
nir, le manque de confiance en soi.
On doit douter de tout, mais pas
de soi.
tion économique avec les autres
pays; le refus de l'effort dans la
compétition individuelle, l'horreur
du changement, la crainte de l'ave-
nir, le manque de confiance en soi.
On doit douter de tout, mais pas
de soi.
Positif, ô combien, le refus de
l'enfer qu'est une vie d'homme
frustré de toutes les satisfactions
l'enfer qu'est une vie d'homme
frustré de toutes les satisfactions
naturelles et où le prototype de
l'individu réussi est un dingue tra-
vaillant soixante-douze heures par
semaine, buvant de l'eau minérale
parce qu'il souffre d'un ulcère, mou-
rant d'infarctus, et dont les objets
de désir ne sont plus les femmes,
mais les avions privés, les voitures,
les charges de P.D.G. et toutes les
formes ou les insignes du pouvoir.
Il est normal que ce refus vien-
ne de la France, il est réconfortant
qu'il s'exprime par la jeunesse. Car
c'est le signe qu'il s'agit, si l'on
peut dire, d'un refus dynamique, et
pas seulement d'un repliement sur
les tiédeurs défuntes.
l'individu réussi est un dingue tra-
vaillant soixante-douze heures par
semaine, buvant de l'eau minérale
parce qu'il souffre d'un ulcère, mou-
rant d'infarctus, et dont les objets
de désir ne sont plus les femmes,
mais les avions privés, les voitures,
les charges de P.D.G. et toutes les
formes ou les insignes du pouvoir.
Il est normal que ce refus vien-
ne de la France, il est réconfortant
qu'il s'exprime par la jeunesse. Car
c'est le signe qu'il s'agit, si l'on
peut dire, d'un refus dynamique, et
pas seulement d'un repliement sur
les tiédeurs défuntes.
Que faut-il faire pour concilier la
recherche d'un bonheur naturel et
l'amélioration des conditions maté-
rielles qui font inéluctablement
partie, aujourd'hui, du bonheur des
hommes vivant dans des sociétés
avancées ? Personne ne le sait. Il
faut inventer, il faut imaginer, il
faut créer. « Le monde pense, la
France parle », disait Michelet. Il y
a bien longtemps que la France ne
parlait plus et que le monde pen-
sait sans elle. Dans ce qu'elle a
commencé de dire, il y a trop de
confusion pour discerner les che-
mins de l'avenir, quel que soit le
futur immédiat de ces balbutie-
ments.
recherche d'un bonheur naturel et
l'amélioration des conditions maté-
rielles qui font inéluctablement
partie, aujourd'hui, du bonheur des
hommes vivant dans des sociétés
avancées ? Personne ne le sait. Il
faut inventer, il faut imaginer, il
faut créer. « Le monde pense, la
France parle », disait Michelet. Il y
a bien longtemps que la France ne
parlait plus et que le monde pen-
sait sans elle. Dans ce qu'elle a
commencé de dire, il y a trop de
confusion pour discerner les che-
mins de l'avenir, quel que soit le
futur immédiat de ces balbutie-
ments.
T puis, cet instinct de vie, ce
sens du bonheur et du plaisir
que la France ne partage peut-
être qu'avec l'Italie, les peuples
« producteurs » l'ont refoulé. Et ils
peuvent être les plus forts, nous
imposer le choix entre la contagion
progressive de leur névrose et un
lent glissement hors du monde mo-
derne. Alors, un certain malheur et
le mouvement vers l'autodestruction
l'emporteraient peut-être, et avec
eux tout l'Occident.
sens du bonheur et du plaisir
que la France ne partage peut-
être qu'avec l'Italie, les peuples
« producteurs » l'ont refoulé. Et ils
peuvent être les plus forts, nous
imposer le choix entre la contagion
progressive de leur névrose et un
lent glissement hors du monde mo-
derne. Alors, un certain malheur et
le mouvement vers l'autodestruction
l'emporteraient peut-être, et avec
eux tout l'Occident.
Mais, pour l'heure, comment ne
pas percevoir ce qu'il y a, dans le
soulèvement français, de santé men-
tale ?
pas percevoir ce qu'il y a, dans le
soulèvement français, de santé men-
tale ?
Depuis le temps que nous égre-
nons en classe les dates des révo-
lutions qui jalonnent les siècles,
voilà que nous y sommes, nous, de
notre vivant. Cela vaut bien d'y
regarder sans les lunettes rosés de
l'optimisme niais, mais sans les
lunettes noires que posent trop
facilement devant nos yeux les désa-
gréments personnels qu'il peut y
avoir à vivre l'Histoire, au lieu de
la lire. F. G. +
nons en classe les dates des révo-
lutions qui jalonnent les siècles,
voilà que nous y sommes, nous, de
notre vivant. Cela vaut bien d'y
regarder sans les lunettes rosés de
l'optimisme niais, mais sans les
lunettes noires que posent trop
facilement devant nos yeux les désa-
gréments personnels qu'il peut y
avoir à vivre l'Histoire, au lieu de
la lire. F. G. +
Le lendemain, la motion est ap-
prouvée par acclamations : plus de
600 avocats en robe sont rassemblés
dans la bibliothèque de l'Ordre. Le
bâtonnier préside la réunion. Trois
heures de discussion. Pour la pre-
mière fois, débats portant sur des
problèmes professionnels de fond. Le
bâtonnier décide la réunion prochai-
ne de « colonnes », assemblées où ces
problèmes seront débattus. Prévue
pour le lundi 27 mai, assemblée
générale de tous les avocats sta-
giaires. « S'il y a un problème de
l'université, dit le bâtonnier, un pro-
blème aussi grave se pose pour la
Justice. L'indépendance des magis-
trats n'est pas suffisamment assurée.
Il faut que les partis adoptent des
mesures favorables à une autonomie
de la justice qui a toujours fait la
grandeur de la France. » Et, au-delà,
la confiance du pays dans la Justice,
confiance aujourd'hui en pleine crise.
prouvée par acclamations : plus de
600 avocats en robe sont rassemblés
dans la bibliothèque de l'Ordre. Le
bâtonnier préside la réunion. Trois
heures de discussion. Pour la pre-
mière fois, débats portant sur des
problèmes professionnels de fond. Le
bâtonnier décide la réunion prochai-
ne de « colonnes », assemblées où ces
problèmes seront débattus. Prévue
pour le lundi 27 mai, assemblée
générale de tous les avocats sta-
giaires. « S'il y a un problème de
l'université, dit le bâtonnier, un pro-
blème aussi grave se pose pour la
Justice. L'indépendance des magis-
trats n'est pas suffisamment assurée.
Il faut que les partis adoptent des
mesures favorables à une autonomie
de la justice qui a toujours fait la
grandeur de la France. » Et, au-delà,
la confiance du pays dans la Justice,
confiance aujourd'hui en pleine crise.
La forteresse. Bien que le Bar-
reau de Paris ait approuvé à l'una-
nimité la motion du Conseil de
l'Ordre, certains la jugent trop
faible ; d'autres la tiennent pour un
simple « vœu » du Conseil, qui n'a
pas fait l'objet d'un vote.
reau de Paris ait approuvé à l'una-
nimité la motion du Conseil de
l'Ordre, certains la jugent trop
faible ; d'autres la tiennent pour un
simple « vœu » du Conseil, qui n'a
pas fait l'objet d'un vote.
Une autre motion, protestant
contre la mesure prise par le mi-
nistère de l'Intérieur à rencontre
de M. Daniel Cohn-Bendit, et favo-
rable à l'indépendance de la ma-
contre la mesure prise par le mi-
nistère de l'Intérieur à rencontre
de M. Daniel Cohn-Bendit, et favo-
rable à l'indépendance de la ma-
L'EXPRESS -
Manuel Bidermanas
M« CLAUDE LUSSAN.
A cause d'une phrase.
A cause d'une phrase.
gistrature, a été votée par le
Centre des avocats républicains dans
une réunion hors du Palais.
Centre des avocats républicains dans
une réunion hors du Palais.
« Le mouvement continue, disent
certains jeunes avocats. Nous vou-
lons des structures qui permettent
à la base de s'exprimer plus direc-
tement. »
certains jeunes avocats. Nous vou-
lons des structures qui permettent
à la base de s'exprimer plus direc-
tement. »
Dans la forteresse de la tradition,
le vent nouveau souffle. Au-delà
des problèmes professionnels, l'in-
le vent nouveau souffle. Au-delà
des problèmes professionnels, l'in-
dépendance du pouvoir judiciaire est
l'affaire de tous. +
l'affaire de tous. +
ARCHITECTURE
Détruire
avant de reconstruire
« Les choses vont aller assez rapi-
dement. Nous sommes entrés dans
la phase décisive. 1969 sera Tannée-
charnière. » M. Max Querrien, direc-
teur de l'architecture au ministère
des Affaires culturelles, ne savait pas
si bien dire lorsqu'il annonçait, en
février dernier, l'imminence de la
réforme de l'enseignement !
dement. Nous sommes entrés dans
la phase décisive. 1969 sera Tannée-
charnière. » M. Max Querrien, direc-
teur de l'architecture au ministère
des Affaires culturelles, ne savait pas
si bien dire lorsqu'il annonçait, en
février dernier, l'imminence de la
réforme de l'enseignement !
Les étudiants l'ont pris de vitesse.
Depuis le 14 mai, ils occupent
l'E.N.S.B.A. (Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts), devenue un
vaste centre d'information et de dis-
cussions ouvert à la population.
Grève illimitée des étudiants (y com-
pris ceux de l'Ecole spéciale d'archi-
tecture) et même de certains ensei-
gnants. Plus de cours ; boycott des
examens d'admission et des diplômes
de juin fermement décidé ; plus de
« patrons d'atelier ».
Depuis le 14 mai, ils occupent
l'E.N.S.B.A. (Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts), devenue un
vaste centre d'information et de dis-
cussions ouvert à la population.
Grève illimitée des étudiants (y com-
pris ceux de l'Ecole spéciale d'archi-
tecture) et même de certains ensei-
gnants. Plus de cours ; boycott des
examens d'admission et des diplômes
de juin fermement décidé ; plus de
« patrons d'atelier ».
Lundi dernier, à 22 h 15, un groupe
composé de 90 % d'architectes et de
10 % d'étudiants occupe, rue Porta-
lis, le siège du Conseil de l'Ordre.
Arrivés là, ceux qui appartenaient
composé de 90 % d'architectes et de
10 % d'étudiants occupe, rue Porta-
lis, le siège du Conseil de l'Ordre.
Arrivés là, ceux qui appartenaient
à cet Ordre ont déchiré leur carte.
Fort de sa légitimité, le Conseil
contesté a répliqué par un communi-
qué rappelant que « créé par la loi,
il ne peut être dissous que par la
loi ».
Fort de sa légitimité, le Conseil
contesté a répliqué par un communi-
qué rappelant que « créé par la loi,
il ne peut être dissous que par la
loi ».
Successivement, les conseils régio-
naux de Lyon, Toulouse, Bordeaux,
étaient également investis ; ainsi que
les Ecoles des Beaux-Arts de Mar-
seille, Lyon, Montpellier, Lille.
Suggestions. Déjà, début mars, au
groupe C (le groupe dissident des
Beaux-Arts installé au Grand-Palais),
les élèves avaient occupé l'adminis-
tration en proclamant : « Ce n'est
plus une question de demandes, mais
une question de revendications. »
Bloqué dans son bureau, le directeur
avait refusé d'appeler la police. Pour-
tant, les demandes étaient « raison-
nables ». Par exemple, pour le di-
plôme de fin d'études, les étudiants
voulaient présenter une thèse écrite
sur un sujet actuel : l'habitat vu sous
l'angle politique ou l'ordinateur et
l'architecture. Ces suggestions
n'étaient jamais acceptées. « L'admi-
nistration aurait cédé sur le dixième
de ces exigences, on n'en serait peut-
être pas là, dit un assistant. Elle
aurait préparé l'évolution au lieu de
la subir. »
naux de Lyon, Toulouse, Bordeaux,
étaient également investis ; ainsi que
les Ecoles des Beaux-Arts de Mar-
seille, Lyon, Montpellier, Lille.
Suggestions. Déjà, début mars, au
groupe C (le groupe dissident des
Beaux-Arts installé au Grand-Palais),
les élèves avaient occupé l'adminis-
tration en proclamant : « Ce n'est
plus une question de demandes, mais
une question de revendications. »
Bloqué dans son bureau, le directeur
avait refusé d'appeler la police. Pour-
tant, les demandes étaient « raison-
nables ». Par exemple, pour le di-
plôme de fin d'études, les étudiants
voulaient présenter une thèse écrite
sur un sujet actuel : l'habitat vu sous
l'angle politique ou l'ordinateur et
l'architecture. Ces suggestions
n'étaient jamais acceptées. « L'admi-
nistration aurait cédé sur le dixième
de ces exigences, on n'en serait peut-
être pas là, dit un assistant. Elle
aurait préparé l'évolution au lieu de
la subir. »
Mais, comme l'a clamé un membre
du comité de grève, jeudi dernier,
dans la cour de l'école, « les archi-
tectes savent bien qu'il faut détruire
avant de reconstruire. +
du comité de grève, jeudi dernier,
dans la cour de l'école, « les archi-
tectes savent bien qu'il faut détruire
avant de reconstruire. +
13
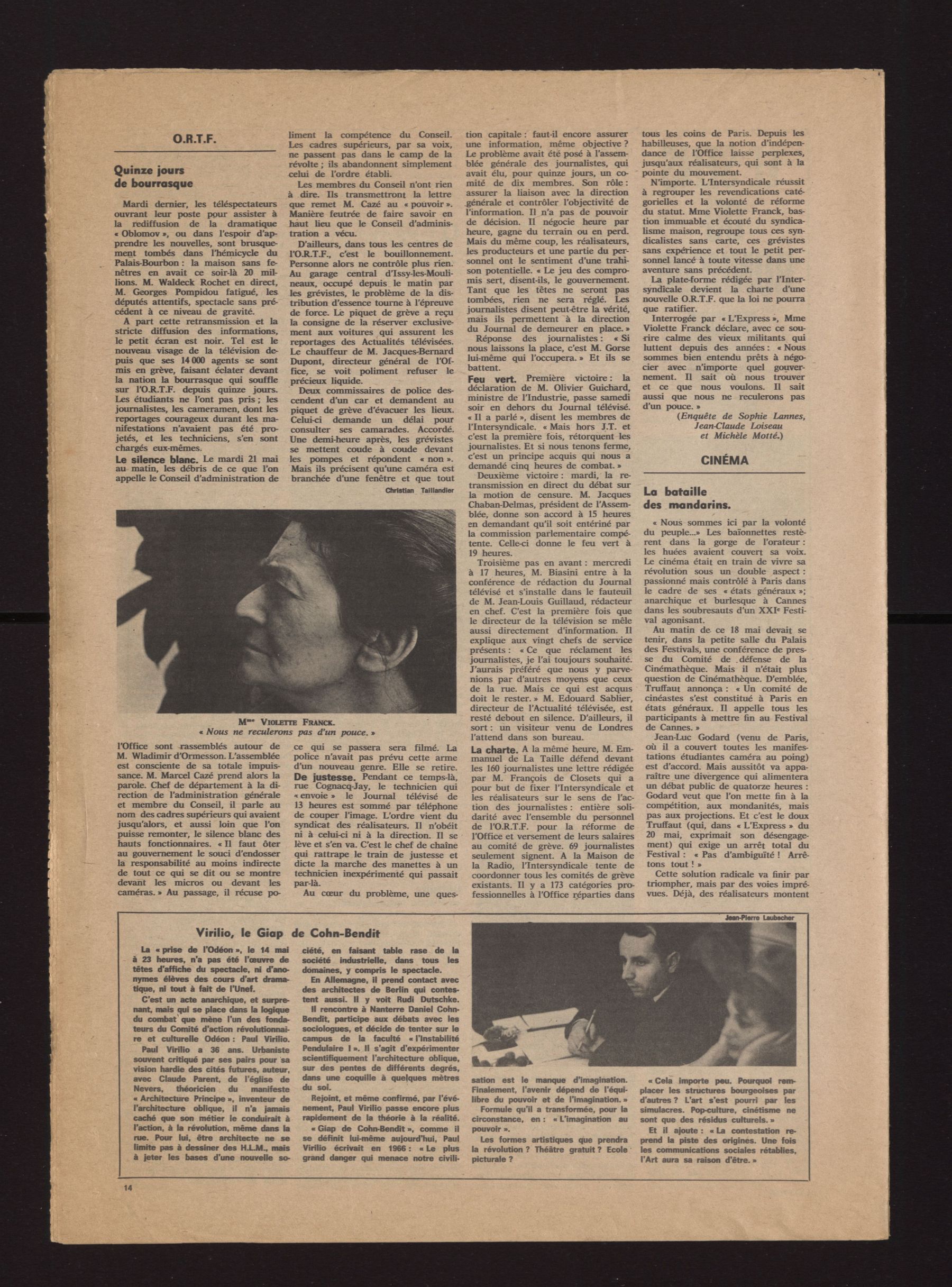

O.R.T.F.
Quinze jours
de bourrasque
de bourrasque
Mardi dernier, les téléspectateurs
ouvrant leur poste pour assister à
la rediffusion de la dramatique
« Oblomov », ou dans l'espoir d'ap-
prendre les nouvelles, sont brusque-
ment tombés dans l'hémicycle du
Palais-Bourbon : la maison sans fe-
nêtres en avait ce soir-là 20 mil-
lions. M. Waldeck Rochet en direct,
M. Georges Pompidou fatigué, les
députés attentifs, spectacle sans pré-
cédent à ce niveau de gravité.
ouvrant leur poste pour assister à
la rediffusion de la dramatique
« Oblomov », ou dans l'espoir d'ap-
prendre les nouvelles, sont brusque-
ment tombés dans l'hémicycle du
Palais-Bourbon : la maison sans fe-
nêtres en avait ce soir-là 20 mil-
lions. M. Waldeck Rochet en direct,
M. Georges Pompidou fatigué, les
députés attentifs, spectacle sans pré-
cédent à ce niveau de gravité.
A part cette retransmission et la
stricte diffusion des informations,
le petit écran est noir. Tel est le
nouveau visage de la télévision de-
puis que ses 14000 agents se sont
mis en grève, faisant éclater devant
la nation la bourrasque qui souffle
sur l'O.R.T.F. depuis quinze jours.
Les étudiants ne l'ont pas pris ; les
journalistes, les cameramen, dont les
reportages courageux durant les ma-
nifestations n'avaient pas été pro-
jetés, et les techniciens, s'en sont
chargés eux-mêmes.
stricte diffusion des informations,
le petit écran est noir. Tel est le
nouveau visage de la télévision de-
puis que ses 14000 agents se sont
mis en grève, faisant éclater devant
la nation la bourrasque qui souffle
sur l'O.R.T.F. depuis quinze jours.
Les étudiants ne l'ont pas pris ; les
journalistes, les cameramen, dont les
reportages courageux durant les ma-
nifestations n'avaient pas été pro-
jetés, et les techniciens, s'en sont
chargés eux-mêmes.
Le silence blanc. Le mardi 21 mai
au matin, les débris de ce que l'on
appelle le Conseil d'administration de
au matin, les débris de ce que l'on
appelle le Conseil d'administration de
liment la compétence du Conseil.
Les cadres supérieurs, par sa voix,
ne passent pas dans le camp de la
révolte ; ils abandonnent simplement
celui de l'ordre établi.
Les cadres supérieurs, par sa voix,
ne passent pas dans le camp de la
révolte ; ils abandonnent simplement
celui de l'ordre établi.
Les membres du Conseil n'ont rien
à dire. Ils transmettront la lettre
que remet M. Cazé au « pouvoir ».
Manière feutrée de faire savoir en
haut lieu que le Conseil d'adminis-
tration a vécu.
à dire. Ils transmettront la lettre
que remet M. Cazé au « pouvoir ».
Manière feutrée de faire savoir en
haut lieu que le Conseil d'adminis-
tration a vécu.
D'ailleurs, dans tous les centres de
l'O.R.T.F., c'est le bouillonnement.
Personne alors ne contrôle plus rien.
Au garage central d'Issy-les-Mouli-
neaux, occupé depuis le matin par
les grévistes, le problème de la dis-
tribution d'essence tourne à l'épreuve
de force. Lé piquet de grève a reçu
la consigne de la réserver exclusive-
ment aux voitures qui assurent les
reportages des Actualités télévisées.
Le chauffeur de M. Jacques-Bernard
Dupont, directeur général de l'Of-
fice, se voit poliment refuser le
précieux liquide.
l'O.R.T.F., c'est le bouillonnement.
Personne alors ne contrôle plus rien.
Au garage central d'Issy-les-Mouli-
neaux, occupé depuis le matin par
les grévistes, le problème de la dis-
tribution d'essence tourne à l'épreuve
de force. Lé piquet de grève a reçu
la consigne de la réserver exclusive-
ment aux voitures qui assurent les
reportages des Actualités télévisées.
Le chauffeur de M. Jacques-Bernard
Dupont, directeur général de l'Of-
fice, se voit poliment refuser le
précieux liquide.
Deux commissaires de police des-
cendent d'un car et demandent au
piquet de grève d'évacuer les lieux.
Celui-ci demande un délai pour
consulter ses camarades. Accordé.
Une demi-heure après, les grévistes
se mettent coude à coude devant
les pompes et répondent « non ».
Mais ils précisent qu'une caméra est
branchée d'une fenêtre et que tout
Christian Taillandier
cendent d'un car et demandent au
piquet de grève d'évacuer les lieux.
Celui-ci demande un délai pour
consulter ses camarades. Accordé.
Une demi-heure après, les grévistes
se mettent coude à coude devant
les pompes et répondent « non ».
Mais ils précisent qu'une caméra est
branchée d'une fenêtre et que tout
Christian Taillandier
M"' VIOLETTE FRANCK.
« Nous ne reculerons pas d'un pouce. »
l'Office sont rassemblés autour de
M. Wladimir d'Ormesson. L'assemblée
est consciente de sa totale impuis-
sance. M. Marcel Cazé prend alors la
parole. Chef de département à la di-
rection de l'administration générale
et membre du Conseil, il parle au
nom des cadres supérieurs qui avaient
jusqu'alors, et aussi loin que l'on
puisse remonter, le silence blanc des
hauts fonctionnaires. « II faut ôter
au gouvernement le souci d'endosser
la responsabilité au moins indirecte
de tout ce qui se dit ou se montre
devant les micros ou devant les
caméras. » Au passage, il récuse po-
M. Wladimir d'Ormesson. L'assemblée
est consciente de sa totale impuis-
sance. M. Marcel Cazé prend alors la
parole. Chef de département à la di-
rection de l'administration générale
et membre du Conseil, il parle au
nom des cadres supérieurs qui avaient
jusqu'alors, et aussi loin que l'on
puisse remonter, le silence blanc des
hauts fonctionnaires. « II faut ôter
au gouvernement le souci d'endosser
la responsabilité au moins indirecte
de tout ce qui se dit ou se montre
devant les micros ou devant les
caméras. » Au passage, il récuse po-
ce qui se passera sera filmé. La
police n'avait pas prévu cette arme
d'un nouveau genre. Elle se retire.
De justesse. Pendant ce temps-là,
rue Cognacq-Jay, le technicien qui
i envoie » le Journal télévisé de
13 heures est sommé par téléphone
de couper l'image. L'ordre vient du
syndicat des réalisateurs. Il n'obéit
ni à celui-ci ni à la direction. Il se
lève et s'en va. C'est le chef de chaîne
qui rattrape le train de justesse et
dicte la marche des manettes à un
technicien inexpérimenté qui passait
par-là.
police n'avait pas prévu cette arme
d'un nouveau genre. Elle se retire.
De justesse. Pendant ce temps-là,
rue Cognacq-Jay, le technicien qui
i envoie » le Journal télévisé de
13 heures est sommé par téléphone
de couper l'image. L'ordre vient du
syndicat des réalisateurs. Il n'obéit
ni à celui-ci ni à la direction. Il se
lève et s'en va. C'est le chef de chaîne
qui rattrape le train de justesse et
dicte la marche des manettes à un
technicien inexpérimenté qui passait
par-là.
Au cœur du problème, une ques-
tion capitale : faut-il encore assurer
une information, même objective ?
Le problème avait été posé à l'assem-
blée générale des journalistes, qui
avait élu, pour quinze jours, un co-
mité de dix membres. Son rôle :
assurer la liaison avec la direction
générale et contrôler l'objectivité de
l'information. Il n'a pas de pouvoir
de décision. Il négocie heure par
heure, gagne du terrain ou en perd.
Mais du même coup, les réalisateurs,
les producteurs et une partie du per-
sonnel ont le sentiment d'une trahi-
son potentielle. « Le jeu des compro-
mis sert, disent-ils, le gouvernement.
Tant que les têtes ne seront pas
tombées, rien ne sera réglé. Les
journalistes disent peut-être la vérité,
mais ils permettent à la direction
du Journal de demeurer en place. »
Réponse des journalistes : « Si
nous laissons la place, c'est M. Gorse
lui-même qui l'occupera. » Et ils se
battent.
une information, même objective ?
Le problème avait été posé à l'assem-
blée générale des journalistes, qui
avait élu, pour quinze jours, un co-
mité de dix membres. Son rôle :
assurer la liaison avec la direction
générale et contrôler l'objectivité de
l'information. Il n'a pas de pouvoir
de décision. Il négocie heure par
heure, gagne du terrain ou en perd.
Mais du même coup, les réalisateurs,
les producteurs et une partie du per-
sonnel ont le sentiment d'une trahi-
son potentielle. « Le jeu des compro-
mis sert, disent-ils, le gouvernement.
Tant que les têtes ne seront pas
tombées, rien ne sera réglé. Les
journalistes disent peut-être la vérité,
mais ils permettent à la direction
du Journal de demeurer en place. »
Réponse des journalistes : « Si
nous laissons la place, c'est M. Gorse
lui-même qui l'occupera. » Et ils se
battent.
Feu vert. Première victoire : la
déclaration de M. Olivier Guichard,
ministre de l'Industrie, passe samedi
soir en dehors du Journal télévisé.
« II a parlé », disent les membres de
l'Intersyndicale. « Mais hors J.T. et
c'est la première fois, rétorquent les
journalistes. Et si nous tenons ferme,
c'est un principe acquis qui nous a
demandé cinq heures de combat. »
déclaration de M. Olivier Guichard,
ministre de l'Industrie, passe samedi
soir en dehors du Journal télévisé.
« II a parlé », disent les membres de
l'Intersyndicale. « Mais hors J.T. et
c'est la première fois, rétorquent les
journalistes. Et si nous tenons ferme,
c'est un principe acquis qui nous a
demandé cinq heures de combat. »
Deuxième victoire : mardi, la re-
transmission en direct du débat sur
la motion de censure. M. Jacques
Chaban-Delmas, président de l'Assem-
blée, donne son accord à 15 heures
en demandant qu'il soit entériné par
la commission parlementaire compé-
tente. Celle-ci donne le feu vert à
19 heures.
transmission en direct du débat sur
la motion de censure. M. Jacques
Chaban-Delmas, président de l'Assem-
blée, donne son accord à 15 heures
en demandant qu'il soit entériné par
la commission parlementaire compé-
tente. Celle-ci donne le feu vert à
19 heures.
Troisième pas en avant : mercredi
à 17 heures, M. Biasini entre à la
conférence de rédaction du Journal
télévisé et s'installe dans le fauteuil
de M. Jean-Louis Guillaud, rédacteur
en chef. C'est la première fois que
le directeur de la télévision se mêle
aussi directement d'information. Il
explique aux vingt chefs de service
présents : « Ce que réclament les
journalistes, je l'ai toujours souhaité.
J'aurais préféré que nous y parve-
nions par d'autres moyens que ceux
de la rue. Mais ce qui est acquis
doit le rester. » M. Edouard Sablier,
directeur de l'Actualité télévisée, est
resté debout en silence. D'ailleurs, il
sort : un visiteur venu de Londres
l'attend dans son bureau.
La charte. A la même heure, M. Em-
manuel de La Taille défend devant
les 160 journalistes une lettre rédigée
par M. François de Closets qui a
pour but de fixer l'Intersyndicale et
les réalisateurs sur le sens de l'ac-
tion des journalistes : entière soli-
darité avec l'ensemble du personnel
de l'O.R.T.F. pour la réforme de
l'Office et versement de leurs salaires
au comité de grève. 69 journalistes
seulement signent. A la Maison de
la Radio, l'Intersyndicale tente de
coordonner tous les comités de grève
existants. Il y a 173 catégories pro-
fessionnelles à l'Office réparties dans
à 17 heures, M. Biasini entre à la
conférence de rédaction du Journal
télévisé et s'installe dans le fauteuil
de M. Jean-Louis Guillaud, rédacteur
en chef. C'est la première fois que
le directeur de la télévision se mêle
aussi directement d'information. Il
explique aux vingt chefs de service
présents : « Ce que réclament les
journalistes, je l'ai toujours souhaité.
J'aurais préféré que nous y parve-
nions par d'autres moyens que ceux
de la rue. Mais ce qui est acquis
doit le rester. » M. Edouard Sablier,
directeur de l'Actualité télévisée, est
resté debout en silence. D'ailleurs, il
sort : un visiteur venu de Londres
l'attend dans son bureau.
La charte. A la même heure, M. Em-
manuel de La Taille défend devant
les 160 journalistes une lettre rédigée
par M. François de Closets qui a
pour but de fixer l'Intersyndicale et
les réalisateurs sur le sens de l'ac-
tion des journalistes : entière soli-
darité avec l'ensemble du personnel
de l'O.R.T.F. pour la réforme de
l'Office et versement de leurs salaires
au comité de grève. 69 journalistes
seulement signent. A la Maison de
la Radio, l'Intersyndicale tente de
coordonner tous les comités de grève
existants. Il y a 173 catégories pro-
fessionnelles à l'Office réparties dans
tous les coins de Paris. Depuis les
habilleuses, que la notion d'indépen-
dance de l'Office laisse perplexes,
jusqu'aux réalisateurs, qui sont à la
pointe du mouvement.
habilleuses, que la notion d'indépen-
dance de l'Office laisse perplexes,
jusqu'aux réalisateurs, qui sont à la
pointe du mouvement.
N'importe. L'Intersyndicale réussit
à regrouper les revendications caté-
gorielles et la volonté de réforme
du statut. Mme Violette Franck, bas-
tion immuable et écouté du syndica-
lisme maison, regroupe tous ces syn-
dicalistes sans carte, ces grévistes
sans expérience et tout le petit per-
sonnel lancé à toute vitesse dans une
aventure sans précédent.
à regrouper les revendications caté-
gorielles et la volonté de réforme
du statut. Mme Violette Franck, bas-
tion immuable et écouté du syndica-
lisme maison, regroupe tous ces syn-
dicalistes sans carte, ces grévistes
sans expérience et tout le petit per-
sonnel lancé à toute vitesse dans une
aventure sans précédent.
La plate-forme rédigée par l'Inter-
syndicale devient la charte d'une
nouvelle O.R.T.F. que la loi ne pourra
que ratifier.
syndicale devient la charte d'une
nouvelle O.R.T.F. que la loi ne pourra
que ratifier.
Interrogée par « L'Express », Mme
Violette Franck déclare, avec ce sou-
rire calme des vieux militants qui
luttent depuis des années : « Nous
sommes bien entendu prêts à négo-
cier avec n'importe quel gouver-
nement. Il sait où nous trouver
et ce que nous voulons. Il sait
aussi que nous ne reculerons pas
d'un pouce. »
Violette Franck déclare, avec ce sou-
rire calme des vieux militants qui
luttent depuis des années : « Nous
sommes bien entendu prêts à négo-
cier avec n'importe quel gouver-
nement. Il sait où nous trouver
et ce que nous voulons. Il sait
aussi que nous ne reculerons pas
d'un pouce. »
(Enquête de Sophie Lannes,
Jean-Claude Loiseau
et Michèle Motte.)
Jean-Claude Loiseau
et Michèle Motte.)
CINÉMA
La bataille
des mandarins.
des mandarins.
« Nous sommes ici par la volonté
du peuple...» Les baïonnettes restè-
rent dans la gorge de l'orateur :
les huées avaient couvert sa voix.
Le cinéma était en train de vivre sa
révolution sous un double aspect :
passionné mais contrôlé à Paris dans
le cadre de ses « états généraux »;
anarchique et burlesque à Cannes
dans les soubresauts d'un XXIe Festi-
val agonisant.
du peuple...» Les baïonnettes restè-
rent dans la gorge de l'orateur :
les huées avaient couvert sa voix.
Le cinéma était en train de vivre sa
révolution sous un double aspect :
passionné mais contrôlé à Paris dans
le cadre de ses « états généraux »;
anarchique et burlesque à Cannes
dans les soubresauts d'un XXIe Festi-
val agonisant.
Au matin de ce 18 mai devait se
tenir, dans la petite salle du Palais
des Festivals, une conférence de pres-
se du Comité de .défense de la
Cinémathèque. Mais il n'était plus
question de Cinémathèque. D'emblée,
Truffaut annonça : « Un comité de
cinéastes s'est constitué à Paris en
états généraux. Il appelle tous les
participants à mettre fin au Festival
de Cannes. »
tenir, dans la petite salle du Palais
des Festivals, une conférence de pres-
se du Comité de .défense de la
Cinémathèque. Mais il n'était plus
question de Cinémathèque. D'emblée,
Truffaut annonça : « Un comité de
cinéastes s'est constitué à Paris en
états généraux. Il appelle tous les
participants à mettre fin au Festival
de Cannes. »
Jean-Luc Godard (venu de Paris,
où il a couvert toutes les manifes-
tations étudiantes caméra au poing)
est d'accord. Mais aussitôt va appa-
raître une divergence qui alimentera
un débat public de quatorze heures :
Godard veut que l'on mette fin à la
compétition, aux mondanités, mais
pas aux projections. Et c'est le doux
Truffaut (qui, dans « L'Express » du
20 mai, exprimait son désengage-
ment) qui exige un arrêt total du
Festival : « Pas d'ambiguïté ! Arrê-
tons tout ! »
où il a couvert toutes les manifes-
tations étudiantes caméra au poing)
est d'accord. Mais aussitôt va appa-
raître une divergence qui alimentera
un débat public de quatorze heures :
Godard veut que l'on mette fin à la
compétition, aux mondanités, mais
pas aux projections. Et c'est le doux
Truffaut (qui, dans « L'Express » du
20 mai, exprimait son désengage-
ment) qui exige un arrêt total du
Festival : « Pas d'ambiguïté ! Arrê-
tons tout ! »
Cette solution radicale va finir par
triompher, mais par des voies impré-
vues. Déjà, des réalisateurs montent
triompher, mais par des voies impré-
vues. Déjà, des réalisateurs montent
Jam-Piant) Laubacher
Virilio, le Giop de Cohn-Bendir
La m prise de l'Odéon », le 14 mai
à 23 heures, n'a pas été l'œuvre de
têtes d'affiche du spectacle, ni d'ano-
nymes élèves des cours d'art drama-
tique, ni tout à fait de l'Unef.
à 23 heures, n'a pas été l'œuvre de
têtes d'affiche du spectacle, ni d'ano-
nymes élèves des cours d'art drama-
tique, ni tout à fait de l'Unef.
C'est un acte anarchique, et surpre-
nant, mais qui se place dans la logique
du combat' que mène l'un des fonda-
teurs du Comité d'action révolutionnai-
re et culturelle Odéon : Paul Virilio.
nant, mais qui se place dans la logique
du combat' que mène l'un des fonda-
teurs du Comité d'action révolutionnai-
re et culturelle Odéon : Paul Virilio.
Paul Virilio a 36 ans. Urbaniste
souvent critiqué par ses pairs pour sa
vision hardie des cités futures, auteur,
avec Claude Parent, de l'église de
Nevers, théoricien du manifeste
« Architecture Principe », inventeur de
l'architecture oblique, il n'a jamais
caché que son métier le conduirait à
l'action, à la révolution, même dans la
rue. Pour lui, être architecte ne se
limite pas à dessiner des H.L.M., mais
à jeter les bases d'une nouvelle so-
souvent critiqué par ses pairs pour sa
vision hardie des cités futures, auteur,
avec Claude Parent, de l'église de
Nevers, théoricien du manifeste
« Architecture Principe », inventeur de
l'architecture oblique, il n'a jamais
caché que son métier le conduirait à
l'action, à la révolution, même dans la
rue. Pour lui, être architecte ne se
limite pas à dessiner des H.L.M., mais
à jeter les bases d'une nouvelle so-
ciété, en faisant table rase de la
société industrielle, dans tous les
domaines, y compris le spectacle.
société industrielle, dans tous les
domaines, y compris le spectacle.
En Allemagne, il prend contact avec
des architectes de Berlin qui contes-
tent aussi. Il y voit Rudi Dutschke.
des architectes de Berlin qui contes-
tent aussi. Il y voit Rudi Dutschke.
Il rencontre à Nanterre Daniel Cohn-
Bendit, participe aux débats avec les
sociologues, et décide de tenter sur le
campus de la faculté « l'Instabilité
Pendulaire I ». Il s'agit d'expérimenter
scientifiquement l'architecture oblique,
sur des pentes de différents degrés,
dans une coquille à quelques mètres
du soi.
Bendit, participe aux débats avec les
sociologues, et décide de tenter sur le
campus de la faculté « l'Instabilité
Pendulaire I ». Il s'agit d'expérimenter
scientifiquement l'architecture oblique,
sur des pentes de différents degrés,
dans une coquille à quelques mètres
du soi.
Rejoint, et même confirmé, par l'évé-
nement, Paul Vïrilio passe encore plus
rapidement de la théorie à la réalité.
nement, Paul Vïrilio passe encore plus
rapidement de la théorie à la réalité.
« Giap de Cohn-Bendit », comme il
se définit lui-même aujourd'hui, Paul
Virilio écrivait en 1966 : « Le plus
grand danger qui menace notre civili-
se définit lui-même aujourd'hui, Paul
Virilio écrivait en 1966 : « Le plus
grand danger qui menace notre civili-
sation est le manque d'imagination.
Finalement, l'avenir dépend de l'équi-
libre du pouvoir et de l'imagination. »
Finalement, l'avenir dépend de l'équi-
libre du pouvoir et de l'imagination. »
Formule qu'il a transformée, pour la
circonstance, en : « L'imagination au
pouvoir ».
circonstance, en : « L'imagination au
pouvoir ».
Les formes artistiques que prendra
la révolution ? Théâtre gratuit ? Ecole
picturale ?
la révolution ? Théâtre gratuit ? Ecole
picturale ?
« Cela importe peu. Pourquoi rem-
placer les structures bourgeoises par
d'autres ? L'art s'est pourri par les
simulacres. Pop-culture, cinètisme ne
sont que des résidus culturels. »
placer les structures bourgeoises par
d'autres ? L'art s'est pourri par les
simulacres. Pop-culture, cinètisme ne
sont que des résidus culturels. »
Et il ajoute : « La contestation re-
prend la piste des origines. Une fois
les communications sociales rétablies,
l'Art aura sa raison d'être. »
prend la piste des origines. Une fois
les communications sociales rétablies,
l'Art aura sa raison d'être. »
14
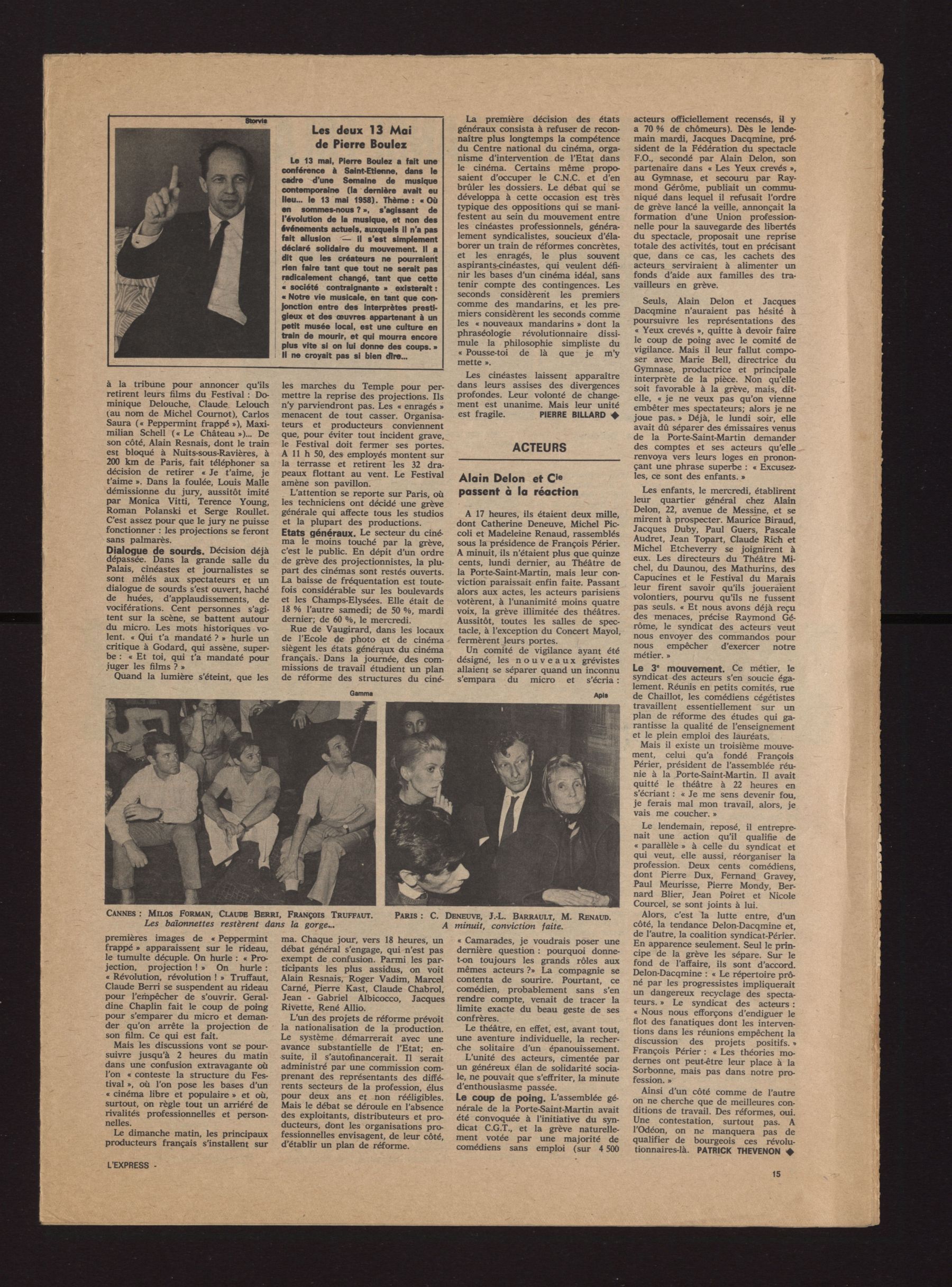

Les deux 13 Mai
de Pierre Boulez
de Pierre Boulez
Le 13 mal, Pierre Boulez a fait une
conférence à Saint-Etienne, dans le
cadre d'une Semaine de musique
contemporaine (la dernière avait eu
Heu... le 13 mai 1958). Thème: «Où
en sommes-nous ? », s'agissant de
l'évolution de la musique, et non des
événements actuels, auxquels II n'a pas
fait allusion — il s'est simplement
déclaré solidaire du mouvement. Il a
dit que les créateurs ne pourraient
rien faire tant que tout ne serait pas
radicalement changé, tant que cette
« société contraignante » existerait :
« Notre vie musicale, en tant que con-
jonction entre des interprètes presti-
gieux et des œuvres appartenant à un
petit musée local, est une culture en
train de mourir, et qui mourra encore
plus vite si on lui donne des coups. >
II ne croyait pas si bien dire...
conférence à Saint-Etienne, dans le
cadre d'une Semaine de musique
contemporaine (la dernière avait eu
Heu... le 13 mai 1958). Thème: «Où
en sommes-nous ? », s'agissant de
l'évolution de la musique, et non des
événements actuels, auxquels II n'a pas
fait allusion — il s'est simplement
déclaré solidaire du mouvement. Il a
dit que les créateurs ne pourraient
rien faire tant que tout ne serait pas
radicalement changé, tant que cette
« société contraignante » existerait :
« Notre vie musicale, en tant que con-
jonction entre des interprètes presti-
gieux et des œuvres appartenant à un
petit musée local, est une culture en
train de mourir, et qui mourra encore
plus vite si on lui donne des coups. >
II ne croyait pas si bien dire...
à la tribune pour annoncer qu'ils
retirent leurs films du Festival : Do-
minique Delouche, Claude Lelouch
(au nom de Michel Cournot), Carlos
Saura (« Peppermint frappé »), Maxi-
milian Schell («Le Château»)... De
son côté, Alain Resnais, dont le train
est bloqué à Nuits-sous-Ravières, à
200 km de Paris, fait téléphoner sa
décision de retirer « Je t'aime, je
t'aime ». Dans la foulée, Louis Malle
démissionne du jury, aussitôt imité
par Monica Vitti, Terence Young,
Roman Polanski et Serge Roullet.
C'est assez pour que le jury ne puisse
fonctionner : les projections se feront
sans palmarès.
retirent leurs films du Festival : Do-
minique Delouche, Claude Lelouch
(au nom de Michel Cournot), Carlos
Saura (« Peppermint frappé »), Maxi-
milian Schell («Le Château»)... De
son côté, Alain Resnais, dont le train
est bloqué à Nuits-sous-Ravières, à
200 km de Paris, fait téléphoner sa
décision de retirer « Je t'aime, je
t'aime ». Dans la foulée, Louis Malle
démissionne du jury, aussitôt imité
par Monica Vitti, Terence Young,
Roman Polanski et Serge Roullet.
C'est assez pour que le jury ne puisse
fonctionner : les projections se feront
sans palmarès.
Dialogue de sourds. Décision déjà
dépassée. Dans la grande salle du
Palais, cinéastes et journalistes se
sont mêlés aux spectateurs et un
dialogue de sourds s'est ouvert, haché
de huées, d'applaudissements, de
vociférations. Cent personnes s'agi-
tent sur la scène, se battent autour
du micro. Les mots historiques vo-
lent. « Qui t'a mandaté ? » hurle un
critique à Godard, qui assène, super-
be : « Et toi, qui t'a mandaté pour
juger les films ? »
Quand la lumière s'éteint, que les
dépassée. Dans la grande salle du
Palais, cinéastes et journalistes se
sont mêlés aux spectateurs et un
dialogue de sourds s'est ouvert, haché
de huées, d'applaudissements, de
vociférations. Cent personnes s'agi-
tent sur la scène, se battent autour
du micro. Les mots historiques vo-
lent. « Qui t'a mandaté ? » hurle un
critique à Godard, qui assène, super-
be : « Et toi, qui t'a mandaté pour
juger les films ? »
Quand la lumière s'éteint, que les
les marches du Temple pour per-
mettre la reprise des projections. Ils
n'y parviendront pas. Les « enragés »
menacent de tout casser. Organisa-
teurs et producteurs conviennent
que, pour éviter tout incident grave,
le Festival doit fermer ses portes.
A 11 h 50, des employés montent sur
la terrasse et retirent les 32 dra-
peaux flottant au vent. Le Festival
amène son pavillon.
mettre la reprise des projections. Ils
n'y parviendront pas. Les « enragés »
menacent de tout casser. Organisa-
teurs et producteurs conviennent
que, pour éviter tout incident grave,
le Festival doit fermer ses portes.
A 11 h 50, des employés montent sur
la terrasse et retirent les 32 dra-
peaux flottant au vent. Le Festival
amène son pavillon.
L'attention se reporte sur Paris, où
les techniciens ont décidé une grève
générale qui affecte tous les studios
et la plupart des productions.
Etats généraux. Le secteur du ciné-
ma le moins touché par la grève,
c'est le public. En dépit d'un ordre
de grève des projectionnistes, la plu-
part des cinémas sont restés ouverts.
La baisse de fréquentation est toute-
fois considérable sur les boulevards
et les Champs-Elysées. Elle était de
18 % l'autre samedi; de 50 %, mardi
dernier; de 60 %, le mercredi.
les techniciens ont décidé une grève
générale qui affecte tous les studios
et la plupart des productions.
Etats généraux. Le secteur du ciné-
ma le moins touché par la grève,
c'est le public. En dépit d'un ordre
de grève des projectionnistes, la plu-
part des cinémas sont restés ouverts.
La baisse de fréquentation est toute-
fois considérable sur les boulevards
et les Champs-Elysées. Elle était de
18 % l'autre samedi; de 50 %, mardi
dernier; de 60 %, le mercredi.
Rue de Vaugirard, dans les locaux
de l'Ecole de photo et de cinéma
siègent les états généraux du cinéma
français.- Dans la journée, des com-
missions de travail étudient un plan
de réforme des structures du ciné-
Gamma
de l'Ecole de photo et de cinéma
siègent les états généraux du cinéma
français.- Dans la journée, des com-
missions de travail étudient un plan
de réforme des structures du ciné-
Gamma
La première décision des états
généraux consista à refuser de recon-
naître plus longtemps la compétence
du Centre national du cinéma, orga-
nisme d'intervention de l'Etat dans
le cinéma. Certains même propo-
saient d'occuper le C.N.C. et d'en
brûler les dossiers. Le débat qui se
développa à cette occasion est très
typique des oppositions qui se mani-
festent au sein du mouvement entre
les cinéastes professionnels, généra-
lement syndicalistes, soucieux d'éla-
borer un train de réformes concrètes,
et les enragés, le plus souvent
aspirants-cinéastes, qui veulent défi-
nir les bases d'un cinéma idéal, sans
tenir compte des contingences. Les
seconds considèrent les premiers
comme des mandarins, et les pre-
miers considèrent les seconds comme
les « nouveaux mandarins » dont la
phraséologie révolutionnaire dissi-
mule la philosophie simpliste du
« Pousse-toi de là que je m'y
mette ».
généraux consista à refuser de recon-
naître plus longtemps la compétence
du Centre national du cinéma, orga-
nisme d'intervention de l'Etat dans
le cinéma. Certains même propo-
saient d'occuper le C.N.C. et d'en
brûler les dossiers. Le débat qui se
développa à cette occasion est très
typique des oppositions qui se mani-
festent au sein du mouvement entre
les cinéastes professionnels, généra-
lement syndicalistes, soucieux d'éla-
borer un train de réformes concrètes,
et les enragés, le plus souvent
aspirants-cinéastes, qui veulent défi-
nir les bases d'un cinéma idéal, sans
tenir compte des contingences. Les
seconds considèrent les premiers
comme des mandarins, et les pre-
miers considèrent les seconds comme
les « nouveaux mandarins » dont la
phraséologie révolutionnaire dissi-
mule la philosophie simpliste du
« Pousse-toi de là que je m'y
mette ».
Les cinéastes laissent apparaître
dans leurs assises des divergences
profondes. Leur volonté de change-
ment est unanime. Mais leur unité
est fragile. PIERRE BILLARD •
dans leurs assises des divergences
profondes. Leur volonté de change-
ment est unanime. Mais leur unité
est fragile. PIERRE BILLARD •
ACTEURS
Alain Delon et Cie
passent à la réaction
passent à la réaction
A 17 heures, ils étaient deux mille,
dont Catherine Deneuve, Michel Pic-
coli et Madeleine Renaud, rassemblés
sous la présidence de François Périer.
A minuit, ils n'étaient plus que quinze
cents, lundi dernier, au Théâtre de
la Porte-Saint-Martin, mais leur con-
viction paraissait enfin faite. Passant
alors aux actes, les acteurs parisiens
votèrent, à l'unanimité moins quatre
voix, la grève illimitée des théâtres.
Aussitôt, toutes les salles de spec-
tacle, à l'exception du Concert Mayol,
fermèrent leurs portes.
dont Catherine Deneuve, Michel Pic-
coli et Madeleine Renaud, rassemblés
sous la présidence de François Périer.
A minuit, ils n'étaient plus que quinze
cents, lundi dernier, au Théâtre de
la Porte-Saint-Martin, mais leur con-
viction paraissait enfin faite. Passant
alors aux actes, les acteurs parisiens
votèrent, à l'unanimité moins quatre
voix, la grève illimitée des théâtres.
Aussitôt, toutes les salles de spec-
tacle, à l'exception du Concert Mayol,
fermèrent leurs portes.
Un comité de vigilance ayant été
désigné, les nouveaux grévistes
allaient se séparer quand un inconnu
s'empara du micro et s'écria :
désigné, les nouveaux grévistes
allaient se séparer quand un inconnu
s'empara du micro et s'écria :
Apla
CANNES : MILOS FORMAN, CLAUDE BERRI, FRANÇOIS TRUFFAUT.
Les baïonnettes restèrent dans la gorge...
Les baïonnettes restèrent dans la gorge...
PARIS : C. DENEUVE, J.-L. BARRAULT, M. RENAUD.
A minuit, conviction faite.
A minuit, conviction faite.
premières images de « Peppermint
frappé » apparaissent sur le rideau,
le tumulte décuple. On hurle : « Pro-
jection, projection ! » On hurle :
« Révolution, révolution ! » Truffaut,
Claude Berri se suspendent au rideau
pour l'empêcher de s'ouvrir. Géral-
dine Chaplin fait le coup de poing
pour s'emparer du micro et deman-
der qu'on arrête la projection de
son film. Ce qui est fait.
frappé » apparaissent sur le rideau,
le tumulte décuple. On hurle : « Pro-
jection, projection ! » On hurle :
« Révolution, révolution ! » Truffaut,
Claude Berri se suspendent au rideau
pour l'empêcher de s'ouvrir. Géral-
dine Chaplin fait le coup de poing
pour s'emparer du micro et deman-
der qu'on arrête la projection de
son film. Ce qui est fait.
Mais les discussions vont se pour-
suivre jusqu'à 2 heures du matin
dans une confusion extravagante où
l'on « conteste la structure du Fes-
tival », où l'on pose les bases d'un
« cinéma libre et populaire » et où,
surtout, on règle tout un arriéré de
rivalités professionnelles et person-
nelles.
suivre jusqu'à 2 heures du matin
dans une confusion extravagante où
l'on « conteste la structure du Fes-
tival », où l'on pose les bases d'un
« cinéma libre et populaire » et où,
surtout, on règle tout un arriéré de
rivalités professionnelles et person-
nelles.
Le dimanche matin, les principaux
producteurs français s'installent sur
producteurs français s'installent sur
ma. Chaque jour, vers 18 heures, un
débat général s'engage, qui n'est pas
exempt de confusion. Parmi les par-
ticipants les plus assidus, on voit
Alain Resnais, Roger Vadim, Marcel
Carné, Pierre Kast, Claude Chabrol,
Jean - Gabriel Albicocco, Jacques
Rivette, René Allio.
débat général s'engage, qui n'est pas
exempt de confusion. Parmi les par-
ticipants les plus assidus, on voit
Alain Resnais, Roger Vadim, Marcel
Carné, Pierre Kast, Claude Chabrol,
Jean - Gabriel Albicocco, Jacques
Rivette, René Allio.
L'un des projets de réforme prévoit
la nationalisation de la production.
Le système démarrerait avec une
avance substantielle de l'Etat; en-
suite, il s'autofinancerait. Il serait
administré par une commission com-
prenant des représentants des diffé-
rents secteurs de la profession, élus
pour deux ans et non rééligibles.
Mais le débat se déroule en l'absence
des exploitants, distributeurs et pro-
ducteurs, dont les organisations pro-
fessionnelles envisagent, de leur côté,
d'établir un plan de réforme.
la nationalisation de la production.
Le système démarrerait avec une
avance substantielle de l'Etat; en-
suite, il s'autofinancerait. Il serait
administré par une commission com-
prenant des représentants des diffé-
rents secteurs de la profession, élus
pour deux ans et non rééligibles.
Mais le débat se déroule en l'absence
des exploitants, distributeurs et pro-
ducteurs, dont les organisations pro-
fessionnelles envisagent, de leur côté,
d'établir un plan de réforme.
« Camarades, je voudrais poser une
dernière question : pourquoi donne-
t-on toujours les grands rôles aux
mêmes acteurs ?» La compagnie se
contenta de sourire. Pourtant, ce
comédien, probablement sans s'en
rendre compte, venait de tracer la
limite exacte du beau geste de ses
confrères.
dernière question : pourquoi donne-
t-on toujours les grands rôles aux
mêmes acteurs ?» La compagnie se
contenta de sourire. Pourtant, ce
comédien, probablement sans s'en
rendre compte, venait de tracer la
limite exacte du beau geste de ses
confrères.
Le théâtre, en effet, est, avant tout,
une aventure individuelle, la recher-
che solitaire d'un épanouissement.
une aventure individuelle, la recher-
che solitaire d'un épanouissement.
L'unité des acteurs, cimentée par
un généreux élan de solidarité socia-
le, ne pouvait que s'effriter, la minute
d'enthousiasme passée.
Le coup de poing. L'assemblée gé-
nérale de la Porte-Saint-Martin avait
été convoquée à l'initiative du syn-
dicat C.G.T., et la grève naturelle-
ment votée par une majorité de
comédiens sans emploi (sur 4 500
un généreux élan de solidarité socia-
le, ne pouvait que s'effriter, la minute
d'enthousiasme passée.
Le coup de poing. L'assemblée gé-
nérale de la Porte-Saint-Martin avait
été convoquée à l'initiative du syn-
dicat C.G.T., et la grève naturelle-
ment votée par une majorité de
comédiens sans emploi (sur 4 500
acteurs officiellement recensés, il y
a 70 % de chômeurs). Dès le lende-
main mardi, Jacques Dacqmine, pré-
sident de la Fédération du spectacle
F.O., secondé par Alain Delon, son
partenaire dans « Les Yeux crevés »,
au Gymnase, et secouru par Ray-
mond Gérôme, publiait un commu-
niqué dans lequel il refusait l'ordre
de grève lancé la veille, annonçait la
formation d'une Union profession-
nelle pour la sauvegarde des libertés
du spectacle, proposait une reprise
totale des activités, tout en précisant
que, dans ce cas, les cachets des
acteurs serviraient à alimenter un
fonds d'aide aux familles des tra-
vailleurs en grève.
a 70 % de chômeurs). Dès le lende-
main mardi, Jacques Dacqmine, pré-
sident de la Fédération du spectacle
F.O., secondé par Alain Delon, son
partenaire dans « Les Yeux crevés »,
au Gymnase, et secouru par Ray-
mond Gérôme, publiait un commu-
niqué dans lequel il refusait l'ordre
de grève lancé la veille, annonçait la
formation d'une Union profession-
nelle pour la sauvegarde des libertés
du spectacle, proposait une reprise
totale des activités, tout en précisant
que, dans ce cas, les cachets des
acteurs serviraient à alimenter un
fonds d'aide aux familles des tra-
vailleurs en grève.
Seuls, Alain Delon et Jacques
Dacqmine n'auraient pas hésité à
poursuivre les représentations des
« Yeux crevés », quitte à devoir faire
le coup de poing avec le comité de
vigilance. Mais il leur fallut compo-
ser avec Marie Bell, directrice du
Gymnase, productrice et principale
interprète de la pièce. Non qu'elle
soit favorable à la grève, mais, dit-
elle, « je ne veux pas qu'on vienne
embêter mes spectateurs; alors je ne
joue pas. » Déjà, le lundi soir, elle
avait dû séparer des émissaires venus
de la Porte-Saint-Martin demander
des comptes et ses acteurs qu'elle
renvoya vers leurs loges en pronon-
çant une phrase superbe : « Excusez-
les, ce sont des enfants. »
Dacqmine n'auraient pas hésité à
poursuivre les représentations des
« Yeux crevés », quitte à devoir faire
le coup de poing avec le comité de
vigilance. Mais il leur fallut compo-
ser avec Marie Bell, directrice du
Gymnase, productrice et principale
interprète de la pièce. Non qu'elle
soit favorable à la grève, mais, dit-
elle, « je ne veux pas qu'on vienne
embêter mes spectateurs; alors je ne
joue pas. » Déjà, le lundi soir, elle
avait dû séparer des émissaires venus
de la Porte-Saint-Martin demander
des comptes et ses acteurs qu'elle
renvoya vers leurs loges en pronon-
çant une phrase superbe : « Excusez-
les, ce sont des enfants. »
Les enfants, le mercredi, établirent
leur quartier général chez Alain
Delon, 22, avenue de Messine, et se
mirent à prospecter. Maurice Biraud,
Jacques Duby, Paul Guers, Pascale
Audret, Jean Topart, Claude Rich et
Michel Etcheverry se joignirent à
eux. Les directeurs du Théâtre Mi-
chel, du Daunou, des Mathurins, des
Capucines et le Festival du Marais
leur firent savoir qu'ils joueraient
volontiers, pourvu qu'ils ne fussent
pas seuls. « Et nous avons déjà reçu
des menaces, précise Raymond Gé-
rôme, le syndicat des acteurs veut
nous envoyer des commandos pour
nous empêcher d'exercer notre
métier. »
leur quartier général chez Alain
Delon, 22, avenue de Messine, et se
mirent à prospecter. Maurice Biraud,
Jacques Duby, Paul Guers, Pascale
Audret, Jean Topart, Claude Rich et
Michel Etcheverry se joignirent à
eux. Les directeurs du Théâtre Mi-
chel, du Daunou, des Mathurins, des
Capucines et le Festival du Marais
leur firent savoir qu'ils joueraient
volontiers, pourvu qu'ils ne fussent
pas seuls. « Et nous avons déjà reçu
des menaces, précise Raymond Gé-
rôme, le syndicat des acteurs veut
nous envoyer des commandos pour
nous empêcher d'exercer notre
métier. »
Le 3e mouvement. Ce métier, le
syndicat des acteurs s'en soucie éga-
lement. Réunis en petits comités, rue
de Chaillot, les comédiens cégétistes
travaillent essentiellement sur un
plan de réforme des études qui ga-
rantisse la qualité de l'enseignement
et le plein emploi des lauréats.
syndicat des acteurs s'en soucie éga-
lement. Réunis en petits comités, rue
de Chaillot, les comédiens cégétistes
travaillent essentiellement sur un
plan de réforme des études qui ga-
rantisse la qualité de l'enseignement
et le plein emploi des lauréats.
Mais il existe un troisième mouve-
ment, celui qu'a fondé François
Périer, président de l'assemblée réu-
nie à la Porte-Saint-Martin. Il avait
quitté le théâtre à 22 heures en
s'écriant : « Je me sens devenir fou,
je ferais mal mon travail, alors, je
vais me coucher. »
ment, celui qu'a fondé François
Périer, président de l'assemblée réu-
nie à la Porte-Saint-Martin. Il avait
quitté le théâtre à 22 heures en
s'écriant : « Je me sens devenir fou,
je ferais mal mon travail, alors, je
vais me coucher. »
Le lendemain, reposé, il entrepre-
nait une action qu'il qualifie de
« parallèle » à celle du syndicat et
qui veut, elle aussi, réorganiser la
profession. Deux cents comédiens,
dont Pierre Dux, Fernand Gravey,
Paul Meurisse, Pierre Mondy, Ber-
nard Blier, Jean Poiret et Nicole
Courcel, se sont joints à lui.
nait une action qu'il qualifie de
« parallèle » à celle du syndicat et
qui veut, elle aussi, réorganiser la
profession. Deux cents comédiens,
dont Pierre Dux, Fernand Gravey,
Paul Meurisse, Pierre Mondy, Ber-
nard Blier, Jean Poiret et Nicole
Courcel, se sont joints à lui.
Alors, c'est la lutte entre, d'un
côté, la tendance Delon-Dacqmine et,
de l'autre, la coalition syndicat-Périer.
En apparence seulement. Seul le prin-
cipe de la grève les sépare. Sur le
fond de l'affaire, ils sont d'accord.
Delon-Dacqmine : « Le répertoire prô-
né par les progressistes impliquerait
un dangereux recyclage des specta-
teurs. » Le syndicat des acteurs :
« Nous nous efforçons d'endiguer le
flot des fanatiques dont les interven-
tions dans les réunions empêchent la
discussion des projets positifs. »
François Périer : « Les théories mo-
dernes ont peut-être leur place à la
Sorbonne, mais pas dans notre pro-
fession. »
côté, la tendance Delon-Dacqmine et,
de l'autre, la coalition syndicat-Périer.
En apparence seulement. Seul le prin-
cipe de la grève les sépare. Sur le
fond de l'affaire, ils sont d'accord.
Delon-Dacqmine : « Le répertoire prô-
né par les progressistes impliquerait
un dangereux recyclage des specta-
teurs. » Le syndicat des acteurs :
« Nous nous efforçons d'endiguer le
flot des fanatiques dont les interven-
tions dans les réunions empêchent la
discussion des projets positifs. »
François Périer : « Les théories mo-
dernes ont peut-être leur place à la
Sorbonne, mais pas dans notre pro-
fession. »
Ainsi d'un côté comme de l'autre
on ne cherche que de meilleures con-
ditions de travail. Des réformes, oui.
Une contestation, surtout pas. A
l'Odéon, on ne manquera pas de
qualifier de bourgeois ces révolu-
tionnaires-là. PATRICK THEVENON •
on ne cherche que de meilleures con-
ditions de travail. Des réformes, oui.
Une contestation, surtout pas. A
l'Odéon, on ne manquera pas de
qualifier de bourgeois ces révolu-
tionnaires-là. PATRICK THEVENON •
L'EXPRESS -
15
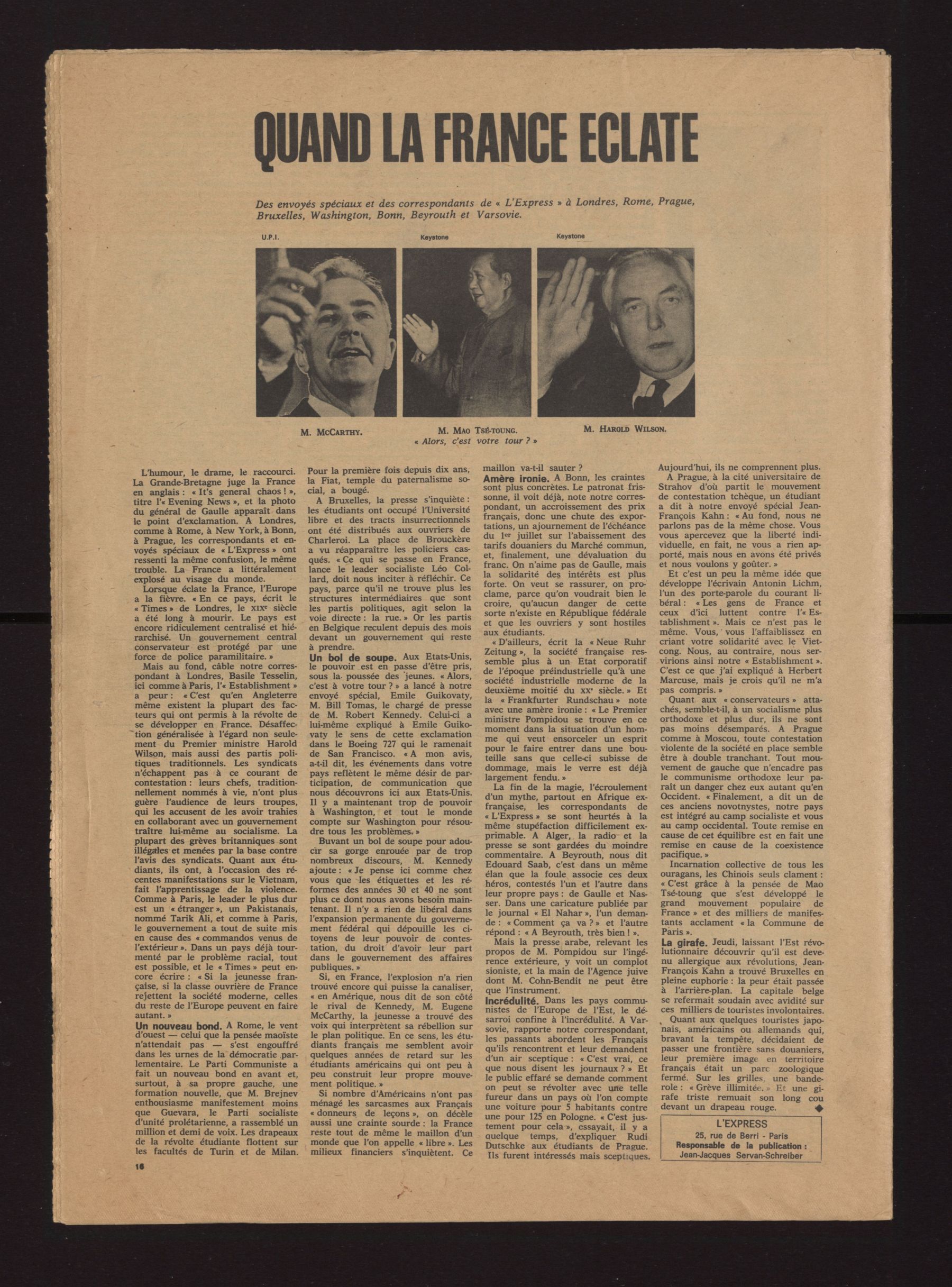

QUAND LA FRANCE ECLATE
Des envoyés spéciaux et des correspondants de « L'Express » à Londres, Rome, Prague,
Bruxelles, Washington, Bonn, Beyrouth et Varsovie.
Bruxelles, Washington, Bonn, Beyrouth et Varsovie.
U.P.I.
Keystone
Keyatone
M. MCCARTHY.
M. MAO TSÉ-TOUNG.
« Alors, c'est votre tour ? »
« Alors, c'est votre tour ? »
M. HAROLD WILSON.
L'humour, le drame, le raccourci.
La Grande-Bretagne juge la France
en anglais : « It's général chaos ! »,
titre l'« Evening News », et la photo
du général de Gaulle apparaît dans
le point d'exclamation. A Londres,
comme à Rome, à New York, à Bonn,
à Prague, les correspondants et en-
voyés spéciaux de « L'Express » ont
ressenti la même confusion, le même
trouble. La France a littéralement
explosé au visage du monde.
La Grande-Bretagne juge la France
en anglais : « It's général chaos ! »,
titre l'« Evening News », et la photo
du général de Gaulle apparaît dans
le point d'exclamation. A Londres,
comme à Rome, à New York, à Bonn,
à Prague, les correspondants et en-
voyés spéciaux de « L'Express » ont
ressenti la même confusion, le même
trouble. La France a littéralement
explosé au visage du monde.
Lorsque éclate la France, l'Europe
a la fièvre. « En ce pays, écrit le
« Times » de Londres, le xixe siècle
a été long à mourir. Le pays est
encore ridiculement centralisé et hié-
rarchisé. Un gouvernement central
conservateur est protégé par une
force de police paramilitaire. »
a la fièvre. « En ce pays, écrit le
« Times » de Londres, le xixe siècle
a été long à mourir. Le pays est
encore ridiculement centralisé et hié-
rarchisé. Un gouvernement central
conservateur est protégé par une
force de police paramilitaire. »
Mais au fond, câble notre corres-
pondant à Londres, Basile Tesselin,
ici comme à Paris, l'« Establishment »
a peur : « C'est qu'en Angleterre
même existent la plupart des fac-
teurs qui ont permis à la révolte de
se développer en France. Désaffec-
"tion généralisée à l'égard non seule-
ment du Premier ministre Harold
Wilson, mais aussi des partis poli-
tiques traditionnels. Les syndicats
n'échappent pas à ce courant de
contestation : leurs chefs, tradition-
nellement nommés à vie, n'ont plus
guère l'audience de leurs troupes,
qui les accusent de les avoir trahies
en collaborant avec un gouvernement
traître lui-même au socialisme. La
plupart des grèves britanniques sont
illégales et menées par la base contre
l'avis des syndicats. Quant aux étu-
diants, ils ont, à l'occasion des ré-
centes manifestations sur le Vietnam,
fait l'apprentissage de la violence.
Comme à Paris, le leader le plus dur
est un « étranger », un Pakistanais,
nommé Tarik Ali, et comme à Paris,
le gouvernement a tout de suite mis
en cause des « commandos venus de
l'extérieur ». Dans un pays déjà tour-
menté par le problème racial, tout
est possible, et le « Times » peut en-
core écrire : « Si la jeunesse fran-
çaise, si la classe ouvrière de France
rejettent la société moderne, celles
du reste de l'Europe peuvent en faire
autant. »
pondant à Londres, Basile Tesselin,
ici comme à Paris, l'« Establishment »
a peur : « C'est qu'en Angleterre
même existent la plupart des fac-
teurs qui ont permis à la révolte de
se développer en France. Désaffec-
"tion généralisée à l'égard non seule-
ment du Premier ministre Harold
Wilson, mais aussi des partis poli-
tiques traditionnels. Les syndicats
n'échappent pas à ce courant de
contestation : leurs chefs, tradition-
nellement nommés à vie, n'ont plus
guère l'audience de leurs troupes,
qui les accusent de les avoir trahies
en collaborant avec un gouvernement
traître lui-même au socialisme. La
plupart des grèves britanniques sont
illégales et menées par la base contre
l'avis des syndicats. Quant aux étu-
diants, ils ont, à l'occasion des ré-
centes manifestations sur le Vietnam,
fait l'apprentissage de la violence.
Comme à Paris, le leader le plus dur
est un « étranger », un Pakistanais,
nommé Tarik Ali, et comme à Paris,
le gouvernement a tout de suite mis
en cause des « commandos venus de
l'extérieur ». Dans un pays déjà tour-
menté par le problème racial, tout
est possible, et le « Times » peut en-
core écrire : « Si la jeunesse fran-
çaise, si la classe ouvrière de France
rejettent la société moderne, celles
du reste de l'Europe peuvent en faire
autant. »
Un nouveau bond. A Rome, le vent
d'ouest — celui que la pensée maoïste
n'attendait pas — s'est engouffré
dans les urnes de la démocratie par-
lementaire. Le Parti Communiste a
fait un nouveau bond en avant et,
surtout, à sa propre gauche, une
formation nouvelle, que M. Brejnev
enthousiasme manifestement moins
que Guevara, le Parti socialiste
d'unité prolétarienne, a rassemblé un
million et demi de voix. Les drapeaux
de la révolte étudiante flottent sur
les facultés de Turin et de Milan.
d'ouest — celui que la pensée maoïste
n'attendait pas — s'est engouffré
dans les urnes de la démocratie par-
lementaire. Le Parti Communiste a
fait un nouveau bond en avant et,
surtout, à sa propre gauche, une
formation nouvelle, que M. Brejnev
enthousiasme manifestement moins
que Guevara, le Parti socialiste
d'unité prolétarienne, a rassemblé un
million et demi de voix. Les drapeaux
de la révolte étudiante flottent sur
les facultés de Turin et de Milan.
16
Pour la première fois depuis dix ans,
la Fiat, temple du paternalisme so-
cial, a bougé.
la Fiat, temple du paternalisme so-
cial, a bougé.
A Bruxelles, la presse s'inquiète :
les étudiants ont occupé l'Université
libre et des tracts insurrectionnels
ont été distribués aux ouvriers de
Charleroi. La place de Brouckère
a vu réapparaître les policiers cas-
qués. « Ce qui se passe en France,
lance le leader socialiste Léo Col-
lard, doit nous inciter à réfléchir. Ce
pays, parce qu'il ne trouve plus les
structures intermédiaires que sont
les partis politiques, agit selon la
voie directe : la rue. » Or les partis
en Belgique reculent depuis des mois
devant un gouvernement qui reste
à prendre.
les étudiants ont occupé l'Université
libre et des tracts insurrectionnels
ont été distribués aux ouvriers de
Charleroi. La place de Brouckère
a vu réapparaître les policiers cas-
qués. « Ce qui se passe en France,
lance le leader socialiste Léo Col-
lard, doit nous inciter à réfléchir. Ce
pays, parce qu'il ne trouve plus les
structures intermédiaires que sont
les partis politiques, agit selon la
voie directe : la rue. » Or les partis
en Belgique reculent depuis des mois
devant un gouvernement qui reste
à prendre.
Un bol de soupe. Aux Etats-Unis,
le pouvoir est en passe d'être pris,
sous la- poussée des 'jeunes. « Alors,
c'est à votre tour ?» a lancé à notre
envoyé spécial, Emile Guikovaty,
M. Bill Tomas, le chargé de presse
de M. Robert Kennedy. Celui-ci a
lui-même expliqué à Emile Guiko-
vaty le sens de cette exclamation
dans le Boeing 727 qui le ramenait
de San Francisco. « A mon avis,
a-t-il dit, les événements dans votre
pays reflètent le même désir de par-
ticipation, de communication que
nous découvrons ici aux Etats-Unis.
Il y a maintenant trop de pouvoir
à Washington, et tout le monde
compte sur Washington pour résou-
dre tous les problèmes. »
le pouvoir est en passe d'être pris,
sous la- poussée des 'jeunes. « Alors,
c'est à votre tour ?» a lancé à notre
envoyé spécial, Emile Guikovaty,
M. Bill Tomas, le chargé de presse
de M. Robert Kennedy. Celui-ci a
lui-même expliqué à Emile Guiko-
vaty le sens de cette exclamation
dans le Boeing 727 qui le ramenait
de San Francisco. « A mon avis,
a-t-il dit, les événements dans votre
pays reflètent le même désir de par-
ticipation, de communication que
nous découvrons ici aux Etats-Unis.
Il y a maintenant trop de pouvoir
à Washington, et tout le monde
compte sur Washington pour résou-
dre tous les problèmes. »
Buvant un bol de soupe pour adou-
cir sa gorge enrouée par de trop
nombreux discours, M. Kennedy
ajoute : « Je pense ici comme chez
vous que les étiquettes et les ré-
formes des années 30 et 40 ne sont
plus ce dont nous avons besoin main-
tenant. Il n'y a rien de libéral dans
l'expansion permanente du gouverne-
ment fédéral qui dépouille les ci-
toyens de leur pouvoir de contes-
tation, du droit d'avoir leur part
dans le gouvernement des affaires
publiques. »
cir sa gorge enrouée par de trop
nombreux discours, M. Kennedy
ajoute : « Je pense ici comme chez
vous que les étiquettes et les ré-
formes des années 30 et 40 ne sont
plus ce dont nous avons besoin main-
tenant. Il n'y a rien de libéral dans
l'expansion permanente du gouverne-
ment fédéral qui dépouille les ci-
toyens de leur pouvoir de contes-
tation, du droit d'avoir leur part
dans le gouvernement des affaires
publiques. »
Si, en France, l'explosion n'a rien
trouvé encore qui puisse la canaliser,
« en Amérique, nous dit de son côté
le rival de Kennedy, M. Eugène
McCarthy, la jeunesse a trouvé des
voix qui interprètent sa rébellion sur
le plan politique. En ce sens, les étu-
diants français me semblent avoir
quelques années de retard sur les
étudiants américains qui ont peu à
peu construit leur propre mouve-
ment politique. »
trouvé encore qui puisse la canaliser,
« en Amérique, nous dit de son côté
le rival de Kennedy, M. Eugène
McCarthy, la jeunesse a trouvé des
voix qui interprètent sa rébellion sur
le plan politique. En ce sens, les étu-
diants français me semblent avoir
quelques années de retard sur les
étudiants américains qui ont peu à
peu construit leur propre mouve-
ment politique. »
Si nombre d'Américains n'ont pas
ménagé les sarcasmes aux Français
« donneurs de leçons », on décèle
aussi une crainte sourde : la France
reste tout de même le maillon d'un
monde que l'on appelle « libre ». Les
milieux financiers s'inquiètent. Ce
ménagé les sarcasmes aux Français
« donneurs de leçons », on décèle
aussi une crainte sourde : la France
reste tout de même le maillon d'un
monde que l'on appelle « libre ». Les
milieux financiers s'inquiètent. Ce
maillon va-t-il sauter ?
Arrière ironie. A Bonn, les craintes
sont plus concrètes. Le patronat fris-
sonne, il voit déjà, note notre corres-
pondant, un accroissement des prix
français, donc une chute des expor-
tations, un ajournement de l'échéance
du 1er juillet sur l'abaissement des
tarifs douaniers du Marché commun,
et, finalement, une dévaluation du
franc. On n'aime pas de Gaulle, mais
la solidarité des intérêts est plus
forte. On veut se rassurer, on pro-
clame, parce qu'on voudrait bien le
croire, qu'aucun danger de cette
sorte n'existe en République fédérale
et que les ouvriers y sont hostiles
aux étudiants.
Arrière ironie. A Bonn, les craintes
sont plus concrètes. Le patronat fris-
sonne, il voit déjà, note notre corres-
pondant, un accroissement des prix
français, donc une chute des expor-
tations, un ajournement de l'échéance
du 1er juillet sur l'abaissement des
tarifs douaniers du Marché commun,
et, finalement, une dévaluation du
franc. On n'aime pas de Gaulle, mais
la solidarité des intérêts est plus
forte. On veut se rassurer, on pro-
clame, parce qu'on voudrait bien le
croire, qu'aucun danger de cette
sorte n'existe en République fédérale
et que les ouvriers y sont hostiles
aux étudiants.
« D'ailleurs, écrit la « Neue Ruhr
Zeitung », la société française res-
semble plus à un Etat corporatif
de l'époque préindustrielle qu'à une
société industrielle moderne de la
deuxième moitié du xx€ siècle. » Et
la « Frankfurter Rundschau » note
avec une amère ironie : « Le Premier
ministre Pompidou se trouve en ce
moment dans la situation d'un hom-
me qui veut ensorceler un esprit
pour le faire entrer dans une bou-
teille sans que celle-ci subisse de
dommage, mais le verre est déjà
largement fendu. »
Zeitung », la société française res-
semble plus à un Etat corporatif
de l'époque préindustrielle qu'à une
société industrielle moderne de la
deuxième moitié du xx€ siècle. » Et
la « Frankfurter Rundschau » note
avec une amère ironie : « Le Premier
ministre Pompidou se trouve en ce
moment dans la situation d'un hom-
me qui veut ensorceler un esprit
pour le faire entrer dans une bou-
teille sans que celle-ci subisse de
dommage, mais le verre est déjà
largement fendu. »
La fin de la magie, l'écroulement
d'un mythe, partout en Afrique ex-
française, les correspondants de
« L'Express » se sont heurtés à la
même stupéfaction difficilement ex-
primable. A Alger, la radio et la
presse se sont gardées du moindre
commentaire. A Beyrouth, nous dit
Edouard Saab, c'est dans un même
élan que la foule associe ces deux
héros, contestés l'un et l'autre dans
leur propre pays : de Gaulle et Nas-
ser. Dans une caricature publiée par
le journal « El Nahar », l'un deman-
de : « Comment ça va ?» et l'autre
répond : « A Beyrouth, très bien ! ».
d'un mythe, partout en Afrique ex-
française, les correspondants de
« L'Express » se sont heurtés à la
même stupéfaction difficilement ex-
primable. A Alger, la radio et la
presse se sont gardées du moindre
commentaire. A Beyrouth, nous dit
Edouard Saab, c'est dans un même
élan que la foule associe ces deux
héros, contestés l'un et l'autre dans
leur propre pays : de Gaulle et Nas-
ser. Dans une caricature publiée par
le journal « El Nahar », l'un deman-
de : « Comment ça va ?» et l'autre
répond : « A Beyrouth, très bien ! ».
Mais la presse arabe, relevant les
propos de M. Pompidou sur l'ingé-
rence extérieure, y voit un complot
sioniste, et la main de l'Agence juive
dont M. Cohn-Bendit ne peut être
que l'instrument.
propos de M. Pompidou sur l'ingé-
rence extérieure, y voit un complot
sioniste, et la main de l'Agence juive
dont M. Cohn-Bendit ne peut être
que l'instrument.
Incrédulité. Dans les pays commu-
nistes de l'Europe de l'Est, le dé-
sarroi confine à l'incrédulité. A Var-
sovie, rapporte notre correspondant,
les passants abordent les Français
qu'ils rencontrent et leur demandent
d'un air sceptique : « C'est vrai, ce
que nous disent les journaux ?» Et
le public effaré se demande comment
on peut se révolter avec une telle
fureur dans un pays où l'on compte
une voiture pour 5 habitants contre
une pour 125 en Pologne. « C'est jus-
tement pour cela », essayait, il y a
quelque temps, d'expliquer Rudi
Dutschke aux étudiants de Prague.
Ils furent intéressés mais scepnuues.
nistes de l'Europe de l'Est, le dé-
sarroi confine à l'incrédulité. A Var-
sovie, rapporte notre correspondant,
les passants abordent les Français
qu'ils rencontrent et leur demandent
d'un air sceptique : « C'est vrai, ce
que nous disent les journaux ?» Et
le public effaré se demande comment
on peut se révolter avec une telle
fureur dans un pays où l'on compte
une voiture pour 5 habitants contre
une pour 125 en Pologne. « C'est jus-
tement pour cela », essayait, il y a
quelque temps, d'expliquer Rudi
Dutschke aux étudiants de Prague.
Ils furent intéressés mais scepnuues.
Aujourd'hui, ils ne comprennent plus.
A Prague, à la cité universitaire de
Strahov d'où partit le mouvement
de contestation tchèque, un étudiant
a dit à notre envoyé spécial Jean-
François Kahn : « Au fond, nous ne
parlons pas de la même chose. Vous
vous apercevez que la liberté indi-
viduelle, en fait, ne vous a rien ap-
porté, mais nous en avons été privés
et nous voulons y goûter. »
A Prague, à la cité universitaire de
Strahov d'où partit le mouvement
de contestation tchèque, un étudiant
a dit à notre envoyé spécial Jean-
François Kahn : « Au fond, nous ne
parlons pas de la même chose. Vous
vous apercevez que la liberté indi-
viduelle, en fait, ne vous a rien ap-
porté, mais nous en avons été privés
et nous voulons y goûter. »
Et c'est un peu la même idée que
développe l'écrivain Antonin Lichm,
l'un des porte-parole du courant li-
béral : « Les gens de France et
ceux d'ici luttent contre l'« Es-
tablishment ». Mais ce n'est pas le
même. Vous, vous l'affaiblissez en
criant votre solidarité avec le Viet-
cong. Nous, au contraire, nous ser-
virions ainsi notre « Establishment ».
C'est ce que j'ai expliqué à Herbert
Marcuse, mais je crois qu'il ne m'a
pas compris. »
développe l'écrivain Antonin Lichm,
l'un des porte-parole du courant li-
béral : « Les gens de France et
ceux d'ici luttent contre l'« Es-
tablishment ». Mais ce n'est pas le
même. Vous, vous l'affaiblissez en
criant votre solidarité avec le Viet-
cong. Nous, au contraire, nous ser-
virions ainsi notre « Establishment ».
C'est ce que j'ai expliqué à Herbert
Marcuse, mais je crois qu'il ne m'a
pas compris. »
Quant aux « conservateurs » atta-
chés, semble-t-il, à un socialisme plus
orthodoxe et plus dur, ils ne sont
pas moins désemparés. A Prague
comme à Moscou, toute contestation
violente de la société en place semble
être à double tranchant. Tout mou-
vement de gauche que n'encadre pas
le communisme orthodoxe leur pa-
raît un danger chez eux autant qu'en
Occident. « Finalement, a dit un de
ces anciens novotnystes, notre pays
est intégré au camp socialiste et vous
au camp occidental. Toute remise en
cause de cet équilibre est en fait une
remise en cause de la coexistence
pacifique. »
chés, semble-t-il, à un socialisme plus
orthodoxe et plus dur, ils ne sont
pas moins désemparés. A Prague
comme à Moscou, toute contestation
violente de la société en place semble
être à double tranchant. Tout mou-
vement de gauche que n'encadre pas
le communisme orthodoxe leur pa-
raît un danger chez eux autant qu'en
Occident. « Finalement, a dit un de
ces anciens novotnystes, notre pays
est intégré au camp socialiste et vous
au camp occidental. Toute remise en
cause de cet équilibre est en fait une
remise en cause de la coexistence
pacifique. »
Incarnation collective de tous les
ouragans, les Chinois seuls clament :
« C'est grâce à la pensée de Mao
Tsé-toung que s'est développé le
grand mouvement populaire de
France » et des milliers de manifes-
tants acclament « la Commune de
Paris ».
ouragans, les Chinois seuls clament :
« C'est grâce à la pensée de Mao
Tsé-toung que s'est développé le
grand mouvement populaire de
France » et des milliers de manifes-
tants acclament « la Commune de
Paris ».
La girafe. Jeudi, laissant l'Est révo-
lutionnaire découvrir qu'il est deve-
nu allergique aux révolutions, Jean-
François Kahn a trouvé Bruxelles en
pleine euphorie : la peur était passée
à l'arrière-plan. La capitale belge
se refermait soudain avec avidité sur
ces milliers de touristes involontaires.
lutionnaire découvrir qu'il est deve-
nu allergique aux révolutions, Jean-
François Kahn a trouvé Bruxelles en
pleine euphorie : la peur était passée
à l'arrière-plan. La capitale belge
se refermait soudain avec avidité sur
ces milliers de touristes involontaires.
Quant aux quelques touristes japo-
nais, américains ou allemands qui,
bravant la tempête, décidaient de
passer une frontière sans douaniers,
leur première imagt en territoire
français était un pan zoologique
fermé. Sur les grilles une bande-
role : « Grève illimitéi. . H* une gi-
rafe triste remuait son long cou
devant un drapeau rouge. +
nais, américains ou allemands qui,
bravant la tempête, décidaient de
passer une frontière sans douaniers,
leur première imagt en territoire
français était un pan zoologique
fermé. Sur les grilles une bande-
role : « Grève illimitéi. . H* une gi-
rafe triste remuait son long cou
devant un drapeau rouge. +
L'EXPRESS
25, rue de Berri - Paris
Responsable de la publication :
Jean-Jacques Servan-Schreiber
Category
Title
L'Express
Issue
supplement exceptionnel
Date
??
Keywords
Publication information
supplement exceptionnel