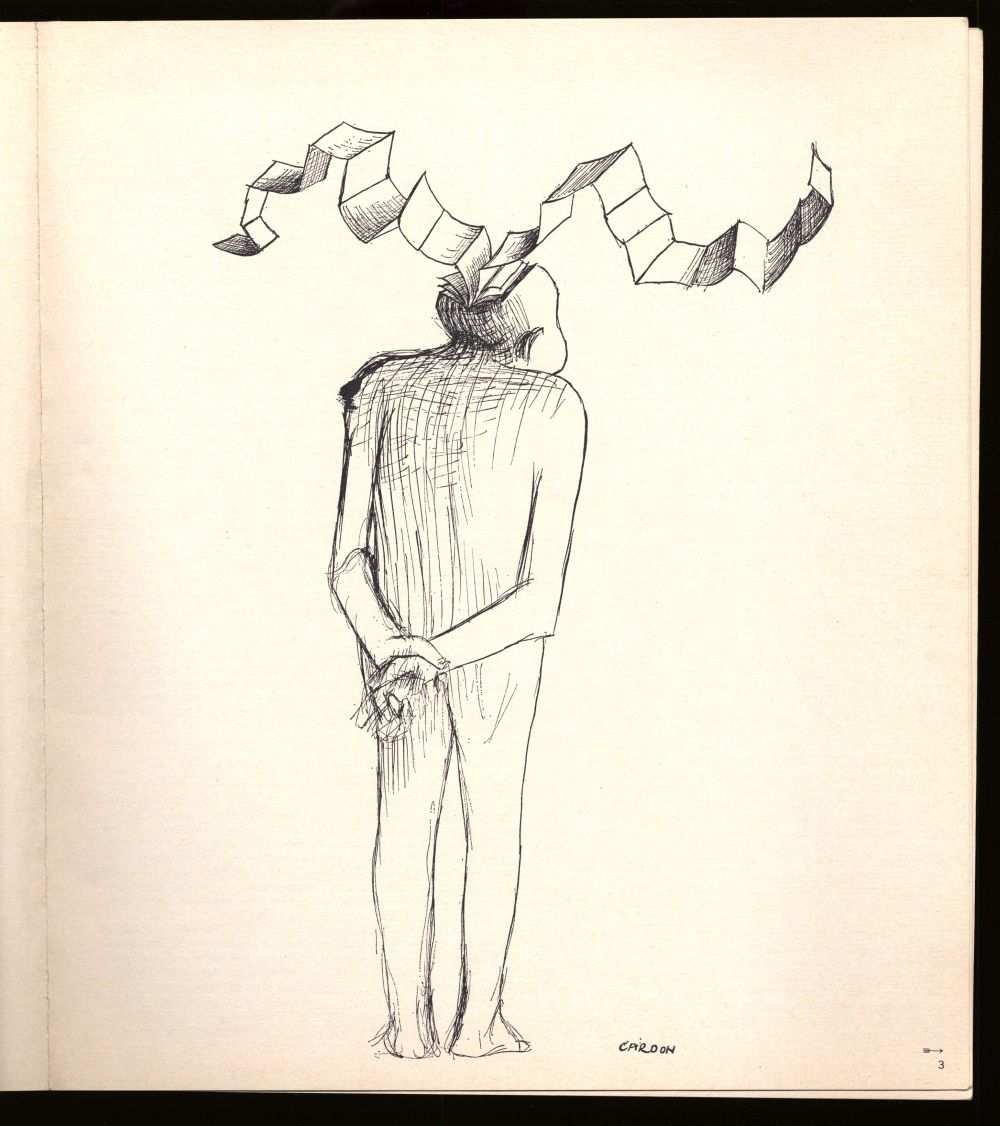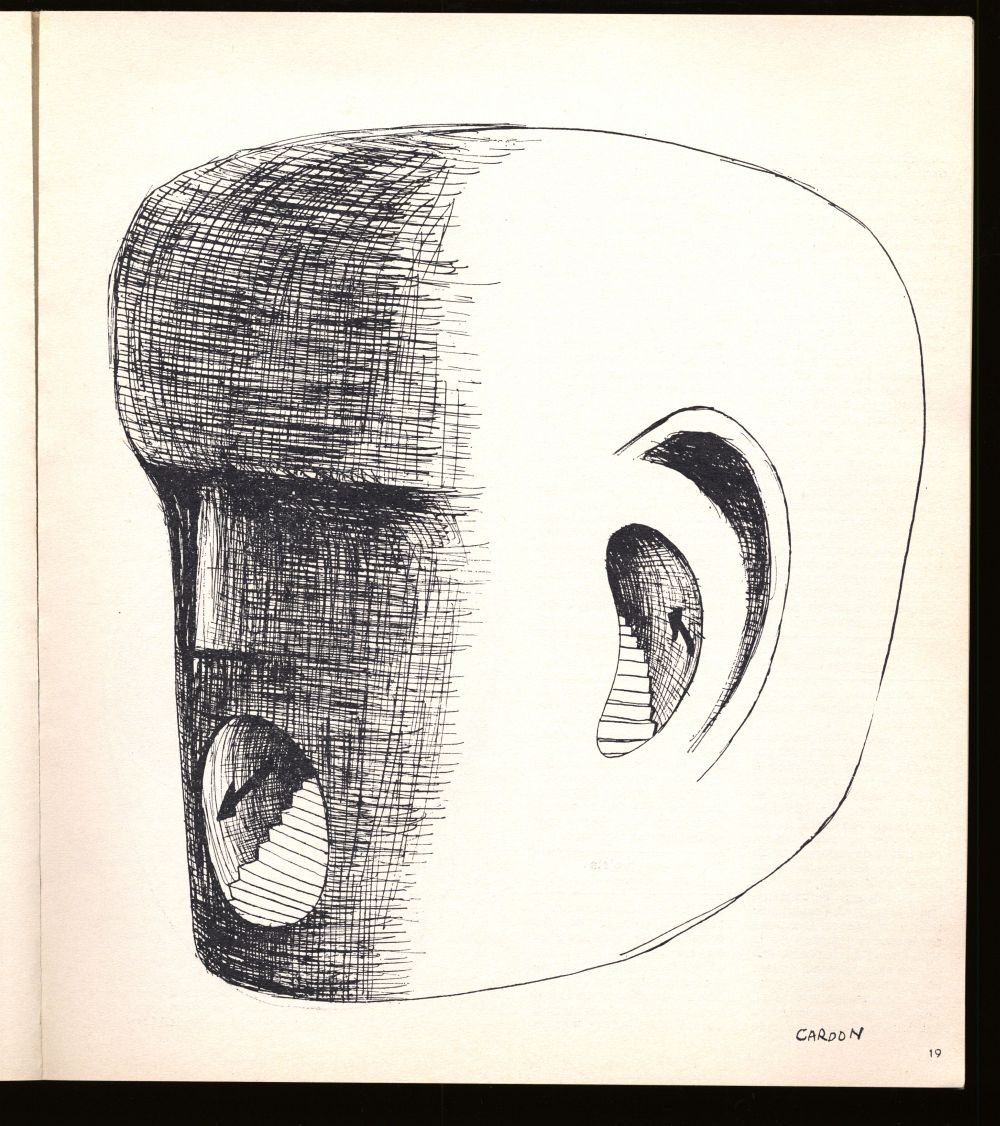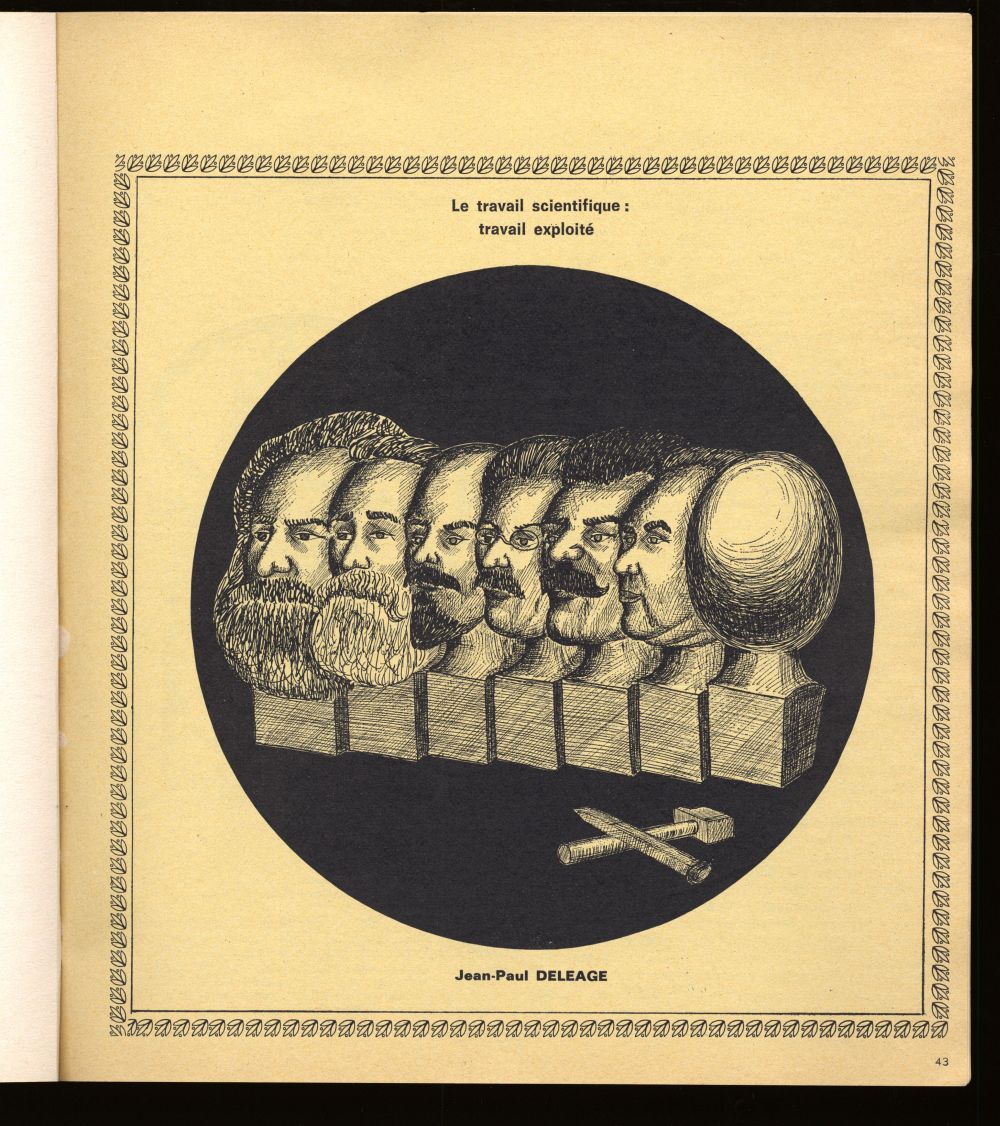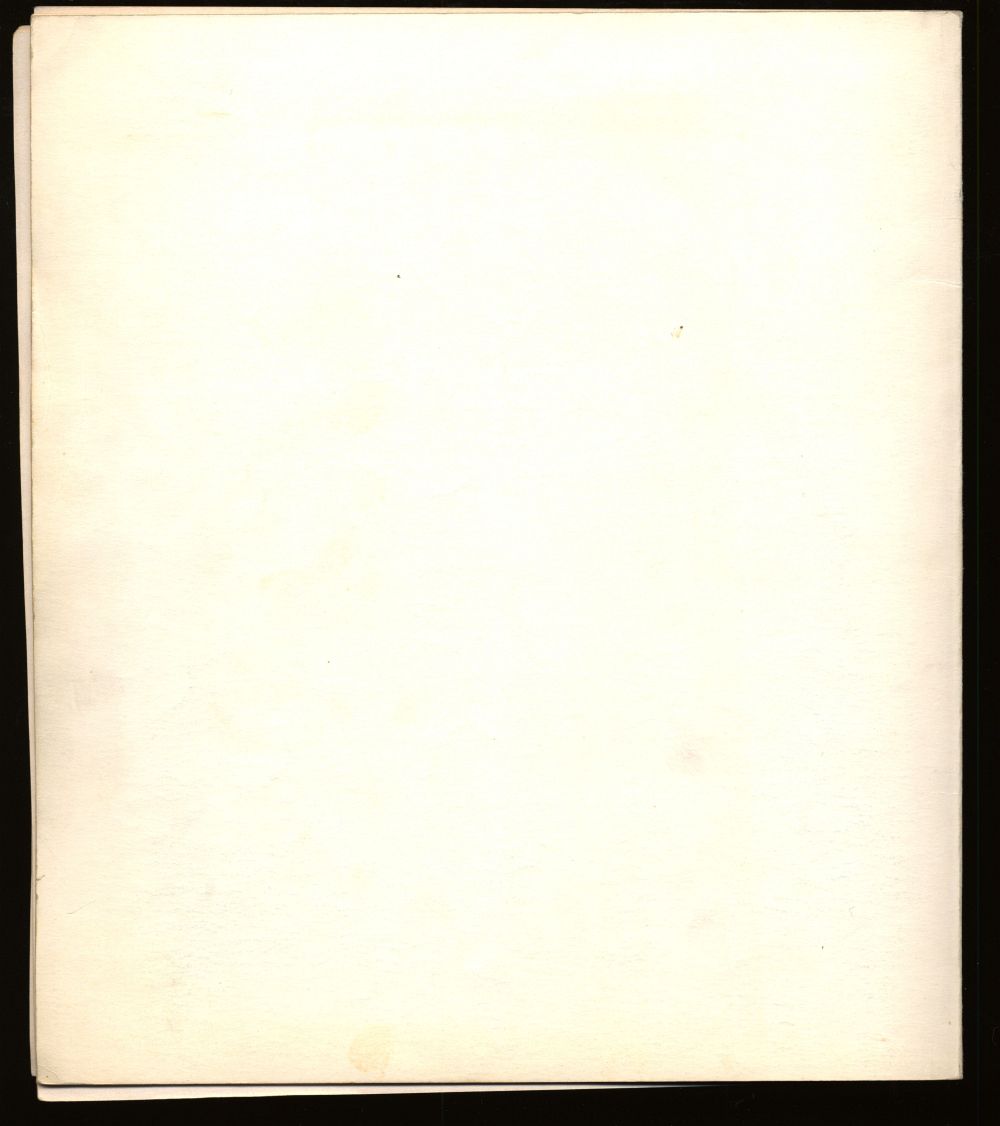Niveau 3
Thumbnail
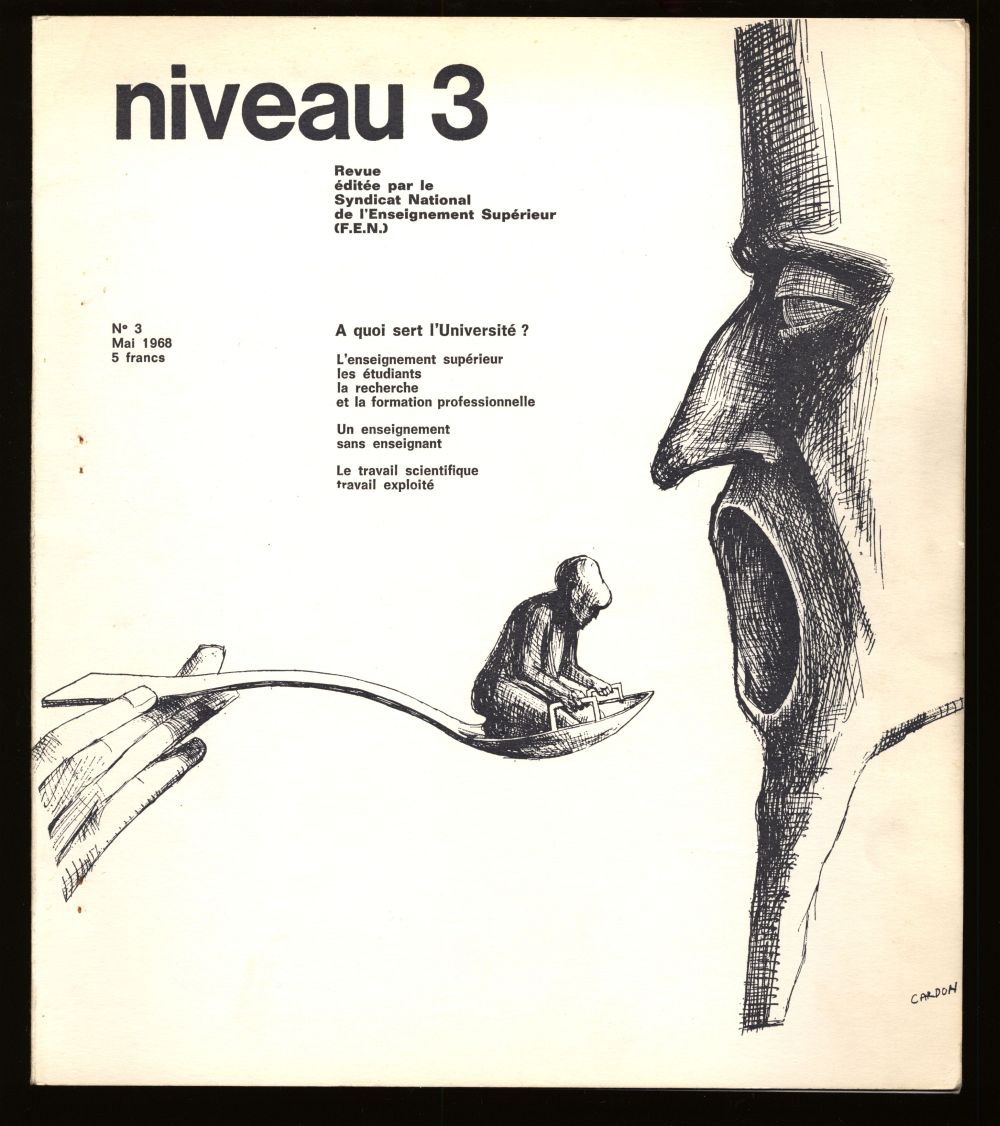

niveau 3
N° 3
Mai 1968
5 francs
5 francs
Revue
éditée par le
Syndicat National
de l'Enseignement Supérieur
(F.E.N.)
A quoi sert l'Université ?
L'enseignement supérieur
les étudiants
la recherche
et la formation professionnelle
Un enseignement
sans enseignant
sans enseignant
Le travail scientifique
travail exploité
travail exploité
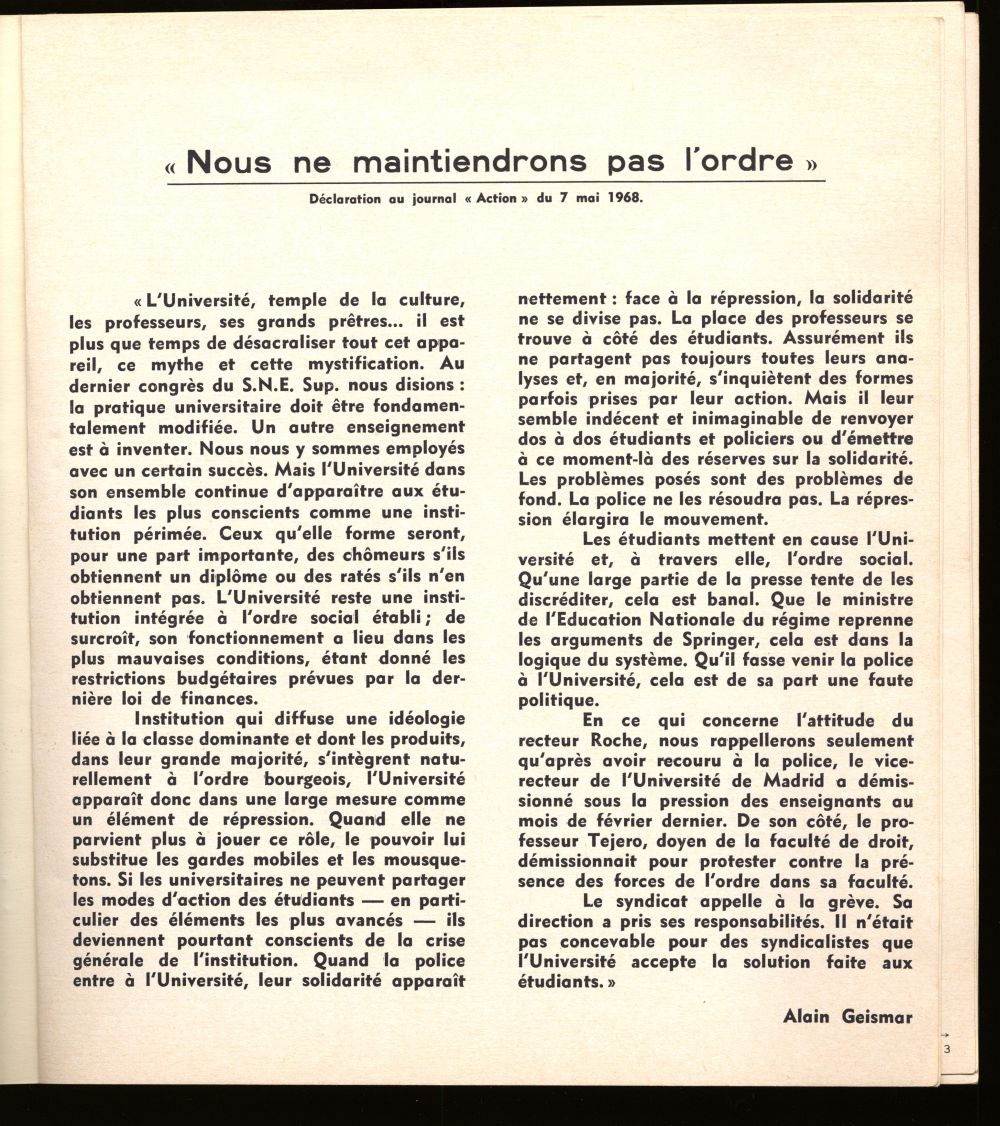

Nous ne maintiendrons pas l'ordre
Déclaration au journal «Action» du 7 mai 1968.
« L'Université, temple de la culture,
les professeurs, ses grands prêtres... il est
plus que temps de désacraliser tout cet appa-
reil, ce mythe et cette mystification. Au
dernier congrès du S.N.E. Sup. nous disions :
la pratique universitaire doit être fondamen-
talement modifiée. Un autre enseignement
est à inventer. Nous nous y sommes employés
avec un certain succès. Mais l'Université dans
son ensemble continue d'apparaître aux étu-
diants les plus conscients comme une insti-
tution périmée. Ceux qu'elle forme seront,
pour une part importante, des chômeurs s'ils
obtiennent un diplôme ou des ratés s'ils n'en
obtiennent pas. L'Université reste une insti-
tution intégrée à l'ordre social établi; de
surcroît, son fonctionnement a lieu dans les
plus mauvaises conditions, étant donné les
restrictions budgétaires prévues par la der-
nière loi de finances.
les professeurs, ses grands prêtres... il est
plus que temps de désacraliser tout cet appa-
reil, ce mythe et cette mystification. Au
dernier congrès du S.N.E. Sup. nous disions :
la pratique universitaire doit être fondamen-
talement modifiée. Un autre enseignement
est à inventer. Nous nous y sommes employés
avec un certain succès. Mais l'Université dans
son ensemble continue d'apparaître aux étu-
diants les plus conscients comme une insti-
tution périmée. Ceux qu'elle forme seront,
pour une part importante, des chômeurs s'ils
obtiennent un diplôme ou des ratés s'ils n'en
obtiennent pas. L'Université reste une insti-
tution intégrée à l'ordre social établi; de
surcroît, son fonctionnement a lieu dans les
plus mauvaises conditions, étant donné les
restrictions budgétaires prévues par la der-
nière loi de finances.
Institution qui diffuse une idéologie
liée à la classe dominante et dont les produits,
dans leur grande majorité, s'intègrent natu-
rellement à l'ordre bourgeois, l'Université
apparaît donc dans une large mesure comme
un élément de répression. Quand elle ne
parvient plus à jouer ce rôle, le pouvoir lui
substitue les gardes mobiles et les mousque-
tons. Si les universitaires ne peuvent partager
les modes d'action des étudiants — en parti-
culier des éléments les plus avancés — ils
deviennent pourtant conscients de la crise
générale de l'institution. Quand la police
entre à l'Université, leur solidarité apparaît
liée à la classe dominante et dont les produits,
dans leur grande majorité, s'intègrent natu-
rellement à l'ordre bourgeois, l'Université
apparaît donc dans une large mesure comme
un élément de répression. Quand elle ne
parvient plus à jouer ce rôle, le pouvoir lui
substitue les gardes mobiles et les mousque-
tons. Si les universitaires ne peuvent partager
les modes d'action des étudiants — en parti-
culier des éléments les plus avancés — ils
deviennent pourtant conscients de la crise
générale de l'institution. Quand la police
entre à l'Université, leur solidarité apparaît
nettement : face à la répression, la solidarité
ne se divise pas. La place des professeurs se
trouve à côté des étudiants. Assurément ils
ne partagent pas toujours toutes leurs ana-
lyses et, en majorité, s'inquiètent des formes
parfois prises par leur action. Mais il leur
semble indécent et inimaginable de renvoyer
dos à dos étudiants et policiers ou d'émettre
à ce moment-là des réserves sur la solidarité.
Les problèmes posés sont des problèmes de
fond. La police ne les résoudra pas. La répres-
sion élargira le mouvement.
ne se divise pas. La place des professeurs se
trouve à côté des étudiants. Assurément ils
ne partagent pas toujours toutes leurs ana-
lyses et, en majorité, s'inquiètent des formes
parfois prises par leur action. Mais il leur
semble indécent et inimaginable de renvoyer
dos à dos étudiants et policiers ou d'émettre
à ce moment-là des réserves sur la solidarité.
Les problèmes posés sont des problèmes de
fond. La police ne les résoudra pas. La répres-
sion élargira le mouvement.
Les étudiants mettent en cause l'Uni-
versité et, à travers elle, l'ordre social.
Qu'une large partie de la presse tente de les
discréditer, cela est banal. Que le ministre
de l'Education Nationale du régime reprenne
les arguments de Springer, cela est dans la
logique du système. Qu'il fasse venir la police
à l'Université, cela est de sa part une faute
politique.
versité et, à travers elle, l'ordre social.
Qu'une large partie de la presse tente de les
discréditer, cela est banal. Que le ministre
de l'Education Nationale du régime reprenne
les arguments de Springer, cela est dans la
logique du système. Qu'il fasse venir la police
à l'Université, cela est de sa part une faute
politique.
En ce qui concerne l'attitude du
recteur Roche, nous rappellerons seulement
qu'après avoir recouru à la police, le vice-
recteur de l'Université de Madrid a démis-
sionné sous la pression des enseignants au
mois de février dernier. De son côté, le pro-
fesseur Tejero, doyen de la faculté de droit,
démissionnait pour protester contre la pré-
sence des forces de l'ordre dans sa faculté.
recteur Roche, nous rappellerons seulement
qu'après avoir recouru à la police, le vice-
recteur de l'Université de Madrid a démis-
sionné sous la pression des enseignants au
mois de février dernier. De son côté, le pro-
fesseur Tejero, doyen de la faculté de droit,
démissionnait pour protester contre la pré-
sence des forces de l'ordre dans sa faculté.
Le syndicat appelle à la grève. Sa
direction a pris ses responsabilités. Il n'était
pas concevable pour des syndicalistes que
l'Université accepte la solution faite aux
étudiants. »
direction a pris ses responsabilités. Il n'était
pas concevable pour des syndicalistes que
l'Université accepte la solution faite aux
étudiants. »
Alain Geismar
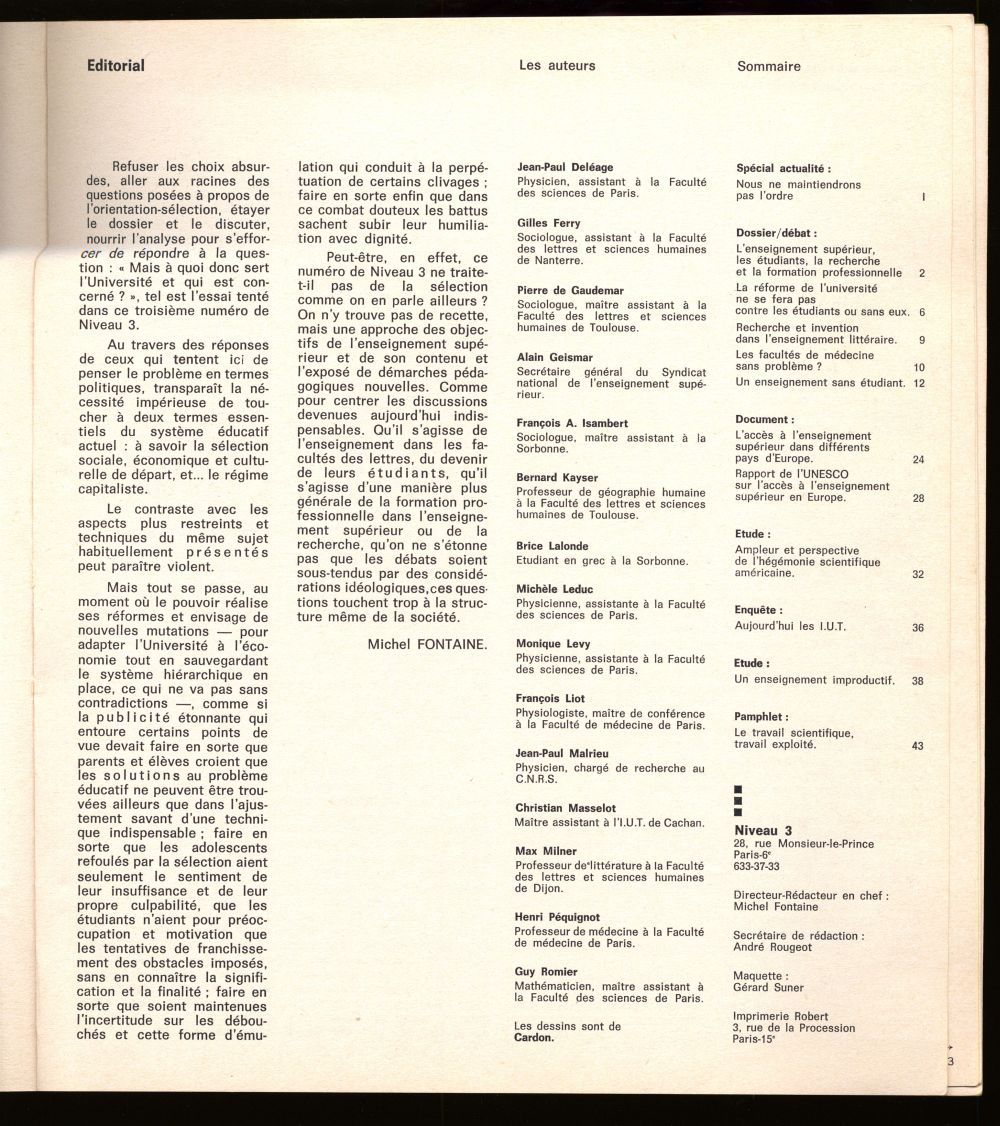

Editorial
Les auteurs
Sommaire
Refuser les choix absur-
des, aller aux racines des
questions posées à propos de
l'orientation-sélection, étayer
le dossier et le discuter,
nourrir l'analyse pour s'effor-
cer de répondre à la ques-
tion : « Mais à quoi donc sert
l'Université et qui est con-
cerné ? », tel est l'essai tenté
dans ce troisième numéro de
Niveau 3.
des, aller aux racines des
questions posées à propos de
l'orientation-sélection, étayer
le dossier et le discuter,
nourrir l'analyse pour s'effor-
cer de répondre à la ques-
tion : « Mais à quoi donc sert
l'Université et qui est con-
cerné ? », tel est l'essai tenté
dans ce troisième numéro de
Niveau 3.
Au travers des réponses
de ceux qui tentent ici de
penser le problème en termes
politiques, transparaît la né-
cessité impérieuse de tou-
cher à deux termes essen-
tiels du système éducatif
actuel : à savoir la sélection
sociale, économique et cultu-
relle de départ, et... le régime
capitaliste.
de ceux qui tentent ici de
penser le problème en termes
politiques, transparaît la né-
cessité impérieuse de tou-
cher à deux termes essen-
tiels du système éducatif
actuel : à savoir la sélection
sociale, économique et cultu-
relle de départ, et... le régime
capitaliste.
Le contraste avec les
aspects plus restreints et
techniques du même sujet
habituellement présentés
peut paraître violent.
aspects plus restreints et
techniques du même sujet
habituellement présentés
peut paraître violent.
Mais tout se passe, au
moment où le pouvoir réalise
ses réformes et envisage de
nouvelles mutations — pour
adapter l'Université à l'éco-
nomie tout en sauvegardant
le système hiérarchique en
place, ce qui ne va pas sans
contradictions —, comme si
la publicité étonnante qui
entoure certains points de
vue devait faire en sorte que
parents et élèves croient que
les solutions au problème
éducatif ne peuvent être trou-
vées ailleurs que dans l'ajus-
tement savant d'une techni-
que indispensable ; faire en
sorte que les adolescents
refoulés par la sélection aient
seulement le sentiment de
leur insuffisance et de leur
propre culpabilité, que les
étudiants n'aient pour préoc-
cupation et motivation que
les tentatives de franchisse-
ment des obstacles imposés,
sans en connaître la signifi-
cation et la finalité ; faire en
sorte que soient maintenues
l'incertitude sur les débou-
chés et cette forme d'ému-
moment où le pouvoir réalise
ses réformes et envisage de
nouvelles mutations — pour
adapter l'Université à l'éco-
nomie tout en sauvegardant
le système hiérarchique en
place, ce qui ne va pas sans
contradictions —, comme si
la publicité étonnante qui
entoure certains points de
vue devait faire en sorte que
parents et élèves croient que
les solutions au problème
éducatif ne peuvent être trou-
vées ailleurs que dans l'ajus-
tement savant d'une techni-
que indispensable ; faire en
sorte que les adolescents
refoulés par la sélection aient
seulement le sentiment de
leur insuffisance et de leur
propre culpabilité, que les
étudiants n'aient pour préoc-
cupation et motivation que
les tentatives de franchisse-
ment des obstacles imposés,
sans en connaître la signifi-
cation et la finalité ; faire en
sorte que soient maintenues
l'incertitude sur les débou-
chés et cette forme d'ému-
lation qui conduit à la perpé-
tuation de certains clivages ;
faire en sorte enfin que dans
ce combat douteux les battus
sachent subir leur humilia-
tion avec dignité.
tuation de certains clivages ;
faire en sorte enfin que dans
ce combat douteux les battus
sachent subir leur humilia-
tion avec dignité.
Peut-être, en effet, ce
numéro de Niveau 3 ne traite-
t-il pas de la sélection
comme on en parle ailleurs ?
On n'y trouve pas de recette,
mais une approche des objec-
tifs de l'enseignement supé-
rieur et de son contenu et
l'exposé de démarches péda-
gogiques nouvelles. Comme
pour centrer les discussions
devenues aujourd'hui indis-
pensables. Qu'il s'agisse de
l'enseignement dans les fa-
cultés des lettres, du devenir
de leurs étudiants, qu'il
s'agisse d'une manière plus
générale de la formation pro-
fessionnelle dans l'enseigne-
ment supérieur ou de la
recherche, qu'on ne s'étonne
pas que les débats soient
sous-tendus par des considé-
rations idéologiques,ces ques-
tions touchent trop à la struc-
ture même de la société.
numéro de Niveau 3 ne traite-
t-il pas de la sélection
comme on en parle ailleurs ?
On n'y trouve pas de recette,
mais une approche des objec-
tifs de l'enseignement supé-
rieur et de son contenu et
l'exposé de démarches péda-
gogiques nouvelles. Comme
pour centrer les discussions
devenues aujourd'hui indis-
pensables. Qu'il s'agisse de
l'enseignement dans les fa-
cultés des lettres, du devenir
de leurs étudiants, qu'il
s'agisse d'une manière plus
générale de la formation pro-
fessionnelle dans l'enseigne-
ment supérieur ou de la
recherche, qu'on ne s'étonne
pas que les débats soient
sous-tendus par des considé-
rations idéologiques,ces ques-
tions touchent trop à la struc-
ture même de la société.
Michel FONTAINE.
Jean-Paul Deléage
Physicien, assistant à la Faculté
des sciences de Paris.
des sciences de Paris.
Gilles Ferry
Sociologue, assistant à la Faculté
des lettres et sciences humaines
de Nanterre.
des lettres et sciences humaines
de Nanterre.
Pierre de Gaudemar
Sociologue, maître assistant à la
Faculté des lettres et sciences
humaines de Toulouse.
Faculté des lettres et sciences
humaines de Toulouse.
Alain Geismar
Secrétaire général du Syndicat
national de l'enseignement supé-
national de l'enseignement supé-
François A. Isambert
Sociologue, maître assistant à la
Sorbonne.
Sorbonne.
Bernard Kayser
Professeur de géographie humaine
à la Faculté des lettres et sciences
humaines de Toulouse.
à la Faculté des lettres et sciences
humaines de Toulouse.
Brice Lalonde
Etudiant en grec à la Sorbonne.
Michèle Leduc
Physicienne, assistante à la Faculté
des sciences de Paris.
des sciences de Paris.
Monique Levy
Physicienne, assistante à la Faculté
des sciences de Paris.
des sciences de Paris.
François Liot
Physiologiste, maître de conférence
à la Faculté de médecine de Paris.
à la Faculté de médecine de Paris.
Jean-Paul Malrieu
Physicien, chargé de recherche au
C.N.R.S.
C.N.R.S.
Christian Masselot
Maître assistant à l'I.U.T. de Cachan.
Max Milner
Professeur de'littérature à la Faculté
des lettres et sciences humaines
de Dijon.
des lettres et sciences humaines
de Dijon.
Henri Péquignot
Professeur de médecine à la Faculté
de médecine de Paris.
de médecine de Paris.
Guy Romier
Mathématicien, maître assistant à
la Faculté des sciences de Paris.
la Faculté des sciences de Paris.
Les dessins sont de
Cardon.
Cardon.
Spécial actualité :
Nous ne maintiendrons
pas l'ordre I
Dossier/débat :
L'enseignement supérieur,
les étudiants, la recherche
et la formation professionnelle 2
La réforme de l'université
ne se fera pas
contre les étudiants ou sans eux. 6
Recherche et invention
dans l'enseignement littéraire. 9
Les facultés de médecine
sans problème ? 10
Un enseignement sans étudiant. 12
Document :
L'accès à l'enseignement
supérieur dans différents
pays d'Europe.
supérieur dans différents
pays d'Europe.
Rapport de l'UNESCO
sur l'accès à l'enseignement
supérieur en Europe.
24
28
Etude :
Ampleur et perspective
de l'hégémonie scientifique
américaine. 32
de l'hégémonie scientifique
américaine. 32
Enquête :
Aujourd'hui les I.U.T.
36
Etude :
Un enseignement improductif. 38
Pamphlet :
Le travail scientifique,
travail exploité.
travail exploité.
43
Niveau 3
28, rue Monsieur-le-Prince
Paris-6e
633-37-33
Directeur-Rédacteur en chef :
Michel Fontaine
Michel Fontaine
Secrétaire de rédaction :
André Rougeot
André Rougeot
Maquette :
Gérard Suner
Gérard Suner
Imprimerie Robert
3, rue de la Procession
Paris-15'
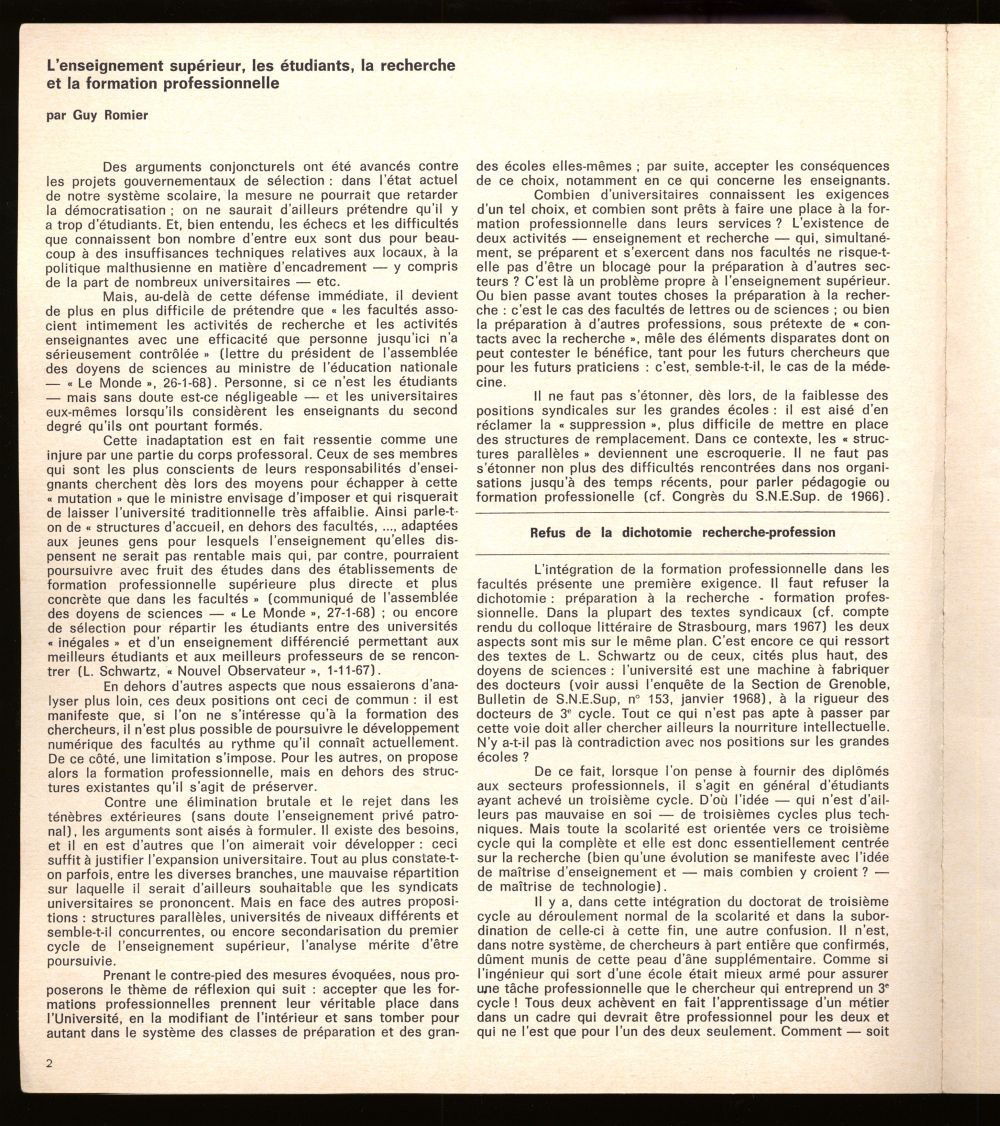

L'enseignement supérieur, les étudiants, la recherche
et la formation professionnelle
et la formation professionnelle
par Guy Romier
Des arguments conjoncturels ont été avancés contre
les projets gouvernementaux de sélection : dans l'état actuel
de notre système scolaire, la mesure ne pourrait que retarder
la démocratisation ; on ne saurait d'ailleurs prétendre qu'il y
a trop d'étudiants. Et, bien entendu, les échecs et les difficultés
que connaissent bon nombre d'entre eux sont dus pour beau-
coup à des insuffisances techniques relatives aux locaux, à la
politique malthusienne en matière d'encadrement — y compris
de la part de nombreux universitaires — etc.
les projets gouvernementaux de sélection : dans l'état actuel
de notre système scolaire, la mesure ne pourrait que retarder
la démocratisation ; on ne saurait d'ailleurs prétendre qu'il y
a trop d'étudiants. Et, bien entendu, les échecs et les difficultés
que connaissent bon nombre d'entre eux sont dus pour beau-
coup à des insuffisances techniques relatives aux locaux, à la
politique malthusienne en matière d'encadrement — y compris
de la part de nombreux universitaires — etc.
Mais, au-delà de cette défense immédiate, il devient
de plus en plus difficile de prétendre que « les facultés asso-
cient intimement les activités de recherche et les activités
enseignantes avec une efficacité que personne jusqu'ici n'a
sérieusement contrôlée » (lettre du président de l'assemblée
des doyens de sciences au ministre de l'éducation nationale
de plus en plus difficile de prétendre que « les facultés asso-
cient intimement les activités de recherche et les activités
enseignantes avec une efficacité que personne jusqu'ici n'a
sérieusement contrôlée » (lettre du président de l'assemblée
des doyens de sciences au ministre de l'éducation nationale
— « Le Monde », 26-1-68). Personne, si ce n'est les étudiants
— mais sans doute est-ce négligeable — et les universitaires
eux-mêmes lorsqu'ils considèrent les enseignants du second
degré qu'ils ont pourtant formés.
eux-mêmes lorsqu'ils considèrent les enseignants du second
degré qu'ils ont pourtant formés.
Cette inadaptation est en fait ressentie comme une
injure par une partie du corps professoral. Ceux de ses membres
qui sont les plus conscients de leurs responsabilités d'ensei-
gnants cherchent dès lors des moyens pour échapper à cette
« mutation » que le ministre envisage d'imposer et qui risquerait
de laisser l'université traditionnelle très affaiblie. Ainsi parle-t-
on de « structures d'accueil, en dehors des facultés, ..., adaptées
aux jeunes gens pour lesquels l'enseignement qu'elles dis-
pensent ne serait pas rentable mais qui, par contre, pourraient
poursuivre avec fruit des études dans des établissements de
formation professionnelle supérieure plus directe et plus
concrète que dans les facultés » (communiqué de l'assemblée
des doyens de sciences — « Le Monde », 27-1-68} ; ou encore
de sélection pour répartir les étudiants entre des universités
« inégales » et d'un enseignement différencié permettant aux
meilleurs étudiants et aux meilleurs professeurs de se rencon-
trer (L. Schwartz, « Nouvel Observateur », 1-11-67).
injure par une partie du corps professoral. Ceux de ses membres
qui sont les plus conscients de leurs responsabilités d'ensei-
gnants cherchent dès lors des moyens pour échapper à cette
« mutation » que le ministre envisage d'imposer et qui risquerait
de laisser l'université traditionnelle très affaiblie. Ainsi parle-t-
on de « structures d'accueil, en dehors des facultés, ..., adaptées
aux jeunes gens pour lesquels l'enseignement qu'elles dis-
pensent ne serait pas rentable mais qui, par contre, pourraient
poursuivre avec fruit des études dans des établissements de
formation professionnelle supérieure plus directe et plus
concrète que dans les facultés » (communiqué de l'assemblée
des doyens de sciences — « Le Monde », 27-1-68} ; ou encore
de sélection pour répartir les étudiants entre des universités
« inégales » et d'un enseignement différencié permettant aux
meilleurs étudiants et aux meilleurs professeurs de se rencon-
trer (L. Schwartz, « Nouvel Observateur », 1-11-67).
En dehors d'autres aspects que nous essaierons d'ana-
lyser plus loin, ces deux positions ont ceci de commun : il est
manifeste que, si l'on ne s'intéresse qu'à la formation des
chercheurs, il n'est plus possible de poursuivre le développement
numérique des facultés au rythme qu'il connaît actuellement.
De ce côté, une limitation s'impose. Pour les autres, on propose
alors la formation professionnelle, mais en dehors des struc-
tures existantes qu'il s'agit de préserver.
lyser plus loin, ces deux positions ont ceci de commun : il est
manifeste que, si l'on ne s'intéresse qu'à la formation des
chercheurs, il n'est plus possible de poursuivre le développement
numérique des facultés au rythme qu'il connaît actuellement.
De ce côté, une limitation s'impose. Pour les autres, on propose
alors la formation professionnelle, mais en dehors des struc-
tures existantes qu'il s'agit de préserver.
Contre une élimination brutale et le rejet dans les
ténèbres extérieures (sans doute l'enseignement privé patro-
nal), les arguments sont aisés à formuler. Il existe des besoins,
et il en est d'autres que l'on aimerait voir développer : ceci
suffit à justifier l'expansion universitaire. Tout au plus constate-t-
on parfois, entre les diverses branches, une mauvaise répartition
sur laquelle il serait d'ailleurs souhaitable que les syndicats
universitaires se prononcent. Mais en face des autres proposi-
tions : structures parallèles, universités de niveaux différents et
semble-t-il concurrentes, ou encore secondarisation du premier
cycle de l'enseignement supérieur, l'analyse mérite d'être
poursuivie.
ténèbres extérieures (sans doute l'enseignement privé patro-
nal), les arguments sont aisés à formuler. Il existe des besoins,
et il en est d'autres que l'on aimerait voir développer : ceci
suffit à justifier l'expansion universitaire. Tout au plus constate-t-
on parfois, entre les diverses branches, une mauvaise répartition
sur laquelle il serait d'ailleurs souhaitable que les syndicats
universitaires se prononcent. Mais en face des autres proposi-
tions : structures parallèles, universités de niveaux différents et
semble-t-il concurrentes, ou encore secondarisation du premier
cycle de l'enseignement supérieur, l'analyse mérite d'être
poursuivie.
Prenant le contre-pied des mesures évoquées, nous pro-
poserons le thème de réflexion qui suit : accepter que les for-
mations professionnelles prennent leur véritable place dans
l'Université, en la modifiant de l'intérieur et sans tomber pour
autant dans le système des classes de préparation et des gran-
poserons le thème de réflexion qui suit : accepter que les for-
mations professionnelles prennent leur véritable place dans
l'Université, en la modifiant de l'intérieur et sans tomber pour
autant dans le système des classes de préparation et des gran-
des écoles elles-mêmes ; par suite, accepter les conséquences
de ce choix, notamment en ce qui concerne les enseignants.
de ce choix, notamment en ce qui concerne les enseignants.
Combien d'universitaires connaissent les exigences
d'un tel choix, et combien sont prêts à faire une place a la for-
mation professionnelle dans leurs services ? L'existence de
deux activités — enseignement et recherche — qui, simultané-
ment, se préparent et s'exercent dans nos facultés ne risque-t-
elle pas d'être un blocage pour la préparation à d'autres sec-
teurs ? C'est là un problème propre à l'enseignement supérieur.
Ou bien passe avant toutes choses la préparation à la recher-
che : c'est le cas des facultés de lettres ou de sciences ; ou bien
la préparation à d'autres professions, sous prétexte de « con-
tacts avec la recherche », mêle des éléments disparates dont on
peut contester le bénéfice, tant pour les futurs chercheurs que
pour les futurs praticiens : c'est, semble-t-il, le cas de la méde-
cine.
d'un tel choix, et combien sont prêts à faire une place a la for-
mation professionnelle dans leurs services ? L'existence de
deux activités — enseignement et recherche — qui, simultané-
ment, se préparent et s'exercent dans nos facultés ne risque-t-
elle pas d'être un blocage pour la préparation à d'autres sec-
teurs ? C'est là un problème propre à l'enseignement supérieur.
Ou bien passe avant toutes choses la préparation à la recher-
che : c'est le cas des facultés de lettres ou de sciences ; ou bien
la préparation à d'autres professions, sous prétexte de « con-
tacts avec la recherche », mêle des éléments disparates dont on
peut contester le bénéfice, tant pour les futurs chercheurs que
pour les futurs praticiens : c'est, semble-t-il, le cas de la méde-
cine.
Il ne faut pas s'étonner, dès lors, de la faiblesse des
positions syndicales sur les grandes écoles : il est aisé d'en
réclamer la « suppression », plus difficile de mettre en place
des structures de remplacement. Dans ce contexte, les « struc-
tures parallèles » deviennent une escroquerie. Il ne faut pas
s'étonner non plus des difficultés rencontrées dans nos organi-
sations jusqu'à des temps récents, pour parler pédagogie ou
formation professionelle (cf. Congrès du S.N.E.Sup. de 1966).
positions syndicales sur les grandes écoles : il est aisé d'en
réclamer la « suppression », plus difficile de mettre en place
des structures de remplacement. Dans ce contexte, les « struc-
tures parallèles » deviennent une escroquerie. Il ne faut pas
s'étonner non plus des difficultés rencontrées dans nos organi-
sations jusqu'à des temps récents, pour parler pédagogie ou
formation professionelle (cf. Congrès du S.N.E.Sup. de 1966).
Refus de la dichotomie recherche-profession
L'intégration de la formation professionnelle dans les
facultés présente une première exigence. Il faut refuser la
dichotomie : préparation à la recherche - formation profes-
sionnelle. Dans la plupart des textes syndicaux (cf. compte
rendu du colloque littéraire de Strasbourg, mars 1967) les deux
aspects sont mis sur le même plan. C'est encore ce qui ressort
des textes de L. Schwartz ou de ceux, cités plus haut, des
doyens de sciences : l'université est une machine à fabriquer
des docteurs (voir aussi l'enquête de la Section de Grenoble,
Bulletin de S.N.E.Sup, n° 153, janvier 1968), à la rigueur des
docteurs de 3U cycle. Tout ce qui n'est pas apte à passer par
cette voie doit aller chercher ailleurs la nourriture intellectuelle.
N'y a-t-il pas là contradiction avec nos positions sur les grandes
écoles ?
facultés présente une première exigence. Il faut refuser la
dichotomie : préparation à la recherche - formation profes-
sionnelle. Dans la plupart des textes syndicaux (cf. compte
rendu du colloque littéraire de Strasbourg, mars 1967) les deux
aspects sont mis sur le même plan. C'est encore ce qui ressort
des textes de L. Schwartz ou de ceux, cités plus haut, des
doyens de sciences : l'université est une machine à fabriquer
des docteurs (voir aussi l'enquête de la Section de Grenoble,
Bulletin de S.N.E.Sup, n° 153, janvier 1968), à la rigueur des
docteurs de 3U cycle. Tout ce qui n'est pas apte à passer par
cette voie doit aller chercher ailleurs la nourriture intellectuelle.
N'y a-t-il pas là contradiction avec nos positions sur les grandes
écoles ?
De ce fait, lorsque l'on pense à fournir des diplômés
aux secteurs professionnels, il s'agit en général d'étudiants
ayant achevé un troisième cycle. D'où l'idée — qui n'est d'ail-
leurs pas mauvaise en soi — de troisièmes cycles plus tech-
niques. Mais toute la scolarité est orientée vers ce troisième
cycle qui la complète et elle est donc essentiellement centrée
sur la recherche (bien qu'une évolution se manifeste avec l'idée
de maîtrise d'enseignement et — mais combien y croient ? —
de maîtrise de technologie).
aux secteurs professionnels, il s'agit en général d'étudiants
ayant achevé un troisième cycle. D'où l'idée — qui n'est d'ail-
leurs pas mauvaise en soi — de troisièmes cycles plus tech-
niques. Mais toute la scolarité est orientée vers ce troisième
cycle qui la complète et elle est donc essentiellement centrée
sur la recherche (bien qu'une évolution se manifeste avec l'idée
de maîtrise d'enseignement et — mais combien y croient ? —
de maîtrise de technologie).
Il y a, dans cette intégration du doctorat de troisième
cycle au déroulement normal de la scolarité et dans la subor-
dination de celle-ci à cette fin, une autre confusion. Il n'est,
dans notre système, de chercheurs à part entière que confirmés,
dûment munis de cette peau d'âne supplémentaire. Comme si
l'ingénieur qui sort d'une école était mieux armé pour assurer
une tâche professionnelle que le chercheur qui entreprend un 3e
cycle ! Tous deux achèvent en fait l'apprentissage d'un métier
dans un cadre qui devrait être professionnel pour les deux et
qui ne l'est que pour l'un des deux seulement. Comment — soit
cycle au déroulement normal de la scolarité et dans la subor-
dination de celle-ci à cette fin, une autre confusion. Il n'est,
dans notre système, de chercheurs à part entière que confirmés,
dûment munis de cette peau d'âne supplémentaire. Comme si
l'ingénieur qui sort d'une école était mieux armé pour assurer
une tâche professionnelle que le chercheur qui entreprend un 3e
cycle ! Tous deux achèvent en fait l'apprentissage d'un métier
dans un cadre qui devrait être professionnel pour les deux et
qui ne l'est que pour l'un des deux seulement. Comment — soit
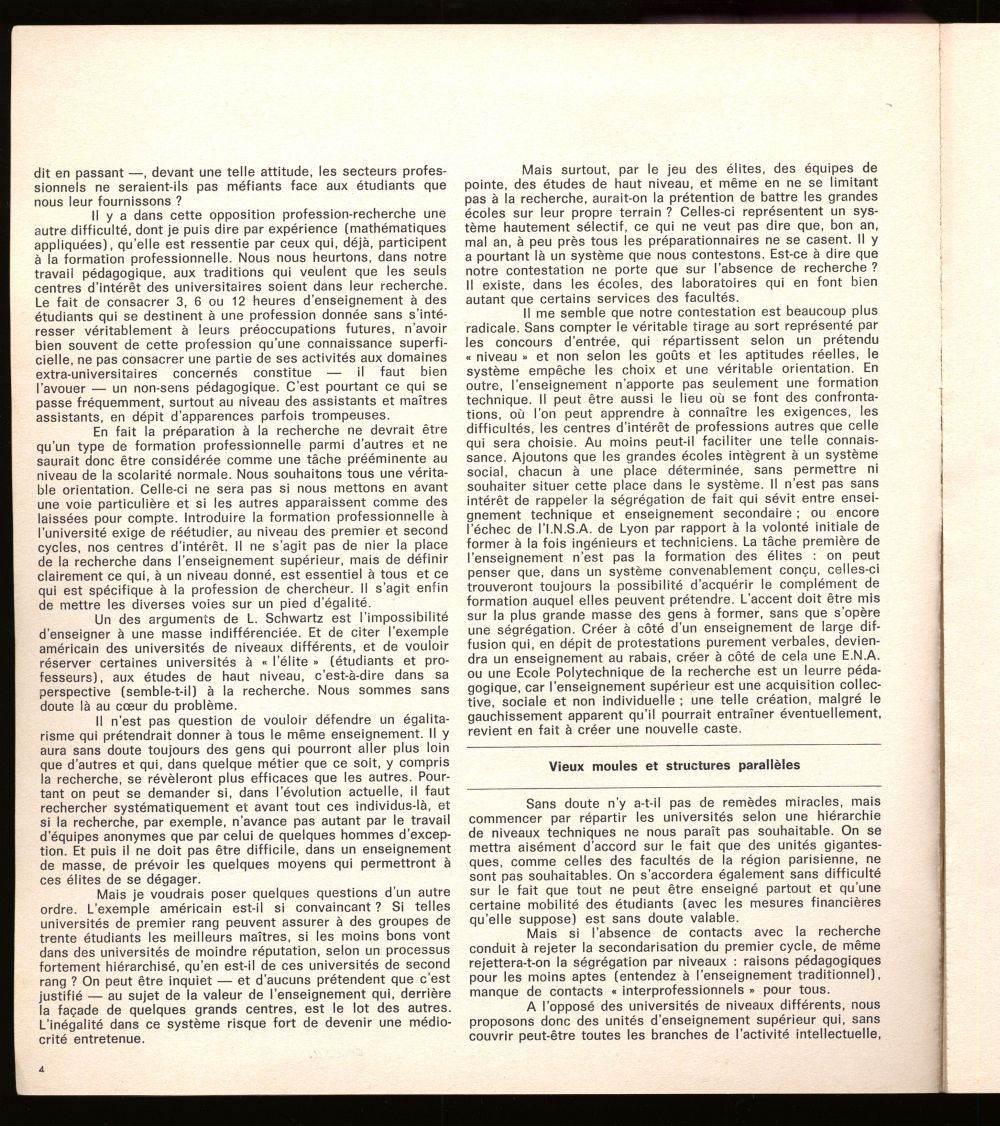

dit en passant —, devant une telle attitude, les secteurs profes-
sionnels ne seraient-ils pas méfiants face aux étudiants que
nous leur fournissons ?
sionnels ne seraient-ils pas méfiants face aux étudiants que
nous leur fournissons ?
Il y a dans cette opposition profession-recherche une
autre difficulté, dont je puis dire par expérience (mathématiques
appliquées), qu'elle est ressentie par ceux qui, déjà, participent
à la formation professionnelle. Nous nous heurtons, dans notre
travail pédagogique, aux traditions qui veulent que les seuls
centres d'intérêt des universitaires soient dans leur recherche.
Le fait de consacrer 3, 6 ou 12 heures d'enseignement à des
étudiants qui se destinent à une profession donnée sans s'inté-
resser véritablement à leurs préoccupations futures, n'avoir
bien souvent de cette profession qu'une connaissance superfi-
cielle, ne pas consacrer une partie de ses activités aux domaines
extra-universitaires concernés constitue — il faut bien
l'avouer — un non-sens pédagogique. C'est pourtant ce qui se
passe fréquemment, surtout au niveau des assistants et maîtres
assistants, en dépit d'apparences parfois trompeuses.
autre difficulté, dont je puis dire par expérience (mathématiques
appliquées), qu'elle est ressentie par ceux qui, déjà, participent
à la formation professionnelle. Nous nous heurtons, dans notre
travail pédagogique, aux traditions qui veulent que les seuls
centres d'intérêt des universitaires soient dans leur recherche.
Le fait de consacrer 3, 6 ou 12 heures d'enseignement à des
étudiants qui se destinent à une profession donnée sans s'inté-
resser véritablement à leurs préoccupations futures, n'avoir
bien souvent de cette profession qu'une connaissance superfi-
cielle, ne pas consacrer une partie de ses activités aux domaines
extra-universitaires concernés constitue — il faut bien
l'avouer — un non-sens pédagogique. C'est pourtant ce qui se
passe fréquemment, surtout au niveau des assistants et maîtres
assistants, en dépit d'apparences parfois trompeuses.
En fait la préparation à la recherche ne devrait être
qu'un type de formation professionnelle parmi d'autres et ne
saurait donc être considérée comme une tâche prééminente au
niveau de la scolarité normale. Nous souhaitons tous une vérita-
ble orientation. Celle-ci ne sera pas si nous mettons en avant
une voie particulière et si les autres apparaissent comme des
laissées pour compte. Introduire la formation professionnelle à
l'université exige de réétudier, au niveau des premier et second
cycles, nos centres d'intérêt. Il ne s'agit pas de nier la place
de la recherche dans l'enseignement supérieur, mais de définir
clairement ce qui, à un niveau donné, est essentiel à tous et ce
qui est spécifique à la profession de chercheur. H s'agit enfin
de mettre les diverses voies sur un pied d'égalité.
qu'un type de formation professionnelle parmi d'autres et ne
saurait donc être considérée comme une tâche prééminente au
niveau de la scolarité normale. Nous souhaitons tous une vérita-
ble orientation. Celle-ci ne sera pas si nous mettons en avant
une voie particulière et si les autres apparaissent comme des
laissées pour compte. Introduire la formation professionnelle à
l'université exige de réétudier, au niveau des premier et second
cycles, nos centres d'intérêt. Il ne s'agit pas de nier la place
de la recherche dans l'enseignement supérieur, mais de définir
clairement ce qui, à un niveau donné, est essentiel à tous et ce
qui est spécifique à la profession de chercheur. H s'agit enfin
de mettre les diverses voies sur un pied d'égalité.
Un des arguments de L. Schwartz est l'impossibilité
d'enseigner à une masse indifférenciée. Et de citer l'exemple
américain des universités de niveaux différents, et de vouloir
réserver certaines universités à « l'élite » (étudiants et pro-
fesseurs), aux études de haut niveau, c'est-à-dire dans sa
perspective (semble-t-il) à la recherche. Nous sommes sans
doute là au cœur du problème.
d'enseigner à une masse indifférenciée. Et de citer l'exemple
américain des universités de niveaux différents, et de vouloir
réserver certaines universités à « l'élite » (étudiants et pro-
fesseurs), aux études de haut niveau, c'est-à-dire dans sa
perspective (semble-t-il) à la recherche. Nous sommes sans
doute là au cœur du problème.
Il n'est pas question de vouloir défendre un égalita-
risme qui prétendrait donner à tous le même enseignement. Il y
aura sans doute toujours des gens qui pourront aller plus loin
que d'autres et qui, dans quelque métier que ce soit, y compris
la recherche, se révéleront plus efficaces que les autres. Pour-
tant on peut se demander si, dans l'évolution actuelle, il faut
rechercher systématiquement et avant tout ces individus-là, et
si la recherche, par exemple, n'avance pas autant par le travail
d'équipes anonymes que par celui de quelques hommes d'excep-
tion. Et puis il ne doit pas être difficile, dans un enseignement
de masse, de prévoir les quelques moyens qui permettront à
ces élites de se dégager.
risme qui prétendrait donner à tous le même enseignement. Il y
aura sans doute toujours des gens qui pourront aller plus loin
que d'autres et qui, dans quelque métier que ce soit, y compris
la recherche, se révéleront plus efficaces que les autres. Pour-
tant on peut se demander si, dans l'évolution actuelle, il faut
rechercher systématiquement et avant tout ces individus-là, et
si la recherche, par exemple, n'avance pas autant par le travail
d'équipes anonymes que par celui de quelques hommes d'excep-
tion. Et puis il ne doit pas être difficile, dans un enseignement
de masse, de prévoir les quelques moyens qui permettront à
ces élites de se dégager.
Mais je voudrais poser quelques questions d'un autre
ordre. L'exemple américain est-il si convaincant ? Si telles
universités de premier rang peuvent assurer à des groupes de
trente étudiants les meilleurs maîtres, si les moins bons vont
dans des universités de moindre réputation, selon un processus
fortement hiérarchisé, qu'en est-il de ces universités de second
rang ? On peut être inquiet — et d'aucuns prétendent que c'est
justifié — au sujet de la valeur de l'enseignement qui, derrière
la façade de quelques grands centres, est le lot des autres.
L'inégalité dans ce système risque fort de devenir une médio-
crité entretenue.
ordre. L'exemple américain est-il si convaincant ? Si telles
universités de premier rang peuvent assurer à des groupes de
trente étudiants les meilleurs maîtres, si les moins bons vont
dans des universités de moindre réputation, selon un processus
fortement hiérarchisé, qu'en est-il de ces universités de second
rang ? On peut être inquiet — et d'aucuns prétendent que c'est
justifié — au sujet de la valeur de l'enseignement qui, derrière
la façade de quelques grands centres, est le lot des autres.
L'inégalité dans ce système risque fort de devenir une médio-
crité entretenue.
Mais surtout, par le jeu des élites, des équipes de
pointe, des études de haut niveau, et même en ne se limitant
pas à la recherche, aurait-on la prétention de battre les grandes
écoles sur leur propre terrain ? Celles-ci représentent un sys-
tème hautement sélectif, ce qui ne veut pas dire que, bon an,
mal an, à peu près tous les préparationnaires ne se casent. Il y
a pourtant là un système que nous contestons. Est-ce à dire que
notre contestation ne porte que sur l'absence de recherche ?
Il existe, dans les écoles, des laboratoires qui en font bien
autant que certains services des facultés.
pointe, des études de haut niveau, et même en ne se limitant
pas à la recherche, aurait-on la prétention de battre les grandes
écoles sur leur propre terrain ? Celles-ci représentent un sys-
tème hautement sélectif, ce qui ne veut pas dire que, bon an,
mal an, à peu près tous les préparationnaires ne se casent. Il y
a pourtant là un système que nous contestons. Est-ce à dire que
notre contestation ne porte que sur l'absence de recherche ?
Il existe, dans les écoles, des laboratoires qui en font bien
autant que certains services des facultés.
Il me semble que notre contestation est beaucoup plus
radicale. Sans compter le véritable tirage au sort représenté par
les concours d'entrée, qui répartissent selon un prétendu
« niveau » et non selon les goûts et les aptitudes réelles, le
système empêche les choix et une véritable orientation. En
outre, l'enseignement n'apporte pas seulement une formation
technique. Il peut être aussi le lieu où se font des confronta-
tions, où l'on peut apprendre à connaître les exigences, les
difficultés, les centres d'intérêt de professions autres que celle
qui sera choisie. Au moins peut-il faciliter une telle connais-
sance. Ajoutons que les grandes écoles intègrent à un système
social, chacun à une place déterminée, sans permettre ni
souhaiter situer cette place dans le système. Il n'est pas sans
intérêt de rappeler la ségrégation de fait qui sévit entre ensei-
gnement technique et enseignement secondaire ; ou encore
l'échec de l'I.N.S.A. de Lyon par rapport à la volonté initiale de
former à la fois ingénieurs et techniciens. La tâche première de
l'enseignement n'est pas la formation des élites : on peut
penser que, dans un système convenablement conçu, celles-ci
trouveront toujours la possibilité d'acquérir le complément de
formation auquel elles peuvent prétendre. L'accent doit être mis
sur la plus grande masse des gens à former, sans que s'opère
une ségrégation. Créer à côté d'un enseignement de large dif-
fusion qui, en dépit de protestations purement verbales, devien-
dra un enseignement au rabais, créer à côté de cela une E.N.A.
ou une Ecole Polytechnique de la recherche est un leurre péda-
gogique, car l'enseignement supérieur est une acquisition collec-
tive, sociale et non individuelle ; une telle création, malgré le
gauchissement apparent qu'il pourrait entraîner éventuellement,
revient en fait à créer une nouvelle caste.
radicale. Sans compter le véritable tirage au sort représenté par
les concours d'entrée, qui répartissent selon un prétendu
« niveau » et non selon les goûts et les aptitudes réelles, le
système empêche les choix et une véritable orientation. En
outre, l'enseignement n'apporte pas seulement une formation
technique. Il peut être aussi le lieu où se font des confronta-
tions, où l'on peut apprendre à connaître les exigences, les
difficultés, les centres d'intérêt de professions autres que celle
qui sera choisie. Au moins peut-il faciliter une telle connais-
sance. Ajoutons que les grandes écoles intègrent à un système
social, chacun à une place déterminée, sans permettre ni
souhaiter situer cette place dans le système. Il n'est pas sans
intérêt de rappeler la ségrégation de fait qui sévit entre ensei-
gnement technique et enseignement secondaire ; ou encore
l'échec de l'I.N.S.A. de Lyon par rapport à la volonté initiale de
former à la fois ingénieurs et techniciens. La tâche première de
l'enseignement n'est pas la formation des élites : on peut
penser que, dans un système convenablement conçu, celles-ci
trouveront toujours la possibilité d'acquérir le complément de
formation auquel elles peuvent prétendre. L'accent doit être mis
sur la plus grande masse des gens à former, sans que s'opère
une ségrégation. Créer à côté d'un enseignement de large dif-
fusion qui, en dépit de protestations purement verbales, devien-
dra un enseignement au rabais, créer à côté de cela une E.N.A.
ou une Ecole Polytechnique de la recherche est un leurre péda-
gogique, car l'enseignement supérieur est une acquisition collec-
tive, sociale et non individuelle ; une telle création, malgré le
gauchissement apparent qu'il pourrait entraîner éventuellement,
revient en fait à créer une nouvelle caste.
Vieux moules et structures parallèles
Sans doute n'y a-t-il pas de remèdes miracles, mais
commencer par répartir les universités selon une hiérarchie
de niveaux techniques ne nous paraît pas souhaitable. On se
mettra aisément d'accord sur le fait que des unités gigantes-
ques, comme celles des facultés de la région parisienne, ne
sont pas souhaitables. On s'accordera également sans difficulté
sur le fait que tout ne peut être enseigné partout et qu'une
certaine mobilité des étudiants (avec les mesures financières
qu'elle suppose) est sans doute valable.
commencer par répartir les universités selon une hiérarchie
de niveaux techniques ne nous paraît pas souhaitable. On se
mettra aisément d'accord sur le fait que des unités gigantes-
ques, comme celles des facultés de la région parisienne, ne
sont pas souhaitables. On s'accordera également sans difficulté
sur le fait que tout ne peut être enseigné partout et qu'une
certaine mobilité des étudiants (avec les mesures financières
qu'elle suppose) est sans doute valable.
Mais si l'absence de contacts avec la recherche
conduit à rejeter la secondarisation du premier cycle, de même
rejettera-t-on la ségrégation par niveaux : raisons pédagogiques
pour les moins aptes (entendez à l'enseignement traditionnel),
manque de contacts « interprofessionnels » pour tous.
conduit à rejeter la secondarisation du premier cycle, de même
rejettera-t-on la ségrégation par niveaux : raisons pédagogiques
pour les moins aptes (entendez à l'enseignement traditionnel),
manque de contacts « interprofessionnels » pour tous.
A l'opposé des universités de niveaux différents, nous
proposons donc des unités d'enseignement supérieur qui, sans
couvrir peut-être toutes les branches de l'activité intellectuelle,
proposons donc des unités d'enseignement supérieur qui, sans
couvrir peut-être toutes les branches de l'activité intellectuelle,
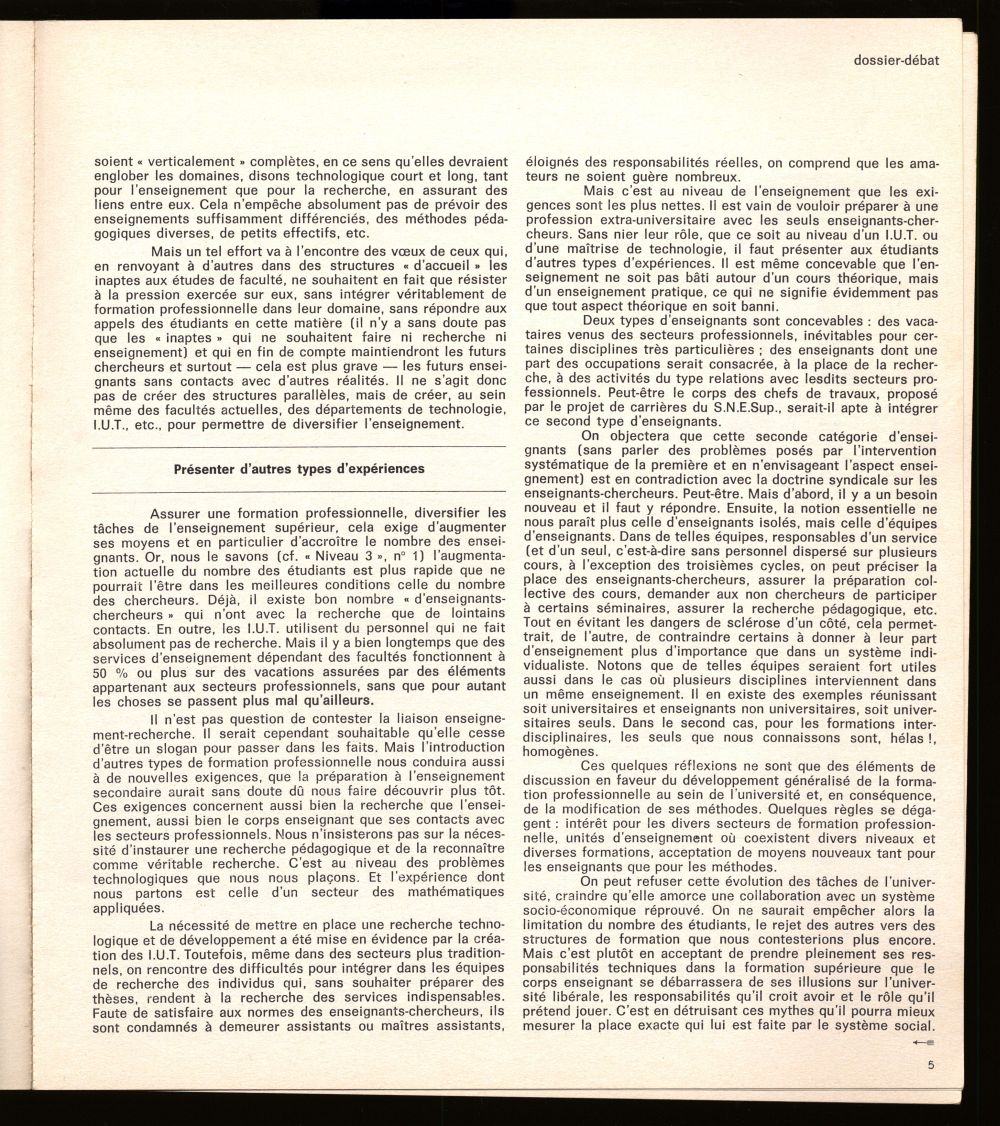

dossier-débat
soient « verticalement » complètes, en ce sens qu'elles devraient
englober les domaines, disons technologique court et long, tant
pour l'enseignement que pour la recherche, en assurant des
liens entre eux. Cela n'empêche absolument pas de prévoir des
enseignements suffisamment différenciés, des méthodes péda-
gogiques diverses, de petits effectifs, etc.
englober les domaines, disons technologique court et long, tant
pour l'enseignement que pour la recherche, en assurant des
liens entre eux. Cela n'empêche absolument pas de prévoir des
enseignements suffisamment différenciés, des méthodes péda-
gogiques diverses, de petits effectifs, etc.
Mais un tel effort va à l'encontre des vœux de ceux qui,
en renvoyant à d'autres dans des structures « d'accueil » les
inaptes aux études de faculté, ne souhaitent en fait que résister
à la pression exercée sur eux, sans intégrer véritablement de
formation professionnelle dans leur domaine, sans répondre aux
appels des étudiants en cette matière (il n'y a sans doute pas
que les « inaptes » qui ne souhaitent faire ni recherche ni
enseignement) et qui en fin de compte maintiendront les futurs
chercheurs et surtout — cela est plus grave — les futurs ensei-
gnants sans contacts avec d'autres réalités. Il ne s'agit donc
pas de créer des structures parallèles, mais de créer, au sein
même des facultés actuelles, des départements de technologie,
I.U.T., etc., pour permettre de diversifier l'enseignement.
en renvoyant à d'autres dans des structures « d'accueil » les
inaptes aux études de faculté, ne souhaitent en fait que résister
à la pression exercée sur eux, sans intégrer véritablement de
formation professionnelle dans leur domaine, sans répondre aux
appels des étudiants en cette matière (il n'y a sans doute pas
que les « inaptes » qui ne souhaitent faire ni recherche ni
enseignement) et qui en fin de compte maintiendront les futurs
chercheurs et surtout — cela est plus grave — les futurs ensei-
gnants sans contacts avec d'autres réalités. Il ne s'agit donc
pas de créer des structures parallèles, mais de créer, au sein
même des facultés actuelles, des départements de technologie,
I.U.T., etc., pour permettre de diversifier l'enseignement.
Présenter d'autres types d'expériences
Assurer une formation professionnelle, diversifier les
tâches de l'enseignement supérieur, cela exige d'augmenter
ses moyens et en particulier d'accroître le nombre des ensei-
gnants. Or, nous le savons (cf. « Niveau 3 », n° 1) l'augmenta-
tion actuelle du nombre des étudiants est plus rapide que ne
pourrait l'être dans les meilleures conditions celle du nombre
des chercheurs. Déjà, il existe bon nombre « d'enseignants-
chercheurs » qui n'ont avec la recherche que de lointains
contacts. En outre, les I.U.T. utilisent du personnel qui ne fait
absolument pas de recherche. Mais il y a bien longtemps que des
services d'enseignement dépendant des facultés fonctionnent à
50 % ou plus sur des vacations assurées par des éléments
appartenant aux secteurs professionnels, sans que pour autant
les choses se passent plus mal qu'ailleurs.
tâches de l'enseignement supérieur, cela exige d'augmenter
ses moyens et en particulier d'accroître le nombre des ensei-
gnants. Or, nous le savons (cf. « Niveau 3 », n° 1) l'augmenta-
tion actuelle du nombre des étudiants est plus rapide que ne
pourrait l'être dans les meilleures conditions celle du nombre
des chercheurs. Déjà, il existe bon nombre « d'enseignants-
chercheurs » qui n'ont avec la recherche que de lointains
contacts. En outre, les I.U.T. utilisent du personnel qui ne fait
absolument pas de recherche. Mais il y a bien longtemps que des
services d'enseignement dépendant des facultés fonctionnent à
50 % ou plus sur des vacations assurées par des éléments
appartenant aux secteurs professionnels, sans que pour autant
les choses se passent plus mal qu'ailleurs.
Il n'est pas question de contester la liaison enseigne-
ment-recherche. Il serait cependant souhaitable qu'elle cesse
d'être un slogan pour passer dans les faits. Mais l'introduction
d'autres types de formation professionnelle nous conduira aussi
à de nouvelles exigences, que la préparation à l'enseignement
secondaire aurait sans doute dû nous faire découvrir plus tôt.
Ces exigences concernent aussi bien la recherche que l'ensei-
gnement, aussi bien le corps enseignant que ses contacts avec
les secteurs professionnels. Nous n'insisterons pas sur la néces-
sité d'instaurer une recherche pédagogique et de la reconnaître
comme véritable recherche. C'est au niveau des problèmes
technologiques que nous nous plaçons. Et l'expérience dont
nous partons est celle d'un secteur des mathématiques
appliquées.
ment-recherche. Il serait cependant souhaitable qu'elle cesse
d'être un slogan pour passer dans les faits. Mais l'introduction
d'autres types de formation professionnelle nous conduira aussi
à de nouvelles exigences, que la préparation à l'enseignement
secondaire aurait sans doute dû nous faire découvrir plus tôt.
Ces exigences concernent aussi bien la recherche que l'ensei-
gnement, aussi bien le corps enseignant que ses contacts avec
les secteurs professionnels. Nous n'insisterons pas sur la néces-
sité d'instaurer une recherche pédagogique et de la reconnaître
comme véritable recherche. C'est au niveau des problèmes
technologiques que nous nous plaçons. Et l'expérience dont
nous partons est celle d'un secteur des mathématiques
appliquées.
La nécessité de mettre en place une recherche techno-
logique et de développement a été mise en évidence par la créa-
tion des I.U.T. Toutefois, même dans des secteurs plus tradition-
nels, on rencontre des difficultés pour intégrer dans les équipes
de recherche des individus qui, sans souhaiter préparer des
thèses, rendent à la recherche des services indispensables.
Faute de satisfaire aux normes des enseignants-chercheurs, ils
sont condamnés à demeurer assistants ou maîtres assistants,
logique et de développement a été mise en évidence par la créa-
tion des I.U.T. Toutefois, même dans des secteurs plus tradition-
nels, on rencontre des difficultés pour intégrer dans les équipes
de recherche des individus qui, sans souhaiter préparer des
thèses, rendent à la recherche des services indispensables.
Faute de satisfaire aux normes des enseignants-chercheurs, ils
sont condamnés à demeurer assistants ou maîtres assistants,
éloignés des responsabilités réelles, on comprend que les ama-
teurs ne soient guère nombreux.
teurs ne soient guère nombreux.
Mais c'est au niveau de l'enseignement que les exi-
gences sont les plus nettes. Il est vain de vouloir préparer à une
profession extra-universitaire avec les seuls enseignants-cher-
cheurs. Sans nier leur rôle, que ce soit au niveau d'un I.U.T. ou
d'une maîtrise de technologie, il faut présenter aux étudiants
d'autres types d'expériences. Il est même concevable que l'en-
seignement ne soit pas bâti autour d'un cours théorique, mais
d'un enseignement pratique, ce qui ne signifie évidemment pas
que tout aspect théorique en soit banni.
gences sont les plus nettes. Il est vain de vouloir préparer à une
profession extra-universitaire avec les seuls enseignants-cher-
cheurs. Sans nier leur rôle, que ce soit au niveau d'un I.U.T. ou
d'une maîtrise de technologie, il faut présenter aux étudiants
d'autres types d'expériences. Il est même concevable que l'en-
seignement ne soit pas bâti autour d'un cours théorique, mais
d'un enseignement pratique, ce qui ne signifie évidemment pas
que tout aspect théorique en soit banni.
Deux types d'enseignants sont concevables : des vaca-
taires venus des secteurs professionnels, inévitables pour cer-
taines disciplines très particulières ; des enseignants dont une
part des occupations serait consacrée, à la place de la recher-
che, à des activités du type relations avec lesdits secteurs pro-
fessionnels. Peut-être le corps des chefs de travaux, proposé
par le projet de carrières du S.N.E.Sup., serait-il apte à intégrer
ce second type d'enseignants.
taires venus des secteurs professionnels, inévitables pour cer-
taines disciplines très particulières ; des enseignants dont une
part des occupations serait consacrée, à la place de la recher-
che, à des activités du type relations avec lesdits secteurs pro-
fessionnels. Peut-être le corps des chefs de travaux, proposé
par le projet de carrières du S.N.E.Sup., serait-il apte à intégrer
ce second type d'enseignants.
On objectera que cette seconde catégorie d'ensei-
gnants (sans parler des problèmes posés par l'intervention
systématique de la première et en n'envisageant l'aspect ensei-
gnement) est en contradiction avec la doctrine syndicale sur les
enseignants-chercheurs. Peut-être. Mais d'abord, il y a un besoin
nouveau et il faut y répondre. Ensuite, la notion essentielle ne
nous paraît plus celle d'enseignants isolés, mais celle d'équipes
d'enseignants. Dans de telles équipes, responsables d'un service
(et d'un seul, c'est-à-dire sans personnel dispersé sur plusieurs
cours, à l'exception des troisièmes cycles, on peut préciser la
place des enseignants-chercheurs, assurer la préparation col-
lective des cours, demander aux non chercheurs de participer
à certains séminaires, assurer la recherche pédagogique, etc.
Tout en évitant les dangers de sclérose d'un côté, cela permet-
trait, de l'autre, de contraindre certains à donner à leur part
d'enseignement plus d'importance que dans un système indi-
vidualiste. Notons que de telles équipes seraient fort utiles
aussi dans le cas où plusieurs disciplines interviennent dans
un même enseignement. Il en existe des exemples réunissant
soit universitaires et enseignants non universitaires, soit univer-
sitaires seuls. Dans le second cas, pour les formations inter-
disciplinaires, les seuls que nous connaissons sont, hélas !,
homogènes.
gnants (sans parler des problèmes posés par l'intervention
systématique de la première et en n'envisageant l'aspect ensei-
gnement) est en contradiction avec la doctrine syndicale sur les
enseignants-chercheurs. Peut-être. Mais d'abord, il y a un besoin
nouveau et il faut y répondre. Ensuite, la notion essentielle ne
nous paraît plus celle d'enseignants isolés, mais celle d'équipes
d'enseignants. Dans de telles équipes, responsables d'un service
(et d'un seul, c'est-à-dire sans personnel dispersé sur plusieurs
cours, à l'exception des troisièmes cycles, on peut préciser la
place des enseignants-chercheurs, assurer la préparation col-
lective des cours, demander aux non chercheurs de participer
à certains séminaires, assurer la recherche pédagogique, etc.
Tout en évitant les dangers de sclérose d'un côté, cela permet-
trait, de l'autre, de contraindre certains à donner à leur part
d'enseignement plus d'importance que dans un système indi-
vidualiste. Notons que de telles équipes seraient fort utiles
aussi dans le cas où plusieurs disciplines interviennent dans
un même enseignement. Il en existe des exemples réunissant
soit universitaires et enseignants non universitaires, soit univer-
sitaires seuls. Dans le second cas, pour les formations inter-
disciplinaires, les seuls que nous connaissons sont, hélas !,
homogènes.
Ces quelques réflexions ne sont que des éléments de
discussion en faveur du développement généralisé de la forma-
tion professionnelle au sein de l'université et, en conséquence,
de la modification de ses méthodes. Quelques règles se déga-
gent : intérêt pour les divers secteurs de formation profession-
nelle, unités d'enseignement où coexistent divers niveaux et
diverses formations, acceptation de moyens nouveaux tant pour
les enseignants que pour les méthodes.
discussion en faveur du développement généralisé de la forma-
tion professionnelle au sein de l'université et, en conséquence,
de la modification de ses méthodes. Quelques règles se déga-
gent : intérêt pour les divers secteurs de formation profession-
nelle, unités d'enseignement où coexistent divers niveaux et
diverses formations, acceptation de moyens nouveaux tant pour
les enseignants que pour les méthodes.
On peut refuser cette évolution des tâches de l'univer-
sité, craindre qu'elle amorce une collaboration avec un système
socio-économique réprouvé. On ne saurait empêcher alors la
limitation du nombre des étudiants, le rejet des autres vers des
structures de formation que nous contesterions plus encore.
Mais c'est plutôt en acceptant de prendre pleinement ses res-
ponsabilités techniques dans la formation supérieure que le
corps enseignant se débarrassera de ses illusions sur l'univer-
sité libérale, les responsabilités qu'il croit avoir et le rôle qu'il
prétend jouer. C'est en détruisant ces mythes qu'il pourra mieux
mesurer la place exacte qui lui est faite par le système social.
sité, craindre qu'elle amorce une collaboration avec un système
socio-économique réprouvé. On ne saurait empêcher alors la
limitation du nombre des étudiants, le rejet des autres vers des
structures de formation que nous contesterions plus encore.
Mais c'est plutôt en acceptant de prendre pleinement ses res-
ponsabilités techniques dans la formation supérieure que le
corps enseignant se débarrassera de ses illusions sur l'univer-
sité libérale, les responsabilités qu'il croit avoir et le rôle qu'il
prétend jouer. C'est en détruisant ces mythes qu'il pourra mieux
mesurer la place exacte qui lui est faite par le système social.


La réforme de l'université ne se fera pas
contre les étudiants ou sans eux
contre les étudiants ou sans eux
par Brice LALONDE
_ à a charge
es étonnairt q
» PU à fait
es étonnairt q
» PU à fait
Depuis 1880, les facultés
de lettres se sont longtemps
contentées de transmettre à un
nombre restreint d'étudiants,
issus pour la plupart des cou-
ches privilégiées, un bagage
hétéroclite baptisé culture gé-
nérale.
de lettres se sont longtemps
contentées de transmettre à un
nombre restreint d'étudiants,
issus pour la plupart des cou-
ches privilégiées, un bagage
hétéroclite baptisé culture gé-
nérale.
L'université fonctionnait en
champ clos, suivant son rythme
propre, ne produisant finale-
ment rien d'autres que ce dont
elle avait hérité, figée dans un
dialogue intemporel avec le
Beau, le Vrai et le Bien. Maî-
tres et disciples se transmet-
taient, dans l'ombre des biblio-
thèques feutrées, le flambeau
d'un humanisme érudit et plein
de distinction. Le brusque ac-
croissement du nombre d'étu-
diants autant que les « nouvel-
les exigences » de l'économie
ont donné le coup de grâce à
cette université libérale mori-
bonde, d'où le mot même de
technique avait toujours été
banni. Parallèlement, le déve-
loppement des sciences humai-
nes modifiait l'équilibre des fa-
cultés. C'est cette année seu-
lement, à la Sorbonne, qu'a été
créé un institut de sociologie,
alors que, de l'autre côté, si
l'institut de lettres classiques
ne fournit presque plus d'ensei-
gnants, il produit encore para-
doxalement les doyens de fa-
culté.
champ clos, suivant son rythme
propre, ne produisant finale-
ment rien d'autres que ce dont
elle avait hérité, figée dans un
dialogue intemporel avec le
Beau, le Vrai et le Bien. Maî-
tres et disciples se transmet-
taient, dans l'ombre des biblio-
thèques feutrées, le flambeau
d'un humanisme érudit et plein
de distinction. Le brusque ac-
croissement du nombre d'étu-
diants autant que les « nouvel-
les exigences » de l'économie
ont donné le coup de grâce à
cette université libérale mori-
bonde, d'où le mot même de
technique avait toujours été
banni. Parallèlement, le déve-
loppement des sciences humai-
nes modifiait l'équilibre des fa-
cultés. C'est cette année seu-
lement, à la Sorbonne, qu'a été
créé un institut de sociologie,
alors que, de l'autre côté, si
l'institut de lettres classiques
ne fournit presque plus d'ensei-
gnants, il produit encore para-
doxalement les doyens de fa-
culté.
Ceci suffit pour que cha-
cun admette maintenant la fail-
lite de l'université libérale. On
s'accorde même à reconnaître
que la crise requiert des solu-
tions urgentes, non seulement
d'ordre matériel et institution-
nel mais aussi d'ordre pédago-
gique. La grande majorité du
corps enseignant ne va, hélas,
pas plus loin que ces rassuran-
tes pétitions de principe sans
conséquence. De temps à au-
tre, un doyen, enlevant ainsi
une grosse épine du pied de
nombre de ses collègues, s'en-
hardit jusqu'à dénoncer la
« terrifiante improductivité des
études de lettres » ; une enquê-
te révèle que les étudiants
trouvent de moins en moins de
débouchés. __
cun admette maintenant la fail-
lite de l'université libérale. On
s'accorde même à reconnaître
que la crise requiert des solu-
tions urgentes, non seulement
d'ordre matériel et institution-
nel mais aussi d'ordre pédago-
gique. La grande majorité du
corps enseignant ne va, hélas,
pas plus loin que ces rassuran-
tes pétitions de principe sans
conséquence. De temps à au-
tre, un doyen, enlevant ainsi
une grosse épine du pied de
nombre de ses collègues, s'en-
hardit jusqu'à dénoncer la
« terrifiante improductivité des
études de lettres » ; une enquê-
te révèle que les étudiants
trouvent de moins en moins de
débouchés. __
Allant plus loin, un groupe
d'assistants fit, dans le même
journal, un procès radical de
l'enseignement littéraire. Bien
que l'article ait suscité de
nombreux échos cher les étu-
diants, deux ans plus tard, ses
d'assistants fit, dans le même
journal, un procès radical de
l'enseignement littéraire. Bien
que l'article ait suscité de
nombreux échos cher les étu-
diants, deux ans plus tard, ses
auteurs ont toujours gardé
l'anonymat. Dans les facultés,
la terreur hiérarchique devant
le «patron» règne encore.
L'assistant se tait et le profes-
seur s'agrippe de plus belle,
comme à un dernier lambeau
de sa vieille université, à l'hé-
ritage de ses prérogatives péni-
blement conquises et jalouse-
ment sauvegardées.
l'anonymat. Dans les facultés,
la terreur hiérarchique devant
le «patron» règne encore.
L'assistant se tait et le profes-
seur s'agrippe de plus belle,
comme à un dernier lambeau
de sa vieille université, à l'hé-
ritage de ses prérogatives péni-
blement conquises et jalouse-
ment sauvegardées.
Depuis de nombreuses an-
nées, à l'université, les étu-
diants avaient tiré la sonnette
d'alarme. Il fallait une réforme.
En 1963, aux portes de la Sor-
bonne, un tract proclamait :
« nous ne voulons être ni des
robots ni des rats de bibliothè-
que ». Quelques années après,
le gouvernement, I u i aussi,
semblant prendre enfin cons-
cience de la crise, annonçait à
grand renfort de publicité sa
grande Réforme. Aujourd'hui,
le «plan Fouchet » fait l'effet
d'un pétard mouillé. Alors
qu'on commence à l'appliquer,
il semble déjà avoir vécu. La
révolution dont parlait M. Pom-
pidou n'était même pas une ré-
forme (1) et, devant la crise
qui s'aggrave, on a recours aux
expédients.
nées, à l'université, les étu-
diants avaient tiré la sonnette
d'alarme. Il fallait une réforme.
En 1963, aux portes de la Sor-
bonne, un tract proclamait :
« nous ne voulons être ni des
robots ni des rats de bibliothè-
que ». Quelques années après,
le gouvernement, I u i aussi,
semblant prendre enfin cons-
cience de la crise, annonçait à
grand renfort de publicité sa
grande Réforme. Aujourd'hui,
le «plan Fouchet » fait l'effet
d'un pétard mouillé. Alors
qu'on commence à l'appliquer,
il semble déjà avoir vécu. La
révolution dont parlait M. Pom-
pidou n'était même pas une ré-
forme (1) et, devant la crise
qui s'aggrave, on a recours aux
expédients.
L'opposition
refuge confortable
refuge confortable
Un ministre remplace l'au-
tre. M. Peyrefitte veut rectifier
le tir. Bon rhéteur, il s'affirme,
au Parlement, ennemi du mal-
thusianisme et en même temps
fait discrètement entériner par
les assemblées de faculté la
sélection à l'entrée ou au cours
des premières années de l'uni-
versité. Il n'hésite même pas à
stigmatiser la sclérose des pro-
fesseurs et à s'en prendre au
« dogmatisme, à l'intellectua-
lisme et à l'individualisme »
des doctes. Mais ce n'est pas
au gaullisme, après dix ans de
pouvoir, qu'il revient de stig-
matiser le dogmatisme, l'indivi-
dualisme, le formalisme, le nar-
cissisme, l'anachronisme, le
pointillisme et l'éclectisme pro-
fessoral. Car le plan Fouchet
tre. M. Peyrefitte veut rectifier
le tir. Bon rhéteur, il s'affirme,
au Parlement, ennemi du mal-
thusianisme et en même temps
fait discrètement entériner par
les assemblées de faculté la
sélection à l'entrée ou au cours
des premières années de l'uni-
versité. Il n'hésite même pas à
stigmatiser la sclérose des pro-
fesseurs et à s'en prendre au
« dogmatisme, à l'intellectua-
lisme et à l'individualisme »
des doctes. Mais ce n'est pas
au gaullisme, après dix ans de
pouvoir, qu'il revient de stig-
matiser le dogmatisme, l'indivi-
dualisme, le formalisme, le nar-
cissisme, l'anachronisme, le
pointillisme et l'éclectisme pro-
fessoral. Car le plan Fouchet
(1) Le plan Fouchet, même s'il lui a
donné de nouvelles structures, n'a pas
sensiblement changé la vieille université ;
sa cohérence n'existe vraiment qu'au ni-
veau de ses intentions. En renforçant le
contrôle administratif, et en réduisant la
durée des études, il a seulement intensifié
la sélection et la spécialisation. Le résultat
est désastreux. On s'aperçoit que la
Réforme de l'université reste à faire.
donné de nouvelles structures, n'a pas
sensiblement changé la vieille université ;
sa cohérence n'existe vraiment qu'au ni-
veau de ses intentions. En renforçant le
contrôle administratif, et en réduisant la
durée des études, il a seulement intensifié
la sélection et la spécialisation. Le résultat
est désastreux. On s'aperçoit que la
Réforme de l'université reste à faire.
est précisément le modèle de
réforme qui, servant d'abord
les intérêts principaux du pou-
voir, ne permet qu'un enseigne-
ment de ce type. La condamna-
tion de la sclérose est, pour le
pouvoir, l'alibi d'une politique
qui l'a jusqu'à présent objecti-
vement favorisé.
réforme qui, servant d'abord
les intérêts principaux du pou-
voir, ne permet qu'un enseigne-
ment de ce type. La condamna-
tion de la sclérose est, pour le
pouvoir, l'alibi d'une politique
qui l'a jusqu'à présent objecti-
vement favorisé.
Aujourd'hui, le plan Fou-
chet ou ses séquelles parvien-
nent à leur aboutissement logi-
que : les mesures d'élimina-
tion. Pour le gouvernement, le
choix est clair et il n'est pas
d'ordre pédagogique, même si
M. Peyrefitte cherche à son
tour à donner le change : fer-
mer ces universités dont on ne
peut rien faire et créer des
I.U.T. pour diffuser démocrati-
quement à la large masse le ga-
limatias juridico-technico-litté-
raire dont les entreprises veu-
lent voir leurs cadres pourvus.
Pour les étudiants, il est de
plus en plus urgent non seule-
ment de définir sur quelles ba-
ses doit s'opérer une transfor-
mation de l'université mais
d'animer un combat sans am-
biguïté ni compromis avec qui
que ce soit. Sinon, nous aurons
bientôt à abandonner ces uni-
versités vides comme autant de
hochets dans les mains des
doctes, et nous verrons sur
leurs ruines des fabriques su-
périeures de cadres bâclés, en-
fin devenues les jouets d'entre-
prises aujourd'hui si impatien-
tes.
chet ou ses séquelles parvien-
nent à leur aboutissement logi-
que : les mesures d'élimina-
tion. Pour le gouvernement, le
choix est clair et il n'est pas
d'ordre pédagogique, même si
M. Peyrefitte cherche à son
tour à donner le change : fer-
mer ces universités dont on ne
peut rien faire et créer des
I.U.T. pour diffuser démocrati-
quement à la large masse le ga-
limatias juridico-technico-litté-
raire dont les entreprises veu-
lent voir leurs cadres pourvus.
Pour les étudiants, il est de
plus en plus urgent non seule-
ment de définir sur quelles ba-
ses doit s'opérer une transfor-
mation de l'université mais
d'animer un combat sans am-
biguïté ni compromis avec qui
que ce soit. Sinon, nous aurons
bientôt à abandonner ces uni-
versités vides comme autant de
hochets dans les mains des
doctes, et nous verrons sur
leurs ruines des fabriques su-
périeures de cadres bâclés, en-
fin devenues les jouets d'entre-
prises aujourd'hui si impatien-
tes.
Déjà le faux débat prend
des proportions redoutables.
Vedéliens et Zamanskystes,
masqués d'efficience, de tech-
nicité et de rentabilité, se dis-
putent le visage de ces fabri-
ques de demain. Ce qui nous
intéresse ici, c'est que les « pa-
trons », ceux qui ne se risquent
pas dans le zèle moderniste,
guidés par leur volonté de re-
trouver le calme serein et sans
problème des maîtres et des
disciples, des petites commu-
nautés d'étudiants de l'univer-
sité d'avant-hier, n'ont opposé
aucune résistance à ces mesu-
res de sélection. Ils n'ont pas
eu d'autres soucis, lors de la
préparation de la réforme, que
de recaser leur cours, leur heu-
re de latin, de philologie ou
d'histoire romaine. Tout cela,
comme ils le disent, pour sau-
ver leurs meubles.
des proportions redoutables.
Vedéliens et Zamanskystes,
masqués d'efficience, de tech-
nicité et de rentabilité, se dis-
putent le visage de ces fabri-
ques de demain. Ce qui nous
intéresse ici, c'est que les « pa-
trons », ceux qui ne se risquent
pas dans le zèle moderniste,
guidés par leur volonté de re-
trouver le calme serein et sans
problème des maîtres et des
disciples, des petites commu-
nautés d'étudiants de l'univer-
sité d'avant-hier, n'ont opposé
aucune résistance à ces mesu-
res de sélection. Ils n'ont pas
eu d'autres soucis, lors de la
préparation de la réforme, que
de recaser leur cours, leur heu-
re de latin, de philologie ou
d'histoire romaine. Tout cela,
comme ils le disent, pour sau-
ver leurs meubles.
Il va sans dire qu'entre le
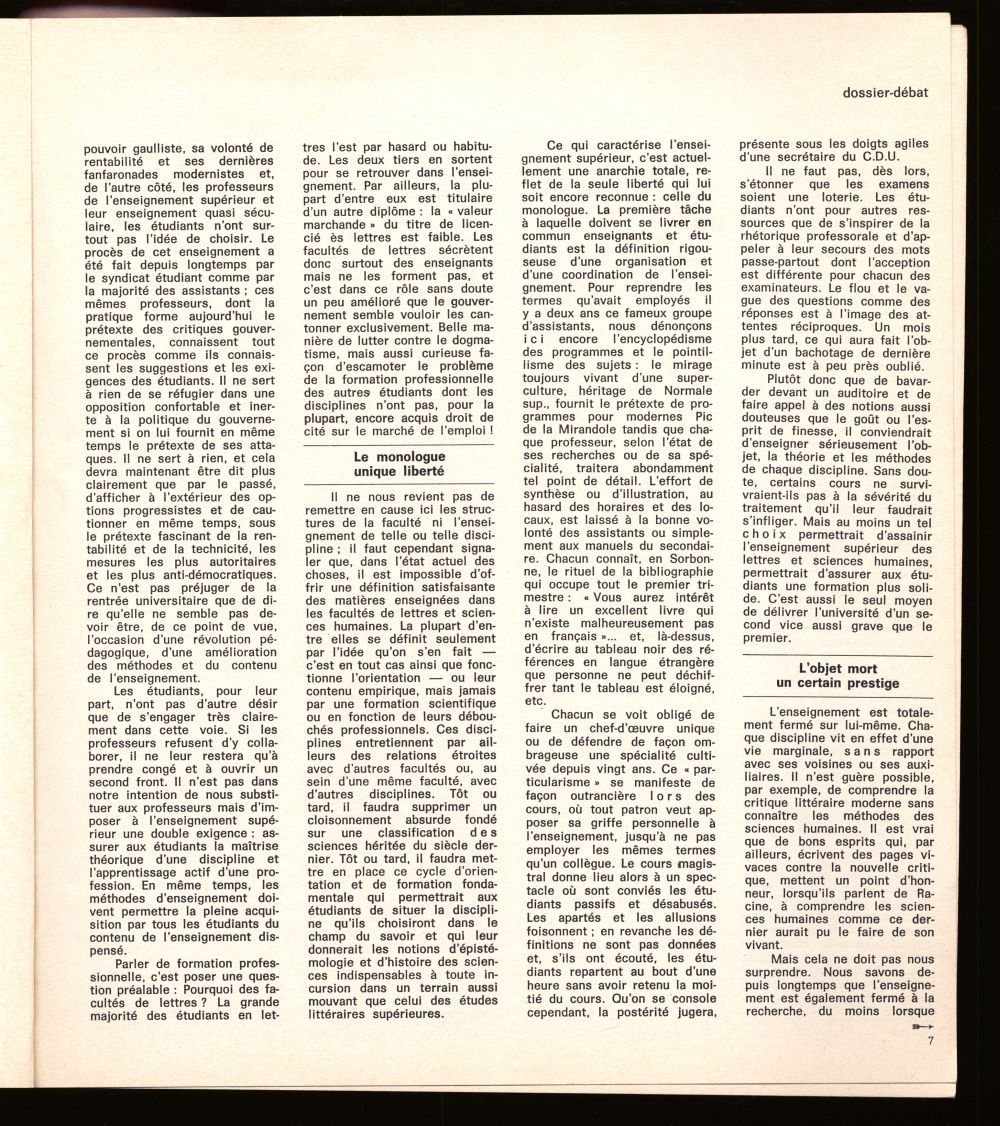

dossier-débat
pouvoir gaulliste, sa volonté de
rentabilité et ses dernières
fanfaronades modernistes et,
de l'autre côté, les professeurs
de l'enseignement supérieur et
leur enseignement quasi sécu-
laire, les étudiants n'ont sur-
tout pas l'idée de choisir. Le
procès de cet enseignement a
été fait depuis longtemps par
le syndicat étudiant comme par
la majorité des assistants ; ces
mêmes professeurs, dont la
pratique forme aujourd'hui le
prétexte des critiques gouver-
nementales, connaissent tout
ce procès comme ils connais-
sent les suggestions et les exi-
gences des étudiants. Il ne sert
à rien de se réfugier dans une
opposition confortable et iner-
te à la politique du gouverne-
ment si on lui fournit en même
temps le prétexte de ses atta-
ques. Il ne sert à rien, et cela
devra maintenant être dit plus
clairement que par le passé,
d'afficher à l'extérieur des op-
tions progressistes et de cau-
tionner en même temps, sous
le prétexte fascinant de la ren-
tabilité et de la technicité, les
mesures les plus autoritaires
et les plus anti-démocratiques.
Ce n'est pas préjuger de la
rentrée universitaire que de di-
re qu'elle ne semble pas de-
voir être, de ce point de vue,
l'occasion d'une révolution pé-
dagogique, d'une amélioration
des méthodes et du contenu
de l'enseignement.
rentabilité et ses dernières
fanfaronades modernistes et,
de l'autre côté, les professeurs
de l'enseignement supérieur et
leur enseignement quasi sécu-
laire, les étudiants n'ont sur-
tout pas l'idée de choisir. Le
procès de cet enseignement a
été fait depuis longtemps par
le syndicat étudiant comme par
la majorité des assistants ; ces
mêmes professeurs, dont la
pratique forme aujourd'hui le
prétexte des critiques gouver-
nementales, connaissent tout
ce procès comme ils connais-
sent les suggestions et les exi-
gences des étudiants. Il ne sert
à rien de se réfugier dans une
opposition confortable et iner-
te à la politique du gouverne-
ment si on lui fournit en même
temps le prétexte de ses atta-
ques. Il ne sert à rien, et cela
devra maintenant être dit plus
clairement que par le passé,
d'afficher à l'extérieur des op-
tions progressistes et de cau-
tionner en même temps, sous
le prétexte fascinant de la ren-
tabilité et de la technicité, les
mesures les plus autoritaires
et les plus anti-démocratiques.
Ce n'est pas préjuger de la
rentrée universitaire que de di-
re qu'elle ne semble pas de-
voir être, de ce point de vue,
l'occasion d'une révolution pé-
dagogique, d'une amélioration
des méthodes et du contenu
de l'enseignement.
Les étudiants, pour leur
part, n'ont pas d'autre désir
que de s'engager très claire-
ment dans cette voie. Si les
professeurs refusent d'y colla-
borer, il ne leur restera qu'à
prendre congé et à ouvrir un
second front. Il n'est pas dans
notre intention de nous substi-
tuer aux professeurs mais d'im-
poser à l'enseignement supé-
rieur une double exigence : as-
surer aux étudiants la maîtrise
théorique d'une discipline et
l'apprentissage actif d'une pro-
fession. En même temps, les
méthodes d'enseignement doi-
vent permettre la pleine acqui-
sition par tous les étudiants du
contenu de l'enseignement dis-
pensé.
part, n'ont pas d'autre désir
que de s'engager très claire-
ment dans cette voie. Si les
professeurs refusent d'y colla-
borer, il ne leur restera qu'à
prendre congé et à ouvrir un
second front. Il n'est pas dans
notre intention de nous substi-
tuer aux professeurs mais d'im-
poser à l'enseignement supé-
rieur une double exigence : as-
surer aux étudiants la maîtrise
théorique d'une discipline et
l'apprentissage actif d'une pro-
fession. En même temps, les
méthodes d'enseignement doi-
vent permettre la pleine acqui-
sition par tous les étudiants du
contenu de l'enseignement dis-
pensé.
Parler de formation profes-
sionnelle, c'est poser une ques-
tion préalable : Pourquoi des fa-
cultés de lettres ? La grande
majorité des étudiants en let-
sionnelle, c'est poser une ques-
tion préalable : Pourquoi des fa-
cultés de lettres ? La grande
majorité des étudiants en let-
tres l'est par hasard ou habitu-
de. Les deux tiers en sortent
pour se retrouver dans l'ensei-
gnement. Par ailleurs, la plu-
part d'entre eux est titulaire
d'un autre diplôme : la « valeur
marchande » du titre de licen-
cié es lettres est faible. Les
facultés de lettres sécrètent
donc surtout des enseignants
mais ne les forment pas, et
c'est dans ce rôle sans doute
un peu amélioré que le gouver-
nement semble vouloir les can-
tonner exclusivement. Belle ma-
nière de lutter contre le dogma-
tisme, mais aussi curieuse fa-
çon d'escamoter le problème
de la formation professionnelle
des autres étudiants dont les
disciplines n'ont pas, pour la
plupart, encore acquis droit de
cité sur le marché de l'emploi !
de. Les deux tiers en sortent
pour se retrouver dans l'ensei-
gnement. Par ailleurs, la plu-
part d'entre eux est titulaire
d'un autre diplôme : la « valeur
marchande » du titre de licen-
cié es lettres est faible. Les
facultés de lettres sécrètent
donc surtout des enseignants
mais ne les forment pas, et
c'est dans ce rôle sans doute
un peu amélioré que le gouver-
nement semble vouloir les can-
tonner exclusivement. Belle ma-
nière de lutter contre le dogma-
tisme, mais aussi curieuse fa-
çon d'escamoter le problème
de la formation professionnelle
des autres étudiants dont les
disciplines n'ont pas, pour la
plupart, encore acquis droit de
cité sur le marché de l'emploi !
Le monologue
unique liberté
unique liberté
11 ne nous revient pas de
remettre en cause ici les struc-
tures de la faculté ni l'ensei-
gnement de telle ou telle disci-
pline ; il faut cependant signa-
ler que, dans l'état actuel des
choses, il est impossible d'of-
frir une définition satisfaisante
des matières enseignées dans
les facultés de lettres et scien-
ces humaines. La plupart d'en-
tre elles se définit seulement
par l'idée qu'on s'en fait —
c'est en tout cas ainsi que fonc-
tionne l'orientation — ou leur
contenu empirique, mais jamais
par une formation scientifique
ou en fonction de leurs débou-
chés professionnels. Ces disci-
plines entretiennent par ail-
leurs des relations étroites
avec d'autres facultés ou, au
sein d'une même faculté, avec
d'autres disciplines. Tôt ou
tard, il faudra supprimer un
cloisonnement absurde fondé
sur une classification des
sciences héritée du siècle der-
nier. Tôt ou tard, il faudra met-
tre en place ce cycle d'orien-
tation et de formation fonda-
mentale qui permettrait aux
étudiants de situer la discipli-
ne qu'ils choisiront dans le
champ du savoir et qui leur
donnerait les notions d'épisté-
mologie et d'histoire des scien-
ces indispensables à toute in-
cursion dans un terrain aussi
mouvant que celui des études
littéraires supérieures.
remettre en cause ici les struc-
tures de la faculté ni l'ensei-
gnement de telle ou telle disci-
pline ; il faut cependant signa-
ler que, dans l'état actuel des
choses, il est impossible d'of-
frir une définition satisfaisante
des matières enseignées dans
les facultés de lettres et scien-
ces humaines. La plupart d'en-
tre elles se définit seulement
par l'idée qu'on s'en fait —
c'est en tout cas ainsi que fonc-
tionne l'orientation — ou leur
contenu empirique, mais jamais
par une formation scientifique
ou en fonction de leurs débou-
chés professionnels. Ces disci-
plines entretiennent par ail-
leurs des relations étroites
avec d'autres facultés ou, au
sein d'une même faculté, avec
d'autres disciplines. Tôt ou
tard, il faudra supprimer un
cloisonnement absurde fondé
sur une classification des
sciences héritée du siècle der-
nier. Tôt ou tard, il faudra met-
tre en place ce cycle d'orien-
tation et de formation fonda-
mentale qui permettrait aux
étudiants de situer la discipli-
ne qu'ils choisiront dans le
champ du savoir et qui leur
donnerait les notions d'épisté-
mologie et d'histoire des scien-
ces indispensables à toute in-
cursion dans un terrain aussi
mouvant que celui des études
littéraires supérieures.
Ce qui caractérise l'ensei-
gnement supérieur, c'est actuel-
lement une anarchie totale, re-
flet de la seule liberté qui lui
soit encore reconnue : celle du
monologue. La première tâche
à laquelle doivent se livrer en
commun enseignants et étu-
diants est la définition rigou-
seuse d'une organisation et
d'une coordination de l'ensei-
gnement. Pour reprendre les
termes qu'avait employés il
y a deux ans ce fameux groupe
d'assistants, nous dénonçons
ici encore l'encyclopédisme
des programmes et le pointil-
lisme des sujets : le mirage
toujours vivant d'une super-
culture, héritage de Normale
sup., fournit le prétexte de pro-
grammes pour modernes Pic
de la Mirandole tandis que cha-
que professeur, selon l'état de
ses recherches ou de sa spé-
cialité, traitera abondamment
tel point de détail. L'effort de
synthèse ou d'illustration, au
hasard des horaires et des lo-
caux, est laissé à la bonne vo-
lonté des assistants ou simple-
ment aux manuels du secondai-
re. Chacun connaît, en Sorbon-
ne, le rituel de la bibliographie
qui occupe tout le premier tri-
mestre : « Vous aurez intérêt
à lire un excellent livre qui
n'existe malheureusement pas
en français »... et, là-dessus,
d'écrire au tableau noir des ré-
férences en langue étrangère
que personne ne peut déchif-
frer tant le tableau est éloigné,
etc.
gnement supérieur, c'est actuel-
lement une anarchie totale, re-
flet de la seule liberté qui lui
soit encore reconnue : celle du
monologue. La première tâche
à laquelle doivent se livrer en
commun enseignants et étu-
diants est la définition rigou-
seuse d'une organisation et
d'une coordination de l'ensei-
gnement. Pour reprendre les
termes qu'avait employés il
y a deux ans ce fameux groupe
d'assistants, nous dénonçons
ici encore l'encyclopédisme
des programmes et le pointil-
lisme des sujets : le mirage
toujours vivant d'une super-
culture, héritage de Normale
sup., fournit le prétexte de pro-
grammes pour modernes Pic
de la Mirandole tandis que cha-
que professeur, selon l'état de
ses recherches ou de sa spé-
cialité, traitera abondamment
tel point de détail. L'effort de
synthèse ou d'illustration, au
hasard des horaires et des lo-
caux, est laissé à la bonne vo-
lonté des assistants ou simple-
ment aux manuels du secondai-
re. Chacun connaît, en Sorbon-
ne, le rituel de la bibliographie
qui occupe tout le premier tri-
mestre : « Vous aurez intérêt
à lire un excellent livre qui
n'existe malheureusement pas
en français »... et, là-dessus,
d'écrire au tableau noir des ré-
férences en langue étrangère
que personne ne peut déchif-
frer tant le tableau est éloigné,
etc.
Chacun se voit obligé de
faire un chef-d'œuvre unique
ou de défendre de façon om-
brageuse une spécialité culti-
vée depuis vingt ans. Ce « par-
ticularisme » se manifeste de
façon outrancière lors des
cours, où tout patron veut ap-
poser sa griffe personnelle à
l'enseignement, jusqu'à ne pas
employer les mêmes termes
qu'un collègue. Le cours magis-
tral donne lieu alors à un spec-
tacle où sont conviés les étu-
diants passifs et désabusés.
Les apartés et les allusions
foisonnent ; en revanche les dé-
finitions ne sont pas données
et, s'ils ont écouté, les étu-
diants repartent au bout d'une
heure sans avoir retenu la moi-
tié du cours. Qu'on se console
cependant, la postérité jugera,
faire un chef-d'œuvre unique
ou de défendre de façon om-
brageuse une spécialité culti-
vée depuis vingt ans. Ce « par-
ticularisme » se manifeste de
façon outrancière lors des
cours, où tout patron veut ap-
poser sa griffe personnelle à
l'enseignement, jusqu'à ne pas
employer les mêmes termes
qu'un collègue. Le cours magis-
tral donne lieu alors à un spec-
tacle où sont conviés les étu-
diants passifs et désabusés.
Les apartés et les allusions
foisonnent ; en revanche les dé-
finitions ne sont pas données
et, s'ils ont écouté, les étu-
diants repartent au bout d'une
heure sans avoir retenu la moi-
tié du cours. Qu'on se console
cependant, la postérité jugera,
présente sous les doigts agiles
d'une secrétaire du C.D.U.
d'une secrétaire du C.D.U.
Il ne faut pas, dès lors,
s'étonner que les examens
soient une loterie. Les étu-
diants n'ont pour autres res-
sources que de s'inspirer de la
rhétorique professorale et d'ap-
peler à leur secours des mots
passe-partout dont l'acception
est différente pour chacun des
examinateurs. Le flou et le va-
gue des questions comme des
réponses est à l'image des at-
tentes réciproques. Un mois
plus tard, ce qui aura fait l'ob-
jet d'un bachotage de dernière
minute est à peu près oublié.
s'étonner que les examens
soient une loterie. Les étu-
diants n'ont pour autres res-
sources que de s'inspirer de la
rhétorique professorale et d'ap-
peler à leur secours des mots
passe-partout dont l'acception
est différente pour chacun des
examinateurs. Le flou et le va-
gue des questions comme des
réponses est à l'image des at-
tentes réciproques. Un mois
plus tard, ce qui aura fait l'ob-
jet d'un bachotage de dernière
minute est à peu près oublié.
Plutôt donc que de bavar-
der devant un auditoire et de
faire appel à des notions aussi
douteuses que le goût ou l'es-
prit de finesse, il conviendrait
d'enseigner sérieusement l'ob-
jet, la théorie et les méthodes
de chaque discipline. Sans dou-
te, certains cours ne survi-
vraient-ils pas à la sévérité du
traitement qu'il leur faudrait
s'infliger. Mais au moins un tel
choix permettrait d'assainir
l'enseignement supérieur des
lettres et sciences humaines,
permettrait d'assurer aux étu-
diants une formation plus soli-
de. C'est aussi le seul moyen
de délivrer l'université d'un se-
cond vice aussi grave que le
premier.
der devant un auditoire et de
faire appel à des notions aussi
douteuses que le goût ou l'es-
prit de finesse, il conviendrait
d'enseigner sérieusement l'ob-
jet, la théorie et les méthodes
de chaque discipline. Sans dou-
te, certains cours ne survi-
vraient-ils pas à la sévérité du
traitement qu'il leur faudrait
s'infliger. Mais au moins un tel
choix permettrait d'assainir
l'enseignement supérieur des
lettres et sciences humaines,
permettrait d'assurer aux étu-
diants une formation plus soli-
de. C'est aussi le seul moyen
de délivrer l'université d'un se-
cond vice aussi grave que le
premier.
L'objet mort
un certain prestige
un certain prestige
L'enseignement est totale-
ment fermé sur lui-même. Cha-
que discipline vit en effet d'une
vie marginale, sans rapport
avec ses voisines ou ses auxi-
liaires. Il n'est guère possible,
par exemple, de comprendre la
critique littéraire moderne sans
connaître les méthodes des
sciences humaines. Il est vrai
que de bons esprits qui, par
ailleurs, écrivent des pages vi-
vaces contre la nouvelle criti-
que, mettent un point d'hon-
neur, lorsqu'ils parlent de Ra-
cine, à comprendre les scien-
ces humaines comme ce der-
nier aurait pu le faire de son
vivant.
ment fermé sur lui-même. Cha-
que discipline vit en effet d'une
vie marginale, sans rapport
avec ses voisines ou ses auxi-
liaires. Il n'est guère possible,
par exemple, de comprendre la
critique littéraire moderne sans
connaître les méthodes des
sciences humaines. Il est vrai
que de bons esprits qui, par
ailleurs, écrivent des pages vi-
vaces contre la nouvelle criti-
que, mettent un point d'hon-
neur, lorsqu'ils parlent de Ra-
cine, à comprendre les scien-
ces humaines comme ce der-
nier aurait pu le faire de son
vivant.
Mais cela ne doit pas nous
surprendre. Nous savons de-
puis longtemps que l'enseigne-
ment est également fermé à la
recherche, du moins lorsque
surprendre. Nous savons de-
puis longtemps que l'enseigne-
ment est également fermé à la
recherche, du moins lorsque
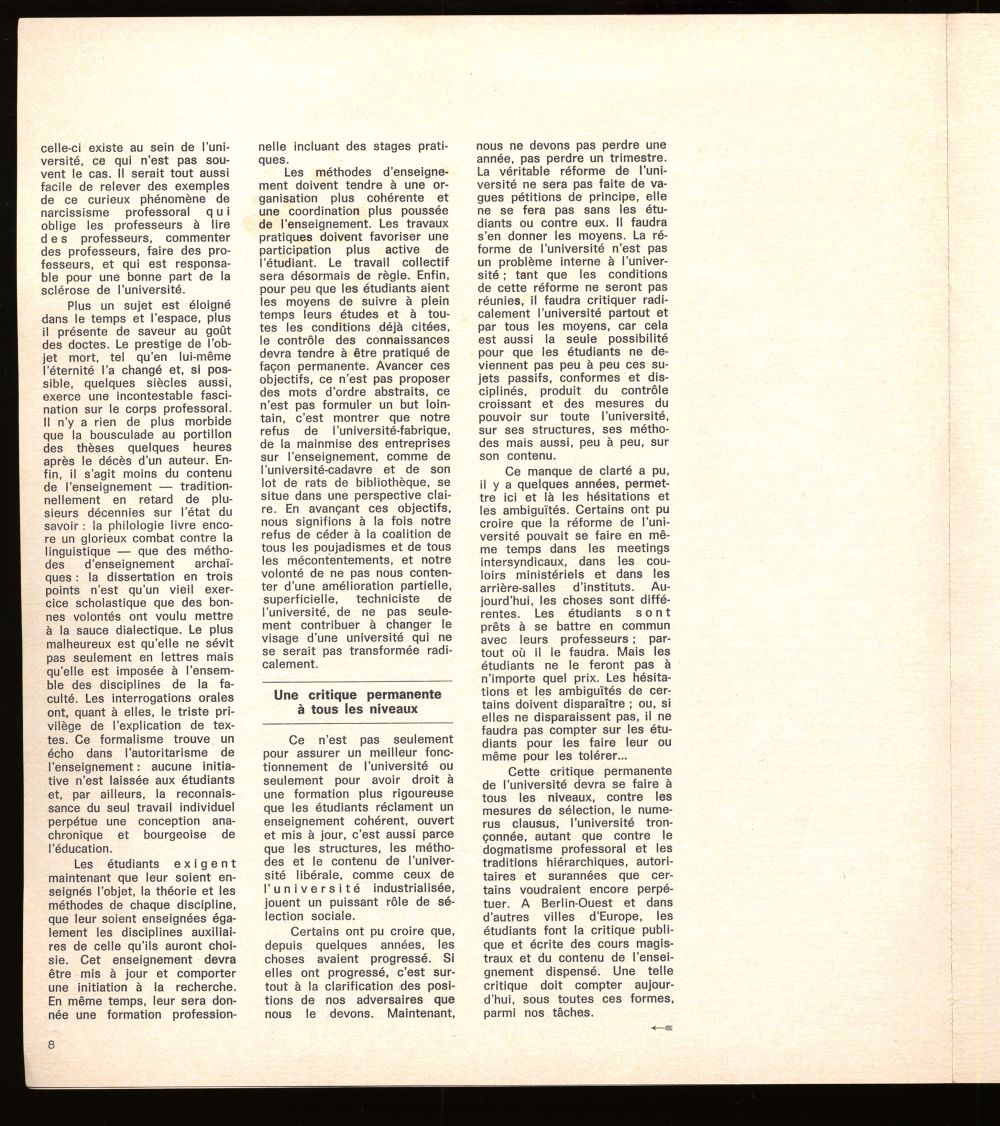

celle-ci existe au sein de l'uni-
versité, ce qui n'est pas sou-
vent le cas. Il serait tout aussi
facile de relever des exemples
de ce curieux phénomène de
narcissisme professoral q u i
oblige les professeurs à lire
des professeurs, commenter
des professeurs, faire des pro-
fesseurs, et qui est responsa-
ble pour une bonne part de la
sclérose de l'université.
versité, ce qui n'est pas sou-
vent le cas. Il serait tout aussi
facile de relever des exemples
de ce curieux phénomène de
narcissisme professoral q u i
oblige les professeurs à lire
des professeurs, commenter
des professeurs, faire des pro-
fesseurs, et qui est responsa-
ble pour une bonne part de la
sclérose de l'université.
Plus un sujet est éloigné
dans le temps et l'espace, plus
il présente de saveur au goût
des doctes. Le prestige de l'ob-
jet mort, tel qu'en lui-même
l'éternité l'a changé et, si pos-
sible, quelques siècles aussi,
exerce une incontestable fasci-
nation sur le corps professoral.
II n'y a rien de plus morbide
que la bousculade au portillon
des thèses quelques heures
après le décès d'un auteur. En-
fin, il s'agit moins du contenu
de l'enseignement — tradition-
nellement en retard de plu-
sieurs décennies sur l'état du
savoir : la philologie livre enco-
re un glorieux combat contre la
linguistique — que des métho-
des d'enseignement archaï-
ques : la dissertation en trois
points n'est qu'un vieil exer-
cice scholastique que des bon-
nes volontés ont voulu mettre
à la sauce dialectique. Le plus
malheureux est qu'elle ne sévit
pas seulement en lettres mais
qu'elle est imposée à l'ensem-
ble des disciplines de la fa-
culté. Les interrogations orales
ont, quant à elles, le triste pri-
vilège de l'explication de tex-
tes. Ce formalisme trouve un
écho dans l'autoritarisme de
l'enseignement : aucune initia-
tive n'est laissée aux étudiants
et, par ailleurs, la reconnais-
sance du seul travail individuel
perpétue une conception ana-
chronique et bourgeoise de
l'éducation.
dans le temps et l'espace, plus
il présente de saveur au goût
des doctes. Le prestige de l'ob-
jet mort, tel qu'en lui-même
l'éternité l'a changé et, si pos-
sible, quelques siècles aussi,
exerce une incontestable fasci-
nation sur le corps professoral.
II n'y a rien de plus morbide
que la bousculade au portillon
des thèses quelques heures
après le décès d'un auteur. En-
fin, il s'agit moins du contenu
de l'enseignement — tradition-
nellement en retard de plu-
sieurs décennies sur l'état du
savoir : la philologie livre enco-
re un glorieux combat contre la
linguistique — que des métho-
des d'enseignement archaï-
ques : la dissertation en trois
points n'est qu'un vieil exer-
cice scholastique que des bon-
nes volontés ont voulu mettre
à la sauce dialectique. Le plus
malheureux est qu'elle ne sévit
pas seulement en lettres mais
qu'elle est imposée à l'ensem-
ble des disciplines de la fa-
culté. Les interrogations orales
ont, quant à elles, le triste pri-
vilège de l'explication de tex-
tes. Ce formalisme trouve un
écho dans l'autoritarisme de
l'enseignement : aucune initia-
tive n'est laissée aux étudiants
et, par ailleurs, la reconnais-
sance du seul travail individuel
perpétue une conception ana-
chronique et bourgeoise de
l'éducation.
Les étudiants exigent
maintenant que leur soient en-
seignés l'objet, la théorie et les
méthodes de chaque discipline,
que leur soient enseignées éga-
lement les disciplines auxiliai-
res de celle qu'ils auront choi-
sie. Cet enseignement devra
être mis à jour et comporter
une initiation à la recherche.
En même temps, leur sera don-
née une formation profession-
maintenant que leur soient en-
seignés l'objet, la théorie et les
méthodes de chaque discipline,
que leur soient enseignées éga-
lement les disciplines auxiliai-
res de celle qu'ils auront choi-
sie. Cet enseignement devra
être mis à jour et comporter
une initiation à la recherche.
En même temps, leur sera don-
née une formation profession-
nelle incluant des stages prati-
ques.
ques.
Les méthodes d'enseigne-
ment doivent tendre à une or-
ganisation plus cohérente et
une coordination plus poussée
de l'enseignement. Les travaux
pratiques doivent favoriser une
participation plus active de
l'étudiant. Le travail collectif
sera désormais de règle. Enfin,
pour peu que les étudiants aient
les moyens de suivre à plein
temps leurs études et à tou-
tes les conditions déjà citées,
le contrôle des connaissances
devra tendre à être pratiqué de
façon permanente. Avancer ces
objectifs, ce n'est pas proposer
des mots d'ordre abstraits, ce
n'est pas formuler un but loin-
tain, c'est montrer que notre
refus de l'université-fabrique,
de la mainmise des entreprises
sur l'enseignement, comme de
l'université-cadavre et de son
lot de rats de bibliothèque, se
situe dans une perspective clai-
re. En avançant ces objectifs,
nous signifions à la fois notre
refus de céder à la coalition de
tous les poujadismes et de tous
les mécontentements, et notre
volonté de ne pas nous conten-
ter d'une amélioration partielle,
superficielle, techniciste de
l'université, de ne pas seule-
ment contribuer à changer le
visage d'une université qui ne
se serait pas transformée radi-
calement.
ment doivent tendre à une or-
ganisation plus cohérente et
une coordination plus poussée
de l'enseignement. Les travaux
pratiques doivent favoriser une
participation plus active de
l'étudiant. Le travail collectif
sera désormais de règle. Enfin,
pour peu que les étudiants aient
les moyens de suivre à plein
temps leurs études et à tou-
tes les conditions déjà citées,
le contrôle des connaissances
devra tendre à être pratiqué de
façon permanente. Avancer ces
objectifs, ce n'est pas proposer
des mots d'ordre abstraits, ce
n'est pas formuler un but loin-
tain, c'est montrer que notre
refus de l'université-fabrique,
de la mainmise des entreprises
sur l'enseignement, comme de
l'université-cadavre et de son
lot de rats de bibliothèque, se
situe dans une perspective clai-
re. En avançant ces objectifs,
nous signifions à la fois notre
refus de céder à la coalition de
tous les poujadismes et de tous
les mécontentements, et notre
volonté de ne pas nous conten-
ter d'une amélioration partielle,
superficielle, techniciste de
l'université, de ne pas seule-
ment contribuer à changer le
visage d'une université qui ne
se serait pas transformée radi-
calement.
Une critique permanente
à tous les niveaux
à tous les niveaux
Ce n'est pas seulement
pour assurer un meilleur fonc-
tionnement de l'université ou
seulement pour avoir droit à
une formation plus rigoureuse
que les étudiants réclament un
enseignement cohérent, ouvert
et mis à jour, c'est aussi parce
que les structures, les métho-
des et le contenu de l'univer-
sité libérale, comme ceux de
l'université industrialisée,
jouent un puissant rôle de sé-
lection sociale.
pour assurer un meilleur fonc-
tionnement de l'université ou
seulement pour avoir droit à
une formation plus rigoureuse
que les étudiants réclament un
enseignement cohérent, ouvert
et mis à jour, c'est aussi parce
que les structures, les métho-
des et le contenu de l'univer-
sité libérale, comme ceux de
l'université industrialisée,
jouent un puissant rôle de sé-
lection sociale.
Certains ont pu croire que,
depuis quelques années, les
choses avaient progressé. Si
elles ont progressé, c'est sur-
tout à la clarification des posi-
tions de nos adversaires que
nous le devons. Maintenant,
depuis quelques années, les
choses avaient progressé. Si
elles ont progressé, c'est sur-
tout à la clarification des posi-
tions de nos adversaires que
nous le devons. Maintenant,
nous ne devons pas perdre une
année, pas perdre un trimestre.
La véritable réforme de l'uni-
versité ne sera pas faite de va-
gues pétitions de principe, elle
ne se fera pas sans les étu-
diants ou contre eux. Il faudra
s'en donner les moyens. La ré-
forme de l'université n'est pas
un problème interne à l'univer-
sité ; tant que les conditions
de cette réforme ne seront pas
réunies, il faudra critiquer radi-
calement l'université partout et
par tous les moyens, car cela
est aussi la seule possibilité
pour que les étudiants ne de-
viennent pas peu à peu ces su-
jets passifs, conformes et dis-
ciplinés, produit du contrôle
croissant et des mesures du
pouvoir sur toute l'université,
sur ses structures, ses métho-
des mais aussi, peu à peu, sur
son contenu.
année, pas perdre un trimestre.
La véritable réforme de l'uni-
versité ne sera pas faite de va-
gues pétitions de principe, elle
ne se fera pas sans les étu-
diants ou contre eux. Il faudra
s'en donner les moyens. La ré-
forme de l'université n'est pas
un problème interne à l'univer-
sité ; tant que les conditions
de cette réforme ne seront pas
réunies, il faudra critiquer radi-
calement l'université partout et
par tous les moyens, car cela
est aussi la seule possibilité
pour que les étudiants ne de-
viennent pas peu à peu ces su-
jets passifs, conformes et dis-
ciplinés, produit du contrôle
croissant et des mesures du
pouvoir sur toute l'université,
sur ses structures, ses métho-
des mais aussi, peu à peu, sur
son contenu.
Ce manque de clarté a pu,
il y a quelques années, permet-
tre ici et là les hésitations et
les ambiguïtés. Certains ont pu
croire que la réforme de l'uni-
versité pouvait se faire en mê-
me temps dans les meetings
intersyndicaux, dans les cou-
loirs ministériels et dans les
arrière-salles d'instituts. Au-
jourd'hui, les choses sont diffé-
rentes. Les étudiants sont
prêts à se battre en commun
avec leurs professeurs ; par-
tout où il le faudra. Mais les
étudiants ne le feront pas à
n'importe quel prix. Les hésita-
tions et les ambiguïtés de cer-
tains doivent disparaître ; ou, si
elles ne disparaissent pas, il ne
faudra pas compter sur les étu-
diants pour les faire leur ou
même pour les tolérer...
il y a quelques années, permet-
tre ici et là les hésitations et
les ambiguïtés. Certains ont pu
croire que la réforme de l'uni-
versité pouvait se faire en mê-
me temps dans les meetings
intersyndicaux, dans les cou-
loirs ministériels et dans les
arrière-salles d'instituts. Au-
jourd'hui, les choses sont diffé-
rentes. Les étudiants sont
prêts à se battre en commun
avec leurs professeurs ; par-
tout où il le faudra. Mais les
étudiants ne le feront pas à
n'importe quel prix. Les hésita-
tions et les ambiguïtés de cer-
tains doivent disparaître ; ou, si
elles ne disparaissent pas, il ne
faudra pas compter sur les étu-
diants pour les faire leur ou
même pour les tolérer...
Cette critique permanente
de l'université devra se faire à
tous les niveaux, contre les
mesures de sélection, le nume-
rus clausus, l'université tron-
çonnée, autant que contre le
dogmatisme professoral et les
traditions hiérarchiques, autori-
taires et surannées que cer-
tains voudraient encore perpé-
tuer. A Berlin-Ouest et dans
d'autres villes d'Europe, les
étudiants font la critique publi-
que et écrite des cours magis-
traux et du contenu de l'ensei-
gnement dispensé. Une telle
critique doit compter aujour-
d'hui, sous toutes ces formes,
parmi nos tâches.
de l'université devra se faire à
tous les niveaux, contre les
mesures de sélection, le nume-
rus clausus, l'université tron-
çonnée, autant que contre le
dogmatisme professoral et les
traditions hiérarchiques, autori-
taires et surannées que cer-
tains voudraient encore perpé-
tuer. A Berlin-Ouest et dans
d'autres villes d'Europe, les
étudiants font la critique publi-
que et écrite des cours magis-
traux et du contenu de l'ensei-
gnement dispensé. Une telle
critique doit compter aujour-
d'hui, sous toutes ces formes,
parmi nos tâches.
8


Recherche et invention
dans l'enseignement littéraire
par Max Milner
dossier-débat
Le problème de la recher-
che dans les facultés des let-
tres et sciences humaines se
pose de façon très différente
selon les disciplines. Pour cer-
taines d'entre elles (psycholo-
gie, sociologie, linguistique, dé-
mographie, certaines branches
de la géographie) la situation
présente de grandes analogies
avec ce qui se passe dans les
facultés des sciences. Pour
d'autres — celles que je vou-
drais évoquer ici — il en va
tout autrement : il s'agit des
disciplines plus proprement
« littéraires », dans lesquelles
le travail en laboratoire ou en
équipe, la recherche et l'exploi-
tation scientifique des docu-
ments, ou bien n'ont aucune
place, ou bien ont une place
relativement restreinte par rap-
port à la création individuelle,
à l'interprétation personnelle, à
la mise en oeuvre d'une culture
et à l'exercice d'un jugement
qui échappent aux normes du
travail scientifique tradition-
nel. Il est difficile de spécifier
quelles sont exactement ces
disciplines : disons, en gros,
qu'il s'agit des « langues et lit-
tératures », anciennes ou mo-
dernes, de la philosophie, dans
une certaine mesure de l'his-
toire et de l'histoire de l'art.
che dans les facultés des let-
tres et sciences humaines se
pose de façon très différente
selon les disciplines. Pour cer-
taines d'entre elles (psycholo-
gie, sociologie, linguistique, dé-
mographie, certaines branches
de la géographie) la situation
présente de grandes analogies
avec ce qui se passe dans les
facultés des sciences. Pour
d'autres — celles que je vou-
drais évoquer ici — il en va
tout autrement : il s'agit des
disciplines plus proprement
« littéraires », dans lesquelles
le travail en laboratoire ou en
équipe, la recherche et l'exploi-
tation scientifique des docu-
ments, ou bien n'ont aucune
place, ou bien ont une place
relativement restreinte par rap-
port à la création individuelle,
à l'interprétation personnelle, à
la mise en oeuvre d'une culture
et à l'exercice d'un jugement
qui échappent aux normes du
travail scientifique tradition-
nel. Il est difficile de spécifier
quelles sont exactement ces
disciplines : disons, en gros,
qu'il s'agit des « langues et lit-
tératures », anciennes ou mo-
dernes, de la philosophie, dans
une certaine mesure de l'his-
toire et de l'histoire de l'art.
Mais il faut tout de suite
préciser que certains secteurs
de ces disciplines (par exem-
préciser que certains secteurs
de ces disciplines (par exem-
ple l'histoire des textes) met-
tent en œuvre des méthodes
de recherche qui permettent
de classer sans problème par-
mi les chercheurs ceux qui les
emploient. Le danger, que l'on
n'a pas évité à une certaine
époque, serait de vouloir tirer
de ces méthodes une norme
applicable à tous les « litté-
raires ». On aboutit ainsi à re-
vêtir d'un vernis de science
des travaux qui n'ont rien à y
gagner. Il n'y a pas si long-
temps, une thèse de littérature
ne pouvait être autre chose
qu'une thèse d'histoire litté-
raire, parce qu'on estimait que
seule la recherche de type his-
torique, appuyée sur des dé-
pouillements d'archives, des
publications d'inédits, des iden-
tifications de « sources », per-
mettait d'atteindre une objecti-
vité suffisante pour porter pier-
re. Il en est résulté le dévelop-
pement, à l'extérieur de l'Uni-
versité, d'une critique parallèle
ou « nouvelle critique », dont la
vitalité et la fécondité se sont
tellement affirmées, durant ces
dernières années, que l'Univer-
sité commence, assez timide-
ment encore, à l'intégrer.
tent en œuvre des méthodes
de recherche qui permettent
de classer sans problème par-
mi les chercheurs ceux qui les
emploient. Le danger, que l'on
n'a pas évité à une certaine
époque, serait de vouloir tirer
de ces méthodes une norme
applicable à tous les « litté-
raires ». On aboutit ainsi à re-
vêtir d'un vernis de science
des travaux qui n'ont rien à y
gagner. Il n'y a pas si long-
temps, une thèse de littérature
ne pouvait être autre chose
qu'une thèse d'histoire litté-
raire, parce qu'on estimait que
seule la recherche de type his-
torique, appuyée sur des dé-
pouillements d'archives, des
publications d'inédits, des iden-
tifications de « sources », per-
mettait d'atteindre une objecti-
vité suffisante pour porter pier-
re. Il en est résulté le dévelop-
pement, à l'extérieur de l'Uni-
versité, d'une critique parallèle
ou « nouvelle critique », dont la
vitalité et la fécondité se sont
tellement affirmées, durant ces
dernières années, que l'Univer-
sité commence, assez timide-
ment encore, à l'intégrer.
Or, ce développement de la
« nouvelle critique » à l'inté-
rieur de l'Université pose en
termes nouveaux le problème
du statut du « chercheur litté-
raire ». Ou plutôt, il le pose
comme il aurait toujours dû
être posé, c'est-à-dire en te-
nant compte des particularités
inhérentes à cette étrange acti-
vité de l'esprit qu'est l'inter-
prétation de la littérature. Acti-
vité étrange, car faire compren-
dre un texte, un écrivain ou un
mouvement littéraire, c'est par-
tir d'un donné objectif (telle
œuvre, tel manifeste, tel fait
biographique) et tendre vers
l'objectivité (car comment
prendre au sérieux le critique
prétendant que son interpréta-
tion ne vaut que pour lui
seul ?) mais en passant obliga-
toirement par le détour d'une
sensibilité artistique, d'une cul-
ture personnelle, d'un discerne-
ment des rapports cachés en-
tre les détails d'une œuvre ou
les manifestations d'une per-
sonnalité, qui assurent seuls,
en définitive, la fécondité de
la démarche critique (1).
« nouvelle critique » à l'inté-
rieur de l'Université pose en
termes nouveaux le problème
du statut du « chercheur litté-
raire ». Ou plutôt, il le pose
comme il aurait toujours dû
être posé, c'est-à-dire en te-
nant compte des particularités
inhérentes à cette étrange acti-
vité de l'esprit qu'est l'inter-
prétation de la littérature. Acti-
vité étrange, car faire compren-
dre un texte, un écrivain ou un
mouvement littéraire, c'est par-
tir d'un donné objectif (telle
œuvre, tel manifeste, tel fait
biographique) et tendre vers
l'objectivité (car comment
prendre au sérieux le critique
prétendant que son interpréta-
tion ne vaut que pour lui
seul ?) mais en passant obliga-
toirement par le détour d'une
sensibilité artistique, d'une cul-
ture personnelle, d'un discerne-
ment des rapports cachés en-
tre les détails d'une œuvre ou
les manifestations d'une per-
sonnalité, qui assurent seuls,
en définitive, la fécondité de
la démarche critique (1).
Comment distinguer, dans
ces conditions, le chercheur du
ces conditions, le chercheur du
non chercheur ? Il est évident
qu'on ne saurait retenir com-
me critères l'abondance ou
l'épaisseur des publications.
On sait les ravages intellec-
tuels que le principe « publish
or perish » opère chez nos col-
lègues d'Outre-Atlantique. Non
seulement il est possible d'en-
combrer de ses articles les re-
vues spécialisées (ou même
de ses livres les rayons des
libraires) sans faire le moins
du monde œuvre de chercheur,
mais — chose troublante et
qu'il faut pourtant affirmer
avec force même si elle com-
plique notre réflexion — il y a
de grands professeurs qui pu-
blient peu, et dont l'enseigne-
ment est cependant une perpé-
tuelle recherche orale, capable
de susciter et d'entretenir des
vocations de chercheurs beau-
coup plus efficacement que ce-
lui de tel de leurs collègues,
dont la bibliographie couvrira
plusieurs pages dans le volu-
me d'hommage que lui offriront
ses disciples et amis. Qu'on
ne vienne pas nous dire que
ceux-là se contentent d' « en-
seigner », c'est-à-dire de com-
muniquer à leurs étudiants
une science toute faite, car ils
possèdent et mettent en œu-
vre le don d'invention, sans le-
quel il n'existe pas, en littéra-
ture (ou en philosophie, ou en
histoire), de recherche de va-
leur. Et c'est bien, en fin de
compte, l'invention qui me pa-
raît être, en matière de recher-
che littéraire, le seul critère à
retenir. Est un chercheur tout
enseignant qui ne se contente
pas de répéter ce que les au-
tres ont dit, mais qui, à la suite
d'une approche personnelle des
problèmes, découvre des faits
ou établit des rapports que
d'autres n'ont pas aperçus, pro-
pose des interprétations origi-
nales et sérieusement moti-
vées, met en circulation des
idées nouvelles.
qu'on ne saurait retenir com-
me critères l'abondance ou
l'épaisseur des publications.
On sait les ravages intellec-
tuels que le principe « publish
or perish » opère chez nos col-
lègues d'Outre-Atlantique. Non
seulement il est possible d'en-
combrer de ses articles les re-
vues spécialisées (ou même
de ses livres les rayons des
libraires) sans faire le moins
du monde œuvre de chercheur,
mais — chose troublante et
qu'il faut pourtant affirmer
avec force même si elle com-
plique notre réflexion — il y a
de grands professeurs qui pu-
blient peu, et dont l'enseigne-
ment est cependant une perpé-
tuelle recherche orale, capable
de susciter et d'entretenir des
vocations de chercheurs beau-
coup plus efficacement que ce-
lui de tel de leurs collègues,
dont la bibliographie couvrira
plusieurs pages dans le volu-
me d'hommage que lui offriront
ses disciples et amis. Qu'on
ne vienne pas nous dire que
ceux-là se contentent d' « en-
seigner », c'est-à-dire de com-
muniquer à leurs étudiants
une science toute faite, car ils
possèdent et mettent en œu-
vre le don d'invention, sans le-
quel il n'existe pas, en littéra-
ture (ou en philosophie, ou en
histoire), de recherche de va-
leur. Et c'est bien, en fin de
compte, l'invention qui me pa-
raît être, en matière de recher-
che littéraire, le seul critère à
retenir. Est un chercheur tout
enseignant qui ne se contente
pas de répéter ce que les au-
tres ont dit, mais qui, à la suite
d'une approche personnelle des
problèmes, découvre des faits
ou établit des rapports que
d'autres n'ont pas aperçus, pro-
pose des interprétations origi-
nales et sérieusement moti-
vées, met en circulation des
idées nouvelles.
Culture
et création
et création
Mais comment détecter
ceux qui possèdent ce don
d'invention et qui l'exercent 1
C'est ici que les l.P.R.E.S. (2)
pourraient avoir leur rôle à
jouer, à condition que leur fonc-
tionnement soit entouré d'as-
ceux qui possèdent ce don
d'invention et qui l'exercent 1
C'est ici que les l.P.R.E.S. (2)
pourraient avoir leur rôle à
jouer, à condition que leur fonc-
tionnement soit entouré d'as-
sez de garanties pour qu'ils ne
deviennent pas, précisément,
des pépinières de pseudo-cher-
cheurs s'efforçant, au détri-
ment de leur culture générale,
de conquérir leur place dans la
foire aux publications. Les
l.P.R.E.S. pourraient jouer ce
rôle que l'agrégation, récom-
pensant surtout la clarté d'es-
prit et les talents d'expression,
ne peut pas jouer. Il faudrait
pour cela faire une large place
à un enseignement destiné à
favoriser la maîtrise de la cul-
ture et le développement de
l'esprit créateur. Ainsi se trou-
veraient désarmées les mé-
fiances de bien des littéraires
qui craignent que les l.P.R.E.S.
ne provoquent une spécialisa-
tion excessive et un abaisse-
ment de la qualification des
maîtres.
deviennent pas, précisément,
des pépinières de pseudo-cher-
cheurs s'efforçant, au détri-
ment de leur culture générale,
de conquérir leur place dans la
foire aux publications. Les
l.P.R.E.S. pourraient jouer ce
rôle que l'agrégation, récom-
pensant surtout la clarté d'es-
prit et les talents d'expression,
ne peut pas jouer. Il faudrait
pour cela faire une large place
à un enseignement destiné à
favoriser la maîtrise de la cul-
ture et le développement de
l'esprit créateur. Ainsi se trou-
veraient désarmées les mé-
fiances de bien des littéraires
qui craignent que les l.P.R.E.S.
ne provoquent une spécialisa-
tion excessive et un abaisse-
ment de la qualification des
maîtres.
Quant aux enseignants dé-
jà dans la course, il est évident
que c'est essentiellement à tra-
vers leurs publications que
leurs facultés d'invention peu-
vent être discernées. Le cas
des maîtres qui publient peu,
mais dont l'enseignement oral
est lui-même une recherche,
est un cas limite et ne pose
pas de problèmes insolubles ;
le peu qu'ils publient permet,
en général, de les ranger par-
mi les « grands ». C'est là, en
effet, un point essentiel et sur
lequel il faut revenir : rien
n'est plus désastreux que de
s'appuyer sur le nombre et
l'épaisseur de ses publications
pour juger de l'activité d'un
chercheur littéraire. Les tra-
vaux forcés à perpétuité des
universitaires américains sont,
à cet égard, aussi néfastes que
la thèse - chef-d'œuvre - artisa-
nal (et parfois unique, hélas !)
des universitaires français. On
ne saurait assez, en ces matiè-
res, tenir compte des différen-
ces introduites par la discipli-
ne, par le sujet, par le rythme
de travail du chercheur. L'un
préférera débiter sa pensée
sous forme d'articles fréquents
et stimulants, l'autre préférera
mûrir longtemps une œuvre
fortement structurée ; l'un ne
s'exprimera à son aise qu'en
noircissant une quantité consi-
dérable de papier, l'autre expo-
sera en peu de pages des idées
de poids. L'apport des uns et
aes autres doit pouvoir être uti-
lisé et reconnu. Les proposi-
jà dans la course, il est évident
que c'est essentiellement à tra-
vers leurs publications que
leurs facultés d'invention peu-
vent être discernées. Le cas
des maîtres qui publient peu,
mais dont l'enseignement oral
est lui-même une recherche,
est un cas limite et ne pose
pas de problèmes insolubles ;
le peu qu'ils publient permet,
en général, de les ranger par-
mi les « grands ». C'est là, en
effet, un point essentiel et sur
lequel il faut revenir : rien
n'est plus désastreux que de
s'appuyer sur le nombre et
l'épaisseur de ses publications
pour juger de l'activité d'un
chercheur littéraire. Les tra-
vaux forcés à perpétuité des
universitaires américains sont,
à cet égard, aussi néfastes que
la thèse - chef-d'œuvre - artisa-
nal (et parfois unique, hélas !)
des universitaires français. On
ne saurait assez, en ces matiè-
res, tenir compte des différen-
ces introduites par la discipli-
ne, par le sujet, par le rythme
de travail du chercheur. L'un
préférera débiter sa pensée
sous forme d'articles fréquents
et stimulants, l'autre préférera
mûrir longtemps une œuvre
fortement structurée ; l'un ne
s'exprimera à son aise qu'en
noircissant une quantité consi-
dérable de papier, l'autre expo-
sera en peu de pages des idées
de poids. L'apport des uns et
aes autres doit pouvoir être uti-
lisé et reconnu. Les proposi-
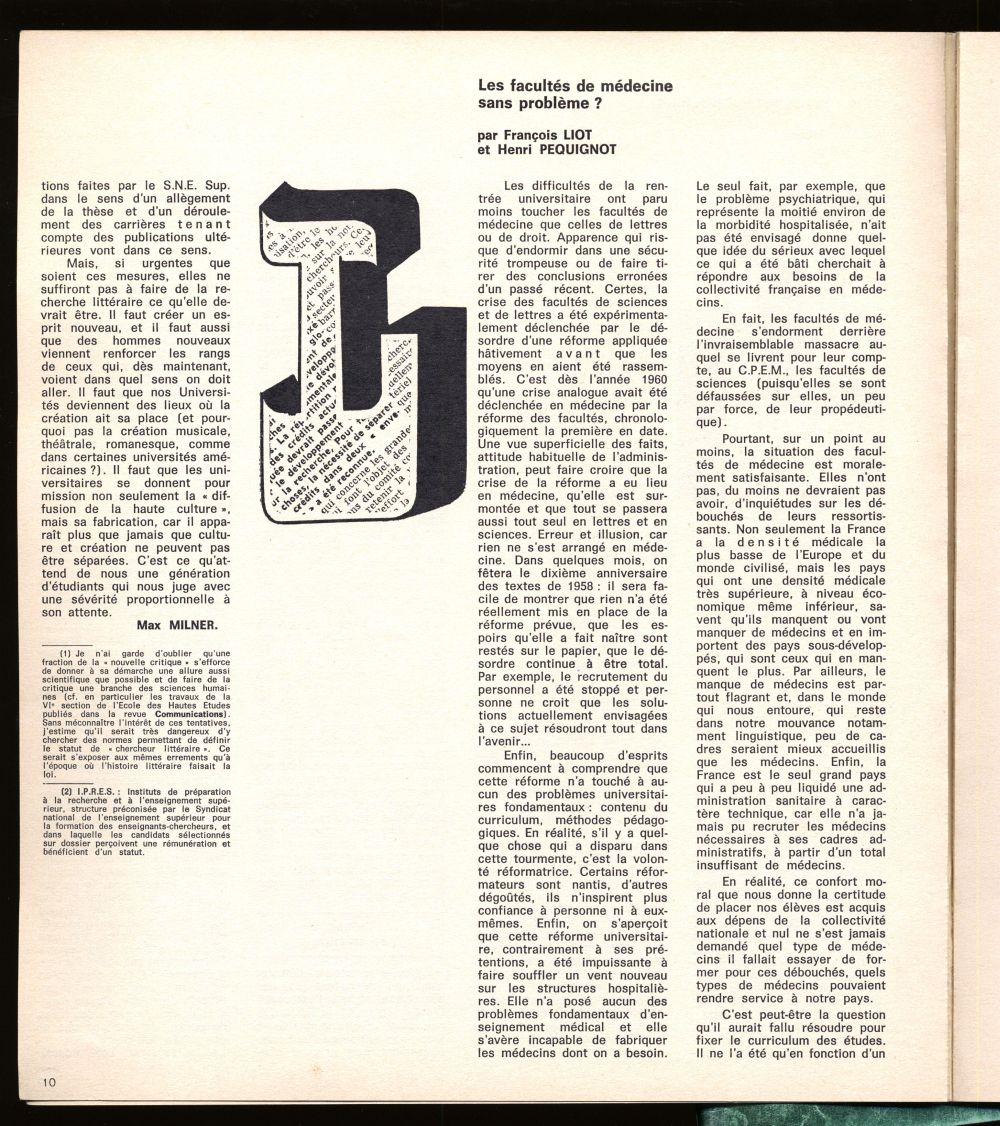

tions faites par le S.N.E. Sup.
dans le sens d'un allégement
de la thèse et d'un déroule-
ment des carrières tenant
compte des publications ulté-
rieures vont dans ce sens.
dans le sens d'un allégement
de la thèse et d'un déroule-
ment des carrières tenant
compte des publications ulté-
rieures vont dans ce sens.
Mais, si urgentes que
soient ces mesures, elles ne
suffiront pas à faire de la re-
cherche littéraire ce qu'elle de-
vrait être. Il faut créer un es-
prit nouveau, et il faut aussi
que des hommes nouveaux
viennent renforcer les rangs
de ceux qui, dès maintenant,
voient dans quel sens on doit
aller. Il faut que nos Universi-
tés deviennent des lieux où la
création ait sa place (et pour-
quoi pas la création musicale,
théâtrale, romanesque, comme
dans certaines universités amé-
ricaines?). Il faut que les uni-
versitaires se donnent pour
mission non seulement la « dif-
fusion de la haute culture »,
mais sa fabrication, car il appa-
raît plus que jamais que cultu-
re et création ne peuvent pas
être séparées. C'est ce qu'at-
tend de nous une génération
d'étudiants qui nous juge avec
une sévérité proportionnelle à
son attente.
soient ces mesures, elles ne
suffiront pas à faire de la re-
cherche littéraire ce qu'elle de-
vrait être. Il faut créer un es-
prit nouveau, et il faut aussi
que des hommes nouveaux
viennent renforcer les rangs
de ceux qui, dès maintenant,
voient dans quel sens on doit
aller. Il faut que nos Universi-
tés deviennent des lieux où la
création ait sa place (et pour-
quoi pas la création musicale,
théâtrale, romanesque, comme
dans certaines universités amé-
ricaines?). Il faut que les uni-
versitaires se donnent pour
mission non seulement la « dif-
fusion de la haute culture »,
mais sa fabrication, car il appa-
raît plus que jamais que cultu-
re et création ne peuvent pas
être séparées. C'est ce qu'at-
tend de nous une génération
d'étudiants qui nous juge avec
une sévérité proportionnelle à
son attente.
Max MILNER.
(1) Je n'ai garde d'oublier qu'une
fraction de la « nouvelle critique » s'efforce
de donner à sa démarche une allure aussi
scientifique que possible et de faire de la
critique une branche des sciences humai-
nes (cf. en particulier les travaux de la
VIe section de l'Ecole des Hautes Etudes
publiés dans la revue Communications).
Sans méconnaître l'intérêt de ces tentatives,
j'estime qu'il serait très dangereux d'y
chercher des normes permettant de définir
le statut de « chercheur littéraire ». Ce
serait s'exposer aux mêmes errements qu'à
l'époque où l'histoire littéraire faisait la
loi.
fraction de la « nouvelle critique » s'efforce
de donner à sa démarche une allure aussi
scientifique que possible et de faire de la
critique une branche des sciences humai-
nes (cf. en particulier les travaux de la
VIe section de l'Ecole des Hautes Etudes
publiés dans la revue Communications).
Sans méconnaître l'intérêt de ces tentatives,
j'estime qu'il serait très dangereux d'y
chercher des normes permettant de définir
le statut de « chercheur littéraire ». Ce
serait s'exposer aux mêmes errements qu'à
l'époque où l'histoire littéraire faisait la
loi.
(2) I.P.R.E.S. : instituts de préparation
à la recherche et à l'enseignement supé-
rieur, structure préconisée par le Syndicat
national de l'enseignement supérieur pour
la formation des enseignants-chercheurs, et
dans laquelle les candidats sélectionnés
sur dossier perçoivent une rémunération et
bénéficient d'un statut.
à la recherche et à l'enseignement supé-
rieur, structure préconisée par le Syndicat
national de l'enseignement supérieur pour
la formation des enseignants-chercheurs, et
dans laquelle les candidats sélectionnés
sur dossier perçoivent une rémunération et
bénéficient d'un statut.
Les facultés de médecine
sans problème ?
sans problème ?
par François LIOT
et Henri PEQUIGNOT
et Henri PEQUIGNOT
Les difficultés de la ren-
trée universitaire ont paru
moins toucher les facultés de
médecine que celles de lettres
ou de droit. Apparence qui ris-
que d'endormir dans une sécu-
rité trompeuse ou de faire ti-
rer des conclusions erronées
d'un passé récent. Certes, la
crise des facultés de sciences
et de lettres a été expérimenta-
lement déclenchée par le dé-
sordre d'une réforme appliquée
hâtivement avant que les
moyens en aient été rassem-
blés. C'est dès l'année 1960
qu'une crise analogue avait été
déclenchée en médecine par la
réforme des facultés, chronolo-
giquement la première en date.
Une vue superficielle des faits,
attitude habituelle de l'adminis-
tration, peut faire croire que la
crise de la réforme a eu lieu
en médecine, qu'elle est sur-
montée et que tout se passera
aussi tout seul en lettres et en
sciences. Erreur et illusion, car
rien ne s'est arrangé en méde-
cine. Dans quelques mois, on
fêtera le dixième anniversaire
des textes de 1958 : il sera fa-
cile de montrer que rien n'a été
réellement mis en place de la
réforme prévue, que les es-
poirs qu'elle a fait naître sont
restés sur le papier, que le dé-
sordre continue à être total.
Par exemple, le recrutement du
personnel a été stoppé et per-
sonne ne croit que les solu-
tions actuellement envisagées
à ce sujet résoudront tout dans
l'avenir...
trée universitaire ont paru
moins toucher les facultés de
médecine que celles de lettres
ou de droit. Apparence qui ris-
que d'endormir dans une sécu-
rité trompeuse ou de faire ti-
rer des conclusions erronées
d'un passé récent. Certes, la
crise des facultés de sciences
et de lettres a été expérimenta-
lement déclenchée par le dé-
sordre d'une réforme appliquée
hâtivement avant que les
moyens en aient été rassem-
blés. C'est dès l'année 1960
qu'une crise analogue avait été
déclenchée en médecine par la
réforme des facultés, chronolo-
giquement la première en date.
Une vue superficielle des faits,
attitude habituelle de l'adminis-
tration, peut faire croire que la
crise de la réforme a eu lieu
en médecine, qu'elle est sur-
montée et que tout se passera
aussi tout seul en lettres et en
sciences. Erreur et illusion, car
rien ne s'est arrangé en méde-
cine. Dans quelques mois, on
fêtera le dixième anniversaire
des textes de 1958 : il sera fa-
cile de montrer que rien n'a été
réellement mis en place de la
réforme prévue, que les es-
poirs qu'elle a fait naître sont
restés sur le papier, que le dé-
sordre continue à être total.
Par exemple, le recrutement du
personnel a été stoppé et per-
sonne ne croit que les solu-
tions actuellement envisagées
à ce sujet résoudront tout dans
l'avenir...
Enfin, beaucoup d'esprits
commencent à comprendre que
cette réforme n'a touché à au-
cun des problèmes universitai-
res fondamentaux : contenu du
curriculum, méthodes pédago-
giques. En réalité, s'il y a quel-
que chose qui a disparu dans
cette tourmente, c'est la volon-
té réformatrice. Certains réfor-
mateurs sont nantis, d'autres
dégoûtés, ils n'inspirent plus
confiance à personne ni à eux-
mêmes. Enfin, on s'aperçoit
que cette réforme universitai-
re, contrairement à ses pré-
tentions, a été impuissante à
faire souffler un vent nouveau
sur les structures hospitaliè-
res. Elle n'a posé aucun des
problèmes fondamentaux d'en-
seignement médical et elle
s'avère incapable de fabriquer
les médecins dont on a besoin.
commencent à comprendre que
cette réforme n'a touché à au-
cun des problèmes universitai-
res fondamentaux : contenu du
curriculum, méthodes pédago-
giques. En réalité, s'il y a quel-
que chose qui a disparu dans
cette tourmente, c'est la volon-
té réformatrice. Certains réfor-
mateurs sont nantis, d'autres
dégoûtés, ils n'inspirent plus
confiance à personne ni à eux-
mêmes. Enfin, on s'aperçoit
que cette réforme universitai-
re, contrairement à ses pré-
tentions, a été impuissante à
faire souffler un vent nouveau
sur les structures hospitaliè-
res. Elle n'a posé aucun des
problèmes fondamentaux d'en-
seignement médical et elle
s'avère incapable de fabriquer
les médecins dont on a besoin.
Le seul fait, par exemple, que
le problème psychiatrique, qui
représente la moitié environ de
la morbidité hospitalisée, n'ait
pas été envisagé donne quel-
que idée du sérieux avec lequel
ce qui a été bâti cherchait à
répondre aux besoins de la
collectivité française en méde-
cins.
le problème psychiatrique, qui
représente la moitié environ de
la morbidité hospitalisée, n'ait
pas été envisagé donne quel-
que idée du sérieux avec lequel
ce qui a été bâti cherchait à
répondre aux besoins de la
collectivité française en méde-
cins.
En fait, les facultés de mé-
decine s'endorment derrière
l'invraisemblable massacre au-
quel se livrent pour leur comp-
te, au C.P.E.M., les facultés de
sciences (puisqu'elles se sont
défaussées sur elles, un peu
par force, de leur propédeuti-
que).
decine s'endorment derrière
l'invraisemblable massacre au-
quel se livrent pour leur comp-
te, au C.P.E.M., les facultés de
sciences (puisqu'elles se sont
défaussées sur elles, un peu
par force, de leur propédeuti-
que).
Pourtant, sur un point au
moins, la situation des facul-
tés de médecine est morale-
ment satisfaisante. Elles n'ont
pas, du moins ne devraient pas
avoir, d'inquiétudes sur les dé-
bouchés de leurs ressortis-
sants. Non seulement la France
a la densité médicale la
plus basse de l'Europe et du
monde civilisé, mais les pays
qui ont une densité médicale
très supérieure, à niveau éco-
nomique même inférieur, sa-
vent qu'ils manquent ou vont
manquer de médecins et en im-
portent des pays sous-dévelop-
pés, qui sont ceux qui en man-
quent le plus. Par ailleurs, le
manque de médecins est par-
tout flagrant et, dans le monde
qui nous entoure, qui reste
dans notre mouvance notam-
ment linguistique, peu de ca-
dres seraient mieux accueillis
que les médecins. Enfin, la
France est le seul grand pays
qui a peu à peu liquidé une ad-
ministration sanitaire à carac-
tère technique, car elle n'a ja-
mais pu recruter les médecins
nécessaires à ses cadres ad-
ministratifs, à partir d'un total
insuffisant de médecins.
moins, la situation des facul-
tés de médecine est morale-
ment satisfaisante. Elles n'ont
pas, du moins ne devraient pas
avoir, d'inquiétudes sur les dé-
bouchés de leurs ressortis-
sants. Non seulement la France
a la densité médicale la
plus basse de l'Europe et du
monde civilisé, mais les pays
qui ont une densité médicale
très supérieure, à niveau éco-
nomique même inférieur, sa-
vent qu'ils manquent ou vont
manquer de médecins et en im-
portent des pays sous-dévelop-
pés, qui sont ceux qui en man-
quent le plus. Par ailleurs, le
manque de médecins est par-
tout flagrant et, dans le monde
qui nous entoure, qui reste
dans notre mouvance notam-
ment linguistique, peu de ca-
dres seraient mieux accueillis
que les médecins. Enfin, la
France est le seul grand pays
qui a peu à peu liquidé une ad-
ministration sanitaire à carac-
tère technique, car elle n'a ja-
mais pu recruter les médecins
nécessaires à ses cadres ad-
ministratifs, à partir d'un total
insuffisant de médecins.
En réalité, ce confort mo-
ral que nous donne la certitude
de placer nos élèves est acquis
aux dépens de la collectivité
nationale et nul ne s'est jamais
demandé quel type de méde-
cins il fallait essayer de for-
mer pour ces débouchés, quels
types de médecins pouvaient
rendre service à notre pays.
ral que nous donne la certitude
de placer nos élèves est acquis
aux dépens de la collectivité
nationale et nul ne s'est jamais
demandé quel type de méde-
cins il fallait essayer de for-
mer pour ces débouchés, quels
types de médecins pouvaient
rendre service à notre pays.
C'est peut-être la question
qu'il aurait fallu résoudre pour
fixer le curriculum des études.
Il ne l'a été qu'en fonction d'un
qu'il aurait fallu résoudre pour
fixer le curriculum des études.
Il ne l'a été qu'en fonction d'un
10
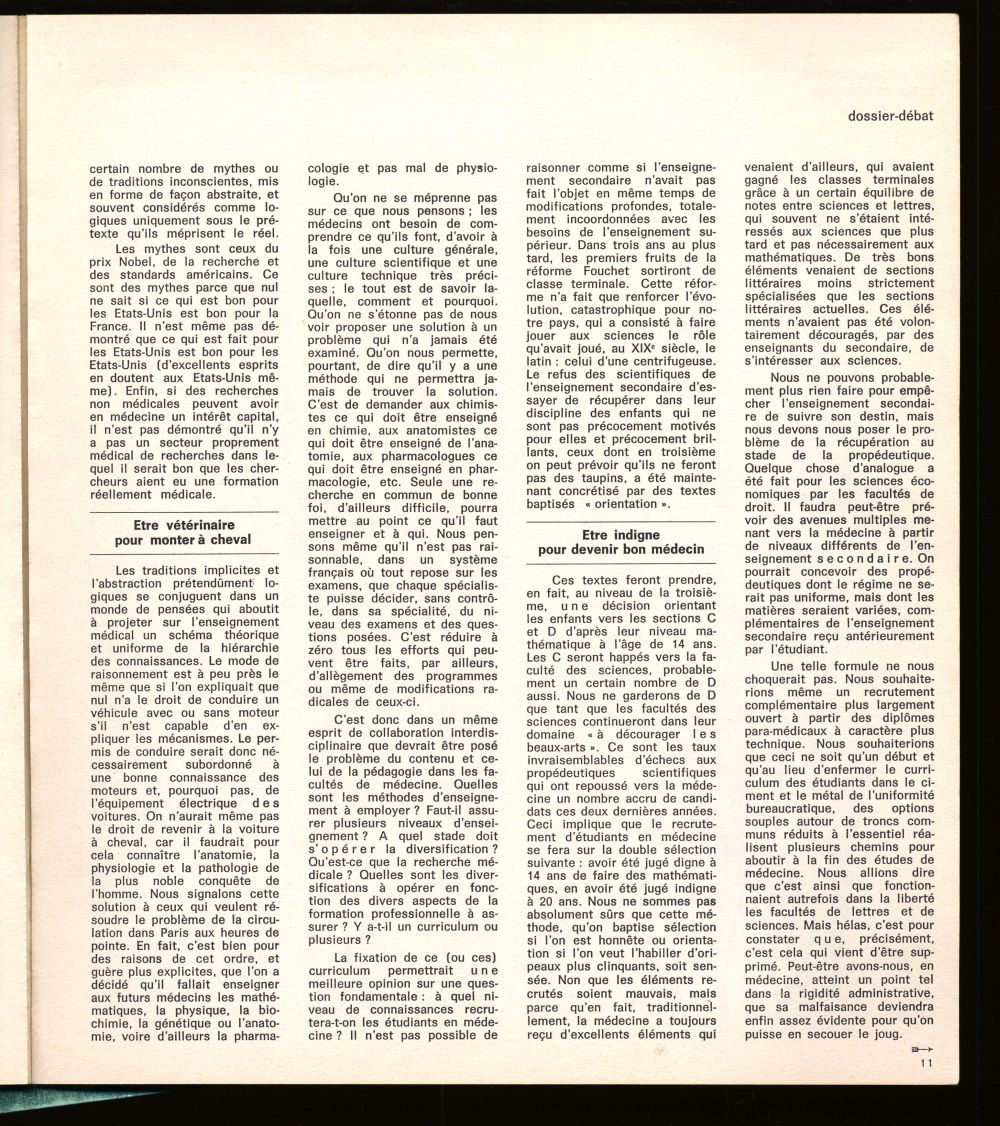

dossier-débat
certain nombre de mythes ou
de traditions inconscientes, mis
en forme de façon abstraite, et
souvent considérés comme lo-
giques uniquement sous le pré-
texte qu'ils méprisent le réel.
Les mythes sont ceux du
prix Nobel, de la recherche et
des standards américains. Ce
sont des mythes parce que nul
ne sait si ce qui est bon pour
les Etats-Unis est bon pour la
France. Il n'est même pas dé-
montré que ce qui est fait pour
les Etats-Unis est bon pour les
Etats-Unis (d'excellents esprits
en doutent aux Etats-Unis mê-
me). Enfin, si des recherches
non médicales peuvent avoir
en médecine un intérêt capital,
il n'est pas démontré qu'il n'y
a pas un secteur proprement
médical de recherches dans le-
quel il serait bon que les cher-
cheurs aient eu une formation
réellement médicale.
de traditions inconscientes, mis
en forme de façon abstraite, et
souvent considérés comme lo-
giques uniquement sous le pré-
texte qu'ils méprisent le réel.
Les mythes sont ceux du
prix Nobel, de la recherche et
des standards américains. Ce
sont des mythes parce que nul
ne sait si ce qui est bon pour
les Etats-Unis est bon pour la
France. Il n'est même pas dé-
montré que ce qui est fait pour
les Etats-Unis est bon pour les
Etats-Unis (d'excellents esprits
en doutent aux Etats-Unis mê-
me). Enfin, si des recherches
non médicales peuvent avoir
en médecine un intérêt capital,
il n'est pas démontré qu'il n'y
a pas un secteur proprement
médical de recherches dans le-
quel il serait bon que les cher-
cheurs aient eu une formation
réellement médicale.
Etre vétérinaire
pour monter à cheval
pour monter à cheval
Les traditions implicites et
l'abstraction prétendument lo-
giques se conjuguent dans un
monde de pensées qui aboutit
à projeter sur l'enseignement
médical un schéma théorique
et uniforme de la hiérarchie
des connaissances. Le mode de
raisonnement est à peu près le
même que si l'on expliquait que
nul n'a le droit de conduire un
véhicule avec ou sans moteur
s'il n'est capable d'en ex-
pliquer les mécanismes. Le per-
mis de conduire serait donc né-
cessairement subordonné à
une bonne connaissance des
moteurs et, pourquoi pas, de
l'équipement électrique des
voitures. On n'aurait même pas
le droit de revenir à la voiture
à cheval, car il faudrait pour
cela connaître l'anatomie, la
physiologie et la pathologie de
la plus noble conquête de
l'homme. Nous signalons cette
solution à ceux qui veulent ré-
soudre le problème de la circu-
lation dans Paris aux heures de
pointe. En fait, c'est bien pour
des raisons de cet ordre, et
guère plus explicites, que l'on a
décidé qu'il fallait enseigner
aux futurs médecins les mathé-
matiques, la physique, la bio-
chimie, la génétique ou l'anato-
mie, voire d'ailleurs la pharma-
l'abstraction prétendument lo-
giques se conjuguent dans un
monde de pensées qui aboutit
à projeter sur l'enseignement
médical un schéma théorique
et uniforme de la hiérarchie
des connaissances. Le mode de
raisonnement est à peu près le
même que si l'on expliquait que
nul n'a le droit de conduire un
véhicule avec ou sans moteur
s'il n'est capable d'en ex-
pliquer les mécanismes. Le per-
mis de conduire serait donc né-
cessairement subordonné à
une bonne connaissance des
moteurs et, pourquoi pas, de
l'équipement électrique des
voitures. On n'aurait même pas
le droit de revenir à la voiture
à cheval, car il faudrait pour
cela connaître l'anatomie, la
physiologie et la pathologie de
la plus noble conquête de
l'homme. Nous signalons cette
solution à ceux qui veulent ré-
soudre le problème de la circu-
lation dans Paris aux heures de
pointe. En fait, c'est bien pour
des raisons de cet ordre, et
guère plus explicites, que l'on a
décidé qu'il fallait enseigner
aux futurs médecins les mathé-
matiques, la physique, la bio-
chimie, la génétique ou l'anato-
mie, voire d'ailleurs la pharma-
cologie et pas mal de physio-
logie.
logie.
Qu'on ne se méprenne pas
sur ce que nous pensons ; les
médecins ont besoin de com-
prendre ce qu'ils font, d'avoir à
la fois une culture générale,
une culture scientifique et une
culture technique très préci-
ses ; le tout est de savoir la-
quelle, comment et pourquoi.
Qu'on ne s'étonne pas de nous
voir proposer une solution à un
problème qui n'a jamais été
examiné. Qu'on nous permette,
pourtant, de dire qu'il y a une
méthode qui ne permettra ja-
mais de trouver la solution.
C'est de demander aux chimis-
tes ce qui doit être enseigné
en chimie, aux anatomistes ce
qui doit être enseigné de l'ana-
tomie, aux pharmacologues ce
qui doit être enseigné en phar-
macologie, etc. Seule une re-
cherche en commun de bonne
foi, d'ailleurs difficile, pourra
mettre au point ce qu'il faut
enseigner et à qui. Nous pen-
sons même qu'il n'est pas rai-
sonnable, dans un système
français où tout repose sur les
examens, que chaque spécialis-
te puisse décider, sans contrô-
le, dans sa spécialité, du ni-
veau des examens et des ques-
tions posées. C'est réduire à
zéro tous les efforts qui peu-
vent être faits, par ailleurs,
d'allégement des programmes
ou même de modifications ra-
dicales de ceux-ci.
sur ce que nous pensons ; les
médecins ont besoin de com-
prendre ce qu'ils font, d'avoir à
la fois une culture générale,
une culture scientifique et une
culture technique très préci-
ses ; le tout est de savoir la-
quelle, comment et pourquoi.
Qu'on ne s'étonne pas de nous
voir proposer une solution à un
problème qui n'a jamais été
examiné. Qu'on nous permette,
pourtant, de dire qu'il y a une
méthode qui ne permettra ja-
mais de trouver la solution.
C'est de demander aux chimis-
tes ce qui doit être enseigné
en chimie, aux anatomistes ce
qui doit être enseigné de l'ana-
tomie, aux pharmacologues ce
qui doit être enseigné en phar-
macologie, etc. Seule une re-
cherche en commun de bonne
foi, d'ailleurs difficile, pourra
mettre au point ce qu'il faut
enseigner et à qui. Nous pen-
sons même qu'il n'est pas rai-
sonnable, dans un système
français où tout repose sur les
examens, que chaque spécialis-
te puisse décider, sans contrô-
le, dans sa spécialité, du ni-
veau des examens et des ques-
tions posées. C'est réduire à
zéro tous les efforts qui peu-
vent être faits, par ailleurs,
d'allégement des programmes
ou même de modifications ra-
dicales de ceux-ci.
C'est donc dans un même
esprit de collaboration interdis-
ciplinaire que devrait être posé
le problème du contenu et ce-
lui de la pédagogie dans les fa-
cultés de médecine. Quelles
sont les méthodes d'enseigne-
ment à employer ? Faut-il assu-
rer plusieurs niveaux d'ensei-
gnement ? A quel stade doit
s' o p é r e r la diversification ?
Qu'est-ce que la recherche mé-
dicale ? Quelles sont les diver-
sifications à opérer en fonc-
tion des divers aspects de la
formation professionnelle à as-
surer ? Y a-t-il un curriculum ou
plusieurs ?
esprit de collaboration interdis-
ciplinaire que devrait être posé
le problème du contenu et ce-
lui de la pédagogie dans les fa-
cultés de médecine. Quelles
sont les méthodes d'enseigne-
ment à employer ? Faut-il assu-
rer plusieurs niveaux d'ensei-
gnement ? A quel stade doit
s' o p é r e r la diversification ?
Qu'est-ce que la recherche mé-
dicale ? Quelles sont les diver-
sifications à opérer en fonc-
tion des divers aspects de la
formation professionnelle à as-
surer ? Y a-t-il un curriculum ou
plusieurs ?
La fixation de ce (ou ces)
curriculum permettrait une
meilleure opinion sur une ques-
tion fondamentale : à quel ni-
veau de connaissances recru-
tera-t-on les étudiants en méde-
cine ? Il n'est pas possible de
curriculum permettrait une
meilleure opinion sur une ques-
tion fondamentale : à quel ni-
veau de connaissances recru-
tera-t-on les étudiants en méde-
cine ? Il n'est pas possible de
raisonner comme si l'enseigne-
ment secondaire n'avait pas
fait l'objet en même temps de
modifications profondes, totale-
ment incoordonnées avec les
besoins de l'enseignement su-
périeur. Dans trois ans au plus
tard, les premiers fruits de la
réforme Fouchet sortiront de
classe terminale. Cette réfor-
me n'a fait que renforcer l'évo-
lution, catastrophique pour no-
tre pays, qui a consisté à faire
jouer aux sciences le rôle
qu'avait joué, au XIXe siècle, le
latin : celui d'une centrifugeuse.
Le refus des scientifiques de
l'enseignement secondaire d'es-
sayer de récupérer dans leur
discipline des enfants qui ne
sont pas précocement motivés
pour elles et précocement bril-
lants, ceux dont en troisième
on peut prévoir qu'ils ne feront
pas des taupins, a été mainte-
nant concrétisé par des textes
baptisés « orientation ».
ment secondaire n'avait pas
fait l'objet en même temps de
modifications profondes, totale-
ment incoordonnées avec les
besoins de l'enseignement su-
périeur. Dans trois ans au plus
tard, les premiers fruits de la
réforme Fouchet sortiront de
classe terminale. Cette réfor-
me n'a fait que renforcer l'évo-
lution, catastrophique pour no-
tre pays, qui a consisté à faire
jouer aux sciences le rôle
qu'avait joué, au XIXe siècle, le
latin : celui d'une centrifugeuse.
Le refus des scientifiques de
l'enseignement secondaire d'es-
sayer de récupérer dans leur
discipline des enfants qui ne
sont pas précocement motivés
pour elles et précocement bril-
lants, ceux dont en troisième
on peut prévoir qu'ils ne feront
pas des taupins, a été mainte-
nant concrétisé par des textes
baptisés « orientation ».
Etre indigne
pour devenir bon médecin
pour devenir bon médecin
Ces textes feront prendre,
en fait, au niveau de la troisiè-
me, une décision orientant
les enfants vers les sections C
et D d'après leur niveau ma-
thématique à l'âge de 14 ans.
Les C seront happés vers la fa-
culté des sciences, probable-
ment un certain nombre de D
aussi. Nous ne garderons de D
que tant que les facultés des
sciences continueront dans leur
domaine « à décourager I e s
beaux-arts ». Ce sont les taux
invraisemblables d'échecs aux
propédeutiques scientifiques
qui ont repoussé vers la méde-
cine un nombre accru de candi-
dats ces deux dernières années.
Ceci implique que le recrute-
ment d'étudiants en médecine
se fera sur la double sélection
suivante : avoir été jugé digne à
14 ans de faire des mathémati-
ques, en avoir été jugé indigne
à 20 ans. Nous ne sommes pas
absolument sûrs que cette mé-
thode, qu'on baptise sélection
si l'on est honnête ou orienta-
tion si l'on veut l'habiller d'ori-
peaux plus clinquants, soit sen-
sée. Non que les éléments re-
crutés soient mauvais, mais
parce qu'en fait, traditionnel-
lement, la médecine a toujours
reçu d'excellents éléments qui
en fait, au niveau de la troisiè-
me, une décision orientant
les enfants vers les sections C
et D d'après leur niveau ma-
thématique à l'âge de 14 ans.
Les C seront happés vers la fa-
culté des sciences, probable-
ment un certain nombre de D
aussi. Nous ne garderons de D
que tant que les facultés des
sciences continueront dans leur
domaine « à décourager I e s
beaux-arts ». Ce sont les taux
invraisemblables d'échecs aux
propédeutiques scientifiques
qui ont repoussé vers la méde-
cine un nombre accru de candi-
dats ces deux dernières années.
Ceci implique que le recrute-
ment d'étudiants en médecine
se fera sur la double sélection
suivante : avoir été jugé digne à
14 ans de faire des mathémati-
ques, en avoir été jugé indigne
à 20 ans. Nous ne sommes pas
absolument sûrs que cette mé-
thode, qu'on baptise sélection
si l'on est honnête ou orienta-
tion si l'on veut l'habiller d'ori-
peaux plus clinquants, soit sen-
sée. Non que les éléments re-
crutés soient mauvais, mais
parce qu'en fait, traditionnel-
lement, la médecine a toujours
reçu d'excellents éléments qui
venaient d'ailleurs, qui avaient
gagné les classes terminales
grâce à un certain équilibre de
notes entre sciences et lettres,
qui souvent ne s'étaient inté-
ressés aux sciences que plus
tard et pas nécessairement aux
mathématiques. De très bons
éléments venaient de sections
littéraires moins strictement
spécialisées que les sections
littéraires actuelles. Ces élé-
ments n'avaient pas été volon-
tairement découragés, par des
enseignants du secondaire, de
s'intéresser aux sciences.
gagné les classes terminales
grâce à un certain équilibre de
notes entre sciences et lettres,
qui souvent ne s'étaient inté-
ressés aux sciences que plus
tard et pas nécessairement aux
mathématiques. De très bons
éléments venaient de sections
littéraires moins strictement
spécialisées que les sections
littéraires actuelles. Ces élé-
ments n'avaient pas été volon-
tairement découragés, par des
enseignants du secondaire, de
s'intéresser aux sciences.
Nous ne pouvons probable-
ment plus rien faire pour empê-
cher l'enseignement secondai-
re de suivre son destin, mais
nous devons nous poser le pro-
blème de la récupération au
stade de la propédeutique.
Quelque chose d'analogue a
été fait pour les sciences éco-
nomiques par les facultés de
droit. Il faudra peut-être pré-
voir des avenues multiples me-
nant vers la médecine à partir
de niveaux différents de l'en-
seignement secondaire. On
pourrait concevoir des propé-
deutiques dont le régime ne se-
rait pas uniforme, mais dont les
matières seraient variées, com-
plémentaires de l'enseignement
secondaire reçu antérieurement
par l'étudiant.
ment plus rien faire pour empê-
cher l'enseignement secondai-
re de suivre son destin, mais
nous devons nous poser le pro-
blème de la récupération au
stade de la propédeutique.
Quelque chose d'analogue a
été fait pour les sciences éco-
nomiques par les facultés de
droit. Il faudra peut-être pré-
voir des avenues multiples me-
nant vers la médecine à partir
de niveaux différents de l'en-
seignement secondaire. On
pourrait concevoir des propé-
deutiques dont le régime ne se-
rait pas uniforme, mais dont les
matières seraient variées, com-
plémentaires de l'enseignement
secondaire reçu antérieurement
par l'étudiant.
Une telle formule ne nous
choquerait pas. Nous souhaite-
rions même un recrutement
complémentaire plus largement
ouvert à partir des diplômes
para-médicaux à caractère plus
technique. Nous souhaiterions
que ceci ne soit qu'un début et
qu'au lieu d'enfermer le curri-
culum des étudiants dans le ci-
ment et le métal de l'uniformité
bureaucratique, des options
souples autour de troncs com-
muns réduits à l'essentiel réa-
lisent plusieurs chemins pour
aboutir à la fin des études de
médecine. Nous allions dire
que c'est ainsi que fonction-
naient autrefois dans la liberté
les facultés de lettres et de
sciences. Mais hélas, c'est pour
constater que, précisément,
c'est cela qui vient d'être sup-
primé. Peut-être avons-nous, en
médecine, atteint un point tel
dans la rigidité administrative,
que sa malfaisance deviendra
enfin assez évidente pour qu'on
puisse en secouer le joug.
choquerait pas. Nous souhaite-
rions même un recrutement
complémentaire plus largement
ouvert à partir des diplômes
para-médicaux à caractère plus
technique. Nous souhaiterions
que ceci ne soit qu'un début et
qu'au lieu d'enfermer le curri-
culum des étudiants dans le ci-
ment et le métal de l'uniformité
bureaucratique, des options
souples autour de troncs com-
muns réduits à l'essentiel réa-
lisent plusieurs chemins pour
aboutir à la fin des études de
médecine. Nous allions dire
que c'est ainsi que fonction-
naient autrefois dans la liberté
les facultés de lettres et de
sciences. Mais hélas, c'est pour
constater que, précisément,
c'est cela qui vient d'être sup-
primé. Peut-être avons-nous, en
médecine, atteint un point tel
dans la rigidité administrative,
que sa malfaisance deviendra
enfin assez évidente pour qu'on
puisse en secouer le joug.
11
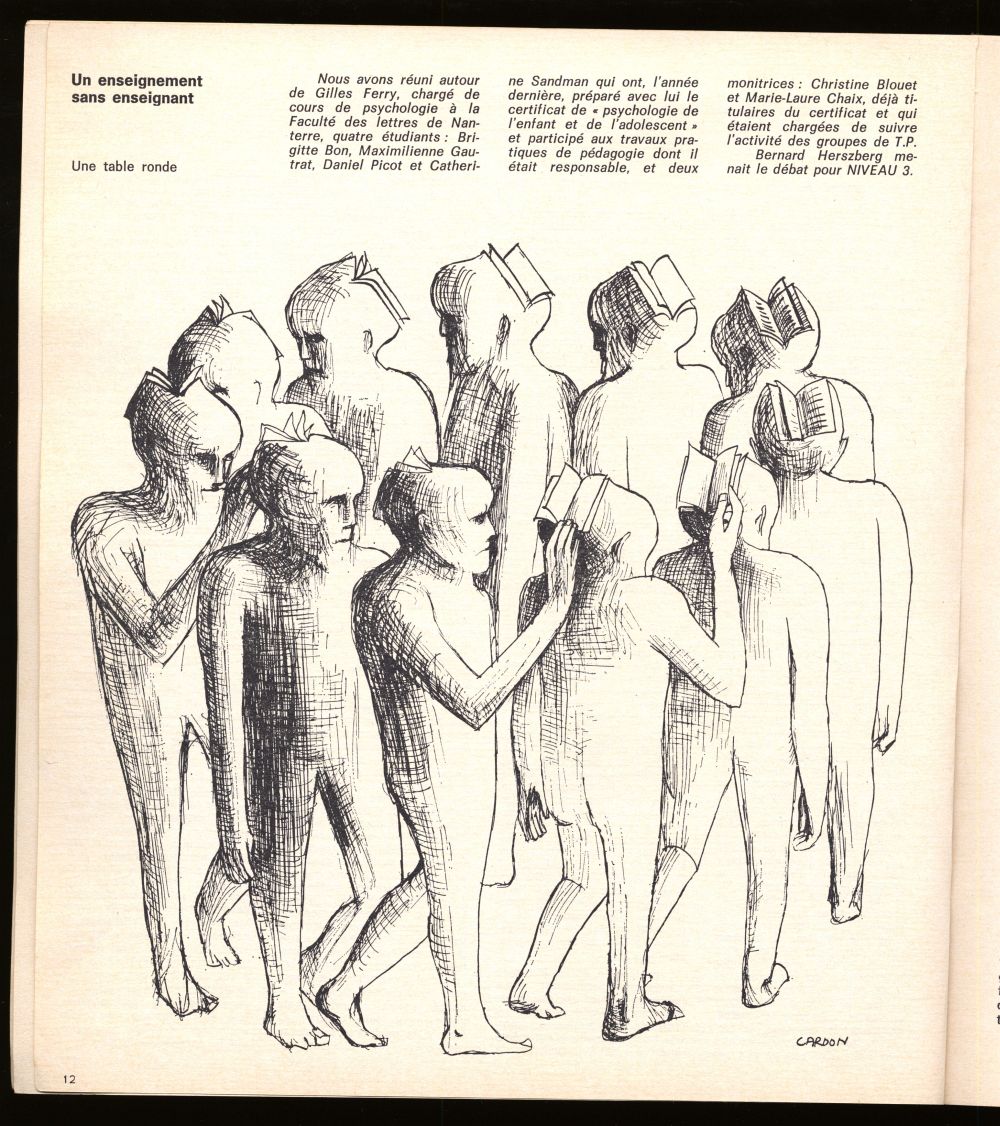

Un enseignement
sans enseignant
sans enseignant
Une table ronde
Nous avons réuni autour
de Gilles Ferry, chargé de
cours de psychologie à la
Faculté des lettres de A/an-
terre, quatre étudiants : Bri-
gitte Bon, Maximilienne Gau-
trat, Daniel Picot et Catheri-
de Gilles Ferry, chargé de
cours de psychologie à la
Faculté des lettres de A/an-
terre, quatre étudiants : Bri-
gitte Bon, Maximilienne Gau-
trat, Daniel Picot et Catheri-
ne Sandman qui ont, l'année
dernière, préparé avec lui le
certificat de « psychologie de
l'enfant et de l'adolescent »
et participé aux travaux pra-
tiques de pédagogie dont il
était responsable, et deux
dernière, préparé avec lui le
certificat de « psychologie de
l'enfant et de l'adolescent »
et participé aux travaux pra-
tiques de pédagogie dont il
était responsable, et deux
monitrices : Christine Blouet
et Marie-Laure Chaix, déjà ti-
tulaires du certificat et qui
étaient chargées de suivre
l'activité des groupes de T.P.
Bernard Herszberg me-
nait le débat pour NIVEAU 3.
et Marie-Laure Chaix, déjà ti-
tulaires du certificat et qui
étaient chargées de suivre
l'activité des groupes de T.P.
Bernard Herszberg me-
nait le débat pour NIVEAU 3.
12
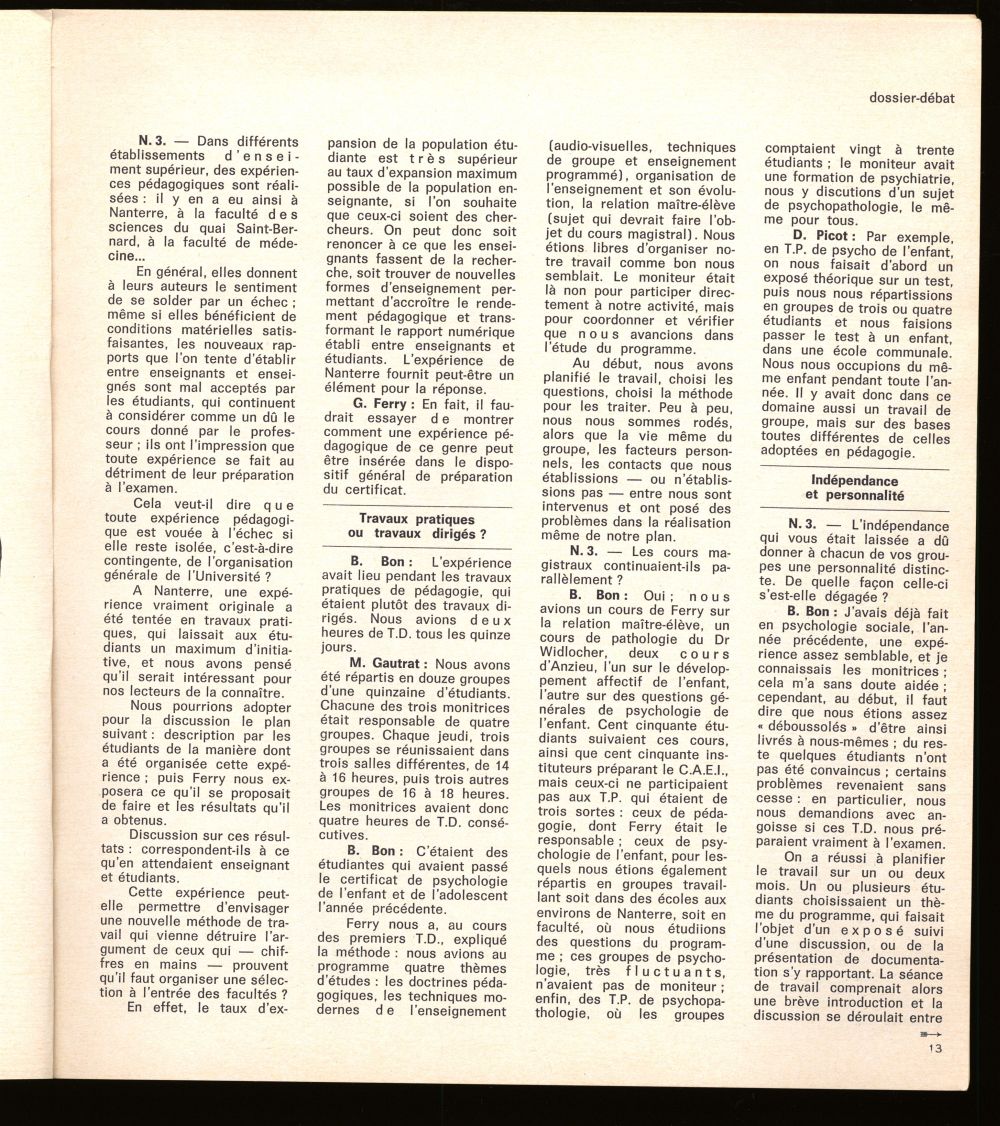

dossier-débat
N.3. — Dans différents
établissements d'ensei-
ment supérieur, des expérien-
ces pédagogiques sont réali-
sées : il y en a eu ainsi à
Nanterre, à la faculté des
sciences du quai Saint-Ber-
nard, à la faculté de méde-
cine...
établissements d'ensei-
ment supérieur, des expérien-
ces pédagogiques sont réali-
sées : il y en a eu ainsi à
Nanterre, à la faculté des
sciences du quai Saint-Ber-
nard, à la faculté de méde-
cine...
En général, elles donnent
à leurs auteurs le sentiment
de se solder par un échec ;
même si elles bénéficient de
conditions matérielles satis-
faisantes, les nouveaux rap-
ports que l'on tente d'établir
entre enseignants et ensei-
gnés sont mal acceptés par
les étudiants, qui continuent
à considérer comme un dû le
cours donné par le profes-
seur ; ils ont l'impression que
toute expérience se fait au
détriment de leur préparation
à l'examen.
à leurs auteurs le sentiment
de se solder par un échec ;
même si elles bénéficient de
conditions matérielles satis-
faisantes, les nouveaux rap-
ports que l'on tente d'établir
entre enseignants et ensei-
gnés sont mal acceptés par
les étudiants, qui continuent
à considérer comme un dû le
cours donné par le profes-
seur ; ils ont l'impression que
toute expérience se fait au
détriment de leur préparation
à l'examen.
Cela veut-il dire que
toute expérience pédagogi-
que est vouée à l'échec si
elle reste isolée, c'est-à-dire
contingente, de l'organisation
générale de l'Université ?
toute expérience pédagogi-
que est vouée à l'échec si
elle reste isolée, c'est-à-dire
contingente, de l'organisation
générale de l'Université ?
A Nanterre, une expé-
rience vraiment originale a
été tentée en travaux prati-
ques, qui laissait aux étu-
diants un maximum d'initia-
tive, et nous avons pensé
qu'il serait intéressant pour
nos lecteurs de la connaître.
rience vraiment originale a
été tentée en travaux prati-
ques, qui laissait aux étu-
diants un maximum d'initia-
tive, et nous avons pensé
qu'il serait intéressant pour
nos lecteurs de la connaître.
Nous pourrions adopter
pour la discussion le plan
suivant : description par les
étudiants de la manière dont
a été organisée cette expé-
rience ; puis Ferry nous ex-
posera ce qu'il se proposait
de faire et les résultats qu'il
a obtenus.
pour la discussion le plan
suivant : description par les
étudiants de la manière dont
a été organisée cette expé-
rience ; puis Ferry nous ex-
posera ce qu'il se proposait
de faire et les résultats qu'il
a obtenus.
Discussion sur ces résul-
tats : correspondent-ils à ce
qu'en attendaient enseignant
et étudiants.
tats : correspondent-ils à ce
qu'en attendaient enseignant
et étudiants.
Cette expérience peut-
elle permettre d'envisager
une nouvelle méthode de tra-
vail qui vienne détruire l'ar-
gument de ceux qui — chif-
fres en mains — prouvent
qu'il faut organiser une sélec-
tion à l'entrée des facultés ?
elle permettre d'envisager
une nouvelle méthode de tra-
vail qui vienne détruire l'ar-
gument de ceux qui — chif-
fres en mains — prouvent
qu'il faut organiser une sélec-
tion à l'entrée des facultés ?
En effet, le taux d'ex-
pansion de la population étu-
diante est très supérieur
au taux d'expansion maximum
possible de la population en-
seignante, si l'on souhaite
que ceux-ci soient des cher-
cheurs. On peut donc soit
renoncer à ce que les ensei-
gnants fassent de la recher-
che, soit trouver de nouvelles
formes d'enseignement per-
mettant d'accroître le rende-
ment pédagogique et trans-
formant le rapport numérique
établi entre enseignants et
étudiants. L'expérience de
Nanterre fournit peut-être un
élément pour la réponse.
diante est très supérieur
au taux d'expansion maximum
possible de la population en-
seignante, si l'on souhaite
que ceux-ci soient des cher-
cheurs. On peut donc soit
renoncer à ce que les ensei-
gnants fassent de la recher-
che, soit trouver de nouvelles
formes d'enseignement per-
mettant d'accroître le rende-
ment pédagogique et trans-
formant le rapport numérique
établi entre enseignants et
étudiants. L'expérience de
Nanterre fournit peut-être un
élément pour la réponse.
G. Ferry : En fait, il fau-
drait essayer d e montrer
comment une expérience pé-
dagogique de ce genre peut
être insérée dans le dispo-
sitif général de préparation
du certificat.
drait essayer d e montrer
comment une expérience pé-
dagogique de ce genre peut
être insérée dans le dispo-
sitif général de préparation
du certificat.
Travaux pratiques
ou travaux dirigés ?
ou travaux dirigés ?
B. Bon : L'expérience
avait lieu pendant les travaux
pratiques de pédagogie, qui
étaient plutôt des travaux di-
rigés. Nous avions deux
heures de T.D. tous les quinze
jours.
avait lieu pendant les travaux
pratiques de pédagogie, qui
étaient plutôt des travaux di-
rigés. Nous avions deux
heures de T.D. tous les quinze
jours.
M. Gautrat : Nous avons
été répartis en douze groupes
d'une quinzaine d'étudiants.
Chacune des trois monitrices
était responsable de quatre
groupes. Chaque jeudi, trois
groupes se réunissaient dans
trois salles différentes, de 14
à 16 heures, puis trois autres
groupes de 16 à 18 heures.
Les monitrices avaient donc
quatre heures de T.D. consé-
cutives.
été répartis en douze groupes
d'une quinzaine d'étudiants.
Chacune des trois monitrices
était responsable de quatre
groupes. Chaque jeudi, trois
groupes se réunissaient dans
trois salles différentes, de 14
à 16 heures, puis trois autres
groupes de 16 à 18 heures.
Les monitrices avaient donc
quatre heures de T.D. consé-
cutives.
B. Bon : C'étaient des
étudiantes qui avaient passé
le certificat de psychologie
de l'enfant et de l'adolescent
l'année précédente.
étudiantes qui avaient passé
le certificat de psychologie
de l'enfant et de l'adolescent
l'année précédente.
Ferry nous a, au cours
des premiers T.D., expliqué
la méthode : nous avions au
programme quatre thèmes
d'études : les doctrines péda-
gogiques, les techniques mo-
dernes de l'enseignement
des premiers T.D., expliqué
la méthode : nous avions au
programme quatre thèmes
d'études : les doctrines péda-
gogiques, les techniques mo-
dernes de l'enseignement
(audio-visuelles, techniques
de groupe et enseignement
programmé), organisation de
l'enseignement et son évolu-
tion, la relation maître-élève
(sujet qui devrait faire l'ob-
jet du cours magistral). Nous
étions libres d'organiser no-
tre travail comme bon nous
semblait. Le moniteur était
là non pour participer direc-
tement à notre activité, mais
pour coordonner et vérifier
que nous avancions dans
l'étude du programme.
de groupe et enseignement
programmé), organisation de
l'enseignement et son évolu-
tion, la relation maître-élève
(sujet qui devrait faire l'ob-
jet du cours magistral). Nous
étions libres d'organiser no-
tre travail comme bon nous
semblait. Le moniteur était
là non pour participer direc-
tement à notre activité, mais
pour coordonner et vérifier
que nous avancions dans
l'étude du programme.
Au début, nous avons
planifié le travail, choisi les
questions, choisi la méthode
pour les traiter. Peu à peu,
nous nous sommes rodés,
alors que la vie même du
groupe, les facteurs person-
nels, les contacts que nous
établissions — ou n'établis-
sions pas — entre nous sont
intervenus et ont posé des
problèmes dans la réalisation
même de notre plan.
planifié le travail, choisi les
questions, choisi la méthode
pour les traiter. Peu à peu,
nous nous sommes rodés,
alors que la vie même du
groupe, les facteurs person-
nels, les contacts que nous
établissions — ou n'établis-
sions pas — entre nous sont
intervenus et ont posé des
problèmes dans la réalisation
même de notre plan.
N.3. — Les cours ma-
gistraux continuaient-ils pa-
rallèlement ?
gistraux continuaient-ils pa-
rallèlement ?
B. Bon : Oui ; nous
avions un cours de Ferry sur
la relation maître-élève, un
cours de pathologie du Dr
Widlocher, deux cours
d'Anzieu, l'un sur le dévelop-
pement affectif de l'enfant,
l'autre sur des questions gé-
nérales de psychologie de
l'enfant. Cent cinquante étu-
diants suivaient ces cours,
ainsi que cent cinquante ins-
tituteurs préparant le C.A.E.I.,
mais ceux-ci ne participaient
pas aux T.P. qui étaient de
trois sortes : ceux de péda-
gogie, dont Ferry était le
responsable ; ceux de psy-
chologie de l'enfant, pour les-
quels nous étions également
répartis en groupes travail-
lant soit dans des écoles aux
environs de Nanterre, soit en
faculté, où nous étudiions
des questions du program-
me ; ces groupes de psycho-
logie, très fluctuants,
n'avaient pas de moniteur ;
enfin, des T.P. de psychopa-
thologie, où les groupes
avions un cours de Ferry sur
la relation maître-élève, un
cours de pathologie du Dr
Widlocher, deux cours
d'Anzieu, l'un sur le dévelop-
pement affectif de l'enfant,
l'autre sur des questions gé-
nérales de psychologie de
l'enfant. Cent cinquante étu-
diants suivaient ces cours,
ainsi que cent cinquante ins-
tituteurs préparant le C.A.E.I.,
mais ceux-ci ne participaient
pas aux T.P. qui étaient de
trois sortes : ceux de péda-
gogie, dont Ferry était le
responsable ; ceux de psy-
chologie de l'enfant, pour les-
quels nous étions également
répartis en groupes travail-
lant soit dans des écoles aux
environs de Nanterre, soit en
faculté, où nous étudiions
des questions du program-
me ; ces groupes de psycho-
logie, très fluctuants,
n'avaient pas de moniteur ;
enfin, des T.P. de psychopa-
thologie, où les groupes
comptaient vingt à trente
étudiants ; le moniteur avait
une formation de psychiatrie,
nous y discutions d'un sujet
de psychopathologie, le mê-
me pour tous.
étudiants ; le moniteur avait
une formation de psychiatrie,
nous y discutions d'un sujet
de psychopathologie, le mê-
me pour tous.
D. Picot : Par exemple,
en T.P. de psycho de l'enfant,
on nous faisait d'abord un
exposé théorique sur un test,
puis nous nous répartissions
en groupes de trois ou quatre
étudiants et nous faisions
passer le test à un enfant,
dans une école communale.
Nous nous occupions du mê-
me enfant pendant toute l'an-
née. Il y avait donc dans ce
domaine aussi un travail de
groupe, mais sur des bases
toutes différentes de celles
adoptées en pédagogie.
en T.P. de psycho de l'enfant,
on nous faisait d'abord un
exposé théorique sur un test,
puis nous nous répartissions
en groupes de trois ou quatre
étudiants et nous faisions
passer le test à un enfant,
dans une école communale.
Nous nous occupions du mê-
me enfant pendant toute l'an-
née. Il y avait donc dans ce
domaine aussi un travail de
groupe, mais sur des bases
toutes différentes de celles
adoptées en pédagogie.
Indépendance
et personnalité
et personnalité
N. 3. — L'indépendance
qui vous était laissée a dû
donner à chacun de vos grou-
pes une personnalité distinc-
te. De quelle façon celle-ci
s'est-elle dégagée ?
qui vous était laissée a dû
donner à chacun de vos grou-
pes une personnalité distinc-
te. De quelle façon celle-ci
s'est-elle dégagée ?
B. Bon : J'avais déjà fait
en psychologie sociale, l'an-
née précédente, une expé-
rience assez semblable, et je
connaissais les monitrices ;
cela m'a sans doute aidée ;
cependant, au début, il faut
dire que nous étions assez
« déboussolés » d'être ainsi
livrés à nous-mêmes ; du res-
te quelques étudiants n'ont
pas été convaincus ; certains
problèmes revenaient sans
cesse : en particulier, nous
nous demandions avec an-
goisse si ces T.D. nous pré-
paraient vraiment à l'examen.
en psychologie sociale, l'an-
née précédente, une expé-
rience assez semblable, et je
connaissais les monitrices ;
cela m'a sans doute aidée ;
cependant, au début, il faut
dire que nous étions assez
« déboussolés » d'être ainsi
livrés à nous-mêmes ; du res-
te quelques étudiants n'ont
pas été convaincus ; certains
problèmes revenaient sans
cesse : en particulier, nous
nous demandions avec an-
goisse si ces T.D. nous pré-
paraient vraiment à l'examen.
On a réussi à planifier
le travail sur un ou deux
mois. Un ou plusieurs étu-
diants choisissaient un thè-
me du programme, qui faisait
l'objet d'un exposé suivi
d'une discussion, ou de la
présentation de documenta-
tion s'y rapportant. La séance
de travail comprenait alors
une brève introduction et la
discussion se déroulait entre
le travail sur un ou deux
mois. Un ou plusieurs étu-
diants choisissaient un thè-
me du programme, qui faisait
l'objet d'un exposé suivi
d'une discussion, ou de la
présentation de documenta-
tion s'y rapportant. La séance
de travail comprenait alors
une brève introduction et la
discussion se déroulait entre
13
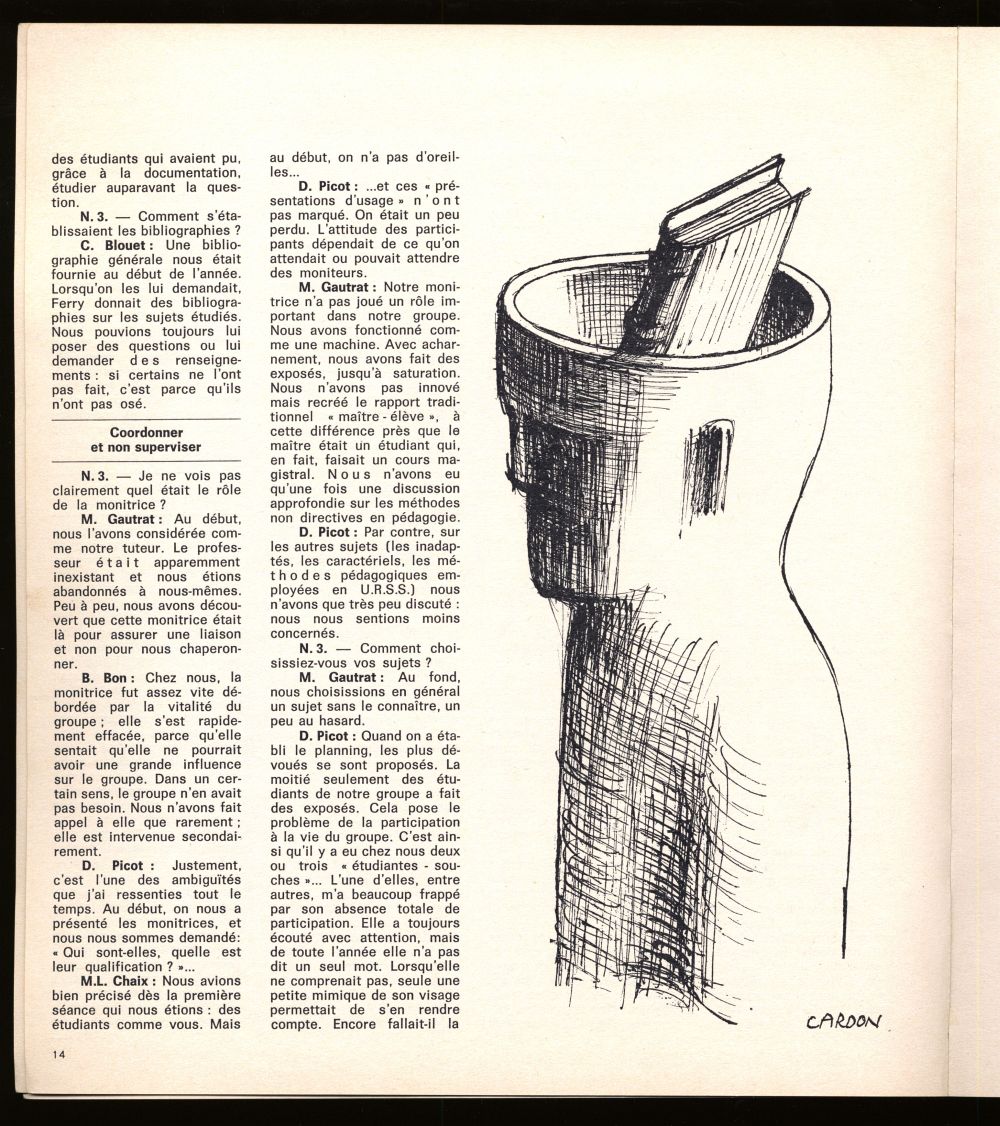

des étudiants qui avaient pu,
grâce à la documentation,
étudier auparavant la ques-
tion.
grâce à la documentation,
étudier auparavant la ques-
tion.
N. 3. — Comment s'éta-
blissaient les bibliographies ?
blissaient les bibliographies ?
C. Blouet : Une biblio-
graphie générale nous était
fournie au début de l'année.
Lorsqu'on les lui demandait,
Ferry donnait des bibliogra-
phies sur les sujets étudiés.
Nous pouvions toujours lui
poser des questions ou lui
demander des renseigne-
ments : si certains ne l'ont
pas fait, c'est parce qu'ils
n'ont pas osé.
graphie générale nous était
fournie au début de l'année.
Lorsqu'on les lui demandait,
Ferry donnait des bibliogra-
phies sur les sujets étudiés.
Nous pouvions toujours lui
poser des questions ou lui
demander des renseigne-
ments : si certains ne l'ont
pas fait, c'est parce qu'ils
n'ont pas osé.
Coordonner
et non superviser
et non superviser
N.3. — Je ne vois pas
clairement quel était le rôle
de la monitrice ?
clairement quel était le rôle
de la monitrice ?
M. Gautrat : Au début,
nous l'avons considérée com-
me notre tuteur. Le profes-
seur était apparemment
inexistant et nous étions
abandonnés à nous-mêmes.
Peu à peu, nous avons décou-
vert que cette monitrice était
là pour assurer une liaison
et non pour nous chaperon-
ner.
nous l'avons considérée com-
me notre tuteur. Le profes-
seur était apparemment
inexistant et nous étions
abandonnés à nous-mêmes.
Peu à peu, nous avons décou-
vert que cette monitrice était
là pour assurer une liaison
et non pour nous chaperon-
ner.
B. Bon : Chez nous, la
monitrice fut assez vite dé-
bordée par la vitalité du
groupe ; elle s'est rapide-
ment effacée, parce qu'elle
sentait qu'elle ne pourrait
avoir une grande influence
sur le groupe. Dans un cer-
tain sens, le groupe n'en avait
pas besoin. Nous n'avons fait
appel à elle que rarement ;
elle est intervenue secondai-
rement.
monitrice fut assez vite dé-
bordée par la vitalité du
groupe ; elle s'est rapide-
ment effacée, parce qu'elle
sentait qu'elle ne pourrait
avoir une grande influence
sur le groupe. Dans un cer-
tain sens, le groupe n'en avait
pas besoin. Nous n'avons fait
appel à elle que rarement ;
elle est intervenue secondai-
rement.
D. Picot : Justement,
c'est l'une des ambiguïtés
que j'ai ressenties tout le
temps. Au début, on nous a
présenté les monitrices, et
nous nous sommes demandé:
« Qui sont-elles, quelle est
leur qualification ? »...
c'est l'une des ambiguïtés
que j'ai ressenties tout le
temps. Au début, on nous a
présenté les monitrices, et
nous nous sommes demandé:
« Qui sont-elles, quelle est
leur qualification ? »...
M.L. Chaix : Nous avions
bien précisé dès la première
séance qui nous étions : des
étudiants comme vous. Mais
bien précisé dès la première
séance qui nous étions : des
étudiants comme vous. Mais
au début, on n'a pas d'oreil-
les...
les...
D. Picot : ...et ces « pré-
sentations d'usage » n'ont
pas marqué. On était un peu
perdu. L'attitude des partici-
pants dépendait de ce qu'on
attendait ou pouvait attendre
des moniteurs.
sentations d'usage » n'ont
pas marqué. On était un peu
perdu. L'attitude des partici-
pants dépendait de ce qu'on
attendait ou pouvait attendre
des moniteurs.
M. Gautrat : Notre moni-
trice n'a pas joué un rôle im-
portant dans notre groupe.
Nous avons fonctionné com-
me une machine. Avec achar-
nement, nous avons fait des
exposés, jusqu'à saturation.
Nous n'avons pas innové
mais recréé le rapport tradi-
tionnel « maître - élève », à
cette différence près que le
maître était un étudiant qui,
en fait, faisait un cours ma-
gistral. Nous n'avons eu
qu'une fois une discussion
approfondie sur les méthodes
non directives en pédagogie.
trice n'a pas joué un rôle im-
portant dans notre groupe.
Nous avons fonctionné com-
me une machine. Avec achar-
nement, nous avons fait des
exposés, jusqu'à saturation.
Nous n'avons pas innové
mais recréé le rapport tradi-
tionnel « maître - élève », à
cette différence près que le
maître était un étudiant qui,
en fait, faisait un cours ma-
gistral. Nous n'avons eu
qu'une fois une discussion
approfondie sur les méthodes
non directives en pédagogie.
D. Picot : Par contre, sur
les autres sujets (les inadap-
tés, les caractériels, les mé-
t h o d e s pédagogiques em-
ployées en U.R.S.S.) nous
n'avons que très peu discuté :
nous nous sentions moins
concernés.
les autres sujets (les inadap-
tés, les caractériels, les mé-
t h o d e s pédagogiques em-
ployées en U.R.S.S.) nous
n'avons que très peu discuté :
nous nous sentions moins
concernés.
N. 3. — Comment choi-
sissiez-vous vos sujets ?
sissiez-vous vos sujets ?
M. Gautrat : Au fond,
nous choisissions en général
un sujet sans le connaître, un
peu au hasard.
nous choisissions en général
un sujet sans le connaître, un
peu au hasard.
D. Picot : Quand on a éta-
bli le planning, les plus dé-
voués se sont proposés. La
moitié seulement des étu-
diants de notre groupe a fait
des exposés. Cela pose le
problème de la participation
à la vie du groupe. C'est ain-
si qu'il y a eu chez nous deux
ou trois « étudiantes - sou-
ches »... L'une d'elles, entre
autres, m'a beaucoup frappé
par son absence totale de
participation. Elle a toujours
écouté avec attention, mais
de toute l'année elle n'a pas
dit un seul mot. Lorsqu'elle
ne comprenait pas, seule une
petite mimique de son visage
permettait de s'en rendre
compte. Encore fallait-il la
bli le planning, les plus dé-
voués se sont proposés. La
moitié seulement des étu-
diants de notre groupe a fait
des exposés. Cela pose le
problème de la participation
à la vie du groupe. C'est ain-
si qu'il y a eu chez nous deux
ou trois « étudiantes - sou-
ches »... L'une d'elles, entre
autres, m'a beaucoup frappé
par son absence totale de
participation. Elle a toujours
écouté avec attention, mais
de toute l'année elle n'a pas
dit un seul mot. Lorsqu'elle
ne comprenait pas, seule une
petite mimique de son visage
permettait de s'en rendre
compte. Encore fallait-il la
14
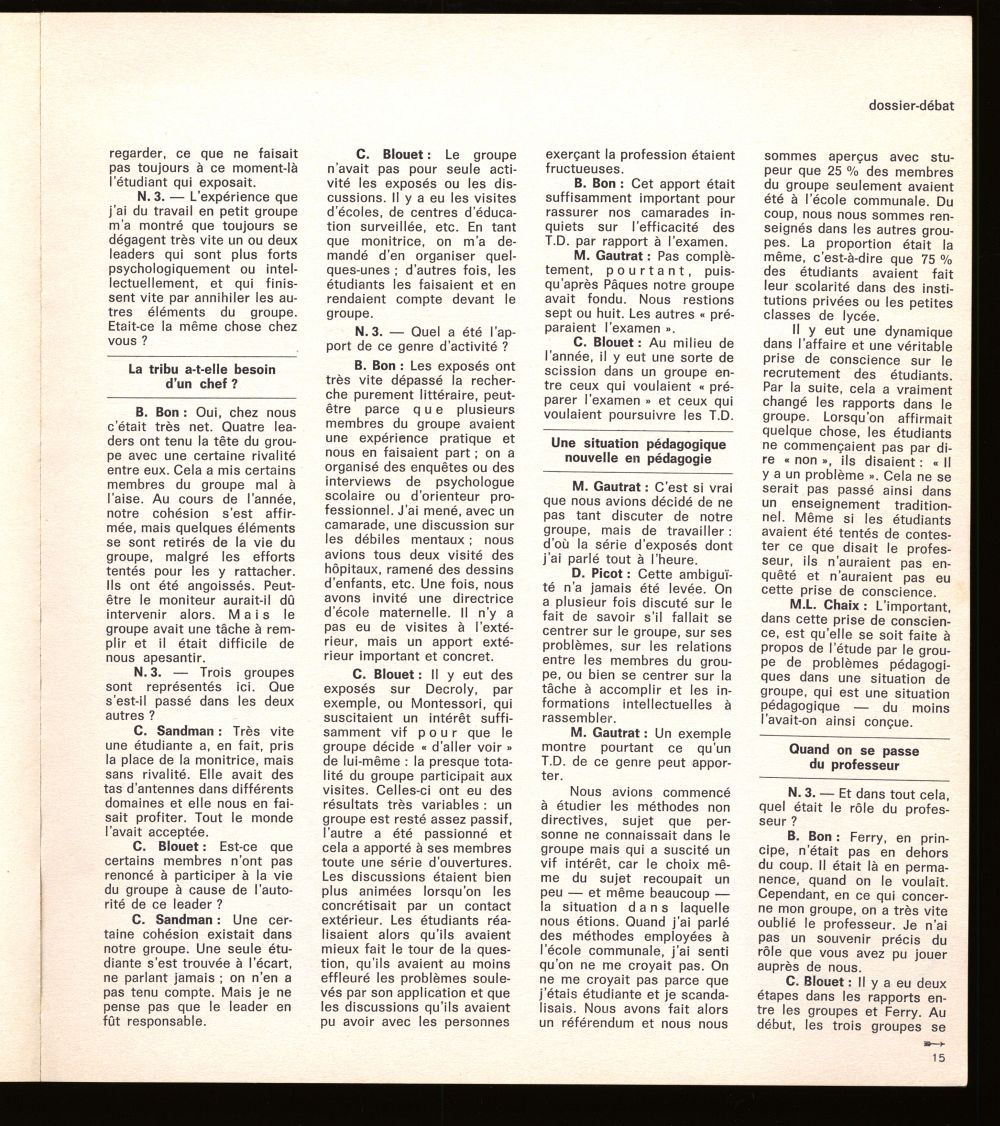

dossier-débat
regarder, ce que ne faisait
pas toujours à ce moment-là
l'étudiant qui exposait.
pas toujours à ce moment-là
l'étudiant qui exposait.
N. 3. — L'expérience que
j'ai du travail en petit groupe
m'a montré que toujours se
dégagent très vite un ou deux
leaders qui sont plus forts
psychologiquement ou intel-
lectuellement, et qui finis-
sent vite par annihiler les au-
tres éléments du groupe.
Etait-ce la même chose chez
vous ?
j'ai du travail en petit groupe
m'a montré que toujours se
dégagent très vite un ou deux
leaders qui sont plus forts
psychologiquement ou intel-
lectuellement, et qui finis-
sent vite par annihiler les au-
tres éléments du groupe.
Etait-ce la même chose chez
vous ?
La tribu a-t-elle besoin
d'un chef ?
d'un chef ?
B. Bon : Oui, chez nous
c'était très net. Quatre lea-
ders ont tenu la tête du grou-
pe avec une certaine rivalité
entre eux. Cela a mis certains
membres du groupe mal à
l'aise. Au cours de l'année,
notre cohésion s'est affir-
mée, mais quelques éléments
se sont retirés de la vie du
groupe, malgré les efforts
tentés pour les y rattacher.
Ils ont été angoissés. Peut-
être le moniteur aurait-il dû
intervenir alors. Mais le
groupe avait une tâche à rem-
plir et il était difficile de
nous apesantir.
c'était très net. Quatre lea-
ders ont tenu la tête du grou-
pe avec une certaine rivalité
entre eux. Cela a mis certains
membres du groupe mal à
l'aise. Au cours de l'année,
notre cohésion s'est affir-
mée, mais quelques éléments
se sont retirés de la vie du
groupe, malgré les efforts
tentés pour les y rattacher.
Ils ont été angoissés. Peut-
être le moniteur aurait-il dû
intervenir alors. Mais le
groupe avait une tâche à rem-
plir et il était difficile de
nous apesantir.
N. 3. — Trois groupes
sont représentés ici. Que
s'est-il passé dans les deux
autres ?
sont représentés ici. Que
s'est-il passé dans les deux
autres ?
C. Sandman : Très vite
une étudiante a, en fait, pris
la place de la monitrice, mais
sans rivalité. Elle avait des
tas d'antennes dans différents
domaines et elle nous en fai-
sait profiter. Tout le monde
l'avait acceptée.
une étudiante a, en fait, pris
la place de la monitrice, mais
sans rivalité. Elle avait des
tas d'antennes dans différents
domaines et elle nous en fai-
sait profiter. Tout le monde
l'avait acceptée.
C. Blouet : Est-ce que
certains membres n'ont pas
renoncé à participer à la vie
du groupe à cause de l'auto-
rité de ce leader ?
certains membres n'ont pas
renoncé à participer à la vie
du groupe à cause de l'auto-
rité de ce leader ?
C. Sandman : Une cer-
taine cohésion existait dans
notre groupe. Une seule étu-
diante s'est trouvée à l'écart,
ne parlant jamais ; on n'en a
pas tenu compte. Mais je ne
pense pas que le leader en
fût responsable.
taine cohésion existait dans
notre groupe. Une seule étu-
diante s'est trouvée à l'écart,
ne parlant jamais ; on n'en a
pas tenu compte. Mais je ne
pense pas que le leader en
fût responsable.
C. Blouet : Le groupe
n'avait pas pour seule acti-
vité les exposés ou les dis-
cussions. Il y a eu les visites
d'écoles, de centres d'éduca-
tion surveillée, etc. En tant
que monitrice, on m'a de-
mandé d'en organiser quel-
ques-unes ; d'autres fois, les
étudiants les faisaient et en
rendaient compte devant le
groupe.
n'avait pas pour seule acti-
vité les exposés ou les dis-
cussions. Il y a eu les visites
d'écoles, de centres d'éduca-
tion surveillée, etc. En tant
que monitrice, on m'a de-
mandé d'en organiser quel-
ques-unes ; d'autres fois, les
étudiants les faisaient et en
rendaient compte devant le
groupe.
N.3. — Quel a été l'ap-
port de ce genre d'activité ?
port de ce genre d'activité ?
B. Bon : Les exposés ont
très vite dépassé la recher-
che purement littéraire, peut-
être parce que plusieurs
membres du groupe avaient
une expérience pratique et
nous en faisaient part ; on a
organisé des enquêtes ou des
interviews de psychologue
scolaire ou d'orienteur pro-
fessionnel. J'ai mené, avec un
camarade, une discussion sur
les débiles mentaux ; nous
avions tous deux visité des
hôpitaux, ramené des dessins
d'enfants, etc. Une fois, nous
avons invité une directrice
d'école maternelle. Il n'y a
pas eu de visites à l'exté-
rieur, mais un apport exté-
rieur important et concret.
très vite dépassé la recher-
che purement littéraire, peut-
être parce que plusieurs
membres du groupe avaient
une expérience pratique et
nous en faisaient part ; on a
organisé des enquêtes ou des
interviews de psychologue
scolaire ou d'orienteur pro-
fessionnel. J'ai mené, avec un
camarade, une discussion sur
les débiles mentaux ; nous
avions tous deux visité des
hôpitaux, ramené des dessins
d'enfants, etc. Une fois, nous
avons invité une directrice
d'école maternelle. Il n'y a
pas eu de visites à l'exté-
rieur, mais un apport exté-
rieur important et concret.
C. Blouet : II y eut des
exposés sur Decroly, par
exemple, ou Montessori, qui
suscitaient un intérêt suffi-
samment vif pour que le
groupe décide « d'aller voir »
de lui-même : la presque tota-
lité du groupe participait aux
visites. Celles-ci ont eu des
résultats très variables : un
groupe est resté assez passif,
l'autre a été passionné et
cela a apporté à ses membres
toute une série d'ouvertures.
Les discussions étaient bien
plus animées lorsqu'on les
concrétisait par un contact
extérieur. Les étudiants réa-
lisaient alors qu'ils avaient
mieux fait le tour de la ques-
tion, qu'ils avaient au moins
effleuré les problèmes soule-
vés par son application et que
les discussions qu'ils avaient
pu avoir avec les personnes
exposés sur Decroly, par
exemple, ou Montessori, qui
suscitaient un intérêt suffi-
samment vif pour que le
groupe décide « d'aller voir »
de lui-même : la presque tota-
lité du groupe participait aux
visites. Celles-ci ont eu des
résultats très variables : un
groupe est resté assez passif,
l'autre a été passionné et
cela a apporté à ses membres
toute une série d'ouvertures.
Les discussions étaient bien
plus animées lorsqu'on les
concrétisait par un contact
extérieur. Les étudiants réa-
lisaient alors qu'ils avaient
mieux fait le tour de la ques-
tion, qu'ils avaient au moins
effleuré les problèmes soule-
vés par son application et que
les discussions qu'ils avaient
pu avoir avec les personnes
exerçant la profession étaient
fructueuses.
fructueuses.
B. Bon : Cet apport était
suffisamment important pour
rassurer nos camarades in-
quiets sur l'efficacité des
T.D. par rapport à l'examen.
suffisamment important pour
rassurer nos camarades in-
quiets sur l'efficacité des
T.D. par rapport à l'examen.
M. Gautrat : Pas complè-
tement, pourtant, puis-
qu'après Pâques notre groupe
avait fondu. Nous restions
sept ou huit. Les autres « pré-
paraient l'examen ».
tement, pourtant, puis-
qu'après Pâques notre groupe
avait fondu. Nous restions
sept ou huit. Les autres « pré-
paraient l'examen ».
C. Blouet : Au milieu de
l'année, il y eut une sorte de
scission dans un groupe en-
tre ceux qui voulaient « pré-
parer l'examen » et ceux qui
voulaient poursuivre les T.D.
l'année, il y eut une sorte de
scission dans un groupe en-
tre ceux qui voulaient « pré-
parer l'examen » et ceux qui
voulaient poursuivre les T.D.
Une situation pédagogique
nouvelle en pédagogie
nouvelle en pédagogie
M. Gautrat : C'est si vrai
que nous avions décidé de ne
pas tant discuter de notre
groupe, mais de travailler :
d'où la série d'exposés dont
j'ai parlé tout à l'heure.
que nous avions décidé de ne
pas tant discuter de notre
groupe, mais de travailler :
d'où la série d'exposés dont
j'ai parlé tout à l'heure.
D. Picot : Cette ambiguï-
té n'a jamais été levée. On
a plusieur fois discuté sur le
fait de savoir s'il fallait se
centrer sur le groupe, sur ses
problèmes, sur les relations
entre les membres du grou-
pe, ou bien se centrer sur la
tâche à accomplir et les in-
formations intellectuelles à
rassembler.
té n'a jamais été levée. On
a plusieur fois discuté sur le
fait de savoir s'il fallait se
centrer sur le groupe, sur ses
problèmes, sur les relations
entre les membres du grou-
pe, ou bien se centrer sur la
tâche à accomplir et les in-
formations intellectuelles à
rassembler.
M. Gautrat : Un exemple
montre pourtant ce qu'un
T.D. de ce genre peut appor-
ter.
montre pourtant ce qu'un
T.D. de ce genre peut appor-
ter.
Nous avions commencé
à étudier les méthodes non
directives, sujet que per-
sonne ne connaissait dans le
groupe mais qui a suscité un
vif intérêt, car le choix mê-
me du sujet recoupait un
peu — et même beaucoup —
la situation dans laquelle
nous étions. Quand j'ai parlé
des méthodes employées à
l'école communale, j'ai senti
qu'on ne me croyait pas. On
ne me croyait pas parce que
j'étais étudiante et je scanda-
lisais. Nous avons fait alors
un référendum et nous nous
à étudier les méthodes non
directives, sujet que per-
sonne ne connaissait dans le
groupe mais qui a suscité un
vif intérêt, car le choix mê-
me du sujet recoupait un
peu — et même beaucoup —
la situation dans laquelle
nous étions. Quand j'ai parlé
des méthodes employées à
l'école communale, j'ai senti
qu'on ne me croyait pas. On
ne me croyait pas parce que
j'étais étudiante et je scanda-
lisais. Nous avons fait alors
un référendum et nous nous
sommes aperçus avec stu-
peur que 25 % des membres
du groupe seulement avaient
été à l'école communale. Du
coup, nous nous sommes ren-
seignés dans les autres grou-
pes. La proportion était la
même, c'est-à-dire que 75 %
des étudiants avaient fait
leur scolarité dans des insti-
tutions privées ou les petites
classes de lycée.
peur que 25 % des membres
du groupe seulement avaient
été à l'école communale. Du
coup, nous nous sommes ren-
seignés dans les autres grou-
pes. La proportion était la
même, c'est-à-dire que 75 %
des étudiants avaient fait
leur scolarité dans des insti-
tutions privées ou les petites
classes de lycée.
Il y eut une dynamique
dans l'affaire et une véritable
prise de conscience sur le
recrutement des étudiants.
Par la suite, cela a vraiment
changé les rapports dans le
groupe. Lorsqu'on affirmait
quelque chose, les étudiants
ne commençaient pas par di-
re « non », ils disaient : « II
y a un problème ». Cela ne se
serait pas passé ainsi dans
un enseignement tradition-
nel. Même si les étudiants
avaient été tentés de contes-
ter ce que disait le profes-
seur, ils n'auraient pas en-
quêté et n'auraient pas eu
cette prise de conscience.
dans l'affaire et une véritable
prise de conscience sur le
recrutement des étudiants.
Par la suite, cela a vraiment
changé les rapports dans le
groupe. Lorsqu'on affirmait
quelque chose, les étudiants
ne commençaient pas par di-
re « non », ils disaient : « II
y a un problème ». Cela ne se
serait pas passé ainsi dans
un enseignement tradition-
nel. Même si les étudiants
avaient été tentés de contes-
ter ce que disait le profes-
seur, ils n'auraient pas en-
quêté et n'auraient pas eu
cette prise de conscience.
M.L. Chaix : L'important,
dans cette prise de conscien-
ce, est qu'elle se soit faite à
propos de l'étude par le grou-
pe de problèmes pédagogi-
ques dans une situation de
groupe, qui est une situation
pédagogique — du moins
l'avait-on ainsi conçue.
dans cette prise de conscien-
ce, est qu'elle se soit faite à
propos de l'étude par le grou-
pe de problèmes pédagogi-
ques dans une situation de
groupe, qui est une situation
pédagogique — du moins
l'avait-on ainsi conçue.
Quand on se passe
du professeur
du professeur
N. 3. — Et dans tout cela,
quel était le rôle du profes-
seur ?
quel était le rôle du profes-
seur ?
B. Bon : Ferry, en prin-
cipe, n'était pas en dehors
du coup. Il était là en perma-
nence, quand on le voulait.
Cependant, en ce qui concer-
ne mon groupe, on a très vite
oublié le professeur. Je n'ai
pas un souvenir précis du
rôle que vous avez pu jouer
auprès de nous.
cipe, n'était pas en dehors
du coup. Il était là en perma-
nence, quand on le voulait.
Cependant, en ce qui concer-
ne mon groupe, on a très vite
oublié le professeur. Je n'ai
pas un souvenir précis du
rôle que vous avez pu jouer
auprès de nous.
C. Blouet : II y a eu deux
étapes dans les rapports en-
tre les groupes et Ferry. Au
début, les trois groupes se
étapes dans les rapports en-
tre les groupes et Ferry. Au
début, les trois groupes se
15
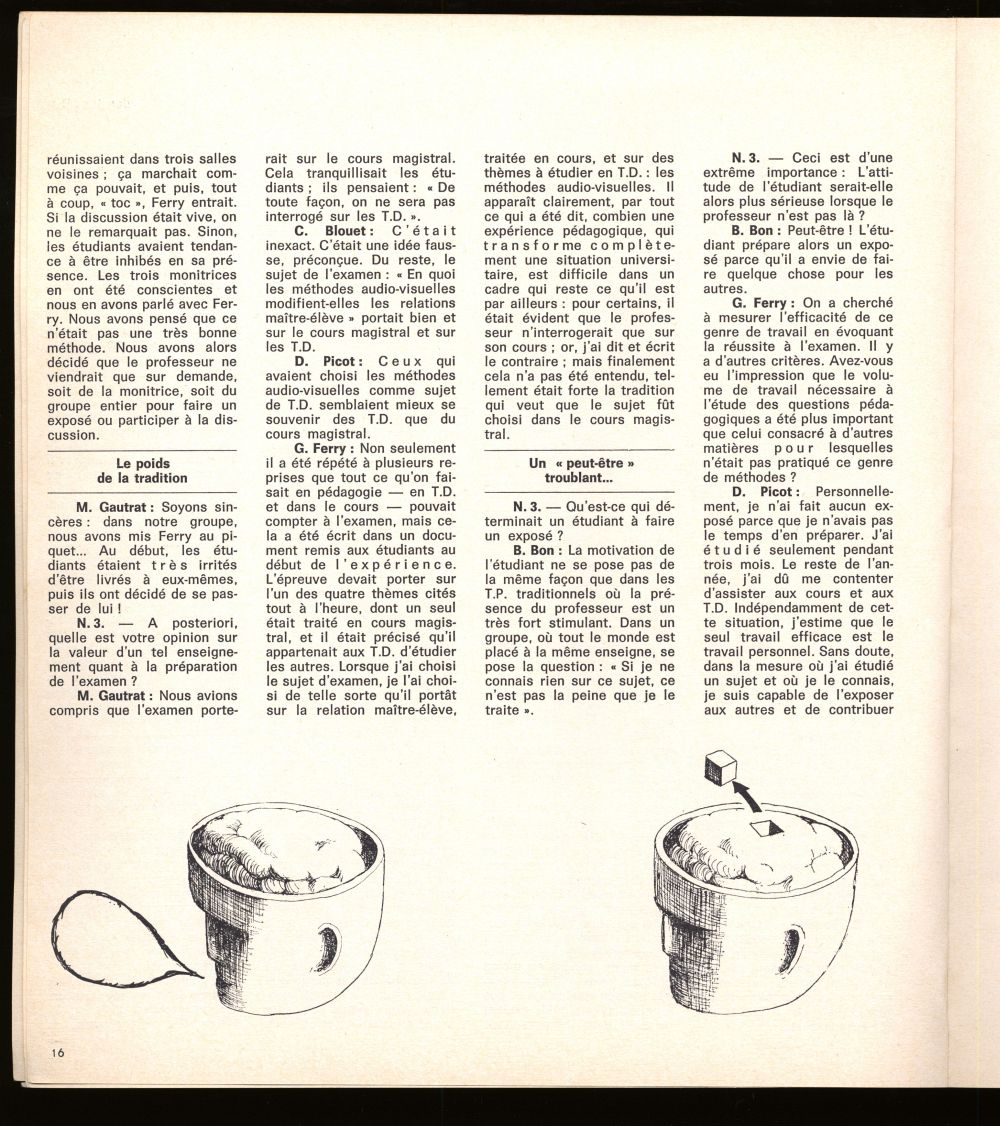

réunissaient dans trois salles
voisines ; ça marchait com-
me ça pouvait, et puis, tout
à coup, « toc », Ferry entrait.
Si la discussion était vive, on
ne le remarquait pas. Sinon,
ies étudiants avaient tendan-
ce à être inhibés en sa pré-
sence. Les trois monitrices
en ont été conscientes et
nous en avons parlé avec Fer-
ry. Nous avons pensé que ce
n'était pas une très bonne
méthode. Nous avons alors
décidé que le professeur ne
viendrait que sur demande,
soit de la monitrice, soit du
groupe entier pour faire un
exposé ou participer à la dis-
cussion.
voisines ; ça marchait com-
me ça pouvait, et puis, tout
à coup, « toc », Ferry entrait.
Si la discussion était vive, on
ne le remarquait pas. Sinon,
ies étudiants avaient tendan-
ce à être inhibés en sa pré-
sence. Les trois monitrices
en ont été conscientes et
nous en avons parlé avec Fer-
ry. Nous avons pensé que ce
n'était pas une très bonne
méthode. Nous avons alors
décidé que le professeur ne
viendrait que sur demande,
soit de la monitrice, soit du
groupe entier pour faire un
exposé ou participer à la dis-
cussion.
Le poids
de la tradition
de la tradition
M. Gautrat : Soyons sin-
cères : dans notre groupe,
nous avons mis Ferry au pi-
quet... Au début, les étu-
diants étaient très irrités
d'être livrés à eux-mêmes,
puis ils ont décidé de se pas-
ser de lui !
cères : dans notre groupe,
nous avons mis Ferry au pi-
quet... Au début, les étu-
diants étaient très irrités
d'être livrés à eux-mêmes,
puis ils ont décidé de se pas-
ser de lui !
N. 3. — A posteriori,
quelle est votre opinion sur
la valeur d'un tel enseigne-
ment quant à la préparation
de l'examen ?
quelle est votre opinion sur
la valeur d'un tel enseigne-
ment quant à la préparation
de l'examen ?
M. Gautrat : Nous avions
compris que l'examen porte-
compris que l'examen porte-
rait sur le cours magistral.
Cela tranquillisait les étu-
diants ; ils pensaient : « De
toute façon, on ne sera pas
interrogé sur les T.D. ».
Cela tranquillisait les étu-
diants ; ils pensaient : « De
toute façon, on ne sera pas
interrogé sur les T.D. ».
C. Blouet : C'était
inexact. C'était une idée faus-
se, préconçue. Du reste, le
sujet de l'examen : « En quoi
les méthodes audio-visuelles
modifient-elles les relations
maître-élève » portait bien et
sur le cours magistral et sur
les T.D.
inexact. C'était une idée faus-
se, préconçue. Du reste, le
sujet de l'examen : « En quoi
les méthodes audio-visuelles
modifient-elles les relations
maître-élève » portait bien et
sur le cours magistral et sur
les T.D.
D. Picot : Ceux qui
avaient choisi les méthodes
audio-visuelles comme sujet
de T.D. semblaient mieux se
souvenir des T.D. que du
cours magistral.
avaient choisi les méthodes
audio-visuelles comme sujet
de T.D. semblaient mieux se
souvenir des T.D. que du
cours magistral.
G. Ferry : Non seulement
il a été répété à plusieurs re-
prises que tout ce qu'on fai-
sait en pédagogie — en T.D.
et dans le cours — pouvait
compter à l'examen, mais ce-
la a été écrit dans un docu-
ment remis aux étudiants au
début de l'expérience.
L'épreuve devait porter sur
l'un des quatre thèmes cités
tout à l'heure, dont un seul
était traité en cours magis-
tral, et il était précisé qu'il
appartenait aux T.D. d'étudier
les autres. Lorsque j'ai choisi
le sujet d'examen, je l'ai choi-
si de telle sorte qu'il portât
sur la relation maître-élève,
il a été répété à plusieurs re-
prises que tout ce qu'on fai-
sait en pédagogie — en T.D.
et dans le cours — pouvait
compter à l'examen, mais ce-
la a été écrit dans un docu-
ment remis aux étudiants au
début de l'expérience.
L'épreuve devait porter sur
l'un des quatre thèmes cités
tout à l'heure, dont un seul
était traité en cours magis-
tral, et il était précisé qu'il
appartenait aux T.D. d'étudier
les autres. Lorsque j'ai choisi
le sujet d'examen, je l'ai choi-
si de telle sorte qu'il portât
sur la relation maître-élève,
traitée en cours, et sur des
thèmes à étudier en T.D. : les
méthodes audio-visuelles. Il
apparaît clairement, par tout
ce qui a été dit, combien une
expérience pédagogique, qui
transforme complète-
ment une situation universi-
taire, est difficile dans un
cadre qui reste ce qu'il est
par ailleurs : pour certains, il
était évident que le profes-
seur n'interrogerait que sur
son cours ; or, j'ai dit et écrit
le contraire ; mais finalement
cela n'a pas été entendu, tel-
lement était forte la tradition
qui veut que le sujet fût
choisi dans le cours magis-
tral.
thèmes à étudier en T.D. : les
méthodes audio-visuelles. Il
apparaît clairement, par tout
ce qui a été dit, combien une
expérience pédagogique, qui
transforme complète-
ment une situation universi-
taire, est difficile dans un
cadre qui reste ce qu'il est
par ailleurs : pour certains, il
était évident que le profes-
seur n'interrogerait que sur
son cours ; or, j'ai dit et écrit
le contraire ; mais finalement
cela n'a pas été entendu, tel-
lement était forte la tradition
qui veut que le sujet fût
choisi dans le cours magis-
tral.
Un « peut-être »
troublant...
troublant...
N.3. — Qu'est-ce qui dé-
terminait un étudiant à faire
un exposé ?
terminait un étudiant à faire
un exposé ?
B. Bon : La motivation de
l'étudiant ne se pose pas de
la même façon que dans les
T.P. traditionnels où la pré-
sence du professeur est un
très fort stimulant. Dans un
groupe, où tout le monde est
placé à la même enseigne, se
pose la question : « Si je ne
connais rien sur ce sujet, ce
n'est pas la peine que je le
traite ».
l'étudiant ne se pose pas de
la même façon que dans les
T.P. traditionnels où la pré-
sence du professeur est un
très fort stimulant. Dans un
groupe, où tout le monde est
placé à la même enseigne, se
pose la question : « Si je ne
connais rien sur ce sujet, ce
n'est pas la peine que je le
traite ».
N.3. — Ceci est d'une
extrême importance : L'atti-
tude de l'étudiant serait-elle
alors plus sérieuse lorsque le
professeur n'est pas là ?
extrême importance : L'atti-
tude de l'étudiant serait-elle
alors plus sérieuse lorsque le
professeur n'est pas là ?
B. Bon : Peut-être ! L'étu-
diant prépare alors un expo-
sé parce qu'il a envie de fai-
re quelque chose pour les
autres.
diant prépare alors un expo-
sé parce qu'il a envie de fai-
re quelque chose pour les
autres.
G. Ferry : On a cherché
à mesurer l'efficacité de ce
genre de travail en évoquant
la réussite à l'examen. Il y
a d'autres critères. Avez-vous
eu l'impression que le volu-
me de travail nécessaire à
l'étude des questions péda-
gogiques a été plus important
que celui consacré à d'autres
matières pour lesquelles
n'était pas pratiqué ce genre
de méthodes ?
à mesurer l'efficacité de ce
genre de travail en évoquant
la réussite à l'examen. Il y
a d'autres critères. Avez-vous
eu l'impression que le volu-
me de travail nécessaire à
l'étude des questions péda-
gogiques a été plus important
que celui consacré à d'autres
matières pour lesquelles
n'était pas pratiqué ce genre
de méthodes ?
D. Picot : Personnelle-
ment, je n'ai fait aucun ex-
posé parce que je n'avais pas
le temps d'en préparer. J'ai
étudié seulement pendant
trois mois. Le reste de l'an-
née, j'ai dû me contenter
d'assister aux cours et aux
T.D. Indépendamment de cet-
te situation, j'estime que le
seul travail efficace est le
travail personnel. Sans doute,
dans la mesure où j'ai étudié
un sujet et où je le connais,
je suis capable de l'exposer
aux autres et de contribuer
ment, je n'ai fait aucun ex-
posé parce que je n'avais pas
le temps d'en préparer. J'ai
étudié seulement pendant
trois mois. Le reste de l'an-
née, j'ai dû me contenter
d'assister aux cours et aux
T.D. Indépendamment de cet-
te situation, j'estime que le
seul travail efficace est le
travail personnel. Sans doute,
dans la mesure où j'ai étudié
un sujet et où je le connais,
je suis capable de l'exposer
aux autres et de contribuer
16
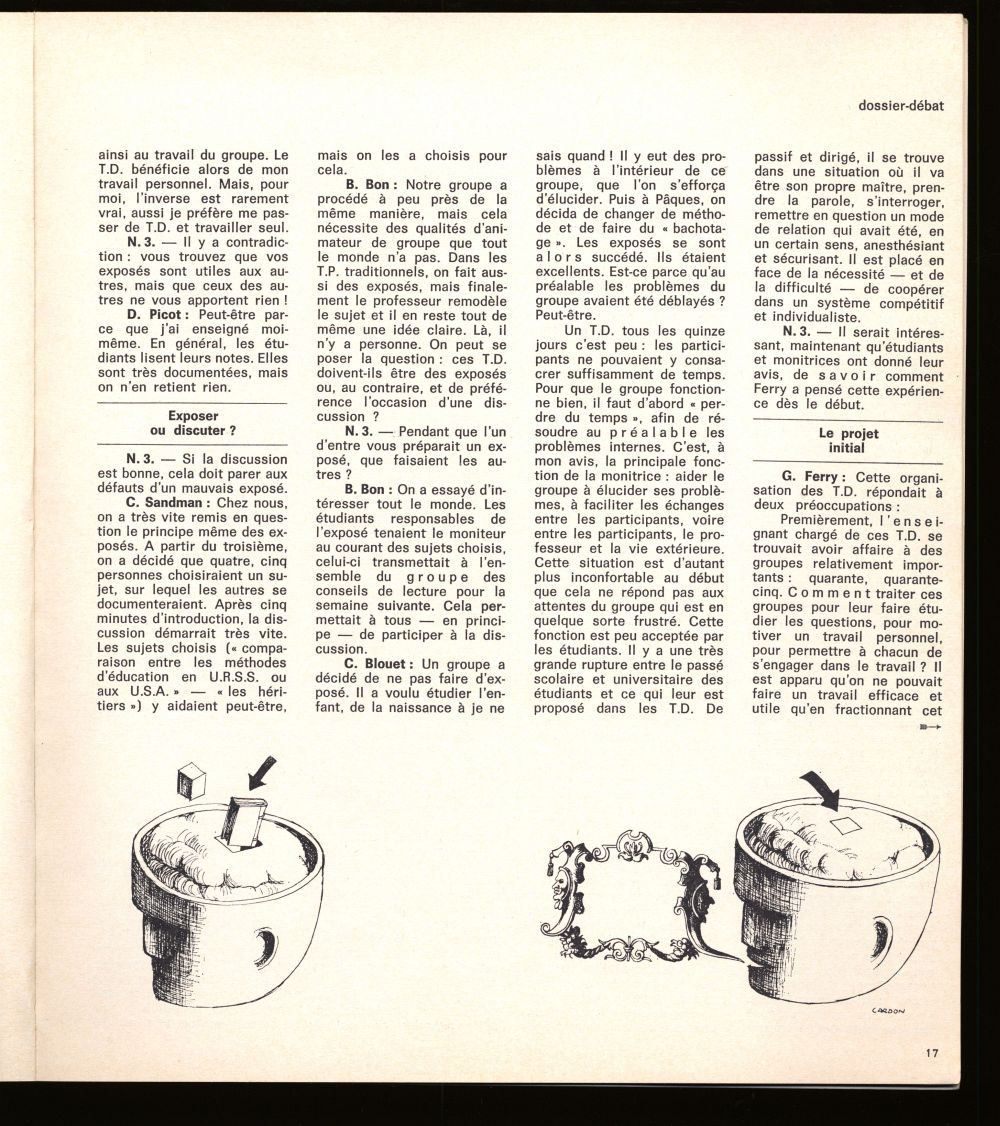

ainsi au travail du groupe. Le
T.D. bénéficie alors de mon
travail personnel. Mais, pour
moi, l'inverse est rarement
vrai, aussi je préfère me pas-
ser de T.D. et travailler seul.
T.D. bénéficie alors de mon
travail personnel. Mais, pour
moi, l'inverse est rarement
vrai, aussi je préfère me pas-
ser de T.D. et travailler seul.
N.3. — II y a contradic-
tion : vous trouvez que vos
exposés sont utiles aux au-
tres, mais que ceux des au-
tres ne vous apportent rien !
tion : vous trouvez que vos
exposés sont utiles aux au-
tres, mais que ceux des au-
tres ne vous apportent rien !
D. Picot : Peut-être par-
ce que j'ai enseigné moi-
même. En général, les étu-
diants lisent leurs notes. Elles
sont très documentées, mais
on n'en retient rien.
ce que j'ai enseigné moi-
même. En général, les étu-
diants lisent leurs notes. Elles
sont très documentées, mais
on n'en retient rien.
Exposer
ou discuter ?
ou discuter ?
N.3. — Si la discussion
est bonne, cela doit parer aux
défauts d'un mauvais exposé.
est bonne, cela doit parer aux
défauts d'un mauvais exposé.
C. Sandman : Chez nous,
on a très vite remis en ques-
tion le principe même des ex-
posés. A partir du troisième,
on a décidé que quatre, cinq
personnes choisiraient un su-
jet, sur lequel les autres se
documenteraient. Après cinq
minutes d'introduction, la dis-
cussion démarrait très vite.
Les sujets choisis (« compa-
raison entre les méthodes
d'éducation en U.R.S.S. ou
aux U.S.A. » — « les héri-
tiers ») y aidaient peut-être,
on a très vite remis en ques-
tion le principe même des ex-
posés. A partir du troisième,
on a décidé que quatre, cinq
personnes choisiraient un su-
jet, sur lequel les autres se
documenteraient. Après cinq
minutes d'introduction, la dis-
cussion démarrait très vite.
Les sujets choisis (« compa-
raison entre les méthodes
d'éducation en U.R.S.S. ou
aux U.S.A. » — « les héri-
tiers ») y aidaient peut-être,
mais on les a choisis pour
cela.
cela.
B. Bon : Notre groupe a
procédé à peu près de la
même manière, mais cela
nécessite des qualités d'ani-
mateur de groupe que tout
le monde n'a pas. Dans les
T.P. traditionnels, on fait aus-
si des exposés, mais finale-
ment le professeur remodèle
le sujet et il en reste tout de
même une idée claire. Là, il
n'y a personne. On peut se
poser la question : ces T.D.
doivent-ils être des exposés
ou, au contraire, et de préfé-
rence l'occasion d'une dis-
cussion ?
procédé à peu près de la
même manière, mais cela
nécessite des qualités d'ani-
mateur de groupe que tout
le monde n'a pas. Dans les
T.P. traditionnels, on fait aus-
si des exposés, mais finale-
ment le professeur remodèle
le sujet et il en reste tout de
même une idée claire. Là, il
n'y a personne. On peut se
poser la question : ces T.D.
doivent-ils être des exposés
ou, au contraire, et de préfé-
rence l'occasion d'une dis-
cussion ?
N.3. — Pendant que l'un
d'entre vous préparait un ex-
posé, que faisaient les au-
tres ?
d'entre vous préparait un ex-
posé, que faisaient les au-
tres ?
B. Bon : On a essayé d'in-
téresser tout le monde. Les
étudiants responsables de
l'exposé tenaient le moniteur
au courant des sujets choisis,
celui-ci transmettait à l'en-
semble du groupe des
conseils de lecture pour la
semaine suivante. Cela per-
mettait à tous — en princi-
pe — de participer à la dis-
cussion.
téresser tout le monde. Les
étudiants responsables de
l'exposé tenaient le moniteur
au courant des sujets choisis,
celui-ci transmettait à l'en-
semble du groupe des
conseils de lecture pour la
semaine suivante. Cela per-
mettait à tous — en princi-
pe — de participer à la dis-
cussion.
C. Blouet: Un groupe a
décidé de ne pas faire d'ex-
posé. Il a voulu étudier l'en-
fant, de la naissance à je ne
décidé de ne pas faire d'ex-
posé. Il a voulu étudier l'en-
fant, de la naissance à je ne
sais quand ! Il y eut des pro-
blèmes à l'intérieur de ce
groupe, que l'on s'efforça
d'élucider. Puis à Pâques, on
décida de changer de métho-
de et de faire du « bachota-
ge ». Les exposés se sont
alors succédé. Ils étaient
excellents. Est-ce parce qu'au
préalable les problèmes du
groupe avaient été déblayés ?
Peut-être.
blèmes à l'intérieur de ce
groupe, que l'on s'efforça
d'élucider. Puis à Pâques, on
décida de changer de métho-
de et de faire du « bachota-
ge ». Les exposés se sont
alors succédé. Ils étaient
excellents. Est-ce parce qu'au
préalable les problèmes du
groupe avaient été déblayés ?
Peut-être.
Un T.D. tous les quinze
jours c'est peu : les partici-
pants ne pouvaient y consa-
crer suffisamment de temps.
Pour que le groupe fonction-
ne bien, il faut d'abord « per-
dre du temps », afin de ré-
soudre au préalable les
problèmes internes. C'est, à
mon avis, la principale fonc-
tion de la monitrice : aider le
groupe à élucider ses problè-
mes, à faciliter les échanges
entre les participants, voire
entre les participants, le pro-
fesseur et la vie extérieure.
Cette situation est d'autant
plus inconfortable au début
que cela ne répond pas aux
attentes du groupe qui est en
quelque sorte frustré. Cette
fonction est peu acceptée par
les étudiants. Il y a une très
grande rupture entre le passé
scolaire et universitaire des
étudiants et ce qui leur est
proposé dans les T.D. De
jours c'est peu : les partici-
pants ne pouvaient y consa-
crer suffisamment de temps.
Pour que le groupe fonction-
ne bien, il faut d'abord « per-
dre du temps », afin de ré-
soudre au préalable les
problèmes internes. C'est, à
mon avis, la principale fonc-
tion de la monitrice : aider le
groupe à élucider ses problè-
mes, à faciliter les échanges
entre les participants, voire
entre les participants, le pro-
fesseur et la vie extérieure.
Cette situation est d'autant
plus inconfortable au début
que cela ne répond pas aux
attentes du groupe qui est en
quelque sorte frustré. Cette
fonction est peu acceptée par
les étudiants. Il y a une très
grande rupture entre le passé
scolaire et universitaire des
étudiants et ce qui leur est
proposé dans les T.D. De
dossier-débat
passif et dirigé, il se trouve
dans une situation où il va
être son propre maître, pren-
dre la parole, s'interroger,
remettre en question un mode
de relation qui avait été, en
un certain sens, anesthésiant
et sécurisant. Il est placé en
face de la nécessité — et de
la difficulté — de coopérer
dans un système compétitif
et individualiste.
dans une situation où il va
être son propre maître, pren-
dre la parole, s'interroger,
remettre en question un mode
de relation qui avait été, en
un certain sens, anesthésiant
et sécurisant. Il est placé en
face de la nécessité — et de
la difficulté — de coopérer
dans un système compétitif
et individualiste.
N.3. — II serait intéres-
sant, maintenant qu'étudiants
et monitrices ont donné leur
avis, de savoir comment
Ferry a pensé cette expérien-
ce dès le début.
sant, maintenant qu'étudiants
et monitrices ont donné leur
avis, de savoir comment
Ferry a pensé cette expérien-
ce dès le début.
Le projet
initial
initial
G. Ferry : Cette organi-
sation des T.D. répondait à
deux préoccupations :
sation des T.D. répondait à
deux préoccupations :
Premièrement, I ' e n s e i-
gnant chargé de ces T.D. se
trouvait avoir affaire à des
groupes relativement impor-
tants : quarante, quarante-
cinq. Comment traiter ces
groupes pour leur faire étu-
dier les questions, pour mo-
tiver un travail personnel,
pour permettre à chacun de
s'engager dans le travail ? Il
est apparu qu'on ne pouvait
faire un travail efficace et
utile qu'en fractionnant cet
gnant chargé de ces T.D. se
trouvait avoir affaire à des
groupes relativement impor-
tants : quarante, quarante-
cinq. Comment traiter ces
groupes pour leur faire étu-
dier les questions, pour mo-
tiver un travail personnel,
pour permettre à chacun de
s'engager dans le travail ? Il
est apparu qu'on ne pouvait
faire un travail efficace et
utile qu'en fractionnant cet
17
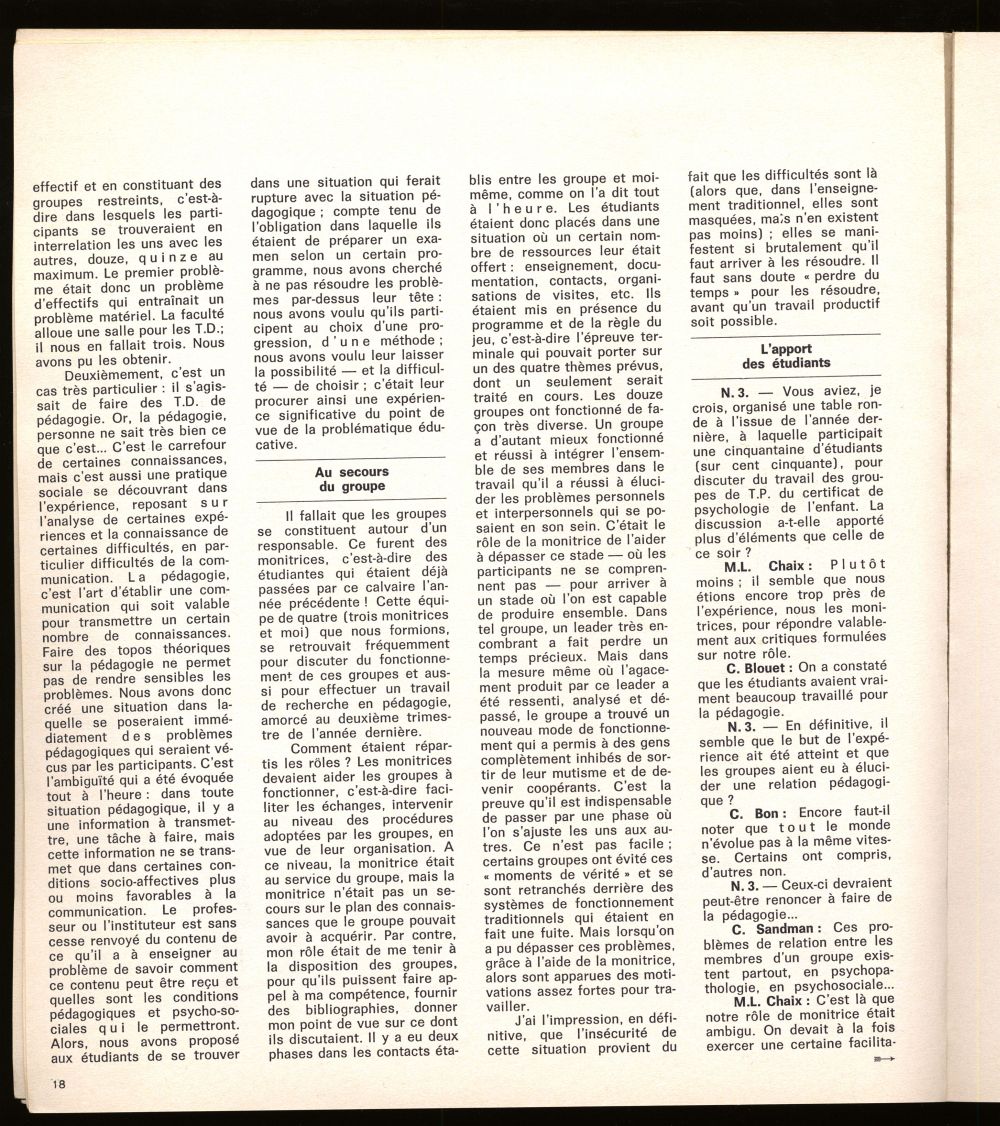

effectif et en constituant des
groupes restreints, c'est-à-
dire dans lesquels les parti-
cipants se trouveraient en
interrelation les uns avec les
autres, douze, quinze au
maximum. Le premier problè-
me était donc un problème
d'effectifs qui entraînait un
problème matériel. La faculté
alloue une salle pour les T.D.;
il nous en fallait trois. Nous
avons pu les obtenir.
groupes restreints, c'est-à-
dire dans lesquels les parti-
cipants se trouveraient en
interrelation les uns avec les
autres, douze, quinze au
maximum. Le premier problè-
me était donc un problème
d'effectifs qui entraînait un
problème matériel. La faculté
alloue une salle pour les T.D.;
il nous en fallait trois. Nous
avons pu les obtenir.
Deuxièmement, c'est un
cas très particulier : il s'agis-
sait de faire des T.D. de
pédagogie. Or, la pédagogie,
personne ne sait très bien ce
que c'est... C'est le carrefour
de certaines connaissances,
mais c'est aussi une pratique
sociale se découvrant dans
l'expérience, reposant sur
l'analyse de certaines expé-
riences et la connaissance de
certaines difficultés, en par-
ticulier difficultés de la com-
munication. La pédagogie,
c'est l'art d'établir une com-
munication qui soit valable
pour transmettre un certain
nombre de connaissances.
Faire des topos théoriques
sur la pédagogie ne permet
pas de rendre sensibles les
problèmes. Nous avons donc
créé une situation dans la-
quelle se poseraient immé-
diatement des problèmes
pédagogiques qui seraient vé-
cus par les participants. C'est
l'ambiguïté qui a été évoquée
tout à l'heure : dans toute
situation pédagogique, il y a
une information à transmet-
tre, une tâche à faire, mais
cette information ne se trans-
met que dans certaines con-
ditions socio-affectives plus
ou moins favorables à la
communication. Le profes-
seur ou l'instituteur est sans
cesse renvoyé du contenu de
ce qu'il a à enseigner au
problème de savoir comment
ce contenu peut être reçu et
quelles sont les conditions
pédagogiques et psycho-so-
ciales qui le permettront.
Alors, nous avons proposé
aux étudiants de se trouver
cas très particulier : il s'agis-
sait de faire des T.D. de
pédagogie. Or, la pédagogie,
personne ne sait très bien ce
que c'est... C'est le carrefour
de certaines connaissances,
mais c'est aussi une pratique
sociale se découvrant dans
l'expérience, reposant sur
l'analyse de certaines expé-
riences et la connaissance de
certaines difficultés, en par-
ticulier difficultés de la com-
munication. La pédagogie,
c'est l'art d'établir une com-
munication qui soit valable
pour transmettre un certain
nombre de connaissances.
Faire des topos théoriques
sur la pédagogie ne permet
pas de rendre sensibles les
problèmes. Nous avons donc
créé une situation dans la-
quelle se poseraient immé-
diatement des problèmes
pédagogiques qui seraient vé-
cus par les participants. C'est
l'ambiguïté qui a été évoquée
tout à l'heure : dans toute
situation pédagogique, il y a
une information à transmet-
tre, une tâche à faire, mais
cette information ne se trans-
met que dans certaines con-
ditions socio-affectives plus
ou moins favorables à la
communication. Le profes-
seur ou l'instituteur est sans
cesse renvoyé du contenu de
ce qu'il a à enseigner au
problème de savoir comment
ce contenu peut être reçu et
quelles sont les conditions
pédagogiques et psycho-so-
ciales qui le permettront.
Alors, nous avons proposé
aux étudiants de se trouver
18
dans une situation qui ferait
rupture avec la situation pé-
dagogique ; compte tenu de
l'obligation dans laquelle ils
étaient de préparer un exa-
men selon un certain pro-
gramme, nous avons cherché
à ne pas résoudre les problè-
mes par-dessus leur tête :
nous avons voulu qu'ils parti-
cipent au choix d'une pro-
gression, d'une méthode ;
nous avons voulu leur laisser
la possibilité — et la difficul-
té — de choisir ; c'était leur
procurer ainsi une expérien-
ce significative du point de
vue de la problématique édu-
cative.
rupture avec la situation pé-
dagogique ; compte tenu de
l'obligation dans laquelle ils
étaient de préparer un exa-
men selon un certain pro-
gramme, nous avons cherché
à ne pas résoudre les problè-
mes par-dessus leur tête :
nous avons voulu qu'ils parti-
cipent au choix d'une pro-
gression, d'une méthode ;
nous avons voulu leur laisser
la possibilité — et la difficul-
té — de choisir ; c'était leur
procurer ainsi une expérien-
ce significative du point de
vue de la problématique édu-
cative.
Au secours
du groupe
du groupe
II fallait que les groupes
se constituent autour d'un
responsable. Ce furent des
monitrices, c'est-à-dire des
étudiantes qui étaient déjà
passées par ce calvaire l'an-
née précédente ! Cette équi-
pe de quatre (trois monitrices
et moi) que nous formions,
se retrouvait fréquemment
pour discuter du fonctionne-
ment de ces groupes et aus-
si pour effectuer un travail
de recherche en pédagogie,
amorcé au deuxième trimes-
tre de l'année dernière.
se constituent autour d'un
responsable. Ce furent des
monitrices, c'est-à-dire des
étudiantes qui étaient déjà
passées par ce calvaire l'an-
née précédente ! Cette équi-
pe de quatre (trois monitrices
et moi) que nous formions,
se retrouvait fréquemment
pour discuter du fonctionne-
ment de ces groupes et aus-
si pour effectuer un travail
de recherche en pédagogie,
amorcé au deuxième trimes-
tre de l'année dernière.
Comment étaient répar-
tis les rôles ? Les monitrices
devaient aider les groupes à
fonctionner, c'est-à-dire faci-
liter les échanges, intervenir
au niveau des procédures
adoptées par les groupes, en
vue de leur organisation. A
ce niveau, la monitrice était
au service du groupe, mais la
monitrice n'était pas un se-
cours sur le plan des connais-
sances que le groupe pouvait
avoir à acquérir. Par contre,
mon rôle était de me tenir à
la disposition des groupes,
pour qu'ils puissent faire ap-
pel à ma compétence, fournir
des bibliographies, donner
mon point de vue sur ce dont
ils discutaient. Il y a eu deux
phases dans les contacts éta-
tis les rôles ? Les monitrices
devaient aider les groupes à
fonctionner, c'est-à-dire faci-
liter les échanges, intervenir
au niveau des procédures
adoptées par les groupes, en
vue de leur organisation. A
ce niveau, la monitrice était
au service du groupe, mais la
monitrice n'était pas un se-
cours sur le plan des connais-
sances que le groupe pouvait
avoir à acquérir. Par contre,
mon rôle était de me tenir à
la disposition des groupes,
pour qu'ils puissent faire ap-
pel à ma compétence, fournir
des bibliographies, donner
mon point de vue sur ce dont
ils discutaient. Il y a eu deux
phases dans les contacts éta-
blis entre les groupe et moi-
même, comme on l'a dit tout
à l'heure. Les étudiants
étaient donc placés dans une
situation où un certain nom-
bre de ressources leur était
offert : enseignement, docu-
mentation, contacts, organi-
sations de visites, etc. Ils
étaient mis en présence du
programme et de la règle du
jeu, c'est-à-dire l'épreuve ter-
minale qui pouvait porter sur
un des quatre thèmes prévus,
dont un seulement serait
traité en cours. Les douze
groupes ont fonctionné de fa-
çon très diverse. Un groupe
a d'autant mieux fonctionné
et réussi à intégrer l'ensem-
ble de ses membres dans le
travail qu'il a réussi à éluci-
der les problèmes personnels
et interpersonnels qui se po-
saient en son sein. C'était le
rôle de la monitrice de l'aider
à dépasser ce stade — où les
participants ne se compren-
nent pas — pour arriver à
un stade où l'on est capable
de produire ensemble. Dans
tel groupe, un leader très en-
combrant a fait perdre un
temps précieux. Mais dans
la mesure même où l'agace-
ment produit par ce leader a
été ressenti, analysé et dé-
passé, le groupe a trouvé un
nouveau mode de fonctionne-
ment qui a permis à des gens
complètement inhibés de sor-
tir de leur mutisme et de de-
venir coopérants. C'est la
preuve qu'il est indispensable
de passer par une phase où
l'on s'ajuste les uns aux au-
tres. Ce n'est pas facile ;
certains groupes ont évité ces
« moments de vérité » et se
sont retranchés derrière des
systèmes de fonctionnement
traditionnels qui étaient en
fait une fuite. Mais lorsqu'on
a pu dépasser ces problèmes,
grâce à l'aide de la monitrice,
alors sont apparues des moti-
vations assez fortes pour tra-
vailler.
même, comme on l'a dit tout
à l'heure. Les étudiants
étaient donc placés dans une
situation où un certain nom-
bre de ressources leur était
offert : enseignement, docu-
mentation, contacts, organi-
sations de visites, etc. Ils
étaient mis en présence du
programme et de la règle du
jeu, c'est-à-dire l'épreuve ter-
minale qui pouvait porter sur
un des quatre thèmes prévus,
dont un seulement serait
traité en cours. Les douze
groupes ont fonctionné de fa-
çon très diverse. Un groupe
a d'autant mieux fonctionné
et réussi à intégrer l'ensem-
ble de ses membres dans le
travail qu'il a réussi à éluci-
der les problèmes personnels
et interpersonnels qui se po-
saient en son sein. C'était le
rôle de la monitrice de l'aider
à dépasser ce stade — où les
participants ne se compren-
nent pas — pour arriver à
un stade où l'on est capable
de produire ensemble. Dans
tel groupe, un leader très en-
combrant a fait perdre un
temps précieux. Mais dans
la mesure même où l'agace-
ment produit par ce leader a
été ressenti, analysé et dé-
passé, le groupe a trouvé un
nouveau mode de fonctionne-
ment qui a permis à des gens
complètement inhibés de sor-
tir de leur mutisme et de de-
venir coopérants. C'est la
preuve qu'il est indispensable
de passer par une phase où
l'on s'ajuste les uns aux au-
tres. Ce n'est pas facile ;
certains groupes ont évité ces
« moments de vérité » et se
sont retranchés derrière des
systèmes de fonctionnement
traditionnels qui étaient en
fait une fuite. Mais lorsqu'on
a pu dépasser ces problèmes,
grâce à l'aide de la monitrice,
alors sont apparues des moti-
vations assez fortes pour tra-
vailler.
J'ai l'impression, en défi-
nitive, que l'insécurité de
cette situation provient du
nitive, que l'insécurité de
cette situation provient du
fait que les difficultés sont là
(alors que, dans l'enseigne-
ment traditionnel, elles sont
masquées, mais n'en existent
pas moins) ; elles se mani-
festent si brutalement qu'il
faut arriver à les résoudre. Il
faut sans doute « perdre du
temps » pour les résoudre,
avant qu'un travail productif
soit possible.
(alors que, dans l'enseigne-
ment traditionnel, elles sont
masquées, mais n'en existent
pas moins) ; elles se mani-
festent si brutalement qu'il
faut arriver à les résoudre. Il
faut sans doute « perdre du
temps » pour les résoudre,
avant qu'un travail productif
soit possible.
L'apport
des étudiants
des étudiants
N.3. — Vous aviez, je
crois, organisé une table ron-
de à l'issue de l'année der-
nière, à laquelle participait
une cinquantaine d'étudiants
(sur cent cinquante), pour
discuter du travail des grou-
pes de T.P. du certificat de
psychologie de l'enfant. La
discussion a-t-elle apporté
plus d'éléments que celle de
ce soir ?
crois, organisé une table ron-
de à l'issue de l'année der-
nière, à laquelle participait
une cinquantaine d'étudiants
(sur cent cinquante), pour
discuter du travail des grou-
pes de T.P. du certificat de
psychologie de l'enfant. La
discussion a-t-elle apporté
plus d'éléments que celle de
ce soir ?
M.L. Chaix : Plutôt
moins ; il semble que nous
étions encore trop près de
l'expérience, nous les moni-
trices, pour répondre valable-
ment aux critiques formulées
sur notre rôle.
moins ; il semble que nous
étions encore trop près de
l'expérience, nous les moni-
trices, pour répondre valable-
ment aux critiques formulées
sur notre rôle.
C. Blouet : On a constaté
que les étudiants avaient vrai-
ment beaucoup travaillé pour
la pédagogie.
que les étudiants avaient vrai-
ment beaucoup travaillé pour
la pédagogie.
N.3. — En définitive, il
semble que le but de l'expé-
rience ait été atteint et que
les groupes aient eu à éluci-
der une relation pédagogi-
que ?
semble que le but de l'expé-
rience ait été atteint et que
les groupes aient eu à éluci-
der une relation pédagogi-
que ?
C. Bon : Encore faut-il
noter que tout le monde
n'évolue pas à la même vites-
se. Certains ont compris,
d'autres non.
noter que tout le monde
n'évolue pas à la même vites-
se. Certains ont compris,
d'autres non.
N. 3. — Ceux-ci devraient
peut-être renoncer à faire de
la pédagogie...
peut-être renoncer à faire de
la pédagogie...
C. Sandman : Ces pro-
blèmes de relation entre les
membres d'un groupe exis-
tent partout, en psychopa-
thologie, en psychosociale...
blèmes de relation entre les
membres d'un groupe exis-
tent partout, en psychopa-
thologie, en psychosociale...
M.L. Chaix : C'est là que
notre rôle de monitrice était
ambigu. On devait à la fois
exercer une certaine facilita-
notre rôle de monitrice était
ambigu. On devait à la fois
exercer une certaine facilita-
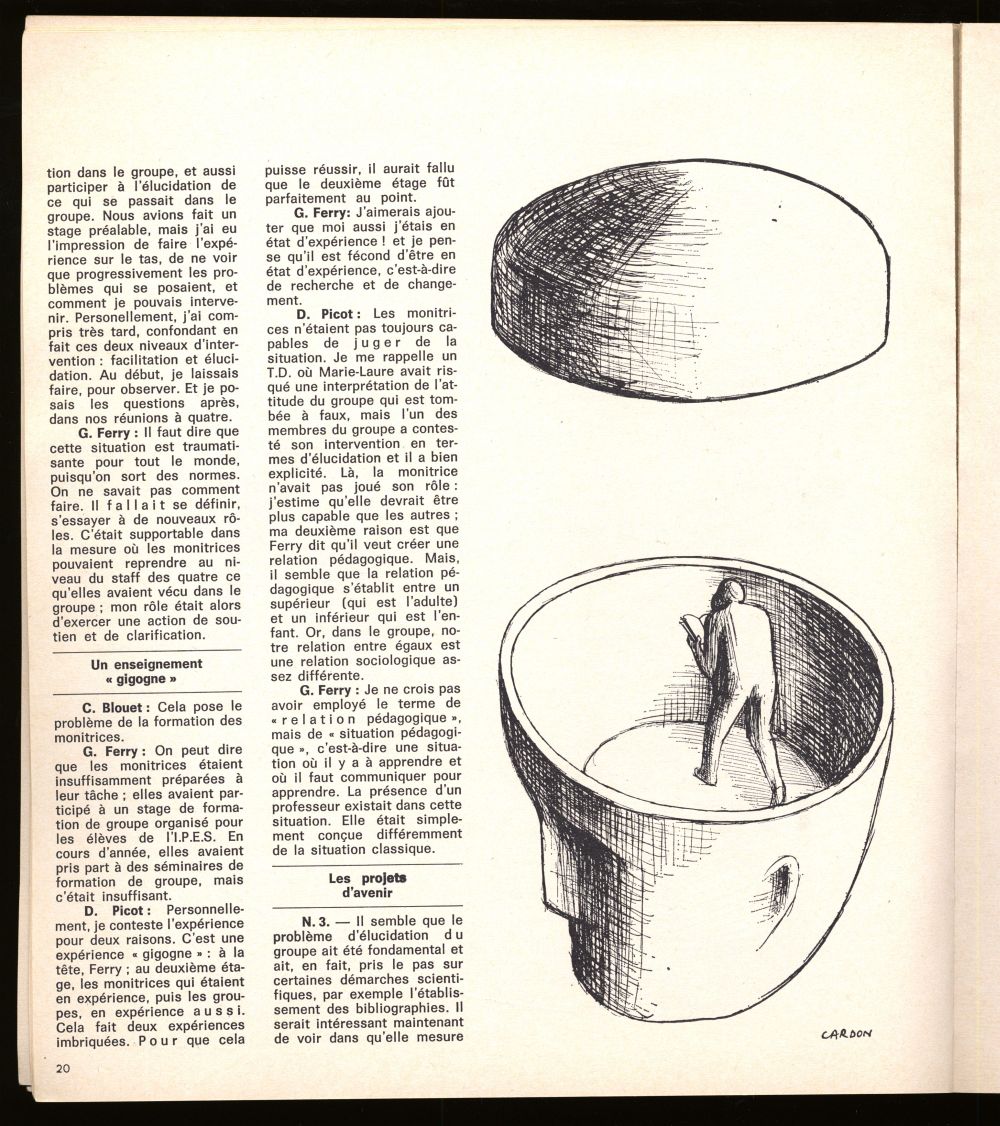

tion dans le groupe, et aussi
participer à l'élucidation de
ce qui se passait dans le
groupe. Nous avions fait un
stage préalable, mais j'ai eu
l'impression de faire l'expé-
rience sur le tas, de ne voir
que progressivement les pro-
blèmes qui se posaient, et
comment je pouvais interve-
nir. Personellement, j'ai com-
pris très tard, confondant en
fait ces deux niveaux d'inter-
vention : facilitation et éluci-
dation. Au début, je laissais
faire, pour observer. Et je po-
sais les questions après,
dans nos réunions à quatre.
G. Ferry : II faut dire que
cette situation est traumati-
sante pour tout le monde,
puisqu'on sort des normes.
On ne savait pas comment
faire. Il fallait se définir,
s'essayer à de nouveaux rô-
les. C'était supportable dans
la mesure où les monitrices
pouvaient reprendre au ni-
veau du staff des quatre ce
qu'elles avaient vécu dans le
groupe ; mon rôle était alors
d'exercer une action de sou-
tien et de clarification.
participer à l'élucidation de
ce qui se passait dans le
groupe. Nous avions fait un
stage préalable, mais j'ai eu
l'impression de faire l'expé-
rience sur le tas, de ne voir
que progressivement les pro-
blèmes qui se posaient, et
comment je pouvais interve-
nir. Personellement, j'ai com-
pris très tard, confondant en
fait ces deux niveaux d'inter-
vention : facilitation et éluci-
dation. Au début, je laissais
faire, pour observer. Et je po-
sais les questions après,
dans nos réunions à quatre.
G. Ferry : II faut dire que
cette situation est traumati-
sante pour tout le monde,
puisqu'on sort des normes.
On ne savait pas comment
faire. Il fallait se définir,
s'essayer à de nouveaux rô-
les. C'était supportable dans
la mesure où les monitrices
pouvaient reprendre au ni-
veau du staff des quatre ce
qu'elles avaient vécu dans le
groupe ; mon rôle était alors
d'exercer une action de sou-
tien et de clarification.
Un enseignement
« gigogne »
« gigogne »
C. Blouet : Cela pose le
problème de la formation des
monitrices.
problème de la formation des
monitrices.
G. Ferry : On peut dire
que les monitrices étaient
insuffisamment préparées à
leur tâche ; elles avaient par-
ticipé à un stage de forma-
tion de groupe organisé pour
les élèves de l'I.P.E.S. En
cours d'année, elles avaient
pris part à des séminaires de
formation de groupe, mais
c'était insuffisant.
que les monitrices étaient
insuffisamment préparées à
leur tâche ; elles avaient par-
ticipé à un stage de forma-
tion de groupe organisé pour
les élèves de l'I.P.E.S. En
cours d'année, elles avaient
pris part à des séminaires de
formation de groupe, mais
c'était insuffisant.
D. Picot : Personnelle-
ment, je conteste l'expérience
pour deux raisons. C'est une
expérience « gigogne » : à la
tête, Ferry ; au deuxième éta-
ge, les monitrices qui étaient
en expérience, puis les grou-
pes, en expérience aussi.
Cela fait deux expériences
imbriquées. Pour que cela
ment, je conteste l'expérience
pour deux raisons. C'est une
expérience « gigogne » : à la
tête, Ferry ; au deuxième éta-
ge, les monitrices qui étaient
en expérience, puis les grou-
pes, en expérience aussi.
Cela fait deux expériences
imbriquées. Pour que cela
puisse réussir, il aurait fallu
que le deuxième étage fût
parfaitement au point.
que le deuxième étage fût
parfaitement au point.
G. Ferry: J'aimerais ajou-
ter que moi aussi j'étais en
état d'expérience ! et je pen-
se qu'il est fécond d'être en
état d'expérience, c'est-à-dire
de recherche et de change-
ment.
ter que moi aussi j'étais en
état d'expérience ! et je pen-
se qu'il est fécond d'être en
état d'expérience, c'est-à-dire
de recherche et de change-
ment.
D. Picot : Les monitri-
ces n'étaient pas toujours ca-
pables de juger de la
situation. Je me rappelle un
T.D. où Marie-Laure avait ris-
qué une interprétation de l'at-
titude du groupe qui est tom-
bée à faux, mais l'un des
membres du groupe a contes-
té son intervention en ter-
mes d'élucidation et il a bien
explicité. Là, la monitrice
n'avait pas joué son rôle :
j'estime qu'elle devrait être
plus capable que les autres ;
ma deuxième raison est que
Ferry dit qu'il veut créer une
relation pédagogique. Mais,
il semble que la relation pé-
dagogique s'établit entre un
supérieur (qui est l'adulte)
et un inférieur qui est l'en-
fant. Or, dans le groupe, no-
tre relation entre égaux est
une relation sociologique as-
sez différente.
ces n'étaient pas toujours ca-
pables de juger de la
situation. Je me rappelle un
T.D. où Marie-Laure avait ris-
qué une interprétation de l'at-
titude du groupe qui est tom-
bée à faux, mais l'un des
membres du groupe a contes-
té son intervention en ter-
mes d'élucidation et il a bien
explicité. Là, la monitrice
n'avait pas joué son rôle :
j'estime qu'elle devrait être
plus capable que les autres ;
ma deuxième raison est que
Ferry dit qu'il veut créer une
relation pédagogique. Mais,
il semble que la relation pé-
dagogique s'établit entre un
supérieur (qui est l'adulte)
et un inférieur qui est l'en-
fant. Or, dans le groupe, no-
tre relation entre égaux est
une relation sociologique as-
sez différente.
G. Ferry : Je ne crois pas
avoir employé le terme de
«relation pédagogique »,
mais de « situation pédagogi-
que », c'est-à-dire une situa-
tion où il y a à apprendre et
où il faut communiquer pour
apprendre. La présence d'un
professeur existait dans cette
situation. Elle était simple-
ment conçue différemment
de la situation classique.
avoir employé le terme de
«relation pédagogique »,
mais de « situation pédagogi-
que », c'est-à-dire une situa-
tion où il y a à apprendre et
où il faut communiquer pour
apprendre. La présence d'un
professeur existait dans cette
situation. Elle était simple-
ment conçue différemment
de la situation classique.
Les projets
d'avenir
d'avenir
N. 3. — II semble que le
problème d'élucidation d u
groupe ait été fondamental et
ait, en fait, pris le pas sur
certaines démarches scienti-
fiques, par exemple l'établis-
sement des bibliographies. Il
serait intéressant maintenant
de voir dans qu'elle mesure
problème d'élucidation d u
groupe ait été fondamental et
ait, en fait, pris le pas sur
certaines démarches scienti-
fiques, par exemple l'établis-
sement des bibliographies. Il
serait intéressant maintenant
de voir dans qu'elle mesure
20
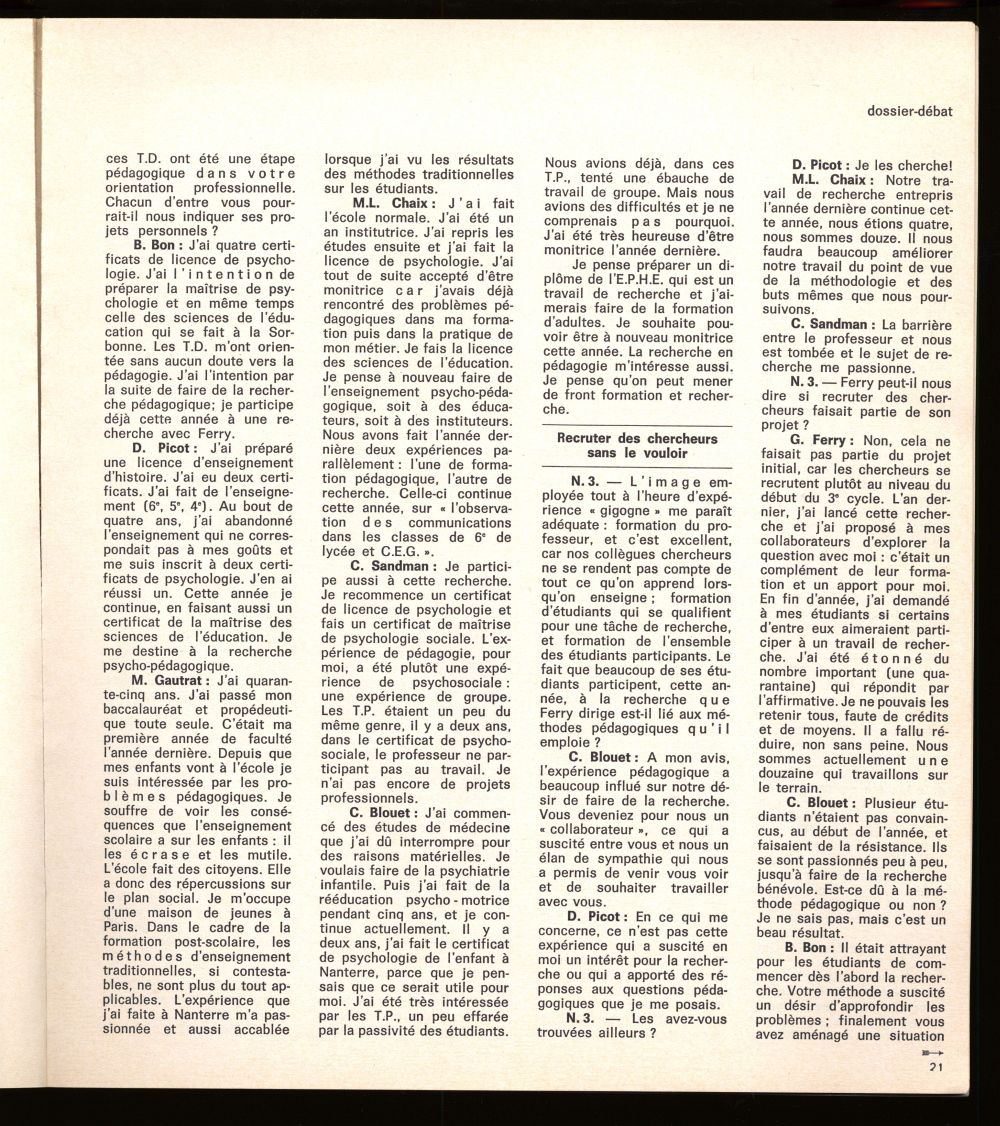

dossier-débat
ces T.D. ont été une étape
pédagogique dans votre
orientation professionnelle.
Chacun d'entre vous pour-
rait-il nous indiquer ses pro-
jets personnels ?
pédagogique dans votre
orientation professionnelle.
Chacun d'entre vous pour-
rait-il nous indiquer ses pro-
jets personnels ?
B. Bon : J'ai quatre certi-
ficats de licence de psycho-
logie. J'ai l'intention de
préparer la maîtrise de psy-
chologie et en même temps
celle des sciences de l'édu-
cation qui se fait à la Sor-
bonne. Les T.D. m'ont orien-
tée sans aucun doute vers la
pédagogie. J'ai l'intention par
la suite de faire de la recher-
che pédagogique; je participe
déjà cette année à une re-
cherche avec Ferry.
ficats de licence de psycho-
logie. J'ai l'intention de
préparer la maîtrise de psy-
chologie et en même temps
celle des sciences de l'édu-
cation qui se fait à la Sor-
bonne. Les T.D. m'ont orien-
tée sans aucun doute vers la
pédagogie. J'ai l'intention par
la suite de faire de la recher-
che pédagogique; je participe
déjà cette année à une re-
cherche avec Ferry.
D. Picot : J'ai préparé
une licence d'enseignement
d'histoire. J'ai eu deux certi-
ficats. J'ai fait de l'enseigne-
ment (6e, 5e, 4e). Au bout de
quatre ans, j'ai abandonné
l'enseignement qui ne corres-
pondait pas à mes goûts et
me suis inscrit à deux certi-
ficats de psychologie. J'en ai
réussi un. Cette année je
continue, en faisant aussi un
certificat de la maîtrise des
sciences de l'éducation. Je
me destine à la recherche
psycho-pédagogique.
une licence d'enseignement
d'histoire. J'ai eu deux certi-
ficats. J'ai fait de l'enseigne-
ment (6e, 5e, 4e). Au bout de
quatre ans, j'ai abandonné
l'enseignement qui ne corres-
pondait pas à mes goûts et
me suis inscrit à deux certi-
ficats de psychologie. J'en ai
réussi un. Cette année je
continue, en faisant aussi un
certificat de la maîtrise des
sciences de l'éducation. Je
me destine à la recherche
psycho-pédagogique.
M. Gaufrât : J'ai quaran-
te-cinq ans. J'ai passé mon
baccalauréat et propédeuti-
que toute seule. C'était ma
première année de faculté
l'année dernière. Depuis que
mes enfants vont à l'école je
suis intéressée par les pro-
blêmes pédagogiques. Je
souffre de voir les consé-
quences que l'enseignement
scolaire a sur les enfants : il
les écrase et les mutile.
L'école fait des citoyens. Elle
a donc des répercussions sur
le plan social. Je m'occupe
d'une maison de jeunes à
Paris. Dans le cadre de la
formation post-scolaire, les
méthodes d'enseignement
traditionnelles, si contesta-
bles, ne sont plus du tout ap-
plicables. L'expérience que
j'ai faite à Nanterre m'a pas-
sionnée et aussi accablée
te-cinq ans. J'ai passé mon
baccalauréat et propédeuti-
que toute seule. C'était ma
première année de faculté
l'année dernière. Depuis que
mes enfants vont à l'école je
suis intéressée par les pro-
blêmes pédagogiques. Je
souffre de voir les consé-
quences que l'enseignement
scolaire a sur les enfants : il
les écrase et les mutile.
L'école fait des citoyens. Elle
a donc des répercussions sur
le plan social. Je m'occupe
d'une maison de jeunes à
Paris. Dans le cadre de la
formation post-scolaire, les
méthodes d'enseignement
traditionnelles, si contesta-
bles, ne sont plus du tout ap-
plicables. L'expérience que
j'ai faite à Nanterre m'a pas-
sionnée et aussi accablée
lorsque j'ai vu les résultats
des méthodes traditionnelles
sur les étudiants.
des méthodes traditionnelles
sur les étudiants.
M.L. Chaix : J'ai fait
l'école normale. J'ai été un
an institutrice. J'ai repris les
études ensuite et j'ai fait la
licence de psychologie. J'ai
tout de suite accepté d'être
monitrice car j'avais déjà
rencontré des problèmes pé-
dagogiques dans ma forma-
tion puis dans la pratique de
mon métier. Je fais la licence
des sciences de l'éducation.
Je pense à nouveau faire de
l'enseignement psycho-péda-
gogique, soit à des éduca-
teurs, soit à des instituteurs.
Nous avons fait l'année der-
nière deux expériences pa-
rallèlement: l'une de forma-
tion pédagogique, l'autre de
recherche. Celle-ci continue
cette année, sur « l'observa-
tion des communications
dans les classes de 6e de
lycée et C.E.G. ».
l'école normale. J'ai été un
an institutrice. J'ai repris les
études ensuite et j'ai fait la
licence de psychologie. J'ai
tout de suite accepté d'être
monitrice car j'avais déjà
rencontré des problèmes pé-
dagogiques dans ma forma-
tion puis dans la pratique de
mon métier. Je fais la licence
des sciences de l'éducation.
Je pense à nouveau faire de
l'enseignement psycho-péda-
gogique, soit à des éduca-
teurs, soit à des instituteurs.
Nous avons fait l'année der-
nière deux expériences pa-
rallèlement: l'une de forma-
tion pédagogique, l'autre de
recherche. Celle-ci continue
cette année, sur « l'observa-
tion des communications
dans les classes de 6e de
lycée et C.E.G. ».
C. Sandman : Je partici-
pe aussi à cette recherche.
Je recommence un certificat
de licence de psychologie et
fais un certificat de maîtrise
de psychologie sociale. L'ex-
périence de pédagogie, pour
moi, a été plutôt une expé-
rience de psychosociale :
une expérience de groupe.
Les T.P. étaient un peu du
même genre, il y a deux ans,
dans le certificat de psycho-
sociale, le professeur ne par-
ticipant pas au travail. Je
n'ai pas encore de projets
professionnels.
pe aussi à cette recherche.
Je recommence un certificat
de licence de psychologie et
fais un certificat de maîtrise
de psychologie sociale. L'ex-
périence de pédagogie, pour
moi, a été plutôt une expé-
rience de psychosociale :
une expérience de groupe.
Les T.P. étaient un peu du
même genre, il y a deux ans,
dans le certificat de psycho-
sociale, le professeur ne par-
ticipant pas au travail. Je
n'ai pas encore de projets
professionnels.
C. Blouet : J'ai commen-
cé des études de médecine
que j'ai dû interrompre pour
des raisons matérielles. Je
voulais faire de la psychiatrie
infantile. Puis j'ai fait de la
rééducation psycho - motrice
pendant cinq ans, et je con-
tinue actuellement. Il y a
deux ans, j'ai fait le certificat
de psychologie de l'enfant à
Nanterre, parce que je pen-
sais que ce serait utile pour
moi. J'ai été très intéressée
par les T.P., un peu effarée
par la passivité des étudiants.
cé des études de médecine
que j'ai dû interrompre pour
des raisons matérielles. Je
voulais faire de la psychiatrie
infantile. Puis j'ai fait de la
rééducation psycho - motrice
pendant cinq ans, et je con-
tinue actuellement. Il y a
deux ans, j'ai fait le certificat
de psychologie de l'enfant à
Nanterre, parce que je pen-
sais que ce serait utile pour
moi. J'ai été très intéressée
par les T.P., un peu effarée
par la passivité des étudiants.
Nous avions déjà, dans ces
T.P., tenté une ébauche de
travail de groupe. Mais nous
avions des difficultés et je ne
comprenais pas pourquoi.
J'ai été très heureuse d'être
monitrice l'année dernière.
T.P., tenté une ébauche de
travail de groupe. Mais nous
avions des difficultés et je ne
comprenais pas pourquoi.
J'ai été très heureuse d'être
monitrice l'année dernière.
Je pense préparer un di-
plôme de l'E.P.H.E. qui est un
travail de recherche et j'ai-
merais faire de la formation
d'adultes. Je souhaite pou-
voir être à nouveau monitrice
cette année. La recherche en
pédagogie m'intéresse aussi.
Je pense qu'on peut mener
de front formation et recher-
che.
plôme de l'E.P.H.E. qui est un
travail de recherche et j'ai-
merais faire de la formation
d'adultes. Je souhaite pou-
voir être à nouveau monitrice
cette année. La recherche en
pédagogie m'intéresse aussi.
Je pense qu'on peut mener
de front formation et recher-
che.
Recruter des chercheurs
sans le vouloir
sans le vouloir
N. 3. — L'image em-
ployée tout à l'heure d'expé-
rience « gigogne » me paraît
adéquate : formation du pro-
fesseur, et c'est excellent,
car nos collègues chercheurs
ne se rendent pas compte de
tout ce qu'on apprend lors-
qu'on enseigne ; formation
d'étudiants qui se qualifient
pour une tâche de recherche,
et formation de l'ensemble
des étudiants participants. Le
fait que beaucoup de ses étu-
diants participent, cette an-
née, à la recherche que
Ferry dirige est-il lié aux mé-
thodes pédagogiques qu'il
emploie ?
ployée tout à l'heure d'expé-
rience « gigogne » me paraît
adéquate : formation du pro-
fesseur, et c'est excellent,
car nos collègues chercheurs
ne se rendent pas compte de
tout ce qu'on apprend lors-
qu'on enseigne ; formation
d'étudiants qui se qualifient
pour une tâche de recherche,
et formation de l'ensemble
des étudiants participants. Le
fait que beaucoup de ses étu-
diants participent, cette an-
née, à la recherche que
Ferry dirige est-il lié aux mé-
thodes pédagogiques qu'il
emploie ?
C. Blouet : A mon avis,
l'expérience pédagogique a
beaucoup influé sur notre dé-
sir de faire de la recherche.
Vous deveniez pour nous un
« collaborateur », ce qui a
suscité entre vous et nous un
élan de sympathie qui nous
a permis de venir vous voir
et de souhaiter travailler
avec vous.
l'expérience pédagogique a
beaucoup influé sur notre dé-
sir de faire de la recherche.
Vous deveniez pour nous un
« collaborateur », ce qui a
suscité entre vous et nous un
élan de sympathie qui nous
a permis de venir vous voir
et de souhaiter travailler
avec vous.
D. Picot : En ce qui me
concerne, ce n'est pas cette
expérience qui a suscité en
moi un intérêt pour la recher-
che ou qui a apporté des ré-
ponses aux questions péda-
gogiques que je me posais.
concerne, ce n'est pas cette
expérience qui a suscité en
moi un intérêt pour la recher-
che ou qui a apporté des ré-
ponses aux questions péda-
gogiques que je me posais.
N. 3. — Les avez-vous
trouvées ailleurs ?
trouvées ailleurs ?
D. Picot : Je les cherche!
M.L. Chaix : Notre tra-
vail de recherche entrepris
l'année dernière continue cet-
te année, nous étions quatre,
nous sommes douze. Il nous
faudra beaucoup améliorer
notre travail du point de vue
de la méthodologie et des
buts mêmes que nous pour-
suivons.
vail de recherche entrepris
l'année dernière continue cet-
te année, nous étions quatre,
nous sommes douze. Il nous
faudra beaucoup améliorer
notre travail du point de vue
de la méthodologie et des
buts mêmes que nous pour-
suivons.
C. Sandman : La barrière
entre le professeur et nous
est tombée et le sujet de re-
cherche me passionne.
entre le professeur et nous
est tombée et le sujet de re-
cherche me passionne.
N. 3. — Ferry peut-il nous
dire si recruter des cher-
cheurs faisait partie de son
projet ?
dire si recruter des cher-
cheurs faisait partie de son
projet ?
G. Ferry : Non, cela ne
faisait pas partie du projet
initial, car les chercheurs se
recrutent plutôt au niveau du
début du 3e cycle. L'an der-
nier, j'ai lancé cette recher-
che et j'ai proposé à mes
collaborateurs d'explorer la
question avec moi : c'était un
complément de leur forma-
tion et un apport pour moi.
En fin d'année, j'ai demandé
à mes étudiants si certains
d'entre eux aimeraient parti-
ciper à un travail de recher-
che. J'ai été étonné du
nombre important (une qua-
rantaine) qui répondit par
l'affirmative. Je ne pouvais les
retenir tous, faute de crédits
et de moyens. Il a fallu ré-
duire, non sans peine. Nous
sommes actuellement une
douzaine qui travaillons sur
le terrain.
faisait pas partie du projet
initial, car les chercheurs se
recrutent plutôt au niveau du
début du 3e cycle. L'an der-
nier, j'ai lancé cette recher-
che et j'ai proposé à mes
collaborateurs d'explorer la
question avec moi : c'était un
complément de leur forma-
tion et un apport pour moi.
En fin d'année, j'ai demandé
à mes étudiants si certains
d'entre eux aimeraient parti-
ciper à un travail de recher-
che. J'ai été étonné du
nombre important (une qua-
rantaine) qui répondit par
l'affirmative. Je ne pouvais les
retenir tous, faute de crédits
et de moyens. Il a fallu ré-
duire, non sans peine. Nous
sommes actuellement une
douzaine qui travaillons sur
le terrain.
C. Blouet : Plusieur étu-
diants n'étaient pas convain-
cus, au début de l'année, et
faisaient de la résistance. Ils
se sont passionnés peu à peu,
jusqu'à faire de la recherche
bénévole. Est-ce dû à la mé-
thode pédagogique ou non ?
Je ne sais pas, mais c'est un
beau résultat.
diants n'étaient pas convain-
cus, au début de l'année, et
faisaient de la résistance. Ils
se sont passionnés peu à peu,
jusqu'à faire de la recherche
bénévole. Est-ce dû à la mé-
thode pédagogique ou non ?
Je ne sais pas, mais c'est un
beau résultat.
B. Bon : II était attrayant
pour les étudiants de com-
mencer dès l'abord la recher-
che. Votre méthode a suscité
un désir d'approfondir les
problèmes ; finalement vous
avez aménagé une situation
pour les étudiants de com-
mencer dès l'abord la recher-
che. Votre méthode a suscité
un désir d'approfondir les
problèmes ; finalement vous
avez aménagé une situation
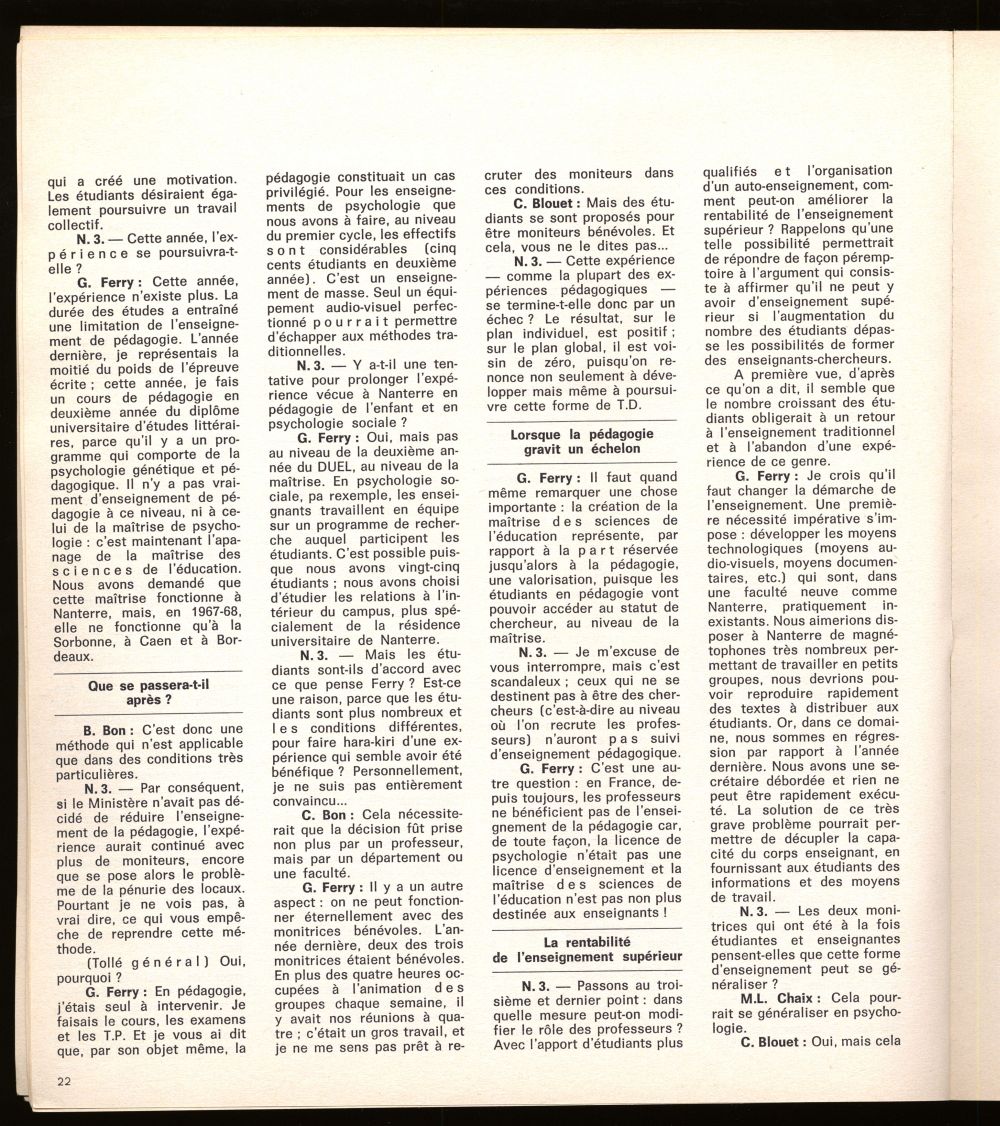

qui a créé une motivation.
Les étudiants désiraient éga-
lement poursuivre un travail
collectif.
Les étudiants désiraient éga-
lement poursuivre un travail
collectif.
N. 3. — Cette année, l'ex-
périence se poursuivra-t-
elle ?
périence se poursuivra-t-
elle ?
G. Ferry : Cette année,
l'expérience n'existe plus. La
durée des études a entraîné
une limitation de l'enseigne-
ment de pédagogie. L'année
dernière, je représentais la
moitié du poids de l'épreuve
écrite ; cette année, je fais
un cours de pédagogie en
deuxième année du diplôme
universitaire d'études littérai-
res, parce qu'il y a un pro-
gramme qui comporte de la
psychologie génétique et pé-
dagogique. Il n'y a pas vrai-
ment d'enseignement de pé-
dagogie à ce niveau, ni à ce-
lui de la maîtrise de psycho-
logie : c'est maintenant l'apa-
nage de la maîtrise des
sciences de l'éducation.
Nous avons demandé que
cette maîtrise fonctionne à
Nanterre, mais, en 1967-68,
elle ne fonctionne qu'à la
Sorbonne, à Caen et à Bor-
deaux.
l'expérience n'existe plus. La
durée des études a entraîné
une limitation de l'enseigne-
ment de pédagogie. L'année
dernière, je représentais la
moitié du poids de l'épreuve
écrite ; cette année, je fais
un cours de pédagogie en
deuxième année du diplôme
universitaire d'études littérai-
res, parce qu'il y a un pro-
gramme qui comporte de la
psychologie génétique et pé-
dagogique. Il n'y a pas vrai-
ment d'enseignement de pé-
dagogie à ce niveau, ni à ce-
lui de la maîtrise de psycho-
logie : c'est maintenant l'apa-
nage de la maîtrise des
sciences de l'éducation.
Nous avons demandé que
cette maîtrise fonctionne à
Nanterre, mais, en 1967-68,
elle ne fonctionne qu'à la
Sorbonne, à Caen et à Bor-
deaux.
Que se passera-t-il
après ?
après ?
B. Bon : C'est donc une
méthode qui n'est applicable
que dans des conditions très
particulières.
méthode qui n'est applicable
que dans des conditions très
particulières.
N.3. — Par conséquent,
si le Ministère n'avait pas dé-
cidé de réduire l'enseigne-
ment de la pédagogie, l'expé-
rience aurait continué avec
plus de moniteurs, encore
que se pose alors le problè-
me de la pénurie des locaux.
Pourtant je ne vois pas, à
vrai dire, ce qui vous empê-
che de reprendre cette mé-
thode.
si le Ministère n'avait pas dé-
cidé de réduire l'enseigne-
ment de la pédagogie, l'expé-
rience aurait continué avec
plus de moniteurs, encore
que se pose alors le problè-
me de la pénurie des locaux.
Pourtant je ne vois pas, à
vrai dire, ce qui vous empê-
che de reprendre cette mé-
thode.
(Tollé général) Oui,
pourquoi ?
pourquoi ?
G. Ferry : En pédagogie,
j'étais seul à intervenir. Je
faisais le cours, les examens
et les T.P. Et je vous ai dit
que, par son objet même, la
j'étais seul à intervenir. Je
faisais le cours, les examens
et les T.P. Et je vous ai dit
que, par son objet même, la
pédagogie constituait un cas
privilégié. Pour les enseigne-
ments de psychologie que
nous avons à faire, au niveau
du premier cycle, les effectifs
sont considérables (cinq
cents étudiants en deuxième
année). C'est un enseigne-
ment de masse. Seul un équi-
pement audio-visuel perfec-
tionné pourrait permettre
d'échapper aux méthodes tra-
ditionnelles.
privilégié. Pour les enseigne-
ments de psychologie que
nous avons à faire, au niveau
du premier cycle, les effectifs
sont considérables (cinq
cents étudiants en deuxième
année). C'est un enseigne-
ment de masse. Seul un équi-
pement audio-visuel perfec-
tionné pourrait permettre
d'échapper aux méthodes tra-
ditionnelles.
N.3. — Y a-t-il une ten-
tative pour prolonger l'expé-
rience vécue à Nanterre en
pédagogie de l'enfant et en
psychologie sociale ?
tative pour prolonger l'expé-
rience vécue à Nanterre en
pédagogie de l'enfant et en
psychologie sociale ?
G. Ferry : Oui, mais pas
au niveau de la deuxième an-
née du DUEL, au niveau de la
maîtrise. En psychologie so-
ciale, pa rexemple, les ensei-
gnants travaillent en équipe
sur un programme de recher-
che auquel participent les
étudiants. C'est possible puis-
que nous avons vingt-cinq
étudiants ; nous avons choisi
d'étudier les relations à l'in-
térieur du campus, plus spé-
cialement de la résidence
universitaire de Nanterre.
au niveau de la deuxième an-
née du DUEL, au niveau de la
maîtrise. En psychologie so-
ciale, pa rexemple, les ensei-
gnants travaillent en équipe
sur un programme de recher-
che auquel participent les
étudiants. C'est possible puis-
que nous avons vingt-cinq
étudiants ; nous avons choisi
d'étudier les relations à l'in-
térieur du campus, plus spé-
cialement de la résidence
universitaire de Nanterre.
N.3. — Mais les étu-
diants sont-ils d'accord avec
ce que pense Ferry ? Est-ce
une raison, parce que les étu-
diants sont plus nombreux et
I e s conditions différentes,
pour faire hara-kiri d'une ex-
périence qui semble avoir été
bénéfique ? Personnellement,
je ne suis pas entièrement
convaincu...
diants sont-ils d'accord avec
ce que pense Ferry ? Est-ce
une raison, parce que les étu-
diants sont plus nombreux et
I e s conditions différentes,
pour faire hara-kiri d'une ex-
périence qui semble avoir été
bénéfique ? Personnellement,
je ne suis pas entièrement
convaincu...
C. Bon : Cela nécessite-
rait que la décision fût prise
non plus par un professeur,
mais par un département ou
une faculté.
rait que la décision fût prise
non plus par un professeur,
mais par un département ou
une faculté.
G. Ferry : II y a un autre
aspect : on ne peut fonction-
ner éternellement avec des
monitrices bénévoles. L'an-
née dernière, deux des trois
monitrices étaient bénévoles.
En plus des quatre heures oc-
cupées à l'animation des
groupes chaque semaine, il
y avait nos réunions à qua-
tre ; c'était un gros travail, et
je ne me sens pas prêt à re-
aspect : on ne peut fonction-
ner éternellement avec des
monitrices bénévoles. L'an-
née dernière, deux des trois
monitrices étaient bénévoles.
En plus des quatre heures oc-
cupées à l'animation des
groupes chaque semaine, il
y avait nos réunions à qua-
tre ; c'était un gros travail, et
je ne me sens pas prêt à re-
cruter des moniteurs dans
ces conditions.
ces conditions.
C. Blouet : Mais des étu-
diants se sont proposés pour
être moniteurs bénévoles. Et
cela, vous ne le dites pas...
diants se sont proposés pour
être moniteurs bénévoles. Et
cela, vous ne le dites pas...
N. 3. — Cette expérience
— comme la plupart des ex-
périences pédagogiques —
se termine-t-elle donc par un
échec ? Le résultat, sur le
plan individuel, est positif ;
sur le plan global, il est voi-
sin de zéro, puisqu'on re-
nonce non seulement à déve-
lopper mais même à poursui-
vre cette forme de T.D.
— comme la plupart des ex-
périences pédagogiques —
se termine-t-elle donc par un
échec ? Le résultat, sur le
plan individuel, est positif ;
sur le plan global, il est voi-
sin de zéro, puisqu'on re-
nonce non seulement à déve-
lopper mais même à poursui-
vre cette forme de T.D.
Lorsque la pédagogie
gravit un échelon
gravit un échelon
G. Ferry : II faut quand
même remarquer une chose
importante : la création de la
maîtrise des sciences de
l'éducation représente, par
rapport à la part réservée
jusqu'alors à la pédagogie,
une valorisation, puisque les
étudiants en pédagogie vont
pouvoir accéder au statut de
chercheur, au niveau de la
maîtrise.
même remarquer une chose
importante : la création de la
maîtrise des sciences de
l'éducation représente, par
rapport à la part réservée
jusqu'alors à la pédagogie,
une valorisation, puisque les
étudiants en pédagogie vont
pouvoir accéder au statut de
chercheur, au niveau de la
maîtrise.
N.3. — Je m'excuse de
vous interrompre, mais c'est
scandaleux ; ceux qui ne se
destinent pas à être des cher-
cheurs (c'est-à-dire au niveau
où l'on recrute les profes-
seurs) n'auront pas suivi
d'enseignement pédagogique.
vous interrompre, mais c'est
scandaleux ; ceux qui ne se
destinent pas à être des cher-
cheurs (c'est-à-dire au niveau
où l'on recrute les profes-
seurs) n'auront pas suivi
d'enseignement pédagogique.
G. Ferry : C'est une au-
tre question : en France, de-
puis toujours, les professeurs
ne bénéficient pas de l'ensei-
gnement de la pédagogie car,
de toute façon, la licence de
psychologie n'était pas une
licence d'enseignement et la
maîtrise des sciences de
l'éducation n'est pas non plus
destinée aux enseignants !
tre question : en France, de-
puis toujours, les professeurs
ne bénéficient pas de l'ensei-
gnement de la pédagogie car,
de toute façon, la licence de
psychologie n'était pas une
licence d'enseignement et la
maîtrise des sciences de
l'éducation n'est pas non plus
destinée aux enseignants !
La rentabilité
de l'enseignement supérieur
de l'enseignement supérieur
N.3. — Passons au troi-
sième et dernier point : dans
quelle mesure peut-on modi-
fier le rôle des professeurs ?
Avec l'apport d'étudiants plus
sième et dernier point : dans
quelle mesure peut-on modi-
fier le rôle des professeurs ?
Avec l'apport d'étudiants plus
qualifiés et l'organisation
d'un auto-enseignement, com-
ment peut-on améliorer la
rentabilité de l'enseignement
supérieur ? Rappelons qu'une
telle possibilité permettrait
de répondre de façon péremp-
toire à l'argument qui consis-
te à affirmer qu'il ne peut y
avoir d'enseignement supé-
rieur si l'augmentation du
nombre des étudiants dépas-
se les possibilités de former
des enseignants-chercheurs.
d'un auto-enseignement, com-
ment peut-on améliorer la
rentabilité de l'enseignement
supérieur ? Rappelons qu'une
telle possibilité permettrait
de répondre de façon péremp-
toire à l'argument qui consis-
te à affirmer qu'il ne peut y
avoir d'enseignement supé-
rieur si l'augmentation du
nombre des étudiants dépas-
se les possibilités de former
des enseignants-chercheurs.
A première vue, d'après
ce qu'on a dit, il semble que
le nombre croissant des étu-
diants obligerait à un retour
à l'enseignement traditionnel
et à l'abandon d'une expé-
rience de ce genre.
ce qu'on a dit, il semble que
le nombre croissant des étu-
diants obligerait à un retour
à l'enseignement traditionnel
et à l'abandon d'une expé-
rience de ce genre.
G. Ferry : Je crois qu'il
faut changer la démarche de
l'enseignement. Une premiè-
re nécessité impérative s'im-
pose : développer les moyens
technologiques (moyens au-
dio-visuels, moyens documen-
taires, etc.) qui sont, dans
une faculté neuve comme
Nanterre, pratiquement in-
existants. Nous aimerions dis-
poser à Nanterre de magné-
tophones très nombreux per-
mettant de travailler en petits
groupes, nous devrions pou-
voir reproduire rapidement
des textes à distribuer aux
étudiants. Or, dans ce domai-
ne, nous sommes en régres-
sion par rapport à l'année
dernière. Nous avons une se-
crétaire débordée et rien ne
peut être rapidement exécu-
té. La solution de ce très
grave problème pourrait per-
mettre de décupler la capa-
cité du corps enseignant, en
fournissant aux étudiants des
informations et des moyens
de travail.
faut changer la démarche de
l'enseignement. Une premiè-
re nécessité impérative s'im-
pose : développer les moyens
technologiques (moyens au-
dio-visuels, moyens documen-
taires, etc.) qui sont, dans
une faculté neuve comme
Nanterre, pratiquement in-
existants. Nous aimerions dis-
poser à Nanterre de magné-
tophones très nombreux per-
mettant de travailler en petits
groupes, nous devrions pou-
voir reproduire rapidement
des textes à distribuer aux
étudiants. Or, dans ce domai-
ne, nous sommes en régres-
sion par rapport à l'année
dernière. Nous avons une se-
crétaire débordée et rien ne
peut être rapidement exécu-
té. La solution de ce très
grave problème pourrait per-
mettre de décupler la capa-
cité du corps enseignant, en
fournissant aux étudiants des
informations et des moyens
de travail.
N.3. — Les deux moni-
trices qui ont été à la fois
étudiantes et enseignantes
pensent-elles que cette forme
d'enseignement peut se gé-
néraliser ?
trices qui ont été à la fois
étudiantes et enseignantes
pensent-elles que cette forme
d'enseignement peut se gé-
néraliser ?
M.L. Chaix : Cela pour-
rait se généraliser en psycho-
logie.
rait se généraliser en psycho-
logie.
C. Blouet : Oui, mais cela
22
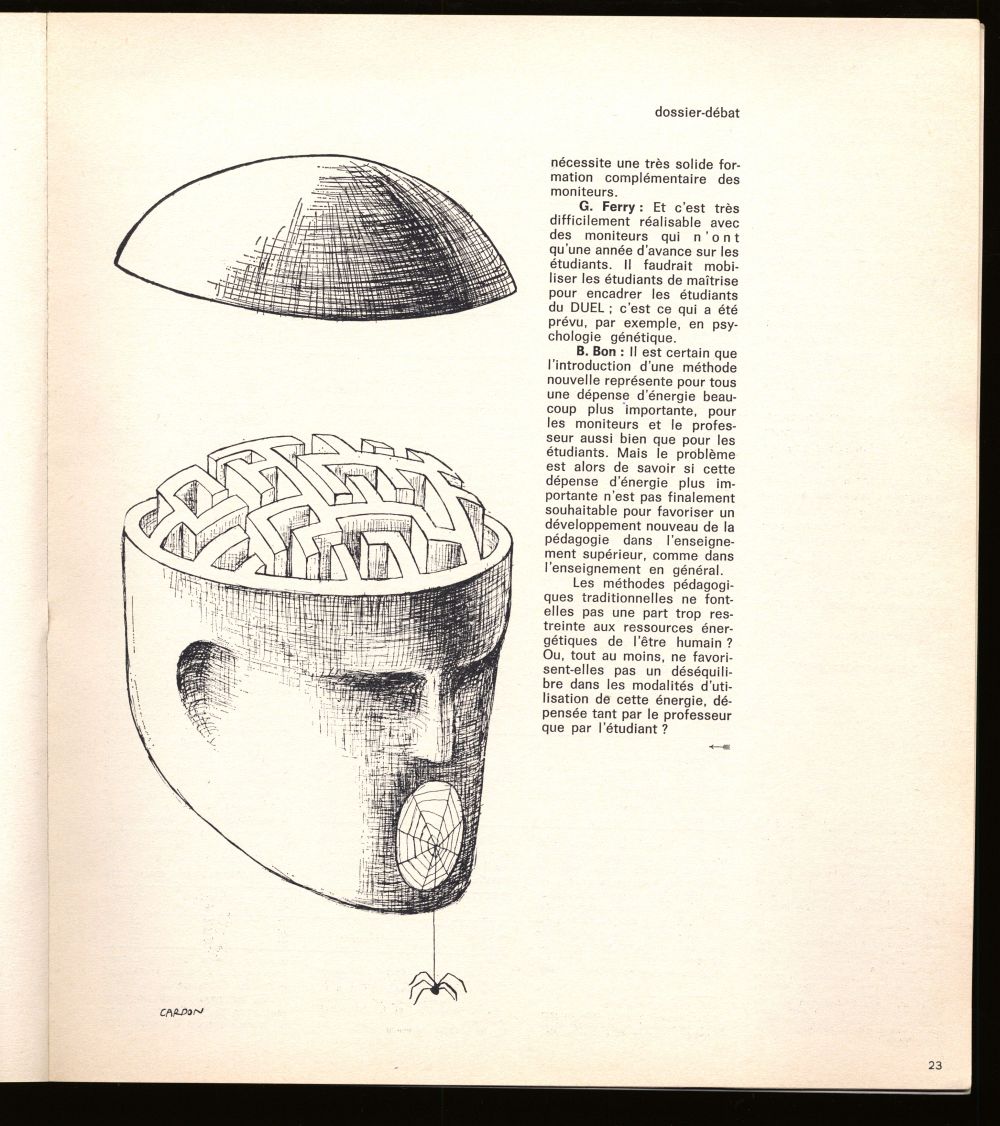

dossier-débat
nécessite une très solide for-
mation complémentaire des
moniteurs.
mation complémentaire des
moniteurs.
G. Ferry : Et c'est très
difficilement réalisable avec
des moniteurs qui n'ont
qu'une année d'avance sur les
étudiants. Il faudrait mobi-
liser les étudiants de maîtrise
pour encadrer les étudiants
du DUEL ; c'est ce qui a été
prévu, par exemple, en psy-
chologie génétique.
difficilement réalisable avec
des moniteurs qui n'ont
qu'une année d'avance sur les
étudiants. Il faudrait mobi-
liser les étudiants de maîtrise
pour encadrer les étudiants
du DUEL ; c'est ce qui a été
prévu, par exemple, en psy-
chologie génétique.
B. Bon : II est certain que
l'introduction d'une méthode
nouvelle représente pour tous
une dépense d'énergie beau-
coup plus importante, pour
les moniteurs et le profes-
seur aussi bien que pour les
étudiants. Mais le problème
est alors de savoir si cette
dépense d'énergie plus im-
portante n'est pas finalement
souhaitable pour favoriser un
développement nouveau de la
pédagogie dans l'enseigne-
ment supérieur, comme dans
l'enseignement en général.
l'introduction d'une méthode
nouvelle représente pour tous
une dépense d'énergie beau-
coup plus importante, pour
les moniteurs et le profes-
seur aussi bien que pour les
étudiants. Mais le problème
est alors de savoir si cette
dépense d'énergie plus im-
portante n'est pas finalement
souhaitable pour favoriser un
développement nouveau de la
pédagogie dans l'enseigne-
ment supérieur, comme dans
l'enseignement en général.
Les méthodes pédagogi-
ques traditionnelles ne font-
elles pas une part trop res-
treinte aux ressources éner-
gétiques de l'être humain ?
Ou, tout au moins, ne favori-
sent-elles pas un déséquili-
bre dans les modalités d'uti-
lisation de cette énergie, dé-
pensée tant par le professeur
que par l'étudiant ?
ques traditionnelles ne font-
elles pas une part trop res-
treinte aux ressources éner-
gétiques de l'être humain ?
Ou, tout au moins, ne favori-
sent-elles pas un déséquili-
bre dans les modalités d'uti-
lisation de cette énergie, dé-
pensée tant par le professeur
que par l'étudiant ?
23


L'accès à l'enseignement
supérieur
dans les différents
pays d'Europe,
par Michèle LEDUC
Les statistiques montrent
que, globalement, les taux de
scolarisation au niveau supé-
rieur ne cessent d'augmenter
en Europe (1), (2), (3). Néan-
moins leur valeur et surtout
leur croissance sont inégales
selon les pays. En effet, le
problème fondamental de la
rencontre des choix indivi-
duels d'études et des besoins
objectifs de la société est
résolu différemment dans les
pays à planification économi-
que intégrale et dans ceux où
l'on pratique une économie de
marché. Si pourtant l'on cons-
tate partout un gonflement
des flux scolaires tel que les
couches sociales monopoli-
sant traditionnellement l'en-
seignement supérieur ne peu-
vent en rendre compte à elles
seules, la question se pose de
rechercher quelle est la parti-
cipation actuelle des divers
milieux sociaux à cet essor.
Ceci conduit à étudier l'in-
fluence de trois facteurs prin-
cipaux :
que, globalement, les taux de
scolarisation au niveau supé-
rieur ne cessent d'augmenter
en Europe (1), (2), (3). Néan-
moins leur valeur et surtout
leur croissance sont inégales
selon les pays. En effet, le
problème fondamental de la
rencontre des choix indivi-
duels d'études et des besoins
objectifs de la société est
résolu différemment dans les
pays à planification économi-
que intégrale et dans ceux où
l'on pratique une économie de
marché. Si pourtant l'on cons-
tate partout un gonflement
des flux scolaires tel que les
couches sociales monopoli-
sant traditionnellement l'en-
seignement supérieur ne peu-
vent en rendre compte à elles
seules, la question se pose de
rechercher quelle est la parti-
cipation actuelle des divers
milieux sociaux à cet essor.
Ceci conduit à étudier l'in-
fluence de trois facteurs prin-
cipaux :
— la stratification sociale ;
— le sexe ;
— l'origine géographique.
(1) La présente étude a été réalisée à
partir des documents établis par l'UNESCO
pour préparer la conférence des mi-
nistres de l'éducation des Etats-membres
d'Europe sur l'accès à l'enseignement su-
périeur (Vienne, novembre 1967). Cette do-
cumentation a été rassemblée à partir
d'enquêtes nationales sur l'enseignement
supérieur, menées dans tous les pays.
Unesco, Mineurop - 3 et Mineurop - 4.
partir des documents établis par l'UNESCO
pour préparer la conférence des mi-
nistres de l'éducation des Etats-membres
d'Europe sur l'accès à l'enseignement su-
périeur (Vienne, novembre 1967). Cette do-
cumentation a été rassemblée à partir
d'enquêtes nationales sur l'enseignement
supérieur, menées dans tous les pays.
Unesco, Mineurop - 3 et Mineurop - 4.
(2) Voir l'article de M. Lévy dans ce
numéro.
numéro.
(3) L'enseignement supérieur est ici
défini comme comprenant tous les ensei-
gnements (classique, professionnel, tech-
nique, normal) donnés dans les établisse-
ments où l'on ne peut accéder qu'après
avoir achevé des études secondaires (l'âge
d'admission étant généralement de 18 ans
environ) et où les études sont sanction-
nées par un diplôme.
défini comme comprenant tous les ensei-
gnements (classique, professionnel, tech-
nique, normal) donnés dans les établisse-
ments où l'on ne peut accéder qu'après
avoir achevé des études secondaires (l'âge
d'admission étant généralement de 18 ans
environ) et où les études sont sanction-
nées par un diplôme.
(Il n'y a pas de distinction entre les
modalités d'enseignement : à plein temps,
à temps partiel, du soir ou par correspon-
dance, pourvu que la formation soit du
même niveau.)
modalités d'enseignement : à plein temps,
à temps partiel, du soir ou par correspon-
dance, pourvu que la formation soit du
même niveau.)
Il y a toujours une forte pro-
portion d'aptitudes intellectuelles
non mobilisées dans le milieu eu-
ropéen. Le problème est beaucoup
plus aigu dans les pays non plani-
fiés intégralement, qui pratiquent
une politique de l'enseignement
supérieur fondée sur des ajuste-
ments répétés à la « demande so-
ciale ». En outre, la prise de
conscience d'inégalités autres que
celles résultant de l'insuffisance
des moyens financiers (qui est
pourtant loin d'être un aspect se-
condaire du problème) « met en
cause, dans les pays hautement
industrialisés, les structures, les
méthodes, les objectifs tradition-
nels de l'enseignement, dont on
attend qu'il compense ces inégali-
tés aussi subtiles que profondes...
au lieu d'y contribuer, comme par
le passé » (4).
portion d'aptitudes intellectuelles
non mobilisées dans le milieu eu-
ropéen. Le problème est beaucoup
plus aigu dans les pays non plani-
fiés intégralement, qui pratiquent
une politique de l'enseignement
supérieur fondée sur des ajuste-
ments répétés à la « demande so-
ciale ». En outre, la prise de
conscience d'inégalités autres que
celles résultant de l'insuffisance
des moyens financiers (qui est
pourtant loin d'être un aspect se-
condaire du problème) « met en
cause, dans les pays hautement
industrialisés, les structures, les
méthodes, les objectifs tradition-
nels de l'enseignement, dont on
attend qu'il compense ces inégali-
tés aussi subtiles que profondes...
au lieu d'y contribuer, comme par
le passé » (4).
La stratification sociale
Toutes les données dont on
dispose établissent clairement
l'inégalité des chances devant
l'enseignement pour les enfants
des différentes catégories socia-
les. C'est, bien entendu, au niveau
supérieur que l'inégalité se fait le
plus nettement sentir.
dispose établissent clairement
l'inégalité des chances devant
l'enseignement pour les enfants
des différentes catégories socia-
les. C'est, bien entendu, au niveau
supérieur que l'inégalité se fait le
plus nettement sentir.
Une étude française (5) parti-
culièrement détaillée montre l'ac-
tion de la catégorie socio-profes-
sionnelle du père sur les chances
de scolarisation des garçons dans
l'enseignement supérieur ; elle in-
dique les taux respectifs de scola-
rité et d'apprentissage sous con-
trat en 1962, pour une population
âgée de 19 ans. ^
culièrement détaillée montre l'ac-
tion de la catégorie socio-profes-
sionnelle du père sur les chances
de scolarisation des garçons dans
l'enseignement supérieur ; elle in-
dique les taux respectifs de scola-
rité et d'apprentissage sous con-
trat en 1962, pour une population
âgée de 19 ans. ^
liai, plus ou moins « éducogène »,
est prépondérant à un certain ni-
veau.
est prépondérant à un certain ni-
veau.
Une classification des catégo-
ries sociales en trois milieux (éle-
vé, moyen et modeste) permet de
tirer certaines conclusions pour
d'autres pays, si elle est établie
sur la population active d'une part,
et sur les étudiants d'autre part.
C'est le cas pour les Pays-Bas (7)
et pour la Suède (8). ^
ries sociales en trois milieux (éle-
vé, moyen et modeste) permet de
tirer certaines conclusions pour
d'autres pays, si elle est établie
sur la population active d'une part,
et sur les étudiants d'autre part.
C'est le cas pour les Pays-Bas (7)
et pour la Suède (8). ^
On voit que l'élément ouvrier
est proportionnellement moins im-
portant à l'Est qu'à l'Ouest de
l'Europe. Or, à l'examen du ta-
bleau I, on constate que la propor-
tion d'étudiants de la classe ou-
vrière est nettement plus élevée
dans les pays de démocratie popu-
laire que dans les pays occiden-
taux : 33 % en Hongrie, 35 % en
Pologne, 38 % en Tchécoslovaquie,
56 % en Yougoslavie. (Le cas de
est proportionnellement moins im-
portant à l'Est qu'à l'Ouest de
l'Europe. Or, à l'examen du ta-
bleau I, on constate que la propor-
tion d'étudiants de la classe ou-
vrière est nettement plus élevée
dans les pays de démocratie popu-
laire que dans les pays occiden-
taux : 33 % en Hongrie, 35 % en
Pologne, 38 % en Tchécoslovaquie,
56 % en Yougoslavie. (Le cas de
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
élevé
moyen
modeste
moyen
modeste
Population active Pays-Bas
5
40
55
5
40
55
Enfants à l'Université aux Pays-Bas en 1961..
55
39
6
55
39
6
Enfants à l'Université en Suède en 1961 . .
39
43
14
39
43
14
La disparité entre la structure
sociale de la population et celle
des étudiants est considérable
dans ces deux pays, la démocrati-
sation pour le milieu modeste
étant pourtant plus avancée en
Suède (en supposant la propor-
tion des trois milieux comparables
aux Pays-Bas et en Suède).
sociale de la population et celle
des étudiants est considérable
dans ces deux pays, la démocrati-
sation pour le milieu modeste
étant pourtant plus avancée en
Suède (en supposant la propor-
tion des trois milieux comparables
aux Pays-Bas et en Suède).
Malheureusement, une vérita-
ble étude sociale comparative à
l'échelle internationale n'est pas
réalisable, car les modes de clas-
sification adoptés par les diffé-
rents pays sont extrêmement dif-
férents ; en outre, la comparaison
exige qu'on rapporte les effectifs
des étudiants aux catégories cor-
respondantes de la population ac-
tive. On ne dispose pas, concer-
nant celle-ci, de données suffi-
santes. Pourtant, une approche
globale est possible pour les ou-
vriers et pour les ruraux, en se ré-
ble étude sociale comparative à
l'échelle internationale n'est pas
réalisable, car les modes de clas-
sification adoptés par les diffé-
rents pays sont extrêmement dif-
férents ; en outre, la comparaison
exige qu'on rapporte les effectifs
des étudiants aux catégories cor-
respondantes de la population ac-
tive. On ne dispose pas, concer-
nant celle-ci, de données suffi-
santes. Pourtant, une approche
globale est possible pour les ou-
vriers et pour les ruraux, en se ré-
Professions libérales ...................
85,3 %
et
0,0 %
85,3 %
et
0,0 %
Instituteurs et professions intellectuelles
diverses ...........................
79,3 %
et
1 ,4 %
79,3 %
et
1 ,4 %
Industriels et gros commerçants .......
58,8 %
et
3,4 %
58,8 %
et
3,4 %
Employés de commerce ................
37,6 %
et
7,8 %
37,6 %
et
7,8 %
Ouvriers qualifiés ......................
17,8 %
et
5,1 %
17,8 %
et
5,1 %
Agriculteurs exploitants ................
13,0 %
et
2,4 %
13,0 %
et
2,4 %
Manœuvres ............................
8,2 %
et
4,5 %
8,2 %
et
4,5 %
Dès l'abord, il apparaît que
les chances décroissent lorsqu'on
descend l'échelle sociale. Pourtant
le cas des instituteurs et des in-
tellectuels par rapport aux indus-
triels et aux gros commerçants,
ainsi que celui- des ouvriers quali-
fiés par rapport aux employés de
commerce, montrent que le facteur
du revenu n'est pas seul à jouer :
celui de la culture du milieu fami-
les chances décroissent lorsqu'on
descend l'échelle sociale. Pourtant
le cas des instituteurs et des in-
tellectuels par rapport aux indus-
triels et aux gros commerçants,
ainsi que celui- des ouvriers quali-
fiés par rapport aux employés de
commerce, montrent que le facteur
du revenu n'est pas seul à jouer :
celui de la culture du milieu fami-
férant aux hypothèses relatives à
la répartition des trois secteurs
de l'activité économique dans le
monde (6). ^r
la répartition des trois secteurs
de l'activité économique dans le
monde (6). ^r
la Yougoslavie, où le secteur se-
condaire est très peu développé,
est particulièrement frappant.)
Ceci semble indiquer que, dans ce
groupe de pays, la place des en-
fants d'ouvriers dans la population
étudiante correspond, grosso mo-
do, à celle de la classe ouvrière
dans la population active, alors
que c'est encore loin d'être le cas
pour l'Ouest.
condaire est très peu développé,
est particulièrement frappant.)
Ceci semble indiquer que, dans ce
groupe de pays, la place des en-
fants d'ouvriers dans la population
étudiante correspond, grosso mo-
do, à celle de la classe ouvrière
dans la population active, alors
que c'est encore loin d'être le cas
pour l'Ouest.
Pour l'Europe occidentale, on
dispose de certaines données plus
précises, révélatrices. En Belgique,
11,2 % d'enfants d'ouvriers accé-
dant au supérieur sont à comparer
à une population ouvrière de 48
pour cent ; les chiffres correspon-
dants pour la France sont 8,3 %
et 37,6 %. La participation ouvriè-
re à l'enseignement supérieur y
est très faible. La situation sem-
ble encore plus catastrophique en
Allemagne fédérale et en Autri-
che, puisque la proportion n'y a
pas augmenté depuis 1955. La si-
tuation du Royaume-Uni est, de
loin, la plus avancée des pays de
l'Ouest : les ouvriers y fournissent
à peu près 25 % des étudiants et
représentent environ la moitié de
la population active. Seule la Nor-
vège marque un progrès compara-
ble (20 %). La Finlande suit avec
17,6 %, puis la Suède avec 14 %.
dispose de certaines données plus
précises, révélatrices. En Belgique,
11,2 % d'enfants d'ouvriers accé-
dant au supérieur sont à comparer
à une population ouvrière de 48
pour cent ; les chiffres correspon-
dants pour la France sont 8,3 %
et 37,6 %. La participation ouvriè-
re à l'enseignement supérieur y
est très faible. La situation sem-
ble encore plus catastrophique en
Allemagne fédérale et en Autri-
che, puisque la proportion n'y a
pas augmenté depuis 1955. La si-
tuation du Royaume-Uni est, de
loin, la plus avancée des pays de
l'Ouest : les ouvriers y fournissent
à peu près 25 % des étudiants et
représentent environ la moitié de
la population active. Seule la Nor-
vège marque un progrès compara-
ble (20 %). La Finlande suit avec
17,6 %, puis la Suède avec 14 %.
On peut faire une analyse ana-
Primaire Secondaire Tertiaire
Europe orientale .....
. . 47
29
24
. . 47
29
24
URSS
45
30
25
45
30
25
Europe occidentale ...........
20
42
38
20
42
38
(4) UNESCO, Mineurop - 3.
(5) Etudes et enquêtes (mai-juin 1957),
Bureau universitaire de statistique et Do-
cumentation scolaire et professionnelle.
Bureau universitaire de statistique et Do-
cumentation scolaire et professionnelle.
(6) Roger Girod. - Etudes sociologiques
sur les couches salariées. Ouvriers et em-
ployés. Paris, Marcel Rivière (1961), p. 82.
sur les couches salariées. Ouvriers et em-
ployés. Paris, Marcel Rivière (1961), p. 82.
(7) « De outwikterling van het onder-
wijs in Nederland », dl 1, (1966) (CBS
publikatie).
wijs in Nederland », dl 1, (1966) (CBS
publikatie).
(8) UNESCO. Mineurop - 3.
logue à propos des agriculteurs
(tableau II). Avec un secteur pri-
maire de 47 % de la population
active, les pays socialistes comp-
tent 20 à 30 % d'étudiants issus
de milieux ruraux. Il semble donc
(tableau II). Avec un secteur pri-
maire de 47 % de la population
active, les pays socialistes comp-
tent 20 à 30 % d'étudiants issus
de milieux ruraux. Il semble donc
24
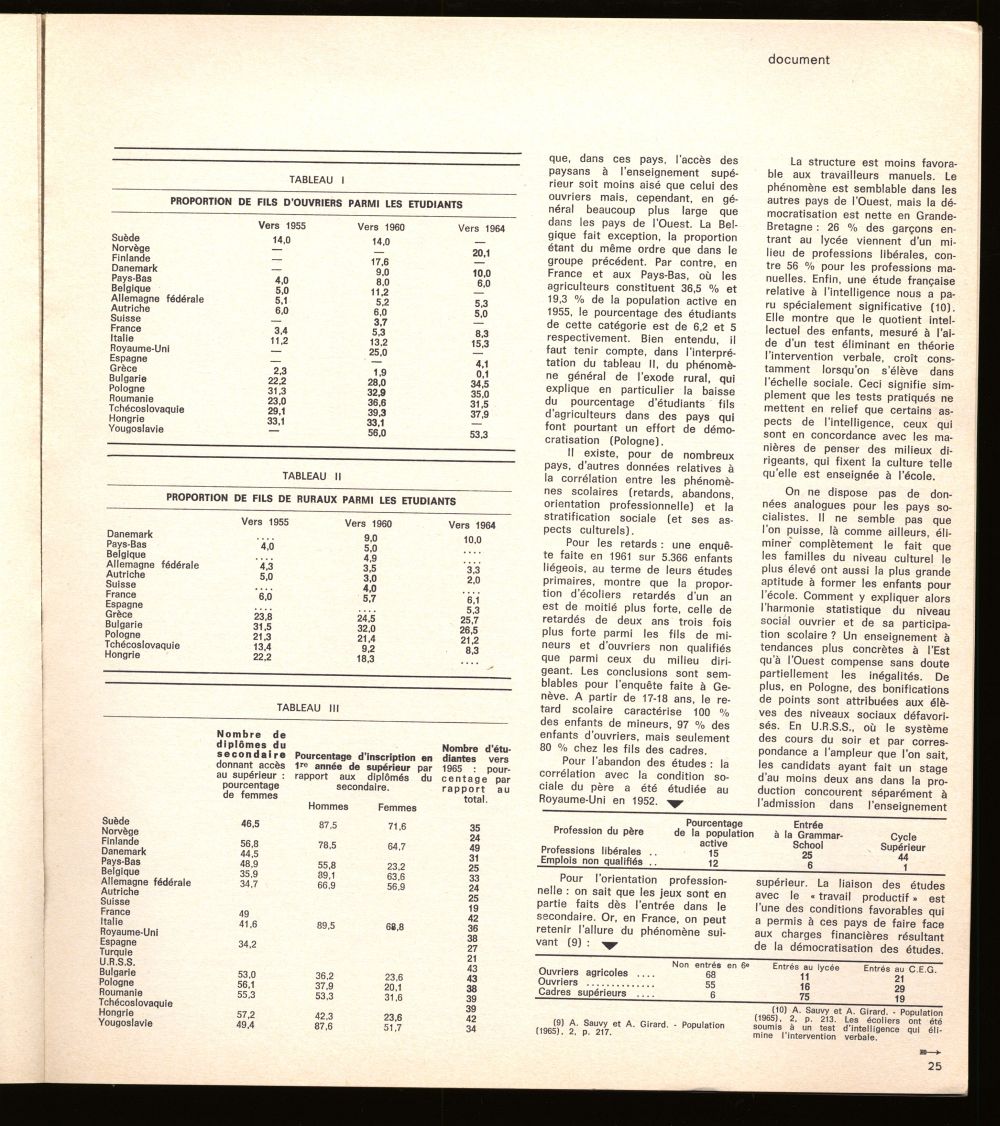

document
TABLEAU I
PROPORTION DE FILS D'OUVRIERS PARMI LES ETUDIANTS
Vers 1955
Vers 1960
Vers 1964
Vers 1960
Vers 1964
Suède
14,0
14,0
—
14,0
14,0
—
Norvège
—
—
20,1
—
—
20,1
Finlande
—
17.6
—
—
17.6
—
Danemark
—
9.0
10,0
—
9.0
10,0
Pays-Bas
4,0
8,0
6,0
4,0
8,0
6,0
Belgique
5,0
11.2
—
5,0
11.2
—
Allemagne fédérale
5,1
5.2
5,3
5,1
5.2
5,3
Autriche
6,0
6,0
5,0
6,0
6,0
5,0
Suisse
—
3,7
—
—
3,7
—
France
3,4
5.3
8,3
3,4
5.3
8,3
Italie
11,2
13.2
15,3
11,2
13.2
15,3
Royaume-Uni
—
25,0
—
—
25,0
—
Espagne
—
—
4,1
—
—
4,1
Grèce
2,3
1,9
0,1
2,3
1,9
0,1
Bulgarie
22,2
28,0
34,5
22,2
28,0
34,5
Pologne
31,3
32.9
35,0
31,3
32.9
35,0
Roumanie
23,0
36,6
31,5
23,0
36,6
31,5
Tchécoslovaquie
29,1
39,3
37,9
29,1
39,3
37,9
Hongrie
33,1
33,1
—
33,1
33,1
—
Yougoslavie
-------
56,0
53.3
-------
56,0
53.3
TABLEAU II
PROPORTION DE FILS DE RURAUX PARMI LES ETUDIANTS
Vers 1955
Vers 1960
Vers 1964
Vers 1960
Vers 1964
Danemark
9,0
10,0
10,0
Pays-Bas
4id
5,0
4id
5,0
Belgique
4,9
Allemagne fédérale
4J3
3,5
'3.3
4J3
3,5
'3.3
Autriche
5,0
3,0
2,0
5,0
3,0
2,0
Suisse
4.0
France
6,'d
5.7
e'.i
6,'d
5.7
e'.i
Espagne
5.3
Grèce
23,8
24,'s
25,7
23,8
24,'s
25,7
Bulgarie
31,5
32,0
26,5
31,5
32,0
26,5
Pologne
21,3
21,4
21,2
21,3
21,4
21,2
Tchécoslovaquie
13,4
9,2
8,3
13,4
9,2
8,3
Hongrie
22,2
18,3
22,2
18,3
TABLEAU III
Nombre de
diplômes du
Nombre d'étu-
secondaire
Pourcentage d'inscription en
diantes vers
Pourcentage d'inscription en
diantes vers
donnant accès
1n- année de supérieur par
1965 : pour-
1n- année de supérieur par
1965 : pour-
au supérieur :
rapport aux diplômés du
centage par
rapport aux diplômés du
centage par
pourcentage
secondaire.
rapport au
secondaire.
rapport au
de femmes
total.
Hommes Femmes
Suède
46,5
87,5 71,6
35
46,5
87,5 71,6
35
Norvège
24
Finlande
56,8
78,5 64,7
49
56,8
78,5 64,7
49
Danemark
44,5
44,5
31
Pays-Bas
48,9
55,8 23,2
25
48,9
55,8 23,2
25
Belgique
35,9
39,1 63,6
33
35,9
39,1 63,6
33
Allemagne fédérale
34,7
66,9 56,9
24
34,7
66,9 56,9
24
Autriche
Suisse
France
Italie
Royaume-Uni
Espagne
Turquie
U.R.S.S.
Bulgarie
Pologne
Roumanie
Tchécoslovaquie
Hongrie
Yougoslavie
49
41,6
41,6
34,2
53,0
56,1
55,3
56,1
55,3
57,2
49,4
49,4
89,5
36,2
37,9
53,3
37,9
53,3
42,3
87,6
87,6
68,8
23.6
20,1
31,6
20,1
31,6
23,6
51,7
25
19
42
36
38
27
21
43
43
38
39
39
42
34
19
42
36
38
27
21
43
43
38
39
39
42
34
que, dans ces pays, l'accès des
paysans à l'enseignement supé-
rieur soit moins aisé que celui des
ouvriers mais, cependant, en gé-
néral beaucoup plus large que
dans les pays de l'Ouest. La Bel-
gique fait exception, la proportion
étant du même ordre que dans le
groupe précédent. Par contre, en
France et aux Pays-Bas, où les
agriculteurs constituent 36,5 % et
19,3 % de la population active en
1955, le pourcentage des étudiants
de cette catégorie est de 6,2 et 5
respectivement. Bien entendu, il
faut tenir compte, dans l'interpré-
tation du tableau II, du phénomè-
ne général de l'exode rural, qui
explique en particulier la baisse
du pourcentage d'étudiants fils
d'agriculteurs dans des pays qui
font pourtant un effort de démo-
cratisation (Pologne).
paysans à l'enseignement supé-
rieur soit moins aisé que celui des
ouvriers mais, cependant, en gé-
néral beaucoup plus large que
dans les pays de l'Ouest. La Bel-
gique fait exception, la proportion
étant du même ordre que dans le
groupe précédent. Par contre, en
France et aux Pays-Bas, où les
agriculteurs constituent 36,5 % et
19,3 % de la population active en
1955, le pourcentage des étudiants
de cette catégorie est de 6,2 et 5
respectivement. Bien entendu, il
faut tenir compte, dans l'interpré-
tation du tableau II, du phénomè-
ne général de l'exode rural, qui
explique en particulier la baisse
du pourcentage d'étudiants fils
d'agriculteurs dans des pays qui
font pourtant un effort de démo-
cratisation (Pologne).
Il existe, pour de nombreux
pays, d'autres données relatives à
la corrélation entre les phénomè-
nes scolaires (retards, abandons,
orientation professionnelle) et la
stratification sociale (et ses as-
pects culturels).
pays, d'autres données relatives à
la corrélation entre les phénomè-
nes scolaires (retards, abandons,
orientation professionnelle) et la
stratification sociale (et ses as-
pects culturels).
Pour les retards : une enquê-
te faite en 1961 sur 5.366 enfants
liégeois, au terme de leurs études
primaires, montre que la propor-
tion d'écoliers retardés d'un an
est de moitié plus forte, celle de
retardés de deux ans trois fois
plus forte parmi les fils de mi-
neurs et d'ouvriers non qualifiés
que parmi ceux du milieu diri-
geant. Les conclusions sont sem-
blables pour l'enquête faite à Ge-
nève. A partir de 17-18 ans, le re-
tard scolaire caractérise 100 %
des enfants de mineurs, 97 % des
enfants d'ouvriers, mais seulement
80 % chez les fils des cadres.
te faite en 1961 sur 5.366 enfants
liégeois, au terme de leurs études
primaires, montre que la propor-
tion d'écoliers retardés d'un an
est de moitié plus forte, celle de
retardés de deux ans trois fois
plus forte parmi les fils de mi-
neurs et d'ouvriers non qualifiés
que parmi ceux du milieu diri-
geant. Les conclusions sont sem-
blables pour l'enquête faite à Ge-
nève. A partir de 17-18 ans, le re-
tard scolaire caractérise 100 %
des enfants de mineurs, 97 % des
enfants d'ouvriers, mais seulement
80 % chez les fils des cadres.
Pour l'abandon des études : la
corrélation avec la condition so-
ciale du père a été étudiée au
Royaume-Uni en 1952. -^r
corrélation avec la condition so-
ciale du père a été étudiée au
Royaume-Uni en 1952. -^r
La structure est moins favora-
ble aux travailleurs manuels. Le
phénomène est semblable dans les
autres pays de l'Ouest, mais la dé-
mocratisation est nette en Grande-
Bretagne : 26 % des garçons en-
trant au lycée viennent d'un mi-
lieu de professions libérales, con-
tre 56 % pour les professions ma-
nuelles. Enfin, une étude française
relative à l'intelligence nous a pa-
ru spécialement significative (10).
Elle montre que le quotient intel-
lectuel des enfants, mesuré à l'ai-
de d'un test éliminant en théorie
l'intervention verbale, croît cons-
tamment lorsqu'on s'élève dans
l'échelle sociale. Ceci signifie sim-
plement que les tests pratiqués ne
mettent en relief que certains as-
pects de l'intelligence, ceux qui
sont en concordance avec les ma-
nières de penser des milieux di-
rigeants, qui fixent la culture telle
qu'elle est enseignée à l'école.
ble aux travailleurs manuels. Le
phénomène est semblable dans les
autres pays de l'Ouest, mais la dé-
mocratisation est nette en Grande-
Bretagne : 26 % des garçons en-
trant au lycée viennent d'un mi-
lieu de professions libérales, con-
tre 56 % pour les professions ma-
nuelles. Enfin, une étude française
relative à l'intelligence nous a pa-
ru spécialement significative (10).
Elle montre que le quotient intel-
lectuel des enfants, mesuré à l'ai-
de d'un test éliminant en théorie
l'intervention verbale, croît cons-
tamment lorsqu'on s'élève dans
l'échelle sociale. Ceci signifie sim-
plement que les tests pratiqués ne
mettent en relief que certains as-
pects de l'intelligence, ceux qui
sont en concordance avec les ma-
nières de penser des milieux di-
rigeants, qui fixent la culture telle
qu'elle est enseignée à l'école.
On ne dispose pas de don-
nées analogues pour les pays so-
cialistes. Il ne semble pas que
l'on puisse, là comme ailleurs, éli-
miner complètement le fait que
les familles du niveau culturel le
plus élevé ont aussi la plus grande
aptitude à former les enfants pour
l'école. Comment y expliquer alors
l'harmonie statistique du niveau
social ouvrier et de sa participa-
tion scolaire ? Un enseignement à
tendances plus concrètes à l'Est
qu'à l'Ouest compense sans doute
partiellement les inégalités. De
plus, en Pologne, des bonifications
de points sont attribuées aux élè-
ves des niveaux sociaux défavori-
sés. En U.R.S.S., où le système
des cours du soir et par corres-
pondance a l'ampleur que l'on sait,
les candidats ayant fait un stage
d'au moins deux ans dans la pro-
duction concourent séparément à
l'admission dans l'enseignement
nées analogues pour les pays so-
cialistes. Il ne semble pas que
l'on puisse, là comme ailleurs, éli-
miner complètement le fait que
les familles du niveau culturel le
plus élevé ont aussi la plus grande
aptitude à former les enfants pour
l'école. Comment y expliquer alors
l'harmonie statistique du niveau
social ouvrier et de sa participa-
tion scolaire ? Un enseignement à
tendances plus concrètes à l'Est
qu'à l'Ouest compense sans doute
partiellement les inégalités. De
plus, en Pologne, des bonifications
de points sont attribuées aux élè-
ves des niveaux sociaux défavori-
sés. En U.R.S.S., où le système
des cours du soir et par corres-
pondance a l'ampleur que l'on sait,
les candidats ayant fait un stage
d'au moins deux ans dans la pro-
duction concourent séparément à
l'admission dans l'enseignement
Pourcentage
Entrée
Entrée
Profession du père
de la population
à la Grammar-
Cycle
de la population
à la Grammar-
Cycle
active
School
Supérieur
School
Supérieur
Professions libérales . .
15
25
44
15
25
44
Emplois non qualifiés . .
12
6
1
12
6
1
Pour l'orientation profession-
nelle : on sait que les jeux sont en
partie faits dès l'entrée dans le
secondaire. Or, en France, on peut
retenir l'allure du phénomène sui-
vant (9) : v
nelle : on sait que les jeux sont en
partie faits dès l'entrée dans le
secondaire. Or, en France, on peut
retenir l'allure du phénomène sui-
vant (9) : v
supérieur. La liaison des études
avec le « travail productif » est
l'une des conditions favorables qui
a permis à ces pays de faire face
aux charges financières résultant
de la démocratisation des études.
avec le « travail productif » est
l'une des conditions favorables qui
a permis à ces pays de faire face
aux charges financières résultant
de la démocratisation des études.
Ouvriers agricoles
Ouvriers .........
Cadres supérieurs
Non entrés en
68
55
6
68
55
6
Entrés au lycée
11
16
75
11
16
75
Entrés au C.E.G.
21
29
19
21
29
19
(9) A. Sauvy et A. Girard. - Population
(1965), 2, p. 217.
(1965), 2, p. 217.
(10) A. Sauvy et A. Girard. - Population
(1965), 2, p. 213. Les écoliers ont été
soumis à un test d'intelligence qui éli-
mine l'intervention verbale.
(1965), 2, p. 213. Les écoliers ont été
soumis à un test d'intelligence qui éli-
mine l'intervention verbale.
25
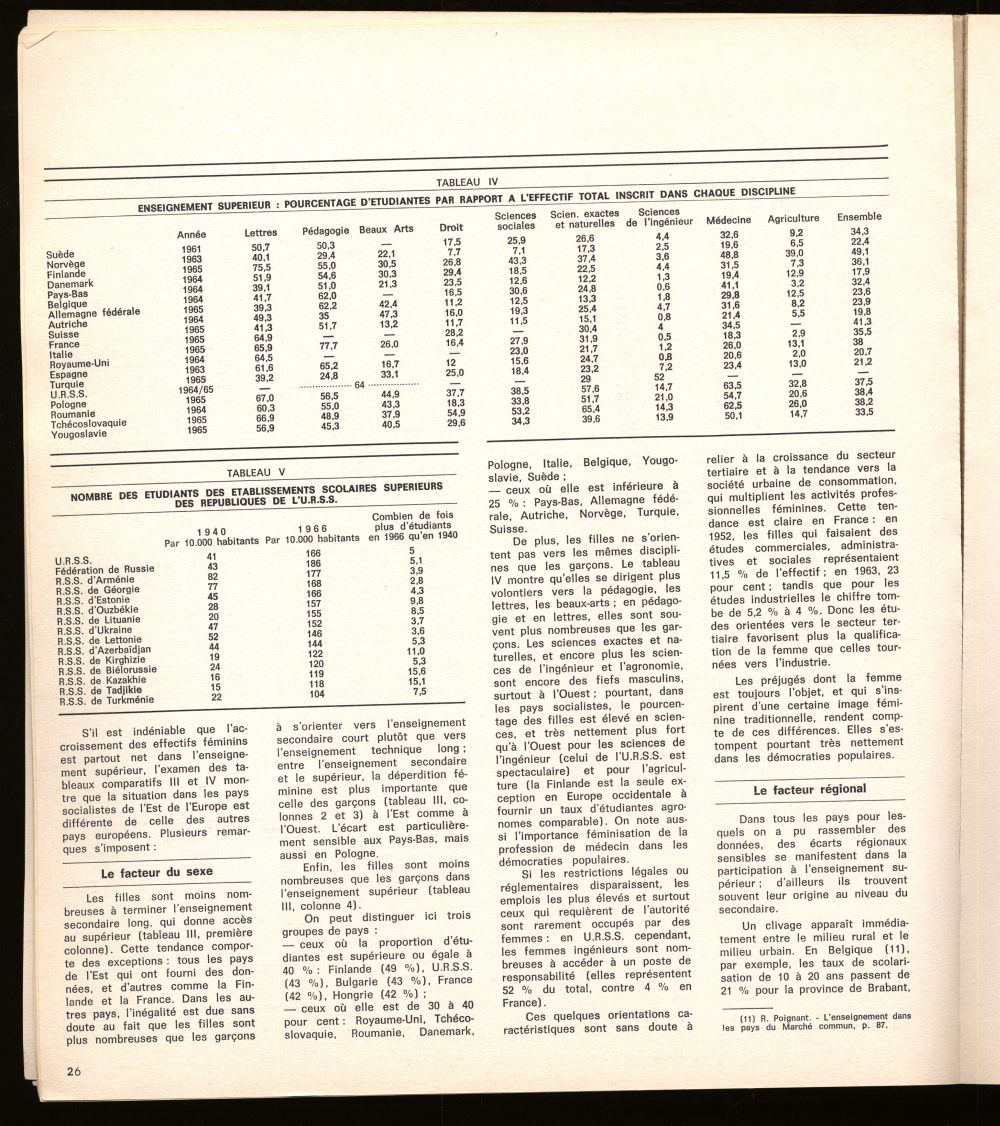

TABLEAU IV
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : POURCENTAGE D'ETUDIANTES PAR RAPPORT A L'EFFECTIF TOTAL INSCRIT DANS CHAQUE DISCIPLINE
Sciences
Scien. exactes
Sciences
Scien. exactes
Sciences
Année
Lettres
Pédagogie
Beaux Arts
Droit
sociales
et naturelles
de l'ingénieur
Médecine
Agriculture
Ensemble
Lettres
Pédagogie
Beaux Arts
Droit
sociales
et naturelles
de l'ingénieur
Médecine
Agriculture
Ensemble
Suède
1961
50,7
50,3
—
17,5
25,9
26,6
4,4
32,6
9,2
34,3
1961
50,7
50,3
—
17,5
25,9
26,6
4,4
32,6
9,2
34,3
Norvège
1963
40,1
29,4
22,1
7,7
7,1
17,3
2,5
19,6
6,5
22,4
1963
40,1
29,4
22,1
7,7
7,1
17,3
2,5
19,6
6,5
22,4
Finlande
1965
75,5
55,0
30,5
26,8
43.3
37,4
3.6
48,8
39,0
49,1
1965
75,5
55,0
30,5
26,8
43.3
37,4
3.6
48,8
39,0
49,1
Danemark
1964
51,9
54,6
30,3
29,4
18,5
22,5
4,4
31,5
7,3
36,1
1964
51,9
54,6
30,3
29,4
18,5
22,5
4,4
31,5
7,3
36,1
Pays-Bas
1964
39,1
51,0
21,3
23,5
12,6
12.2
1,3
19,4
12,9
17,9
1964
39,1
51,0
21,3
23,5
12,6
12.2
1,3
19,4
12,9
17,9
Belgique
1964
41,7
62,0
—
16,5
30,6
24,8
0.6
41,1
3,2
32.4
1964
41,7
62,0
—
16,5
30,6
24,8
0.6
41,1
3,2
32.4
Allemagne fédérale
1965
39,3
62,2
42,4
11.2
12,5
13,3
1,8
29,8
12,5
23,6
1965
39,3
62,2
42,4
11.2
12,5
13,3
1,8
29,8
12,5
23,6
Autriche
1964
49,3
35
47,3
16.0
19,3
25,4
4,7
31,6
8,2
23,9
1964
49,3
35
47,3
16.0
19,3
25,4
4,7
31,6
8,2
23,9
Suisse
1965
41.3
51,7
13,2
11,7
11,5
15,1
0,8
21,4
5,5
19,8
1965
41.3
51,7
13,2
11,7
11,5
15,1
0,8
21,4
5,5
19,8
France
1965
64,9
—
—
28,2
—
30.4
4
34.5
—
41,3
1965
64,9
—
—
28,2
—
30.4
4
34.5
—
41,3
Italie
1965
65,9
77,7
26.0
16,4
27,9
31,9
0.5
18,3
2.9
35,5
1965
65,9
77,7
26.0
16,4
27,9
31,9
0.5
18,3
2.9
35,5
Royaume-Uni
1964
64,5
—
—
—
23.0
21,7
1.2
26,0
13.1
38
1964
64,5
—
—
—
23.0
21,7
1.2
26,0
13.1
38
Espagne
1963
61,6
65,2
16.7
12
15.6
24,7
03
20,6
2,0
20,7
1963
61,6
65,2
16.7
12
15.6
24,7
03
20,6
2,0
20,7
Turquie
1965
39,2
24,8
33,1
25,0
18,4
23,2
7,2
23,4
13.0
21,2
1965
39,2
24,8
33,1
25,0
18,4
23,2
7,2
23,4
13.0
21,2
Urj o C
1 QRA /fi'ï
1 QRA /fi'ï
RA -
on
co
co
.H.b.b.
i yo*f / DO
i yo*f / DO
OH ..................
£J3
Ot
Ot
Pologne
1965
67.0
56,5
44,9
37,7
38,5
57,6
14,7
63,5
32,8
37,5
1965
67.0
56,5
44,9
37,7
38,5
57,6
14,7
63,5
32,8
37,5
Roumanie
1964
60,3
55,0
43,3
18,3
33,8
51.7
21,0
54,7
20,6
38,4
1964
60,3
55,0
43,3
18,3
33,8
51.7
21,0
54,7
20,6
38,4
Tchécoslovaquie
1965
66,9
48,9
37,9
54.9
53,2
65,4
14.3
62.5
26,0
38,2
1965
66,9
48,9
37,9
54.9
53,2
65,4
14.3
62.5
26,0
38,2
Yougoslavie
1965
56,9
45,3
40,5
29,6
34,3
39,6
13,9
50.1
14,7
33,5
1965
56,9
45,3
40,5
29,6
34,3
39,6
13,9
50.1
14,7
33,5
TABLEAU V
NOMBRE DES ETUDIANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SUPERIEURS
_____________________DES REPUBLIQUES DE L'U.R.S.S._______________________
_____________________DES REPUBLIQUES DE L'U.R.S.S._______________________
Combien de fois
1940 1966 plus d'étudiants
Par 10.000 habitants Par 10.000 habitants en 1966 qu'en 1940
U.R.S.S.
41
166
5
41
166
5
Fédération de Russie
43
186
5,1
43
186
5,1
R.S.S. d'Arménie
82
177
3,9
82
177
3,9
R.S.S. de Géorgie
77
168
2,8
77
168
2,8
R.S.S. d'Estonie
45
166
4,3
45
166
4,3
R.S.S. d'Ouzbékie
28
157
9,8
28
157
9,8
R.S.S. de Lituanie
20
155
8,5
20
155
8,5
R.S.S. d'Ukraine
47
152
3.7
47
152
3.7
R.S.S. de Lettonie
52
146
3.6
52
146
3.6
R.S.S. d'Azerbaïdjan
44
144
5,3
44
144
5,3
R.S.S. de Kirghizie
19
122
11,0
19
122
11,0
R.S.S. de Biélorussie
24
120
5,3
24
120
5,3
R.S.S. de Kazakhie
16
119
15,6
16
119
15,6
R.S.S. de Tadjikie
15
118
15,1
15
118
15,1
R.S.S. de Turkménie
22
104
7,5
22
104
7,5
S'il est indéniable que l'ac-
croissement des effectifs féminins
est partout net dans l'enseigne-
ment supérieur, l'examen des ta-
bleaux comparatifs III et IV mon-
tre que la situation dans les pays
socialistes de l'Est de l'Europe est
différente de celle des autres
pays européens. Plusieurs remar-
ques s'imposent :
croissement des effectifs féminins
est partout net dans l'enseigne-
ment supérieur, l'examen des ta-
bleaux comparatifs III et IV mon-
tre que la situation dans les pays
socialistes de l'Est de l'Europe est
différente de celle des autres
pays européens. Plusieurs remar-
ques s'imposent :
Le facteur du sexe
Les filles sont moins nom-
breuses à terminer l'enseignement
secondaire long, qui donne accès
au supérieur (tableau III, première
colonne). Cette tendance compor-
te des exceptions : tous les pays
de l'Est qui ont fourni des don-
nées, et d'autres comme la Fin-
lande et la France. Dans les au-
tres pays, l'inégalité est due sans
doute au fait que les filles sont
plus nombreuses que les garçons
breuses à terminer l'enseignement
secondaire long, qui donne accès
au supérieur (tableau III, première
colonne). Cette tendance compor-
te des exceptions : tous les pays
de l'Est qui ont fourni des don-
nées, et d'autres comme la Fin-
lande et la France. Dans les au-
tres pays, l'inégalité est due sans
doute au fait que les filles sont
plus nombreuses que les garçons
à s'orienter vers l'enseignement
secondaire court plutôt que vers
l'enseignement technique long ;
entre l'enseignement secondaire
et le supérieur, la déperdition fé-
minine est plus importante que
celle des garçons (tableau III, co-
lonnes 2 et 3) à l'Est comme à
l'Ouest. L'écart est particulière-
ment sensible aux Pays-Bas, mais
aussi en Pologne.
secondaire court plutôt que vers
l'enseignement technique long ;
entre l'enseignement secondaire
et le supérieur, la déperdition fé-
minine est plus importante que
celle des garçons (tableau III, co-
lonnes 2 et 3) à l'Est comme à
l'Ouest. L'écart est particulière-
ment sensible aux Pays-Bas, mais
aussi en Pologne.
Enfin, les filles sont moins
nombreuses que les garçons dans
l'enseignement supérieur (tableau
III, colonne 4).
nombreuses que les garçons dans
l'enseignement supérieur (tableau
III, colonne 4).
On peut distinguer ici trois
groupes de pays :
groupes de pays :
—• ceux où la proportion d'étu-
diantes est supérieure ou égale à
40 %: Finlande (49 %), U.R.S.S.
(43 %), Bulgarie (43 %), France
(42 %), Hongrie (42 %) ;
— ceux où elle est de 30 à 40
pour cent : Royaume-Uni, Tchéco-
slovaquie, Roumanie, Danemark,
diantes est supérieure ou égale à
40 %: Finlande (49 %), U.R.S.S.
(43 %), Bulgarie (43 %), France
(42 %), Hongrie (42 %) ;
— ceux où elle est de 30 à 40
pour cent : Royaume-Uni, Tchéco-
slovaquie, Roumanie, Danemark,
Pologne, Italie, Belgique, Yougo-
slavie, Suède ;
slavie, Suède ;
— ceux où elle est inférieure à
25 % : Pays-Bas, Allemagne fédé-
rale, Autriche, Norvège, Turquie,
Suisse.
25 % : Pays-Bas, Allemagne fédé-
rale, Autriche, Norvège, Turquie,
Suisse.
De plus, les filles ne s'orien-
tent pas vers les mêmes discipli-
nes que les garçons. Le tableau
IV montre qu'elles se dirigent plus
volontiers vers la pédagogie, les
lettres, les beaux-arts ; en pédago-
gie et en lettres, elles sont sou-
vent plus nombreuses que les gar-
çons. Les sciences exactes et na-
turelles, et encore plus les scien-
ces de l'ingénieur et l'agronomie,
sont encore des fiefs masculins,
surtout à l'Ouest ; pourtant, dans
les pays socialistes, le pourcen-
tage des filles est élevé en scien-
ces, et très nettement plus fort
qu'à l'Ouest pour les sciences de
l'ingénieur (celui de l'U.R.S.S. est
spectaculaire) et pour l'agricul-
ture (la Finlande est la seule ex-
ception en Europe occidentale à
fournir un taux d'étudiantes agro-
nomes comparable). On note aus-
si l'importance féminisation de la
profession de médecin dans les
démocraties populaires.
tent pas vers les mêmes discipli-
nes que les garçons. Le tableau
IV montre qu'elles se dirigent plus
volontiers vers la pédagogie, les
lettres, les beaux-arts ; en pédago-
gie et en lettres, elles sont sou-
vent plus nombreuses que les gar-
çons. Les sciences exactes et na-
turelles, et encore plus les scien-
ces de l'ingénieur et l'agronomie,
sont encore des fiefs masculins,
surtout à l'Ouest ; pourtant, dans
les pays socialistes, le pourcen-
tage des filles est élevé en scien-
ces, et très nettement plus fort
qu'à l'Ouest pour les sciences de
l'ingénieur (celui de l'U.R.S.S. est
spectaculaire) et pour l'agricul-
ture (la Finlande est la seule ex-
ception en Europe occidentale à
fournir un taux d'étudiantes agro-
nomes comparable). On note aus-
si l'importance féminisation de la
profession de médecin dans les
démocraties populaires.
Si les restrictions légales ou
réglementaires disparaissent, les
emplois les plus élevés et surtout
ceux qui requièrent de l'autorité
sont rarement occupés par des
femmes : en U.R.S.S. cependant,
les femmes ingénieurs sont nom-
breuses à accéder à un poste de
responsabilité (elles représentent
52 % du total, contre 4 % en
France).
réglementaires disparaissent, les
emplois les plus élevés et surtout
ceux qui requièrent de l'autorité
sont rarement occupés par des
femmes : en U.R.S.S. cependant,
les femmes ingénieurs sont nom-
breuses à accéder à un poste de
responsabilité (elles représentent
52 % du total, contre 4 % en
France).
Ces quelques orientations ca-
ractéristiques sont sans doute à
ractéristiques sont sans doute à
relier à la croissance du secteur
tertiaire et à la tendance vers la
société urbaine de consommation,
qui multiplient les activités profes-
sionnelles féminines. Cette ten-
dance est claire en France : en
1952, les filles qui faisaient des
études commerciales, administra-
tives et sociales représentaient
11,5 % de l'effectif; en 1963, 23
pour cent ; tandis que pour les
études industrielles le chiffre tom-
be de 5,2 % à 4 %. Donc les étu-
des orientées vers le secteur ter-
tiaire favorisent plus la qualifica-
tion de la femme que celles tour-
nées vers l'industrie.
tertiaire et à la tendance vers la
société urbaine de consommation,
qui multiplient les activités profes-
sionnelles féminines. Cette ten-
dance est claire en France : en
1952, les filles qui faisaient des
études commerciales, administra-
tives et sociales représentaient
11,5 % de l'effectif; en 1963, 23
pour cent ; tandis que pour les
études industrielles le chiffre tom-
be de 5,2 % à 4 %. Donc les étu-
des orientées vers le secteur ter-
tiaire favorisent plus la qualifica-
tion de la femme que celles tour-
nées vers l'industrie.
Les préjugés dont la femme
est toujours l'objet, et qui s'ins-
pirent d'une certaine image fémi-
nine traditionnelle, rendent comp-
te de ces différences. Elles s'es-
tompent pourtant très nettement
dans les démocraties populaires.
est toujours l'objet, et qui s'ins-
pirent d'une certaine image fémi-
nine traditionnelle, rendent comp-
te de ces différences. Elles s'es-
tompent pourtant très nettement
dans les démocraties populaires.
Le facteur régional
Dans tous les pays pour les-
quels on a pu rassembler des
données, des écarts régionaux
sensibles se manifestent dans la
participation à l'enseignement su-
périeur ; d'ailleurs ils trouvent
souvent leur origine au niveau du
secondaire.
quels on a pu rassembler des
données, des écarts régionaux
sensibles se manifestent dans la
participation à l'enseignement su-
périeur ; d'ailleurs ils trouvent
souvent leur origine au niveau du
secondaire.
Un clivage apparaît immédia-
tement entre le milieu rural et le
milieu urbain. En Belgique (11),
par exemple, les taux de scolari-
sation de 10 à 20 ans passent de
21 % pour la province de Brabant,
tement entre le milieu rural et le
milieu urbain. En Belgique (11),
par exemple, les taux de scolari-
sation de 10 à 20 ans passent de
21 % pour la province de Brabant,
(11) R. Poignant. - L'enseignement dans
les pays du Marché commun, p. 87.
les pays du Marché commun, p. 87.
26
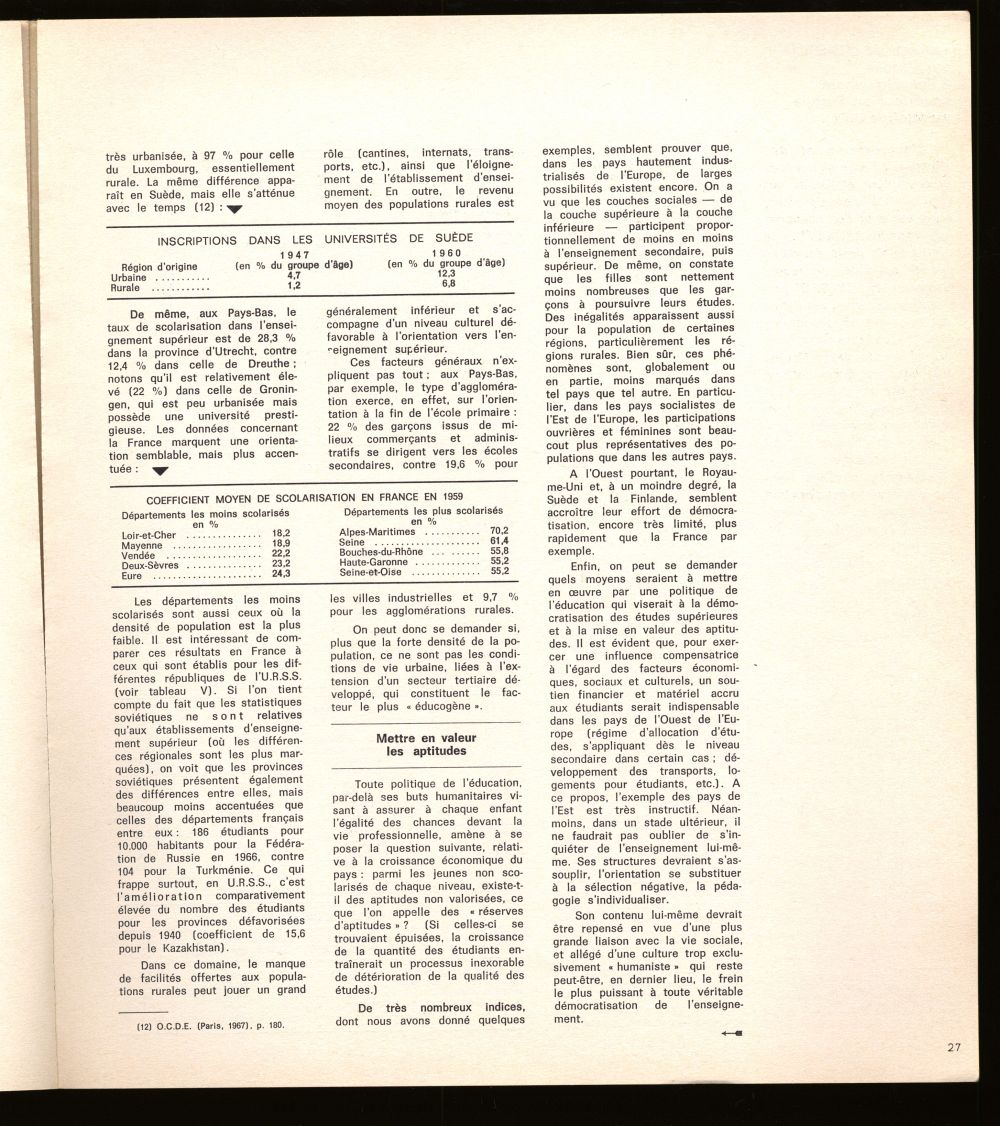

très urbanisée, à 97 % pour celle
du Luxembourg, essentiellement
rurale. La même différence appa-
raît en Suède, mais elle s'atténue
avec le temps (12) : -^
du Luxembourg, essentiellement
rurale. La même différence appa-
raît en Suède, mais elle s'atténue
avec le temps (12) : -^
rôle (cantines, internats, trans-
ports, etc.), ainsi que l'éloigne-
ment de l'établissement d'ensei-
gnement. En outre, le revenu
moyen des populations rurales est
ports, etc.), ainsi que l'éloigne-
ment de l'établissement d'ensei-
gnement. En outre, le revenu
moyen des populations rurales est
INSCRIPTIONS DANS LES UNIVERSITÉS DE SUÈDE
Région d'origine
Urbaine ..........
Rurale ...........
1 947
(en % du groupe d'âge)
4,7
1,2
4,7
1,2
1 960
(en % du groupe d'âge)
12,3
6,8
De même, aux Pays-Bas, le
taux de scolarisation dans l'ensei-
gnement supérieur est de 28,3 %
dans la province d'Utrecht, contre
12,4 % dans celle de Dreuthe ;
notons qu'il est relativement éle-
vé (22 %) dans celle de Gronin-
gen, qui est peu urbanisée mais
possède une université presti-
gieuse. Les données concernant
la France marquent une orienta-
tion semblable, mais plus accen-
tuée : •wr
taux de scolarisation dans l'ensei-
gnement supérieur est de 28,3 %
dans la province d'Utrecht, contre
12,4 % dans celle de Dreuthe ;
notons qu'il est relativement éle-
vé (22 %) dans celle de Gronin-
gen, qui est peu urbanisée mais
possède une université presti-
gieuse. Les données concernant
la France marquent une orienta-
tion semblable, mais plus accen-
tuée : •wr
généralement inférieur et s'ac-
compagne d'un niveau culturel dé-
favorable à l'orientation vers l'en-
•-eignement supérieur.
compagne d'un niveau culturel dé-
favorable à l'orientation vers l'en-
•-eignement supérieur.
Ces facteurs généraux n'ex-
pliquent pas tout ; aux Pays-Bas,
par exemple, le type d'aggloméra-
tion exerce, en effet, sur l'orien-
tation à la fin de l'école primaire :
22 % des garçons issus de mi-
lieux commerçants et adminis-
tratifs se dirigent vers les écoles
secondaires, contre 19,6 % pour
pliquent pas tout ; aux Pays-Bas,
par exemple, le type d'aggloméra-
tion exerce, en effet, sur l'orien-
tation à la fin de l'école primaire :
22 % des garçons issus de mi-
lieux commerçants et adminis-
tratifs se dirigent vers les écoles
secondaires, contre 19,6 % pour
COEFFICIENT MOYEN DE SCOLARISATION EN FRANCE EN 1959
Départements les moins scolarisés
en %
en %
Loir-et-Cher ............... 18,2
Mayenne .................. 18,9
Vendée ................... 22,2
Deux-Sèvres ............... 23,2
Eure ...................... 24,3
Départements les plus scolarisés
en %
en %
Alpes-Maritimes ........... 70,2
Seine ..................... 61,4
Bouches-du-Rhône ......... 55,8
Haute-Garonne ............. 55,2
Seine-et-Oise .............. 55,2
Les départements les moins
scolarisés sont aussi ceux où la
densité de population est la plus
faible. Il est intéressant de com-
parer ces résultats en France à
ceux qui sont établis pour les dif-
férentes républiques de l'U.R.S.S.
(voir tableau V). Si l'on tient
compte du fait que les statistiques
soviétiques ne sont relatives
qu'aux établissements d'enseigne-
ment supérieur (où les différen-
ces régionales sont les plus mar-
quées), on voit que les provinces
soviétiques présentent également
des différences entre elles, mais
beaucoup moins accentuées que
celles des départements français
entre eux : 186 étudiants pour
10.000 habitants pour la Fédéra-
tion de Russie en 1966, contre
104 pour la Turkménie. Ce qui
frappe surtout, en U.R.S.S., c'est
l'amélioration comparativement
élevée du nombre des étudiants
pour les provinces défavorisées
depuis 1940 (coefficient de 15,6
pour le Kazakhstan).
scolarisés sont aussi ceux où la
densité de population est la plus
faible. Il est intéressant de com-
parer ces résultats en France à
ceux qui sont établis pour les dif-
férentes républiques de l'U.R.S.S.
(voir tableau V). Si l'on tient
compte du fait que les statistiques
soviétiques ne sont relatives
qu'aux établissements d'enseigne-
ment supérieur (où les différen-
ces régionales sont les plus mar-
quées), on voit que les provinces
soviétiques présentent également
des différences entre elles, mais
beaucoup moins accentuées que
celles des départements français
entre eux : 186 étudiants pour
10.000 habitants pour la Fédéra-
tion de Russie en 1966, contre
104 pour la Turkménie. Ce qui
frappe surtout, en U.R.S.S., c'est
l'amélioration comparativement
élevée du nombre des étudiants
pour les provinces défavorisées
depuis 1940 (coefficient de 15,6
pour le Kazakhstan).
Dans ce domaine, le manque
de facilités offertes aux popula-
tions rurales peut jouer un grand
de facilités offertes aux popula-
tions rurales peut jouer un grand
(12) O.C.D.E. (Paris. 1967). p. 180.
les villes industrielles et 9,7 %
pour les agglomérations rurales.
pour les agglomérations rurales.
On peut donc se demander si,
plus que la forte densité de la po-
pulation, ce ne sont pas les condi-
tions de vie urbaine, liées à l'ex-
tension d'un secteur tertiaire dé-
veloppé, qui constituent le fac-
teur le plus « éducogène ».
plus que la forte densité de la po-
pulation, ce ne sont pas les condi-
tions de vie urbaine, liées à l'ex-
tension d'un secteur tertiaire dé-
veloppé, qui constituent le fac-
teur le plus « éducogène ».
Mettre en valeur
les aptitudes
les aptitudes
Toute politique de l'éducation,
par-delà ses buts humanitaires vi-
sant à assurer à chaque enfant
l'égalité des chances devant la
vie professionnelle, amène à se
poser la question suivante, relati-
ve à la croissance économique du
pays : parmi les jeunes non sco-
larisés de chaque niveau, existe-t-
il des aptitudes non valorisées, ce
que l'on appelle des « réserves
d'aptitudes » ? (Si celles-ci se
trouvaient épuisées, la croissance
de la quantité des étudiants en-
traînerait un processus inexorable
de détérioration de la qualité des
études.)
par-delà ses buts humanitaires vi-
sant à assurer à chaque enfant
l'égalité des chances devant la
vie professionnelle, amène à se
poser la question suivante, relati-
ve à la croissance économique du
pays : parmi les jeunes non sco-
larisés de chaque niveau, existe-t-
il des aptitudes non valorisées, ce
que l'on appelle des « réserves
d'aptitudes » ? (Si celles-ci se
trouvaient épuisées, la croissance
de la quantité des étudiants en-
traînerait un processus inexorable
de détérioration de la qualité des
études.)
De très nombreux indices,
dont nous avons donné quelques
dont nous avons donné quelques
exemples, semblent prouver que,
dans les pays hautement indus-
trialisés de l'Europe, de larges
possibilités existent encore. On a
vu que les couches sociales — de
la couche supérieure à la couche
inférieure — participent propor-
tionnellement de moins en moins
à l'enseignement secondaire, puis
supérieur. De même, on constate
que les filles sont nettement
moins nombreuses que les gar-
çons à poursuivre leurs études.
Des inégalités apparaissent aussi
pour la population de certaines
régions, particulièrement les ré-
gions rurales. Bien sûr, ces phé-
nomènes sont, globalement ou
en partie, moins marqués dans
tel pays que tel autre. En particu-
lier, dans les pays socialistes de
l'Est de l'Europe, les participations
ouvrières et féminines sont beau-
coût plus représentatives des po-
pulations que dans les autres pays.
dans les pays hautement indus-
trialisés de l'Europe, de larges
possibilités existent encore. On a
vu que les couches sociales — de
la couche supérieure à la couche
inférieure — participent propor-
tionnellement de moins en moins
à l'enseignement secondaire, puis
supérieur. De même, on constate
que les filles sont nettement
moins nombreuses que les gar-
çons à poursuivre leurs études.
Des inégalités apparaissent aussi
pour la population de certaines
régions, particulièrement les ré-
gions rurales. Bien sûr, ces phé-
nomènes sont, globalement ou
en partie, moins marqués dans
tel pays que tel autre. En particu-
lier, dans les pays socialistes de
l'Est de l'Europe, les participations
ouvrières et féminines sont beau-
coût plus représentatives des po-
pulations que dans les autres pays.
A l'Ouest pourtant, le Royau-
me-Uni et, à un moindre degré, la
Suède et la Finlande, semblent
accroître leur effort de démocra-
tisation, encore très limité, plus
rapidement que la France par
exemple.
me-Uni et, à un moindre degré, la
Suède et la Finlande, semblent
accroître leur effort de démocra-
tisation, encore très limité, plus
rapidement que la France par
exemple.
Enfin, on peut se demander
quels moyens seraient à mettre
en œuvre par une politique de
l'éducation qui viserait à la démo-
cratisation des études supérieures
et à la mise en valeur des aptitu-
des. Il est évident que, pour exer-
cer une influence compensatrice
à l'égard des facteurs économi-
ques, sociaux et culturels, un sou-
tien financier et matériel accru
aux étudiants serait indispensable
dans les pays de l'Ouest de l'Eu-
rope (régime d'allocation d'étu-
des, s'appliquant dès le niveau
secondaire dans certain cas ; dé-
veloppement des transports, lo-
gements pour étudiants, etc.). A
ce propos, l'exemple des pays de
l'Est est très instructif. Néan-
moins, dans un stade ultérieur, il
ne faudrait pas oublier de s'in-
quiéter de l'enseignement lui-mê-
me. Ses structures devraient s'as-
souplir, l'orientation se substituer
à la sélection négative, la péda-
gogie s'individualiser.
quels moyens seraient à mettre
en œuvre par une politique de
l'éducation qui viserait à la démo-
cratisation des études supérieures
et à la mise en valeur des aptitu-
des. Il est évident que, pour exer-
cer une influence compensatrice
à l'égard des facteurs économi-
ques, sociaux et culturels, un sou-
tien financier et matériel accru
aux étudiants serait indispensable
dans les pays de l'Ouest de l'Eu-
rope (régime d'allocation d'étu-
des, s'appliquant dès le niveau
secondaire dans certain cas ; dé-
veloppement des transports, lo-
gements pour étudiants, etc.). A
ce propos, l'exemple des pays de
l'Est est très instructif. Néan-
moins, dans un stade ultérieur, il
ne faudrait pas oublier de s'in-
quiéter de l'enseignement lui-mê-
me. Ses structures devraient s'as-
souplir, l'orientation se substituer
à la sélection négative, la péda-
gogie s'individualiser.
Son contenu lui-même devrait
être repensé en vue d'une plus
grande liaison avec la vie sociale,
et allégé d'une culture trop exclu-
sivement « humaniste » qui reste
peut-être, en dernier lieu, le frein
le plus puissant à toute véritable
démocratisation de l'enseigne-
ment.
être repensé en vue d'une plus
grande liaison avec la vie sociale,
et allégé d'une culture trop exclu-
sivement « humaniste » qui reste
peut-être, en dernier lieu, le frein
le plus puissant à toute véritable
démocratisation de l'enseigne-
ment.
27
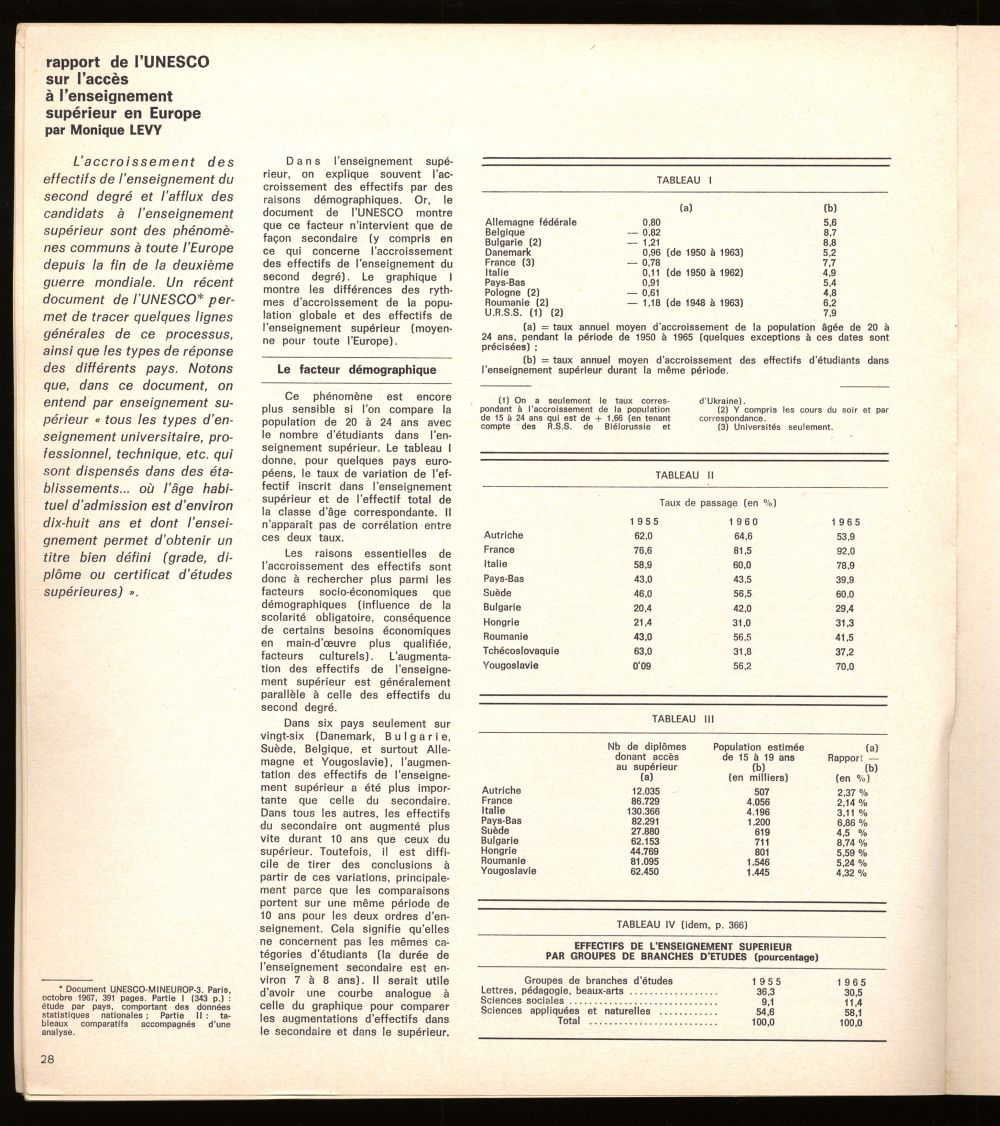

rapport de l'UNESCO
sur l'accès
à l'enseignement
supérieur en Europe
par Monique LEVY
sur l'accès
à l'enseignement
supérieur en Europe
par Monique LEVY
L'accroissement des
effectifs de l'enseignement du
second degré et l'afflux des
candidats à l'enseignement
supérieur sont des phénomè-
nes communs à toute l'Europe
depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale. Un récent
document de l'UNESCO* per-
met de tracer quelques lignes
générales de ce processus,
ainsi que les types de réponse
des différents pays. Notons
que, dans ce document, on
entend par enseignement su-
périeur « tous les types d'en-
seignement universitaire, pro-
fessionnel, technique, etc. qui
sont dispensés dans des éta-
blissements... où l'âge habi-
tuel d'admission est d'environ
dix-huit ans et dont l'ensei-
gnement permet d'obtenir un
titre bien défini (grade, di-
plôme ou certificat d'études
supérieures) ».
effectifs de l'enseignement du
second degré et l'afflux des
candidats à l'enseignement
supérieur sont des phénomè-
nes communs à toute l'Europe
depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale. Un récent
document de l'UNESCO* per-
met de tracer quelques lignes
générales de ce processus,
ainsi que les types de réponse
des différents pays. Notons
que, dans ce document, on
entend par enseignement su-
périeur « tous les types d'en-
seignement universitaire, pro-
fessionnel, technique, etc. qui
sont dispensés dans des éta-
blissements... où l'âge habi-
tuel d'admission est d'environ
dix-huit ans et dont l'ensei-
gnement permet d'obtenir un
titre bien défini (grade, di-
plôme ou certificat d'études
supérieures) ».
' Document UNESCO-MINEUROP-3. Paris,
octobre 1967, 391 pages. Partie I (343 p.) :
étude par pays, comportant des données
statistiques nationales; Partie M : ta-
bleaux comparatifs accompagnés d'une
analyse.
octobre 1967, 391 pages. Partie I (343 p.) :
étude par pays, comportant des données
statistiques nationales; Partie M : ta-
bleaux comparatifs accompagnés d'une
analyse.
Dans l'enseignement supé-
rieur, on explique souvent l'ac-
croissement des effectifs par des
raisons démographiques. Or, le
document de l'UNESCO montre
que ce facteur n'intervient que de
façon secondaire (y compris en
ce qui concerne l'accroissement
des effectifs de l'enseignement du
second degré). Le graphique I
montre les différences des ryth-
mes d'accroissement de la popu-
lation globale et des effectifs de
l'enseignement supérieur (moyen-
ne pour toute l'Europe).
rieur, on explique souvent l'ac-
croissement des effectifs par des
raisons démographiques. Or, le
document de l'UNESCO montre
que ce facteur n'intervient que de
façon secondaire (y compris en
ce qui concerne l'accroissement
des effectifs de l'enseignement du
second degré). Le graphique I
montre les différences des ryth-
mes d'accroissement de la popu-
lation globale et des effectifs de
l'enseignement supérieur (moyen-
ne pour toute l'Europe).
Le facteur démographique
Ce phénomène est encore
plus sensible si l'on compare la
population de 20 à 24 ans avec
le nombre d'étudiants dans l'en-
seignement supérieur. Le tableau I
donne, pour quelques pays euro-
péens, le taux de variation de l'ef-
fectif inscrit dans l'enseignement
supérieur et de l'effectif total de
la classe d'âge correspondante. Il
n'apparaît pas de corrélation entre
ces deux taux.
plus sensible si l'on compare la
population de 20 à 24 ans avec
le nombre d'étudiants dans l'en-
seignement supérieur. Le tableau I
donne, pour quelques pays euro-
péens, le taux de variation de l'ef-
fectif inscrit dans l'enseignement
supérieur et de l'effectif total de
la classe d'âge correspondante. Il
n'apparaît pas de corrélation entre
ces deux taux.
Les raisons essentielles de
l'accroissement des effectifs sont
donc à rechercher plus parmi les
facteurs socio-économiques que
démographiques (influence de la
scolarité obligatoire, conséquence
de certains besoins économiques
en main-d'œuvre plus qualifiée,
facteurs culturels). L'augmenta-
tion des effectifs de l'enseigne-
ment supérieur est généralement
parallèle à celle des effectifs du
second degré.
l'accroissement des effectifs sont
donc à rechercher plus parmi les
facteurs socio-économiques que
démographiques (influence de la
scolarité obligatoire, conséquence
de certains besoins économiques
en main-d'œuvre plus qualifiée,
facteurs culturels). L'augmenta-
tion des effectifs de l'enseigne-
ment supérieur est généralement
parallèle à celle des effectifs du
second degré.
Dans six pays seulement sur
vingt-six (Danemark, Bulgarie,
Suède, Belgique, et surtout Alle-
magne et Yougoslavie), l'augmen-
tation des effectifs de l'enseigne-
ment supérieur a été plus impor-
tante que celle du secondaire.
Dans tous les autres, les effectifs
du secondaire ont augmenté plus
vite durant 10 ans que ceux du
supérieur. Toutefois, il est diffi-
cile de tirer des conclusions à
partir de ces variations, principale-
ment parce que les comparaisons
portent sur une même période de
10 ans pour les deux ordres d'en-
seignement. Cela signifie qu'elles
ne concernent pas les mêmes ca-
tégories d'étudiants (la durée de
l'enseignement secondaire est en-
viron 7 à 8 ans). Il serait utile
d'avoir une courbe analogue à
celle du graphique pour comparer
les augmentations d'effectifs dans
le secondaire et dans le supérieur.
vingt-six (Danemark, Bulgarie,
Suède, Belgique, et surtout Alle-
magne et Yougoslavie), l'augmen-
tation des effectifs de l'enseigne-
ment supérieur a été plus impor-
tante que celle du secondaire.
Dans tous les autres, les effectifs
du secondaire ont augmenté plus
vite durant 10 ans que ceux du
supérieur. Toutefois, il est diffi-
cile de tirer des conclusions à
partir de ces variations, principale-
ment parce que les comparaisons
portent sur une même période de
10 ans pour les deux ordres d'en-
seignement. Cela signifie qu'elles
ne concernent pas les mêmes ca-
tégories d'étudiants (la durée de
l'enseignement secondaire est en-
viron 7 à 8 ans). Il serait utile
d'avoir une courbe analogue à
celle du graphique pour comparer
les augmentations d'effectifs dans
le secondaire et dans le supérieur.
TABLEAU I
Allemagne fédérale
Belgique
Bulgarie (2)
Danemark
France (3)
Italie
Pays-Bas
Pologne (2)
Roumanie (2)
U.R.S.S. (1) (2)
Belgique
Bulgarie (2)
Danemark
France (3)
Italie
Pays-Bas
Pologne (2)
Roumanie (2)
U.R.S.S. (1) (2)
(a)
0,80
— 0,82
— 1,21
0,96 (de 1950 à 1963)
— 0,78
0,11 (de 1950 à 1962)
0,91
0,91
— 0,61
— 1,18 (de 1948 à 1963)
(b)
5,6
8,7
8,8
5,2
7,7
4,9
5,4
4,8
6,2
7,9
8,7
8,8
5,2
7,7
4,9
5,4
4,8
6,2
7,9
(a) = taux annuel moyen d'accroissement de la population âgée de 20 à
24 ans, pendant la période de 1950 à 1965 (quelques exceptions à ces dates sont
précisées) ;
24 ans, pendant la période de 1950 à 1965 (quelques exceptions à ces dates sont
précisées) ;
(b) = taux annuel moyen d'accroissement des effectifs d'étudiants dans
l'enseignement supérieur durant la même période.
l'enseignement supérieur durant la même période.
(1) On a seulement le taux corres-
pondant à l'accroissement de la population
de 15 à 24 ans qui est de + 1,66 (en tenant
compte des R.S.S. de Biélorussie et
pondant à l'accroissement de la population
de 15 à 24 ans qui est de + 1,66 (en tenant
compte des R.S.S. de Biélorussie et
d'Ukraine).
(2) Y compris les cours du soir et par
correspondance.
correspondance.
(3) Universités seulement.
TABLEAU
Taux de
passage (en %)
passage (en %)
1955
1960
1965
1960
1965
Autriche
62,0
64,6
53,9
62,0
64,6
53,9
France
76,6
81,5
92,0
76,6
81,5
92,0
Italie
58,9
60,0
78,9
58,9
60,0
78,9
Pays-Bas
43,0
43,5
39,9
43,0
43,5
39,9
Suède
46,0
56,5
60,0
46,0
56,5
60,0
Bulgarie
20,4
42,0
29,4
20,4
42,0
29,4
Hongrie
21,4
31,0
31,3
21,4
31,0
31,3
Roumanie
43,0
56,5
41,5
43,0
56,5
41,5
Tchécoslovaquie
63,0
31,8
37,2
63,0
31,8
37,2
Yougoslavie
0'09
56,2
70,0
0'09
56,2
70,0
TABLEAU III
Nb de diplômes
Population estimée
(a)
Population estimée
(a)
donant accès
de 15 à 19 ans
Rapport —
de 15 à 19 ans
Rapport —
au supérieur
(b)
(b)
(b)
(b)
(a)
(en milliers)
(en %)
(en milliers)
(en %)
Autriche
12.035
507
2,37 %
12.035
507
2,37 %
France
86.729
4.056
2,14 %
86.729
4.056
2,14 %
Italie
130.366
4.196
3,11 %
130.366
4.196
3,11 %
Pays-Bas
82.291
1.200
6,86 %
82.291
1.200
6,86 %
Suède
27.880
619
4,5 %
27.880
619
4,5 %
Bulgarie
62.153
711
8,74 %
62.153
711
8,74 %
Hongrie
44.769
801
5,59 %
44.769
801
5,59 %
Roumanie
81.095
1.546
5,24 %
81.095
1.546
5,24 %
Yougoslavie
62.450
1.445
4,32 %
62.450
1.445
4,32 %
TABLEAU IV (idem, p. 366)
EFFECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PAR GROUPES DE BRANCHES D'ETUDES (pourcentage)
PAR GROUPES DE BRANCHES D'ETUDES (pourcentage)
Groupes de branches d'études
Lettres, pédagogie, beaux-arts ..........
Sciences sociales ......................
Sciences appliquées et naturelles -----
Total ..................
1955
36,3
9,1
54,6
100,0
1965
30,5
11,4
58,1
30,5
11,4
58,1
100,0
28
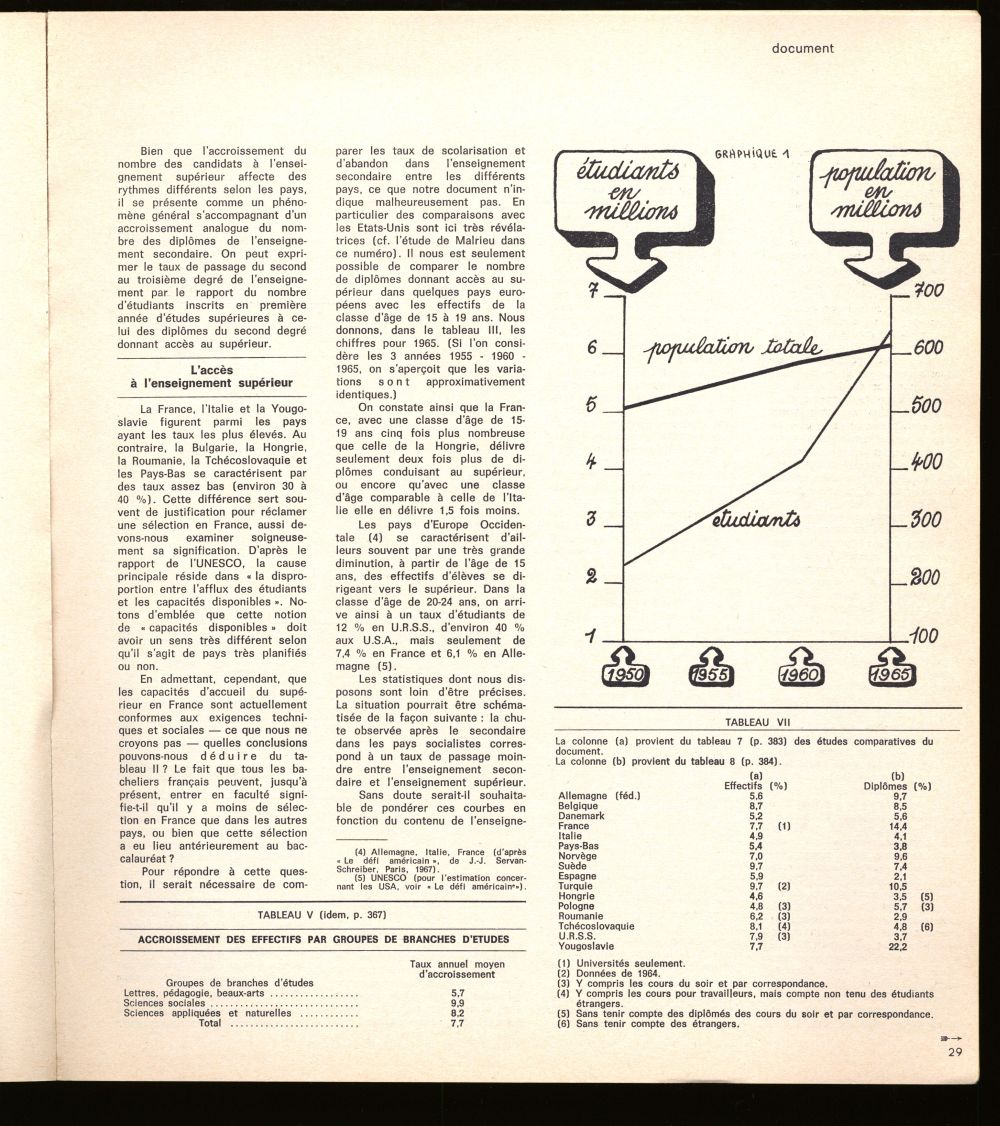

document
Bien que l'accroissement du
nombre des candidats à l'ensei-
gnement supérieur affecte des
rythmes différents selon les pays,
il se présente comme un phéno-
mène général s'accompagnant d'un
accroissement analogue du nom-
bre des diplômes de l'enseigne-
ment secondaire. On peut expri-
mer le taux de passage du second
au troisième degré de l'enseigne-
ment par le rapport du nombre
d'étudiants inscrits en première
année d'études supérieures à ce-
lui des diplômes du second degré
donnant accès au supérieur.
nombre des candidats à l'ensei-
gnement supérieur affecte des
rythmes différents selon les pays,
il se présente comme un phéno-
mène général s'accompagnant d'un
accroissement analogue du nom-
bre des diplômes de l'enseigne-
ment secondaire. On peut expri-
mer le taux de passage du second
au troisième degré de l'enseigne-
ment par le rapport du nombre
d'étudiants inscrits en première
année d'études supérieures à ce-
lui des diplômes du second degré
donnant accès au supérieur.
L'accès
à l'enseignement supérieur
à l'enseignement supérieur
La France, l'Italie et la Yougo-
slavie figurent parmi les pays
ayant les taux les plus élevés. Au
contraire, la Bulgarie, la Hongrie,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et
les Pays-Bas se caractérisent par
des taux assez bas (environ 30 à
40 %). Cette différence sert sou-
vent de justification pour réclamer
une sélection en France, aussi de-
vons-nous examiner soigneuse-
ment sa signification. D'après le
rapport de l'UNESCO, la cause
principale réside dans « la dispro-
portion entre l'afflux des étudiants
et les capacités disponibles ». No-
tons d'emblée que cette notion
de « capacités disponibles » doit
avoir un sens très différent selon
qu'il s'agit de pays très planifiés
ou non.
slavie figurent parmi les pays
ayant les taux les plus élevés. Au
contraire, la Bulgarie, la Hongrie,
la Roumanie, la Tchécoslovaquie et
les Pays-Bas se caractérisent par
des taux assez bas (environ 30 à
40 %). Cette différence sert sou-
vent de justification pour réclamer
une sélection en France, aussi de-
vons-nous examiner soigneuse-
ment sa signification. D'après le
rapport de l'UNESCO, la cause
principale réside dans « la dispro-
portion entre l'afflux des étudiants
et les capacités disponibles ». No-
tons d'emblée que cette notion
de « capacités disponibles » doit
avoir un sens très différent selon
qu'il s'agit de pays très planifiés
ou non.
En admettant, cependant, que
les capacités d'accueil du supé-
rieur en France sont actuellement
conformes aux exigences techni-
ques et sociales — ce que nous ne
croyons pas — quelles conclusions
pouvons-nous déduire du ta-
bleau II ? Le fait que tous les ba-
cheliers français peuvent, jusqu'à
présent, entrer en faculté signi-
fie-t-il qu'il y a moins de sélec-
tion en France que dans les autres
pays, ou bien que cette sélection
a eu lieu antérieurement au bac-
calauréat ?
les capacités d'accueil du supé-
rieur en France sont actuellement
conformes aux exigences techni-
ques et sociales — ce que nous ne
croyons pas — quelles conclusions
pouvons-nous déduire du ta-
bleau II ? Le fait que tous les ba-
cheliers français peuvent, jusqu'à
présent, entrer en faculté signi-
fie-t-il qu'il y a moins de sélec-
tion en France que dans les autres
pays, ou bien que cette sélection
a eu lieu antérieurement au bac-
calauréat ?
Pour répondre à cette ques-
tion, il serait nécessaire de com-
tion, il serait nécessaire de com-
parer les taux de scolarisation et
d'abandon dans l'enseignement
secondaire entre les différents
pays, ce que notre document n'in-
dique malheureusement pas. En
particulier des comparaisons avec
les Etats-Unis sont ici très révéla-
trices (cf. l'étude de Malrieu dans
ce numéro). Il nous est seulement
possible de comparer le nombre
de diplômes donnant accès au su-
périeur dans quelques pays euro-
péens avec les effectifs de la
classe d'âge de 15 à 19 ans. Nous
donnons, dans le tableau III, les
chiffres pour 1965. (Si l'on consi-
dère les 3 années 1955 - 1960 -
1965, on s'aperçoit que les varia-
tions sont approximativement
identiques.)
d'abandon dans l'enseignement
secondaire entre les différents
pays, ce que notre document n'in-
dique malheureusement pas. En
particulier des comparaisons avec
les Etats-Unis sont ici très révéla-
trices (cf. l'étude de Malrieu dans
ce numéro). Il nous est seulement
possible de comparer le nombre
de diplômes donnant accès au su-
périeur dans quelques pays euro-
péens avec les effectifs de la
classe d'âge de 15 à 19 ans. Nous
donnons, dans le tableau III, les
chiffres pour 1965. (Si l'on consi-
dère les 3 années 1955 - 1960 -
1965, on s'aperçoit que les varia-
tions sont approximativement
identiques.)
On constate ainsi que la Fran-
ce, avec une classe d'âge de 15-
19 ans cinq fois plus nombreuse
que celle de la Hongrie, délivre
seulement deux fois plus de di-
plômes conduisant au supérieur,
ou encore qu'avec une classe
d'âge comparable à celle de l'Ita-
lie elle en délivre 1,5 fois moins.
ce, avec une classe d'âge de 15-
19 ans cinq fois plus nombreuse
que celle de la Hongrie, délivre
seulement deux fois plus de di-
plômes conduisant au supérieur,
ou encore qu'avec une classe
d'âge comparable à celle de l'Ita-
lie elle en délivre 1,5 fois moins.
Les pays d'Europe Occiden-
tale (4) se caractérisent d'ail-
leurs souvent par une très grande
diminution, à partir de l'âge de 15
ans, des effectifs d'élèves se di-
rigeant vers le supérieur. Dans la
classe d'âge de 20-24 ans, on arri-
ve ainsi à un taux d'étudiants de
12 % en U.R.S.S., d'environ 40 %
aux U.S.A., mais seulement de
7,4 % en France et 6,1 % en Alle-
magne (5).
tale (4) se caractérisent d'ail-
leurs souvent par une très grande
diminution, à partir de l'âge de 15
ans, des effectifs d'élèves se di-
rigeant vers le supérieur. Dans la
classe d'âge de 20-24 ans, on arri-
ve ainsi à un taux d'étudiants de
12 % en U.R.S.S., d'environ 40 %
aux U.S.A., mais seulement de
7,4 % en France et 6,1 % en Alle-
magne (5).
Les statistiques dont nous dis-
posons sont loin d'être précises.
La situation pourrait être schéma-
tisée de la façon suivante : la chu-
te observée après le secondaire
dans les pays socialistes corres-
pond à un taux de passage moin-
dre entre l'enseignement secon-
daire et l'enseignement supérieur.
posons sont loin d'être précises.
La situation pourrait être schéma-
tisée de la façon suivante : la chu-
te observée après le secondaire
dans les pays socialistes corres-
pond à un taux de passage moin-
dre entre l'enseignement secon-
daire et l'enseignement supérieur.
Sans doute serait-il souhaita-
ble de pondérer ces courbes en
fonction du contenu de l'enseigne-
ble de pondérer ces courbes en
fonction du contenu de l'enseigne-
(4) Allemagne, Italie, France (d'après
« Le défi américain », de J.-J. Servan-
Schreiber, Paris, 1967).
« Le défi américain », de J.-J. Servan-
Schreiber, Paris, 1967).
(5) UNESCO (pour l'estimation concer-
nant les USA, voir « Le défi américain*»).
nant les USA, voir « Le défi américain*»).
TABLEAU V (idem, p. 367)
ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS PAR GROUPES DE BRANCHES D'ETUDES
Groupes de branches d'études
Lettres, pédagogie, beaux-arts ..........
Sciences sociales ......................
Sciences appliquées et naturelles
Total ..................
Taux annuel moyen
d'accroissement
d'accroissement
5,7
9,9
8,2
7,7
9,9
8,2
7,7
TABLEAU VII
La colonne (a) provient du tableau 7 (p. 383) des études comparatives du
document.
La colonne (b) provient du tableau 8 (p. 384).
Allemagne (féd.)
Belgique
Danemark
France
Italie
Pays-Bas
Norvège
Suède
Espagne
Turquie
Hongrie
Pologne
Roumanie
Tchécoslovaquie
U.R.S.S.
Yougoslavie
(a)
Effectifs (%)
5,6
8,7
5,2
5,6
8,7
5,2
7,7 (1)
4,9
5.4
7,0
9,7
5,9
4,9
5.4
7,0
9,7
5,9
9.7 (2)
4,6
4,6
4.8 (3)
6,2 (3)
8,1
6,2 (3)
8,1
7,9
7.7
7.7
(4)
(3)
(3)
(b)
Diplômes (%)
Diplômes (%)
9,7
8,5
5,6
14,4
14,4
4,1
3.8
9,6
7,4
2,1
10,5
10,5
3,5 (5)
5.7 (3)
2,9
2,9
4.8 (6)
3,7
3,7
22,2
(1) Universités seulement.
(2) Données de 1964.
(3) Y compris les cours du soir et par correspondance.
(4) Y compris les cours pour travailleurs, mais compte non tenu des étudiants
étrangers.
étrangers.
(5) Sans tenir compte des diplômés des cours du soir et par correspondance.
(6) Sans tenir compte des étrangers.
29
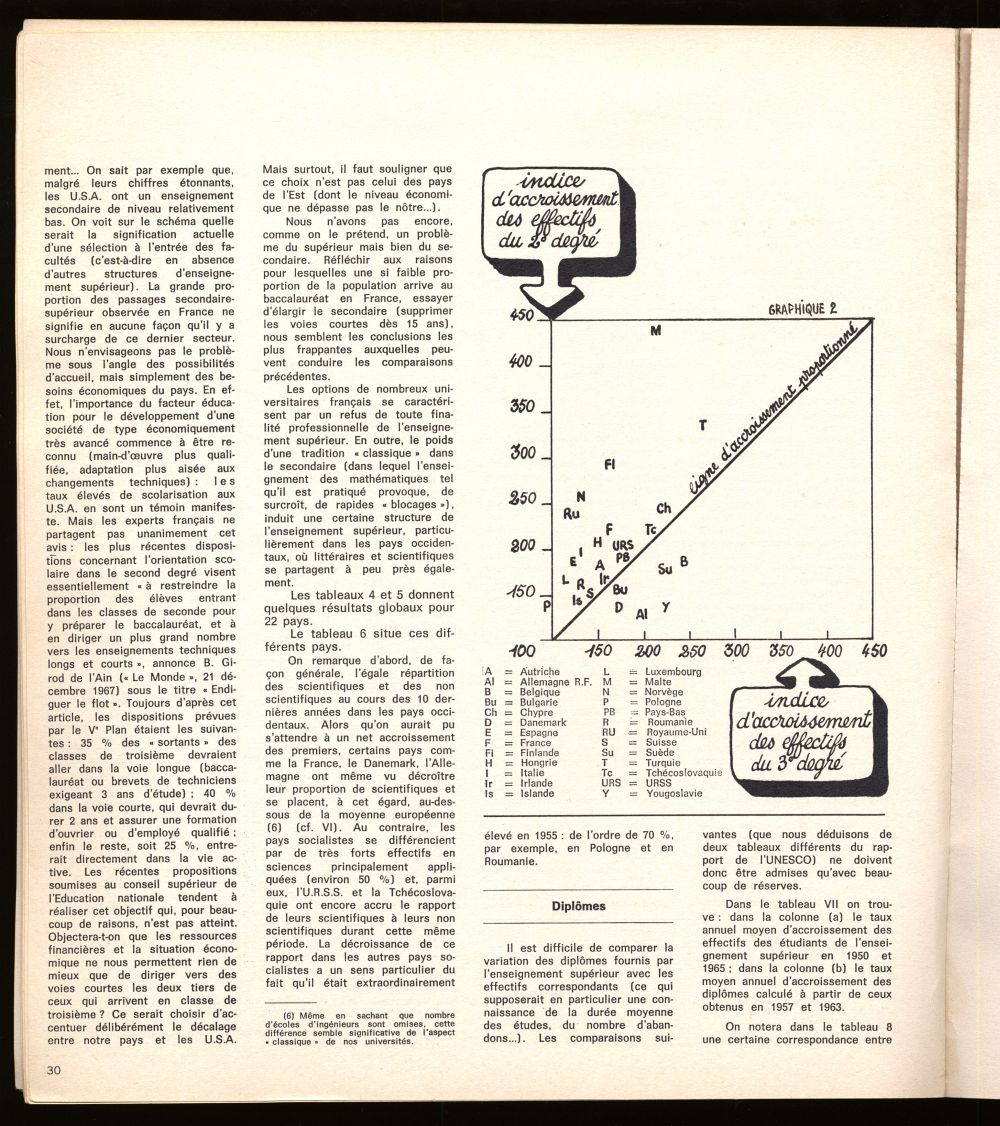

ment... On sait par exemple que,
malgré leurs chiffres étonnants,
les U.S.A. ont un enseignement
secondaire de niveau relativement
bas. On voit sur le schéma quelle
serait la signification actuelle
d'une sélection à l'entrée des fa-
cultés (c'est-à-dire en absence
d'autres structures d'enseigne-
ment supérieur). La grande pro-
portion des passages secondaire-
supérieur observée en France ne
signifie en aucune façon qu'il y a
surcharge de ce dernier secteur.
Nous n'envisageons pas le problè-
me sous l'angle des possibilités
d'accueil, mais simplement des be-
soins économiques du pays. En ef-
fet, l'importance du facteur éduca-
tion pour le développement d'une
société de type économiquement
très avancé commence à être re-
connu (main-d'œuvre plus quali-
fiée, adaptation plus aisée aux
changements techniques) : les
taux élevés de scolarisation aux
U.S.A. en sont un témoin manifes-
te. Mais les experts français ne
partagent pas unanimement cet
avis : les plus récentes disposi-
tions concernant l'orientation sco-
laire dans le second degré visent
essentiellement « à restreindre la
proportion des élèves entrant
dans les classes de seconde pour
y préparer le baccalauréat, et à
en diriger un plus grand nombre
vers les enseignements techniques
longs et courts », annonce B. Gi-
rod de l'Ain (<• Le Monde », 21 dé-
cembre 1967) sous le titre « Endi-
guer le flot ». Toujours d'après cet
article, les dispositions prévues
par le V° Plan étaient les suivan-
tes : 35 % des « sortants » des
classes de troisième devraient
aller dans la voie longue (bacca-
lauréat ou brevets de techniciens
exigeant 3 ans d'étude) ; 40 %
dans la voie courte, qui devrait du-
rer 2 ans et assurer une formation
d'ouvrier ou d'employé qualifié ;
enfin le reste, soit 25 %, entre-
rait directement dans la vie ac-
tive. Les récentes propositions
soumises au conseil supérieur de
l'Education nationale tendent à
réaliser cet objectif qui, pour beau-
coup de raisons, n'est pas atteint.
Objectera-t-on que les ressources
financières et la situation écono-
mique ne nous permettent rien de
mieux que de diriger vers des
voies courtes les deux tiers de
ceux qui arrivent en classe de
troisième ? Ce serait choisir d'ac-
centuer délibérément le décalage
entre notre pays et les U.S.A.
malgré leurs chiffres étonnants,
les U.S.A. ont un enseignement
secondaire de niveau relativement
bas. On voit sur le schéma quelle
serait la signification actuelle
d'une sélection à l'entrée des fa-
cultés (c'est-à-dire en absence
d'autres structures d'enseigne-
ment supérieur). La grande pro-
portion des passages secondaire-
supérieur observée en France ne
signifie en aucune façon qu'il y a
surcharge de ce dernier secteur.
Nous n'envisageons pas le problè-
me sous l'angle des possibilités
d'accueil, mais simplement des be-
soins économiques du pays. En ef-
fet, l'importance du facteur éduca-
tion pour le développement d'une
société de type économiquement
très avancé commence à être re-
connu (main-d'œuvre plus quali-
fiée, adaptation plus aisée aux
changements techniques) : les
taux élevés de scolarisation aux
U.S.A. en sont un témoin manifes-
te. Mais les experts français ne
partagent pas unanimement cet
avis : les plus récentes disposi-
tions concernant l'orientation sco-
laire dans le second degré visent
essentiellement « à restreindre la
proportion des élèves entrant
dans les classes de seconde pour
y préparer le baccalauréat, et à
en diriger un plus grand nombre
vers les enseignements techniques
longs et courts », annonce B. Gi-
rod de l'Ain (<• Le Monde », 21 dé-
cembre 1967) sous le titre « Endi-
guer le flot ». Toujours d'après cet
article, les dispositions prévues
par le V° Plan étaient les suivan-
tes : 35 % des « sortants » des
classes de troisième devraient
aller dans la voie longue (bacca-
lauréat ou brevets de techniciens
exigeant 3 ans d'étude) ; 40 %
dans la voie courte, qui devrait du-
rer 2 ans et assurer une formation
d'ouvrier ou d'employé qualifié ;
enfin le reste, soit 25 %, entre-
rait directement dans la vie ac-
tive. Les récentes propositions
soumises au conseil supérieur de
l'Education nationale tendent à
réaliser cet objectif qui, pour beau-
coup de raisons, n'est pas atteint.
Objectera-t-on que les ressources
financières et la situation écono-
mique ne nous permettent rien de
mieux que de diriger vers des
voies courtes les deux tiers de
ceux qui arrivent en classe de
troisième ? Ce serait choisir d'ac-
centuer délibérément le décalage
entre notre pays et les U.S.A.
Mais surtout, il faut souligner que
ce choix n'est pas celui des pays
de l'Est (dont le niveau économi-
que ne dépasse pas le nôtre...).
ce choix n'est pas celui des pays
de l'Est (dont le niveau économi-
que ne dépasse pas le nôtre...).
Nous n'avons pas encore,
comme on le prétend, un problè-
me du supérieur mais bien du se-
condaire. Réfléchir aux raisons
pour lesquelles une si faible pro-
portion de la population arrive au
baccalauréat en France, essayer
d'élargir le secondaire (supprimer
les voies courtes dès 15 ans),
nous semblent les conclusions les
plus frappantes auxquelles peu-
vent conduire les comparaisons
précédentes.
comme on le prétend, un problè-
me du supérieur mais bien du se-
condaire. Réfléchir aux raisons
pour lesquelles une si faible pro-
portion de la population arrive au
baccalauréat en France, essayer
d'élargir le secondaire (supprimer
les voies courtes dès 15 ans),
nous semblent les conclusions les
plus frappantes auxquelles peu-
vent conduire les comparaisons
précédentes.
Les options de nombreux uni-
versitaires français se caractéri-
sent par un refus de toute fina-
lité professionnelle de l'enseigne-
ment supérieur. En outre, le poids
d'une tradition « classique » dans
le secondaire (dans lequel l'ensei-
gnement des mathématiques tel
qu'il est pratiqué provoque, de
surcroît, de rapides «blocages»),
induit une certaine structure de
l'enseignement supérieur, particu-
lièrement dans les pays occiden-
taux, où littéraires et scientifiques
se partagent à peu près égale-
ment.
versitaires français se caractéri-
sent par un refus de toute fina-
lité professionnelle de l'enseigne-
ment supérieur. En outre, le poids
d'une tradition « classique » dans
le secondaire (dans lequel l'ensei-
gnement des mathématiques tel
qu'il est pratiqué provoque, de
surcroît, de rapides «blocages»),
induit une certaine structure de
l'enseignement supérieur, particu-
lièrement dans les pays occiden-
taux, où littéraires et scientifiques
se partagent à peu près égale-
ment.
Les tableaux 4 et 5 donnent
quelques résultats globaux pour
22 pays.
quelques résultats globaux pour
22 pays.
Le tableau 6 situe ces dif-
férents pays.
férents pays.
On remarque d'abord, de fa-
çon générale, l'égale répartition
des scientifiques et des non
scientifiques au cours des 10 der-
nières années dans les pays occi-
dentaux. Alors qu'on aurait pu
s'attendre à un net accroissement
des premiers, certains pays com-
me la France, le Danemark, l'Alle-
magne ont même vu décroître
leur proportion de scientifiques et
se placent, à cet égard, au-des-
sous de la moyenne européenne
(6) (cf. VI). Au contraire, les
pays socialistes se différencient
par de très forts effectifs en
sciences principalement appli-
quées (environ 50 %) et, parmi
eux, l'U.R.S.S. et la Tchécoslova-
quie ont encore accru le rapport
de leurs scientifiques à leurs non
scientifiques durant cette même
période. La décroissance de ce
rapport dans les autres pays so-
cialistes a un sens particulier du
fait qu'il était extraordinairement
çon générale, l'égale répartition
des scientifiques et des non
scientifiques au cours des 10 der-
nières années dans les pays occi-
dentaux. Alors qu'on aurait pu
s'attendre à un net accroissement
des premiers, certains pays com-
me la France, le Danemark, l'Alle-
magne ont même vu décroître
leur proportion de scientifiques et
se placent, à cet égard, au-des-
sous de la moyenne européenne
(6) (cf. VI). Au contraire, les
pays socialistes se différencient
par de très forts effectifs en
sciences principalement appli-
quées (environ 50 %) et, parmi
eux, l'U.R.S.S. et la Tchécoslova-
quie ont encore accru le rapport
de leurs scientifiques à leurs non
scientifiques durant cette même
période. La décroissance de ce
rapport dans les autres pays so-
cialistes a un sens particulier du
fait qu'il était extraordinairement
GRAPHIQUE
400-
$00 _
250 _
200 _
250 _
200 _
FI
N
•iOO
450 MO 2,50 ZOO 350 _ 400 «50
'A = Autriche L
Al = Allemagne R.F. M
B = Belgique N
Bu = Bulgarie P
Ch = Chypre PB
D = Danemark R
E = Espagne RU
F = France S
Fi = Finlande Su
H = Hongrie T
I = Italie Te
!r = Irlande URS
Is = Islande Y
= Luxembourg
= Malte
= Norvège
= Pologne
.-^ Pays-Bas
= Roumanie
.:= Royaume-Uni
= Suisse
= Suède
= Turquie
= Tchécoslovaquie
= URSS
= Yougoslavie
(6) Même en sachant que nombre
d'écoles d'ingénieurs sont omises, cette
différence semble significative de l'aspect
« classique » de nos universités.
d'écoles d'ingénieurs sont omises, cette
différence semble significative de l'aspect
« classique » de nos universités.
élevé en 1955 : de l'ordre de 70 %,
par exemple, en Pologne et en
Roumanie.
par exemple, en Pologne et en
Roumanie.
Diplômes
II est difficile de comparer la
variation des diplômes fournis par
l'enseignement supérieur avec les
effectifs correspondants (ce qui
supposerait en particulier une con-
naissance de la durée moyenne
des études, du nombre d'aban-
dons...). Les comparaisons sui-
variation des diplômes fournis par
l'enseignement supérieur avec les
effectifs correspondants (ce qui
supposerait en particulier une con-
naissance de la durée moyenne
des études, du nombre d'aban-
dons...). Les comparaisons sui-
vantes (que nous déduisons de
deux tableaux différents du rap-
port de l'UNESCO) ne doivent
donc être admises qu'avec beau-
coup de réserves.
deux tableaux différents du rap-
port de l'UNESCO) ne doivent
donc être admises qu'avec beau-
coup de réserves.
Dans le tableau VII on trou-
ve : dans la colonne (a) le taux
annuel moyen d'accroissement des
effectifs des étudiants de l'ensei-
gnement supérieur en 1950 et
1965 ; dans la colonne (b) le taux
moyen annuel d'accroissement des
diplômes calculé à partir de ceux
obtenus en 1957 et 1963.
ve : dans la colonne (a) le taux
annuel moyen d'accroissement des
effectifs des étudiants de l'ensei-
gnement supérieur en 1950 et
1965 ; dans la colonne (b) le taux
moyen annuel d'accroissement des
diplômes calculé à partir de ceux
obtenus en 1957 et 1963.
On notera dans le tableau 8
une certaine correspondance entre
une certaine correspondance entre
30
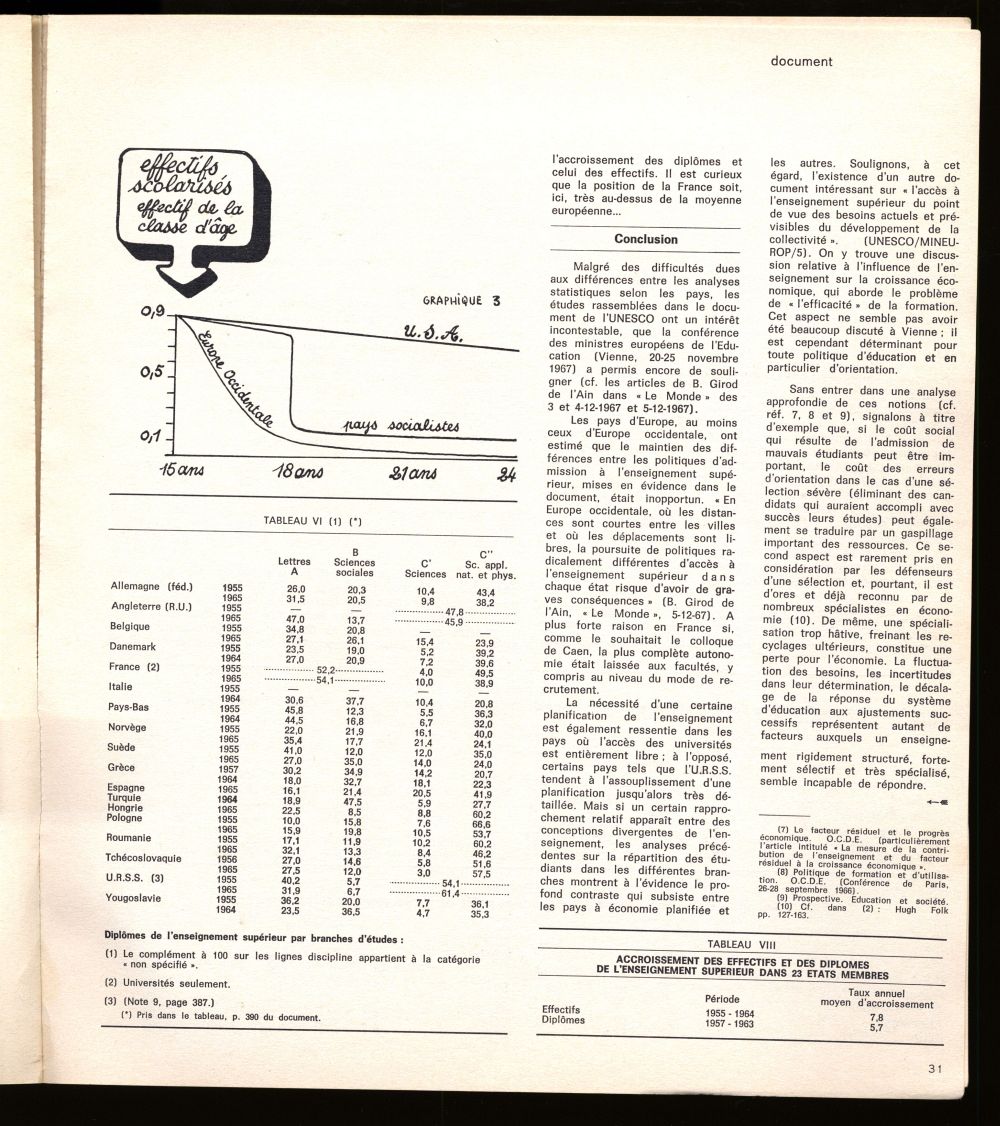

document
i, t
^
TABLEAU VI (1) (*)
B
C"
Lettres
Sciences
C' Se
. appl.
Sciences
C' Se
. appl.
A
sociales
Sciences nat.
et phys.
sociales
Sciences nat.
et phys.
Allemagne (féd.)
1955
26,0
20,3
10,4
43,4
1955
26,0
20,3
10,4
43,4
1965
31,5
20,5
9,8
38,2
31,5
20,5
9,8
38,2
4QCC
A7 R
Angleterre (.n.U.J
iyoo
iyoo
....... .......... **/ ,o
1965
47,0
13,7
................. 45,9--
47,0
13,7
................. 45,9--
Belgique
1955
34,8
20,8
—
—
1955
34,8
20,8
—
—
1965
27,1
26,1
15,4
23,9
27,1
26,1
15,4
23,9
Danemark
1955
23,5
19,0
5,2
39,2
1955
23,5
19,0
5,2
39,2
1964
27,0
20,9
7,2
39,6
27,0
20,9
7,2
39,6
France (2)
1955
1955
52,2 .................
4,0
49,5
4,0
49,5
1 Qfî^
CJt 1 ...........
m n
Op Q
m n
Op Q
iyoo
ot, i ............
IU,U
<JO,î7
IU,U
<JO,î7
Italie
1955
—
------
—
------
1955
—
------
—
------
1964
30,6
37,7
10,4
20,8
30,6
37,7
10,4
20,8
Pays-Bas
1955
45,8
12,3
5,5
36,3
1955
45,8
12,3
5,5
36,3
1964
44,5
16,8
6,7
32,0
44,5
16,8
6,7
32,0
Norvège
1955
22,0
21,9
16,1
40,0
1955
22,0
21,9
16,1
40,0
1965
35,4
17,7
21,4
24.1
35,4
17,7
21,4
24.1
Suède
1955
41,0
12,0
12,0
35,0
1955
41,0
12,0
12,0
35,0
1965
27,0
35,0
14,0
24,0
27,0
35,0
14,0
24,0
Grèce
1957
30,2
34,9
14,2
20,7
1957
30,2
34,9
14,2
20,7
1964
18,0
32,7
18,1
22,3
18,0
32,7
18,1
22,3
Espagne
1965
16,1
21,4
20,5
41,9
1965
16,1
21,4
20,5
41,9
Turquie
1964
18,9
47,5
5,9
27,7
1964
18,9
47,5
5,9
27,7
Hongrie
1965
22,5
8,5
8,8
60,2
1965
22,5
8,5
8,8
60,2
Pologne
1955
10,0
15,8
7,6
66,6
1955
10,0
15,8
7,6
66,6
1965
15,9
19,8
10,5
53,7
15,9
19,8
10,5
53,7
Roumanie
1955
17,1
11,9
10,2
60,2
1955
17,1
11,9
10,2
60,2
1965
32,1
13,3
8,4
46,2
32,1
13,3
8,4
46,2
Tchécoslovaquie
1956
27,0
14,6
5,8
51,6
1956
27,0
14,6
5,8
51,6
1965
27,5 An o
12,0
C 7
3,0
M 4
57,5
27,5 An o
12,0
C 7
3,0
M 4
57,5
U.R.S.S. (3)
1955 1965
**U,t
31.9
O,/
6,7
,1 "
.................. 61.4-
1955 1965
**U,t
31.9
O,/
6,7
,1 "
.................. 61.4-
Yougoslavie
1955
36,2
20,0
7.7
36,1
1955
36,2
20,0
7.7
36,1
1964
23,5
36,5
4,7
35,3
23,5
36,5
4,7
35,3
Diplômes de l'enseignement supérieur par branches d'études :
(1) Le complément à 100 sur les lignes discipline appartient à la catégorie
« non spécifié ».
« non spécifié ».
(2) Universités seulement.
(3) (Note 9, page 387.)
(*) Pris dans le tableau, p. 390 du document.
l'accroissement des diplômes et
celui des effectifs. Il est curieux
que la position de la France soit,
ici, très au-dessus de la moyenne
européenne...
celui des effectifs. Il est curieux
que la position de la France soit,
ici, très au-dessus de la moyenne
européenne...
Conclusion
Malgré des difficultés dues
aux différences entre les analyses
statistiques selon les pays, les
études rassemblées dans le docu-
ment de l'UNESCO ont un intérêt
incontestable, que la conférence
des ministres européens de l'Edu-
cation (Vienne, 20-25 novembre
1967) a permis encore de souli-
gner (cf. les articles de B. Girod
de l'Ain dans « Le Monde » des
3 et 4-12-1967 et 5-12-1967).
aux différences entre les analyses
statistiques selon les pays, les
études rassemblées dans le docu-
ment de l'UNESCO ont un intérêt
incontestable, que la conférence
des ministres européens de l'Edu-
cation (Vienne, 20-25 novembre
1967) a permis encore de souli-
gner (cf. les articles de B. Girod
de l'Ain dans « Le Monde » des
3 et 4-12-1967 et 5-12-1967).
Les pays d'Europe, au moins
ceux d'Europe occidentale, ont
estimé que le maintien des dif-
férences entre les politiques d'ad-
mission à l'enseignement supé-
rieur, mises en évidence dans le
document, était inopportun. « En
Europe occidentale, où les distan-
ces sont courtes entre les villes
et où les déplacements sont li-
bres, la poursuite de politiques ra-
dicalement différentes d'accès à
l'enseignement supérieur dans
chaque état risque d'avoir de gra-
ves conséquences » (B. Girod de
l'Ain, «Le Monde», 5-12-67). A
plus forte raison en France si,
comme le souhaitait le colloque
de Caen, la plus complète autono-
mie était laissée aux facultés, y
compris au niveau du mode de re-
crutement.
ceux d'Europe occidentale, ont
estimé que le maintien des dif-
férences entre les politiques d'ad-
mission à l'enseignement supé-
rieur, mises en évidence dans le
document, était inopportun. « En
Europe occidentale, où les distan-
ces sont courtes entre les villes
et où les déplacements sont li-
bres, la poursuite de politiques ra-
dicalement différentes d'accès à
l'enseignement supérieur dans
chaque état risque d'avoir de gra-
ves conséquences » (B. Girod de
l'Ain, «Le Monde», 5-12-67). A
plus forte raison en France si,
comme le souhaitait le colloque
de Caen, la plus complète autono-
mie était laissée aux facultés, y
compris au niveau du mode de re-
crutement.
La nécessité d'une certaine
planification de l'enseignement
est également ressentie dans les
pays où l'accès des universités
est entièrement libre ; à l'opposé,
certains pays tels que l'U.R.S.S.
tendent à l'assouplissement d'une
planification jusqu'alors très dé-
taillée. Mais si un certain rappro-
chement relatif apparaît entre des
conceptions divergentes de l'en-
seignement, les analyses précé-
dentes sur la répartition des étu-
diants dans les différentes bran-
ches montrent à l'évidence le pro-
fond contraste qui subsiste entre
les pays à économie planifiée et
planification de l'enseignement
est également ressentie dans les
pays où l'accès des universités
est entièrement libre ; à l'opposé,
certains pays tels que l'U.R.S.S.
tendent à l'assouplissement d'une
planification jusqu'alors très dé-
taillée. Mais si un certain rappro-
chement relatif apparaît entre des
conceptions divergentes de l'en-
seignement, les analyses précé-
dentes sur la répartition des étu-
diants dans les différentes bran-
ches montrent à l'évidence le pro-
fond contraste qui subsiste entre
les pays à économie planifiée et
les autres. Soulignons, à cet
égard, l'existence d'un autre do-
cument intéressant sur « l'accès à
l'enseignement supérieur du point
de vue des besoins actuels et pré-
visibles du développement de la
collectivité ». (UNESCO/MINEU-
ROP/5). On y trouve une discus-
sion relative à l'influence de l'en-
seignement sur la croissance éco-
nomique, qui aborde le problème
de « l'efficacité » de la formation.
Cet aspect ne semble pas avoir
été beaucoup discuté à Vienne ; il
est cependant déterminant pour
toute politique d'éducation et en
particulier d'orientation.
égard, l'existence d'un autre do-
cument intéressant sur « l'accès à
l'enseignement supérieur du point
de vue des besoins actuels et pré-
visibles du développement de la
collectivité ». (UNESCO/MINEU-
ROP/5). On y trouve une discus-
sion relative à l'influence de l'en-
seignement sur la croissance éco-
nomique, qui aborde le problème
de « l'efficacité » de la formation.
Cet aspect ne semble pas avoir
été beaucoup discuté à Vienne ; il
est cependant déterminant pour
toute politique d'éducation et en
particulier d'orientation.
Sans entrer dans une analyse
approfondie de ces notions (cf.
réf. 7, 8 et 9), signalons à titre
d'exemple que, si le coût social
qui résulte de l'admission de
mauvais étudiants peut être im-
portant, le coût des erreurs
d'orientation dans le cas d'une sé-
lection sévère (éliminant des can-
didats qui auraient accompli avec
succès leurs études) peut égale-
ment se traduire par un gaspillage
important des ressources. Ce se-
cond aspect est rarement pris en
considération par les défenseurs
d'une sélection et, pourtant, il est
d'ores et déjà reconnu par de
nombreux spécialistes en écono-
mie (10). De même, une spéciali-
sation trop hâtive, freinant les re-
cyclages ultérieurs, constitue une
perte pour l'économie. La fluctua-
tion des besoins, les incertitudes
dans leur détermination, le décala-
ge de la réponse du système
d'éducation aux ajustements suc-
cessifs représentent autant de
facteurs auxquels un enseigne-
ment rigidement structuré, forte-
ment sélectif et très spécialisé,
semble incapable de répondre.
approfondie de ces notions (cf.
réf. 7, 8 et 9), signalons à titre
d'exemple que, si le coût social
qui résulte de l'admission de
mauvais étudiants peut être im-
portant, le coût des erreurs
d'orientation dans le cas d'une sé-
lection sévère (éliminant des can-
didats qui auraient accompli avec
succès leurs études) peut égale-
ment se traduire par un gaspillage
important des ressources. Ce se-
cond aspect est rarement pris en
considération par les défenseurs
d'une sélection et, pourtant, il est
d'ores et déjà reconnu par de
nombreux spécialistes en écono-
mie (10). De même, une spéciali-
sation trop hâtive, freinant les re-
cyclages ultérieurs, constitue une
perte pour l'économie. La fluctua-
tion des besoins, les incertitudes
dans leur détermination, le décala-
ge de la réponse du système
d'éducation aux ajustements suc-
cessifs représentent autant de
facteurs auxquels un enseigne-
ment rigidement structuré, forte-
ment sélectif et très spécialisé,
semble incapable de répondre.
(7) La facteur résiduel et le progrès
économique. O.C.D.E. (particulièrement
l'article intitulé • La mesure de la contri-
bution de l'enseignement et du facteur
résiduel à la croissance économique ».
économique. O.C.D.E. (particulièrement
l'article intitulé • La mesure de la contri-
bution de l'enseignement et du facteur
résiduel à la croissance économique ».
(8) Politique de formation et d'utilisa-
tion. O.C.D.E. (Conférence de Paris,
26-28 septembre 1966).
tion. O.C.D.E. (Conférence de Paris,
26-28 septembre 1966).
(9) Prospective. Education et société.
(10) Cf. dans (2) : Hugh Folk
pp. 127-163.
pp. 127-163.
TABLEAU VIII
ACCROISSEMENT DES EFFECTIFS ET DES DIPLOMES
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS 23 ETATS MEMBRES__________
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS 23 ETATS MEMBRES__________
Taux annuel
moyen d'accroissement
moyen d'accroissement
Effectifs
Diplômes
Diplômes
Période
1955- 1964
1957-1963
1957-1963
7,8
5,7
5,7
31
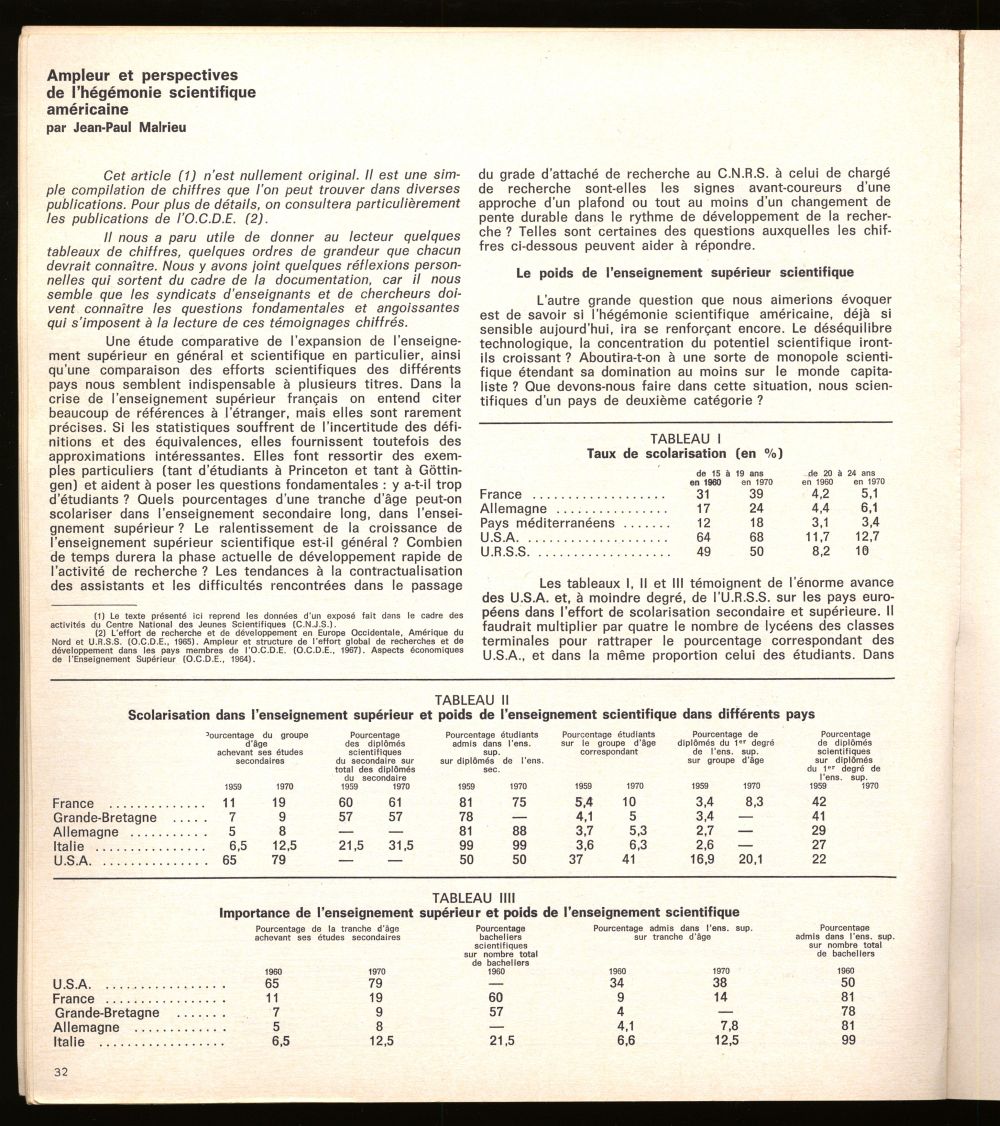

Ampleur et perspectives
de l'hégémonie scientifique
américaine
par Jean-Paul Malrieu
Cet article (1) n'est nullement original. Il est une sim-
ple compilation de chiffres que l'on peut trouver dans diverses
publications. Pour plus de détails, on consultera particulièrement
les publications de l'O.C.D.E. (2).
ple compilation de chiffres que l'on peut trouver dans diverses
publications. Pour plus de détails, on consultera particulièrement
les publications de l'O.C.D.E. (2).
Il nous a paru utile de donner au lecteur quelques
tableaux de chiffres, quelques ordres de grandeur que chacun
devrait connaître. Nous y avons joint quelques réflexions person-
nelles qui sortent du cadre de la documentation, car il nous
semble que les syndicats d'enseignants et de chercheurs doi-
vent connaître les questions fondamentales et angoissantes
qui s'imposent à la lecture de ces témoignages chiffrés.
tableaux de chiffres, quelques ordres de grandeur que chacun
devrait connaître. Nous y avons joint quelques réflexions person-
nelles qui sortent du cadre de la documentation, car il nous
semble que les syndicats d'enseignants et de chercheurs doi-
vent connaître les questions fondamentales et angoissantes
qui s'imposent à la lecture de ces témoignages chiffrés.
Une étude comparative de l'expansion de l'enseigne-
ment supérieur en général et scientifique en particulier, ainsi
qu'une comparaison des efforts scientifiques des différents
pays nous semblent indispensable à plusieurs titres. Dans la
crise de l'enseignement supérieur français on entend citer
beaucoup de références à l'étranger, mais elles sont rarement
précises. Si les statistiques souffrent de l'incertitude des défi-
nitions et des équivalences, elles fournissent toutefois des
approximations intéressantes. Elles font ressortir des exem-
ples particuliers (tant d'étudiants à Princeton et tant à Gôttin-
gen) et aident à poser les questions fondamentales : y a-t-il trop
d'étudiants ? Quels pourcentages d'une tranche d'âge peut-on
scolariser dans l'enseignement secondaire long, dans l'ensei-
gnement supérieur ? Le ralentissement de la croissance de
l'enseignement supérieur scientifique est-il général ? Combien
de temps durera la phase actuelle de développement rapide de
l'activité de recherche ? Les tendances à la contractualisation
des assistants et les difficultés rencontrées dans le passage
ment supérieur en général et scientifique en particulier, ainsi
qu'une comparaison des efforts scientifiques des différents
pays nous semblent indispensable à plusieurs titres. Dans la
crise de l'enseignement supérieur français on entend citer
beaucoup de références à l'étranger, mais elles sont rarement
précises. Si les statistiques souffrent de l'incertitude des défi-
nitions et des équivalences, elles fournissent toutefois des
approximations intéressantes. Elles font ressortir des exem-
ples particuliers (tant d'étudiants à Princeton et tant à Gôttin-
gen) et aident à poser les questions fondamentales : y a-t-il trop
d'étudiants ? Quels pourcentages d'une tranche d'âge peut-on
scolariser dans l'enseignement secondaire long, dans l'ensei-
gnement supérieur ? Le ralentissement de la croissance de
l'enseignement supérieur scientifique est-il général ? Combien
de temps durera la phase actuelle de développement rapide de
l'activité de recherche ? Les tendances à la contractualisation
des assistants et les difficultés rencontrées dans le passage
du grade d'attaché de recherche au C.N.R.S. à celui de chargé
de recherche sont-elles les signes avant-coureurs d'une
approche d'un plafond ou tout au moins d'un changement de
pente durable dans le rythme de développement de la recher-
che ? Telles sont certaines des questions auxquelles les chif-
fres ci-dessous peuvent aider à répondre.
de recherche sont-elles les signes avant-coureurs d'une
approche d'un plafond ou tout au moins d'un changement de
pente durable dans le rythme de développement de la recher-
che ? Telles sont certaines des questions auxquelles les chif-
fres ci-dessous peuvent aider à répondre.
Le poids de l'enseignement supérieur scientifique
L'autre grande question que nous aimerions évoquer
est de savoir si l'hégémonie scientifique américaine, déjà si
sensible aujourd'hui, ira se renforçant encore. Le déséquilibre
technologique, la concentration du potentiel scientifique iront-
ils croissant ? Aboutira-t-on à une sorte de monopole scienti-
fique étendant sa domination au moins sur le monde capita-
liste ? Que devons-nous faire dans cette situation, nous scien-
tifiques d'un pays de deuxième catégorie ?
est de savoir si l'hégémonie scientifique américaine, déjà si
sensible aujourd'hui, ira se renforçant encore. Le déséquilibre
technologique, la concentration du potentiel scientifique iront-
ils croissant ? Aboutira-t-on à une sorte de monopole scienti-
fique étendant sa domination au moins sur le monde capita-
liste ? Que devons-nous faire dans cette situation, nous scien-
tifiques d'un pays de deuxième catégorie ?
TABLEAU 1
Taux
de scolarisation
(en %)
de scolarisation
(en %)
de 15 à
19 ans
de 20 i
i 24 ans
19 ans
de 20 i
i 24 ans
en 1960
en 1970
en 1960
en 1970
en 1970
en 1960
en 1970
France ............
....... 31
39
4,2
5,1
....... 31
39
4,2
5,1
Allemagne .........
...... 17
24
4,4
6,1
...... 17
24
4,4
6,1
Pays méditerranéens
... 12
18
3 1
3,4
... 12
18
3 1
3,4
U.S.A ..............
....... 64
68
11,7
12,7
....... 64
68
11,7
12,7
U.R.S.S .............
....... 49
50
8.2
10
....... 49
50
8.2
10
(1) Le texte présenté ici reprend les données d'un exposé fait dans ie cadre des
activités du Centre National des Jeunes Scientifiques (C.N.J.S.).
activités du Centre National des Jeunes Scientifiques (C.N.J.S.).
(2) L'effort de recherche et de développement en Europe Occidentale, Amérique du
Nord et U.R.S.S. (O.C.D.E., 1965). Ampleur et structure de l'effort global de recherches et de
développement dans les pays membres de l'O.C.D.E. (O.C.D.E.. 1967). Aspects économiques
de l'Enseignement Supérieur (O.C.D.E., 1964).
Nord et U.R.S.S. (O.C.D.E., 1965). Ampleur et structure de l'effort global de recherches et de
développement dans les pays membres de l'O.C.D.E. (O.C.D.E.. 1967). Aspects économiques
de l'Enseignement Supérieur (O.C.D.E., 1964).
Les tableaux 1, II et III témoignent de l'énorme avance
des U.S.A. et, à moindre degré, de l'U.R.S.S. sur les pays euro-
péens dans l'effort de scolarisation secondaire et supérieure. Il
faudrait multiplier par quatre le nombre de lycéens des classes
terminales pour rattraper le pourcentage correspondant des
U.S.A., et dans la même proportion celui des étudiants. Dans
des U.S.A. et, à moindre degré, de l'U.R.S.S. sur les pays euro-
péens dans l'effort de scolarisation secondaire et supérieure. Il
faudrait multiplier par quatre le nombre de lycéens des classes
terminales pour rattraper le pourcentage correspondant des
U.S.A., et dans la même proportion celui des étudiants. Dans
TABLEAU II
Scolarisation dans l'enseignement supérieur
et poids de l'enseignement scientifique dans différents
pays
et poids de l'enseignement scientifique dans différents
pays
pourcentage du groupe
Pourcentage
Pourcentage étudiants
Pourcentage étudiants
Pourcentage de
Pourcentage
Pourcentage
Pourcentage étudiants
Pourcentage étudiants
Pourcentage de
Pourcentage
d'âge
des diplômés
admis dans l'ens.
sur le groupe d'âge
diplômés du 1er degré
de diplômés
des diplômés
admis dans l'ens.
sur le groupe d'âge
diplômés du 1er degré
de diplômés
achevant ses études
scientifiques
sup.
correspondant
de l'ens. sup.
scientifiques
scientifiques
sup.
correspondant
de l'ens. sup.
scientifiques
secondaires
du secondaire sur
sur diplômés de l'ens.
du secondaire sur
sur diplômés de l'ens.
sur groupe d'âge
sur diplômés
sur diplômés
total des diplômés
sec.
sec.
du 1er degré de
du secondaire
l'ens. sup.
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
1959 1970
France ...........
11 19
60 61
81 75
5,4 10
3,4 8,3
42
11 19
60 61
81 75
5,4 10
3,4 8,3
42
Grande-Bretagne
7 9
57 57
78 —
4,1 5
3,4 —
41
7 9
57 57
78 —
4,1 5
3,4 —
41
Allemagne .......
5 8
5 8
81 88
3,7 5,3
2,7 —
29
3,7 5,3
2,7 —
29
Italie .............
6,5 12,5
21,5 31,5
99 99
3,6 6,3
2,6 —
27
6,5 12,5
21,5 31,5
99 99
3,6 6,3
2,6 —
27
U.S.A .............
. 65 79
. 65 79
50 50
37 41
16,9 20,1
22
37 41
16,9 20,1
22
TABLEAU Mil
Importance de
l'enseignement
supérieur et poids de
l'enseignement
scientifique
l'enseignement
supérieur et poids de
l'enseignement
scientifique
Pourcentage
de la tranche d'âge
Pourcentage
Pourcentage admis dans l'ens. sup.
Pourcentage
de la tranche d'âge
Pourcentage
Pourcentage admis dans l'ens. sup.
Pourcentage
achevant ses
études secondaires
bacheliers
sur tranche d'âge
admis dans l'ens. sup.
études secondaires
bacheliers
sur tranche d'âge
admis dans l'ens. sup.
scientifiques
sur nombre total
sur nombre total
de bacheliers
de bacheliers
1960
1970
1960
1960
1970
1960
1970
1960
1960
1970
1960
USA .....
...... 65
79
___
34
38
50
...... 65
79
___
34
38
50
France ...........
11
19
60
9
14
81
11
19
60
9
14
81
Grande-Bretagne
..... 7
9
57
4
..... 7
9
57
4
78
Allemagne .......
...... 5
8
...... 5
8
4,1
7,8
81
7,8
81
Italie ............
...... 6.5
12,5
21,5
6,6
12.5
99
...... 6.5
12,5
21,5
6,6
12.5
99
32
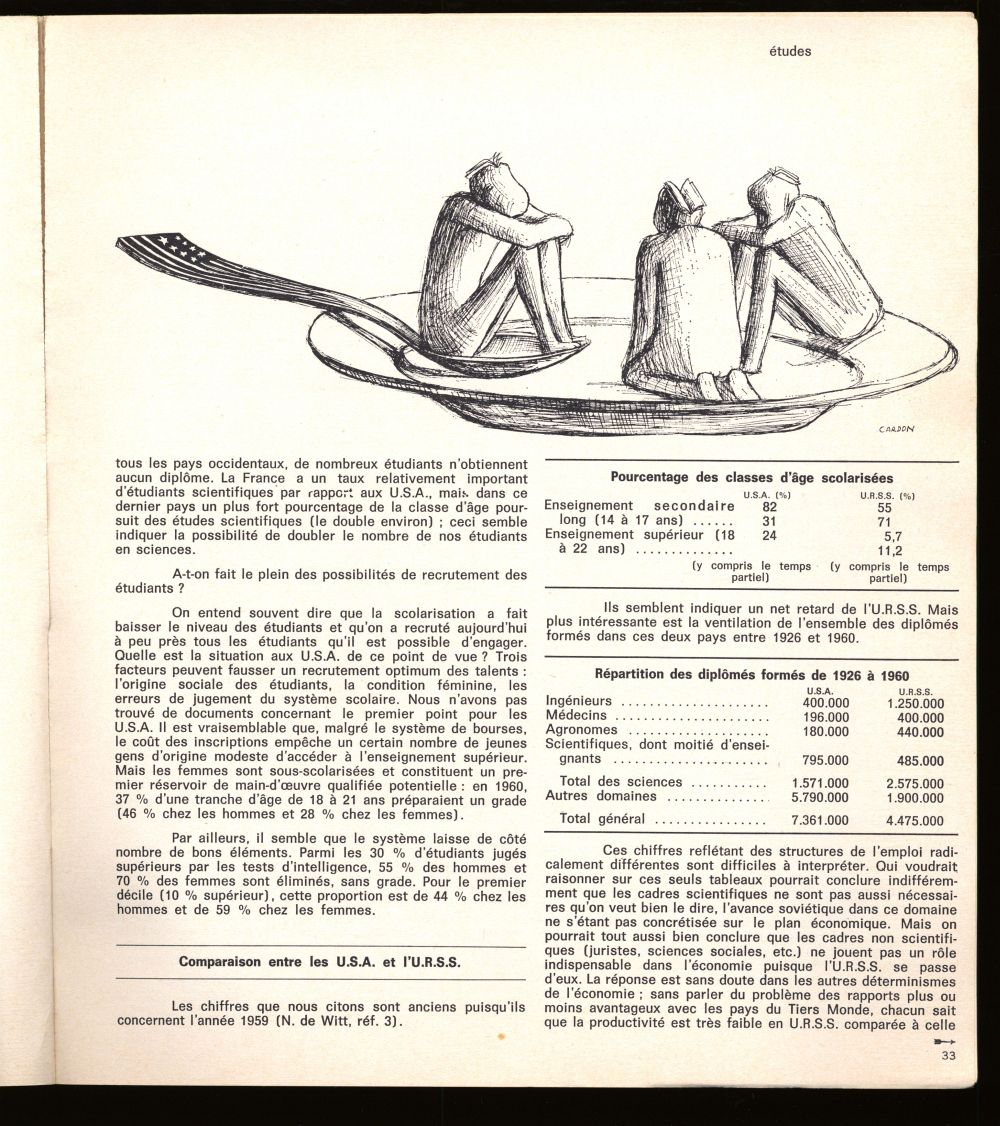

études
tous les pays occidentaux, de nombreux étudiants n'obtiennent
aucun diplôme. La France a un taux relativement important
d'étudiants scientifiques par rapport aux U.S.A., mais dans ce
dernier pays un plus fort pourcentage de la classe d'âge pour-
suit des études scientifiques (le double environ) ; ceci semble
indiquer la possibilité de doubler le nombre de nos étudiants
en sciences.
aucun diplôme. La France a un taux relativement important
d'étudiants scientifiques par rapport aux U.S.A., mais dans ce
dernier pays un plus fort pourcentage de la classe d'âge pour-
suit des études scientifiques (le double environ) ; ceci semble
indiquer la possibilité de doubler le nombre de nos étudiants
en sciences.
A-t-on fait le plein des possibilités de recrutement des
étudiants ?
étudiants ?
On entend souvent dire que la scolarisation a fait
baisser le niveau des étudiants et qu'on a recruté aujourd'hui
à peu près tous les étudiants qu'il est possible d'engager.
Quelle est la situation aux U.S.A. de ce point de vue ? Trois
facteurs peuvent fausser un recrutement optimum des talents :
l'origine sociale des étudiants, la condition féminine, les
erreurs de jugement du système scolaire. Nous n'avons pas
trouvé de documents concernant le premier point pour les
U.S.A. Il est vraisemblable que, malgré le système de bourses,
le coût des inscriptions empêche un certain nombre de jeunes
gens d'origine modeste d'accéder à l'enseignement supérieur.
Mais les femmes sont sous-scolarisées et constituent un pre-
mier réservoir de main-d'œuvre qualifiée potentielle : en 1960,
37 % d'une tranche d'âge de 18 à 21 ans préparaient un grade
(46 % chez les hommes et 28 % chez les femmes).
baisser le niveau des étudiants et qu'on a recruté aujourd'hui
à peu près tous les étudiants qu'il est possible d'engager.
Quelle est la situation aux U.S.A. de ce point de vue ? Trois
facteurs peuvent fausser un recrutement optimum des talents :
l'origine sociale des étudiants, la condition féminine, les
erreurs de jugement du système scolaire. Nous n'avons pas
trouvé de documents concernant le premier point pour les
U.S.A. Il est vraisemblable que, malgré le système de bourses,
le coût des inscriptions empêche un certain nombre de jeunes
gens d'origine modeste d'accéder à l'enseignement supérieur.
Mais les femmes sont sous-scolarisées et constituent un pre-
mier réservoir de main-d'œuvre qualifiée potentielle : en 1960,
37 % d'une tranche d'âge de 18 à 21 ans préparaient un grade
(46 % chez les hommes et 28 % chez les femmes).
Par ailleurs, il semble que le système laisse de côté
nombre de bons éléments. Parmi les 30 % d'étudiants jugés
supérieurs par les tests d'intelligence, 55 % des hommes et
70 % des femmes sont éliminés, sans grade. Pour le premier
décile (10 % supérieur), cette proportion est de 44 % chez les
hommes et de 59 % chez les femmes.
nombre de bons éléments. Parmi les 30 % d'étudiants jugés
supérieurs par les tests d'intelligence, 55 % des hommes et
70 % des femmes sont éliminés, sans grade. Pour le premier
décile (10 % supérieur), cette proportion est de 44 % chez les
hommes et de 59 % chez les femmes.
Comparaison entre les U.S.A. et l'U.R.S.S.
Les chiffres que nous citons sont anciens puisqu'ils
concernent l'année 1959 (N. de Witt, réf. 3).
concernent l'année 1959 (N. de Witt, réf. 3).
Pourcentage des classes d'âge scolarisées
U.S.A. (%) U.R.S.S. (%)
Enseignement secondaire 82 55
31 71
Enseignement supérieur (18 24 à 22 ans) ..............
5,7 11 2
5,7 11 2
(y compris le temps partiel)
(y compris le temps partiel)
(y compris le temps partiel)
Ils semblent indiquer un net retard de l'U.R.S.S. Mais
plus intéressante est la ventilation de l'ensemble des diplômés
formés dans ces deux pays entre 1926 et 1960.
plus intéressante est la ventilation de l'ensemble des diplômés
formés dans ces deux pays entre 1926 et 1960.
Répartition des diplômés formés de 1926 à 1960
Ingénieurs .....................
Médecins ......................
Agronomes ....................
Scientifiques, dont moitié d'ensei-
gnants ......................
gnants ......................
Total des sciences ...........
Autres domaines ...............
Total général
U.S.A.
400.000
196.000
180.000
400.000
196.000
180.000
795.000
1.571.000
5.790.000
5.790.000
7.361.000
U.R.S.S.
1.250.000
400.000
440.000
400.000
440.000
485.000
2.575.000
1.900.000
1.900.000
4.475.000
Ces chiffres reflétant des structures de l'emploi radi-
calement différentes sont difficiles à interpréter. Qui voudrait
raisonner sur ces seuls tableaux pourrait conclure indifférem-
ment que les cadres scientifiques ne sont pas aussi nécessai-
res qu'on veut bien le dire, l'avance soviétique dans ce domaine
ne s'étant pas concrétisée sur le plan économique. Mais on
pourrait tout aussi bien conclure que les cadres non scientifi-
ques (juristes, sciences sociales, etc.) ne jouent pas un rôle
indispensable dans l'économie puisque l'U.R.S.S. se passe
d'eux. La réponse est sans doute dans les autres déterminismes
de l'économie ; sans parler du problème des rapports plus ou
moins avantageux avec les pays du Tiers Monde, chacun sait
que la productivité est très faible en U.R.S.S. comparée à celle
calement différentes sont difficiles à interpréter. Qui voudrait
raisonner sur ces seuls tableaux pourrait conclure indifférem-
ment que les cadres scientifiques ne sont pas aussi nécessai-
res qu'on veut bien le dire, l'avance soviétique dans ce domaine
ne s'étant pas concrétisée sur le plan économique. Mais on
pourrait tout aussi bien conclure que les cadres non scientifi-
ques (juristes, sciences sociales, etc.) ne jouent pas un rôle
indispensable dans l'économie puisque l'U.R.S.S. se passe
d'eux. La réponse est sans doute dans les autres déterminismes
de l'économie ; sans parler du problème des rapports plus ou
moins avantageux avec les pays du Tiers Monde, chacun sait
que la productivité est très faible en U.R.S.S. comparée à celle
33
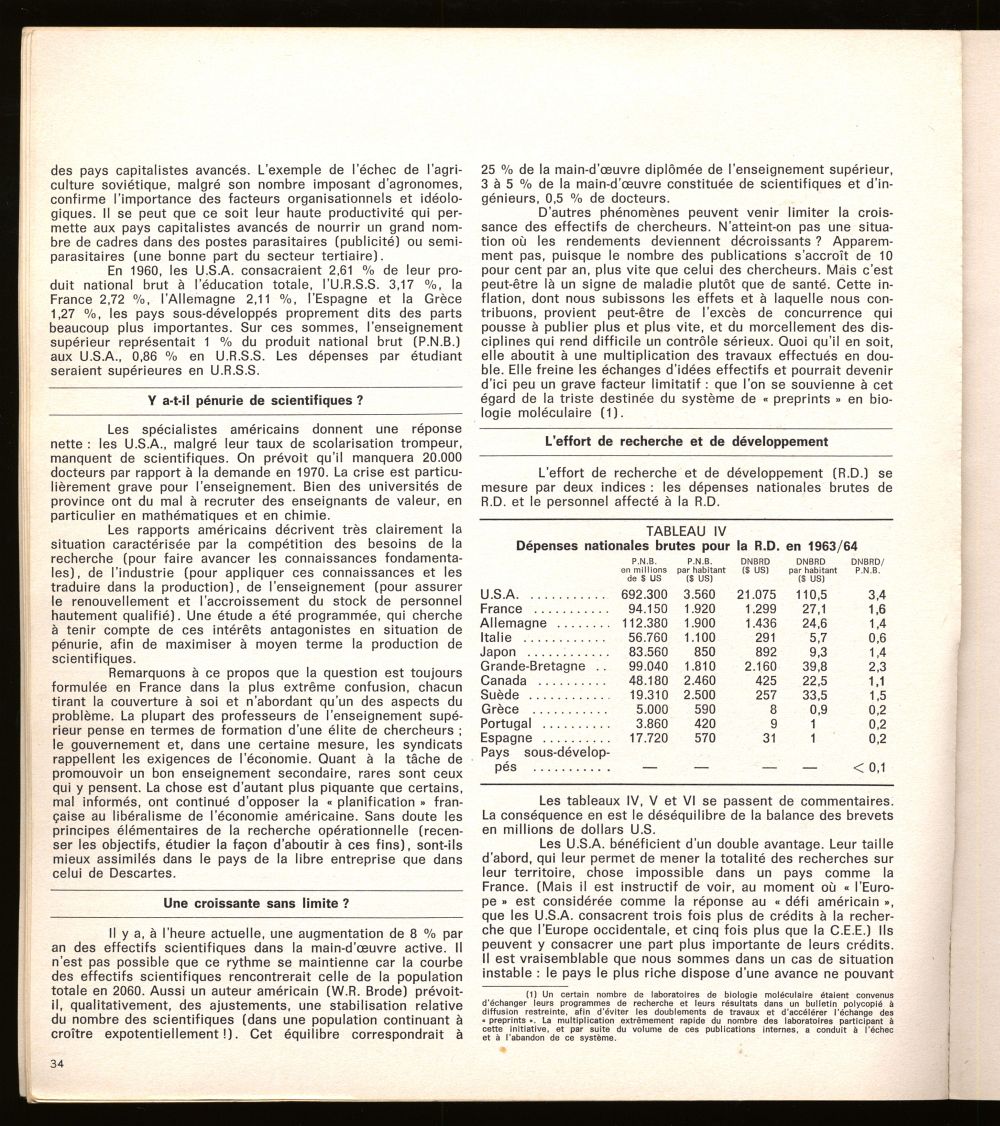

des pays capitalistes avancés. L'exemple de l'échec de l'agri-
culture soviétique, malgré son nombre imposant d'agronomes,
confirme l'importance des facteurs organisationnels et idéolo-
giques. Il se peut que ce soit leur haute productivité qui per-
mette aux pays capitalistes avancés de nourrir un grand nom-
bre de cadres dans des postes parasitaires (publicité) ou semi-
parasitaires (une bonne part du secteur tertiaire).
culture soviétique, malgré son nombre imposant d'agronomes,
confirme l'importance des facteurs organisationnels et idéolo-
giques. Il se peut que ce soit leur haute productivité qui per-
mette aux pays capitalistes avancés de nourrir un grand nom-
bre de cadres dans des postes parasitaires (publicité) ou semi-
parasitaires (une bonne part du secteur tertiaire).
En 1960, les U.S.A. consacraient 2,61 % de leur pro-
duit national brut à l'éducation totale, l'U.R.S.S. 3,17 %, la
France 2,72 %, l'Allemagne 2,11 %, l'Espagne et la Grèce
1,27 %, les pays sous-développés proprement dits des parts
beaucoup plus importantes. Sur ces sommes, l'enseignement
supérieur représentait 1 % du produit national brut (P.N.B.)
aux U.S.A., 0,86 % en U.R.S.S. Les dépenses par étudiant
seraient supérieures en U.R.S.S.
duit national brut à l'éducation totale, l'U.R.S.S. 3,17 %, la
France 2,72 %, l'Allemagne 2,11 %, l'Espagne et la Grèce
1,27 %, les pays sous-développés proprement dits des parts
beaucoup plus importantes. Sur ces sommes, l'enseignement
supérieur représentait 1 % du produit national brut (P.N.B.)
aux U.S.A., 0,86 % en U.R.S.S. Les dépenses par étudiant
seraient supérieures en U.R.S.S.
Y a-t-il pénurie de scientifiques ?
Les spécialistes américains donnent une réponse
nette : les U.S.A., malgré leur taux de scolarisation trompeur,
manquent de scientifiques. On prévoit qu'il manquera 20.000
docteurs par rapport à la demande en 1970. La crise est particu-
lièrement grave pour l'enseignement. Bien des universités de
province ont du mal à recruter des enseignants de valeur, en
particulier en mathématiques et en chimie.
nette : les U.S.A., malgré leur taux de scolarisation trompeur,
manquent de scientifiques. On prévoit qu'il manquera 20.000
docteurs par rapport à la demande en 1970. La crise est particu-
lièrement grave pour l'enseignement. Bien des universités de
province ont du mal à recruter des enseignants de valeur, en
particulier en mathématiques et en chimie.
Les rapports américains décrivent très clairement la
situation caractérisée par la compétition des besoins de la
recherche (pour faire avancer les connaissances fondamenta-
les), de l'industrie (pour appliquer ces connaissances et les
traduire dans la production), de l'enseignement (pour assurer
le renouvellement et l'accroissement du stock de personnel
hautement qualifié). Une étude a été programmée, qui cherche
à tenir compte de ces intérêts antagonistes en situation de
pénurie, afin de maximiser à moyen terme la production de
scientifiques.
situation caractérisée par la compétition des besoins de la
recherche (pour faire avancer les connaissances fondamenta-
les), de l'industrie (pour appliquer ces connaissances et les
traduire dans la production), de l'enseignement (pour assurer
le renouvellement et l'accroissement du stock de personnel
hautement qualifié). Une étude a été programmée, qui cherche
à tenir compte de ces intérêts antagonistes en situation de
pénurie, afin de maximiser à moyen terme la production de
scientifiques.
Remarquons à ce propos que la question est toujours
formulée en France dans la plus extrême confusion, chacun
tirant la couverture à soi et n'abordant qu'un des aspects du
problème. La plupart des professeurs de l'enseignement supé-
rieur pense en termes de formation d'une élite de chercheurs ;
le gouvernement et, dans une certaine mesure, les syndicats
rappellent les exigences de l'économie. Quant à la tâche de
promouvoir un bon enseignement secondaire, rares sont ceux
qui y pensent. La chose est d'autant plus piquante que certains,
mal informés, ont continué d'opposer la « planification » fran-
çaise au libéralisme de l'économie américaine. Sans doute les
principes élémentaires de la recherche opérationnelle (recen-
ser les objectifs, étudier la façon d'aboutir à ces fins), sont-ils
mieux assimilés dans le pays de la libre entreprise que dans
celui de Descartes.
formulée en France dans la plus extrême confusion, chacun
tirant la couverture à soi et n'abordant qu'un des aspects du
problème. La plupart des professeurs de l'enseignement supé-
rieur pense en termes de formation d'une élite de chercheurs ;
le gouvernement et, dans une certaine mesure, les syndicats
rappellent les exigences de l'économie. Quant à la tâche de
promouvoir un bon enseignement secondaire, rares sont ceux
qui y pensent. La chose est d'autant plus piquante que certains,
mal informés, ont continué d'opposer la « planification » fran-
çaise au libéralisme de l'économie américaine. Sans doute les
principes élémentaires de la recherche opérationnelle (recen-
ser les objectifs, étudier la façon d'aboutir à ces fins), sont-ils
mieux assimilés dans le pays de la libre entreprise que dans
celui de Descartes.
Une croissante sans limite ?
Il y a, à l'heure actuelle, une augmentation de 8 % par
an des effectifs scientifiques dans la main-d'œuvre active. Il
n'est pas possible que ce rythme se maintienne car la courbe
des effectifs scientifiques rencontrerait celle de la population
totale en 2060. Aussi un auteur américain (W.R. Brode) prévoit-
il, qualitativement, des ajustements, une stabilisation relative
du nombre des scientifiques (dans une population continuant à
croître expotentiellement !). Cet équilibre correspondrait à
an des effectifs scientifiques dans la main-d'œuvre active. Il
n'est pas possible que ce rythme se maintienne car la courbe
des effectifs scientifiques rencontrerait celle de la population
totale en 2060. Aussi un auteur américain (W.R. Brode) prévoit-
il, qualitativement, des ajustements, une stabilisation relative
du nombre des scientifiques (dans une population continuant à
croître expotentiellement !). Cet équilibre correspondrait à
25 % de la main-d'œuvre diplômée de l'enseignement supérieur,
3 à 5 % de la main-d'œuvre constituée de scientifiques et d'in-
génieurs, 0,5 % de docteurs.
3 à 5 % de la main-d'œuvre constituée de scientifiques et d'in-
génieurs, 0,5 % de docteurs.
D'autres phénomènes peuvent venir limiter la crois-
sance des effectifs de chercheurs. N'atteint-on pas une situa-
tion où les rendements deviennent décroissants ? Apparem-
ment pas, puisque le nombre des publications s'accroît de 10
pour cent par an, plus vite que celui des chercheurs. Mais c'est
peut-être là un signe de maladie plutôt que de santé. Cette in-
flation, dont nous subissons les effets et à laquelle nous con-
tribuons, provient peut-être de l'excès de concurrence qui
pousse à publier plus et plus vite, et du morcellement des dis-
ciplines qui rend difficile un contrôle sérieux. Quoi qu'il en soit,
elle aboutit à une multiplication des travaux effectués en dou-
ble. Elle freine les échanges d'idées effectifs et pourrait devenir
d'ici peu un grave facteur limitatif : que l'on se souvienne à cet
égard de la triste destinée du système de •< preprints » en bio-
logie moléculaire (1).
sance des effectifs de chercheurs. N'atteint-on pas une situa-
tion où les rendements deviennent décroissants ? Apparem-
ment pas, puisque le nombre des publications s'accroît de 10
pour cent par an, plus vite que celui des chercheurs. Mais c'est
peut-être là un signe de maladie plutôt que de santé. Cette in-
flation, dont nous subissons les effets et à laquelle nous con-
tribuons, provient peut-être de l'excès de concurrence qui
pousse à publier plus et plus vite, et du morcellement des dis-
ciplines qui rend difficile un contrôle sérieux. Quoi qu'il en soit,
elle aboutit à une multiplication des travaux effectués en dou-
ble. Elle freine les échanges d'idées effectifs et pourrait devenir
d'ici peu un grave facteur limitatif : que l'on se souvienne à cet
égard de la triste destinée du système de •< preprints » en bio-
logie moléculaire (1).
L'effort de recherche et de développement
L'effort de recherche et de développement (R.D.) se
mesure par deux indices : les dépenses nationales brutes de
R.D. et le personnel affecté à la R.D.
mesure par deux indices : les dépenses nationales brutes de
R.D. et le personnel affecté à la R.D.
TABLEAU IV
Dépenses nationales brutes pour la R.D. en 1963/64
Dépenses nationales brutes pour la R.D. en 1963/64
P. N.B. en millions
P. N.B. par habitant
DNBRD (S US)
DNBRD par habitant
DNBRD/ P. N.B.
P. N.B. par habitant
DNBRD (S US)
DNBRD par habitant
DNBRD/ P. N.B.
de S US
(S US)
(S US)
(S US)
U.S.A ............
692.300
3.560
21.075
110,5
3,4
692.300
3.560
21.075
110,5
3,4
France ...........
94.150
1.920
1.299
27,1
1,6
94.150
1.920
1.299
27,1
1,6
Allemagne ........
112.380
1.900
1.436
24,6
1,4
112.380
1.900
1.436
24,6
1,4
Italie ............
56.760
1.100
291
5,7
0,6
56.760
1.100
291
5,7
0,6
Japon ............
83.560
850
892
9,3
1,4
83.560
850
892
9,3
1,4
Grande-Bretagne . .
99.040
1.810
2.160
39,8
2,3
99.040
1.810
2.160
39,8
2,3
Canada ..........
48.180
2.460
425
22,5
1,1
48.180
2.460
425
22,5
1,1
Suède ............
19.310
2.500
257
33,5
1,5
19.310
2.500
257
33,5
1,5
Grèce ...........
5.000
590
8
0,9
0,2
5.000
590
8
0,9
0,2
Portugal ..........
3.860
420
9
1
0,2
3.860
420
9
1
0,2
Espagne ..........
17.720
570
31
1
0,2
17.720
570
31
1
0,2
Pays sous-dévelop-
pes ...........
*~~
—
—
—
<0,1
*~~
—
—
—
<0,1
Les tableaux IV, V et VI se passent de commentaires.
La conséquence en est le déséquilibre de la balance des brevets
en millions de dollars U.S.
La conséquence en est le déséquilibre de la balance des brevets
en millions de dollars U.S.
Les U.S.A. bénéficient d'un double avantage. Leur taille
d'abord, qui leur permet de mener la totalité des recherches sur
leur territoire, chose impossible dans un pays comme la
France. (Mais il est instructif de voir, au moment où « l'Euro-
pe » est considérée comme la réponse au « défi américain »,
que les U.S.A. consacrent trois fois plus de crédits à la recher-
che que l'Europe occidentale, et cinq fois plus que la C.E.E.) Ils
peuvent y consacrer une part plus importante de leurs crédits.
Il est vraisemblable que nous sommes dans un cas de situation
instable : le pays le plus riche dispose d'une avance ne pouvant
d'abord, qui leur permet de mener la totalité des recherches sur
leur territoire, chose impossible dans un pays comme la
France. (Mais il est instructif de voir, au moment où « l'Euro-
pe » est considérée comme la réponse au « défi américain »,
que les U.S.A. consacrent trois fois plus de crédits à la recher-
che que l'Europe occidentale, et cinq fois plus que la C.E.E.) Ils
peuvent y consacrer une part plus importante de leurs crédits.
Il est vraisemblable que nous sommes dans un cas de situation
instable : le pays le plus riche dispose d'une avance ne pouvant
(1) Un certain nombre de laboratoires de biologie moléculaire étaient convenus
d'échanger leurs programmes de recherche et leurs résultats dans un bulletin polycopié à
diffusion restreinte, afin d'éviter les doublements de travaux et d'accélérer l'échange des
• preprints ». La multiplication extrêmement rapide du nombre des laboratoires participant à
cette initiative, et par suite du volume de ces publications internes, a conduit à l'échec
et à l'abandon de ce système.
d'échanger leurs programmes de recherche et leurs résultats dans un bulletin polycopié à
diffusion restreinte, afin d'éviter les doublements de travaux et d'accélérer l'échange des
• preprints ». La multiplication extrêmement rapide du nombre des laboratoires participant à
cette initiative, et par suite du volume de ces publications internes, a conduit à l'échec
et à l'abandon de ce système.
34
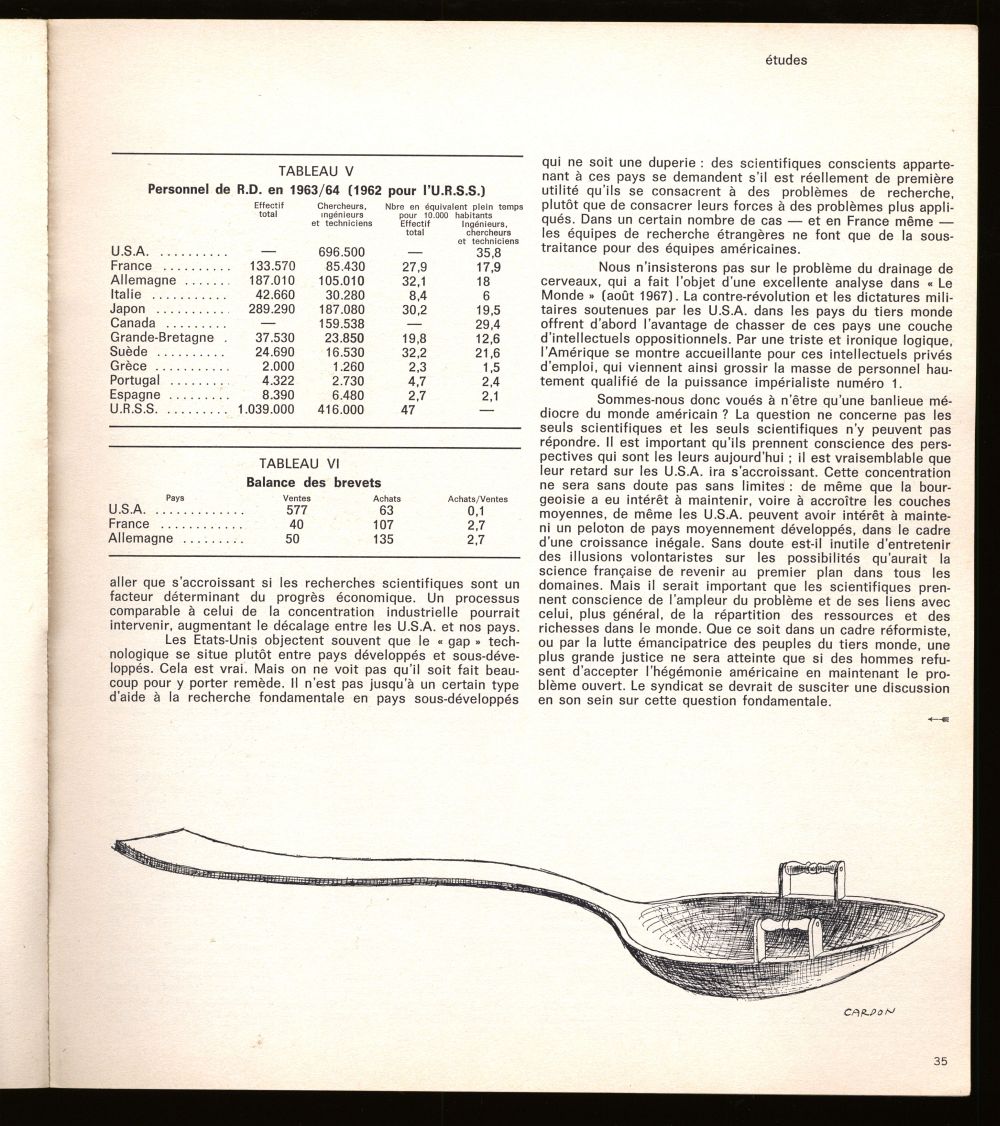

études
TABLEAU V
Personnel de R.D. en 1963/64 (1962 pour l'U.R.S.S.)
Personnel de R.D. en 1963/64 (1962 pour l'U.R.S.S.)
US.A ...........
Effectif total
. 133.570
Chercheurs, ingénieurs et techniciens
696.500 85.430 105.010 30.280 187.080 159.538 23.850 16.530 1.260 2.730 6.480 416.000
Nbre en équivalent plein temps pour 10.000 habitants Effectif Ingénieurs, total chercheurs et techniciens
— 35,8 27,9 17,9 32,1 18 8,4 6 30,2 19,5 — 29,4 19,8 12,6 32,2 21,6 2,3 1,5 4,7 2,4 2,7 2,1 47 —
Effectif total
. 133.570
Chercheurs, ingénieurs et techniciens
696.500 85.430 105.010 30.280 187.080 159.538 23.850 16.530 1.260 2.730 6.480 416.000
Nbre en équivalent plein temps pour 10.000 habitants Effectif Ingénieurs, total chercheurs et techniciens
— 35,8 27,9 17,9 32,1 18 8,4 6 30,2 19,5 — 29,4 19,8 12,6 32,2 21,6 2,3 1,5 4,7 2,4 2,7 2,1 47 —
France .......
Allemagne . . .
. 187.010 42.660 289.290
37.530 24.690 2.000
. 187.010 42.660 289.290
37.530 24.690 2.000
Italie
Japon
Canada
Grande-Bretagne . Suède .........
Grèce .........
Portugal .......
4.322
4.322
Espagne .......
8.390
8.390
URSS . . . ,
1.039.000
1.039.000
TABLEAU VI
Balance des brevets
Balance des brevets
Pays
USA
Ventes
577
Achats
63
Achats/Ventes
0,1
USA
Ventes
577
Achats
63
Achats/Ventes
0,1
France ...........
40
107
2,7
40
107
2,7
Allemagne .....
50
135
2,7
50
135
2,7
aller que s'accroissant si les recherches scientifiques sont un
facteur déterminant du progrès économique. Un processus
comparable à celui de la concentration industrielle pourrait
intervenir, augmentant le décalage entre les U.S.A. et nos pays.
Les Etats-Unis objectent souvent que le « gap » tech-
nologique se situe plutôt entre pays développés et sous-déve-
loppés. Cela est vrai. Mais on ne voit pas qu'il soit fait beau-
coup pour y porter remède. Il n'est pas jusqu'à un certain type
d'aide à la recherche fondamentale en pays sous-développés
facteur déterminant du progrès économique. Un processus
comparable à celui de la concentration industrielle pourrait
intervenir, augmentant le décalage entre les U.S.A. et nos pays.
Les Etats-Unis objectent souvent que le « gap » tech-
nologique se situe plutôt entre pays développés et sous-déve-
loppés. Cela est vrai. Mais on ne voit pas qu'il soit fait beau-
coup pour y porter remède. Il n'est pas jusqu'à un certain type
d'aide à la recherche fondamentale en pays sous-développés
qui ne soit une duperie : des scientifiques conscients apparte-
nant à ces pays se demandent s'il est réellement de première
utilité qu'ils se consacrent à des problèmes de recherche,
plutôt que de consacrer leurs forces à des problèmes plus appli-
qués. Dans un certain nombre de cas — et en France même —
les équipes de recherche étrangères ne font que de la sous-
traitance pour des équipes américaines.
nant à ces pays se demandent s'il est réellement de première
utilité qu'ils se consacrent à des problèmes de recherche,
plutôt que de consacrer leurs forces à des problèmes plus appli-
qués. Dans un certain nombre de cas — et en France même —
les équipes de recherche étrangères ne font que de la sous-
traitance pour des équipes américaines.
Nous n'insisterons pas sur le problème du drainage de
cerveaux, qui a fait l'objet d'une excellente analyse dans « Le
Monde » (août 1967). La contre-révolution et les dictatures mili-
taires soutenues par les U.S.A. dans les pays du tiers monde
offrent d'abord l'avantage de chasser de ces pays une couche
d'intellectuels oppositionnels. Par une triste et ironique logique,
l'Amérique se montre accueillante pour ces intellectuels privés
d'emploi, qui viennent ainsi grossir la masse de personnel hau-
tement qualifié de la puissance impérialiste numéro 1.
cerveaux, qui a fait l'objet d'une excellente analyse dans « Le
Monde » (août 1967). La contre-révolution et les dictatures mili-
taires soutenues par les U.S.A. dans les pays du tiers monde
offrent d'abord l'avantage de chasser de ces pays une couche
d'intellectuels oppositionnels. Par une triste et ironique logique,
l'Amérique se montre accueillante pour ces intellectuels privés
d'emploi, qui viennent ainsi grossir la masse de personnel hau-
tement qualifié de la puissance impérialiste numéro 1.
Sommes-nous donc voués à n'être qu'une banlieue mé-
diocre du monde américain ? La question ne concerne pas les
seuls scientifiques et les seuls scientifiques n'y peuvent pas
répondre. Il est important qu'ils prennent conscience des pers-
pectives qui sont les leurs aujourd'hui ; il est vraisemblable que
leur retard sur les U.S.A. ira s'accroissant. Cette concentration
ne sera sans doute pas sans limites : de même que la bour-
geoisie a eu intérêt à maintenir, voire à accroître les couches
moyennes, de même les U.S.A. peuvent avoir intérêt à mainte-
ni un peloton de pays moyennement développés, dans le cadre
d'une croissance inégale. Sans doute est-il inutile d'entretenir
des illusions volontaristes sur les possibilités qu'aurait la
science française de revenir au premier plan dans tous les
domaines. Mais il serait important que les scientifiques pren-
nent conscience de l'ampleur du problème et de ses liens avec
celui, plus général, de la répartition des ressources et des
richesses dans le monde. Que ce soit dans un cadre réformiste,
ou par la lutte émancipatrice des peuples du tiers monde, une
plus grande justice ne sera atteinte que si des hommes refu-
sent d'accepter l'hégémonie américaine en maintenant le pro-
blème ouvert. Le syndicat se devrait de susciter une discussion
en son sein sur cette question fondamentale.
diocre du monde américain ? La question ne concerne pas les
seuls scientifiques et les seuls scientifiques n'y peuvent pas
répondre. Il est important qu'ils prennent conscience des pers-
pectives qui sont les leurs aujourd'hui ; il est vraisemblable que
leur retard sur les U.S.A. ira s'accroissant. Cette concentration
ne sera sans doute pas sans limites : de même que la bour-
geoisie a eu intérêt à maintenir, voire à accroître les couches
moyennes, de même les U.S.A. peuvent avoir intérêt à mainte-
ni un peloton de pays moyennement développés, dans le cadre
d'une croissance inégale. Sans doute est-il inutile d'entretenir
des illusions volontaristes sur les possibilités qu'aurait la
science française de revenir au premier plan dans tous les
domaines. Mais il serait important que les scientifiques pren-
nent conscience de l'ampleur du problème et de ses liens avec
celui, plus général, de la répartition des ressources et des
richesses dans le monde. Que ce soit dans un cadre réformiste,
ou par la lutte émancipatrice des peuples du tiers monde, une
plus grande justice ne sera atteinte que si des hommes refu-
sent d'accepter l'hégémonie américaine en maintenant le pro-
blème ouvert. Le syndicat se devrait de susciter une discussion
en son sein sur cette question fondamentale.
35
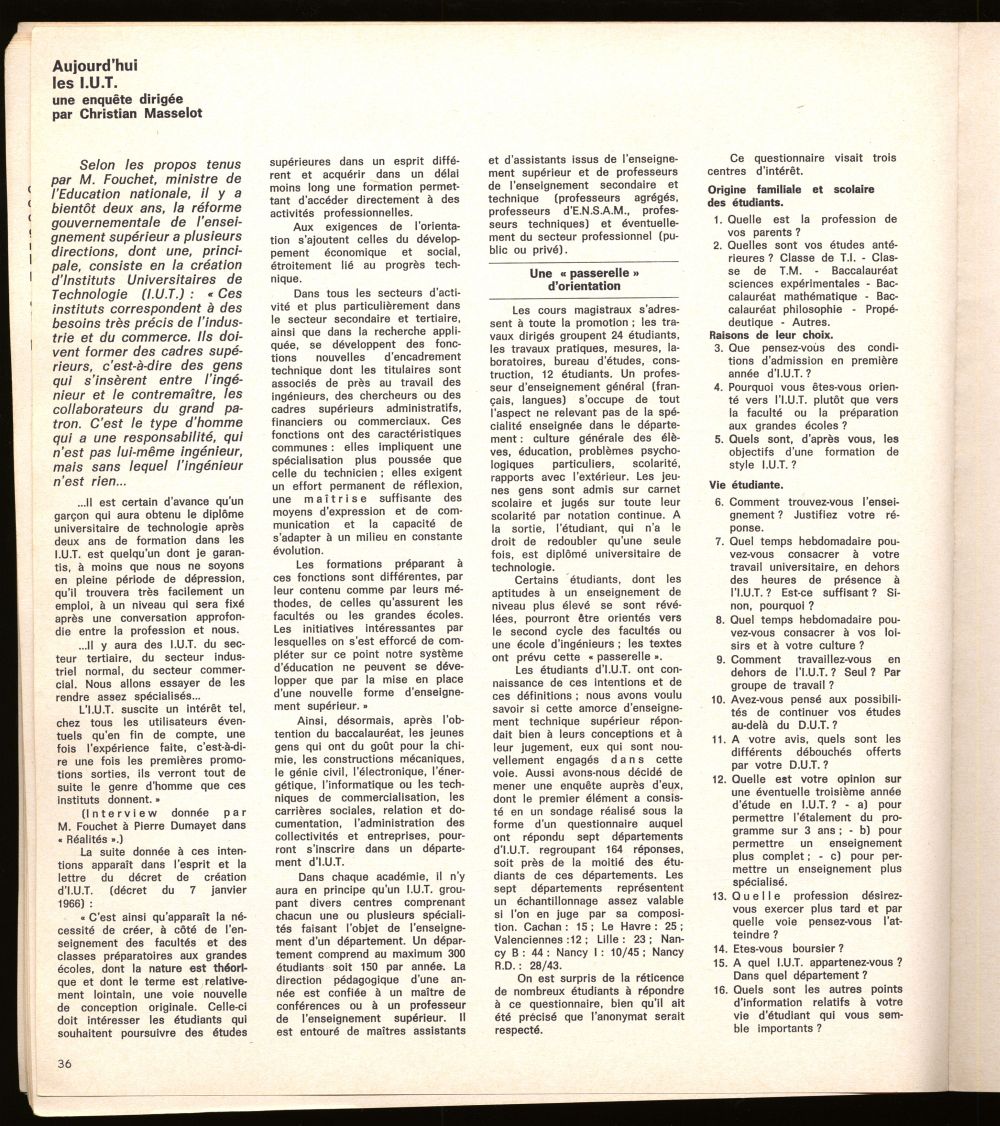

Aujourd'hui
les I.U.T.
les I.U.T.
une enquête dirigée
par Christian Masselot
par Christian Masselot
Selon les propos tenus
par M. Fouchet, ministre de
l'Education nationale, il y a
bientôt deux ans, la réforme
gouvernementale de l'ensei-
gnement supérieur a plusieurs
directions, dont une, princi-
pale, consiste en la création
d'Instituts Universitaires de
Technologie (I.U.T.) : « Ces
instituts correspondent à des
besoins très précis de l'indus-
trie et du commerce. Ils doi-
vent former des cadres supé-
rieurs, c'est-à-dire des gens
qui s'insèrent entre l'ingé-
nieur et le contremaître, les
collaborateurs du grand pa-
tron. C'est le type d'homme
qui a une responsabilité, qui
n'est pas lui-même ingénieur,
mais sans lequel l'ingénieur
n'est rien...
par M. Fouchet, ministre de
l'Education nationale, il y a
bientôt deux ans, la réforme
gouvernementale de l'ensei-
gnement supérieur a plusieurs
directions, dont une, princi-
pale, consiste en la création
d'Instituts Universitaires de
Technologie (I.U.T.) : « Ces
instituts correspondent à des
besoins très précis de l'indus-
trie et du commerce. Ils doi-
vent former des cadres supé-
rieurs, c'est-à-dire des gens
qui s'insèrent entre l'ingé-
nieur et le contremaître, les
collaborateurs du grand pa-
tron. C'est le type d'homme
qui a une responsabilité, qui
n'est pas lui-même ingénieur,
mais sans lequel l'ingénieur
n'est rien...
...Il est certain d'avance qu'un
garçon qui aura obtenu le diplôme
universitaire de technologie après
deux ans de formation dans les
I.U.T. est quelqu'un dont je garan-
tis, à moins que nous ne soyons
en pleine période de dépression,
qu'il trouvera très facilement un
emploi, à un niveau qui sera fixé
après une conversation approfon-
die entre la profession et nous.
garçon qui aura obtenu le diplôme
universitaire de technologie après
deux ans de formation dans les
I.U.T. est quelqu'un dont je garan-
tis, à moins que nous ne soyons
en pleine période de dépression,
qu'il trouvera très facilement un
emploi, à un niveau qui sera fixé
après une conversation approfon-
die entre la profession et nous.
...Il y aura des I.U.T. du sec-
teur tertiaire, du secteur indus-
triel normal, du secteur commer-
cial. Nous allons essayer de les
rendre assez spécialisés...
teur tertiaire, du secteur indus-
triel normal, du secteur commer-
cial. Nous allons essayer de les
rendre assez spécialisés...
L'I.U.T. suscite un intérêt tel,
chez tous les utilisateurs éven-
tuels qu'en fin de compte, une
fois l'expérience faite, c'est-à-di-
re une fois les premières promo-
tions sorties, ils verront tout de
suite le genre d'homme que ces
instituts donnent. »
chez tous les utilisateurs éven-
tuels qu'en fin de compte, une
fois l'expérience faite, c'est-à-di-
re une fois les premières promo-
tions sorties, ils verront tout de
suite le genre d'homme que ces
instituts donnent. »
(Interview donnée par
M. Fouchet à Pierre Dumayet dans
« Réalités ».)
M. Fouchet à Pierre Dumayet dans
« Réalités ».)
La suite donnée à ces inten-
tions apparaît dans l'esprit et la
lettre du décret de création
d'I.U.T. (décret du 7 janvier
1966) :
tions apparaît dans l'esprit et la
lettre du décret de création
d'I.U.T. (décret du 7 janvier
1966) :
« C'est ainsi qu'apparaît la né-
cessité de créer, à côté de l'en-
seignement des facultés et des
classes préparatoires aux grandes
écoles, dont la nature est théori-
que et dont le terme est relative-
ment lointain, une voie nouvelle
de conception originale. Celle-ci
doit intéresser les étudiants qui
souhaitent poursuivre des études
cessité de créer, à côté de l'en-
seignement des facultés et des
classes préparatoires aux grandes
écoles, dont la nature est théori-
que et dont le terme est relative-
ment lointain, une voie nouvelle
de conception originale. Celle-ci
doit intéresser les étudiants qui
souhaitent poursuivre des études
supérieures dans un esprit diffé-
rent et acquérir dans un délai
moins long une formation permet-
tant d'accéder directement à des
activités professionnelles.
rent et acquérir dans un délai
moins long une formation permet-
tant d'accéder directement à des
activités professionnelles.
Aux exigences de l'orienta-
tion s'ajoutent celles du dévelop-
pement économique et social,
étroitement lié au progrès tech-
nique.
tion s'ajoutent celles du dévelop-
pement économique et social,
étroitement lié au progrès tech-
nique.
Dans tous les secteurs d'acti-
vité et plus particulièrement dans
le secteur secondaire et tertiaire,
ainsi que dans la recherche appli-
quée, se développent des fonc-
tions nouvelles d'encadrement
technique dont les titulaires sont
associés de près au travail des
ingénieurs, des chercheurs ou des
cadres supérieurs administratifs,
financiers ou commerciaux. Ces
fonctions ont des caractéristiques
communes : elles impliquent une
spécialisation plus poussée que
celle du technicien ; elles exigent
un effort permanent de réflexion,
une maîtrise suffisante des
moyens d'expression et de com-
munication et la capacité de
s'adapter à un milieu en constante
évolution.
vité et plus particulièrement dans
le secteur secondaire et tertiaire,
ainsi que dans la recherche appli-
quée, se développent des fonc-
tions nouvelles d'encadrement
technique dont les titulaires sont
associés de près au travail des
ingénieurs, des chercheurs ou des
cadres supérieurs administratifs,
financiers ou commerciaux. Ces
fonctions ont des caractéristiques
communes : elles impliquent une
spécialisation plus poussée que
celle du technicien ; elles exigent
un effort permanent de réflexion,
une maîtrise suffisante des
moyens d'expression et de com-
munication et la capacité de
s'adapter à un milieu en constante
évolution.
Les formations préparant à
ces fonctions sont différentes, par
leur contenu comme par leurs mé-
thodes, de celles qu'assurent les
facultés ou les grandes écoles.
Les initiatives intéressantes par
lesquelles on s'est efforcé de com-
pléter sur ce point notre système
d'éducation ne peuvent se déve-
lopper que par la mise en place
d'une nouvelle forme d'enseigne-
ment supérieur. »
ces fonctions sont différentes, par
leur contenu comme par leurs mé-
thodes, de celles qu'assurent les
facultés ou les grandes écoles.
Les initiatives intéressantes par
lesquelles on s'est efforcé de com-
pléter sur ce point notre système
d'éducation ne peuvent se déve-
lopper que par la mise en place
d'une nouvelle forme d'enseigne-
ment supérieur. »
Ainsi, désormais, après l'ob-
tention du baccalauréat, les jeunes
gens qui ont du goût pour la chi-
mie, les constructions mécaniques,
le génie civil, l'électronique, l'éner-
gétique, l'informatique ou les tech-
niques de commercialisation, les
carrières sociales, relation et do-
cumentation, l'administration des
collectivités et entreprises, pour-
ront s'inscrire dans un départe-
ment d'I.U.T.
tention du baccalauréat, les jeunes
gens qui ont du goût pour la chi-
mie, les constructions mécaniques,
le génie civil, l'électronique, l'éner-
gétique, l'informatique ou les tech-
niques de commercialisation, les
carrières sociales, relation et do-
cumentation, l'administration des
collectivités et entreprises, pour-
ront s'inscrire dans un départe-
ment d'I.U.T.
Dans chaque académie, il n'y
aura en principe qu'un I.U.T. grou-
pant divers centres comprenant
chacun une ou plusieurs spéciali-
tés faisant l'objet de l'enseigne-
ment d'un département. Un dépar-
tement comprend au maximum 300
étudiants soit 150 par année. La
direction pédagogique d'une an-
née est confiée à un maître de
conférences ou à un professeur
de l'enseignement supérieur. Il
est entouré de maîtres assistants
aura en principe qu'un I.U.T. grou-
pant divers centres comprenant
chacun une ou plusieurs spéciali-
tés faisant l'objet de l'enseigne-
ment d'un département. Un dépar-
tement comprend au maximum 300
étudiants soit 150 par année. La
direction pédagogique d'une an-
née est confiée à un maître de
conférences ou à un professeur
de l'enseignement supérieur. Il
est entouré de maîtres assistants
et d'assistants issus de l'enseigne-
ment supérieur et de professeurs
de l'enseignement secondaire et
technique (professeurs agrégés,
professeurs d'E.N.S.A.M., profes-
seurs techniques) et éventuelle-
ment du secteur professionnel (pu-
blic ou privé).
ment supérieur et de professeurs
de l'enseignement secondaire et
technique (professeurs agrégés,
professeurs d'E.N.S.A.M., profes-
seurs techniques) et éventuelle-
ment du secteur professionnel (pu-
blic ou privé).
Une « passerelle »
d'orientation
d'orientation
Les cours magistraux s'adres-
sent à toute la promotion ; les tra-
vaux dirigés groupent 24 étudiants,
les travaux pratiques, mesures, la-
boratoires, bureau d'études, cons-
truction, 12 étudiants. Un profes-
seur d'enseignement général (fran-
çais, langues) s'occupe de tout
l'aspect ne relevant pas de la spé-
cialité enseignée dans le départe-
ment : culture générale des élè-
ves, éducation, problèmes psycho-
logiques particuliers, scolarité,
rapports avec l'extérieur. Les jeu-
nes gens sont admis sur carnet
scolaire et jugés sur toute leur
scolarité par notation continue. A
la sortie, l'étudiant, qui n'a le
droit de redoubler qu'une seule
fois, est diplômé universitaire de
technologie.
sent à toute la promotion ; les tra-
vaux dirigés groupent 24 étudiants,
les travaux pratiques, mesures, la-
boratoires, bureau d'études, cons-
truction, 12 étudiants. Un profes-
seur d'enseignement général (fran-
çais, langues) s'occupe de tout
l'aspect ne relevant pas de la spé-
cialité enseignée dans le départe-
ment : culture générale des élè-
ves, éducation, problèmes psycho-
logiques particuliers, scolarité,
rapports avec l'extérieur. Les jeu-
nes gens sont admis sur carnet
scolaire et jugés sur toute leur
scolarité par notation continue. A
la sortie, l'étudiant, qui n'a le
droit de redoubler qu'une seule
fois, est diplômé universitaire de
technologie.
Certains étudiants, dont les
aptitudes à un enseignement de
niveau plus élevé se sont révé-
lées, pourront être orientés vers
le second cycle des facultés ou
une école d'ingénieurs ; les textes
ont prévu cette « passerelle ».
aptitudes à un enseignement de
niveau plus élevé se sont révé-
lées, pourront être orientés vers
le second cycle des facultés ou
une école d'ingénieurs ; les textes
ont prévu cette « passerelle ».
Les étudiants d'I.U.T. ont con-
naissance de ces intentions et de
ces définitions ; nous avons voulu
savoir si cette amorce d'enseigne-
ment technique supérieur répon-
dait bien à leurs conceptions et à
leur jugement, eux qui sont nou-
vellement engagés dans cette
voie. Aussi avons-nous décidé de
mener une enquête auprès d'eux,
dont le premier élément a consis-
té en un sondage réalisé sous la
forme d'un questionnaire auquel
ont répondu sept départements
d'I.U.T. regroupant 164 réponses,
soit près de la moitié des étu-
diants de ces départements. Les
sept départements représentent
un échantillonnage assez valable
si l'on en juge par sa composi-
tion. Cachan : 15 ; Le Havre : 25 ;
Valenciennes :12 ; Lille: 23; Nan-
cy B : 44 : Nancy I : 10/45 ; Nancy
R.D.: 28/43.
naissance de ces intentions et de
ces définitions ; nous avons voulu
savoir si cette amorce d'enseigne-
ment technique supérieur répon-
dait bien à leurs conceptions et à
leur jugement, eux qui sont nou-
vellement engagés dans cette
voie. Aussi avons-nous décidé de
mener une enquête auprès d'eux,
dont le premier élément a consis-
té en un sondage réalisé sous la
forme d'un questionnaire auquel
ont répondu sept départements
d'I.U.T. regroupant 164 réponses,
soit près de la moitié des étu-
diants de ces départements. Les
sept départements représentent
un échantillonnage assez valable
si l'on en juge par sa composi-
tion. Cachan : 15 ; Le Havre : 25 ;
Valenciennes :12 ; Lille: 23; Nan-
cy B : 44 : Nancy I : 10/45 ; Nancy
R.D.: 28/43.
On est surpris de la réticence
de nombreux étudiants à répondre
à ce questionnaire, bien qu'il ait
été précisé que l'anonymat serait
respecté.
de nombreux étudiants à répondre
à ce questionnaire, bien qu'il ait
été précisé que l'anonymat serait
respecté.
Ce questionnaire visait trois
centres d'intérêt.
centres d'intérêt.
Origine familiale et scolaire
des étudiants.
des étudiants.
1. Quelle est la profession de
vos parents ?
vos parents ?
2. Quelles sont vos études anté-
rieures ? Classe de T.l. - Clas-
se de T.M. - Baccalauréat
sciences expérimentales - Bac-
calauréat mathématique - Bac-
calauréat philosophie - Propé-
deutique - Autres.
rieures ? Classe de T.l. - Clas-
se de T.M. - Baccalauréat
sciences expérimentales - Bac-
calauréat mathématique - Bac-
calauréat philosophie - Propé-
deutique - Autres.
Raisons de leur choix.
3. Que pensez-vous des condi-
tions d'admission en première
année d'I.U.T.?
tions d'admission en première
année d'I.U.T.?
4. Pourquoi vous êtes-vous orien-
té vers I'I.U.T. plutôt que vers
la faculté ou la préparation
aux grandes écoles ?
té vers I'I.U.T. plutôt que vers
la faculté ou la préparation
aux grandes écoles ?
5. Quels sont, d'après vous, les
objectifs d'une formation de
style I.U.T. ?
objectifs d'une formation de
style I.U.T. ?
Vie étudiante.
6. Comment trouvez-vous l'ensei-
gnement ? Justifiez votre ré-
ponse.
gnement ? Justifiez votre ré-
ponse.
7. Quel temps hebdomadaire pou-
vez-vous consacrer à votre
travail universitaire, en dehors
des heures de présence à
l'I.U.T. ? Est-ce suffisant ? Si-
non, pourquoi ?
vez-vous consacrer à votre
travail universitaire, en dehors
des heures de présence à
l'I.U.T. ? Est-ce suffisant ? Si-
non, pourquoi ?
8. Quel temps hebdomadaire pou-
vez-vous consacrer à vos loi-
sirs et à votre culture ?
vez-vous consacrer à vos loi-
sirs et à votre culture ?
9. Comment travaillez-vous en
dehors de l'I.U.T.? Seul? Par
groupe de travail ?
dehors de l'I.U.T.? Seul? Par
groupe de travail ?
10. Avez-vous pensé aux possibili-
tés de continuer vos études
au-delà du D.U.T. ?
tés de continuer vos études
au-delà du D.U.T. ?
11. A votre avis, quels sont les
différents débouchés offerts
par votre D.U.T. ?
différents débouchés offerts
par votre D.U.T. ?
12. Quelle est votre opinion sur
une éventuelle troisième année
d'étude en I.U.T. ? - a) pour
permettre l'étalement du pro-
gramme sur 3 ans ; - b) pour
permettre un enseignement
plus complet ; - c) pour per-
mettre un enseignement plus
spécialisé.
une éventuelle troisième année
d'étude en I.U.T. ? - a) pour
permettre l'étalement du pro-
gramme sur 3 ans ; - b) pour
permettre un enseignement
plus complet ; - c) pour per-
mettre un enseignement plus
spécialisé.
13. Quelle profession désirez-
vous exercer plus tard et par
quelle voie pensez-vous l'at-
teindre ?
vous exercer plus tard et par
quelle voie pensez-vous l'at-
teindre ?
14. Etes-vous boursier ?
15. A quel I.U.T. appartenez-vous ?
Dans quel département ?
Dans quel département ?
16. Quels sont les autres points
d'information relatifs à votre
vie d'étudiant qui vous sem-
ble importants ?
d'information relatifs à votre
vie d'étudiant qui vous sem-
ble importants ?
36
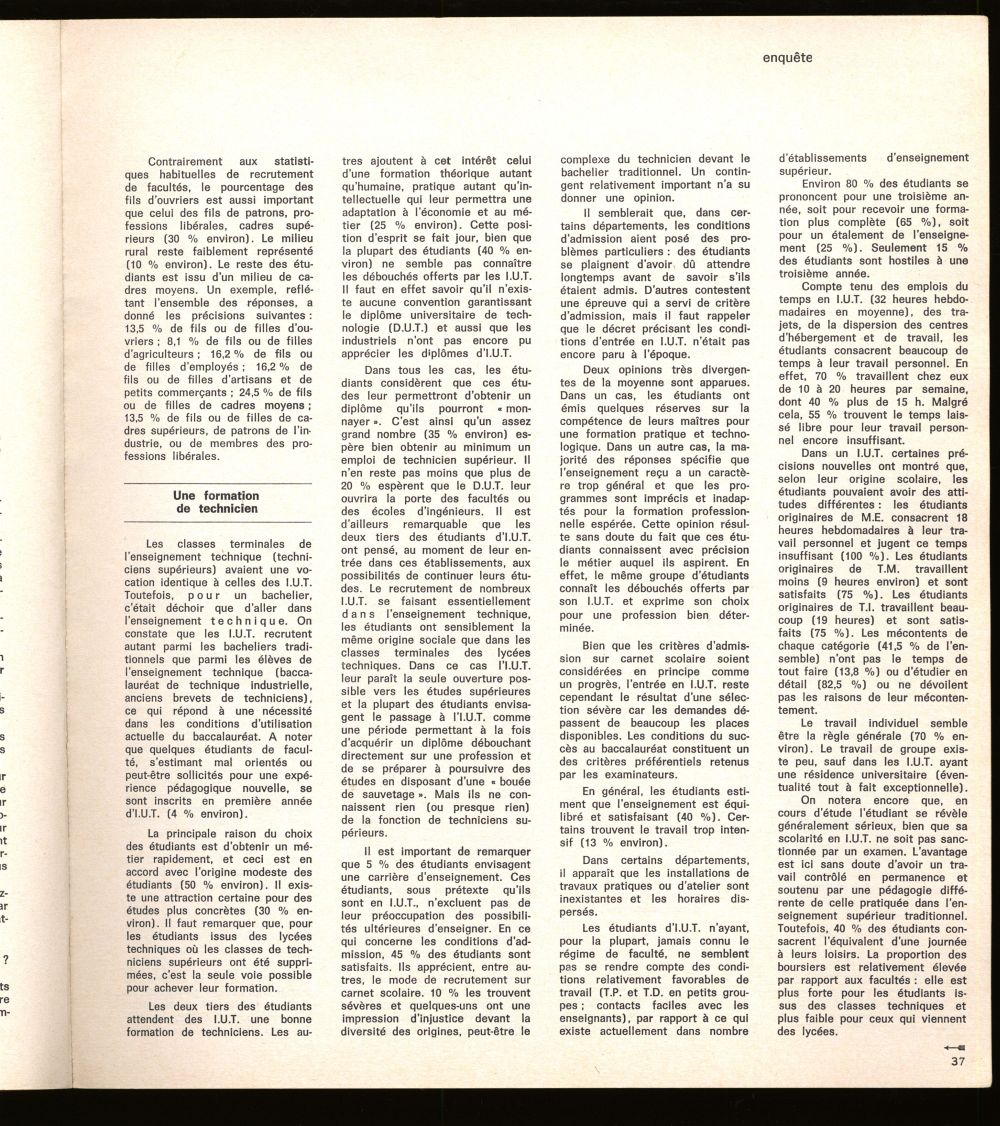

enquête
Contrairement aux statisti-
ques habituelles de recrutement
de facultés, le pourcentage des
fils d'ouvriers est aussi important
que celui des fils de patrons, pro-
fessions libérales, cadres supé-
rieurs (30 % environ). Le milieu
rural reste faiblement représenté
(10 % environ). Le reste des étu-
diants est issu d'un milieu de ca-
dres moyens. Un exemple, reflé-
tant l'ensemble des réponses, a
donné les précisions suivantes :
13,5 % de fils ou de filles d'ou-
vriers ; 8,1 % de fils ou de filles
d'agriculteurs; 16,2% de fils ou
de filles d'employés ; 16,2 % de
fils ou de filles d'artisans et de
petits commerçants ; 24,5 % de fils
ou de filles de cadres moyens ;
13,5 % de fils ou de filles de ca-
dres supérieurs, de patrons de l'in-
dustrie, ou de membres des pro-
fessions libérales.
ques habituelles de recrutement
de facultés, le pourcentage des
fils d'ouvriers est aussi important
que celui des fils de patrons, pro-
fessions libérales, cadres supé-
rieurs (30 % environ). Le milieu
rural reste faiblement représenté
(10 % environ). Le reste des étu-
diants est issu d'un milieu de ca-
dres moyens. Un exemple, reflé-
tant l'ensemble des réponses, a
donné les précisions suivantes :
13,5 % de fils ou de filles d'ou-
vriers ; 8,1 % de fils ou de filles
d'agriculteurs; 16,2% de fils ou
de filles d'employés ; 16,2 % de
fils ou de filles d'artisans et de
petits commerçants ; 24,5 % de fils
ou de filles de cadres moyens ;
13,5 % de fils ou de filles de ca-
dres supérieurs, de patrons de l'in-
dustrie, ou de membres des pro-
fessions libérales.
Une formation
de technicien
de technicien
Les classes terminales de
l'enseignement technique (techni-
ciens supérieurs) avaient une vo-
cation identique à celles des I.U.T.
Toutefois, pour un bachelier,
c'était déchoir que d'aller dans
l'enseignement technique. On
constate que les I.U.T. recrutent
autant parmi les bacheliers tradi-
tionnels que parmi les élèves de
l'enseignement technique (bacca-
lauréat de technique industrielle,
anciens brevets de techniciens),
ce qui répond à une nécessité
dans les conditions d'utilisation
actuelle du baccalauréat. A noter
que quelques étudiants de facul-
té, s'estimant mal orientés ou
peut-être sollicités pour une expé-
rience pédagogique nouvelle, se
sont inscrits en première année
d'I.U.T. (4 % environ).
l'enseignement technique (techni-
ciens supérieurs) avaient une vo-
cation identique à celles des I.U.T.
Toutefois, pour un bachelier,
c'était déchoir que d'aller dans
l'enseignement technique. On
constate que les I.U.T. recrutent
autant parmi les bacheliers tradi-
tionnels que parmi les élèves de
l'enseignement technique (bacca-
lauréat de technique industrielle,
anciens brevets de techniciens),
ce qui répond à une nécessité
dans les conditions d'utilisation
actuelle du baccalauréat. A noter
que quelques étudiants de facul-
té, s'estimant mal orientés ou
peut-être sollicités pour une expé-
rience pédagogique nouvelle, se
sont inscrits en première année
d'I.U.T. (4 % environ).
La principale raison du choix
des étudiants est d'obtenir un mé-
tier rapidement, et ceci est en
accord avec l'origine modeste des
étudiants (50 % environ). Il exis-
te une attraction certaine pour des
études plus concrètes (30 % en-
viron). Il faut remarquer que, pour
les étudiants issus des lycées
techniques où les classes de tech-
niciens supérieurs ont été suppri-
mées, c'est la seule voie possible
pour achever leur formation.
des étudiants est d'obtenir un mé-
tier rapidement, et ceci est en
accord avec l'origine modeste des
étudiants (50 % environ). Il exis-
te une attraction certaine pour des
études plus concrètes (30 % en-
viron). Il faut remarquer que, pour
les étudiants issus des lycées
techniques où les classes de tech-
niciens supérieurs ont été suppri-
mées, c'est la seule voie possible
pour achever leur formation.
Les deux tiers des étudiants
attendent des I.U.T. une bonne
formation de techniciens. Les au-
attendent des I.U.T. une bonne
formation de techniciens. Les au-
tres ajoutent à cet intérêt celui
d'une formation théorique autant
qu'humaine, pratique autant qu'in-
tellectuelle qui leur permettra une
adaptation à l'économie et au mé-
tier (25 % environ). Cette posi-
tion d'esprit se fait jour, bien que
la plupart des étudiants (40 % en-
viron) ne semble pas connaître
les débouchés offerts par les I.U.T.
Il faut en effet savoir qu'il n'exis-
te aucune convention garantissant
le diplôme universitaire de tech-
nologie (D.U.T.) et aussi que les
industriels n'ont pas encore pu
apprécier les diplômes d'I.U.T.
d'une formation théorique autant
qu'humaine, pratique autant qu'in-
tellectuelle qui leur permettra une
adaptation à l'économie et au mé-
tier (25 % environ). Cette posi-
tion d'esprit se fait jour, bien que
la plupart des étudiants (40 % en-
viron) ne semble pas connaître
les débouchés offerts par les I.U.T.
Il faut en effet savoir qu'il n'exis-
te aucune convention garantissant
le diplôme universitaire de tech-
nologie (D.U.T.) et aussi que les
industriels n'ont pas encore pu
apprécier les diplômes d'I.U.T.
Dans tous les cas, les étu-
diants considèrent que ces étu-
des leur permettront d'obtenir un
diplôme qu'ils pourront « mon-
nayer ». C'est ainsi qu'un assez
grand nombre (35 % environ) es-
père bien obtenir au minimum un
emploi de technicien supérieur. Il
n'en reste pas moins que plus de
20 % espèrent que le D.U.T. leur
ouvrira la porte des facultés ou
des écoles d'ingénieurs. Il est
d'ailleurs remarquable que les
deux tiers des étudiants d'I.U.T.
ont pensé, au moment de leur en-
trée dans ces établissements, aux
possibilités de continuer leurs étu-
des. Le recrutement de nombreux
I.U.T. se faisant essentiellement
dans l'enseignement technique,
les étudiants ont sensiblement la
même origine sociale que dans les
classes terminales des lycées
techniques. Dans ce cas l'I.U.T.
leur paraît la seule ouverture pos-
sible vers les études supérieures
et la plupart des étudiants envisa-
gent le passage à l'I.U.T. comme
une période permettant à la fois
d'acquérir un diplôme débouchant
directement sur une profession et
de se préparer à poursuivre des
études en disposant d'une « bouée
de sauvetage ». Mais ils ne con-
naissent rien (ou presque rien)
de la fonction de techniciens su-
périeurs.
diants considèrent que ces étu-
des leur permettront d'obtenir un
diplôme qu'ils pourront « mon-
nayer ». C'est ainsi qu'un assez
grand nombre (35 % environ) es-
père bien obtenir au minimum un
emploi de technicien supérieur. Il
n'en reste pas moins que plus de
20 % espèrent que le D.U.T. leur
ouvrira la porte des facultés ou
des écoles d'ingénieurs. Il est
d'ailleurs remarquable que les
deux tiers des étudiants d'I.U.T.
ont pensé, au moment de leur en-
trée dans ces établissements, aux
possibilités de continuer leurs étu-
des. Le recrutement de nombreux
I.U.T. se faisant essentiellement
dans l'enseignement technique,
les étudiants ont sensiblement la
même origine sociale que dans les
classes terminales des lycées
techniques. Dans ce cas l'I.U.T.
leur paraît la seule ouverture pos-
sible vers les études supérieures
et la plupart des étudiants envisa-
gent le passage à l'I.U.T. comme
une période permettant à la fois
d'acquérir un diplôme débouchant
directement sur une profession et
de se préparer à poursuivre des
études en disposant d'une « bouée
de sauvetage ». Mais ils ne con-
naissent rien (ou presque rien)
de la fonction de techniciens su-
périeurs.
Il est important de remarquer
que 5 % des étudiants envisagent
une carrière d'enseignement. Ces
étudiants, sous prétexte qu'ils
sont en I.U.T., n'excluent pas de
leur préoccupation des possibili-
tés ultérieures d'enseigner. En ce
qui concerne les conditions d'ad-
mission, 45 % des étudiants sont
satisfaits. Ils apprécient, entre au-
tres, le mode de recrutement sur
carnet scolaire. 10 % les trouvent
sévères et quelques-uns ont une
impression d'injustice devant la
diversité des origines, peut-être le
que 5 % des étudiants envisagent
une carrière d'enseignement. Ces
étudiants, sous prétexte qu'ils
sont en I.U.T., n'excluent pas de
leur préoccupation des possibili-
tés ultérieures d'enseigner. En ce
qui concerne les conditions d'ad-
mission, 45 % des étudiants sont
satisfaits. Ils apprécient, entre au-
tres, le mode de recrutement sur
carnet scolaire. 10 % les trouvent
sévères et quelques-uns ont une
impression d'injustice devant la
diversité des origines, peut-être le
complexe du technicien devant le
bachelier traditionnel. Un contin-
gent relativement important n'a su
donner une opinion.
bachelier traditionnel. Un contin-
gent relativement important n'a su
donner une opinion.
Il semblerait que, dans cer-
tains départements, les conditions
d'admission aient posé des pro-
blèmes particuliers : des étudiants
se plaignent d'avoir dû attendre
longtemps avant de savoir s'ils
étaient admis. D'autres contestent
une épreuve qui a servi de critère
d'admission, mais il faut rappeler
que le décret précisant les condi-
tions d'entrée en I.U.T. n'était pas
encore paru à l'époque.
tains départements, les conditions
d'admission aient posé des pro-
blèmes particuliers : des étudiants
se plaignent d'avoir dû attendre
longtemps avant de savoir s'ils
étaient admis. D'autres contestent
une épreuve qui a servi de critère
d'admission, mais il faut rappeler
que le décret précisant les condi-
tions d'entrée en I.U.T. n'était pas
encore paru à l'époque.
Deux opinions très divergen-
tes de la moyenne sont apparues.
Dans un cas, les étudiants ont
émis quelques réserves sur la
compétence de leurs maîtres pour
une formation pratique et techno-
logique. Dans un autre cas, la ma-
jorité des réponses spécifie que
l'enseignement reçu a un caractè-
re trop général et que les pro-
grammes sont imprécis et inadap-
tés pour la formation profession-
nelle espérée. Cette opinion résul-
te sans doute du fait que ces étu-
diants connaissent avec précision
le métier auquel ils aspirent. En
effet, le même groupe d'étudiants
connaît les débouchés offerts par
son I.U.T. et exprime son choix
pour une profession bien déter-
minée.
tes de la moyenne sont apparues.
Dans un cas, les étudiants ont
émis quelques réserves sur la
compétence de leurs maîtres pour
une formation pratique et techno-
logique. Dans un autre cas, la ma-
jorité des réponses spécifie que
l'enseignement reçu a un caractè-
re trop général et que les pro-
grammes sont imprécis et inadap-
tés pour la formation profession-
nelle espérée. Cette opinion résul-
te sans doute du fait que ces étu-
diants connaissent avec précision
le métier auquel ils aspirent. En
effet, le même groupe d'étudiants
connaît les débouchés offerts par
son I.U.T. et exprime son choix
pour une profession bien déter-
minée.
Bien que les critères d'admis-
sion sur carnet scolaire soient
considérées en principe comme
un progrès, l'entrée en I.U.T. reste
cependant le résultat d'une sélec-
tion sévère car les demandes dé-
passent de beaucoup les places
disponibles. Les conditions du suc-
cès au baccalauréat constituent un
des critères préférentiels retenus
par les examinateurs.
sion sur carnet scolaire soient
considérées en principe comme
un progrès, l'entrée en I.U.T. reste
cependant le résultat d'une sélec-
tion sévère car les demandes dé-
passent de beaucoup les places
disponibles. Les conditions du suc-
cès au baccalauréat constituent un
des critères préférentiels retenus
par les examinateurs.
En général, les étudiants esti-
ment que l'enseignement est équi-
libré et satisfaisant (40 %). Cer-
tains trouvent le travail trop inten-
sif (13 % environ).
ment que l'enseignement est équi-
libré et satisfaisant (40 %). Cer-
tains trouvent le travail trop inten-
sif (13 % environ).
Dans certains départements,
il apparaît que les installations de
travaux pratiques ou d'atelier sont
inexistantes et les horaires dis-
persés.
il apparaît que les installations de
travaux pratiques ou d'atelier sont
inexistantes et les horaires dis-
persés.
Les étudiants d'I.U.T. n'ayant,
pour la plupart, jamais connu le
régime de faculté, ne semblent
pas se rendre compte des condi-
tions relativement favorables de
travail (T.P. et T.D. en petits grou-
pes ; contacts faciles avec les
enseignants), par rapport à ce qui
existe actuellement dans nombre
pour la plupart, jamais connu le
régime de faculté, ne semblent
pas se rendre compte des condi-
tions relativement favorables de
travail (T.P. et T.D. en petits grou-
pes ; contacts faciles avec les
enseignants), par rapport à ce qui
existe actuellement dans nombre
d'établissements d'enseignement
supérieur.
supérieur.
Environ 80 % des étudiants se
prononcent pour une troisième an-
née, soit pour recevoir une forma-
tion plus complète (65 %), soit
pour un étalement de l'enseigne-
ment (25 %). Seulement 15 %
des étudiants sont hostiles à une
troisième année.
prononcent pour une troisième an-
née, soit pour recevoir une forma-
tion plus complète (65 %), soit
pour un étalement de l'enseigne-
ment (25 %). Seulement 15 %
des étudiants sont hostiles à une
troisième année.
Compte tenu des emplois du
temps en I.U.T. (32 heures hebdo-
madaires en moyenne), des tra-
jets, de la dispersion des centres
d'hébergement et de travail, les
étudiants consacrent beaucoup de
temps à leur travail personnel. En
effet, 70 % travaillent chez eux
de 10 à 20 heures par semaine,
dont 40 % plus de 15 h. Malgré
cela, 55 % trouvent le temps lais-
sé libre pour leur travail person-
nel encore insuffisant.
temps en I.U.T. (32 heures hebdo-
madaires en moyenne), des tra-
jets, de la dispersion des centres
d'hébergement et de travail, les
étudiants consacrent beaucoup de
temps à leur travail personnel. En
effet, 70 % travaillent chez eux
de 10 à 20 heures par semaine,
dont 40 % plus de 15 h. Malgré
cela, 55 % trouvent le temps lais-
sé libre pour leur travail person-
nel encore insuffisant.
Dans un I.U.T. certaines pré-
cisions nouvelles ont montré que,
selon leur origine scolaire, les
étudiants pouvaient avoir des atti-
tudes différentes : les étudiants
originaires de M.E. consacrent 18
heures hebdomadaires à leur tra-
vail personnel et jugent ce temps
insuffisant (100 %). Les étudiants
originaires de T.M. travaillent
moins (9 heures environ) et sont
satisfaits (75 %). Les étudiants
originaires de T.l. travaillent beau-
coup (19 heures) et sont satis-
faits (75 %). Les mécontents de
chaque catégorie (41,5 % de l'en-
semble) n'ont pas le temps de
tout faire (13,8 %) ou d'étudier en
détail (82,5 %) ou ne dévoilent
pas les raisons de leur méconten-
tement.
cisions nouvelles ont montré que,
selon leur origine scolaire, les
étudiants pouvaient avoir des atti-
tudes différentes : les étudiants
originaires de M.E. consacrent 18
heures hebdomadaires à leur tra-
vail personnel et jugent ce temps
insuffisant (100 %). Les étudiants
originaires de T.M. travaillent
moins (9 heures environ) et sont
satisfaits (75 %). Les étudiants
originaires de T.l. travaillent beau-
coup (19 heures) et sont satis-
faits (75 %). Les mécontents de
chaque catégorie (41,5 % de l'en-
semble) n'ont pas le temps de
tout faire (13,8 %) ou d'étudier en
détail (82,5 %) ou ne dévoilent
pas les raisons de leur méconten-
tement.
Le travail individuel semble
être la règle générale (70 % en-
viron). Le travail de groupe exis-
te peu, sauf dans les I.U.T. ayant
une résidence universitaire (éven-
tualité tout à fait exceptionnelle).
être la règle générale (70 % en-
viron). Le travail de groupe exis-
te peu, sauf dans les I.U.T. ayant
une résidence universitaire (éven-
tualité tout à fait exceptionnelle).
On notera encore que, en
cours d'étude l'étudiant se révèle
généralement sérieux, bien que sa
scolarité en I.U.T. ne soit pas sanc-
tionnée par un examen. L'avantage
est ici sans doute d'avoir un tra-
vail contrôlé en permanence et
soutenu par une pédagogie diffé-
rente de celle pratiquée dans l'en-
seignement supérieur traditionnel.
Toutefois, 40 % des étudiants con-
sacrent l'équivalent d'une journée
à leurs loisirs. La proportion des
boursiers est relativement élevée
par rapport aux facultés : elle est
plus forte pour les étudiants is-
sus des classes techniques et
plus faible pour ceux qui viennent
des lycées.
cours d'étude l'étudiant se révèle
généralement sérieux, bien que sa
scolarité en I.U.T. ne soit pas sanc-
tionnée par un examen. L'avantage
est ici sans doute d'avoir un tra-
vail contrôlé en permanence et
soutenu par une pédagogie diffé-
rente de celle pratiquée dans l'en-
seignement supérieur traditionnel.
Toutefois, 40 % des étudiants con-
sacrent l'équivalent d'une journée
à leurs loisirs. La proportion des
boursiers est relativement élevée
par rapport aux facultés : elle est
plus forte pour les étudiants is-
sus des classes techniques et
plus faible pour ceux qui viennent
des lycées.
37
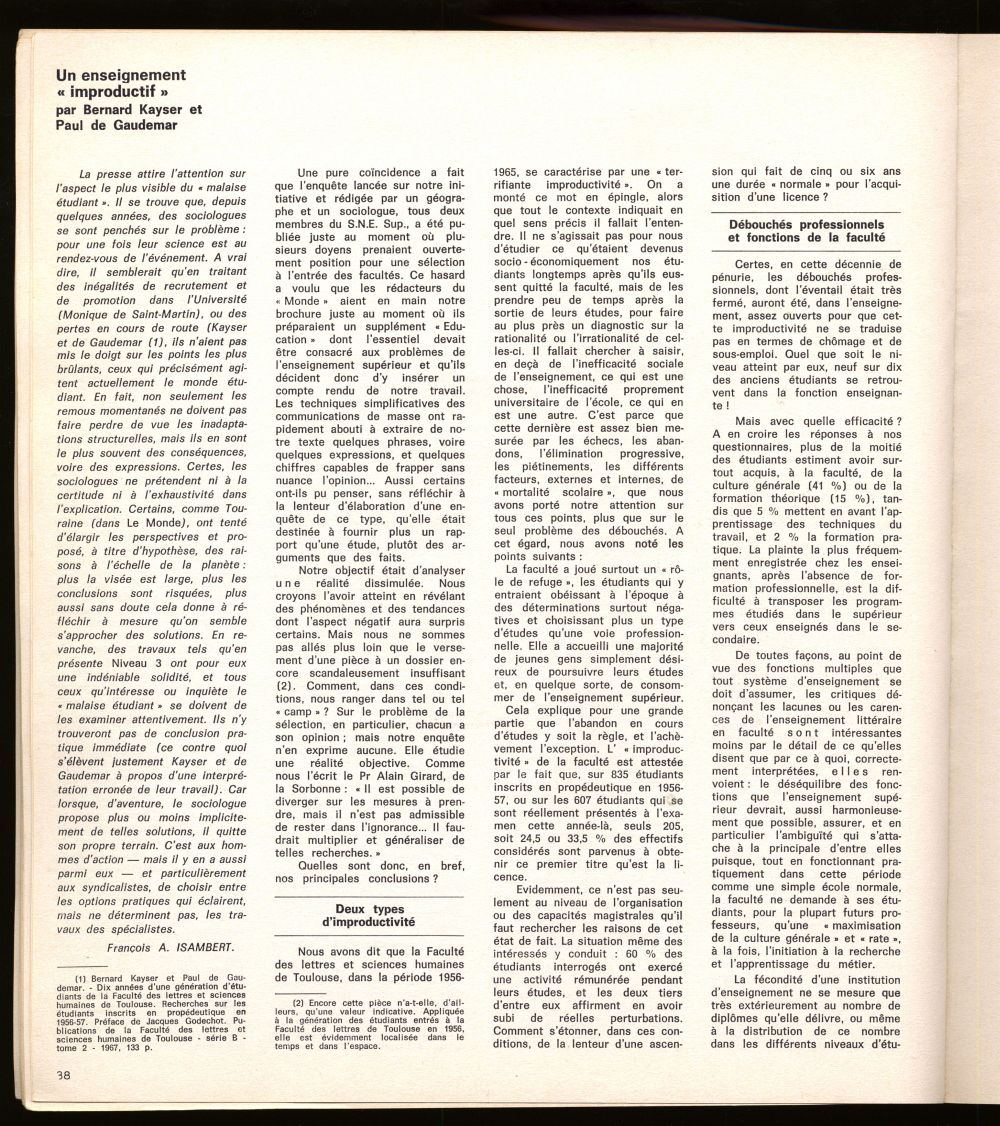

Un enseignement
« improductif »
par Bernard Kayser et
Paul de Gaudemar
« improductif »
par Bernard Kayser et
Paul de Gaudemar
La presse attire l'attention sur
l'aspect le plus visible du « malaise
étudiant *. Il se trouve que, depuis
quelques années, des sociologues
se sont penchés sur le problème :
pour une fois leur science est au
rendez-vous de l'événement. A vrai
dire, il semblerait qu'en traitant
des inégalités de recrutement et
de promotion dans l'Université
(Monique de Saint-Martin), ou des
pertes en cours de route (Kayser
et de Gaudemar (1), ils n'aient pas
mis le doigt sur les points les plus
brûlants, ceux qui précisément agi-
tent actuellement le monde étu-
diant. En fait, non seulement les
remous momentanés ne doivent pas
faire perdre de vue les inadapta-
tions structurelles, mais ils en sont
le plus souvent des conséquences,
voire des expressions. Certes, les
sociologues ne prétendent ni à la
certitude ni à l'exhaustivité dans
l'explication. Certains, comme Tou-
raine (dans Le Monde), ont tenté
d'élargir les perspectives et pro-
posé, à titre d'hypothèse, des rai-
sons à l'échelle de la planète :
plus la visée est large, plus les
conclusions sont risquées, plus
aussi sans doute cela donne à ré-
fléchir à mesure qu'on semble
s'approcher des solutions. En re-
vanche, des travaux tels qu'en
présente Niveau 3 ont pour eux
une indéniable solidité, et tous
ceux qu'intéressé ou inquiète le
« malaise étudiant » se doivent de
les examiner attentivement. Ils n'y
trouveront pas de conclusion pra-
tique immédiate (ce contre quoi
s'élèvent 'justement Kayser et de
Gaudemar à propos d'une interpré-
tation erronée de leur travail). Car
lorsque, d'aventure, le sociologue
propose plus ou moins implicite-
ment de telles solutions, il quitte
son propre terrain. C'est aux hom-
mes d'action —• mais il y en a aussi
parmi eux — et particulièrement
aux syndicalistes, de choisir entre
les options pratiques qui éclairent,
mais ne déterminent pas, les tra-
vaux des spécialistes.
l'aspect le plus visible du « malaise
étudiant *. Il se trouve que, depuis
quelques années, des sociologues
se sont penchés sur le problème :
pour une fois leur science est au
rendez-vous de l'événement. A vrai
dire, il semblerait qu'en traitant
des inégalités de recrutement et
de promotion dans l'Université
(Monique de Saint-Martin), ou des
pertes en cours de route (Kayser
et de Gaudemar (1), ils n'aient pas
mis le doigt sur les points les plus
brûlants, ceux qui précisément agi-
tent actuellement le monde étu-
diant. En fait, non seulement les
remous momentanés ne doivent pas
faire perdre de vue les inadapta-
tions structurelles, mais ils en sont
le plus souvent des conséquences,
voire des expressions. Certes, les
sociologues ne prétendent ni à la
certitude ni à l'exhaustivité dans
l'explication. Certains, comme Tou-
raine (dans Le Monde), ont tenté
d'élargir les perspectives et pro-
posé, à titre d'hypothèse, des rai-
sons à l'échelle de la planète :
plus la visée est large, plus les
conclusions sont risquées, plus
aussi sans doute cela donne à ré-
fléchir à mesure qu'on semble
s'approcher des solutions. En re-
vanche, des travaux tels qu'en
présente Niveau 3 ont pour eux
une indéniable solidité, et tous
ceux qu'intéressé ou inquiète le
« malaise étudiant » se doivent de
les examiner attentivement. Ils n'y
trouveront pas de conclusion pra-
tique immédiate (ce contre quoi
s'élèvent 'justement Kayser et de
Gaudemar à propos d'une interpré-
tation erronée de leur travail). Car
lorsque, d'aventure, le sociologue
propose plus ou moins implicite-
ment de telles solutions, il quitte
son propre terrain. C'est aux hom-
mes d'action —• mais il y en a aussi
parmi eux — et particulièrement
aux syndicalistes, de choisir entre
les options pratiques qui éclairent,
mais ne déterminent pas, les tra-
vaux des spécialistes.
François A. ISAMBERT.
(1) Bernard Kayser et Paul de Gau-
demar. - Dix années d'une génération d'étu-
diants de la Faculté des lettres et sciences
humaines de Toulouse. Recherches sur les
étudiants inscrits en propédeutique en
1956-57. Préface de Jacques Godechot. Pu-
blications de la Faculté des lettres et
sciences humaines de Toulouse - série B •
tome 2 - 1967, 133 p.
demar. - Dix années d'une génération d'étu-
diants de la Faculté des lettres et sciences
humaines de Toulouse. Recherches sur les
étudiants inscrits en propédeutique en
1956-57. Préface de Jacques Godechot. Pu-
blications de la Faculté des lettres et
sciences humaines de Toulouse - série B •
tome 2 - 1967, 133 p.
Une pure coïncidence a fait
que l'enquête lancée sur notre ini-
tiative et rédigée par un géogra-
phe et un sociologue, tous deux
membres du S.N.E. Sup., a été pu-
bliée juste au moment où plu-
sieurs doyens prenaient ouverte-
ment position pour une sélection
à l'entrée des facultés. Ce hasard
a voulu que les rédacteurs du
« Monde » aient en main notre
brochure juste au moment où ils
préparaient un supplément « Edu-
cation » dont l'essentiel devait
être consacré aux problèmes de
l'enseignement supérieur et qu'ils
décident donc d'y insérer un
compte rendu de notre travail.
Les techniques simplificatives des
communications de masse ont ra-
pidement abouti à extraire de no-
tre texte quelques phrases, voire
quelques expressions, et quelques
chiffres capables de frapper sans
nuance l'opinion... Aussi certains
ont-ils pu penser, sans réfléchir à
la lenteur d'élaboration d'une en-
quête de ce type, qu'elle était
destinée à fournir plus un rap-
port qu'une étude, plutôt des ar-
guments que des faits.
que l'enquête lancée sur notre ini-
tiative et rédigée par un géogra-
phe et un sociologue, tous deux
membres du S.N.E. Sup., a été pu-
bliée juste au moment où plu-
sieurs doyens prenaient ouverte-
ment position pour une sélection
à l'entrée des facultés. Ce hasard
a voulu que les rédacteurs du
« Monde » aient en main notre
brochure juste au moment où ils
préparaient un supplément « Edu-
cation » dont l'essentiel devait
être consacré aux problèmes de
l'enseignement supérieur et qu'ils
décident donc d'y insérer un
compte rendu de notre travail.
Les techniques simplificatives des
communications de masse ont ra-
pidement abouti à extraire de no-
tre texte quelques phrases, voire
quelques expressions, et quelques
chiffres capables de frapper sans
nuance l'opinion... Aussi certains
ont-ils pu penser, sans réfléchir à
la lenteur d'élaboration d'une en-
quête de ce type, qu'elle était
destinée à fournir plus un rap-
port qu'une étude, plutôt des ar-
guments que des faits.
Notre objectif était d'analyser
une réalité dissimulée. Nous
croyons l'avoir atteint en révélant
des phénomènes et des tendances
dont l'aspect négatif aura surpris
certains. Mais nous ne sommes
pas allés plus loin que le verse-
ment d'une pièce à un dossier en-
core scandaleusement insuffisant
(2). Comment, dans ces condi-
tions, nous ranger dans tel ou tel
« camp » ? Sur le problème de la
sélection, en particulier, chacun a
son opinion ; mais notre enquête
n'en exprime aucune. Elle étudie
une réalité objective. Comme
nous l'écrit le Pr Alain Girard, de
la Sorbonne : « II est possible de
diverger sur les mesures à pren-
dre, mais il n'est pas admissible
de rester dans l'ignorance... Il fau-
drait multiplier et généraliser de
telles recherches. »
une réalité dissimulée. Nous
croyons l'avoir atteint en révélant
des phénomènes et des tendances
dont l'aspect négatif aura surpris
certains. Mais nous ne sommes
pas allés plus loin que le verse-
ment d'une pièce à un dossier en-
core scandaleusement insuffisant
(2). Comment, dans ces condi-
tions, nous ranger dans tel ou tel
« camp » ? Sur le problème de la
sélection, en particulier, chacun a
son opinion ; mais notre enquête
n'en exprime aucune. Elle étudie
une réalité objective. Comme
nous l'écrit le Pr Alain Girard, de
la Sorbonne : « II est possible de
diverger sur les mesures à pren-
dre, mais il n'est pas admissible
de rester dans l'ignorance... Il fau-
drait multiplier et généraliser de
telles recherches. »
Quelles sont donc, en bref,
nos principales conclusions ?
nos principales conclusions ?
Deux types
d'improductivité
d'improductivité
Nous avons dit que la Faculté
des lettres et sciences humaines
de Toulouse, dans la période 1956-
des lettres et sciences humaines
de Toulouse, dans la période 1956-
(2) Encore cette pièce n'a-t-elle, d'ail-
leurs, qu'une valeur indicative. Appliquée
à la génération des étudiants entrés à la
Faculté des lettres de Toulouse en 1956,
elle est évidemment localisée dans le
temps et dans l'espace.
leurs, qu'une valeur indicative. Appliquée
à la génération des étudiants entrés à la
Faculté des lettres de Toulouse en 1956,
elle est évidemment localisée dans le
temps et dans l'espace.
1965, se caractérise par une « ter-
rifiante improductivité ». On a
monté ce mot en épingle, alors
que tout le contexte indiquait en
quel sens précis il fallait l'enten-
dre. Il ne s'agissait pas pour nous
d'étudier ce qu'étaient devenus
socio - économiquement nos étu-
diants longtemps après qu'ils eus-
sent quitté la faculté, mais de les
prendre peu de temps après la
sortie de leurs études, pour faire
au plus près un diagnostic sur la
rationalité ou l'irrationalité de cel-
les-ci. Il fallait chercher à saisir,
en deçà de l'inefficacité sociale
de l'enseignement, ce qui est une
chose, l'inefficacité proprement
universitaire de l'école, ce qui en
est une autre. C'est parce que
cette dernière est assez bien me-
surée par les échecs, les aban-
dons, l'élimination progressive,
les piétinements, les différents
facteurs, externes et internes, de
•• mortalité scolaire », que nous
avons porté notre attention sur
tous ces points, plus que sur le
seul problème des débouchés. A
cet égard, nous avons noté les
points suivants :
rifiante improductivité ». On a
monté ce mot en épingle, alors
que tout le contexte indiquait en
quel sens précis il fallait l'enten-
dre. Il ne s'agissait pas pour nous
d'étudier ce qu'étaient devenus
socio - économiquement nos étu-
diants longtemps après qu'ils eus-
sent quitté la faculté, mais de les
prendre peu de temps après la
sortie de leurs études, pour faire
au plus près un diagnostic sur la
rationalité ou l'irrationalité de cel-
les-ci. Il fallait chercher à saisir,
en deçà de l'inefficacité sociale
de l'enseignement, ce qui est une
chose, l'inefficacité proprement
universitaire de l'école, ce qui en
est une autre. C'est parce que
cette dernière est assez bien me-
surée par les échecs, les aban-
dons, l'élimination progressive,
les piétinements, les différents
facteurs, externes et internes, de
•• mortalité scolaire », que nous
avons porté notre attention sur
tous ces points, plus que sur le
seul problème des débouchés. A
cet égard, nous avons noté les
points suivants :
La faculté a joué surtout un « rô-
le de refuge », les étudiants qui y
entraient obéissant à l'époque à
des déterminations surtout néga-
tives et choisissant plus un type
d'études qu'une voie profession-
nelle. Elle a accueilli une majorité
de jeunes gens simplement dési-
reux de poursuivre leurs études
et, en quelque sorte, de consom-
mer de l'enseignement supérieur.
le de refuge », les étudiants qui y
entraient obéissant à l'époque à
des déterminations surtout néga-
tives et choisissant plus un type
d'études qu'une voie profession-
nelle. Elle a accueilli une majorité
de jeunes gens simplement dési-
reux de poursuivre leurs études
et, en quelque sorte, de consom-
mer de l'enseignement supérieur.
Cela explique pour une grande
partie que l'abandon en cours
d'études y soit la règle, et l'achè-
vement l'exception. L' « improduc-
tivité » de la faculté est attestée
par le fait que, sur 835 étudiants
inscrits en propédeutique en 1956-
57, ou sur les 607 étudiants qui se
sont réellement présentés à l'exa-
men cette année-là, seuls 205,
soit 24,5 ou 33,5 % des effectifs
considérés sont parvenus à obte-
nir ce premier titre qu'est la li-
cence.
partie que l'abandon en cours
d'études y soit la règle, et l'achè-
vement l'exception. L' « improduc-
tivité » de la faculté est attestée
par le fait que, sur 835 étudiants
inscrits en propédeutique en 1956-
57, ou sur les 607 étudiants qui se
sont réellement présentés à l'exa-
men cette année-là, seuls 205,
soit 24,5 ou 33,5 % des effectifs
considérés sont parvenus à obte-
nir ce premier titre qu'est la li-
cence.
Evidemment, ce n'est pas seu-
lement au niveau de l'organisation
ou des capacités magistrales qu'il
faut rechercher les raisons de cet
état de fait. La situation même des
intéressés y conduit : 60 % des
étudiants interrogés ont exercé
une activité rémunérée pendant
leurs études, et les deux tiers
d'entre eux affirment en avoir
subi de réelles perturbations.
Comment s'étonner, dans ces con-
ditions, de la lenteur d'une ascen-
lement au niveau de l'organisation
ou des capacités magistrales qu'il
faut rechercher les raisons de cet
état de fait. La situation même des
intéressés y conduit : 60 % des
étudiants interrogés ont exercé
une activité rémunérée pendant
leurs études, et les deux tiers
d'entre eux affirment en avoir
subi de réelles perturbations.
Comment s'étonner, dans ces con-
ditions, de la lenteur d'une ascen-
sion qui fait de cinq ou six ans
une durée « normale » pour l'acqui-
sition d'une licence ?
une durée « normale » pour l'acqui-
sition d'une licence ?
Débouchés professionnels
et fonctions de la faculté
et fonctions de la faculté
Certes, en cette décennie de
pénurie, les débouchés profes-
sionnels, dont l'éventail était très
fermé, auront été, dans l'enseigne-
ment, assez ouverts pour que cet-
te improductivité ne se traduise
pas en termes de chômage et de
sous-emploi. Quel que soit le ni-
veau atteint par eux, neuf sur dix
des anciens étudiants se retrou-
vent dans la fonction enseignan-
te !
pénurie, les débouchés profes-
sionnels, dont l'éventail était très
fermé, auront été, dans l'enseigne-
ment, assez ouverts pour que cet-
te improductivité ne se traduise
pas en termes de chômage et de
sous-emploi. Quel que soit le ni-
veau atteint par eux, neuf sur dix
des anciens étudiants se retrou-
vent dans la fonction enseignan-
te !
Mais avec quelle efficacité ?
A en croire les réponses à nos
questionnaires, plus de la moitié
des étudiants estiment avoir sur-
tout acquis, à la faculté, de la
culture générale (41 %) ou de la
formation théorique (15 %), tan-
dis que 5 % mettent en avant l'ap-
prentissage des techniques du
travail, et 2 % la formation pra-
tique. La plainte la plus fréquem-
ment enregistrée chez les ensei-
gnants, après l'absence de for-
mation professionnelle, est la dif-
ficulté à transposer les program-
mes étudiés dans le supérieur
vers ceux enseignés dans le se-
condaire.
A en croire les réponses à nos
questionnaires, plus de la moitié
des étudiants estiment avoir sur-
tout acquis, à la faculté, de la
culture générale (41 %) ou de la
formation théorique (15 %), tan-
dis que 5 % mettent en avant l'ap-
prentissage des techniques du
travail, et 2 % la formation pra-
tique. La plainte la plus fréquem-
ment enregistrée chez les ensei-
gnants, après l'absence de for-
mation professionnelle, est la dif-
ficulté à transposer les program-
mes étudiés dans le supérieur
vers ceux enseignés dans le se-
condaire.
De toutes façons, au point de
vue des fonctions multiples que
tout système d'enseignement se
doit d'assumer, les critiques dé-
nonçant les lacunes ou les caren-
ces de l'enseignement littéraire
en faculté sont intéressantes
moins par le détail de ce qu'elles
disent que par ce à quoi, correcte-
ment interprétées, elles ren-
voient : le déséquilibre des fonc-
tions que l'enseignement supé-
rieur devrait, aussi harmonieuse-
ment que possible, assurer, et en
particulier l'ambiguïté qui s'atta-
che à la principale d'entre elles
puisque, tout en fonctionnant pra-
tiquement dans cette période
comme une simple école normale,
la faculté ne demande à ses étu-
diants, pour la plupart futurs pro-
fesseurs, qu'une « maximisation
de la culture générale » et « rate »,
à la fois, l'initiation à la recherche
et l'apprentissage du métier.
vue des fonctions multiples que
tout système d'enseignement se
doit d'assumer, les critiques dé-
nonçant les lacunes ou les caren-
ces de l'enseignement littéraire
en faculté sont intéressantes
moins par le détail de ce qu'elles
disent que par ce à quoi, correcte-
ment interprétées, elles ren-
voient : le déséquilibre des fonc-
tions que l'enseignement supé-
rieur devrait, aussi harmonieuse-
ment que possible, assurer, et en
particulier l'ambiguïté qui s'atta-
che à la principale d'entre elles
puisque, tout en fonctionnant pra-
tiquement dans cette période
comme une simple école normale,
la faculté ne demande à ses étu-
diants, pour la plupart futurs pro-
fesseurs, qu'une « maximisation
de la culture générale » et « rate »,
à la fois, l'initiation à la recherche
et l'apprentissage du métier.
La fécondité d'une institution
d'enseignement ne se mesure que
très extérieurement au nombre de
diplômes qu'elle délivre, ou même
à la distribution de ce nombre
dans les différents niveaux d'étu-
d'enseignement ne se mesure que
très extérieurement au nombre de
diplômes qu'elle délivre, ou même
à la distribution de ce nombre
dans les différents niveaux d'étu-
38
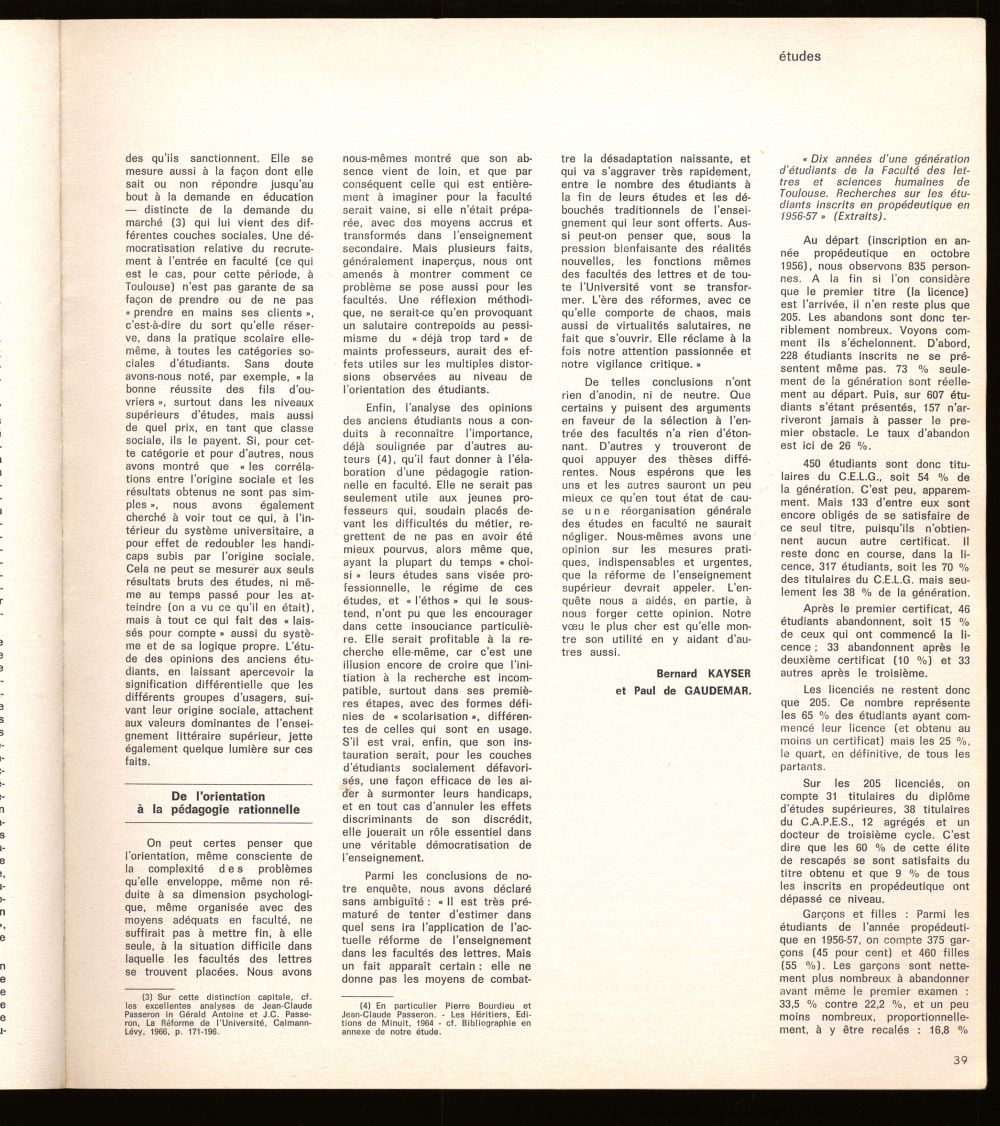

études
des qu'ils sanctionnent. Elle se
mesure aussi à la façon dont elle
sait ou non répondre jusqu'au
bout à la demande en éducation
— distincte de la demande du
marché (3) qui lui vient des dif-
férentes couches sociales. Une dé-
mocratisation relative du recrute-
ment à l'entrée en faculté (ce qui
est le cas, pour cette période, à
Toulouse) n'est pas garante de sa
façon de prendre ou de ne pas
« prendre en mains ses clients »,
c'est-à-dire du sort qu'elle réser-
ve, dans la pratique scolaire elle-
même, à toutes les catégories so-
ciales d'étudiants. Sans doute
avons-nous noté, par exemple, « la
bonne réussite des fils d'ou-
vriers », surtout dans les niveaux
supérieurs d'études, mais aussi
de quel prix, en tant que classe
sociale, ils le payent. Si, pour cet-
te catégorie et pour d'autres, nous
avons montré que « les corréla-
tions entre l'origine sociale et les
résultats obtenus ne sont pas sim-
ples », nous avons également
cherché à voir tout ce qui, à l'in-
térieur du système universitaire, a
pour effet de redoubler les handi-
caps subis par l'origine sociale.
Cela ne peut se mesurer aux seuls
résultats bruts des études, ni mê-
me au temps passé pour les at-
teindre (on a vu ce qu'il en était),
mais à tout ce qui fait des « lais-
sés pour compte » aussi du systè-
me et de sa logique propre. L'étu-
de des opinions des anciens étu-
diants, en laissant apercevoir la
signification différentielle que les
différents groupes d'usagers, sui-
vant leur origine sociale, attachent
aux valeurs dominantes de l'ensei-
gnement littéraire supérieur, jette
également quelque lumière sur ces
faits.
mesure aussi à la façon dont elle
sait ou non répondre jusqu'au
bout à la demande en éducation
— distincte de la demande du
marché (3) qui lui vient des dif-
férentes couches sociales. Une dé-
mocratisation relative du recrute-
ment à l'entrée en faculté (ce qui
est le cas, pour cette période, à
Toulouse) n'est pas garante de sa
façon de prendre ou de ne pas
« prendre en mains ses clients »,
c'est-à-dire du sort qu'elle réser-
ve, dans la pratique scolaire elle-
même, à toutes les catégories so-
ciales d'étudiants. Sans doute
avons-nous noté, par exemple, « la
bonne réussite des fils d'ou-
vriers », surtout dans les niveaux
supérieurs d'études, mais aussi
de quel prix, en tant que classe
sociale, ils le payent. Si, pour cet-
te catégorie et pour d'autres, nous
avons montré que « les corréla-
tions entre l'origine sociale et les
résultats obtenus ne sont pas sim-
ples », nous avons également
cherché à voir tout ce qui, à l'in-
térieur du système universitaire, a
pour effet de redoubler les handi-
caps subis par l'origine sociale.
Cela ne peut se mesurer aux seuls
résultats bruts des études, ni mê-
me au temps passé pour les at-
teindre (on a vu ce qu'il en était),
mais à tout ce qui fait des « lais-
sés pour compte » aussi du systè-
me et de sa logique propre. L'étu-
de des opinions des anciens étu-
diants, en laissant apercevoir la
signification différentielle que les
différents groupes d'usagers, sui-
vant leur origine sociale, attachent
aux valeurs dominantes de l'ensei-
gnement littéraire supérieur, jette
également quelque lumière sur ces
faits.
De l'orientation
à la pédagogie rationnelle
à la pédagogie rationnelle
On peut certes penser que
l'orientation, même consciente de
la complexité des problèmes
qu'elle enveloppe, même non ré-
duite à sa dimension psychologi-
que, même organisée avec des
moyens adéquats en faculté, ne
suffirait pas à mettre fin, à elle
seule, à la situation difficile dans
laquelle les facultés des lettres
se trouvent placées. Nous avons
l'orientation, même consciente de
la complexité des problèmes
qu'elle enveloppe, même non ré-
duite à sa dimension psychologi-
que, même organisée avec des
moyens adéquats en faculté, ne
suffirait pas à mettre fin, à elle
seule, à la situation difficile dans
laquelle les facultés des lettres
se trouvent placées. Nous avons
nous-mêmes montré que son ab-
sence vient de loin, et que par
conséquent celle qui est entière-
ment à imaginer pour la faculté
serait vaine, si elle n'était prépa-
rée, avec des moyens accrus et
transformés dans l'enseignement
secondaire. Mais plusieurs faits,
généralement inaperçus, nous ont
amenés à montrer comment ce
problème se pose aussi pour les
facultés. Une réflexion méthodi-
que, ne serait-ce qu'en provoquant
un salutaire contrepoids au pessi-
misme du « déjà trop tard » de
maints professeurs, aurait des ef-
fets utiles sur les multiples distor-
sions observées au niveau de
l'orientation des étudiants.
sence vient de loin, et que par
conséquent celle qui est entière-
ment à imaginer pour la faculté
serait vaine, si elle n'était prépa-
rée, avec des moyens accrus et
transformés dans l'enseignement
secondaire. Mais plusieurs faits,
généralement inaperçus, nous ont
amenés à montrer comment ce
problème se pose aussi pour les
facultés. Une réflexion méthodi-
que, ne serait-ce qu'en provoquant
un salutaire contrepoids au pessi-
misme du « déjà trop tard » de
maints professeurs, aurait des ef-
fets utiles sur les multiples distor-
sions observées au niveau de
l'orientation des étudiants.
Enfin, l'analyse des opinions
des anciens étudiants nous a con-
duits à reconnaître l'importance,
déjà soulignée par d'autres au-
teurs (4), qu'il faut donner à l'éla-
boration d'une pédagogie ration-
nelle en faculté. Elle ne serait pas
seulement utile aux jeunes pro-
fesseurs qui, soudain placés de-
vant les difficultés du métier, re-
grettent de ne pas en avoir été
mieux pourvus, alors même que,
ayant la plupart du temps « choi-
si » leurs études sans visée pro-
fessionnelle, le régime de ces
études, et « l'éthos » qui le sous-
tend, n'ont pu que les encourager
dans cette insouciance particuliè-
re. Elle serait profitable à la re-
cherche elle-même, car c'est une
illusion encore de croire que l'ini-
tiation à la recherche est incom-
patible, surtout dans ses premiè-
res étapes, avec des formes défi-
nies de « scolarisation », différen-
tes de celles qui sont en usage.
S'il est vrai, enfin, que son ins-
tauration serait, pour les couches
d'étudiants socialement défavori-
sés, une façon efficace de les ai-
der à surmonter leurs handicaps,
et en tout cas d'annuler les effets
discriminants de son discrédit,
elle jouerait un rôle essentiel dans
une véritable démocratisation de
l'enseignement.
des anciens étudiants nous a con-
duits à reconnaître l'importance,
déjà soulignée par d'autres au-
teurs (4), qu'il faut donner à l'éla-
boration d'une pédagogie ration-
nelle en faculté. Elle ne serait pas
seulement utile aux jeunes pro-
fesseurs qui, soudain placés de-
vant les difficultés du métier, re-
grettent de ne pas en avoir été
mieux pourvus, alors même que,
ayant la plupart du temps « choi-
si » leurs études sans visée pro-
fessionnelle, le régime de ces
études, et « l'éthos » qui le sous-
tend, n'ont pu que les encourager
dans cette insouciance particuliè-
re. Elle serait profitable à la re-
cherche elle-même, car c'est une
illusion encore de croire que l'ini-
tiation à la recherche est incom-
patible, surtout dans ses premiè-
res étapes, avec des formes défi-
nies de « scolarisation », différen-
tes de celles qui sont en usage.
S'il est vrai, enfin, que son ins-
tauration serait, pour les couches
d'étudiants socialement défavori-
sés, une façon efficace de les ai-
der à surmonter leurs handicaps,
et en tout cas d'annuler les effets
discriminants de son discrédit,
elle jouerait un rôle essentiel dans
une véritable démocratisation de
l'enseignement.
Parmi les conclusions de no-
tre enquête, nous avons déclaré
sans ambiguïté : « H est très pré-
maturé de tenter d'estimer dans
quel sens ira l'application de l'ac-
tuelle réforme de l'enseignement
dans les facultés des lettres. Mais
un fait apparaît certain : elle ne
donne pas les moyens de combat-
tre enquête, nous avons déclaré
sans ambiguïté : « H est très pré-
maturé de tenter d'estimer dans
quel sens ira l'application de l'ac-
tuelle réforme de l'enseignement
dans les facultés des lettres. Mais
un fait apparaît certain : elle ne
donne pas les moyens de combat-
tre la désadaptation naissante, et
qui va s'aggraver très rapidement,
entre le nombre des étudiants à
la fin de leurs études et les dé-
bouchés traditionnels de l'ensei-
gnement qui leur sont offerts. Aus-
si peut-on penser que, sous la
pression bienfaisante des réalités
nouvelles, les fonctions mêmes
des facultés des lettres et de tou-
te l'Université vont se transfor-
mer. L'ère des réformes, avec ce
qu'elle comporte de chaos, mais
aussi de virtualités salutaires, ne
fait que s'ouvrir. Elle réclame à la
fois notre attention passionnée et
notre vigilance critique. »
qui va s'aggraver très rapidement,
entre le nombre des étudiants à
la fin de leurs études et les dé-
bouchés traditionnels de l'ensei-
gnement qui leur sont offerts. Aus-
si peut-on penser que, sous la
pression bienfaisante des réalités
nouvelles, les fonctions mêmes
des facultés des lettres et de tou-
te l'Université vont se transfor-
mer. L'ère des réformes, avec ce
qu'elle comporte de chaos, mais
aussi de virtualités salutaires, ne
fait que s'ouvrir. Elle réclame à la
fois notre attention passionnée et
notre vigilance critique. »
De telles conclusions n'ont
rien d'anodin, ni de neutre. Que
certains y puisent des arguments
en faveur de la sélection à l'en-
trée des facultés n'a rien d'éton-
nant. D'autres y trouveront de
quoi appuyer des thèses diffé-
rentes. Nous espérons que les
uns et les autres sauront un peu
mieux ce qu'en tout état de cau-
se une réorganisation générale
des études en faculté ne saurait
négliger. Nous-mêmes avons une
opinion sur les mesures prati-
ques, indispensables et urgentes,
que la réforme de l'enseignement
supérieur devrait appeler. L'en-
quête nous a aidés, en partie, à
nous forger cette opinion. Notre
vœu le plus cher est qu'elle mon-
tre son utilité en y aidant d'au-
tres aussi.
rien d'anodin, ni de neutre. Que
certains y puisent des arguments
en faveur de la sélection à l'en-
trée des facultés n'a rien d'éton-
nant. D'autres y trouveront de
quoi appuyer des thèses diffé-
rentes. Nous espérons que les
uns et les autres sauront un peu
mieux ce qu'en tout état de cau-
se une réorganisation générale
des études en faculté ne saurait
négliger. Nous-mêmes avons une
opinion sur les mesures prati-
ques, indispensables et urgentes,
que la réforme de l'enseignement
supérieur devrait appeler. L'en-
quête nous a aidés, en partie, à
nous forger cette opinion. Notre
vœu le plus cher est qu'elle mon-
tre son utilité en y aidant d'au-
tres aussi.
Bernard KAYSER
et Paul de GAUDEMAR.
et Paul de GAUDEMAR.
(3) Sur cette distinction capitale, cf.
les excellentes analyses de Jean-Claude
Passeron in Gérald Antoine et J.C. Passe-
ron, La Réforme de l'Université, Calmann-
Lévy, 1966, p. 171-196.
les excellentes analyses de Jean-Claude
Passeron in Gérald Antoine et J.C. Passe-
ron, La Réforme de l'Université, Calmann-
Lévy, 1966, p. 171-196.
(4) En particulier Pierre Bourdieu et
Jean-Claude Passeron. - Les Héritiers, Edi-
tions de Minuit, 1964 - cf. Bibliographie en
annexe de notre étude.
Jean-Claude Passeron. - Les Héritiers, Edi-
tions de Minuit, 1964 - cf. Bibliographie en
annexe de notre étude.
« Dix années d'une génération
d'étudiants de la Faculté des let-
tres et sciences humaines de
Toulouse. Recherches sur les étu-
diants inscrits en propédeutique en
1956-57» (Extraits).
d'étudiants de la Faculté des let-
tres et sciences humaines de
Toulouse. Recherches sur les étu-
diants inscrits en propédeutique en
1956-57» (Extraits).
Au départ (inscription en an-
née propédeutique en octobre
1356), nous observons 835 person-
nes. A la fin si l'on considère
que le premier titre (la licence)
est l'arrivée, il n'en reste plus que
205. Les abandons sont donc ter-
riblement nombreux. Voyons com-
ment ils s'échelonnent. D'abord,
228 étudiants inscrits ne se pré-
sentent même pas. 73 % seule-
ment de la génération sont réelle-
ment au départ. Puis, sur 607 étu-
diants s'étant présentés, 157 n'ar-
riveront jamais à passer le pre-
mier obstacle. Le taux d'abandon
est ici de 26 %.
née propédeutique en octobre
1356), nous observons 835 person-
nes. A la fin si l'on considère
que le premier titre (la licence)
est l'arrivée, il n'en reste plus que
205. Les abandons sont donc ter-
riblement nombreux. Voyons com-
ment ils s'échelonnent. D'abord,
228 étudiants inscrits ne se pré-
sentent même pas. 73 % seule-
ment de la génération sont réelle-
ment au départ. Puis, sur 607 étu-
diants s'étant présentés, 157 n'ar-
riveront jamais à passer le pre-
mier obstacle. Le taux d'abandon
est ici de 26 %.
450 étudiants sont donc titu-
laires du C.E.L.G., soit 54 % de
la génération. C'est peu, apparem-
ment. Mais 133 d'entre eux sont
encore obligés de se satisfaire de
ce seul titre, puisqu'ils n'obtien-
nent aucun autre certificat. Il
reste donc en course, dans la li-
cence, 317 étudiants, soit les 70 %
des titulaires du C.E.L.G. mais seu-
lement les 38 % de la génération.
laires du C.E.L.G., soit 54 % de
la génération. C'est peu, apparem-
ment. Mais 133 d'entre eux sont
encore obligés de se satisfaire de
ce seul titre, puisqu'ils n'obtien-
nent aucun autre certificat. Il
reste donc en course, dans la li-
cence, 317 étudiants, soit les 70 %
des titulaires du C.E.L.G. mais seu-
lement les 38 % de la génération.
Après le premier certificat, 46
étudiants abandonnent, soit 15 %
de ceux qui ont commencé la li-
cence ; 33 abandonnent après le
deuxième certificat (10 %) et 33
autres après le troisième.
étudiants abandonnent, soit 15 %
de ceux qui ont commencé la li-
cence ; 33 abandonnent après le
deuxième certificat (10 %) et 33
autres après le troisième.
Les licenciés ne restent donc
que 205. Ce nombre représente
les 65 % des étudiants ayant com-
mencé leur licence (et obtenu au
moins un certificat) mais les 25 %,
le quart, en définitive, de tous les
partants.
que 205. Ce nombre représente
les 65 % des étudiants ayant com-
mencé leur licence (et obtenu au
moins un certificat) mais les 25 %,
le quart, en définitive, de tous les
partants.
Sur les 205 licenciés, on
compte 31 titulaires du diplôme
d'études supérieures, 38 titulaires
du C.A.P.E.S., 12 agrégés et un
docteur de troisième cycle. C'est
dire que les 60 % de cette élite
de rescapés se sont satisfaits du
titre obtenu et que 9 % de tous
les inscrits en propédeutique ont
dépassé ce niveau.
compte 31 titulaires du diplôme
d'études supérieures, 38 titulaires
du C.A.P.E.S., 12 agrégés et un
docteur de troisième cycle. C'est
dire que les 60 % de cette élite
de rescapés se sont satisfaits du
titre obtenu et que 9 % de tous
les inscrits en propédeutique ont
dépassé ce niveau.
Garçons et filles : Parmi les
étudiants de l'année propédeuti-
que en 1956-57, on compte 375 gar-
çons (45 pour cent) et 460 filles
(55 %). Les garçons sont nette-
ment plus nombreux à abandonner
avant même le premier examen :
33,5 % contre 22,2 %, et un peu
moins nombreux, proportionnelle-
ment, à y être recalés : 16,8 %
étudiants de l'année propédeuti-
que en 1956-57, on compte 375 gar-
çons (45 pour cent) et 460 filles
(55 %). Les garçons sont nette-
ment plus nombreux à abandonner
avant même le premier examen :
33,5 % contre 22,2 %, et un peu
moins nombreux, proportionnelle-
ment, à y être recalés : 16,8 %
39
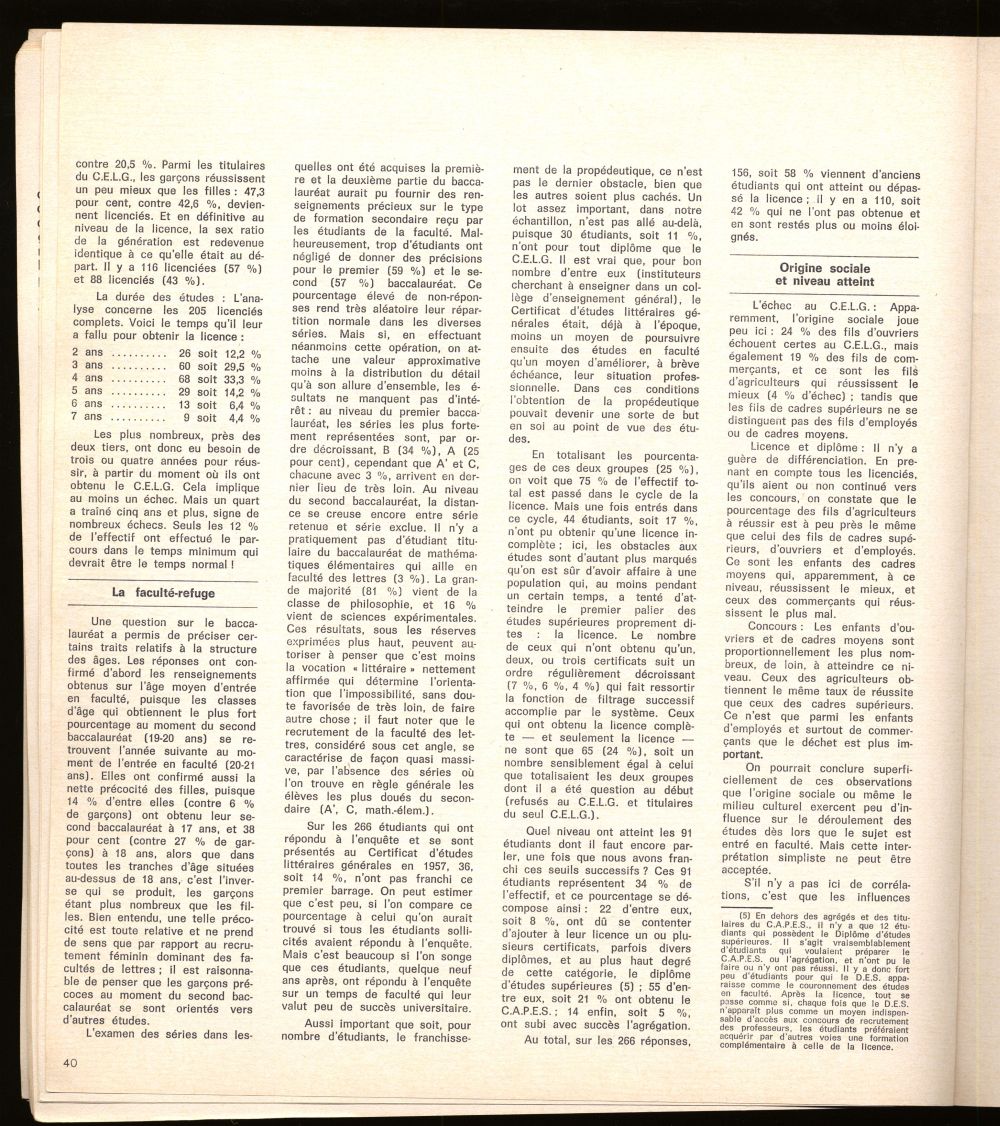

contre 20,5 %. Parmi les titulaires
du G.E.L.G., les garçons réussissent
un peu mieux que les filles : 47,3
pour cent, contre 42,6 %, devien-
nent licenciés. Et en définitive au
niveau de la licence, la sex ratio
de la génération est redevenue
identique à ce qu'elle était au dé-
part. Il y a 116 licenciées (57 %)
et 88 licenciés (43 %).
du G.E.L.G., les garçons réussissent
un peu mieux que les filles : 47,3
pour cent, contre 42,6 %, devien-
nent licenciés. Et en définitive au
niveau de la licence, la sex ratio
de la génération est redevenue
identique à ce qu'elle était au dé-
part. Il y a 116 licenciées (57 %)
et 88 licenciés (43 %).
La durée des études : L'ana-
lyse concerne les 205 licenciés
complets. Voici le temps qu'il leur
a fallu pour obtenir la licence :
lyse concerne les 205 licenciés
complets. Voici le temps qu'il leur
a fallu pour obtenir la licence :
2 ans .......... 26 soit 12,2 %
3 ans .......... 60 soit 29,5 %
4 ans .......... 68 soit 33,3 %
5 ans .......... 29 soit 14,2 %
6 ans .......... 13 soit 6,4 %
7 ans .......... 9 soit 4,4 %
Les plus nombreux, près des
deux tiers, ont donc eu besoin de
trois ou quatre années pour réus-
sir, à partir du moment où ils ont
obtenu le C.E.L.G. Cela implique
au moins un échec. Mais un quart
a traîné cinq ans et plus, signe de
nombreux échecs. Seuls les 12 %
de l'effectif ont effectué le par-
cours dans le temps minimum qui
devrait être le temps normal !
deux tiers, ont donc eu besoin de
trois ou quatre années pour réus-
sir, à partir du moment où ils ont
obtenu le C.E.L.G. Cela implique
au moins un échec. Mais un quart
a traîné cinq ans et plus, signe de
nombreux échecs. Seuls les 12 %
de l'effectif ont effectué le par-
cours dans le temps minimum qui
devrait être le temps normal !
La faculté-refuge
Une question sur le bacca-
lauréat a permis de préciser cer-
tains traits relatifs à la structure
des âges. Les réponses ont con-
firmé d'abord les renseignements
obtenus sur l'âge moyen d'entrée
en faculté, puisque les classes
d'âge qui obtiennent le plus fort
pourcentage au moment du second
baccalauréat (19-20 ans) se re-
trouvent l'année suivante au mo-
ment de l'entrée en faculté (20-21
ans). Elles ont confirmé aussi la
nette précocité des filles, puisque
14 % d'entre elles (contre 6 %
de garçons) ont obtenu leur se-
cond baccalauréat à 17 ans, et 38
pour cent (contre 27 % de gar-
çons) à 18 ans, alors que dans
toutes les tranches d'âge situées
au-dessus de 18 ans, c'est l'inver-
se qui se produit, les garçons
étant plus nombreux que les fil-
les. Bien entendu, une telle préco-
cité est toute relative et ne prend
de sens que par rapport au recru-
tement féminin dominant des fa-
cultés de lettres ; il est raisonna-
ble de penser que les garçons pré-
coces au moment du second bac-
calauréat se sont orientés vers
d'autres études.
lauréat a permis de préciser cer-
tains traits relatifs à la structure
des âges. Les réponses ont con-
firmé d'abord les renseignements
obtenus sur l'âge moyen d'entrée
en faculté, puisque les classes
d'âge qui obtiennent le plus fort
pourcentage au moment du second
baccalauréat (19-20 ans) se re-
trouvent l'année suivante au mo-
ment de l'entrée en faculté (20-21
ans). Elles ont confirmé aussi la
nette précocité des filles, puisque
14 % d'entre elles (contre 6 %
de garçons) ont obtenu leur se-
cond baccalauréat à 17 ans, et 38
pour cent (contre 27 % de gar-
çons) à 18 ans, alors que dans
toutes les tranches d'âge situées
au-dessus de 18 ans, c'est l'inver-
se qui se produit, les garçons
étant plus nombreux que les fil-
les. Bien entendu, une telle préco-
cité est toute relative et ne prend
de sens que par rapport au recru-
tement féminin dominant des fa-
cultés de lettres ; il est raisonna-
ble de penser que les garçons pré-
coces au moment du second bac-
calauréat se sont orientés vers
d'autres études.
L'examen des séries dans les-
quelles ont été acquises la premiè-
re et la deuxième partie du bacca-
lauréat aurait pu fournir des ren-
seignements précieux sur le type
de formation secondaire reçu par
les étudiants de la faculté. Mal-
heureusement, trop d'étudiants ont
négligé de donner des précisions
pour le premier (59 %) et le se-
cond (57 %) baccalauréat. Ce
pourcentage élevé de non-répon-
ses rend très aléatoire leur répar-
tition normale dans les diverses
séries. Mais si, en effectuant
néanmoins cette opération, on at-
tache une valeur approximative
moins à la distribution du détail
qu'à son allure d'ensemble, les é-
sultats ne manquent pas d'inté-
rêt : au niveau du premier bacca-
lauréat, les séries les plus forte-
ment représentées sont, par or-
dre décroissant, B (34 %), A (25
pour cent), cependant que A' et C,
chacune avec 3 %, arrivent en der-
nier lieu de très loin. Au niveau
du second baccalauréat, la distan-
ce se creuse encore entre série
retenue et série exclue. Il n'y a
pratiquement pas d'étudiant titu-
laire du baccalauréat de mathéma-
tiques élémentaires qui aille en
faculté des lettres (3 %). La gran-
de majorité (81 %] vient de la
classe de philosophie, et 16 %
vient de sciences expérimentales.
Ces résultats, sous les réserves
exprimées plus haut, peuvent au-
toriser à penser que c'est moins
la vocation « littéraire » nettement
affirmée qui détermine l'orienta-
tion que l'impossibilité, sans dou-
te favorisée de très loin, de faire
autre chose ; il faut noter que le
recrutement de la faculté des let-
tres, considéré sous cet angle, se
caractérise de façon quasi massi-
ve, par l'absence des séries où
l'on trouve en règle générale les
élèves les plus doués du secon-
daire (A', C, math.-élem.).
re et la deuxième partie du bacca-
lauréat aurait pu fournir des ren-
seignements précieux sur le type
de formation secondaire reçu par
les étudiants de la faculté. Mal-
heureusement, trop d'étudiants ont
négligé de donner des précisions
pour le premier (59 %) et le se-
cond (57 %) baccalauréat. Ce
pourcentage élevé de non-répon-
ses rend très aléatoire leur répar-
tition normale dans les diverses
séries. Mais si, en effectuant
néanmoins cette opération, on at-
tache une valeur approximative
moins à la distribution du détail
qu'à son allure d'ensemble, les é-
sultats ne manquent pas d'inté-
rêt : au niveau du premier bacca-
lauréat, les séries les plus forte-
ment représentées sont, par or-
dre décroissant, B (34 %), A (25
pour cent), cependant que A' et C,
chacune avec 3 %, arrivent en der-
nier lieu de très loin. Au niveau
du second baccalauréat, la distan-
ce se creuse encore entre série
retenue et série exclue. Il n'y a
pratiquement pas d'étudiant titu-
laire du baccalauréat de mathéma-
tiques élémentaires qui aille en
faculté des lettres (3 %). La gran-
de majorité (81 %] vient de la
classe de philosophie, et 16 %
vient de sciences expérimentales.
Ces résultats, sous les réserves
exprimées plus haut, peuvent au-
toriser à penser que c'est moins
la vocation « littéraire » nettement
affirmée qui détermine l'orienta-
tion que l'impossibilité, sans dou-
te favorisée de très loin, de faire
autre chose ; il faut noter que le
recrutement de la faculté des let-
tres, considéré sous cet angle, se
caractérise de façon quasi massi-
ve, par l'absence des séries où
l'on trouve en règle générale les
élèves les plus doués du secon-
daire (A', C, math.-élem.).
Sur les 266 étudiants qui ont
répondu à l'enquête et se sont
présentés au Certificat d'études
littéraires générales en 1957, 36,
soit 14 %, n'ont pas franchi ce
premier barrage. On peut estimer
que c'est peu, si l'on compare ce
pourcentage à celui qu'on aurait
trouvé si tous les étudiants solli-
cités avaient répondu à l'enquête.
Mais c'est beaucoup si l'on songe
que ces étudiants, quelque neuf
ans après, ont répondu à l'enquête
sur un temps de faculté qui leur
valut peu de succès universitaire.
répondu à l'enquête et se sont
présentés au Certificat d'études
littéraires générales en 1957, 36,
soit 14 %, n'ont pas franchi ce
premier barrage. On peut estimer
que c'est peu, si l'on compare ce
pourcentage à celui qu'on aurait
trouvé si tous les étudiants solli-
cités avaient répondu à l'enquête.
Mais c'est beaucoup si l'on songe
que ces étudiants, quelque neuf
ans après, ont répondu à l'enquête
sur un temps de faculté qui leur
valut peu de succès universitaire.
Aussi important que soit, pour
nombre d'étudiants, le franchisse-
nombre d'étudiants, le franchisse-
ment de la propédeutique, ce n'est
pas le dernier obstacle, bien que
les autres soient plus cachés. Un
lot assez important, dans notre
échantillon, n'est pas allé au-delà,
puisque 30 étudiants, soit 11 %,
n'ont pour tout diplôme que le
C.E.L.G. Il est vrai que, pour bon
nombre d'entre eux (instituteurs
cherchant à enseigner dans un col-
lège d'enseignement général), le
Certificat d'études littéraires gé-
nérales était, déjà à l'époque,
moins un moyen de poursuivre
ensuite des études en faculté
qu'un moyen d'améliorer, à brève
échéance, leur situation profes-
sionnelle. Dans ces conditions
l'obtention de la propédeutique
pouvait devenir une sorte de but
en soi au point de vue des étu-
des.
pas le dernier obstacle, bien que
les autres soient plus cachés. Un
lot assez important, dans notre
échantillon, n'est pas allé au-delà,
puisque 30 étudiants, soit 11 %,
n'ont pour tout diplôme que le
C.E.L.G. Il est vrai que, pour bon
nombre d'entre eux (instituteurs
cherchant à enseigner dans un col-
lège d'enseignement général), le
Certificat d'études littéraires gé-
nérales était, déjà à l'époque,
moins un moyen de poursuivre
ensuite des études en faculté
qu'un moyen d'améliorer, à brève
échéance, leur situation profes-
sionnelle. Dans ces conditions
l'obtention de la propédeutique
pouvait devenir une sorte de but
en soi au point de vue des étu-
des.
En totalisant les pourcenta-
ges de ces deux groupes (25 %),
on voit que 75 % de l'effectif to-
tal est passé dans le cycle de la
licence. Mais une fois entrés dans
ce cycle, 44 étudiants, soit 17 %,
n'ont pu obtenir qu'une licence in-
complète ; ici, les obstacles aux
études sont d'autant plus marqués
qu'on est sûr d'avoir affaire à une
population qui, au moins pendant
un certain temps, a tenté d'at-
teindre le premier paiier des
études supérieures proprement di-
tes : la licence. Le nombre
de ceux qui n'ont obtenu qu'un,
deux, ou trois certificats suit un
ordre régulièrement décroissant
(7 %, 6 %, 4 %) qui fait ressortir
la fonction de filtrage successif
accomplie par le système. Ceux
qui ont obtenu la licence complè-
te — et seulement la licence —
ne sont que 65 (24 %), soit un
nombre sensiblement égal à celui
que totalisaient les deux groupes
dont il a été question au début
(refusés au C.E.L.G. et titulaires
du seul C.E.L.G.).
ges de ces deux groupes (25 %),
on voit que 75 % de l'effectif to-
tal est passé dans le cycle de la
licence. Mais une fois entrés dans
ce cycle, 44 étudiants, soit 17 %,
n'ont pu obtenir qu'une licence in-
complète ; ici, les obstacles aux
études sont d'autant plus marqués
qu'on est sûr d'avoir affaire à une
population qui, au moins pendant
un certain temps, a tenté d'at-
teindre le premier paiier des
études supérieures proprement di-
tes : la licence. Le nombre
de ceux qui n'ont obtenu qu'un,
deux, ou trois certificats suit un
ordre régulièrement décroissant
(7 %, 6 %, 4 %) qui fait ressortir
la fonction de filtrage successif
accomplie par le système. Ceux
qui ont obtenu la licence complè-
te — et seulement la licence —
ne sont que 65 (24 %), soit un
nombre sensiblement égal à celui
que totalisaient les deux groupes
dont il a été question au début
(refusés au C.E.L.G. et titulaires
du seul C.E.L.G.).
Quel niveau ont atteint les 91
étudiants dont il faut encore par-
ler, une fois que nous avons fran-
chi ces seuils successifs ? Ces 91
étudiants représentent 34 % de
l'effectif, et ce pourcentage se dé-
compose ainsi : 22 d'entre eux,
soit 8 %, ont dû se contenter
d'ajouter à leur licence un ou plu-
sieurs certificats, parfois divers
diplômes, et au plus haut degré
de cette catégorie, le diplôme
d'études supérieures (5) ; 55 d'en-
tre eux, soit 21 % ont obtenu le
C.A.P.E.S. ; 14 enfin, soit 5 %,
ont subi avec succès l'agrégation.
étudiants dont il faut encore par-
ler, une fois que nous avons fran-
chi ces seuils successifs ? Ces 91
étudiants représentent 34 % de
l'effectif, et ce pourcentage se dé-
compose ainsi : 22 d'entre eux,
soit 8 %, ont dû se contenter
d'ajouter à leur licence un ou plu-
sieurs certificats, parfois divers
diplômes, et au plus haut degré
de cette catégorie, le diplôme
d'études supérieures (5) ; 55 d'en-
tre eux, soit 21 % ont obtenu le
C.A.P.E.S. ; 14 enfin, soit 5 %,
ont subi avec succès l'agrégation.
Au total, sur les 266 réponses,
156, soit 58 % viennent d'anciens
étudiants qui ont atteint ou dépas-
sé la licence; il y en a 110, soit
42 % qui ne l'ont pas obtenue et
en sont restés plus ou moins éloi-
gnés.
étudiants qui ont atteint ou dépas-
sé la licence; il y en a 110, soit
42 % qui ne l'ont pas obtenue et
en sont restés plus ou moins éloi-
gnés.
Origine sociale
et niveau atteint
et niveau atteint
L'échec au C.E.L.G. : Appa-
remment, l'origine sociale joue
peu ici : 24 % des fils d'ouvriers
échouent certes au C.E.L.G., mais
également 19 % des fils de com-
merçants, et ce sont les fils
d'agriculteurs qui réussissent le
mieux (4 % d'échec) ; tandis que
les fils de cadres supérieurs ne se
distinguent pas des fils d'employés
ou de cadres moyens.
remment, l'origine sociale joue
peu ici : 24 % des fils d'ouvriers
échouent certes au C.E.L.G., mais
également 19 % des fils de com-
merçants, et ce sont les fils
d'agriculteurs qui réussissent le
mieux (4 % d'échec) ; tandis que
les fils de cadres supérieurs ne se
distinguent pas des fils d'employés
ou de cadres moyens.
Licence et diplôme : II n'y a
guère de différenciation. En pre-
nant en compte tous les licenciés,
qu'ils aient ou non continué vers
les concours, on constate que le
pourcentage des fils d'agriculteurs
à réussir est à peu près le même
que celui des fils de cadres supé-
rieurs, d'ouvriers et d'employés.
Ce sont les enfants des cadres
moyens qui, apparemment, à ce
niveau, réussissent le mieux, et
ceux des commerçants qui réus-
sissent le plus mal.
guère de différenciation. En pre-
nant en compte tous les licenciés,
qu'ils aient ou non continué vers
les concours, on constate que le
pourcentage des fils d'agriculteurs
à réussir est à peu près le même
que celui des fils de cadres supé-
rieurs, d'ouvriers et d'employés.
Ce sont les enfants des cadres
moyens qui, apparemment, à ce
niveau, réussissent le mieux, et
ceux des commerçants qui réus-
sissent le plus mal.
Concours : Les enfants d'ou-
vriers et de cadres moyens sont
proportionnellement les plus nom-
breux, de loin, à atteindre ce ni-
veau. Ceux des agriculteurs ob-
tiennent le même taux de réussite
que ceux des cadres supérieurs.
Ce n'est que parmi les enfants
d'employés et surtout de commer-
çants que le déchet est plus im-
portant.
vriers et de cadres moyens sont
proportionnellement les plus nom-
breux, de loin, à atteindre ce ni-
veau. Ceux des agriculteurs ob-
tiennent le même taux de réussite
que ceux des cadres supérieurs.
Ce n'est que parmi les enfants
d'employés et surtout de commer-
çants que le déchet est plus im-
portant.
On pourrait conclure superfi-
ciellement de ces observations
que l'origine sociale ou même le
milieu culturel exercent peu d'in-
fluence sur le déroulement des
études dès lors que le sujet est
entré en faculté. Mais cette inter-
prétation simpliste ne peut être
acceptée.
ciellement de ces observations
que l'origine sociale ou même le
milieu culturel exercent peu d'in-
fluence sur le déroulement des
études dès lors que le sujet est
entré en faculté. Mais cette inter-
prétation simpliste ne peut être
acceptée.
S'il n'y a pas ici de corréla-
tions, c'est que les influences
tions, c'est que les influences
(S) En dehors des agrégés et des titu-
laires du C.A.P.E.S., il n'y a que 12 étu-
diants qui possèdent le Diplôme d'études
supérieures. Il s'agit vraisemblablement
d'étudiants qui voulaient préparer le
C.A.P.E.S. ou l'agrégation, et n'ont pu le
faire ou n'y ont pas réussi. Il y a donc fort
peu d'étudiants pour qui le D.E.S. appa-
raisse comme le couronnement des études
en faculté. Après la licence, tout se
passe comme si, chaque fois que le D.E.S.
n'apparaît plus comme un moyen indispen-
sable d'accès aux concours de recrutement
des professeurs, les étudiants préféraient
acquérir par d'autres voies une formation
complémentaire à celle de la licence.
laires du C.A.P.E.S., il n'y a que 12 étu-
diants qui possèdent le Diplôme d'études
supérieures. Il s'agit vraisemblablement
d'étudiants qui voulaient préparer le
C.A.P.E.S. ou l'agrégation, et n'ont pu le
faire ou n'y ont pas réussi. Il y a donc fort
peu d'étudiants pour qui le D.E.S. appa-
raisse comme le couronnement des études
en faculté. Après la licence, tout se
passe comme si, chaque fois que le D.E.S.
n'apparaît plus comme un moyen indispen-
sable d'accès aux concours de recrutement
des professeurs, les étudiants préféraient
acquérir par d'autres voies une formation
complémentaire à celle de la licence.
40
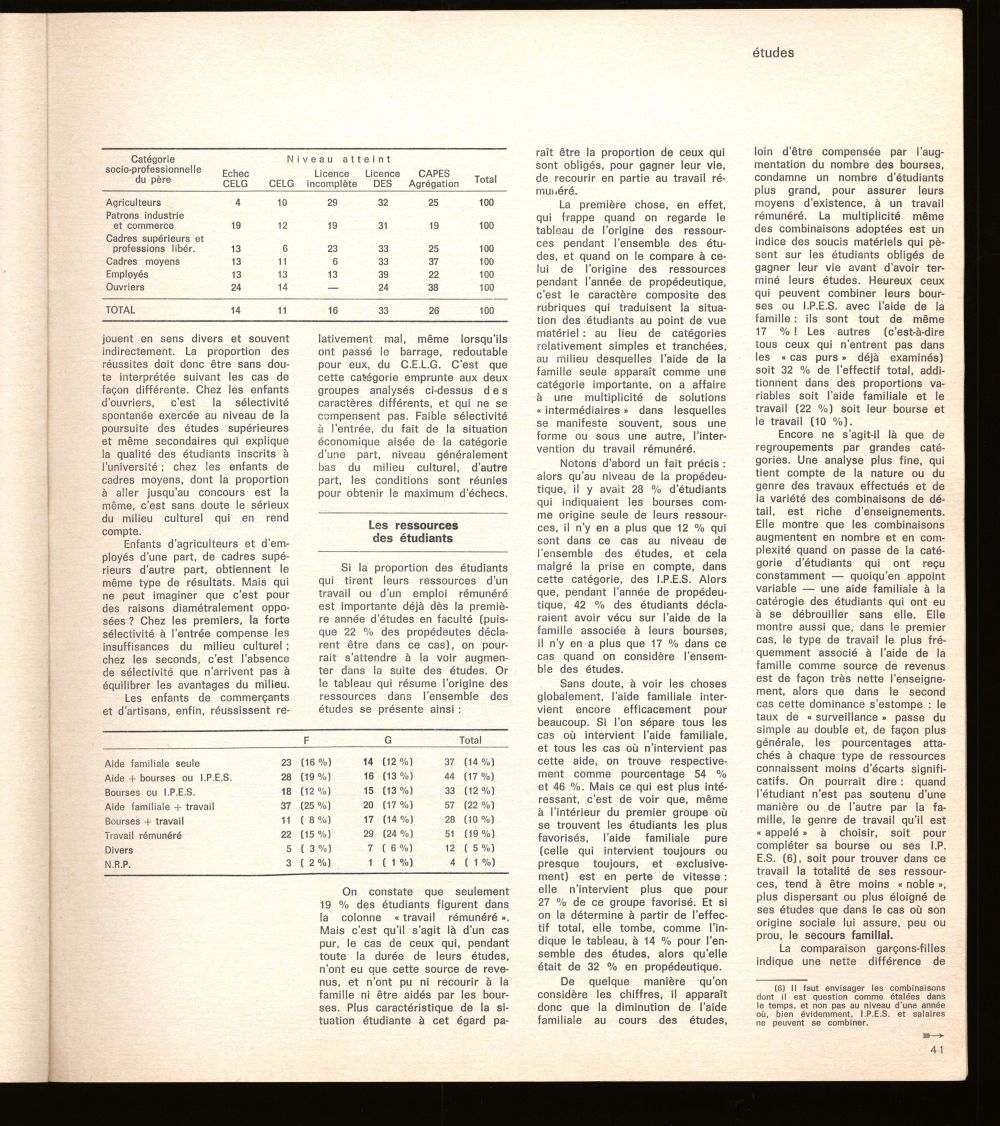

études
Catégorie
socio-professionnelle Echec
du père CELG
du père CELG
Niveau atteint
Licence Licence CAPES
CELG incomplète DES Agrégation
CELG incomplète DES Agrégation
Total
Agriculteurs
4
10
29
32
25
100
4
10
29
32
25
100
Patrons industrie
et commerce
19
12
19
31
19
100
19
12
19
31
19
100
Cadres supérieurs et professions liber.
13
6
23
33
25
100
13
6
23
33
25
100
Cadres moyens
13
11
6
33
37
100
13
11
6
33
37
100
Employés
13
13
13
39
22
100
13
13
13
39
22
100
Ouvriers
24
14
—
24
38
100
24
14
—
24
38
100
TOTAL
14
11
16
33
26
100
14
11
16
33
26
100
jouent en sens divers et souvent
indirectement. La proportion des
réussites doit donc être sans dou-
te interprétée suivant les cas de
façon différente. Chez les enfants
d'ouvriers, c'est la sélectivité
spontanée exercée au niveau de la
poursuite des études supérieures
et même secondaires qui explique
la qualité des étudiants inscrits à
l'université ; chez les enfants de
cadres moyens, dont la proportion
à aller jusqu'au concours est la
même, c'est sans doute le sérieux
du milieu culturel qui en rend
compte.
indirectement. La proportion des
réussites doit donc être sans dou-
te interprétée suivant les cas de
façon différente. Chez les enfants
d'ouvriers, c'est la sélectivité
spontanée exercée au niveau de la
poursuite des études supérieures
et même secondaires qui explique
la qualité des étudiants inscrits à
l'université ; chez les enfants de
cadres moyens, dont la proportion
à aller jusqu'au concours est la
même, c'est sans doute le sérieux
du milieu culturel qui en rend
compte.
Enfants d'agriculteurs et d'em-
ployés d'une part, de cadres supé-
rieurs d'autre part, obtiennent le
même type de résultats. Mais qui
ne peut imaginer que c'est pour
des raisons diamétralement oppo-
sées ? Chez les premiers, la forte
sélectivité à l'entrée compense les
insuffisances du milieu culturel ;
chez les seconds, c'est l'absence
de sélectivité que n'arrivent pas à
équilibrer les avantages du milieu.
ployés d'une part, de cadres supé-
rieurs d'autre part, obtiennent le
même type de résultats. Mais qui
ne peut imaginer que c'est pour
des raisons diamétralement oppo-
sées ? Chez les premiers, la forte
sélectivité à l'entrée compense les
insuffisances du milieu culturel ;
chez les seconds, c'est l'absence
de sélectivité que n'arrivent pas à
équilibrer les avantages du milieu.
Les enfants de commerçants
et d'artisans, enfin, réussissent re-
et d'artisans, enfin, réussissent re-
lativement mal, même lorsqu'ils
ont passé le barrage, redoutable
pour eux, du C.E.L.G. C'est que
cette catégorie emprunte aux deux
groupes analysés ci-dessus des
caractères différents, et qui ne se
compensent pas. Faible sélectivité
à l'entrée, du fait de la situation
économique aisée de la catégorie
d'une part, niveau généralement
bas du milieu culturel, d'autre
part, les conditions sont réunies
pour obtenir le maximum d'échecs.
ont passé le barrage, redoutable
pour eux, du C.E.L.G. C'est que
cette catégorie emprunte aux deux
groupes analysés ci-dessus des
caractères différents, et qui ne se
compensent pas. Faible sélectivité
à l'entrée, du fait de la situation
économique aisée de la catégorie
d'une part, niveau généralement
bas du milieu culturel, d'autre
part, les conditions sont réunies
pour obtenir le maximum d'échecs.
Les ressources
des étudiants
des étudiants
Si la proportion des étudiants
qui tirent leurs ressources d'un
travail ou d'un emploi rémunéré
est importante déjà dès la premiè-
re année d'études en faculté (puis-
que 22 % des propédeutes décla-
rent être dans ce cas), on pour-
rait s'attendre à la voir augmen-
ter dans la suite des études. Or
le tableau qui résume l'origine des
ressources dans l'ensemble des
études se présente ainsi :
qui tirent leurs ressources d'un
travail ou d'un emploi rémunéré
est importante déjà dès la premiè-
re année d'études en faculté (puis-
que 22 % des propédeutes décla-
rent être dans ce cas), on pour-
rait s'attendre à la voir augmen-
ter dans la suite des études. Or
le tableau qui résume l'origine des
ressources dans l'ensemble des
études se présente ainsi :
Total
Aide familiale seule
23
(16%)
14
(12 %
') 37
(14 %)
23
(16%)
14
(12 %
') 37
(14 %)
Aide + bourses ou I.P.E.S.
28
(19 %)
16
(13%
0 44
(17 %)
28
(19 %)
16
(13%
0 44
(17 %)
Bourses ou I.P.E.S.
18
flO 0' 1
HZ /oj
15
(13 %
i) 33
(12 %)
18
flO 0' 1
HZ /oj
15
(13 %
i) 33
(12 %)
Aide familiale + travail
37
rrjc O/ 1
Uo /oJ
20
(17%
0 57
foo o/ i \d.<L Voj
37
rrjc O/ 1
Uo /oJ
20
(17%
0 57
foo o/ i \d.<L Voj
Bourses + travail
11
(o o/ 1 o /oJ
17
(14 %
i) 28
(10 %)
11
(o o/ 1 o /oJ
17
(14 %
i) 28
(10 %)
Travail rémunéré
22
(15 %)
29
(24 %
i) 51
(19%)
22
(15 %)
29
(24 %
i) 51
(19%)
Divers
5
(o o/ 1 O /oJ
7
( 6%
) 12
( 5 %)
5
(o o/ 1 O /oJ
7
( 6%
) 12
( 5 %)
N.R.P.
3
( 2 %)
1
( 1 %
') 4
[ 1 %)
3
( 2 %)
1
( 1 %
') 4
[ 1 %)
On constate que seulement
19 % des étudiants figurent dans
la colonne « travail rémunéré ».
Mais c'est qu'il s'agit là d'un cas
pur, le cas de ceux qui, pendant
toute la durée de leurs études,
n'ont eu que cette source de reve-
nus, et n'ont pu ni recourir à la
famille ni être aidés par les bour-
ses. Plus caractéristique de la si-
tuation étudiante à cet égard pa-
19 % des étudiants figurent dans
la colonne « travail rémunéré ».
Mais c'est qu'il s'agit là d'un cas
pur, le cas de ceux qui, pendant
toute la durée de leurs études,
n'ont eu que cette source de reve-
nus, et n'ont pu ni recourir à la
famille ni être aidés par les bour-
ses. Plus caractéristique de la si-
tuation étudiante à cet égard pa-
raît être la proportion de ceux qui
sont obligés, pour gagner leur vie,
de recourir en partie au travail ré-
mui.éré.
sont obligés, pour gagner leur vie,
de recourir en partie au travail ré-
mui.éré.
La première chose, en effet,
qui frappe quand on regarde le
tableau de l'origine des ressour-
ces pendant l'ensemble des étu-
des, et quand on le compare à ce-
lui de l'origine des ressources
pendant l'année de propédeutique,
c'est le caractère composite des
rubriques qui traduisent la situa-
tion des étudiants au point de vue
matériel : au lieu de catégories
relativement simples et tranchées,
au milieu desquelles l'aide de la
famille seule apparaît comme une
catégorie importante, on a affaire
à une multiplicité de solutions
« intermédiaires » dans lesquelles
se manifeste souvent, sous une
forme ou sous une autre, l'inter-
vention du travail rémunéré.
qui frappe quand on regarde le
tableau de l'origine des ressour-
ces pendant l'ensemble des étu-
des, et quand on le compare à ce-
lui de l'origine des ressources
pendant l'année de propédeutique,
c'est le caractère composite des
rubriques qui traduisent la situa-
tion des étudiants au point de vue
matériel : au lieu de catégories
relativement simples et tranchées,
au milieu desquelles l'aide de la
famille seule apparaît comme une
catégorie importante, on a affaire
à une multiplicité de solutions
« intermédiaires » dans lesquelles
se manifeste souvent, sous une
forme ou sous une autre, l'inter-
vention du travail rémunéré.
Notons d'abord un fait précis :
alors qu'au niveau de la propédeu-
tique, il y avait 23 % d'étudiants
qui indiquaient les bourses com-
me origine seule de leurs ressour-
ces, il n'y en a plus que 12 % qui
sont dans ce cas au niveau de
l'ensemble des études, et cela
malgré la prise en compte, dans
cette catégorie, des I.P.E.S. Alors
que, pendant l'année de propédeu-
tique, 42 % des étudiants décla-
raient avoir vécu sur l'aide de la
famille associée à leurs bourses,
il n'y en a plus que 17 % dans ce
cas quand on considère l'ensem-
ble des études.
alors qu'au niveau de la propédeu-
tique, il y avait 23 % d'étudiants
qui indiquaient les bourses com-
me origine seule de leurs ressour-
ces, il n'y en a plus que 12 % qui
sont dans ce cas au niveau de
l'ensemble des études, et cela
malgré la prise en compte, dans
cette catégorie, des I.P.E.S. Alors
que, pendant l'année de propédeu-
tique, 42 % des étudiants décla-
raient avoir vécu sur l'aide de la
famille associée à leurs bourses,
il n'y en a plus que 17 % dans ce
cas quand on considère l'ensem-
ble des études.
Sans doute, à voir les choses
globalement, l'aide familiale inter-
vient encore efficacement pour
beaucoup. Si l'on sépare tous les
cas où intervient l'aide familiale,
et tous les cas où n'intervient pas
cette aide, on trouve respective-
ment comme pourcentage 54 %
et 46 %. Mais ce qui est plus inté-
ressant, c'est de voir que, même
à l'intérieur du premier groupe où
se trouvent les étudiants les plus
favorisés, l'aide familiale pure
(celle qui intervient toujours ou
presque toujours, et exclusive-
ment) est en perte de vitesse :
elle n'intervient plus que pour
27 % de ce groupe favorisé. Et si
on la détermine à partir de l'effec-
tif total, elle tombe, comme l'in-
dique le tableau, à 14 % pour l'en-
semble des études, alors qu'elle
était de 32 % en propédeutique.
globalement, l'aide familiale inter-
vient encore efficacement pour
beaucoup. Si l'on sépare tous les
cas où intervient l'aide familiale,
et tous les cas où n'intervient pas
cette aide, on trouve respective-
ment comme pourcentage 54 %
et 46 %. Mais ce qui est plus inté-
ressant, c'est de voir que, même
à l'intérieur du premier groupe où
se trouvent les étudiants les plus
favorisés, l'aide familiale pure
(celle qui intervient toujours ou
presque toujours, et exclusive-
ment) est en perte de vitesse :
elle n'intervient plus que pour
27 % de ce groupe favorisé. Et si
on la détermine à partir de l'effec-
tif total, elle tombe, comme l'in-
dique le tableau, à 14 % pour l'en-
semble des études, alors qu'elle
était de 32 % en propédeutique.
De quelque manière qu'on
considère les chiffres, il apparaît
donc que la diminution de l'aide
familiale au cours des études,
considère les chiffres, il apparaît
donc que la diminution de l'aide
familiale au cours des études,
loin d'être compensée par l'aug-
mentation du nombre des bourses,
condamne un nombre d'étudiants
plus grand, pour assurer leurs
moyens d'existence, à un travail
rémunéré. La multiplicité même
des combinaisons adoptées est un
indice des soucis matériels qui pè-
sent sur les étudiants obligés de
gagner leur vie avant d'avoir ter-
miné leurs études. Heureux ceux
qui peuvent combiner leurs bour-
ses ou I.P.E.S. avec l'aide de la
famille : ils sont tout de même
17 % ! Les autres (c'est-à-dire
tous ceux qui n'entrent pas dans
les « cas purs » déjà examinés)
soit 32 % de l'effectif total, addi-
tionnent dans des proportions va-
riables soit l'aide familiale et le
travail (22 %) soit leur bourse et
le travail (10 %).
mentation du nombre des bourses,
condamne un nombre d'étudiants
plus grand, pour assurer leurs
moyens d'existence, à un travail
rémunéré. La multiplicité même
des combinaisons adoptées est un
indice des soucis matériels qui pè-
sent sur les étudiants obligés de
gagner leur vie avant d'avoir ter-
miné leurs études. Heureux ceux
qui peuvent combiner leurs bour-
ses ou I.P.E.S. avec l'aide de la
famille : ils sont tout de même
17 % ! Les autres (c'est-à-dire
tous ceux qui n'entrent pas dans
les « cas purs » déjà examinés)
soit 32 % de l'effectif total, addi-
tionnent dans des proportions va-
riables soit l'aide familiale et le
travail (22 %) soit leur bourse et
le travail (10 %).
Encore ne s'agit-il là que de
regroupements par grandes caté-
gories. Une analyse plus fine, qui
tient compte de la nature ou du
genre des travaux effectués et de
la variété des combinaisons de dé-
tail, est riche d'enseignements.
Elle montre que les combinaisons
augmentent en nombre et en com-
plexité quand on passe de la caté-
gorie d'étudiants qui ont reçu
constamment — quoiqu'en appoint
variable — une aide familiale à la
catérogie des étudiants qui ont eu
à se débrouiller sans elle. Elle
montre aussi que, dans le premier
cas, le type de travail le plus fré-
quemment associé à l'aide de la
famille comme source de revenus
est de façon très nette l'enseigne-
ment, alors que dans le second
cas cette dominance s'estompe : le
taux de « surveillance » passe du
simple au double et, de façon plus
générale, les pourcentages atta-
chés à chaque type de ressources
connaissent moins d'écarts signifi-
catifs. On pourrait dire : quand
l'étudiant n'est pas soutenu d'une
manière ou de l'autre par la fa-
mille, le genre de travail qu'il est
« appelé » à choisir, soit pour
compléter sa bourse ou ses I.P.
E.S. (6), soit pour trouver dans ce
travail la totalité de ses ressour-
ces, tend à être moins « noble »,
plus dispersant ou plus éloigné de
ses études que dans le cas où son
origine sociale lui assure, peu ou
prou, le secours familial.
regroupements par grandes caté-
gories. Une analyse plus fine, qui
tient compte de la nature ou du
genre des travaux effectués et de
la variété des combinaisons de dé-
tail, est riche d'enseignements.
Elle montre que les combinaisons
augmentent en nombre et en com-
plexité quand on passe de la caté-
gorie d'étudiants qui ont reçu
constamment — quoiqu'en appoint
variable — une aide familiale à la
catérogie des étudiants qui ont eu
à se débrouiller sans elle. Elle
montre aussi que, dans le premier
cas, le type de travail le plus fré-
quemment associé à l'aide de la
famille comme source de revenus
est de façon très nette l'enseigne-
ment, alors que dans le second
cas cette dominance s'estompe : le
taux de « surveillance » passe du
simple au double et, de façon plus
générale, les pourcentages atta-
chés à chaque type de ressources
connaissent moins d'écarts signifi-
catifs. On pourrait dire : quand
l'étudiant n'est pas soutenu d'une
manière ou de l'autre par la fa-
mille, le genre de travail qu'il est
« appelé » à choisir, soit pour
compléter sa bourse ou ses I.P.
E.S. (6), soit pour trouver dans ce
travail la totalité de ses ressour-
ces, tend à être moins « noble »,
plus dispersant ou plus éloigné de
ses études que dans le cas où son
origine sociale lui assure, peu ou
prou, le secours familial.
La comparaison garçons-filles
indique une nette différence de
indique une nette différence de
(G) II faut envisager les combinaisons
dont il est question comme étalées dans
le temps, et non pas au niveau d'une année
où, bien évidemment, I.P.E.S. et salaires
ne peuvent se combiner.
dont il est question comme étalées dans
le temps, et non pas au niveau d'une année
où, bien évidemment, I.P.E.S. et salaires
ne peuvent se combiner.
41
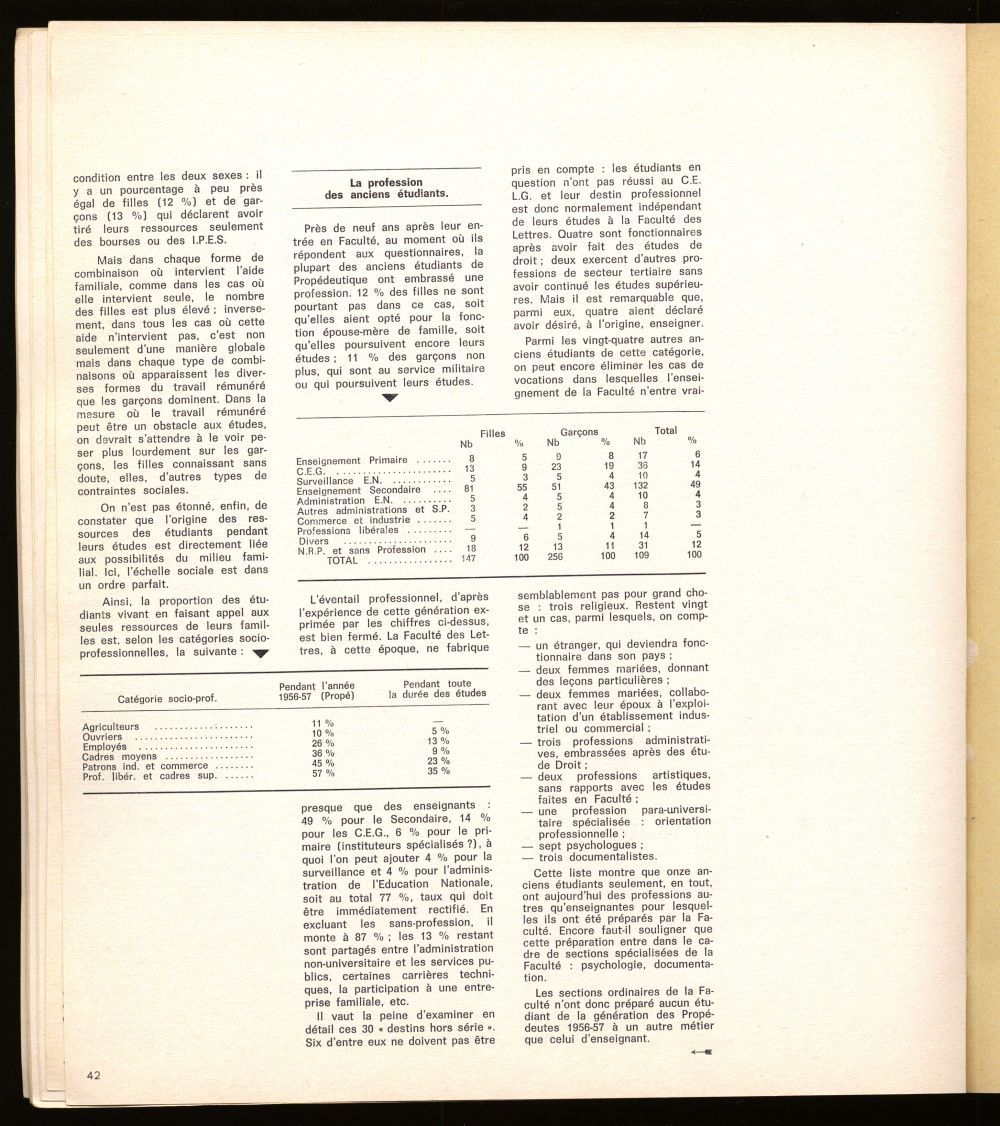

condition entre les deux sexes : il
y a un pourcentage à peu près
égal de filles (12 %) et de gar-
çons (13 %) qui déclarent avoir
tiré leurs ressources seulement
des bourses ou des I.P.E.S.
y a un pourcentage à peu près
égal de filles (12 %) et de gar-
çons (13 %) qui déclarent avoir
tiré leurs ressources seulement
des bourses ou des I.P.E.S.
Mais dans chaque forme de
combinaison où intervient l'aide
familiale, comme dans les cas où
elle intervient soûle, le nombre
des filles est plus élevé ; inverse-
ment, dans tous les cas où cette
aide n'intervient pas, c'est non
seulement d'une manière globale
mais dans chaque type de combi-
naisons où apparaissent les diver-
ses formes du travail rémunéré
que les garçons dominent. Dans la
masure où le travail rémunéré
peut être un obstacle aux études,
on devrait s'attendre à le voir pe-
ser plus lourdement sur les gar-
çons, les filles connaissant sans
doute, elles, d'autres types de
contraintes sociales.
combinaison où intervient l'aide
familiale, comme dans les cas où
elle intervient soûle, le nombre
des filles est plus élevé ; inverse-
ment, dans tous les cas où cette
aide n'intervient pas, c'est non
seulement d'une manière globale
mais dans chaque type de combi-
naisons où apparaissent les diver-
ses formes du travail rémunéré
que les garçons dominent. Dans la
masure où le travail rémunéré
peut être un obstacle aux études,
on devrait s'attendre à le voir pe-
ser plus lourdement sur les gar-
çons, les filles connaissant sans
doute, elles, d'autres types de
contraintes sociales.
On n'est pas étonné, enfin, de
constater que l'origine des res-
sources des étudiants pendant
leurs études est directement liée
aux possibilités du milieu fami-
lial. Ici, l'échelle sociale est dans
un ordre parfait.
constater que l'origine des res-
sources des étudiants pendant
leurs études est directement liée
aux possibilités du milieu fami-
lial. Ici, l'échelle sociale est dans
un ordre parfait.
Ainsi, la proportion des étu-
diants vivant en faisant appel aux
seules ressources de leurs famil-
les est, selon les catégories socio-
professionnelles, la suivante : -mir
diants vivant en faisant appel aux
seules ressources de leurs famil-
les est, selon les catégories socio-
professionnelles, la suivante : -mir
La profession
des anciens étudiants.
des anciens étudiants.
Près de neuf ans après leur en-
trée en Faculté, au moment où ils
répondent aux questionnaires, la
plupart des anciens étudiants de
Propédeutique ont embrassé une
profession. 12 % des filles ne sont
pourtant pas dans ce cas, soit
qu'elles aient opté pour la fonc-
tion épouse-mère de famille, soit
qu'elles poursuivent encore leurs
études ; 11 % des garçons non
plus, qui sont au service militaire
ou qui poursuivent leurs études.
trée en Faculté, au moment où ils
répondent aux questionnaires, la
plupart des anciens étudiants de
Propédeutique ont embrassé une
profession. 12 % des filles ne sont
pourtant pas dans ce cas, soit
qu'elles aient opté pour la fonc-
tion épouse-mère de famille, soit
qu'elles poursuivent encore leurs
études ; 11 % des garçons non
plus, qui sont au service militaire
ou qui poursuivent leurs études.
pris en compte : les étudiants en
question n'ont pas réussi au C.E.
L.G. et leur destin professionnel
est donc normalement indépendant
de leurs études à la Faculté des
Lettres. Quatre sont fonctionnaires
après avoir fait des études de
droit ; deux exercent d'autres pro-
fessions de secteur tertiaire sans
avoir continué les études supérieu-
res. Mais il est remarquable que,
parmi eux, quatre aient déclaré
avoir désiré, à l'origine, enseigner.
Parmi les vingt-quatre autres an-
ciens étudiants de cette catégorie,
on peut encore éliminer les cas de
vocations dans lesquelles l'ensei-
gnement de la Faculté n'entre vrai-
question n'ont pas réussi au C.E.
L.G. et leur destin professionnel
est donc normalement indépendant
de leurs études à la Faculté des
Lettres. Quatre sont fonctionnaires
après avoir fait des études de
droit ; deux exercent d'autres pro-
fessions de secteur tertiaire sans
avoir continué les études supérieu-
res. Mais il est remarquable que,
parmi eux, quatre aient déclaré
avoir désiré, à l'origine, enseigner.
Parmi les vingt-quatre autres an-
ciens étudiants de cette catégorie,
on peut encore éliminer les cas de
vocations dans lesquelles l'ensei-
gnement de la Faculté n'entre vrai-
Filles
Garçons
Total
Garçons
Total
Nb
%
Nb
%
Nb
%
%
Nb
%
Nb
%
3
5
g
8
17
6
5
g
8
17
6
c r- G
13
9
23
19
36
14
13
9
23
19
36
14
5
3
5
4
10
4
3
5
4
10
4
Enseignement Secondaire ....
81
55
51
43
132
49
81
55
51
43
132
49
5
4
5
4
10
4
4
5
4
10
4
Autres administrations et S. P.
3
2
5
4
8
3
3
2
5
4
8
3
Commerce et industrie
5
4
2
2
7
3
5
4
2
2
7
3
Professions libérales .........
1
1
1
1
1
Divers
9
6
5
4
14
5
9
6
5
4
14
5
N.R.P. et sans Profession ....
18
12
13
11
31
12
18
12
13
11
31
12
TOTAL . . .
1 47
100
256
100
109
100
1 47
100
256
100
109
100
L'éventail professionnel, d'après
l'expérience de cette génération ex-
primée par les chiffres ci-dessus,
est bien fermé. La Faculté des Let-
tres, a cette époque, ne fabrique
l'expérience de cette génération ex-
primée par les chiffres ci-dessus,
est bien fermé. La Faculté des Let-
tres, a cette époque, ne fabrique
Catégorie socio-prof.
Pendant l'année 1956-57 (Propé)
Pendant toute la durée des études
Pendant l'année 1956-57 (Propé)
Pendant toute la durée des études
Agriculteurs . ...
11 %
11 %
Ouvriers
10 %
5 %
10 %
5 %
Employés ..............
26 %
13 %
26 %
13 %
Cadres moyens
36 %
9 %
36 %
9 %
Patrons ind. et commerce ......
45 %
23 %
45 %
23 %
Prof, liber, et cadres sup ......
57 %
35 %
57 %
35 %
presque que des enseignants :
49 % pour le Secondaire, 14 %
pour les C.E.G., 6 % pour le pri-
maire (instituteurs spécialisés?), à
quoi l'on peut ajouter 4 % pour la
surveillance et 4 % pour l'adminis-
tration de l'Education Nationale,
soit au total 77 %, taux qui doit
être immédiatement rectifié. En
excluant les sans-profession, il
monte à 87 % ; les 13 % restant
sont partagés entre l'administration
non-universitaire et les services pu-
blics, certaines carrières techni-
ques, la participation à une entre-
prise familiale, etc.
49 % pour le Secondaire, 14 %
pour les C.E.G., 6 % pour le pri-
maire (instituteurs spécialisés?), à
quoi l'on peut ajouter 4 % pour la
surveillance et 4 % pour l'adminis-
tration de l'Education Nationale,
soit au total 77 %, taux qui doit
être immédiatement rectifié. En
excluant les sans-profession, il
monte à 87 % ; les 13 % restant
sont partagés entre l'administration
non-universitaire et les services pu-
blics, certaines carrières techni-
ques, la participation à une entre-
prise familiale, etc.
Il vaut la peine d'examiner en
détail ces 30 « destins hors série ».
Six d'entre eux ne doivent pas être
détail ces 30 « destins hors série ».
Six d'entre eux ne doivent pas être
semblablement pas pour grand cho-
se : trois religieux. Restent vingt
et un cas, parmi lesquels, on comp-
te :
se : trois religieux. Restent vingt
et un cas, parmi lesquels, on comp-
te :
— un étranger, qui deviendra fonc-
tionnaire dans son pays ;
tionnaire dans son pays ;
— deux femmes mariées, donnant
des leçons particulières ;
des leçons particulières ;
— deux femmes mariées, collabo-
rant avec leur époux à l'exploi-
tation d'un établissement indus-
triel ou commercial ;
rant avec leur époux à l'exploi-
tation d'un établissement indus-
triel ou commercial ;
— trois professions administrati-
ves, embrassées après des étu-
de Droit ;
ves, embrassées après des étu-
de Droit ;
— deux professions artistiques,
sans rapports avec les études
faites en Faculté ;
sans rapports avec les études
faites en Faculté ;
— une profession para-universi-
taire spécialisée : orientation
professionnelle ;
taire spécialisée : orientation
professionnelle ;
— sept psychologues ;
— trois documentalistes.
Cette liste montre que onze an-
ciens étudiants seulement, en tout,
ont aujourd'hui des professions au-
tres qu'enseignantes pour lesquel-
les ils ont été préparés par la Fa-
culté. Encore faut-il souligner que
cette préparation entre dans le ca-
dre de sections spécialisées de la
Faculté : psychologie, documenta-
tion.
ciens étudiants seulement, en tout,
ont aujourd'hui des professions au-
tres qu'enseignantes pour lesquel-
les ils ont été préparés par la Fa-
culté. Encore faut-il souligner que
cette préparation entre dans le ca-
dre de sections spécialisées de la
Faculté : psychologie, documenta-
tion.
Les sections ordinaires de la Fa-
culté n'ont donc préparé aucun étu-
diant de la génération des Propé-
deutes 1956-57 à un autre métier
que celui d'enseignant.
culté n'ont donc préparé aucun étu-
diant de la génération des Propé-
deutes 1956-57 à un autre métier
que celui d'enseignant.
42
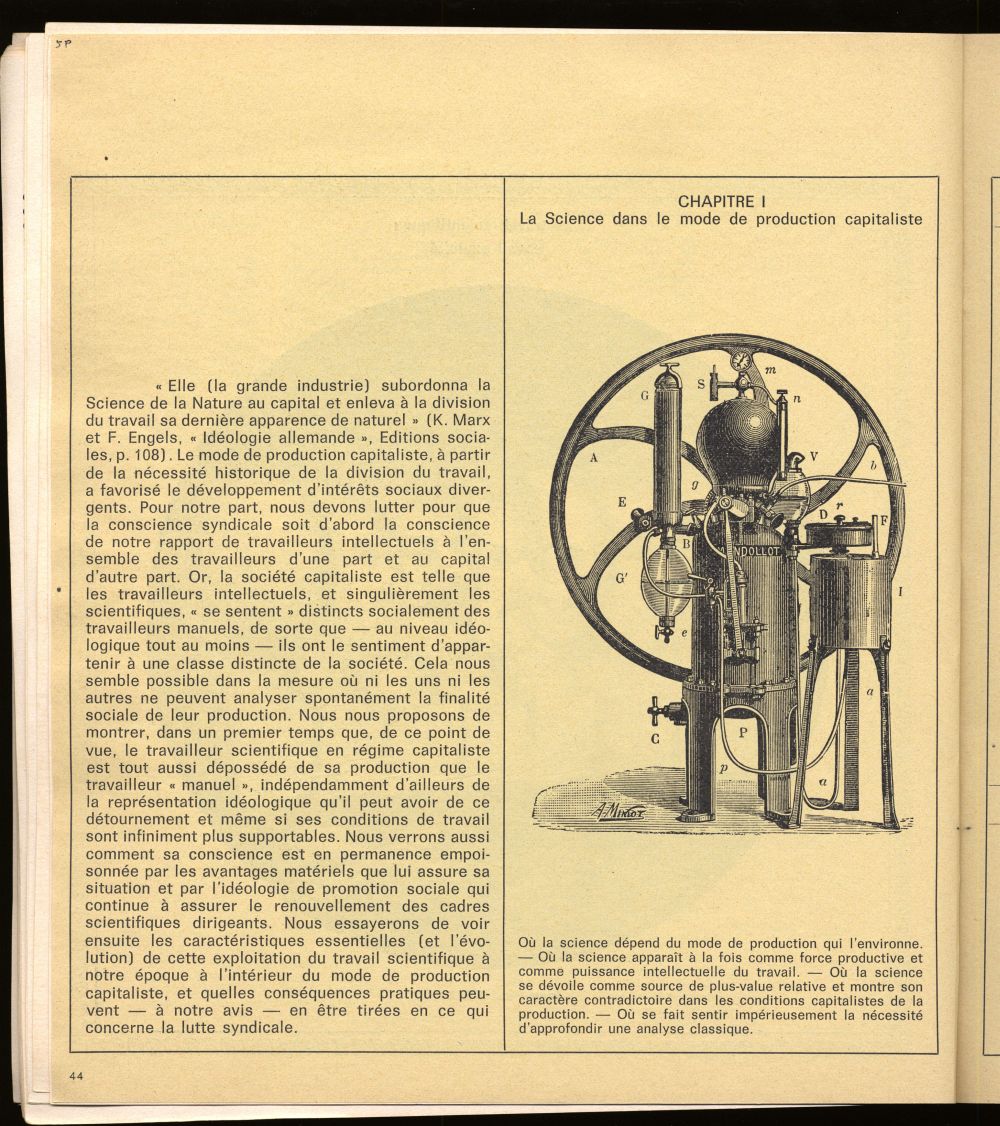

« Elle (la grande industrie) subordonna la
Science de la Nature au capital et enleva à la division
du travail sa dernière apparence de naturel » (K. Marx
et F. Engels, « Idéologie allemande », Editions socia-
les, p. 108). Le mode de production capitaliste, à partir
de la nécessité historique de la division du travail,
a favorisé le développement d'intérêts sociaux diver-
gents. Pour notre part, nous devons lutter pour que
la conscience syndicale soit d'abord la conscience
de notre rapport de travailleurs intellectuels à l'en-
semble des travailleurs d'une part et au capital
d'autre part. Or, la société capitaliste est telle que
les travailleurs intellectuels, et singulièrement les
scientifiques, « se sentent » distincts socialement des
travailleurs manuels, de sorte que — au niveau idéo-
logique tout au moins — ils ont le sentiment d'appar-
tenir à une classe distincte de la société. Cela nous
semble possible dans la mesure où ni les uns ni les
autres ne peuvent analyser spontanément la finalité
sociale de leur production. Nous nous proposons de
montrer, dans un premier temps que, de ce point de
vue, le travailleur scientifique en régime capitaliste
est tout aussi dépossédé de sa production que le
travailleur « manuel », indépendamment d'ailleurs de
la représentation idéologique qu'il peut avoir de ce
détournement et même si ses conditions de travail
sont infiniment plus supportables. Nous verrons aussi
comment sa conscience est en permanence empoi-
sonnée par les avantages matériels que lui assure sa
situation et par l'idéologie de promotion sociale qui
continue à assurer le renouvellement des cadres
scientifiques dirigeants. Nous essayerons de voir
ensuite les caractéristiques essentielles (et l'évo-
lution) de cette exploitation du travail scientifique à
notre époque à l'intérieur du mode de production
capitaliste, et quelles conséquences pratiques peu-
vent — à notre avis — en être tirées en ce qui
concerne la lutte syndicale.
Science de la Nature au capital et enleva à la division
du travail sa dernière apparence de naturel » (K. Marx
et F. Engels, « Idéologie allemande », Editions socia-
les, p. 108). Le mode de production capitaliste, à partir
de la nécessité historique de la division du travail,
a favorisé le développement d'intérêts sociaux diver-
gents. Pour notre part, nous devons lutter pour que
la conscience syndicale soit d'abord la conscience
de notre rapport de travailleurs intellectuels à l'en-
semble des travailleurs d'une part et au capital
d'autre part. Or, la société capitaliste est telle que
les travailleurs intellectuels, et singulièrement les
scientifiques, « se sentent » distincts socialement des
travailleurs manuels, de sorte que — au niveau idéo-
logique tout au moins — ils ont le sentiment d'appar-
tenir à une classe distincte de la société. Cela nous
semble possible dans la mesure où ni les uns ni les
autres ne peuvent analyser spontanément la finalité
sociale de leur production. Nous nous proposons de
montrer, dans un premier temps que, de ce point de
vue, le travailleur scientifique en régime capitaliste
est tout aussi dépossédé de sa production que le
travailleur « manuel », indépendamment d'ailleurs de
la représentation idéologique qu'il peut avoir de ce
détournement et même si ses conditions de travail
sont infiniment plus supportables. Nous verrons aussi
comment sa conscience est en permanence empoi-
sonnée par les avantages matériels que lui assure sa
situation et par l'idéologie de promotion sociale qui
continue à assurer le renouvellement des cadres
scientifiques dirigeants. Nous essayerons de voir
ensuite les caractéristiques essentielles (et l'évo-
lution) de cette exploitation du travail scientifique à
notre époque à l'intérieur du mode de production
capitaliste, et quelles conséquences pratiques peu-
vent — à notre avis — en être tirées en ce qui
concerne la lutte syndicale.
CHAPITRE I
La Science dans le mode de production capitaliste
La Science dans le mode de production capitaliste
Où la science dépend du mode de production qui l'environne.
— Où la science apparaît à la fois comme force productive et
comme puissance intellectuelle du travail. — Où la science
se dévoile comme source de plus-value relative et montre son
caractère contradictoire dans les conditions capitalistes de la
production. — Où se fait sentir impérieusement la nécessité
d'approfondir une analyse classique.
— Où la science apparaît à la fois comme force productive et
comme puissance intellectuelle du travail. — Où la science
se dévoile comme source de plus-value relative et montre son
caractère contradictoire dans les conditions capitalistes de la
production. — Où se fait sentir impérieusement la nécessité
d'approfondir une analyse classique.
44
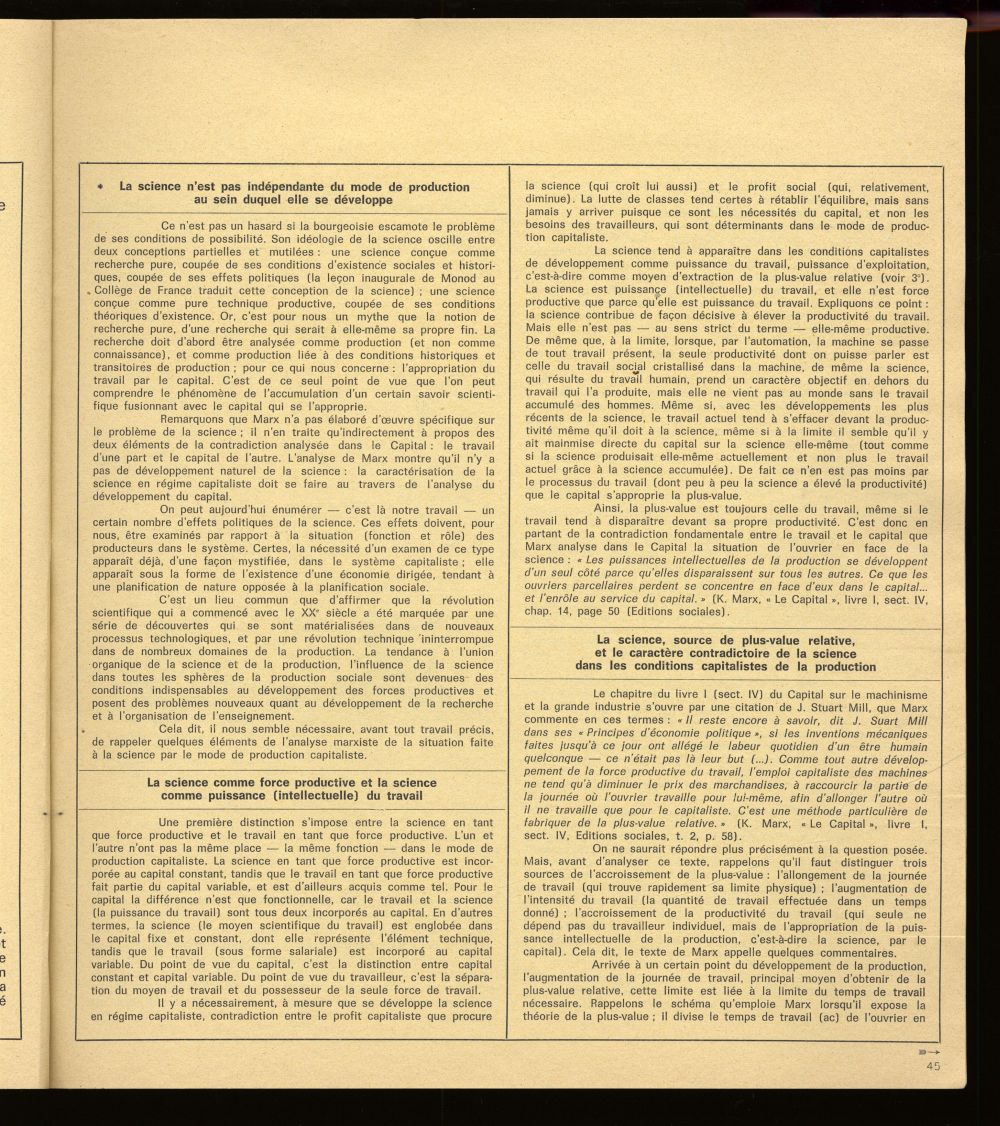

* La science n'est pas indépendante du mode de production
au sein duquel elle se développe
au sein duquel elle se développe
Ce n'est pas un hasard si la bourgeoisie escamote le problème
de ses conditions de possibilité. Son idéologie de la science oscille entre
deux conceptions partielles et mutilées : une science conçue comme
recherche pure, coupée de ses conditions d'existence sociales et histori-
ques, coupée de ses effets politiques (la leçon inaugurale de Monod au
„ Collège de France traduit cette conception de la science) ; une science
conçue comme pure technique productive, coupée de ses conditions
théoriques d'existence. Or, c'est pour nous un mythe que la notion de
recherche pure, d'une recherche qui serait à elle-même sa propre fin. La
recherche doit d'abord être analysée comme production (et non comme
connaissance), et comme production liée à des conditions historiques et
transitoires de production ; pour ce qui nous concerne : l'appropriation du
travail par le capital. C'est de ce seul point de vue que l'on peut
comprendre le phénomène de l'accumulation d'un certain savoir scienti-
fique fusionnant avec le capital qui se l'approprie.
de ses conditions de possibilité. Son idéologie de la science oscille entre
deux conceptions partielles et mutilées : une science conçue comme
recherche pure, coupée de ses conditions d'existence sociales et histori-
ques, coupée de ses effets politiques (la leçon inaugurale de Monod au
„ Collège de France traduit cette conception de la science) ; une science
conçue comme pure technique productive, coupée de ses conditions
théoriques d'existence. Or, c'est pour nous un mythe que la notion de
recherche pure, d'une recherche qui serait à elle-même sa propre fin. La
recherche doit d'abord être analysée comme production (et non comme
connaissance), et comme production liée à des conditions historiques et
transitoires de production ; pour ce qui nous concerne : l'appropriation du
travail par le capital. C'est de ce seul point de vue que l'on peut
comprendre le phénomène de l'accumulation d'un certain savoir scienti-
fique fusionnant avec le capital qui se l'approprie.
Remarquons que Marx n'a pas élaboré d'ceuvre spécifique sur
le problème de la science ; il n'en traite qu'indirectement à propos des
deux éléments de la contradiction analysée dans le Capital : le travail
d'une part et le capital de l'autre. L'analyse de Marx montre qu'il n'y a
pas de développement naturel de la science : la caractérisation de la
science en régime capitaliste doit se faire au travers de l'analyse du
développement du capital.
le problème de la science ; il n'en traite qu'indirectement à propos des
deux éléments de la contradiction analysée dans le Capital : le travail
d'une part et le capital de l'autre. L'analyse de Marx montre qu'il n'y a
pas de développement naturel de la science : la caractérisation de la
science en régime capitaliste doit se faire au travers de l'analyse du
développement du capital.
On peut aujourd'hui énumérer — c'est là notre travail — un
certain nombre d'effets politiques de la science. Ces effets doivent, pour
nous, être examinés par rapport à la situation (fonction et rôle) des
producteurs dans le système. Certes, la nécessité d'un examen de ce type
apparaît déjà, d'une façon mystifiée, dans le système capitaliste ; elle
apparaît sous la forme de l'existence d'une économie dirigée, tendant à
une planification de nature opposée à la planification sociale.
certain nombre d'effets politiques de la science. Ces effets doivent, pour
nous, être examinés par rapport à la situation (fonction et rôle) des
producteurs dans le système. Certes, la nécessité d'un examen de ce type
apparaît déjà, d'une façon mystifiée, dans le système capitaliste ; elle
apparaît sous la forme de l'existence d'une économie dirigée, tendant à
une planification de nature opposée à la planification sociale.
C'est un lieu commun que d'affirmer que la révolution
scientifique qui a commencé avec le X)C siècle a été marquée par une
série de découvertes qui se sont matérialisées dans de nouveaux
processus technologiques, et par une révolution technique 'ininterrompue
dans de nombreux domaines de la production. La tendance à l'union
organique de la science et de la production, l'influence de la science
dans toutes les sphères de la production sociale sont devenues des
conditions indispensables au développement des forces productives et
posent des problèmes nouveaux quant au développement de la recherche
et à l'organisation de l'enseignement.
scientifique qui a commencé avec le X)C siècle a été marquée par une
série de découvertes qui se sont matérialisées dans de nouveaux
processus technologiques, et par une révolution technique 'ininterrompue
dans de nombreux domaines de la production. La tendance à l'union
organique de la science et de la production, l'influence de la science
dans toutes les sphères de la production sociale sont devenues des
conditions indispensables au développement des forces productives et
posent des problèmes nouveaux quant au développement de la recherche
et à l'organisation de l'enseignement.
Cela dit, il nous semble nécessaire, avant tout travail précis,
de rappeler quelques éléments de l'analyse marxiste de la situation faite
à la science par le mode de production capitaliste.
de rappeler quelques éléments de l'analyse marxiste de la situation faite
à la science par le mode de production capitaliste.
La science comme force productive et la science
comme puissance (intellectuelle) du travail
comme puissance (intellectuelle) du travail
Une première distinction s'impose entre la science en tant
que force productive et le travail en tant que force productive. L'un et
l'autre n'ont pas la même place — la même fonction — dans le mode de
production capitaliste. La science en tant que force productive est incor-
porée au capital constant, tandis que le travail en tant que force productive
fait partie du capital variable, et est d'ailleurs acquis comme tel. Pour le
capital la différence n'est que fonctionnelle, car le travail et la science
(la puissance du travail) sont tous deux incorporés au capital. En d'autres
termes, la science (le moyen scientifique du travail) est englobée dans
le capital fixe et constant, dont elle représente l'élément technique,
tandis que le travail (sous forme salariale) est incorporé au capital
variable. Du point de vue du capital, c'est la distinction entre capital
constant et capital variable. Du point de vue du travailleur, c'est la sépara-
tion du moyen de travail et du possesseur de la seule force de travail.
que force productive et le travail en tant que force productive. L'un et
l'autre n'ont pas la même place — la même fonction — dans le mode de
production capitaliste. La science en tant que force productive est incor-
porée au capital constant, tandis que le travail en tant que force productive
fait partie du capital variable, et est d'ailleurs acquis comme tel. Pour le
capital la différence n'est que fonctionnelle, car le travail et la science
(la puissance du travail) sont tous deux incorporés au capital. En d'autres
termes, la science (le moyen scientifique du travail) est englobée dans
le capital fixe et constant, dont elle représente l'élément technique,
tandis que le travail (sous forme salariale) est incorporé au capital
variable. Du point de vue du capital, c'est la distinction entre capital
constant et capital variable. Du point de vue du travailleur, c'est la sépara-
tion du moyen de travail et du possesseur de la seule force de travail.
Il y a nécessairement, à mesure que se développe la science
en régime capitaliste, contradiction entre le profit capitaliste que procure
en régime capitaliste, contradiction entre le profit capitaliste que procure
la science (qui croît lui aussi) et le profit social (qui, relativement,
diminue). La lutte de classes tend certes à rétablir l'équilibre, mais sans
jamais y arriver puisque ce sont les nécessités du capital, et non les
besoins des travailleurs, qui sont déterminants dans le mode de produc-
tion capitaliste.
diminue). La lutte de classes tend certes à rétablir l'équilibre, mais sans
jamais y arriver puisque ce sont les nécessités du capital, et non les
besoins des travailleurs, qui sont déterminants dans le mode de produc-
tion capitaliste.
La science tend à apparaître dans les conditions capitalistes
de développement comme puissance du travail, puissance d'exploitation,
c'est-à-dire comme moyen d'extraction de la plus-value relative (voir 3°).
La science est puissance (intellectuelle) du travail, et elle n'est force
productive que parce qu'elle est puissance du travail. Expliquons ce point :
la science contribue de façon décisive à élever la productivité du travail.
Mais elle n'est pas — au sens strict du terme — elle-même productive.
De même que, à la limite, lorsque, par l'automation, la machine se passe
de tout travail présent, la seule productivité dont on puisse parler est
celle du travail socjal cristallisé dans la machine, de même la science,
qui résulte du travail humain, prend un caractère objectif en dehors du
travail qui l'a produite, mais elle ne vient pas au monde sans le travail
accumulé des hommes. Même si, avec les développements les plus
récents de la science, le travail actuel tend à s'effacer devant la produc-
tivité même qu'il doit à la science, même si à la limite il semble qu'il y
ait mainmise directe du capital sur la science elle-même (tout comme
si la science produisait elle-même actuellement et non plus le travail
actuel grâce à la science accumulée). De fait ce n'en est pas moins par
le processus du travail (dont peu à peu la science a élevé la productivité)
que le capital s'approprie la plus-value.
de développement comme puissance du travail, puissance d'exploitation,
c'est-à-dire comme moyen d'extraction de la plus-value relative (voir 3°).
La science est puissance (intellectuelle) du travail, et elle n'est force
productive que parce qu'elle est puissance du travail. Expliquons ce point :
la science contribue de façon décisive à élever la productivité du travail.
Mais elle n'est pas — au sens strict du terme — elle-même productive.
De même que, à la limite, lorsque, par l'automation, la machine se passe
de tout travail présent, la seule productivité dont on puisse parler est
celle du travail socjal cristallisé dans la machine, de même la science,
qui résulte du travail humain, prend un caractère objectif en dehors du
travail qui l'a produite, mais elle ne vient pas au monde sans le travail
accumulé des hommes. Même si, avec les développements les plus
récents de la science, le travail actuel tend à s'effacer devant la produc-
tivité même qu'il doit à la science, même si à la limite il semble qu'il y
ait mainmise directe du capital sur la science elle-même (tout comme
si la science produisait elle-même actuellement et non plus le travail
actuel grâce à la science accumulée). De fait ce n'en est pas moins par
le processus du travail (dont peu à peu la science a élevé la productivité)
que le capital s'approprie la plus-value.
Ainsi, la plus-value est toujours celle du travail, même si le
travail tend à disparaître devant sa propre productivité. C'est donc en
partant de la contradiction fondamentale entre le travail et le capital que
Marx analyse dans le Capital la situation de l'ouvrier en face de la
science : <* Les puissances intellectuelles de la production se développent
d'un seul côté parce qu'elles disparaissent sur tous les autres. Ce que les
ouvriers parcellaires perdent se concentre en face d'eux dans le capital...
et l'enrôle au service du capital. » (K. Marx, « Le Capital », livre I, sect. IV,
chap. 14, page 50 (Editions sociales).
travail tend à disparaître devant sa propre productivité. C'est donc en
partant de la contradiction fondamentale entre le travail et le capital que
Marx analyse dans le Capital la situation de l'ouvrier en face de la
science : <* Les puissances intellectuelles de la production se développent
d'un seul côté parce qu'elles disparaissent sur tous les autres. Ce que les
ouvriers parcellaires perdent se concentre en face d'eux dans le capital...
et l'enrôle au service du capital. » (K. Marx, « Le Capital », livre I, sect. IV,
chap. 14, page 50 (Editions sociales).
La science, source de plus-value relative,
et le caractère contradictoire de la science
dans les conditions capitalistes de la production
Le chapitre du livre I (sect. IV) du Capital sur le machinisme
et la grande industrie s'ouvre par une citation de J. Stuart Mil), que Marx
commente en ces termes : « // resfe encore à savoir, dit J. Suart Mill
dans ses « Principes d'économie politique », si les inventions mécaniques
faites jusqu'à ce jour ont allégé le labeur quotidien d'un être humain
que/conque — ce n'était pas là leur but (...). Comme tout autre dévelop-
pement de la force productive du travail, l'emploi capitaliste des machines
ne tend qu'à diminuer le prix des marchandises, à raccourcir la partie de
la journée où l'ouvrier travaille pour lui-même, afin d'allonger l'autre où
il ne travaille que pour le capitaliste. C'est une méthode particulière de
fabriquer de la plus-value relative. » (K. Marx, « Le Capital », livre I,
sect. IV, Editions sociales, t. 2, p. 58).
et la grande industrie s'ouvre par une citation de J. Stuart Mil), que Marx
commente en ces termes : « // resfe encore à savoir, dit J. Suart Mill
dans ses « Principes d'économie politique », si les inventions mécaniques
faites jusqu'à ce jour ont allégé le labeur quotidien d'un être humain
que/conque — ce n'était pas là leur but (...). Comme tout autre dévelop-
pement de la force productive du travail, l'emploi capitaliste des machines
ne tend qu'à diminuer le prix des marchandises, à raccourcir la partie de
la journée où l'ouvrier travaille pour lui-même, afin d'allonger l'autre où
il ne travaille que pour le capitaliste. C'est une méthode particulière de
fabriquer de la plus-value relative. » (K. Marx, « Le Capital », livre I,
sect. IV, Editions sociales, t. 2, p. 58).
On ne saurait répondre plus précisément à la question posée.
Mais, avant d'analyser ce texte, rappelons qu'il faut distinguer trois
sources de l'accroissement de la plus-value : l'allongement de la journée
de travail (qui trouve rapidement sa limite physique) ; l'augmentation de
l'intensité du travail (la quantité de travail effectuée dans un temps
donné) ; l'accroissement de la productivité du travail (qui seule ne
dépend pas du travailleur individuel, mais de l'appropriation de la puis-
sance intellectuelle de la production, c'est-à-dire la science, par le
capital). Cela dit, le texte de Marx appelle quelques commentaires.
Mais, avant d'analyser ce texte, rappelons qu'il faut distinguer trois
sources de l'accroissement de la plus-value : l'allongement de la journée
de travail (qui trouve rapidement sa limite physique) ; l'augmentation de
l'intensité du travail (la quantité de travail effectuée dans un temps
donné) ; l'accroissement de la productivité du travail (qui seule ne
dépend pas du travailleur individuel, mais de l'appropriation de la puis-
sance intellectuelle de la production, c'est-à-dire la science, par le
capital). Cela dit, le texte de Marx appelle quelques commentaires.
Arrivée à un certain point du développement de la production,
l'augmentation de la journée de travail, principal moyen d'obtenir de la
plus-value relative, cette limite est liée à la limite du temps de travail
nécessaire. Rappelons le schéma qu'emploie Marx lorsqu'il expose la
théorie de la plus-value ; il divise le temps de travail (ac) de l'ouvrier en
l'augmentation de la journée de travail, principal moyen d'obtenir de la
plus-value relative, cette limite est liée à la limite du temps de travail
nécessaire. Rappelons le schéma qu'emploie Marx lorsqu'il expose la
théorie de la plus-value ; il divise le temps de travail (ac) de l'ouvrier en
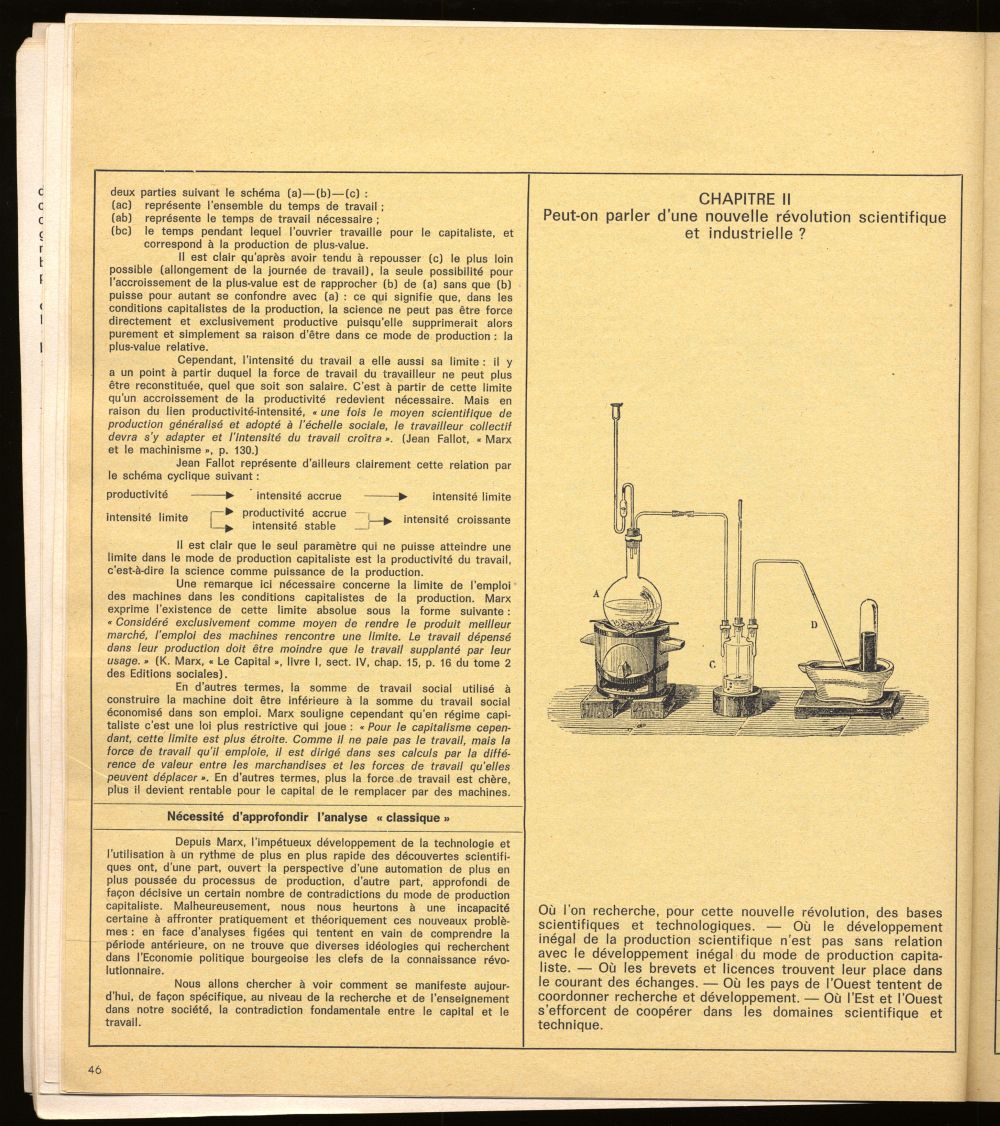

deux parties suivant le schéma (a)—(b)—(c) :
Cac) représente l'ensemble du temps de travail ;
(ab) représente le temps de travail nécessaire ;
Cac) représente l'ensemble du temps de travail ;
(ab) représente le temps de travail nécessaire ;
(bc) le temps pendant lequel l'ouvrier travaille pour le capitaliste, et
correspond à la production de plus-value.
correspond à la production de plus-value.
Il est clair qu'après avoir tendu à repousser (c) le plus loin
possible (allongement de la journée de travail), la seule possibilité pour
l'accroissement de la plus-value est de rapprocher (b] de (a) sans que (b)
puisse pour autant se confondre avec (a) : ce qui signifie que, dans les
conditions capitalistes de la production, la science ne peut pas être force
directement et exclusivement productive puisqu'elle supprimerait alors
purement et simplement sa raison d'être dans ce mode de production : la
plus-value relative.
possible (allongement de la journée de travail), la seule possibilité pour
l'accroissement de la plus-value est de rapprocher (b] de (a) sans que (b)
puisse pour autant se confondre avec (a) : ce qui signifie que, dans les
conditions capitalistes de la production, la science ne peut pas être force
directement et exclusivement productive puisqu'elle supprimerait alors
purement et simplement sa raison d'être dans ce mode de production : la
plus-value relative.
Cependant, l'intensité du travail a elle aussi sa limite : il y
a un point à partir duquel la force de travail du travailleur ne peut plus
être reconstituée, quel que soit son salaire. C'est à partir de cette limite
qu'un accroissement de la productivité redevient nécessaire. Mais en
raison du lien productivité-intensité, « une fois le moyen scientifique de
production généralisé et adopté à l'échelle sociale, le travailleur collectif
devra s'y adapter et l'intensité du travail croîtra ». (Jean Fallût, « Marx
et le machinisme », p. 130.)
a un point à partir duquel la force de travail du travailleur ne peut plus
être reconstituée, quel que soit son salaire. C'est à partir de cette limite
qu'un accroissement de la productivité redevient nécessaire. Mais en
raison du lien productivité-intensité, « une fois le moyen scientifique de
production généralisé et adopté à l'échelle sociale, le travailleur collectif
devra s'y adapter et l'intensité du travail croîtra ». (Jean Fallût, « Marx
et le machinisme », p. 130.)
Jean Fallût représente d'ailleurs clairement cette relation par
le schéma cyclique suivant :
le schéma cyclique suivant :
productivité
intensité limite
intensité limite
intensité accrue
productivité accrue
intensité stable
intensité stable
^- intensité limite
intensité croissante
intensité croissante
II est clair que le seul paramètre qui ne puisse atteindre une
limite dans le mode de production capitaliste est la productivité du travail,
c'est-à-dire la science comme puissance de la production.
limite dans le mode de production capitaliste est la productivité du travail,
c'est-à-dire la science comme puissance de la production.
Une remarque ici nécessaire concerne la limite de l'emploi
des machines dans les conditions capitalistes de la production. Marx
exprime l'existence de cette limite absolue sous la forme suivante :
« Considéré exclusivement comme moyen de rendre le produit meilleur
marché, l'emploi des machines rencontre une limite. Le travail dépensé
dans leur production doit être moindre que le travail supplanté par leur
usage. » (K. Marx, « Le Capital », livre I, sect. IV, chap. 15, p. 16 du tome 2
des Editions sociales).
des machines dans les conditions capitalistes de la production. Marx
exprime l'existence de cette limite absolue sous la forme suivante :
« Considéré exclusivement comme moyen de rendre le produit meilleur
marché, l'emploi des machines rencontre une limite. Le travail dépensé
dans leur production doit être moindre que le travail supplanté par leur
usage. » (K. Marx, « Le Capital », livre I, sect. IV, chap. 15, p. 16 du tome 2
des Editions sociales).
En d'autres termes, la somme de travail social utilisé à
construire la machine doit être inférieure à la somme du travail social
économisé dans son emploi. Marx souligne cependant qu'en régime capi-
taliste c'est une loi plus restrictive qui joue : « Pour le capitalisme cepen-
dant, cette limite est plus étroite. Comme il ne paie pas le travail, mais la
force de travail qu'il emploie, il est dirigé dans ses calculs par la diffé-
rence de valeur entre les marchandises et les forces de travail qu'elles
peuvent déplacer ». En d'autres termes, plus la force de travail est chère,
plus il devient rentable pour le capital de le remplacer par des machines.
construire la machine doit être inférieure à la somme du travail social
économisé dans son emploi. Marx souligne cependant qu'en régime capi-
taliste c'est une loi plus restrictive qui joue : « Pour le capitalisme cepen-
dant, cette limite est plus étroite. Comme il ne paie pas le travail, mais la
force de travail qu'il emploie, il est dirigé dans ses calculs par la diffé-
rence de valeur entre les marchandises et les forces de travail qu'elles
peuvent déplacer ». En d'autres termes, plus la force de travail est chère,
plus il devient rentable pour le capital de le remplacer par des machines.
Nécessité d'approfondir l'analyse « classique »
Depuis Marx, l'impétueux développement de la technologie et
l'utilisation à un rythme de plus en plus rapide des découvertes scientifi-
ques ont, d'une part, ouvert la perspective d'une automation de plus en
plus poussée du processus de production, d'autre part, approfondi de
façon décisive un certain nombre de contradictions du mode de production
capitaliste. Malheureusement, nous nous heurtons à une incapacité
certaine à affronter pratiquement et théoriquement ces nouveaux problè-
mes : en face d'analyses figées qui tentent en vain de comprendre la
période antérieure, on ne trouve que diverses idéologies qui recherchent
dans l'Economie politique bourgeoise les clefs de la connaissance révo-
lutionnaire.
l'utilisation à un rythme de plus en plus rapide des découvertes scientifi-
ques ont, d'une part, ouvert la perspective d'une automation de plus en
plus poussée du processus de production, d'autre part, approfondi de
façon décisive un certain nombre de contradictions du mode de production
capitaliste. Malheureusement, nous nous heurtons à une incapacité
certaine à affronter pratiquement et théoriquement ces nouveaux problè-
mes : en face d'analyses figées qui tentent en vain de comprendre la
période antérieure, on ne trouve que diverses idéologies qui recherchent
dans l'Economie politique bourgeoise les clefs de la connaissance révo-
lutionnaire.
Nous allons chercher à voir comment se manifeste aujour-
d'hui, de façon spécifique, au niveau de la recherche et de l'enseignement
dans notre société, la contradiction fondamentale entre le capital et le
travail.
d'hui, de façon spécifique, au niveau de la recherche et de l'enseignement
dans notre société, la contradiction fondamentale entre le capital et le
travail.
CHAPITRE 11
Peut-on parler d'une nouvelle révolution scientifique
et industrielle ?
et industrielle ?
Où l'on recherche, pour cette nouvelle révolution, des bases
scientifiques et technologiques. — Où le développement
inégal de la production scientifique n'est pas sans relation
avec le développement inégal du mode de production capita-
liste. — Où les brevets et licences trouvent leur place dans
le courant des échanges. — Où les pays de l'Ouest tentent de
coordonner recherche et développement. — Où l'Est et l'Ouest
s'efforcent de coopérer dans les domaines scientifique et
technique.
scientifiques et technologiques. — Où le développement
inégal de la production scientifique n'est pas sans relation
avec le développement inégal du mode de production capita-
liste. — Où les brevets et licences trouvent leur place dans
le courant des échanges. — Où les pays de l'Ouest tentent de
coordonner recherche et développement. — Où l'Est et l'Ouest
s'efforcent de coopérer dans les domaines scientifique et
technique.
46
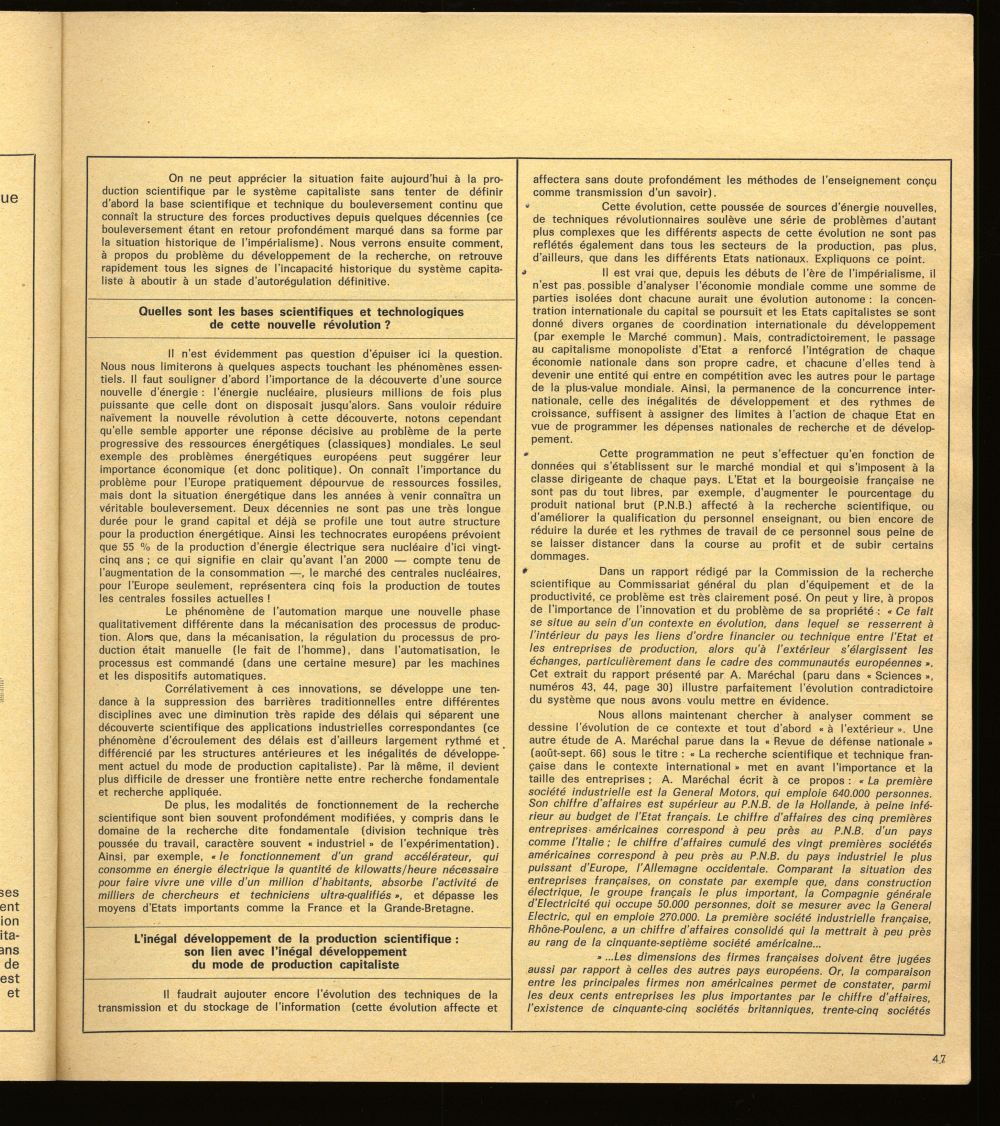

On ne peut apprécier la situation faite aujourd'hui à la pro-
duction scientifique par le système capitaliste sans tenter de définir
d'abord la base scientifique et technique du bouleversement continu que
connaît la structure des forces productives depuis quelques décennies (ce
bouleversement étant en retour profondément marqué dans sa forme par
la situation historique de l'impérialisme). Nous verrons ensuite comment,
à propos du problème du développement de la recherche, on retrouve
rapidement tous les signes de l'incapacité historique du système capita-
liste à aboutir à un stade d'autorégulation définitive.
duction scientifique par le système capitaliste sans tenter de définir
d'abord la base scientifique et technique du bouleversement continu que
connaît la structure des forces productives depuis quelques décennies (ce
bouleversement étant en retour profondément marqué dans sa forme par
la situation historique de l'impérialisme). Nous verrons ensuite comment,
à propos du problème du développement de la recherche, on retrouve
rapidement tous les signes de l'incapacité historique du système capita-
liste à aboutir à un stade d'autorégulation définitive.
Quelles sont les bases scientifiques et technologiques
de cette nouvelle révolution ?
de cette nouvelle révolution ?
Il n'est évidemment pas question d'épuiser ici la question.
Nous nous limiterons à quelques aspects touchant les phénomènes essen-
tiels. Il faut souligner d'abord l'importance de la découverte d'une source
nouvelle d'énergie : l'énergie nucléaire, plusieurs millions de fois plus
puissante que celle dont on disposait jusqu'alors. Sans vouloir réduire
naïvement la nouvelle révolution à cette découverte, notons cependant
qu'elle semble apporter une réponse décisive au problème de la perte
progressive des ressources énergétiques (classiques) mondiales. Le seul
exemple des problèmes énergétiques européens peut suggérer leur
importance économique (et donc politique). On connaît l'importance du
problème pour l'Europe pratiquement dépourvue de ressources fossiles,
mais dont la situation énergétique dans les années à venir connaîtra un
véritable bouleversement. Deux décennies ne sont pas une très longue
durée pour le grand capital et déjà se profile une tout autre structure
pour la production énergétique. Ainsi les technocrates européens prévoient
que 55 % de la production d'énergie électrique sera nucléaire d'ici vingt-
cinq ans ; ce qui signifie en clair qu'avant l'an 2000 — compte tenu de
l'augmentation de la consommation —, le marché des centrales nucléaires,
pour l'Europe seulement, représentera cinq fois la production de toutes
les centrales fossiles actuelles !
Nous nous limiterons à quelques aspects touchant les phénomènes essen-
tiels. Il faut souligner d'abord l'importance de la découverte d'une source
nouvelle d'énergie : l'énergie nucléaire, plusieurs millions de fois plus
puissante que celle dont on disposait jusqu'alors. Sans vouloir réduire
naïvement la nouvelle révolution à cette découverte, notons cependant
qu'elle semble apporter une réponse décisive au problème de la perte
progressive des ressources énergétiques (classiques) mondiales. Le seul
exemple des problèmes énergétiques européens peut suggérer leur
importance économique (et donc politique). On connaît l'importance du
problème pour l'Europe pratiquement dépourvue de ressources fossiles,
mais dont la situation énergétique dans les années à venir connaîtra un
véritable bouleversement. Deux décennies ne sont pas une très longue
durée pour le grand capital et déjà se profile une tout autre structure
pour la production énergétique. Ainsi les technocrates européens prévoient
que 55 % de la production d'énergie électrique sera nucléaire d'ici vingt-
cinq ans ; ce qui signifie en clair qu'avant l'an 2000 — compte tenu de
l'augmentation de la consommation —, le marché des centrales nucléaires,
pour l'Europe seulement, représentera cinq fois la production de toutes
les centrales fossiles actuelles !
Le phénomène de l'automation marque une nouvelle phase
qualitativement différente dans la mécanisation des processus de produc-
tion. Alors que, dans la mécanisation, la régulation du processus de pro-
duction était manuelle (le fait de l'homme), dans l'automatisation, le
processus est commandé (dans une certaine mesure) par les machines
et les dispositifs automatiques.
qualitativement différente dans la mécanisation des processus de produc-
tion. Alors que, dans la mécanisation, la régulation du processus de pro-
duction était manuelle (le fait de l'homme), dans l'automatisation, le
processus est commandé (dans une certaine mesure) par les machines
et les dispositifs automatiques.
Corrélativement à ces innovations, se développe une ten-
dance à la suppression des barrières traditionnelles entre différentes
disciplines avec une diminution très rapide des délais qui séparent une
découverte scientifique des applications industrielles correspondantes (ce
phénomène d'écroulement des délais est d'ailleurs largement rythmé et
différencié par les structures antérieures et les inégalités de développe-
ment actuel du mode de production capitaliste). Par là même, il devient
plus difficile de dresser une frontière nette entre recherche fondamentale
et recherche appliquée.
dance à la suppression des barrières traditionnelles entre différentes
disciplines avec une diminution très rapide des délais qui séparent une
découverte scientifique des applications industrielles correspondantes (ce
phénomène d'écroulement des délais est d'ailleurs largement rythmé et
différencié par les structures antérieures et les inégalités de développe-
ment actuel du mode de production capitaliste). Par là même, il devient
plus difficile de dresser une frontière nette entre recherche fondamentale
et recherche appliquée.
De plus, les modalités de fonctionnement de la recherche
scientifique sont bien souvent profondément modifiées, y compris dans le
domaine de la recherche dite fondamentale (division technique très
poussée du travail, caractère souvent «industriel» de l'expérimentation).
Ainsi, par exemple, « le fonctionnement d'un grand accélérateur, qui
consomme en énergie électrique la quantité de kilowatts/heure nécessaire
pour faire vivre une ville d'un million d'habitants, absorbe l'activité de
milliers de chercheurs et techniciens ultra-qualifiés «, et dépasse les
moyens d'Etats importants comme la France et la Grande-Bretagne.
scientifique sont bien souvent profondément modifiées, y compris dans le
domaine de la recherche dite fondamentale (division technique très
poussée du travail, caractère souvent «industriel» de l'expérimentation).
Ainsi, par exemple, « le fonctionnement d'un grand accélérateur, qui
consomme en énergie électrique la quantité de kilowatts/heure nécessaire
pour faire vivre une ville d'un million d'habitants, absorbe l'activité de
milliers de chercheurs et techniciens ultra-qualifiés «, et dépasse les
moyens d'Etats importants comme la France et la Grande-Bretagne.
L'inégal développement de la production scientifique :
son lien avec l'inégal développement
du mode de production capitaliste
II faudrait aujouter encore l'évolution des techniques de la
transmission et du stockage de l'information (cette évolution affecte et
transmission et du stockage de l'information (cette évolution affecte et
affectera sans doute profondément les méthodes de l'enseignement conçu
comme transmission d'un savoir).
comme transmission d'un savoir).
Cette évolution, cette poussée de sources d'énergie nouvelles,
de techniques révolutionnaires soulève une série de problèmes d'autant
plus complexes que les différents aspects de cette évolution ne sont pas
reflétés également dans tous les secteurs de la production, pas plus,
d'ailleurs, que dans les différents Etats nationaux. Expliquons ce point.
•> II est vrai que, depuis les débuts de l'ère de l'impérialisme, il
de techniques révolutionnaires soulève une série de problèmes d'autant
plus complexes que les différents aspects de cette évolution ne sont pas
reflétés également dans tous les secteurs de la production, pas plus,
d'ailleurs, que dans les différents Etats nationaux. Expliquons ce point.
•> II est vrai que, depuis les débuts de l'ère de l'impérialisme, il
n'est pas. possible d'analyser l'économie mondiale comme une somme de
parties isolées dont chacune aurait une évolution autonome : la concen-
tration internationale du capital se poursuit et les Etats capitalistes se sont
donné divers organes de coordination internationale du développement
(par exemple le Marché commun). Mais, contradictoirement, le passage
au capitalisme monopoliste d'Etat a renforcé l'intégration de chaque
économie nationale dans son propre cadre, et chacune d'elles tend à
devenir une entité qui entre en compétition avec les autres pour le partage
de la plus-value mondiale. Ainsi, la permanence de la concurrence inter-
nationale, celle des inégalités de développement et des rythmes de
croissance, suffisent à assigner des limites à l'action de chaque Etat en
vue de programmer les dépenses nationales de recherche et de dévelop-
pement.
parties isolées dont chacune aurait une évolution autonome : la concen-
tration internationale du capital se poursuit et les Etats capitalistes se sont
donné divers organes de coordination internationale du développement
(par exemple le Marché commun). Mais, contradictoirement, le passage
au capitalisme monopoliste d'Etat a renforcé l'intégration de chaque
économie nationale dans son propre cadre, et chacune d'elles tend à
devenir une entité qui entre en compétition avec les autres pour le partage
de la plus-value mondiale. Ainsi, la permanence de la concurrence inter-
nationale, celle des inégalités de développement et des rythmes de
croissance, suffisent à assigner des limites à l'action de chaque Etat en
vue de programmer les dépenses nationales de recherche et de dévelop-
pement.
- Cette programmation ne peut s'effectuer qu'en fonction de
données qui s'établissent sur le marché mondial et qui s'imposent à la
classe dirigeante de chaque pays. L'Etat et la bourgeoisie française ne
sont pas du tout libres, par exemple, d'augmenter le pourcentage du
produit national brut (P.N.B.) affecté à la recherche scientifique, ou
d'améliorer la qualification du personnel enseignant, ou bien encore de
réduire la durée et les rythmes de travail de ce personnel sous peine de
se laisser distancer dans la course au profit et de subir certains
dommages.
données qui s'établissent sur le marché mondial et qui s'imposent à la
classe dirigeante de chaque pays. L'Etat et la bourgeoisie française ne
sont pas du tout libres, par exemple, d'augmenter le pourcentage du
produit national brut (P.N.B.) affecté à la recherche scientifique, ou
d'améliorer la qualification du personnel enseignant, ou bien encore de
réduire la durée et les rythmes de travail de ce personnel sous peine de
se laisser distancer dans la course au profit et de subir certains
dommages.
* Dans un rapport rédigé par la Commission de la recherche
scientifique au Commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité, ce problème est très clairement posé. On peut y lire, à propos
de l'importance de l'innovation et du problème de sa propriété : « Ce fait
se situe au sein d'un contexte en évolution, dans lequel se resserrent à
l'intérieur du pays les liens d'ordre financier ou technique entre l'Etat et
les entreprises de production, alors qu'à l'extérieur s'élargissent les
échanges, particulièrement dans le cadre des communautés européennes ».
Cet extrait du rapport présenté par A. Maréchal (paru dans « Sciences »,
numéros 43, 44, page 30) illustre parfaitement l'évolution contradictoire
du système que nous avons voulu mettre en évidence.
scientifique au Commissariat général du plan d'équipement et de la
productivité, ce problème est très clairement posé. On peut y lire, à propos
de l'importance de l'innovation et du problème de sa propriété : « Ce fait
se situe au sein d'un contexte en évolution, dans lequel se resserrent à
l'intérieur du pays les liens d'ordre financier ou technique entre l'Etat et
les entreprises de production, alors qu'à l'extérieur s'élargissent les
échanges, particulièrement dans le cadre des communautés européennes ».
Cet extrait du rapport présenté par A. Maréchal (paru dans « Sciences »,
numéros 43, 44, page 30) illustre parfaitement l'évolution contradictoire
du système que nous avons voulu mettre en évidence.
Nous allons maintenant chercher à analyser comment se
dessine l'évolution de ce contexte et tout d'abord « à l'extérieur ». Une
autre étude de A. Maréchal parue dans la « Revue de défense nationale »
(août-sept. 66) sous le titre : « La recherche scientifique et technique fran-
çaise dans le contexte international » met en avant l'importance et la
taille des entreprises ; A. Maréchal écrit à ce propos : « La première
société industrielle est la General Motors, qui emploie 640.000 personnes.
Son chiffre d'affaires est supérieur au P.N.B. de la Hollande, à peine infé-
rieur au budget de l'Etat français. Le chiffre d'affaires des cinq premières
entreprises américaines correspond à peu près au P.N.B. d'un pays
comme l'Italie ; le chiffre d'affaires cumulé des vingt premières sociétés
américaines correspond à peu près au P.N.B. du pays industriel le plus
puissant d'Europe, l'Allemagne occidentale. Comparant la situation des
entreprises françaises, on constate par exemple que, dans construction
électrique, le groupe français le plus important, la Compagnie générale
d'Electricité qui occupe 50.000 personnes, doit se mesurer avec la General
Electric, qui en emploie 270.000. La première société industrielle française,
Rhône-Poulenc, a un chiffre d'affaires consolidé qui la mettrait à peu près
au rang de la cinquante-septième société américaine...
dessine l'évolution de ce contexte et tout d'abord « à l'extérieur ». Une
autre étude de A. Maréchal parue dans la « Revue de défense nationale »
(août-sept. 66) sous le titre : « La recherche scientifique et technique fran-
çaise dans le contexte international » met en avant l'importance et la
taille des entreprises ; A. Maréchal écrit à ce propos : « La première
société industrielle est la General Motors, qui emploie 640.000 personnes.
Son chiffre d'affaires est supérieur au P.N.B. de la Hollande, à peine infé-
rieur au budget de l'Etat français. Le chiffre d'affaires des cinq premières
entreprises américaines correspond à peu près au P.N.B. d'un pays
comme l'Italie ; le chiffre d'affaires cumulé des vingt premières sociétés
américaines correspond à peu près au P.N.B. du pays industriel le plus
puissant d'Europe, l'Allemagne occidentale. Comparant la situation des
entreprises françaises, on constate par exemple que, dans construction
électrique, le groupe français le plus important, la Compagnie générale
d'Electricité qui occupe 50.000 personnes, doit se mesurer avec la General
Electric, qui en emploie 270.000. La première société industrielle française,
Rhône-Poulenc, a un chiffre d'affaires consolidé qui la mettrait à peu près
au rang de la cinquante-septième société américaine...
» ...Les dimensions des firmes françaises doivent être jugées
aussi par rapport à celles des autres pays européens. Or, la comparaison
entre les principales firmes non américaines permet de constater, parmi
les deux cents entreprises les plus importantes par le chiffre d'affaires,
l'existence de cinquante-cinq sociétés britanniques, trente-cinq sociétés
aussi par rapport à celles des autres pays européens. Or, la comparaison
entre les principales firmes non américaines permet de constater, parmi
les deux cents entreprises les plus importantes par le chiffre d'affaires,
l'existence de cinquante-cinq sociétés britanniques, trente-cinq sociétés
47
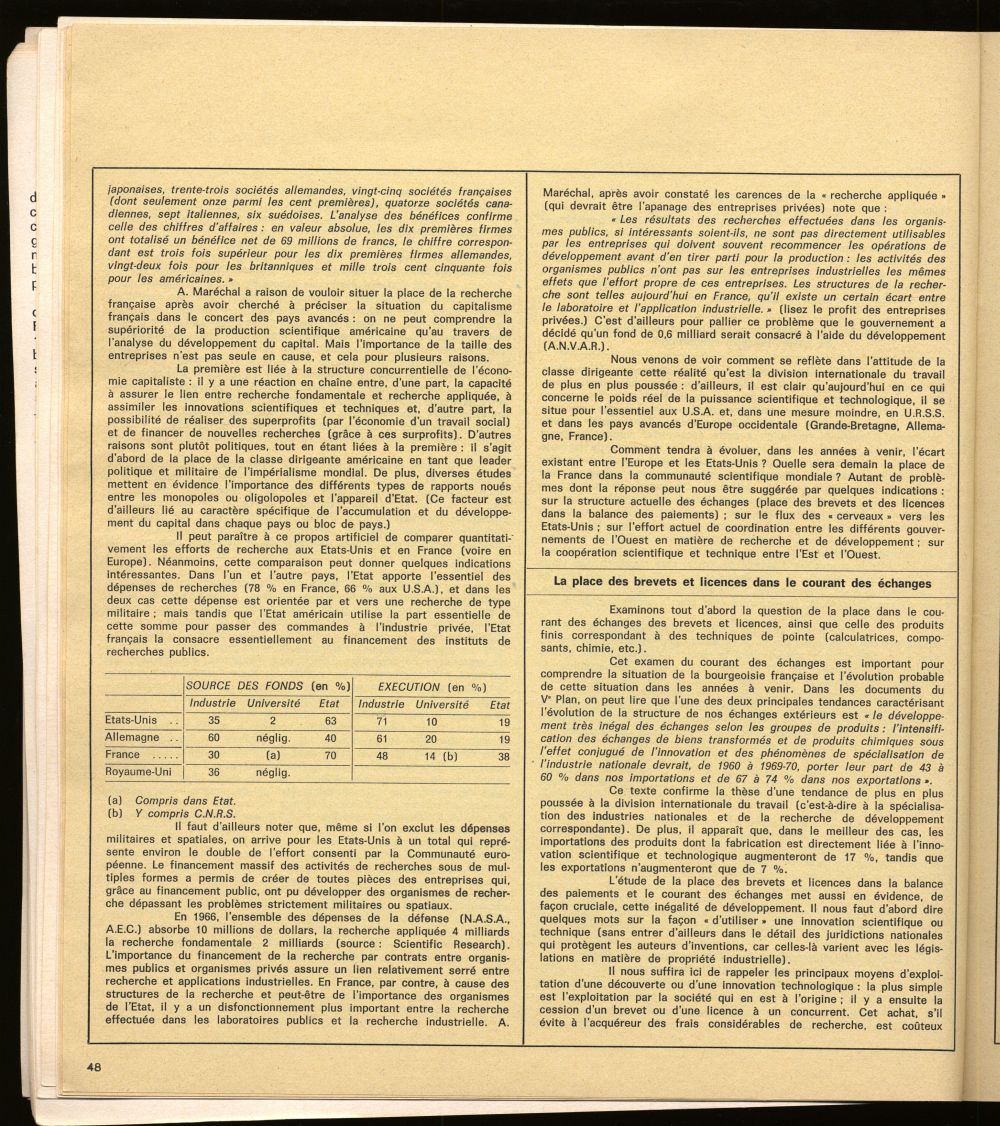

japonaises, trente-trois sociétés allemandes, vingt-cinq sociétés françaises
(dont seulement onze parmi les cent premières), quatorze sociétés cana-
diennes, sept italiennes, six suédoises. L'analyse des bénéfices confirme
celle des chiffres d'affaires : en valeur absolue, les dix premières firmes
ont totalisé un bénéfice net de 69 millions de francs, le chiffre correspon-
dant est trois fois supérieur pour les dix premières firmes allemandes,
vingt-deux fois pour les britanniques et mille trois cent cinquante fois
pour les américaines. »
(dont seulement onze parmi les cent premières), quatorze sociétés cana-
diennes, sept italiennes, six suédoises. L'analyse des bénéfices confirme
celle des chiffres d'affaires : en valeur absolue, les dix premières firmes
ont totalisé un bénéfice net de 69 millions de francs, le chiffre correspon-
dant est trois fois supérieur pour les dix premières firmes allemandes,
vingt-deux fois pour les britanniques et mille trois cent cinquante fois
pour les américaines. »
A. Maréchal a raison de vouloir situer la place de la recherche
française après avoir cherché à préciser la situation du capitalisme
français dans le concert des pays avancés : on ne peut comprendre la
supériorité de la production scientifique américaine qu'au travers de
l'analyse du développement du capital. Mais l'importance de la taille des
entreprises n'est pas seule en cause, et cela pour plusieurs raisons.
française après avoir cherché à préciser la situation du capitalisme
français dans le concert des pays avancés : on ne peut comprendre la
supériorité de la production scientifique américaine qu'au travers de
l'analyse du développement du capital. Mais l'importance de la taille des
entreprises n'est pas seule en cause, et cela pour plusieurs raisons.
La première est liée à la structure concurrentielle de l'écono-
mie capitaliste : il y a une réaction en chaîne entre, d'une part, la capacité
à assurer le lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée, à
assimiler les innovations scientifiques et techniques et, d'autre part, la
possibilité de réaliser des superprofits (par l'économie d'un travail social)
et de financer de nouvelles recherches (grâce à ces surprofits). D'autres
raisons sont plutôt politiques, tout en étant liées à la première : il s'agit
d'abord de la place de la classe dirigeante américaine en tant que leader
politique et militaire de l'impérialisme mondial. De plus, diverses études
mettent en évidence l'importance des différents types de rapports noués
entre les monopoles ou oligolopoles et l'appareil d'Etat. (Ce facteur est
d'ailleurs lié au caractère spécifique de l'accumulation et du développe-
ment du capital dans chaque pays ou bloc de pays.)
mie capitaliste : il y a une réaction en chaîne entre, d'une part, la capacité
à assurer le lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée, à
assimiler les innovations scientifiques et techniques et, d'autre part, la
possibilité de réaliser des superprofits (par l'économie d'un travail social)
et de financer de nouvelles recherches (grâce à ces surprofits). D'autres
raisons sont plutôt politiques, tout en étant liées à la première : il s'agit
d'abord de la place de la classe dirigeante américaine en tant que leader
politique et militaire de l'impérialisme mondial. De plus, diverses études
mettent en évidence l'importance des différents types de rapports noués
entre les monopoles ou oligolopoles et l'appareil d'Etat. (Ce facteur est
d'ailleurs lié au caractère spécifique de l'accumulation et du développe-
ment du capital dans chaque pays ou bloc de pays.)
Il peut paraître à ce propos artificiel de comparer quantitati-'
vement les efforts de recherche aux Etats-Unis et en France (voire en
Europe). Néanmoins, cette comparaison peut donner quelques indications
intéressantes. Dans l'un et l'autre pays, l'Etat apporte l'essentiel des
dépenses de recherches (78 % en France, 66 % aux U.S.A.), et dans les
deux cas cette dépense est orientée par et vers une recherche de type
militaire ; mais tandis que l'Etat américain utilise la part essentielle de
cette somme pour passer des commandes à l'industrie privée, l'Etat
français la consacre essentiellement au financement des instituts de
recherches publics.
vement les efforts de recherche aux Etats-Unis et en France (voire en
Europe). Néanmoins, cette comparaison peut donner quelques indications
intéressantes. Dans l'un et l'autre pays, l'Etat apporte l'essentiel des
dépenses de recherches (78 % en France, 66 % aux U.S.A.), et dans les
deux cas cette dépense est orientée par et vers une recherche de type
militaire ; mais tandis que l'Etat américain utilise la part essentielle de
cette somme pour passer des commandes à l'industrie privée, l'Etat
français la consacre essentiellement au financement des instituts de
recherches publics.
SOURCE DES FONDS (en %)
EXECUTION (en %)
EXECUTION (en %)
Industrie Université Etat
Industrie Université Etat
Industrie Université Etat
Etats-Unis
35 2 63
71 10 19
35 2 63
71 10 19
Allemagne . .
60 néglig. 40
61 20 19
60 néglig. 40
61 20 19
France
30 (a) 70
48 14 (b) 38
30 (a) 70
48 14 (b) 38
Royaume-Uni
36 néglig.
36 néglig.
(a) Compris dans Etat.
(b) Y compris C.N.R.S.
Il faut d'ailleurs noter que, même si l'on exclut les dépenses
militaires et spatiales, on arrive pour les Etats-Unis à un total qui repré-
sente environ le double de l'effort consenti par la Communauté euro-
péenne. Le financement massif des activités de recherches sous de mul-
tiples formes a permis de créer de toutes pièces des entreprises qui,
grâce au financement public, ont pu développer des organismes de recher-
che dépassant les problèmes strictement militaires ou spatiaux.
militaires et spatiales, on arrive pour les Etats-Unis à un total qui repré-
sente environ le double de l'effort consenti par la Communauté euro-
péenne. Le financement massif des activités de recherches sous de mul-
tiples formes a permis de créer de toutes pièces des entreprises qui,
grâce au financement public, ont pu développer des organismes de recher-
che dépassant les problèmes strictement militaires ou spatiaux.
En 1966, l'ensemble des dépenses de la défense (N.A.S.A.,
A.E.C.) absorbe 10 millions de dollars, la recherche appliquée 4 milliards
la recherche fondamentale 2 milliards (source: Scientific Research).
L'importance du financement de la recherche par contrats entre organis-
mes publics et organismes privés assure un lien relativement serré entre
recherche et applications industrielles. En France, par contre, à cause des
structures de la recherche et peut-être de l'importance des organismes
de l'Etat, il y a un disfonctionnement plus important entre la recherche
effectuée dans les laboratoires publics et la recherche industrielle. A.
A.E.C.) absorbe 10 millions de dollars, la recherche appliquée 4 milliards
la recherche fondamentale 2 milliards (source: Scientific Research).
L'importance du financement de la recherche par contrats entre organis-
mes publics et organismes privés assure un lien relativement serré entre
recherche et applications industrielles. En France, par contre, à cause des
structures de la recherche et peut-être de l'importance des organismes
de l'Etat, il y a un disfonctionnement plus important entre la recherche
effectuée dans les laboratoires publics et la recherche industrielle. A.
Maréchal, après avoir constaté les carences de la « recherche appliquée »
(qui devrait être l'apanage des entreprises privées) note que :
(qui devrait être l'apanage des entreprises privées) note que :
* Les résultats des recherches effectuées dans les organis-
mes publics, si intéressants soient-ils, ne sont pas directement utilisables
par les entreprises qui doivent souvent recommencer les opérations de
développement avant d'en tirer parti pour la production : les activités des
organismes publics n'ont pas sur les entreprises industrielles les mêmes
effets que l'effort propre de ces entreprises. Les structures de la recher-
che sont telles aujourd'hui en France, qu'il existe un certain écart entre
le laboratoire et l'application industrielle. » (lisez le profit des entreprises
privées.) C'est d'ailleurs pour pallier ce problème que le gouvernement a
décidé qu'un fond de 0,6 milliard serait consacré à l'aide du développement
(A.N.V.A.R.).
mes publics, si intéressants soient-ils, ne sont pas directement utilisables
par les entreprises qui doivent souvent recommencer les opérations de
développement avant d'en tirer parti pour la production : les activités des
organismes publics n'ont pas sur les entreprises industrielles les mêmes
effets que l'effort propre de ces entreprises. Les structures de la recher-
che sont telles aujourd'hui en France, qu'il existe un certain écart entre
le laboratoire et l'application industrielle. » (lisez le profit des entreprises
privées.) C'est d'ailleurs pour pallier ce problème que le gouvernement a
décidé qu'un fond de 0,6 milliard serait consacré à l'aide du développement
(A.N.V.A.R.).
Nous venons de voir comment se reflète dans l'attitude de la
classe dirigeante cette réalité qu'est la division internationale du travail
de plus en plus poussée : d'ailleurs, il est clair qu'aujourd'hui en ce qui
concerne le poids réel de la puissance scientifique et technologique, il se
situe pour l'essentiel aux U.S.A. et, dans une mesure moindre, en U.R.S.S.
et dans les pays avancés d'Europe occidentale (Grande-Bretagne, Allema-
gne, France).
classe dirigeante cette réalité qu'est la division internationale du travail
de plus en plus poussée : d'ailleurs, il est clair qu'aujourd'hui en ce qui
concerne le poids réel de la puissance scientifique et technologique, il se
situe pour l'essentiel aux U.S.A. et, dans une mesure moindre, en U.R.S.S.
et dans les pays avancés d'Europe occidentale (Grande-Bretagne, Allema-
gne, France).
Comment tendra à évoluer, dans les années à venir, l'écart
existant entre l'Europe et les Etats-Unis ? Quelle sera demain la place de
la France dans la communauté scientifique mondiale ? Autant de problè-
mes dont la réponse peut nous être suggérée par quelques indications :
sur la structure actuelle des échanges (place des brevets et des licences
dans la balance des paiements) ; sur le flux des « cerveaux » vers les
Etats-Unis ; sur l'effort actuel de coordination entre les différents gouver-
nements de l'Ouest en matière de recherche et de développement ; sur
la coopération scientifique et technique entre l'Est et l'Ouest.
existant entre l'Europe et les Etats-Unis ? Quelle sera demain la place de
la France dans la communauté scientifique mondiale ? Autant de problè-
mes dont la réponse peut nous être suggérée par quelques indications :
sur la structure actuelle des échanges (place des brevets et des licences
dans la balance des paiements) ; sur le flux des « cerveaux » vers les
Etats-Unis ; sur l'effort actuel de coordination entre les différents gouver-
nements de l'Ouest en matière de recherche et de développement ; sur
la coopération scientifique et technique entre l'Est et l'Ouest.
La place des brevets et licences dans le courant des échanges
Examinons tout d'abord la question de la place dans le cou-
rant des échanges des brevets et licences, ainsi que celle des produits
finis correspondant à des techniques de pointe (calculatrices, compo-
sants, chimie, etc.).
rant des échanges des brevets et licences, ainsi que celle des produits
finis correspondant à des techniques de pointe (calculatrices, compo-
sants, chimie, etc.).
Cet examen du courant des échanges est important pour
comprendre la situation de la bourgeoisie française et l'évolution probable
de cette situation dans les années à venir. Dans les documents du
V' Plan, on peut lire que l'une des deux principales tendances caractérisant
l'évolution de la structure de nos échanges extérieurs est « le développe-
ment très inégal des échanges selon les groupes de produits : l'intensifi-
cation des échanges de biens transformés et de produits chimiques sous
l'effet conjugué de l'innovation et des phénomènes de spécialisation de
l'industrie nationale devrait, de 1960 à 1969-70, porter leur part de 43 à
60 % dans nos importations et de 67 à 74 % dans nos exportations ».
comprendre la situation de la bourgeoisie française et l'évolution probable
de cette situation dans les années à venir. Dans les documents du
V' Plan, on peut lire que l'une des deux principales tendances caractérisant
l'évolution de la structure de nos échanges extérieurs est « le développe-
ment très inégal des échanges selon les groupes de produits : l'intensifi-
cation des échanges de biens transformés et de produits chimiques sous
l'effet conjugué de l'innovation et des phénomènes de spécialisation de
l'industrie nationale devrait, de 1960 à 1969-70, porter leur part de 43 à
60 % dans nos importations et de 67 à 74 % dans nos exportations ».
Ce texte confirme la thèse d'une tendance de plus en plus
poussée à la division internationale du travail (c'est-à-dire à la spécialisa-
tion des industries nationales et de la recherche de développement
correspondante). De plus, il apparaît que, dans le meilleur des cas, les
importations des produits dont la fabrication est directement liée à l'inno-
vation scientifique et technologique augmenteront de 17 %, tandis que
les exportations n'augmenteront que de 7 %.
poussée à la division internationale du travail (c'est-à-dire à la spécialisa-
tion des industries nationales et de la recherche de développement
correspondante). De plus, il apparaît que, dans le meilleur des cas, les
importations des produits dont la fabrication est directement liée à l'inno-
vation scientifique et technologique augmenteront de 17 %, tandis que
les exportations n'augmenteront que de 7 %.
L'étude de la place des brevets et licences dans la balance
des paiements et le courant des échanges met aussi en évidence, de
façon cruciale, cette inégalité de développement. Il nous faut d'abord dire
quelques mots sur la façon « d'utiliser » une innovation scientifique ou
technique (sans entrer d'ailleurs dans le détail des juridictions nationales
qui protègent les auteurs d'inventions, car celles-là varient avec les légis-
lations en matière de propriété industrielle).
des paiements et le courant des échanges met aussi en évidence, de
façon cruciale, cette inégalité de développement. Il nous faut d'abord dire
quelques mots sur la façon « d'utiliser » une innovation scientifique ou
technique (sans entrer d'ailleurs dans le détail des juridictions nationales
qui protègent les auteurs d'inventions, car celles-là varient avec les légis-
lations en matière de propriété industrielle).
Il nous suffira ici de rappeler les principaux moyens d'exploi-
tation d'une découverte ou d'une innovation technologique : la plus simple
est l'exploitation par la société qui en est à l'origine ; il y a ensuite la
cession d'un brevet ou d'une licence à un concurrent. Cet achat, s'il
évite à l'acquéreur des frais considérables de recherche, est coûteux
tation d'une découverte ou d'une innovation technologique : la plus simple
est l'exploitation par la société qui en est à l'origine ; il y a ensuite la
cession d'un brevet ou d'une licence à un concurrent. Cet achat, s'il
évite à l'acquéreur des frais considérables de recherche, est coûteux
48


(redevances] et ne résoud pas, bien au contraire, le problème de la dépendance technologique ; la dernière méthode est celle du « cross licencing » entre supergrands, qui constitue en fait une entente, un accord sur l'exploitation surveillée des innovations des deux partenaires. Nous laissons à part l'achat du know-how qui concerne l'achat de procédés sans grand intérêt théorique, mais dont l'importance industrielle peut être importante. Cela dit, dégageons la signification du tableau ci-dessous, extrait de la revue « Atomes ».
brutes : ainsi, par exemple, la rémunération des chercheurs (qui constitue un des postes principaux des dépenses de recherche) est plus élevée aux Etats-Unis qu'en Europe, ce qui tend à élever le coût de la recherche aux Etats-Unis relativement à son coût en Europe. Les investissements américains n'en demeurent pas moins deux à cinq fois supérieurs à ce qu'ils sont en Europe. A cela, il faut ajouter que la somme correspondant à la situation européenne correspond en fait à l'addition de données très hétérogènes, à l'existence de recherches souvent concurrentielles dans des domaines voisins (voir les problèmes posés par exemple à l'Euratom). Ajoutons encore à cela les problèmes liés à l'organisation même de la recherche, de l'enseignement, de leurs liens avec l'industrie, dont nous parlerons ultérieurement, mais qui semblent essentiellement jouer aussi un rôle défavorable pour l'Europe. « On sait par ailleurs que les différents pays des Six cherchent de plus en plus à définir une politique commune de la recherche, dont quelques éléments existent déjà : EURATOM, C.E.R.N., etc. Les trois commissions des communautés européennes ont, en mars 1967, transmis aux Etats membres un mémorandum sur les problèmes soulevés par le progrès technique et scientifique dans l'Europe des Six. Une nouvelle discussion a eu lieu en octobre 1967 à Luxembourg, qui reprend ce problème. Le souhait y a été formulé que les Etats membres mettent en œuvre « une action énergique de redressement et de promotion de la recherche scientifique et technique et de l'innovation industrielle ». La discussion a souligné la nécessité d'une concentration des moyens, en cherchant à accélérer le processus d'union économique, et à modifier la structure des marchés ; elle a insisté sur « la nécessité d'éviter les doubles emplois et l'existence de zones de désert technologique ». ' II s'agit bien d'une tentative de programmation de la division du travail, et cela en respectant les impératifs du mode de production capitaliste, puisqu'ont été posés tous les problèmes relatifs à la propriété industrielle des innovations scientifique et technique, à la protection des inventions, aux règles de la concurrence au sein du Marché commun. ' « Le flux des cerveaux » vers les Etats-Unis constitue enfin un phénomène qui précise ces tendances. On sait qu'aujourd'hui les migrations de chercheurs, ingénieurs, médecins créent un véritable marché international de l'intelligence scientifique et technique. Ainsi, un article paru dans la revue patronale « L'Usine nouvelle » (septembre 1967) indique : « D'après certaines estimations, les Etats->Unis auraient économisé 4 milliards de dollars, grâce à l'afflux de techniciens étrangers qui s'y établissent. Tel serait, en effet, le coût de formation des quelque 100.000 chercheurs et techniciens qui se sont expatriés Outre-Atlantique depuis 1945. L'exode de ce personnel hautement qualifié s'effectue par deux filières principales. D'une part, les sociétés américaines les embauchent directement par l'intermédiaire de leurs filiales implantées à l'étranger, soit pour les employer sur place, soit pour les faire venir aux Etats-Unis. Depuis quelque temps, elles sont secondées dans cette tâche par un certain nombre d'agences de placement américaines qui se sont elles-mêmes établies en Europe à cette fin. L'activité de ces agences est surtout importante en Grande-Bretagne. D'autre part, un pourcentage considérable d'étudiants étrangers inscrits dans les universités américaines s'établissent définitivement aux Etats-Unis. » Le « brain drain » constitue un handicap supplémentaire pour les pays de l'Europe occidentale et leurs bourgeoisies ; une étude sur ces problèmes (non publiée pour des raisons politiques), rédigée par un expert de l'O.N.U., propose que ce flux soit compensé par le versement de royalties aux pays fournisseurs de « matière grise ». Il est bien évident que le Department d'Etat n'envisage pas de mesures en ce sens. Toutes ces questions ont d'ailleurs été développées dans une série d'articles parus dans le journal « Le Monde ». • Ce phénomène confirme la tendance au renforcement des inégalités de développement dans un système dominé par une économie de marché. Il met aussi en évidence un nouveau mode d'appropriation de la production scientifique et technique par le capital. Sous cet angle aussi, le système impérialiste mondial apparaît comme incapable de pro-
brutes : ainsi, par exemple, la rémunération des chercheurs (qui constitue un des postes principaux des dépenses de recherche) est plus élevée aux Etats-Unis qu'en Europe, ce qui tend à élever le coût de la recherche aux Etats-Unis relativement à son coût en Europe. Les investissements américains n'en demeurent pas moins deux à cinq fois supérieurs à ce qu'ils sont en Europe. A cela, il faut ajouter que la somme correspondant à la situation européenne correspond en fait à l'addition de données très hétérogènes, à l'existence de recherches souvent concurrentielles dans des domaines voisins (voir les problèmes posés par exemple à l'Euratom). Ajoutons encore à cela les problèmes liés à l'organisation même de la recherche, de l'enseignement, de leurs liens avec l'industrie, dont nous parlerons ultérieurement, mais qui semblent essentiellement jouer aussi un rôle défavorable pour l'Europe. « On sait par ailleurs que les différents pays des Six cherchent de plus en plus à définir une politique commune de la recherche, dont quelques éléments existent déjà : EURATOM, C.E.R.N., etc. Les trois commissions des communautés européennes ont, en mars 1967, transmis aux Etats membres un mémorandum sur les problèmes soulevés par le progrès technique et scientifique dans l'Europe des Six. Une nouvelle discussion a eu lieu en octobre 1967 à Luxembourg, qui reprend ce problème. Le souhait y a été formulé que les Etats membres mettent en œuvre « une action énergique de redressement et de promotion de la recherche scientifique et technique et de l'innovation industrielle ». La discussion a souligné la nécessité d'une concentration des moyens, en cherchant à accélérer le processus d'union économique, et à modifier la structure des marchés ; elle a insisté sur « la nécessité d'éviter les doubles emplois et l'existence de zones de désert technologique ». ' II s'agit bien d'une tentative de programmation de la division du travail, et cela en respectant les impératifs du mode de production capitaliste, puisqu'ont été posés tous les problèmes relatifs à la propriété industrielle des innovations scientifique et technique, à la protection des inventions, aux règles de la concurrence au sein du Marché commun. ' « Le flux des cerveaux » vers les Etats-Unis constitue enfin un phénomène qui précise ces tendances. On sait qu'aujourd'hui les migrations de chercheurs, ingénieurs, médecins créent un véritable marché international de l'intelligence scientifique et technique. Ainsi, un article paru dans la revue patronale « L'Usine nouvelle » (septembre 1967) indique : « D'après certaines estimations, les Etats->Unis auraient économisé 4 milliards de dollars, grâce à l'afflux de techniciens étrangers qui s'y établissent. Tel serait, en effet, le coût de formation des quelque 100.000 chercheurs et techniciens qui se sont expatriés Outre-Atlantique depuis 1945. L'exode de ce personnel hautement qualifié s'effectue par deux filières principales. D'une part, les sociétés américaines les embauchent directement par l'intermédiaire de leurs filiales implantées à l'étranger, soit pour les employer sur place, soit pour les faire venir aux Etats-Unis. Depuis quelque temps, elles sont secondées dans cette tâche par un certain nombre d'agences de placement américaines qui se sont elles-mêmes établies en Europe à cette fin. L'activité de ces agences est surtout importante en Grande-Bretagne. D'autre part, un pourcentage considérable d'étudiants étrangers inscrits dans les universités américaines s'établissent définitivement aux Etats-Unis. » Le « brain drain » constitue un handicap supplémentaire pour les pays de l'Europe occidentale et leurs bourgeoisies ; une étude sur ces problèmes (non publiée pour des raisons politiques), rédigée par un expert de l'O.N.U., propose que ce flux soit compensé par le versement de royalties aux pays fournisseurs de « matière grise ». Il est bien évident que le Department d'Etat n'envisage pas de mesures en ce sens. Toutes ces questions ont d'ailleurs été développées dans une série d'articles parus dans le journal « Le Monde ». • Ce phénomène confirme la tendance au renforcement des inégalités de développement dans un système dominé par une économie de marché. Il met aussi en évidence un nouveau mode d'appropriation de la production scientifique et technique par le capital. Sous cet angle aussi, le système impérialiste mondial apparaît comme incapable de pro-
ECHANGES FRANCE - ETRANGER PENDANT L'ANNEE 1964 (millions de francs)
Recettes Dépenses Soldes
Brevets ....... ....... 17,3 7,6 +9,7
Licences 2949 655 — 3601
Coop-technique .... 4003 280,3 + 120
42.440 BREVETS DEPOSES EN FRANCE EN 1963
Origine France Etranger U.S. A. R.F.A.
Nombre des brevets .. 15.825 26.625 8.361 6.393
En ce qui concerne les brevets déposés en France pour 1964 (et il en est de même depuis environ une dizaine d'années), notre solde est positif. Par contre, le solde des licences est négatif. Le premier phénomène traduit une certaine difficulté à faire passer les innovations du stade de la recherche à celui de la production industrielle. Quant au second, il ne fait que refléter l'étroite dépendance de l'économie française par rapport à l'économie américaine. Précisons d'ailleurs que la situation est sans doute plus défavorable que ne tendent à l'indiquer les seuls chiffres, puisque dans les seuls documents disponibles se trouvent inclus les dépôts effectués par les filiales des sociétés étrangères. (Nous dirons plus loin quelques mots sur la façon dont les problèmes se posent aujourd'hui à l'échelle européenne.) A. Maréchal lui-même écrit : « Dé/a, derrière une façade d'industries au nom français, qui vendent des produits de marque française, s'installe l'avant-garde des firmes pionnières américaines : les calculateurs, l'électronique, les industries alimentaire et agricole sont delà touchées. Qu'arrivera-t-il lorsque la vague d'innovations qu'annoncent les travaux américains en mécanique de précision, en optique, en chimie, en aéronautique, etc. déferlera sur l'Europe ? »
Que signifient les tentatives actuelles de coordination entre pays de l'Ouest en matière de recherche et développement ?
* En ce qui concerne la recherche scientifique et le développement technologique (à l'intérieur du système Etats-Unis + Europe occidentale) on peut affirmer que les écarts actuels tendront à croître, en dépit des tentatives d'harmonisation. Une statistique publiée par l'O.C.D.E., bien que fragmentaire et manquant d'homogénéité (en raison de classifications et de définitions non comparables) met néanmoins le phénomène en relief :
PAYS En millions Par En % du de dollars habitant P.N.B.
Etats-Unis .. ......... 17.531 93,7 31
Allemagne .. ........... 1.105 20,1 1,3
France ...................... 1.108 23,6 1,5
Total des Six 3.070 17 12
Royaume-Uni ............ 1 .775 33,5 2,2
• On peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs correctifs ; C. Freeman et A. Young se sont efforcés de corriger les données
49
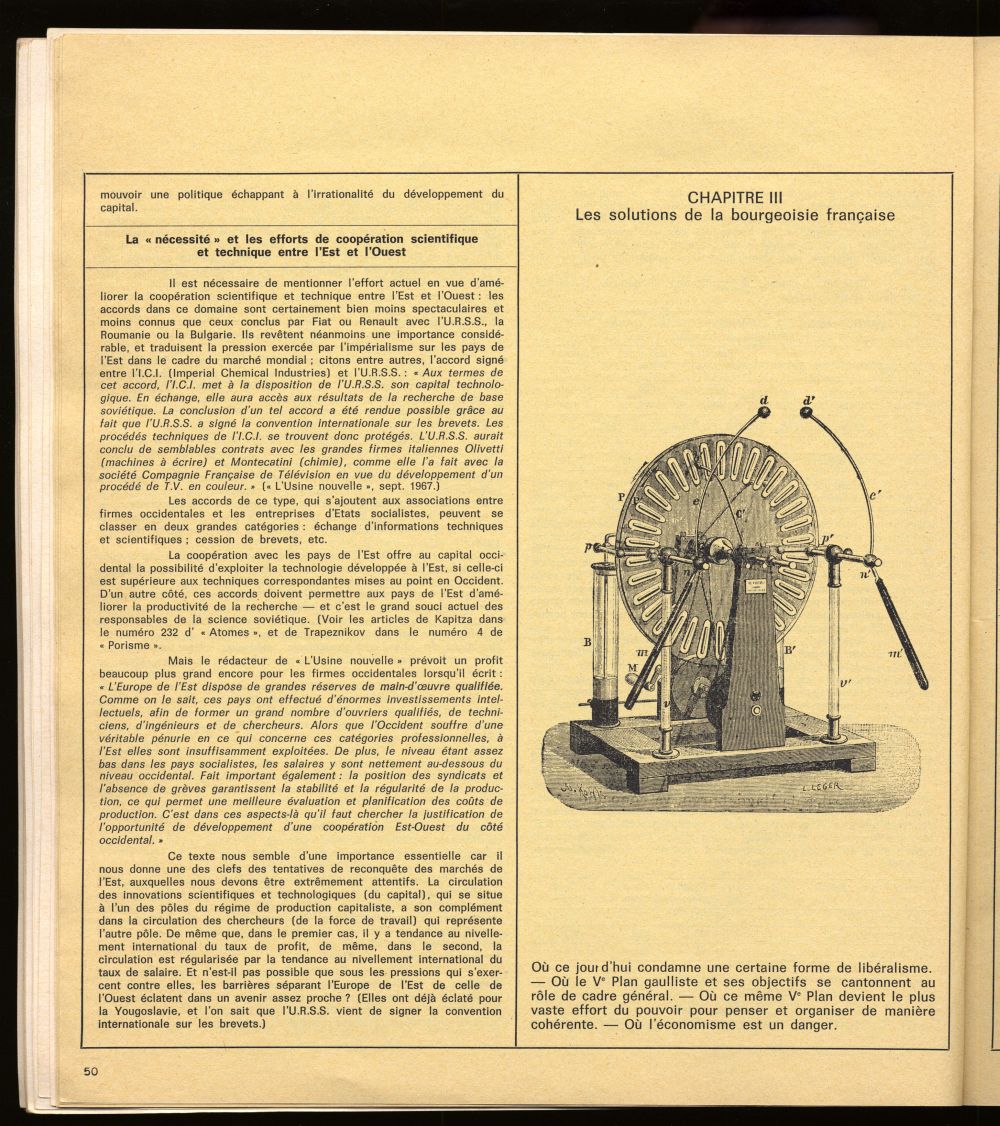

mouvoir une politique échappant à l'irrationalité du développement du
capital.
capital.
La « nécessité » et les efforts de coopération scientifique
et technique entre l'Est et l'Ouest
et technique entre l'Est et l'Ouest
II est nécessaire de mentionner l'effort actuel en vue d'amé-
liorer la coopération scientifique et technique entre l'Est et l'Ouest : les
accords dans ce domaine sont certainement bien moins spectaculaires et
moins connus que ceux conclus par Fiat ou Renault avec l'U.R.S.S., la
Roumanie ou la Bulgarie. Ils revêtent néanmoins une importance considé-
rable, et traduisent la pression exercée par l'impérialisme sur les pays de
l'Est dans le cadre du marché mondial ; citons entre autres, l'accord signé
entre l'I.C.I. (Impérial Chemical Industries) et l'U.R.S.S. : « Aux termes de
cet accord, l'I.C.I. met a la disposition de l'U.R.S.S. son capital technolo-
gique. En échange, elle aura accès aux résultats de la recherche de base
soviétique. La conclusion d'un tel accord a été rendue possible grâce au
fait que l'U.R.S.S. a signé la convention internationale sur les brevets. Les
procédés techniques de l'I.C.I. se trouvent donc protégés. L'U.R.S.S. aurait
conclu de semblables contrats avec les grandes firmes italiennes Olivetti
(machines à écrire) et Montecatini (chimie), comme elle l'a fait avec la
société Compagnie Française de Télévision en vue du développement d'un
procédé de T.V. en couleur. « [« L'Usine nouvelle », sept. 1967.)
liorer la coopération scientifique et technique entre l'Est et l'Ouest : les
accords dans ce domaine sont certainement bien moins spectaculaires et
moins connus que ceux conclus par Fiat ou Renault avec l'U.R.S.S., la
Roumanie ou la Bulgarie. Ils revêtent néanmoins une importance considé-
rable, et traduisent la pression exercée par l'impérialisme sur les pays de
l'Est dans le cadre du marché mondial ; citons entre autres, l'accord signé
entre l'I.C.I. (Impérial Chemical Industries) et l'U.R.S.S. : « Aux termes de
cet accord, l'I.C.I. met a la disposition de l'U.R.S.S. son capital technolo-
gique. En échange, elle aura accès aux résultats de la recherche de base
soviétique. La conclusion d'un tel accord a été rendue possible grâce au
fait que l'U.R.S.S. a signé la convention internationale sur les brevets. Les
procédés techniques de l'I.C.I. se trouvent donc protégés. L'U.R.S.S. aurait
conclu de semblables contrats avec les grandes firmes italiennes Olivetti
(machines à écrire) et Montecatini (chimie), comme elle l'a fait avec la
société Compagnie Française de Télévision en vue du développement d'un
procédé de T.V. en couleur. « [« L'Usine nouvelle », sept. 1967.)
Les accords de ce type, qui s'ajoutent aux associations entre
firmes occidentales et les entreprises d'Etats socialistes, peuvent se
classer en deux grandes catégories : échange d'informations techniques
et scientifiques ; cession de brevets, etc.
firmes occidentales et les entreprises d'Etats socialistes, peuvent se
classer en deux grandes catégories : échange d'informations techniques
et scientifiques ; cession de brevets, etc.
La coopération avec les pays de l'Est offre au capital occi-
dental la possibilité d'exploiter la technologie développée à l'Est, si celle-ci
est supérieure aux techniques correspondantes mises au point en Occident.
D'un autre côté, ces accords doivent permettre aux pays de l'Est d'amé-
liorer la productivité de la recherche — et c'est le grand souci actuel des
responsables de la science soviétique. (Voir les articles de Kapitza dans
le numéro 232 d' « Atomes », et de Trapeznikov dans le numéro 4 de
« Porisme ».
dental la possibilité d'exploiter la technologie développée à l'Est, si celle-ci
est supérieure aux techniques correspondantes mises au point en Occident.
D'un autre côté, ces accords doivent permettre aux pays de l'Est d'amé-
liorer la productivité de la recherche — et c'est le grand souci actuel des
responsables de la science soviétique. (Voir les articles de Kapitza dans
le numéro 232 d' « Atomes », et de Trapeznikov dans le numéro 4 de
« Porisme ».
Mais le rédacteur de « L'Usine nouvelle » prévoit un profit
beaucoup plus grand encore pour les firmes occidentales lorsqu'il écrit :
« L'Europe de l'Est dispose de grandes réserves de main-d'œuvre qualifiée.
Comme on le sait, ces pays ont effectué d'énormes investissements intel-
lectuels, afin de former un grand nombre d'ouvriers qualifiés, de techni-
ciens, d'ingénieurs et de chercheurs. Alors que l'Occident souffre d'une
véritable pénurie en ce qui concerne ces catégories professionnelles, à
l'Est elles sont insuffisamment exploitées. De plus, le niveau étant assez
bas dans les pays socialistes, les salaires y sont nettement au-dessous du
niveau occidental. Fait important également : la position des syndicats et
l'absence de grèves garantissent la stabilité et la régularité de la produc-
tion, ce qui permet une meilleure évaluation et planification des coûts de
production. C'est dans ces aspects-là qu'il faut chercher la justification de
l'opportunité de développement d'une coopération Est-Ouest du côté
occidental. »
beaucoup plus grand encore pour les firmes occidentales lorsqu'il écrit :
« L'Europe de l'Est dispose de grandes réserves de main-d'œuvre qualifiée.
Comme on le sait, ces pays ont effectué d'énormes investissements intel-
lectuels, afin de former un grand nombre d'ouvriers qualifiés, de techni-
ciens, d'ingénieurs et de chercheurs. Alors que l'Occident souffre d'une
véritable pénurie en ce qui concerne ces catégories professionnelles, à
l'Est elles sont insuffisamment exploitées. De plus, le niveau étant assez
bas dans les pays socialistes, les salaires y sont nettement au-dessous du
niveau occidental. Fait important également : la position des syndicats et
l'absence de grèves garantissent la stabilité et la régularité de la produc-
tion, ce qui permet une meilleure évaluation et planification des coûts de
production. C'est dans ces aspects-là qu'il faut chercher la justification de
l'opportunité de développement d'une coopération Est-Ouest du côté
occidental. »
Ce texte nous semble d'une importance essentielle car il
nous donne une des clefs des tentatives de reconquête des marchés de
l'Est, auxquelles nous devons être extrêmement attentifs. La circulation
des innovations scientifiques et technologiques (du capital), qui se situe
à l'un des pôles du régime de production capitaliste, a son complément
dans la circulation des chercheurs (de la force de travail) qui représente
l'autre pôle. De même que, dans le premier cas, il y a tendance au nivelle-
ment international du taux de profit, de même, dans le second, la
circulation est régularisée par la tendance au nivellement international du
taux de salaire. Et n'est-il pas possible que sous les pressions qui s'exer-
cent contre elles, les barrières séparant l'Europe de l'Est de celle de
l'Ouest éclatent dans un avenir assez proche ? (Elles ont déjà éclaté pour
la Yougoslavie, et l'on sait que l'U.R.S.S. vient de signer la convention
internationale sur les brevets.)
nous donne une des clefs des tentatives de reconquête des marchés de
l'Est, auxquelles nous devons être extrêmement attentifs. La circulation
des innovations scientifiques et technologiques (du capital), qui se situe
à l'un des pôles du régime de production capitaliste, a son complément
dans la circulation des chercheurs (de la force de travail) qui représente
l'autre pôle. De même que, dans le premier cas, il y a tendance au nivelle-
ment international du taux de profit, de même, dans le second, la
circulation est régularisée par la tendance au nivellement international du
taux de salaire. Et n'est-il pas possible que sous les pressions qui s'exer-
cent contre elles, les barrières séparant l'Europe de l'Est de celle de
l'Ouest éclatent dans un avenir assez proche ? (Elles ont déjà éclaté pour
la Yougoslavie, et l'on sait que l'U.R.S.S. vient de signer la convention
internationale sur les brevets.)
CHAPITRE III
Les solutions de la bourgeoisie française
Les solutions de la bourgeoisie française
A A'
à
Où ce jourd'hui condamne une certaine forme de libéralisme.
— Où le Ve Plan gaulliste et ses objectifs se cantonnent au
rôle de cadre général. — Où ce même Ve Plan devient le plus
vaste effort du pouvoir pour penser et organiser de manière
cohérente. — Où l'économisme est un danger.
— Où le Ve Plan gaulliste et ses objectifs se cantonnent au
rôle de cadre général. — Où ce même Ve Plan devient le plus
vaste effort du pouvoir pour penser et organiser de manière
cohérente. — Où l'économisme est un danger.
50
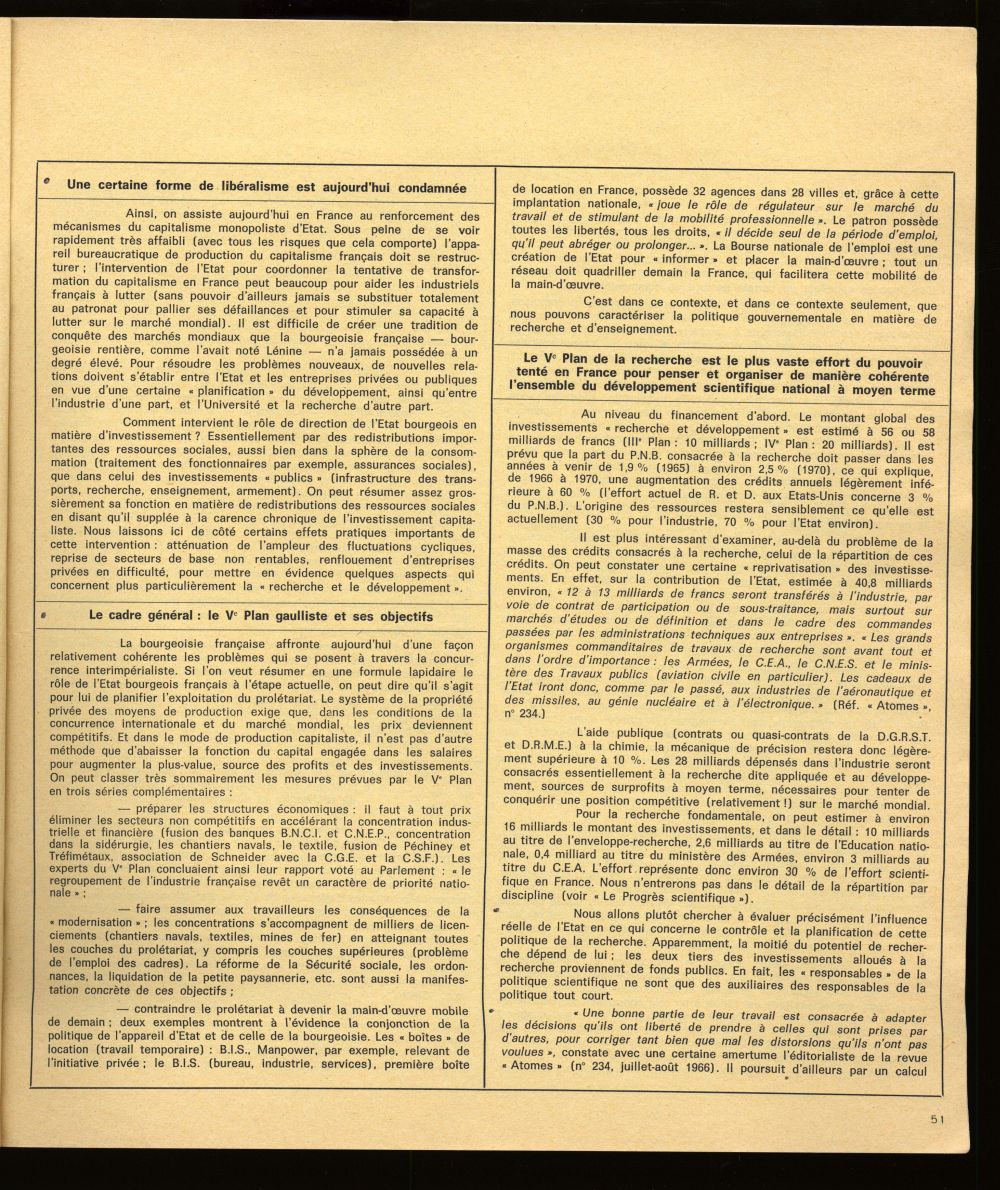

Une certaine forme de libéralisme est aujourd'hui condamnée
Ainsi, on assiste aujourd'hui en France au renforcement des
mécanismes du capitalisme monopoliste d'Etat. Sous peine de se voir
rapidement très affaibli (avec tous les risques que cela comporte) l'appa-
reil bureaucratique de production du capitalisme français doit se restruc-
turer ; l'intervention de l'Etat pour coordonner la tentative de transfor-
mation du capitalisme en France peut beaucoup pour aider les industriels
français à lutter (sans pouvoir d'ailleurs jamais se substituer totalement
au patronat pour pallier ses défaillances et pour stimuler sa capacité à
lutter sur le marché mondial). Il est difficile de créer une tradition de
conquête des marchés mondiaux que la bourgeoisie française — bour-
geoisie rentière, comme l'avait noté Lénine — n'a jamais possédée à un
degré élevé. Pour résoudre les problèmes nouveaux, de nouvelles rela-
tions doivent s'établir entre l'Etat et les entreprises privées ou publiques
en vue d'une certaine « planification » du développement, ainsi qu'entre
l'industrie d'une part, et l'Université et la recherche d'autre part.
mécanismes du capitalisme monopoliste d'Etat. Sous peine de se voir
rapidement très affaibli (avec tous les risques que cela comporte) l'appa-
reil bureaucratique de production du capitalisme français doit se restruc-
turer ; l'intervention de l'Etat pour coordonner la tentative de transfor-
mation du capitalisme en France peut beaucoup pour aider les industriels
français à lutter (sans pouvoir d'ailleurs jamais se substituer totalement
au patronat pour pallier ses défaillances et pour stimuler sa capacité à
lutter sur le marché mondial). Il est difficile de créer une tradition de
conquête des marchés mondiaux que la bourgeoisie française — bour-
geoisie rentière, comme l'avait noté Lénine — n'a jamais possédée à un
degré élevé. Pour résoudre les problèmes nouveaux, de nouvelles rela-
tions doivent s'établir entre l'Etat et les entreprises privées ou publiques
en vue d'une certaine « planification » du développement, ainsi qu'entre
l'industrie d'une part, et l'Université et la recherche d'autre part.
Comment intervient le rôle de direction de l'Etat bourgeois en
matière d'investissement ? Essentiellement par des redistributions impor-
tantes des ressources sociales, aussi bien dans la sphère de la consom-
mation (traitement des fonctionnaires par exemple, assurances sociales),
que dans celui des investissements « publics » (infrastructure des trans-
ports, recherche, enseignement, armement). On peut résumer assez gros-
sièrement sa fonction en matière de redistributions des ressources sociales
en disant qu'il supplée à la carence chronique de l'investissement capita-
liste. Nous laissons ici de côté certains effets pratiques importants de
cette intervention : atténuation de l'ampleur des fluctuations cycliques,
reprise de secteurs de base non rentables, renflouement d'entreprises
privées en difficulté, pour mettre en évidence quelques aspects qui
concernent plus particulièrement la « recherche et le développement ».
matière d'investissement ? Essentiellement par des redistributions impor-
tantes des ressources sociales, aussi bien dans la sphère de la consom-
mation (traitement des fonctionnaires par exemple, assurances sociales),
que dans celui des investissements « publics » (infrastructure des trans-
ports, recherche, enseignement, armement). On peut résumer assez gros-
sièrement sa fonction en matière de redistributions des ressources sociales
en disant qu'il supplée à la carence chronique de l'investissement capita-
liste. Nous laissons ici de côté certains effets pratiques importants de
cette intervention : atténuation de l'ampleur des fluctuations cycliques,
reprise de secteurs de base non rentables, renflouement d'entreprises
privées en difficulté, pour mettre en évidence quelques aspects qui
concernent plus particulièrement la « recherche et le développement ».
Le cadre général : le Ve Plan gaulliste et ses objectifs
La bourgeoisie française affronte aujourd'hui d'une façon
relativement cohérente les problèmes qui se posent à travers la concur-
rence interimpérialiste. Si l'on veut résumer en une formule lapidaire le
rôle de l'Etat bourgeois français à l'étape actuelle, on peut dire qu'il s'agit
pour lui de planifier l'exploitation du prolétariat. Le système de la propriété
privée des moyens de production exige que, dans les conditions de la
concurrence internationale et du marché mondial, les prix deviennent
compétitifs. Et dans le mode de production capitaliste, il n'est pas d'autre
méthode que d'abaisser la fonction du capital engagée dans les salaires
pour augmenter la plus-value, source des profits et des investissements.
On peut classer très sommairement les mesures prévues par le Ve Plan
en trois séries complémentaires :
relativement cohérente les problèmes qui se posent à travers la concur-
rence interimpérialiste. Si l'on veut résumer en une formule lapidaire le
rôle de l'Etat bourgeois français à l'étape actuelle, on peut dire qu'il s'agit
pour lui de planifier l'exploitation du prolétariat. Le système de la propriété
privée des moyens de production exige que, dans les conditions de la
concurrence internationale et du marché mondial, les prix deviennent
compétitifs. Et dans le mode de production capitaliste, il n'est pas d'autre
méthode que d'abaisser la fonction du capital engagée dans les salaires
pour augmenter la plus-value, source des profits et des investissements.
On peut classer très sommairement les mesures prévues par le Ve Plan
en trois séries complémentaires :
— préparer les structures économiques : il faut à tout prix
éliminer les secteurs non compétitifs en accélérant la concentration indus-
trielle et financière (fusion des banques B.N.C.I. et C.N.E.P., concentration
dans la sidérurgie, les chantiers navals, le textile, fusion de Péchiney et
Tréfimétaux, association de Schneider avec la C.G.E. et la C.S.F.). Les
experts du V' Plan concluaient ainsi leur rapport voté au Parlement : « le
regroupement de l'industrie française revêt un caractère de priorité natio-
nale » ;
éliminer les secteurs non compétitifs en accélérant la concentration indus-
trielle et financière (fusion des banques B.N.C.I. et C.N.E.P., concentration
dans la sidérurgie, les chantiers navals, le textile, fusion de Péchiney et
Tréfimétaux, association de Schneider avec la C.G.E. et la C.S.F.). Les
experts du V' Plan concluaient ainsi leur rapport voté au Parlement : « le
regroupement de l'industrie française revêt un caractère de priorité natio-
nale » ;
— faire assumer aux travailleurs les conséquences de la
« modernisation » ; les concentrations s'accompagnent de milliers de licen-
ciements (chantiers navals, textiles, mines de fer) en atteignant toutes
les couches du prolétariat, y compris les couches supérieures (problème
de l'emploi des cadres). La réforme de la Sécurité sociale, les ordon-
nances, la liquidation de la petite paysannerie, etc. sont aussi la manifes-
tation concrète de ces objectifs ;
« modernisation » ; les concentrations s'accompagnent de milliers de licen-
ciements (chantiers navals, textiles, mines de fer) en atteignant toutes
les couches du prolétariat, y compris les couches supérieures (problème
de l'emploi des cadres). La réforme de la Sécurité sociale, les ordon-
nances, la liquidation de la petite paysannerie, etc. sont aussi la manifes-
tation concrète de ces objectifs ;
— contraindre le prolétariat à devenir la main-d'œuvre mobile
de demain ; deux exemples montrent à l'évidence la conjonction de la
politique de l'appareil d'Etat et de celle de la bourgeoisie. Les <• boîtes » de
location (travail temporaire) : B.I.S., Manpower, par exemple, relevant de
l'initiative privée; le B.I.S. (bureau, industrie, services), première boîte
de demain ; deux exemples montrent à l'évidence la conjonction de la
politique de l'appareil d'Etat et de celle de la bourgeoisie. Les <• boîtes » de
location (travail temporaire) : B.I.S., Manpower, par exemple, relevant de
l'initiative privée; le B.I.S. (bureau, industrie, services), première boîte
de location en France, possède 32 agences dans 28 villes et, grâce à cette
implantation nationale, « joue le rôle de régulateur sur le marché du
travail et de stimulant de la mobilité professionnelle ». Le patron possède
toutes les libertés, tous les droits, « // décide seul de la période d'emploi,
qu'il peut abréger ou prolonger... ». La Bourse nationale de l'emploi est une
création de l'Etat pour « informer » et placer la main-d'œuvre ; tout un
réseau doit quadriller demain la France, qui facilitera cette mobilité de
la main-d'œuvre.
implantation nationale, « joue le rôle de régulateur sur le marché du
travail et de stimulant de la mobilité professionnelle ». Le patron possède
toutes les libertés, tous les droits, « // décide seul de la période d'emploi,
qu'il peut abréger ou prolonger... ». La Bourse nationale de l'emploi est une
création de l'Etat pour « informer » et placer la main-d'œuvre ; tout un
réseau doit quadriller demain la France, qui facilitera cette mobilité de
la main-d'œuvre.
C'est dans ce contexte, et dans ce contexte seulement, que
nous pouvons caractériser la politique gouvernementale en matière de
recherche et d'enseignement.
nous pouvons caractériser la politique gouvernementale en matière de
recherche et d'enseignement.
Le Ve Plan de la recherche est le plus vaste effort du pouvoir
tenté en France pour penser et organiser de manière cohérente
l'ensemble du développement scientifique national à moyen terme
Au niveau du financement d'abord. Le montant global des
investissements « recherche et développement » est estimé à 56 ou 58
milliards de francs (IIIe Plan: 10 milliards; IV' Plan: 20 milliards). Il est
prévu que la part du P.N.B. consacrée à la recherche doit passer dans les
années à venir de 1,9% (1965) à environ 2,5% (1970), ce qui explique,
de 1966 à 1970, une augmentation des crédits annuels légèrement infé-
rieure à 60 % (l'effort actuel de R. et D. aux Etats-Unis concerne 3 %
du P.N.B.). L'origine des ressources restera sensiblement ce qu'elle est
actuellement (30 % pour l'industrie, 70 % pour l'Etat environ).
investissements « recherche et développement » est estimé à 56 ou 58
milliards de francs (IIIe Plan: 10 milliards; IV' Plan: 20 milliards). Il est
prévu que la part du P.N.B. consacrée à la recherche doit passer dans les
années à venir de 1,9% (1965) à environ 2,5% (1970), ce qui explique,
de 1966 à 1970, une augmentation des crédits annuels légèrement infé-
rieure à 60 % (l'effort actuel de R. et D. aux Etats-Unis concerne 3 %
du P.N.B.). L'origine des ressources restera sensiblement ce qu'elle est
actuellement (30 % pour l'industrie, 70 % pour l'Etat environ).
Il est plus intéressant d'examiner, au-delà du problème de la
masse des crédits consacrés à la recherche, celui de la répartition de ces
crédits. On peut constater une certaine « reprivatisation » des investisse-
ments. En effet, sur la contribution de l'Etat, estimée à 40,8 milliards
environ, <• 12 à 13 milliards de francs seront transférés à l'industrie, par
voie de contrat de participation ou de sous-traitance, mais surtout sur
marchés d'études ou de définition et dans le cadre des commandes
passées par les administrations techniques aux entreprises ». * Les grands
organismes commanditaires de travaux de recherche sont avant tout et
dans l'ordre d'importance : les Armées, le C.E.A., le C.N.E.S. et le minis-
tère des Travaux publics (aviation civile en particulier). Les cadeaux de
l'Etat iront donc, comme par le passé, aux industries de l'aéronautique et
des missiles, au génie nucléaire et à l'électronique. » (Réf. « Atomes »,
n" 234.)
masse des crédits consacrés à la recherche, celui de la répartition de ces
crédits. On peut constater une certaine « reprivatisation » des investisse-
ments. En effet, sur la contribution de l'Etat, estimée à 40,8 milliards
environ, <• 12 à 13 milliards de francs seront transférés à l'industrie, par
voie de contrat de participation ou de sous-traitance, mais surtout sur
marchés d'études ou de définition et dans le cadre des commandes
passées par les administrations techniques aux entreprises ». * Les grands
organismes commanditaires de travaux de recherche sont avant tout et
dans l'ordre d'importance : les Armées, le C.E.A., le C.N.E.S. et le minis-
tère des Travaux publics (aviation civile en particulier). Les cadeaux de
l'Etat iront donc, comme par le passé, aux industries de l'aéronautique et
des missiles, au génie nucléaire et à l'électronique. » (Réf. « Atomes »,
n" 234.)
L'aide publique (contrats ou quasi-contrats de la D.G.R.S.T.
et D.R.M.E.) à la chimie, la mécanique de précision restera donc légère-
ment supérieure à 10 %. Les 28 milliards dépensés dans l'industrie seront
consacrés essentiellement à la recherche dite appliquée et au développe-
ment, sources de surprofits à moyen terme, nécessaires pour tenter de
conquérir une position compétitive (relativement!) sur le marché mondial.
et D.R.M.E.) à la chimie, la mécanique de précision restera donc légère-
ment supérieure à 10 %. Les 28 milliards dépensés dans l'industrie seront
consacrés essentiellement à la recherche dite appliquée et au développe-
ment, sources de surprofits à moyen terme, nécessaires pour tenter de
conquérir une position compétitive (relativement!) sur le marché mondial.
Pour la recherche fondamentale, on peut estimer à environ
16 milliards le montant des investissements, et dans le détail : 10 milliards
au titre de l'enveloppe-recherche, 2,6 milliards au titre de l'Education natio-
nale, 0,4 milliard au titre du ministère des Armées, environ 3 milliards au
titre du C.E.A. L'effort représente donc environ 30 % de l'effort scienti-
fique en France. Nous n'entrerons pas dans le détail de la répartition par
discipline (voir «Le Progrès scientifique»).
16 milliards le montant des investissements, et dans le détail : 10 milliards
au titre de l'enveloppe-recherche, 2,6 milliards au titre de l'Education natio-
nale, 0,4 milliard au titre du ministère des Armées, environ 3 milliards au
titre du C.E.A. L'effort représente donc environ 30 % de l'effort scienti-
fique en France. Nous n'entrerons pas dans le détail de la répartition par
discipline (voir «Le Progrès scientifique»).
' Nous allons plutôt chercher à évaluer précisément l'influence
réelle de l'Etat en ce qui concerne le contrôle et la planification de cette
politique de la recherche. Apparemment, la moitié du potentiel de recher-
che dépend de lui ; les deux tiers des investissements alloués à la
recherche proviennent de fonds publics. En fait, les « responsables » de la
politique scientifique ne sont que des auxiliaires des responsables de la
politique tout court.
politique de la recherche. Apparemment, la moitié du potentiel de recher-
che dépend de lui ; les deux tiers des investissements alloués à la
recherche proviennent de fonds publics. En fait, les « responsables » de la
politique scientifique ne sont que des auxiliaires des responsables de la
politique tout court.
« Une bonne partie de leur travail est consacrée à adapter
les décisions qu'ils ont liberté de prendre à celles qui sont prises par
d'autres, pour corriger tant bien que mal les distorsions qu'ils n'ont pas
voulues », constate avec une certaine amertume l'éditorialiste de la revue
«Atomes» (n° 234, juillet-août 1966). Il poursuit d'ailleurs par un calcul
les décisions qu'ils ont liberté de prendre à celles qui sont prises par
d'autres, pour corriger tant bien que mal les distorsions qu'ils n'ont pas
voulues », constate avec une certaine amertume l'éditorialiste de la revue
«Atomes» (n° 234, juillet-août 1966). Il poursuit d'ailleurs par un calcul
5l
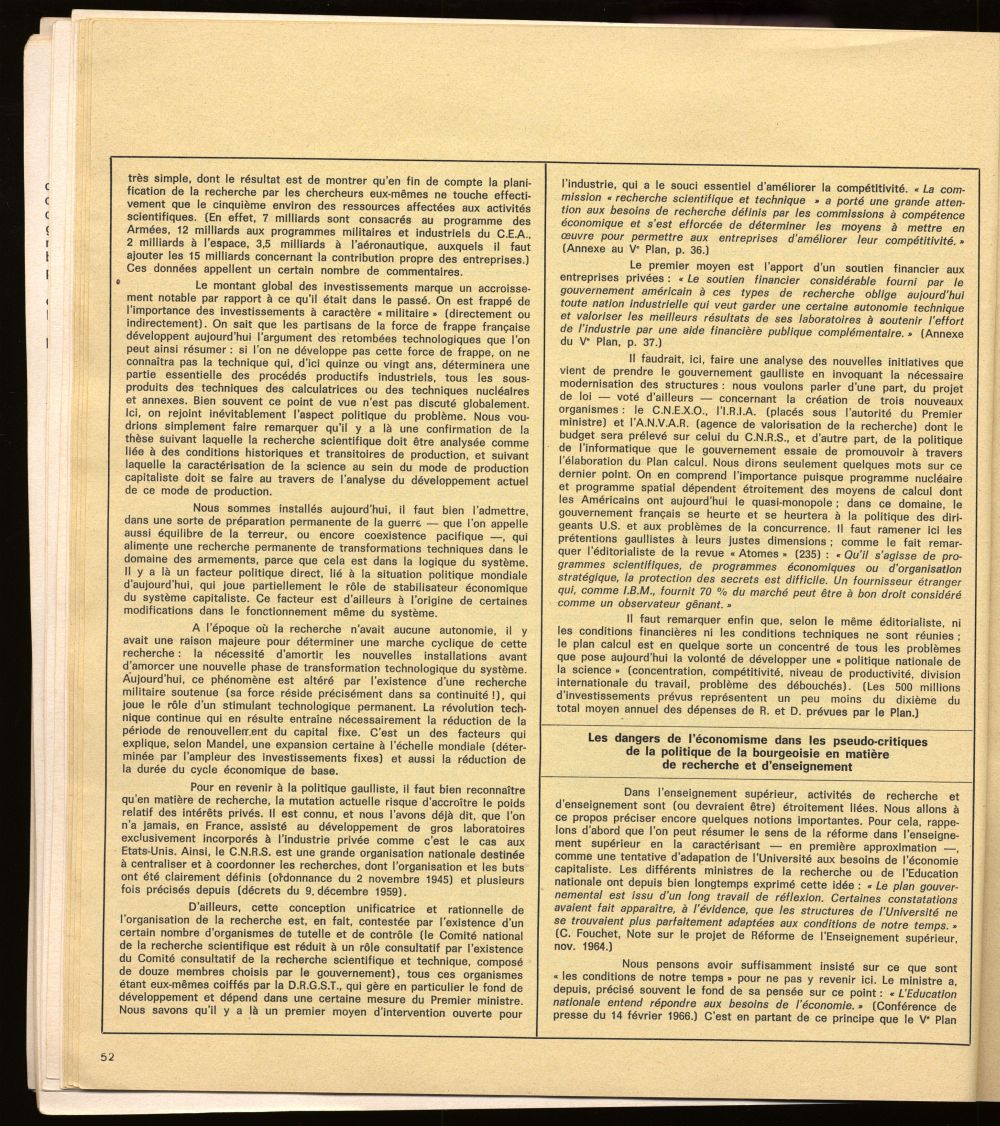

très simple, dont le résultat est de montrer qu'en fin de compte la plani-
fication de la recherche par les chercheurs eux-mêmes ne touche effecti-
vement que le cinquième environ des ressources affectées aux activités
scientifiques. (En effet, 7 milliards sont consacrés au programme des
Armées, 12 milliards aux programmes militaires et industriels du C.E.A.,
2 milliards à l'espace, 3,5 milliards à l'aéronautique, auxquels il faut
ajouter les 15 milliards concernant la contribution propre des entreprises.)
Ces données appellent un certain nombre de commentaires.
fication de la recherche par les chercheurs eux-mêmes ne touche effecti-
vement que le cinquième environ des ressources affectées aux activités
scientifiques. (En effet, 7 milliards sont consacrés au programme des
Armées, 12 milliards aux programmes militaires et industriels du C.E.A.,
2 milliards à l'espace, 3,5 milliards à l'aéronautique, auxquels il faut
ajouter les 15 milliards concernant la contribution propre des entreprises.)
Ces données appellent un certain nombre de commentaires.
Le montant global des investissements marque un accroisse-
ment notable par rapport à ce qu'il était dans le passé. On est frappé de
l'importance des investissements à caractère « militaire » (directement ou
indirectement). On sait que les partisans de la force de frappe française
développent aujourd'hui l'argument des retombées technologiques que l'on
peut ainsi résumer : si l'on ne développe pas cette force de frappe, on ne
connaîtra pas la technique qui, d'ici quinze ou vingt ans, déterminera une
partie essentielle des procédés productifs industriels, tous les sous-
produits des techniques des calculatrices ou des techniques nucléaires
et annexes. Bien souvent ce point de vue n'est pas discuté globalement.
Ici, on rejoint inévitablement l'aspect politique du problème. Nous vou-
drions simplement faire remarquer qu'il y a là une confirmation de la
thèse suivant laquelle la recherche scientifique doit être analysée comme
liée à des conditions historiques et transitoires de production, et suivant
laquelle la caractérisation de la science au sein du mode de production
capitaliste doit se faire au travers de l'analyse du développement actuel
de ce mode de production.
ment notable par rapport à ce qu'il était dans le passé. On est frappé de
l'importance des investissements à caractère « militaire » (directement ou
indirectement). On sait que les partisans de la force de frappe française
développent aujourd'hui l'argument des retombées technologiques que l'on
peut ainsi résumer : si l'on ne développe pas cette force de frappe, on ne
connaîtra pas la technique qui, d'ici quinze ou vingt ans, déterminera une
partie essentielle des procédés productifs industriels, tous les sous-
produits des techniques des calculatrices ou des techniques nucléaires
et annexes. Bien souvent ce point de vue n'est pas discuté globalement.
Ici, on rejoint inévitablement l'aspect politique du problème. Nous vou-
drions simplement faire remarquer qu'il y a là une confirmation de la
thèse suivant laquelle la recherche scientifique doit être analysée comme
liée à des conditions historiques et transitoires de production, et suivant
laquelle la caractérisation de la science au sein du mode de production
capitaliste doit se faire au travers de l'analyse du développement actuel
de ce mode de production.
Nous sommes installés aujourd'hui, il faut bien l'admettre,
dans une sorte de préparation permanente de la guerre. — que l'on appelle
aussi équilibre de la terreur, ou encore coexistence pacifique —, qui
alimente une recherche permanente de transformations techniques dans le
domaine des armements, parce que cela est dans la logique du système.
Il y a là un facteur politique direct, lié à la situation politique mondiale
d'aujourd'hui, qui joue partiellement le rôle de stabilisateur économique
du système capitaliste. Ce facteur est d'ailleurs à l'origine de certaines
modifications dans le fonctionnement même du système.
dans une sorte de préparation permanente de la guerre. — que l'on appelle
aussi équilibre de la terreur, ou encore coexistence pacifique —, qui
alimente une recherche permanente de transformations techniques dans le
domaine des armements, parce que cela est dans la logique du système.
Il y a là un facteur politique direct, lié à la situation politique mondiale
d'aujourd'hui, qui joue partiellement le rôle de stabilisateur économique
du système capitaliste. Ce facteur est d'ailleurs à l'origine de certaines
modifications dans le fonctionnement même du système.
A l'époque où la recherche n'avait aucune autonomie, il y
avait une raison majeure pour déterminer une marche cyclique de cette
recherche : la nécessité d'amortir les nouvelles installations avant
d'amorcer une nouvelle phase de transformation technologique du système.
Aujourd'hui, ce phénomène est altéré par l'existence d'une recherche
militaire soutenue (sa force réside précisément dans sa continuité!), qui
joue le rôle d'un stimulant technologique permanent. La révolution tech-
nique continue qui en résulte entraîne nécessairement la réduction de la
période de renouvellement du capital fixe. C'est un des facteurs qui
explique, selon Mandel, une expansion certaine à l'échelle mondiale (déter-
minée par l'ampleur des investissements fixes) et aussi la réduction de
la durée du cycle économique de base.
avait une raison majeure pour déterminer une marche cyclique de cette
recherche : la nécessité d'amortir les nouvelles installations avant
d'amorcer une nouvelle phase de transformation technologique du système.
Aujourd'hui, ce phénomène est altéré par l'existence d'une recherche
militaire soutenue (sa force réside précisément dans sa continuité!), qui
joue le rôle d'un stimulant technologique permanent. La révolution tech-
nique continue qui en résulte entraîne nécessairement la réduction de la
période de renouvellement du capital fixe. C'est un des facteurs qui
explique, selon Mandel, une expansion certaine à l'échelle mondiale (déter-
minée par l'ampleur des investissements fixes) et aussi la réduction de
la durée du cycle économique de base.
Pour en revenir à la politique gaulliste, il faut bien reconnaître
qu'en matière de recherche, la mutation actuelle risque d'accroître le poids
relatif des intérêts privés. Il est connu, et nous l'avons déjà dit, que l'on
n'a jamais, en France, assisté au développement de gros laboratoires
exclusivement incorporés à l'industrie privée comme c'est le cas aux
Etats-Unis. Ainsi, le C.N.R.S. est une grande organisation nationale destinée
à centraliser et à coordonner les recherches, dont l'organisation et les buts
ont été clairement définis (ordonnance du 2 novembre 1945) et plusieurs
fois précisés depuis (décrets du 9. décembre 1959).
qu'en matière de recherche, la mutation actuelle risque d'accroître le poids
relatif des intérêts privés. Il est connu, et nous l'avons déjà dit, que l'on
n'a jamais, en France, assisté au développement de gros laboratoires
exclusivement incorporés à l'industrie privée comme c'est le cas aux
Etats-Unis. Ainsi, le C.N.R.S. est une grande organisation nationale destinée
à centraliser et à coordonner les recherches, dont l'organisation et les buts
ont été clairement définis (ordonnance du 2 novembre 1945) et plusieurs
fois précisés depuis (décrets du 9. décembre 1959).
D'ailleurs, cette conception unificatrice et rationnelle de
l'organisation de la recherche est, en fait, contestée par l'existence d'un
certain nombre d'organismes de tutelle et de contrôle (le Comité national
de la recherche scientifique est réduit à un rôle consultatif par l'existence
du Comité consultatif de la recherche scientifique et technique, composé
de douze membres choisis par le gouvernement), tous ces organismes
étant eux-mêmes coiffés par la D.R.G.S.T., qui gère en particulier le fond de
développement et dépend dans une certaine mesure du Premier ministre.
Nous savons qu'il y a là un premier moyen d'intervention ouverte pour
l'organisation de la recherche est, en fait, contestée par l'existence d'un
certain nombre d'organismes de tutelle et de contrôle (le Comité national
de la recherche scientifique est réduit à un rôle consultatif par l'existence
du Comité consultatif de la recherche scientifique et technique, composé
de douze membres choisis par le gouvernement), tous ces organismes
étant eux-mêmes coiffés par la D.R.G.S.T., qui gère en particulier le fond de
développement et dépend dans une certaine mesure du Premier ministre.
Nous savons qu'il y a là un premier moyen d'intervention ouverte pour
l'industrie, qui a le souci essentiel d'améliorer la compétitivité. « La com-
mission « recherche scientifique et technique » a porté une grande atten-
tion aux besoins de recherche définis par les commissions à compétence
économique et s'est efforcée de déterminer les moyens à mettre en
œuvre pour permettre aux entreprises d'améliorer leur compétitivité. *
(Annexe au Ve Plan, p. 36.)
mission « recherche scientifique et technique » a porté une grande atten-
tion aux besoins de recherche définis par les commissions à compétence
économique et s'est efforcée de déterminer les moyens à mettre en
œuvre pour permettre aux entreprises d'améliorer leur compétitivité. *
(Annexe au Ve Plan, p. 36.)
Le premier moyen est l'apport d'un soutien financier aux
entreprises privées : « Le soutien financier considérable fourni par le
gouvernement américain à ces types de recherche oblige aujourd'hui
toute nation industrielle qui veut garder une certaine autonomie technique
et valoriser les meilleurs résultats de ses laboratoires à soutenir l'effort
de l'industrie par une aide financière publique complémentaire. » (Annexe
du Ve Plan, p. 37.)
entreprises privées : « Le soutien financier considérable fourni par le
gouvernement américain à ces types de recherche oblige aujourd'hui
toute nation industrielle qui veut garder une certaine autonomie technique
et valoriser les meilleurs résultats de ses laboratoires à soutenir l'effort
de l'industrie par une aide financière publique complémentaire. » (Annexe
du Ve Plan, p. 37.)
Il faudrait, ici, faire une analyse des nouvelles initiatives que
vient de prendre le gouvernement gaulliste en invoquant la nécessaire
modernisation des structures : nous voulons parler d'une part, du projet
de loi — voté d'ailleurs — concernant la création de trois nouveaux
organismes : le C.N.E.X.O., l'I.R.I.A. (placés sous l'autorité du Premier
ministre) et l'A.N.V.A.R. (agence de valorisation de la recherche) dont le
budget sera prélevé sur celui du C.N.R.S., et d'autre part, de la politique
de l'informatique que le gouvernement essaie de promouvoir à travers
l'élaboration du Plan calcul. Nous dirons seulement quelques mots sur ce
dernier point. On en comprend l'importance puisque programme nucléaire
et programme spatial dépendent étroitement des moyens de calcul dont
les Américains ont aujourd'hui le quasi-monopole ; dans ce domaine, le
gouvernement français se heurte et se heurtera à la politique des diri-
geants U.S. et aux problèmes de la concurrence. Il faut ramener ici les
prétentions gaullistes à leurs justes dimensions ; comme le fait remar-
quer l'éditorialiste de la revue «Atomes» (235) : «Qu'il s'agisse de pro-
grammes scientifiques, de programmes économiques ou d'organisation
stratégique, la protection des secrets est difficile. Un fournisseur étranger
qui, comme I.B.M., fournit 70 % du marché peut être à bon droit considéré
comme un observateur gênant. «
vient de prendre le gouvernement gaulliste en invoquant la nécessaire
modernisation des structures : nous voulons parler d'une part, du projet
de loi — voté d'ailleurs — concernant la création de trois nouveaux
organismes : le C.N.E.X.O., l'I.R.I.A. (placés sous l'autorité du Premier
ministre) et l'A.N.V.A.R. (agence de valorisation de la recherche) dont le
budget sera prélevé sur celui du C.N.R.S., et d'autre part, de la politique
de l'informatique que le gouvernement essaie de promouvoir à travers
l'élaboration du Plan calcul. Nous dirons seulement quelques mots sur ce
dernier point. On en comprend l'importance puisque programme nucléaire
et programme spatial dépendent étroitement des moyens de calcul dont
les Américains ont aujourd'hui le quasi-monopole ; dans ce domaine, le
gouvernement français se heurte et se heurtera à la politique des diri-
geants U.S. et aux problèmes de la concurrence. Il faut ramener ici les
prétentions gaullistes à leurs justes dimensions ; comme le fait remar-
quer l'éditorialiste de la revue «Atomes» (235) : «Qu'il s'agisse de pro-
grammes scientifiques, de programmes économiques ou d'organisation
stratégique, la protection des secrets est difficile. Un fournisseur étranger
qui, comme I.B.M., fournit 70 % du marché peut être à bon droit considéré
comme un observateur gênant. «
II faut remarquer enfin que, selon le même éditorialiste, ni
les conditions financières ni les conditions techniques ne sont réunies ;
le plan calcul est en quelque sorte un concentré de tous les problèmes
que pose aujourd'hui la volonté de développer une « politique nationale de
la science » (concentration, compétitivité, niveau de productivité, division
internationale du travail, problème des débouchés). (Les 500 millions
d'investissements prévus représentent un peu moins du dixième du
total moyen annuel des dépenses de R. et D. prévues par le Plan.)
les conditions financières ni les conditions techniques ne sont réunies ;
le plan calcul est en quelque sorte un concentré de tous les problèmes
que pose aujourd'hui la volonté de développer une « politique nationale de
la science » (concentration, compétitivité, niveau de productivité, division
internationale du travail, problème des débouchés). (Les 500 millions
d'investissements prévus représentent un peu moins du dixième du
total moyen annuel des dépenses de R. et D. prévues par le Plan.)
Les dangers de l'économisme dans les pseudo-critiques
de la politique de la bourgeoisie en matière
de recherche et d'enseignement
Dans l'enseignement supérieur, activités de recherche et
d'enseignement sont (ou devraient être) étroitement liées. Nous allons à
ce propos préciser encore quelques notions importantes. Pour cela, rappe-
lons d'abord que l'on peut résumer le sens de la réforme dans l'enseigne-
ment supérieur en la caractérisant — en première approximation —,
comme une tentative d'adapation de l'Université aux besoins de l'économie
capitaliste. Les différents ministres de la recherche ou de l'Education
nationale ont depuis bien longtemps exprimé cette idée : * Le plan gouver-
nemental est issu d'un long travail de réflexion. Certaines constatations
avaient fait apparaître, à l'évidence, que les structures de l'Université ne
se trouvaient plus parfaitement adaptées aux conditions de notre temps. »
(C. Fouchet, Note sur le projet de Réforme de l'Enseignement supérieur,
nov. 1964.)
d'enseignement sont (ou devraient être) étroitement liées. Nous allons à
ce propos préciser encore quelques notions importantes. Pour cela, rappe-
lons d'abord que l'on peut résumer le sens de la réforme dans l'enseigne-
ment supérieur en la caractérisant — en première approximation —,
comme une tentative d'adapation de l'Université aux besoins de l'économie
capitaliste. Les différents ministres de la recherche ou de l'Education
nationale ont depuis bien longtemps exprimé cette idée : * Le plan gouver-
nemental est issu d'un long travail de réflexion. Certaines constatations
avaient fait apparaître, à l'évidence, que les structures de l'Université ne
se trouvaient plus parfaitement adaptées aux conditions de notre temps. »
(C. Fouchet, Note sur le projet de Réforme de l'Enseignement supérieur,
nov. 1964.)
Nous pensons avoir suffisamment insisté sur ce que sont
« les conditions de notre temps » pour ne pas y revenir ici. Le ministre a,
depuis, précisé souvent le fond de sa pensée sur ce point : « L'Education
nationale entend répondre aux besoins de l'économie. » (Conférence de
presse du 14 février 1966.) C'est en partant de ce principe que le V° Plan
« les conditions de notre temps » pour ne pas y revenir ici. Le ministre a,
depuis, précisé souvent le fond de sa pensée sur ce point : « L'Education
nationale entend répondre aux besoins de l'économie. » (Conférence de
presse du 14 février 1966.) C'est en partant de ce principe que le V° Plan
52
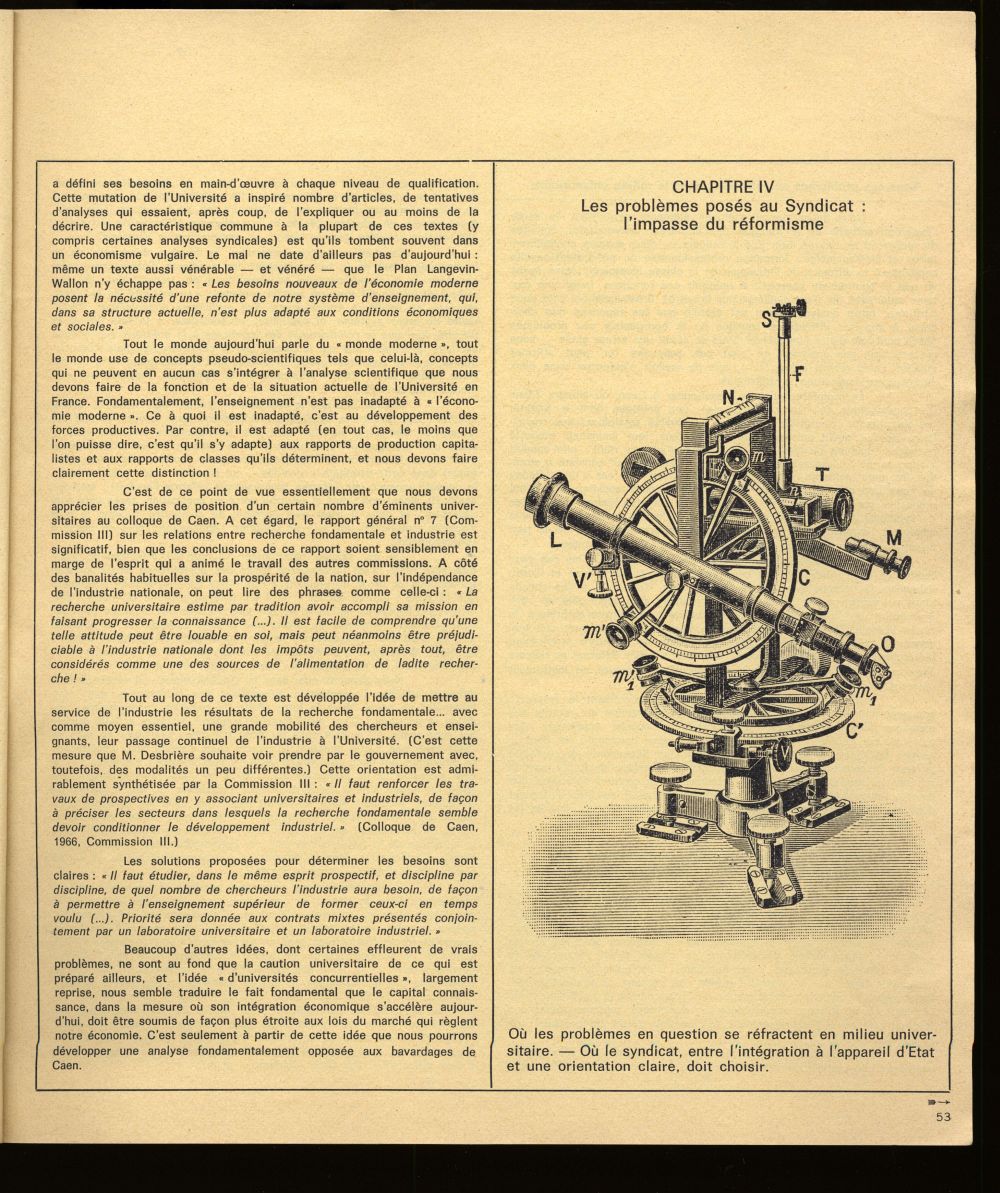

a défini ses besoins en main-d'œuvre à chaque niveau de qualification.
Cette mutation de l'Université a inspiré nombre d'articles, de tentatives
d'analyses qui essaient, après coup, de l'expliquer ou au moins de la
décrire. Une caractéristique commune à la plupart de ces textes (y
compris certaines analyses syndicales) est qu'ils tombent souvent dans
un économisme vulgaire. Le mal ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui :
même un texte aussi vénérable — et vénéré — que le Plan Langevin-
Wallon n'y échappe pas : « Les besoins nouveaux de l'économie moderne
posent la nécessité d'une refonte de notre système d'enseignement, qui,
dans sa structure actuelle, n'est plus adapté aux conditions économiques
et sociales. »
Cette mutation de l'Université a inspiré nombre d'articles, de tentatives
d'analyses qui essaient, après coup, de l'expliquer ou au moins de la
décrire. Une caractéristique commune à la plupart de ces textes (y
compris certaines analyses syndicales) est qu'ils tombent souvent dans
un économisme vulgaire. Le mal ne date d'ailleurs pas d'aujourd'hui :
même un texte aussi vénérable — et vénéré — que le Plan Langevin-
Wallon n'y échappe pas : « Les besoins nouveaux de l'économie moderne
posent la nécessité d'une refonte de notre système d'enseignement, qui,
dans sa structure actuelle, n'est plus adapté aux conditions économiques
et sociales. »
Tout le monde aujourd'hui parle du « monde moderne », tout
le monde use de concepts pseudo-scientifiques tels que celui-là, concepts
qui ne peuvent en aucun cas s'intégrer à l'analyse scientifique que nous
devons faire de la fonction et de la situation actuelle de l'Université en
France. Fondamentalement, l'enseignement n'est pas inadapté à « l'écono-
mie moderne ». Ce à quoi il est inadapté, c'est au développement des
forces productives. Par contre, il est adapté (en tout cas, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il s'y adapte) aux rapports de production capita-
listes et aux rapports de classes qu'ils déterminent, et nous devons faire
clairement cette distinction !
le monde use de concepts pseudo-scientifiques tels que celui-là, concepts
qui ne peuvent en aucun cas s'intégrer à l'analyse scientifique que nous
devons faire de la fonction et de la situation actuelle de l'Université en
France. Fondamentalement, l'enseignement n'est pas inadapté à « l'écono-
mie moderne ». Ce à quoi il est inadapté, c'est au développement des
forces productives. Par contre, il est adapté (en tout cas, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'il s'y adapte) aux rapports de production capita-
listes et aux rapports de classes qu'ils déterminent, et nous devons faire
clairement cette distinction !
C'est de ce point de vue essentiellement que nous devons
apprécier les prises de position d'un certain nombre d'éminents univer-
sitaires au colloque de Caen. A cet égard, le rapport général n° 7 (Com-
mission III) sur les relations entre recherche fondamentale et industrie est
significatif, bien que les conclusions de ce rapport soient sensiblement en
marge de l'esprit qui a animé le travail des autres commissions. A côté
des banalités habituelles sur la prospérité de la nation, sur l'indépendance
de l'industrie nationale, on peut lire des phrases comme celle-ci : « La
recherche universitaire estime par tradition avoir accompli sa mission en
faisant progresser la connaissance (...). Il est facile de comprendre qu'une
telle attitude peut être louable en soi, mais peut néanmoins être préjudi-
ciable à l'industrie nationale dont les impôts peuvent, après tout, être
considérés comme une des sources de l'alimentation de ladite recher-
che ! »
apprécier les prises de position d'un certain nombre d'éminents univer-
sitaires au colloque de Caen. A cet égard, le rapport général n° 7 (Com-
mission III) sur les relations entre recherche fondamentale et industrie est
significatif, bien que les conclusions de ce rapport soient sensiblement en
marge de l'esprit qui a animé le travail des autres commissions. A côté
des banalités habituelles sur la prospérité de la nation, sur l'indépendance
de l'industrie nationale, on peut lire des phrases comme celle-ci : « La
recherche universitaire estime par tradition avoir accompli sa mission en
faisant progresser la connaissance (...). Il est facile de comprendre qu'une
telle attitude peut être louable en soi, mais peut néanmoins être préjudi-
ciable à l'industrie nationale dont les impôts peuvent, après tout, être
considérés comme une des sources de l'alimentation de ladite recher-
che ! »
Tout au long de ce texte est développée l'idée de mettre au
service de l'industrie les résultats de la recherche fondamentale... avec
comme moyen essentiel, une grande mobilité des chercheurs et ensei-
gnants, leur passage continuel de l'industrie à l'Université. (C'est cette
mesure que M. Desbrière souhaite voir prendre par le gouvernement avec,
toutefois, des modalités un peu différentes.) Cette orientation est admi-
rablement synthétisée par la Commission III : « // faut renforcer les tra-
vaux de prospectives en y associant universitaires et industriels, de façon
à préciser les secteurs dans lesquels la recherche fondamentale semble
devoir conditionner le développement industriel, » (Colloque de Caen,
1966, Commission III.)
service de l'industrie les résultats de la recherche fondamentale... avec
comme moyen essentiel, une grande mobilité des chercheurs et ensei-
gnants, leur passage continuel de l'industrie à l'Université. (C'est cette
mesure que M. Desbrière souhaite voir prendre par le gouvernement avec,
toutefois, des modalités un peu différentes.) Cette orientation est admi-
rablement synthétisée par la Commission III : « // faut renforcer les tra-
vaux de prospectives en y associant universitaires et industriels, de façon
à préciser les secteurs dans lesquels la recherche fondamentale semble
devoir conditionner le développement industriel, » (Colloque de Caen,
1966, Commission III.)
Les solutions proposées pour déterminer les besoins sont
claires : « II faut étudier, dans le même esprit prospectif, et discipline par
discipline, de quel nombre de chercheurs l'industrie aura besoin, de façon
à permettre à l'enseignement supérieur de former ceux-ci en temps
voulu (...). Priorité sera donnée aux contrats mixtes présentés conjoin-
tement par un laboratoire universitaire et un laboratoire industriel. »
claires : « II faut étudier, dans le même esprit prospectif, et discipline par
discipline, de quel nombre de chercheurs l'industrie aura besoin, de façon
à permettre à l'enseignement supérieur de former ceux-ci en temps
voulu (...). Priorité sera donnée aux contrats mixtes présentés conjoin-
tement par un laboratoire universitaire et un laboratoire industriel. »
Beaucoup d'autres idées, dont certaines effleurent de vrais
problèmes, ne sont au fond que la caution universitaire de ce qui est
préparé ailleurs, et l'idée « d'universités concurrentielles », largement
reprise, nous semble traduire le fait fondamental que le capital connais-
sance, dans la mesure où son intégration économique s'accélère aujour-
d'hui, doit être soumis de façon plus étroite aux lois du marché qui règlent
notre économie. C'est seulement à partir de cette idée que nous pourrons
développer une analyse fondamentalement opposée aux bavardages de
Caen.
problèmes, ne sont au fond que la caution universitaire de ce qui est
préparé ailleurs, et l'idée « d'universités concurrentielles », largement
reprise, nous semble traduire le fait fondamental que le capital connais-
sance, dans la mesure où son intégration économique s'accélère aujour-
d'hui, doit être soumis de façon plus étroite aux lois du marché qui règlent
notre économie. C'est seulement à partir de cette idée que nous pourrons
développer une analyse fondamentalement opposée aux bavardages de
Caen.
CHAPITRE IV
Les problèmes posés au Syndicat :
l'impasse du réformisme
l'impasse du réformisme
Où les problèmes en question se réfractent en milieu univer-
sitaire. — Où le syndicat, entre l'intégration à l'appareil d'Etat
et une orientation claire, doit choisir.
sitaire. — Où le syndicat, entre l'intégration à l'appareil d'Etat
et une orientation claire, doit choisir.
53
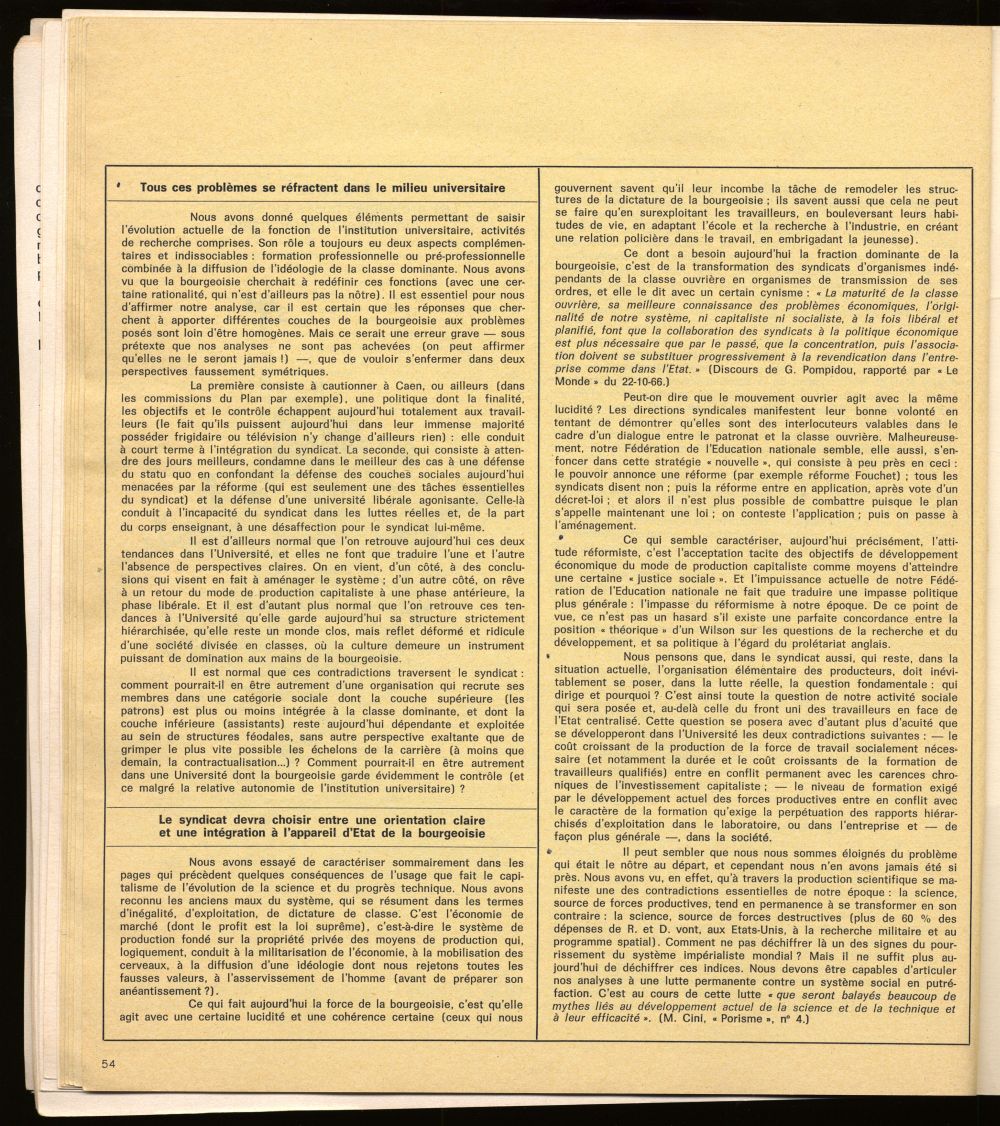

Tous ces problèmes se réfractent dans le milieu universitaire
Nous avons donné quelques éléments permettant de saisir
l'évolution actuelle de la fonction de l'institution universitaire, activités
de recherche comprises. Son rôle a toujours eu deux aspects complémen-
taires et indissociables : formation professionnelle ou pré-professionnelle
combinée à la diffusion de l'idéologie de la classe dominante. Nous avons
vu que la bourgeoisie cherchait à redéfinir ces fonctions (avec une cer-
taine rationalité, qui n'est d'ailleurs pas la nôtre). Il est essentiel pour nous
d'affirmer notre analyse, car il est certain que les réponses que cher-
chent à apporter différentes couches de la bourgeoisie aux problèmes
posés sont loin d'être homogènes. Mais ce serait une erreur grave — sous
prétexte que nos analyses ne sont pas achevées (on peut affirmer
qu'elles ne le seront jamais !) —, que de vouloir s'enfermer dans deux
perspectives faussement symétriques.
l'évolution actuelle de la fonction de l'institution universitaire, activités
de recherche comprises. Son rôle a toujours eu deux aspects complémen-
taires et indissociables : formation professionnelle ou pré-professionnelle
combinée à la diffusion de l'idéologie de la classe dominante. Nous avons
vu que la bourgeoisie cherchait à redéfinir ces fonctions (avec une cer-
taine rationalité, qui n'est d'ailleurs pas la nôtre). Il est essentiel pour nous
d'affirmer notre analyse, car il est certain que les réponses que cher-
chent à apporter différentes couches de la bourgeoisie aux problèmes
posés sont loin d'être homogènes. Mais ce serait une erreur grave — sous
prétexte que nos analyses ne sont pas achevées (on peut affirmer
qu'elles ne le seront jamais !) —, que de vouloir s'enfermer dans deux
perspectives faussement symétriques.
La première consiste à cautionner à Caen, ou ailleurs (dans
les commissions du Plan par exemple), une politique dont la finalité,
les objectifs et le contrôle échappent aujourd'hui totalement aux travail-
leurs (le fait qu'ils puissent aujourd'hui dans leur immense majorité
posséder frigidaire ou télévision n'y change d'ailleurs rien) : elle conduit
à court terme à l'intégration du syndicat. La seconde, qui consiste à atten-
dre des jours meilleurs, condamne dans le meilleur des cas à une défense
du statu quo en confondant la défense des couches sociales aujourd'hui
menacées par la réforme (qui est seulement une des tâches essentielles
du syndicat) et la défense d'une université libérale agonisante. Celle-là
conduit à l'incapacité du syndicat dans les luttes réelles et, de la part
du corps enseignant, à une désaffection pour le syndicat lui-même.
les commissions du Plan par exemple), une politique dont la finalité,
les objectifs et le contrôle échappent aujourd'hui totalement aux travail-
leurs (le fait qu'ils puissent aujourd'hui dans leur immense majorité
posséder frigidaire ou télévision n'y change d'ailleurs rien) : elle conduit
à court terme à l'intégration du syndicat. La seconde, qui consiste à atten-
dre des jours meilleurs, condamne dans le meilleur des cas à une défense
du statu quo en confondant la défense des couches sociales aujourd'hui
menacées par la réforme (qui est seulement une des tâches essentielles
du syndicat) et la défense d'une université libérale agonisante. Celle-là
conduit à l'incapacité du syndicat dans les luttes réelles et, de la part
du corps enseignant, à une désaffection pour le syndicat lui-même.
Il est d'ailleurs normal que l'on retrouve aujourd'hui ces deux
tendances dans l'Université, et elles ne font que traduire l'une et l'autre
l'absence de perspectives claires. On en vient, d'un côté, à des conclu-
sions qui visent en fait à aménager le système ; d'un autre côté, on rêve
à un retour du mode de production capitaliste à une phase antérieure, la
phase libérale. Et il est d'autant plus normal que l'on retrouve ces ten-
dances à l'Université qu'elle garde aujourd'hui sa structure strictement
hiérarchisée, qu'elle reste un monde clos, mais reflet déformé et ridicule
d'une société divisée en classes, où la culture demeure un instrument
puissant de domination aux mains de la bourgeoisie.
tendances dans l'Université, et elles ne font que traduire l'une et l'autre
l'absence de perspectives claires. On en vient, d'un côté, à des conclu-
sions qui visent en fait à aménager le système ; d'un autre côté, on rêve
à un retour du mode de production capitaliste à une phase antérieure, la
phase libérale. Et il est d'autant plus normal que l'on retrouve ces ten-
dances à l'Université qu'elle garde aujourd'hui sa structure strictement
hiérarchisée, qu'elle reste un monde clos, mais reflet déformé et ridicule
d'une société divisée en classes, où la culture demeure un instrument
puissant de domination aux mains de la bourgeoisie.
Il est normal que ces contradictions traversent le syndicat :
comment pourrait-il en être autrement d'une organisation qui recrute ses
membres dans une catégorie sociale dont la couche supérieure (les
patrons) est plus ou moins intégrée à la classe dominante, et dont la
couche inférieure (assistants) reste aujourd'hui dépendante et exploitée
au sein de structures féodales, sans autre perspective exaltante que de
grimper le plus vite possible les échelons de la carrière (à moins que
demain, la contractualisation...) ? Comment pourrait-il en être autrement
dans une Université dont la bourgeoisie garde évidemment le contrôle (et
ce malgré la relative autonomie de l'institution universitaire) ?
comment pourrait-il en être autrement d'une organisation qui recrute ses
membres dans une catégorie sociale dont la couche supérieure (les
patrons) est plus ou moins intégrée à la classe dominante, et dont la
couche inférieure (assistants) reste aujourd'hui dépendante et exploitée
au sein de structures féodales, sans autre perspective exaltante que de
grimper le plus vite possible les échelons de la carrière (à moins que
demain, la contractualisation...) ? Comment pourrait-il en être autrement
dans une Université dont la bourgeoisie garde évidemment le contrôle (et
ce malgré la relative autonomie de l'institution universitaire) ?
Le syndicat devra choisir entre une orientation claire
et une intégration à l'appareil d'Etat de la bourgeoisie
et une intégration à l'appareil d'Etat de la bourgeoisie
Nous avons essayé de caractériser sommairement dans les
pages qui précèdent quelques conséquences de l'usage que fait le capi-
talisme de l'évolution de la science et du progrès technique. Nous avons
reconnu les anciens maux du système, qui se résument dans les termes
d'inégalité, d'exploitation, de dictature de classe. C'est l'économie de
marché (dont le profit est la loi suprême), c'est-à-dire le système de
production fondé sur la propriété privée des moyens de production qui,
logiquement, conduit à la militarisation de l'économie, à la mobilisation des
cerveaux, à la diffusion d'une idéologie dont nous rejetons toutes les
fausses valeurs, à l'asservissement de l'homme (avant de préparer son
anéantissement ?).
pages qui précèdent quelques conséquences de l'usage que fait le capi-
talisme de l'évolution de la science et du progrès technique. Nous avons
reconnu les anciens maux du système, qui se résument dans les termes
d'inégalité, d'exploitation, de dictature de classe. C'est l'économie de
marché (dont le profit est la loi suprême), c'est-à-dire le système de
production fondé sur la propriété privée des moyens de production qui,
logiquement, conduit à la militarisation de l'économie, à la mobilisation des
cerveaux, à la diffusion d'une idéologie dont nous rejetons toutes les
fausses valeurs, à l'asservissement de l'homme (avant de préparer son
anéantissement ?).
Ce qui fait aujourd'hui la force de la bourgeoisie, c'est qu'elle
agit avec une certaine lucidité et une cohérence certaine (ceux qui nous
agit avec une certaine lucidité et une cohérence certaine (ceux qui nous
gouvernent savent qu'il leur incombe la tâche de remodeler les struc-
tures de la dictature de la bourgeoisie ; ils savent aussi que cela ne peut
se faire qu'en surexploitant les travailleurs, en bouleversant leurs habi-
tudes de vie, en adaptant l'école et la recherche à l'industrie, en créant
une relation policière dans le travail, en embrigadant la jeunesse).
tures de la dictature de la bourgeoisie ; ils savent aussi que cela ne peut
se faire qu'en surexploitant les travailleurs, en bouleversant leurs habi-
tudes de vie, en adaptant l'école et la recherche à l'industrie, en créant
une relation policière dans le travail, en embrigadant la jeunesse).
Ce dont a besoin aujourd'hui la fraction dominante de la
bourgeoisie, c'est de la transformation des syndicats d'organismes indé-
pendants de la classe ouvrière en organismes de transmission de ses
ordres, et elle le dit avec un certain cynisme : « La maturité de la classe
ouvrière, sa meilleure connaissance des problèmes économiques, l'origi-
nalité de notre système, ni capitaliste ni socialiste, à la fois libéral et
planifié, font que la collaboration des syndicats à la politique économique
est plus nécessaire que par le passé, que la concentration, puis l'associa-
tion doivent se substituer progressivement à la revendication dans l'entre-
prise comme dans l'Etat. » (Discours de G. Pompidou, rapporté par « Le
Monde » du 22-10-66.)
bourgeoisie, c'est de la transformation des syndicats d'organismes indé-
pendants de la classe ouvrière en organismes de transmission de ses
ordres, et elle le dit avec un certain cynisme : « La maturité de la classe
ouvrière, sa meilleure connaissance des problèmes économiques, l'origi-
nalité de notre système, ni capitaliste ni socialiste, à la fois libéral et
planifié, font que la collaboration des syndicats à la politique économique
est plus nécessaire que par le passé, que la concentration, puis l'associa-
tion doivent se substituer progressivement à la revendication dans l'entre-
prise comme dans l'Etat. » (Discours de G. Pompidou, rapporté par « Le
Monde » du 22-10-66.)
Peut-on dire que le mouvement ouvrier agit avec la même
lucidité ? Les directions syndicales manifestent leur bonne volonté en
tentant de démontrer qu'elles sont des interlocuteurs valables dans le
cadre d'un dialogue entre le patronat et la classe ouvrière. Malheureuse-
ment, notre Fédération de l'Education nationale semble, elle aussi, s'en-
foncer dans cette stratégie « nouvelle », qui consiste à peu près en ceci :
le pouvoir annonce une réforme (par exemple réforme Fouchet) ; tous les
syndicats disent non ; puis la réforme entre en application, après vote d'un
décret-loi ; et alors il n'est plus possible de combattre puisque le plan
s'appelle maintenant une loi ; on conteste l'application ; puis on passe à
l'aménagement.
lucidité ? Les directions syndicales manifestent leur bonne volonté en
tentant de démontrer qu'elles sont des interlocuteurs valables dans le
cadre d'un dialogue entre le patronat et la classe ouvrière. Malheureuse-
ment, notre Fédération de l'Education nationale semble, elle aussi, s'en-
foncer dans cette stratégie « nouvelle », qui consiste à peu près en ceci :
le pouvoir annonce une réforme (par exemple réforme Fouchet) ; tous les
syndicats disent non ; puis la réforme entre en application, après vote d'un
décret-loi ; et alors il n'est plus possible de combattre puisque le plan
s'appelle maintenant une loi ; on conteste l'application ; puis on passe à
l'aménagement.
* Ce qui semble caractériser, aujourd'hui précisément, l'atti-
tude réformiste, c'est l'acceptation tacite des objectifs de développement
économique du mode de production capitaliste comme moyens d'atteindre
une certaine « justice sociale ». Et l'impuissance actuelle de notre Fédé-
ration de l'Education nationale ne fait que traduire une impasse politique
plus générale : l'impasse du réformisme à notre époque. De ce point de
vue, ce n'est pas un hasard s'il existe une parfaite concordance entre la
position •• théorique » d'un Wilson sur les questions de la recherche et du
développement, et sa politique à l'égard du prolétariat anglais.
économique du mode de production capitaliste comme moyens d'atteindre
une certaine « justice sociale ». Et l'impuissance actuelle de notre Fédé-
ration de l'Education nationale ne fait que traduire une impasse politique
plus générale : l'impasse du réformisme à notre époque. De ce point de
vue, ce n'est pas un hasard s'il existe une parfaite concordance entre la
position •• théorique » d'un Wilson sur les questions de la recherche et du
développement, et sa politique à l'égard du prolétariat anglais.
> Nous pensons que, dans le syndicat aussi, qui reste, dans la
situation actuelle, l'organisation élémentaire des producteurs, doit inévi-
tablement se poser, dans la lutte réelle, la question fondamentale : qui
dirige et pourquoi ? C'est ainsi toute la question de notre activité sociale
qui sera posée et, au-delà celle du front uni des travailleurs en face de
l'Etat centralisé. Cette question se posera avec d'autant plus d'acuité que
se développeront dans l'Université les deux contradictions suivantes : •— le
coût croissant de la production de la force de travail socialement néces-
saire (et notamment la durée et le coût croissants de la formation de
travailleurs qualifiés) entre en conflit permanent avec les carences chro-
niques de l'investissement capitaliste ; — le niveau de formation exigé
par le développement actuel des forces productives entre en conflit avec
le caractère de la formation qu'exigé la perpétuation des rapports hiérar-
chisés d'exploitation dans le laboratoire, ou dans l'entreprise et — de
façon plus générale —, dans la société.
tablement se poser, dans la lutte réelle, la question fondamentale : qui
dirige et pourquoi ? C'est ainsi toute la question de notre activité sociale
qui sera posée et, au-delà celle du front uni des travailleurs en face de
l'Etat centralisé. Cette question se posera avec d'autant plus d'acuité que
se développeront dans l'Université les deux contradictions suivantes : •— le
coût croissant de la production de la force de travail socialement néces-
saire (et notamment la durée et le coût croissants de la formation de
travailleurs qualifiés) entre en conflit permanent avec les carences chro-
niques de l'investissement capitaliste ; — le niveau de formation exigé
par le développement actuel des forces productives entre en conflit avec
le caractère de la formation qu'exigé la perpétuation des rapports hiérar-
chisés d'exploitation dans le laboratoire, ou dans l'entreprise et — de
façon plus générale —, dans la société.
• II peut sembler que nous nous sommes éloignés du problème
qui était le nôtre au départ, et cependant nous n'en avons jamais été si
près. Nous avons vu, en effet, qu'à travers la production scientifique se ma-
nifeste une des contradictions essentielles de notre époque : la science,
source de forces productives, tend en permanence à se transformer en son
contraire : la science, source de forces destructives (plus de 60 % des
dépenses de R. et D. vont, aux Etats-Unis, à la recherche militaire et au
programme spatial). Comment ne pas déchiffrer là un des signes du pour-
rissement du système impérialiste mondial ? Mais il ne suffit plus au-
jourd'hui de déchiffrer ces indices. Nous devons être capables d'articuler
nos analyses à une lutte permanente contre un système social en putré-
faction. C'est au cours de cette lutte - que seront balayés beaucoup de
mythes liés au développement actuel de la science et de la technique et
à leur efficacité ». (M. Cini, « Porisme », n° 4.)
près. Nous avons vu, en effet, qu'à travers la production scientifique se ma-
nifeste une des contradictions essentielles de notre époque : la science,
source de forces productives, tend en permanence à se transformer en son
contraire : la science, source de forces destructives (plus de 60 % des
dépenses de R. et D. vont, aux Etats-Unis, à la recherche militaire et au
programme spatial). Comment ne pas déchiffrer là un des signes du pour-
rissement du système impérialiste mondial ? Mais il ne suffit plus au-
jourd'hui de déchiffrer ces indices. Nous devons être capables d'articuler
nos analyses à une lutte permanente contre un système social en putré-
faction. C'est au cours de cette lutte - que seront balayés beaucoup de
mythes liés au développement actuel de la science et de la technique et
à leur efficacité ». (M. Cini, « Porisme », n° 4.)
54
Category
Title
Niveau 3
Issue
no.3
Date
05/1968
Keywords
Publication information
no.3